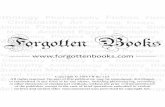enseignement français à l'étranger - recommandations visant ...
Hypothèses sur le e svarabhaktique, la métathèse et l’instabilité du r en ancien français
Transcript of Hypothèses sur le e svarabhaktique, la métathèse et l’instabilité du r en ancien français
Hypothèses sur le e svarabhaktique, la métathèse et l’instabilité du /r/ en ancien français
Oreste FLOQUET, SAPIENZA, Università di Roma (DSEAI, Dipartimento di studi Europei, Americani e Interculturali)
1. Introduction
On considère généralement qu’en ancien français l’insertion vocalique (le type prendrai ~ prenderai) et la métathèse (le type mustrerai ~ muster(r)ai) sont deux phénomènes optionnels tout à fait distincts. Le but de cet article est de présenter quelques considérations essayant de les reconduire à une cause commune d’ordre phonétique, à savoir l’affaiblissement du /r/.
C’est parce qu’ils ont fait l’objet d’analyses essentiellement morpholo-giques que ces deux processus ont pu être interprétés séparément. Si l’on voit les choses sous un angle purement verbal, il est vrai que l’on ne peut pas confondre l’insertion vocalique, qui touche aux conjugaisons autres qu’en –er/–ier, avec la métathèse, qui ne concerne, en revanche, que les futurs des verbes en –er/–ier et les infinitifs1. À cet argument Andrieux et Baumgartner (1983: 40-41) en ajoutent un autre qui relève de l’analyse mor-phophonologique: le type prendrai ~ prenderai présente un élargissement de la base alors que le type mustrerai ~ muster(r)ai est du ressort des transforma-tions de la consonne finale de base:
Malgré l’identité des résultats, on est en droit de distinguer l’apparition de e «svarabhaktique» des réalisations vocaliques de r; cela en raison des différences des phénomènes phonétiques et de la permutation de e et r, possible seulement dans le deuxième cas.
Et cependant, l’on repère tant l’ajout vocalique que l’interversion au niveau aussi bien nominal qu’adjectival. Pour ce qui est du e svarabhaktique on rencontre des formes nominales ou adjectivales, telles que averil, cheverols,
1 Voir Tanquerey (1915: 794-795).
156 Oreste Floquet
esperit, feverier, ivere, liveres, maisterie, peiveres, verai, vesperes dans les plus anciens textes, ce qui prouve, du moins à nos yeux, que le phénomène n’est pas cantonné exclusivement dans le domaine verbal. Pour reprendre les mots de Morin (1980: 222, n. 19):
Dans le Roland, il est difficile de voir dans le e de vulderat une voyelle thématique. [...] Il est plus vraisemblable que ce e soit dans la langue de Roland une sorte de voyelle épen-thétique, plus ou moins morphologisée. Ailleurs dans le manuscrit, elle n’apparaît que dans les groupe [-vr-]: dans les verbes receivre, deveir, muveir, aveir, estuveir, où elle a la po-sition d’une voyelle thématique, mais aussi dans recuverer recuperare, recoeverement, uverir p r re, Severin, liverent l b rant, livere l bra, où elle n’a aucune interprétation morpholo-
gique possible.
La métathèse aussi est une tendance assez précoce qui s’affirme tantôt dans la sphère verbale tantôt dans la sphère nominale2:
(1) De icez berbiz une pernez (Saint Brendan, v. 399)
(2) E al rei Loëwis porta dous espreviers (La Vie de Saint Thomas Becket, v. 2179)
On peut ajouter les formes bregeronnette, couvreture, gouvrener, pernont, tavrenier attestant tant la permutation CVR > CRV que l’inverse CRV > CVR3.
Sans soutenir qu’il s’agit de la même règle, on essaiera essentiellement de montrer que la source commune à ces deux phénomènes est l’instabilité du /r/ apical et vibrant dans les contextes de muta cum liquida et de coda sylla-bique, ce qui permet, à notre avis, de les traiter conjointement4.
2 Sur la métathèse en ancien picard voir Gossen (1970: 114). 3 Dorénavant: C correspond à consonne obstruante, R à consonne rhotique, V à
voyelle, L à consonne latérale. 4 On pourrait objecter qu’après tout, dans le processus d’ajout vocalique, on n’insère
que la voyelle e, alors que dans la métathèse, la forme porpre citée dans Görlich (1882: 79) montre, par exemple, qu’il n’y a pas de restrictions vocaliques. Mais de toute évi-dence les formes avec e sont largement majoritaires.
Hypothèses sur le e svarabhaktique 157
2. Le e svarabhaktique5
Phénomène essentiellement circonscrit aux dialectes du Nord, de l’Ouest et au français d’Angleterre, l’apparition d’une voyelle svarabhaktique est une règle optionnelle ne concernant que les attaques syllabiques CR:
(3) /t/ + /r/: estrai ~ esterai
(4) /d/ + /r/: prendrai ~ prenderai
(5) /b/ + /r/: marbrin ~ marberin
(6) /p/ + /r/: esprit ~ esperit
(7) /v/ + /r/: avrai ~ averai
(8) /f/ + /r/: offrendes ~ offerendes
Plus précisément, il existe une restriction concernant les obstruantes puisque la règle est bloquée si la consonne est une vélaire:
(9) /k/ + /r/: veinkre ~ *veinkere
(10) /g/ + /r/: megre ~ *megere
Au vu de notre corpus de référence (comprenant tous les textes du Anglo Norman Hub, dorénavant ANH6, ainsi que le Voyage de Charlemagne7 et les Year Books8), des grammaires et des études disponibles, il semblerait que, dans les contextes vélaire + rhotique, ce e est tardif et, par ailleurs, marqué d’un point de vue phonologique (seulement la consonne sourde /k/), lexi-cal (/anker/ et /vakr-/) et diaphasique (plus fréquent dans le registre infor-mel)9:
5 Un premier sondage sur le comportement de la voyelle svarabhaktique se trouve dans
Floquet (à paraître). 6 http://www.anglo-norman.net. 7 Il viaggio di Carlomagno in Oriente. Bonafin M. (éd), Pratiche, Parma,19933. 8 Narrations et dialogues en français ancien: The Anglo-Norman Year Books Corpus. Ingham, R.
& Larrivé, P. (éds), CD-Rom. 9 Les variantes du ANH qui figurent dans l’apparat des éditions n’ont jamais été prises
en considération.
158 Oreste Floquet
(11) ankerage, ankerages, ankerrage, hankerage, hankerages 94 occurrences Portbooks (XVe), Northern petitions (fin XIIIe jusqu’au XVe)
(12) ankeres, ankers, ancers 7 occurrences Portbooks, John of Gaunt’s Register (XIVe), Register of Daniel Rough (XIVe)
(13) Wakerer, vakereour 33 occurrences Liber Albus, Foedera, La lumere as Lais, Le Livere de Reis De Brittanie, Britton, The Statutes of the Realm
Par conséquent, la règle n’opère que si la consonne est [+ coronal]. D’un point de vue quantitatif, les formes contenant e ne sont pas mino-
ritaires; en voici quelques exemples suivis de leur nombre d’occurrences dans le ANH:
occ. occ.averai 20 esterai 1avrai averez avrez prenderai prendrai
46 208 101 1 22
estrai offerendes offrendes esperit esprit
0 1 5 224 17
Tableau 1
Les formes les plus fréquentes sont celles qui résistent le mieux en diachro-nie. Dans les Year Books, qui vont de 1292 à 1390, on constate, par exemple:
occ.averez avrez
146 0
esperit esprit
2 0
Tableau 2
Hypothèses sur le e svarabhaktique 159
Chose surprenante, il existe des formes de la même aire dialectale contenant le groupe muta cum liquida où le / / lexical semblerait avoir disparu; la forme sous-jacente étant C R plutôt que CR, la règle ne peut pas opérer10:
occ.ferai frai
98 94
ferez frez derein drein
51 57 63 73
Tableau 3 Il s’agit d’un processus inverse à l’apparition d’un élément svarabhakti, car on a manifestement affaire à une érosion vocalique: C R > CR. Comme on aura l’occasion de le montrer par la suite, l’alternance ferai ~ frai (ou aiderai ~ aidrai) entretient toutefois des rapports assez étroits avec l’épenthèse et la métathèse. On propose d’y voir une allomorphie, impliquant une base longue et une base courte, due à l’instabilité de la prononciation du /r/ et de sa syllabation, dont l’effet serait de faciliter les ré-analyses11.
Au vu des oscillations syllabiques dans les textes versifiés, la forme gra-phique avec svarabhakti pouvant ou pas compter dans la mesure du vers, on est en droit de se demander si les graphies avec ou sans e (qu’elles aient
10 D’après Tanquerey (1915: 795), il pourrait s’agir d’une métathèse à cause de la forme
freez. Toutefois c’est Tanquerey (1915: 213) lui-même qui signale l’existence d’un mor-phème /eez/; on peut ajouter qu’on repère ce morphème dans des contextes où il n’y a pas eu de métathèse: porteez, avereez. Sur cette question, voir aussi Andrieux-Reix & Pellat (2006).
11 En l’occurrence, C R serait ré-interprété comme une variante de CR.
160 Oreste Floquet
une origine CR ou bien C R) renvoient réellement à un contenu phonique univoque ou plutôt à une double prononciation12:
(14) [av rej] averai [avrej]
[f rej] ferai [frej]
[av rej] avrai [avrej]
[f rej] frai [frej]
Dans les formes graphiques contenant un e svarabhaktique (le type averai) ou bien un e lexical (le type ferai), la voyelle n’a pas toujours de consistance phonétique. En (15), par exemple, la voyelle ne compte pas, si bien que averez est bisyllabiques, comme s’il s’agissait de la forme sans voyelle sva-rabhaktique avrez:
(15) e averez le cultel que Deus tint al manger (V.de. Ch., v.180) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En (16) et (17), en revanche, averez et ferez comptent trois syllabes:
(16) asez averez e sanz custe (Saint Brendan, v.585) 1 2 3 4 5 6 7 8
(17) or voil saver des altres si ferunt ensement (V.de. Ch., v.758) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venons-en aux formes graphiques sans e (les types avrai et frai)13. L’exemple (18) montre que la forme frai, graphiquement d’une seule syllabe, en com-porte phonétiquement deux, puisqu’autrement le vers serait hypomètre:
(18) Pur lui irrai, sil frai prendre (Gaimar, v. 6518) 1 2 3 4 5 6 7 [-1]
En (19), on voit que frez peut être aussi monosyllabique: 12 Sur la distance entre graphie et phonie dans le français d’Angleterre, voir Rothwell
(2004) et Short (2007); concernant les graphies de la nasale palatale, voir Floquet (2010).
13 Sur cet aspect voir aussi Tanquerey (1915: 726) qui souligne surtout qu’à la fin du XIIe siècle le plus grand nombre de e svarabhaktique est purement graphique, du moins en anglo-normand.
Hypothèses sur le e svarabhaktique 161
(19) vous en frez enaprés solom le vostre avis (Alexander, v.181) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En (20), la forme courte avrez vaut trois syllabes métriques: (20) Pez avrez de vos veisins (Protheselaus, v. 206) 1 2 3 4 5 6 7 [-1]
En (21), elle vaut deux syllabes: (21) E si joe lunges vif mut grant prou i avrez (Horn, v. 64) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Finalement il faut rappeler que, bien que de façon sporadique, le e intrusif fait son apparition aussi dans le groupe CL (le type sablin > sabelin):
(22) Les tabeles sunt drecees, et sunt alet manger (V. de Ch. v. 832)
Voici quelques données du ANH:
occ. capitele14 nobel- sabel-
7 5 15
Tableau 4
3. La métathèse
Un premier sondage prenant en considération les séquences nominales et verbales, à partir du ANH, montre qu’en anglo-normand les permutations
14 Sur l’alternance l~r (chapitre ~chapitle) voir infra.
162 Oreste Floquet
CRV > CVR sont plus nombreuses que les formes contraires où CVR de-vient CRV15:
occ.brebis16 berbis krenu kernu merkredi me(r)kerdi17 mustrerai musterrai prenez pernez
4 57 1 9 17 51 11 17 3 139
Tableau 5
occ. aperc- aprec- gouver- gouvre- esperviers espreviers
0 4 163 0 30 1
Tableau 6 15 La plupart de ces formes sont citées dans Gossen (1970: 114). 16 Par souci de clarté, on évite de reproduire toutes les graphies possibles aussi bien de la
base que de la désinence. On ne compte jamais les variantes en apparat. 17 Une telle forme ne se trouve pas dans les textes littéraires.
Hypothèses sur le e svarabhaktique 163
Cela est d’autant plus remarquable que Gossen (1970: 114) considère qu’en ancien picard le type esperviers > espreviers (CVR > CRV) est majoritaire par rapport à prenons > pernons (CRV > CVR); toutefois il ne compte pas les métathèses affectant les verbes au futur et au conditionnel (le type mustrerai ~ muster(r)ai) au motif qu’il s’agit là d’un phénomène interrégional (excepté les dialectes du Sud-Est), ce qui est confirmé par Fouché (1967) et indirec-tement par Görlich (1882).
En ce qui concerne les vélaires, l’adjectif kernu semble suggérer que l’inversion est possible, encore que rare, comme pour le svarabhakti. Toute-fois il faut noter que krenu18, sans métathèse, n’est pas un adjectif mais un nom signifiant la crinière. Et d’ailleurs plusieurs alternances picardes vélaire + RV ~ vélaire + VR, citées par Gossen (1970), ne sont pas attestées dans le ANH, ce qui laisse supposer que la forme lexicale contient déjà la sé-quence /k r/; la règle, donc, n’opère pas: eskermir, kernel, gernon19. Finale-ment, comme pour le e intrusif, la règle n’opère que si la consonne est co-ronale.
De toute évidence, il faudra mener des enquêtes plus approfondies, en élargissant le corpus (tant du point de vue quantitatif que diatopique) ainsi qu’en passant au peigne fin toutes les variantes possibles. Ce n’est donc qu’avec beaucoup de cautèle qu’on peut affirmer que si on additionne toutes les occurrences nominales et verbales, le changement CRV > CVR est massivement plus présent et actif par rapport à CVR donnant CRV. Centrale pour notre propos, une telle observation, si elle devait être confir-mée, permettrait de voir dans le groupe CR l’épicentre à partir duquel un certain nombre de ré-analyses se sont développées, et qui ont atteint, dans un deuxième temps, les séquences CVR:
phase-A phase-Bvoyelle intrusive: prenderai metathèse-A: berbis
réduction: frai métathèse-B: espreviers
Tableau 7
18 Une seule occurrence dans Horn. 19 On trouve ces formes-là déjà dans les plus anciens textes littéraires. Par ailleurs,
l’inversion kerstienté < krestienté n’est pas attestée.
164 Oreste Floquet
4. Interprétation phonologique
Il s’agit maintenant de vérifier la possibilité qu’il y ait une source commune aux deux phénomènes en question auxquels on peut ajouter la réduction ferai > frai.
On pourrait supposer une tendance prosodique améliorant les contacts syllabiques20. En phonologie naturelle, par exemple, on considère que l’épenthèse sert à instaurer un rapport de sonorité optimal entre les seg-ments. Voici les cas cités par Venneman (1988: 54):
ancien haut-germanique: zeswa > zesawa (zes.wa > ze.sa.wa) anglais non standard: athlete > ath[ ]lete (ath.lete > a.th[ ].lete) italien: fantasma > fantasima (fan.tas.ma > fan.ta.si.ma)21
Toutefois le même raisonnement appliqué à pren.de.rai (< pren.drai) et mus.ter.rai (< mus.tre.rai) s’avère paradoxal puisque l’on scinderait le groupe CR qui est souvent considéré comme étant l’une des meilleures attaques syllabiques possibles. De notre côté, on essaiera de proposer une explica-tion différente visant à considérer l’interaction entre les segments, en l’occurrence les séquences CRV et CVR, et les réajustements inévitables qui ont fait suite à l’instabilité de /r/. En gros, tant l’apparition d’un élément svarabhakti que l’inversion segmentale seraient conditionnés par un certain nombre de changements qui ont touché premièrement la consonne rho-tique et qui par ricochet ont eu des effets sur la dynamique syllabique. A la base il y a l’idée que les séquences CR sont devenues phonétiquement ins-tables et perceptivement opaques si bien qu’elles ont été ré-analysées de différentes manières22. Comme on va le voir par la suite, une telle approche permet aussi de fournir une explication plausible à l’alternance ferai ~ frai où manifestement la schwa est susceptible de tomber.
C’est un fait notoire, d’ailleurs, combien il est difficile de trouver un dé-nominateur commun à toute la famille des rhotiques au motif de leur nature
20 Cf. Tanquerey (1915: 727), pour qui le svarabhakti sert à améliorer la prononciation
d’un groupe de consonnes sans allonger perceptiblement la longueur du mot. 21 Il s’agit d’une variante non standard. 22 Il faut rappeler que pour Tanquerey (1915: 795) la métathèse est occasionnée par la
centralisation de la voyelle mi-fermée [e].
Hypothèses sur le e svarabhaktique 165
phonétique assez hétéroclite, le /r/ pouvant être vibrant, dévibré, fricatif, approximant quant au mode d’articulation; dental, alvéolaire, post-alvéolaire, rétroflexe ou uvulaire quant au lieu d’articulation. À tout cela s’ajoute son comportement phonologique spécifique, puisque le /r/ peut être vocalique ou pas et ses allophones peuvent alterner tantôt en synchro-nie tantôt en diachronie. Le fonctionnement de rhotiques étant tellement peu clair qu’on a pu se questionner sur le bien-fondé de leur existence en tant que classe naturelle: /r/ est-il une fiction? Ne pouvant pas retracer tout ce débat et les diverses propositions qui ont été avancées (le /r/ est un trait à lui seul, le /r/ est un lieu d’articulation, le /r/ est un trait sous-spécifié, etc.), on se borne à signaler la position de Weise (2001: 349) selon laquelle on ne peut définir le /r/ comme un segment au même titre que /t/, par exemple, mais plutôt comme une position prosodique de l’échelle de sono-rité à la lisière d’une part des consonnes latérales et d’autre part des voyelles, vu que:
[...] the «essence» of /r/ lies not in its segmental features, but exactly in the domain of its distributional patterning: /r/ is a prosody.
Pour nos fins, il suffit de retenir que l’élasticité phonétique des rhotiques est un facteur qui ne peut ne pas avoir des répercussions sur l’interaction entre les segments et donc sur la syllabe.
Depuis toujours, on considère que le r graphique médiéval ne corres-pond qu’à la polivibrante [r] apico-dentale assez bien répandue dans toute la Romania. D’après Straka (1979), l’évolution française de [r] jusqu’à [R] ne remonterait qu’au XVIIe siècle et s’inscrirait dans un procès plus général d’affaiblissement du [r]. Entre [r] et [R] il existe d’ailleurs tout un conti-nuum de réalisations où seulement certaines séquences sont possibles:
(s1) [r] > [ ] > [ð] > [z]
(s2) [r] > [R] > [z] > Ø23
(s3) [r] > [l] > Ø
23 Pour Straka (1979) il n’y aurait amuïssement complet que dans les positions finale et
implosive, rarement intervocalique.
166 Oreste Floquet
L’instabilité de la vibrante est depuis longtemps un fait acquis, du moins pour la période successive au Moyen Age24. Ceci a été récemment réaffirmé par Morin (2005) pour qui, dans la langue du XVIe siècle, le r final pouvait être ou bien battu (ou bien peut-être déjà fricatif) dans les terminaisons [e ] issues des vibrantes anciennement intervocaliques ou bien vibré dans les terminaisons [ r] remontant à un bref latin, à un a devant rn, soit encore à une diphtongue ai. Notre interprétation vise à anticiper tous ces change-ments et s’inspire largement, pour la partie théorique, des travaux connec-tionnistes sur la syllabe en français contemporain de Laks (1995), sur la syllabe en italien de Calderone & Bertinetto (2006) ainsi que sur la théorie de la dissimilation de Ohala (1992). L’hypothèse explicative est la suivante: Le /r/ vibrant et apical entre dans une zone de turbulence25; cela a des répercussions sur la syllabation (ce qui expliquerait l’apparition d’un ajout vocalique), ainsi que sur la perception (ce qui expliquerait la métathèse) des attaques CR. Les métathèses de type B ainsi que les réductions de type ferai > frai, ne seraient donc que des effets secondaires dus à une interprétation du groupe C R comme dérivant de CR.
4.1 Voyelle intrusive et modèle connexionniste
Jusque-là, on n’a rien dit de la nature phonologique de ce processus d’insertion vocalique qu’on a appelé de manière générique épenthèse. A ce propos, les études de Hall (2003 et 2006) argumentent en faveur d’une dis-tinction théorique entre une voyelle épenthétique et une voyelle svarabak-thique qui est, à proprement parler, une voyelle intrusive (a) déclenchée par un groupe consonantique contenant une sonorante (on exclut les gémi-nées), (b) réalisée le plus souvent comme schwa sans valeur syllabique, (c) effacée en raison de la vitesse. Une telle particule neutre n’est donc pas un segment indépendant mais un bruit formantique tout à fait superficiel se différenciant d’une voyelle épenthétique dans la mesure où elle ne peut
24 Voir Vising, (1899), Andersson, (1899), Haden (1955), Fox (1958), Martinet (1969),
Lozachmeur (1976), De Jong (2006), Short (2007). 25 On peut rappeler les rimes sage: larges chez Philippe de Thaon, voir Pope (1952: 450);
ou bien les formes prioré > priolé, prior > prios, Charles > Chales signalées par Görlich (1882: 79).
Hypothèses sur le e svarabhaktique 167
apparaître qu’en proximité de certains groupes consonantiques avec sono-rante. A la différence d’une insertion parasite, la vraie voyelle épenthétique peut disjoindre n’importe quel groupe consonantique (de préférence ceux qui sont phonétiquement marqués) et de ce fait elle peut devenir le noyau d’une nouvelle syllabe. Or, le modèle connexionniste permet de donner une explication plausible à l’apparition du schwa intrusif prenant en considéra-tion la dynamique syllabique. L’idée maitresse de Laks (1995) est que les segments ont une valeur tantôt intrinsèque (allant d’un minimum de sonori-té pour les obstruantes à un maximum de sonorité pour les voyelles: obs-truantes > liquides > glides > voyelles), tantôt contextuelle, résultant des modifications réciproques (par exemple, dans une suite S1+ S2+ S3, la valeur de S2 est influencée et par S1 et par S3: S1 > S2 < S3). Plus précisément, soient deux consonnes C1 et C2 ayant leur force a-contextuelle de base; au moment où elles interagissent, leur sonorité va se transformer de la sorte: (a) si C1 domine C2 puisqu’elle est moins sonore, on aura alors un contact tautosyllabique, respectant la tendance à avoir des syllabes à sonorité crois-sante (typiquement CV), ce qui est le propre des séquences muta cum liquida: valeur intrinsèque valeur contextuelleC1: obstruante C2: liquide
C2 C1
C2 est sonorisé par C1
Tableau 8
(b) à l’inverse, si c’est C2 qui domine C1, les deux consonnes se dissocient donnant un contact hétérosyllabique: valeur intrinsèque valeur contextuelleC1 = C2: obstruante C1
C2
C2 sonorise C1
Tableau 9
168 Oreste Floquet
Puisque le modèle prévoit une syllabation tautosyllabique non marquée pour le groupe muta cum liquida, le /r/ étant sans conteste plus sonore déjà au niveau non contextuel, il s’ensuit, par voie de conséquence, que toute syllabation différente présuppose un changement de sonorité de la part ou des obstruantes ou de la liquide. On avance l’hypothèse qu’il y a eu un af-faiblissement de l’une des deux consonnes dont la conséquence a été le passage d’une syllabation tautosyllabique CRV. (tableau 8) à une syllabation marquée de type hétérosyllabique C.RV (tableau 9): a.vrai > av.rai. Après ce stade intermédiaire, on a pu assister à l’apparition d’un ajout vocalique, qui n’est que l’indice d’une re-syllabification ultérieure: av.rai > a.ve.rai.26 Si une telle hypothèse est juste, il reste à expliquer laquelle des deux consonnes a changé de sonorité. Au vu de la lacune dans les rencontres entre consonnes vélaires et vibrantes, qui ne développent presque jamais de voyelle parasite, il est vraisemblable que la modification ait concerné plutôt le /r/27. C’est un fait notoire que le changement ar > er (asparagus > asperge) témoignerait d’une tendance à la postériorisation du /r/ dans un registre non standard bien avant le XVIIe siècle, date à partir de laquelle on date le passage de [r] à [R]28. Pour ce qui est du phénomène qui nous occupe, il nous semble très difficile de trancher la question de la nature phonétique de la rhotique et on se borne à intégrer à l’approche connexionniste la théorie de la dissimilation de Ohala (1992), selon laquelle l’épenthèse vocalique serait une réaction à une proximité phonétique excessive entre les segments29. Il s’ensuit que, outre la possibilité déjà mentionnée qu’il soit postérieur (et donc déjà [R]), le /r/ pourrait aussi avoir développé des allophones antérieurs: monovi-brant [ ], approximant [ ] ou bien fricatif [ð]. Ces phones sont assez
26 Sur l’oscillation de la syllabation du groupe CR dans l’histoire des langues romanes,
voir Loporcaro (2005) et Russo (dans ce volume). 27 Le schéma interprétatif pourrait être le même pour sablin > sabelin, l’affaiblissement de
l (ce qui devrait donner la variante amuïe [ ]) déclenchant l’émergence du schwa. Tou-tefois, comme on va le voir, il y a lieu d’invoquer aussi d’autres solutions, surtout pour ce qui est des épenthèses dans le groupe CL.
28 Voir Pope (1952: 188) et De Jong (2006: 153). 29 Si deux segments ont beaucoup de traits distinctifs en commun, cela augmente la
possibilité d’une stratégie de dissimilation visant à restaurer leur distance.
Hypothèses sur le e svarabhaktique 169
proches des obstruantes et des fricatives labio-dentales30, ce qui pourrait facilement expliquer et le phénomène de dissimilation et l’exclusion des vélaires dans ce processus. Un autre argument en faveur d’une diminution de la force de /r/, tout en restant dans la zone antérieure, est représenté par les rares alternances l ~r: epistle ~ epistre, titles ~ titres, apostles ~ apostres31.
Quoi qu’il en soit de la qualité phonétique du /r/, il reste à comprendre pourquoi et comment le schwa parasite, phénomène superficiel, a pu être progressivement légitimé au niveau phonologique32.
Ce qui nous paraît intéressant est le fait que la plupart des insertions vo-caliques concernent une portion du lexique ancien français de registre for-mel et dont la base latine originaire contient une voyelle. Voici un tableau avec les bases latines et les exemples en ancien français contenant la voyelle parasite:
latin ancien français prehendere habere offerre vesper,vesperis marmoreus, a, um tabula, ae capitulum, i titulus, i sabulum, i
svarabhakti C R svarabhakti C L
prender- aver- offerendes vesperes merberin tabele capitele titele sabelin
Tableau 10
30 Faire état des spécifications des ces phones, tout en sachant qu’ils alternent souvent
entre eux, n’est pas sans difficultés. Sur cette question épineuse voir Laver (1994) et Hall (1997).
31 D’après Pope (1952: 230), la dissimilation CL > CR remonte au Gallo-roman. Le changement inverse CR > CL est donc successif.
32 Sur la chronologie du e, voir surtout le résumé synthétique dans Tanquerey (1915: 780-784).
170 Oreste Floquet
L’instabilité du /r/ étant un fait assez bien répandu dans toutes les langues, le problème se pose de savoir ce qui a permis à ce schwa intrusif de se sta-biliser au niveau systémique33. On se demande donc si la progressive im-plantation d’une voyelle svarabhaktique n’aurait pas été facilitée par une fausse étymologie avec les bases latines agissant aussi dans les formes du type titres > titles qu’on vient de mentionner34. L’idée est que la tendance naturelle du /r/ à développer un schwa épenthétique a été secondée par un deuxième facteur d’ordre analogique: la forme écrite latine35. Outre l’aspect phonétique, on propose de prendre en considération aussi une espèce d’hypercorrectisme dû à l’interférence du code écrit sur le code oral (effet Buben)36. Voici en guise de synthèse les étapes du processus de phonologi-sation; on peut les diviser en deux parties, l’une concernant les modifica-tions intrinsèques (e1-e2) et l’autre concernant le changement de valeur linguistique (e3-e4)37: (e1) niveau phonétique non systémique: turbulence du /r/; (e2) niveau phonétique non systémique: apparition facultative du schwa;
33 A nos yeux, la thèse de Keller (1976), pour qui l’apparition d’une voyelle parasite est
due au substrat germanique, est tout à fait acceptable bien que partielle; non seulement parce qu’on repère ce type d’épenthèse ailleurs dans la Romania, mais plutôt parce qu’elle évite de se pencher sur la spécificité d’un tel phénomène et des causes possibles de sa phonologisation. Si le changement linguistique est toujours la manifestation dans le système de quelque chose qui existe déjà mais qui doit obtenir son «droit de cité», le point crucial est de savoir ce qui a facilité sa légitimation.
34 Une telle hypothèse permettrait d’expliquer aussi les quelques rares formes graphiques relevées par Tanquerey (1915: 444) comme respondire, avec un i latinisant (< lat. dic re) au lieu de e. Notons au passage que Tanquerey cite bevire et prendire (qui toutefois ne sont pas attestés dans le ANH) et que, comme il le laisse entendre lui-même d’ailleurs, au vu de la tradition manuscrite, vivire est probablement une erreur.
35 Ce qui laisse entrevoir, si confirmé, que c’est dans un milieu très cultivé que ce phé-nomène a pu commencer à être formalisé.
36 Sur l’effet Buben en français, et en général sur l’ingérence de la mémoire de l’écrit sur la prononciation, voir Chevrot & Malderez (1999) et Laks (2005).
37 Sur la distinction théorique entre une modification régulière (et superficielle) et un changement qui, en revanche, affecte plus profondément la structure, voir les proposi-tions sur les différentes intensités des transformations des mondes dans Badiou (2006: 383-401).
Hypothèses sur le e svarabhaktique 171
(e3) ré-analyse du schwa comme faisant partie de la forme lexicale; in-fluence de la graphie sur la phonie (effet Buben);
(e4) niveau systémique: stabilisation du schwa donnant lieu à une allomor-phie.
4.2 Métathèse et indétermination
Depuis que la théorie phonologique a remis en question la conviction selon laquelle la métathèse ne serait pas un phénomène naturel, on a pu com-mencer à repérer, encore que de façon sporadique, des ressemblances avec d’autres phénomènes phonologiques, notamment l’épenthèse vocalique. Blevins et Garret (1998: 548), par exemple, plaident en faveur d’un type particulier de métathèse voyelle + consonne dont l’origine est perceptive et se base sur le fait que si les outputs sont phonétiquement ambigus, ils peu-vent donner lieu à une ré-analyse de la distribution des segments. Par le même raisonnement on peut expliquer aussi le processus d’insertion voca-lique:
Perceptual metathesis is closely related to similarly conditioned vowel epenthesis and long-distance movement. All three types of sound change involve the same limited set of segment types and have their origins in these segments’ long durational cues, which can span entire syllables or even strings of syllables.
Suivant une théorie qui remonte à Ohala, Blevins et Garret (1998: 550), voient dans l’indétermination phonétique et dans la dissimilation les deux moteurs et de la métathèse et de l’épenthèse:
In our view, sound changes result from misinterpretation: X changes to Y when X is misinterpreted – and phonologically internalized, and therefore later produces – as Y. The cause of misinterpretation is perceptual similarity (which may itself have articulatory or other causes).
De son côté, Hume (2004: 209) aussi considère l’instabilité phonétique des segments comme une condition nécessaire à l’émergence de la métathèse, à laquelle elle ajoute le fait que la nouvelle combinaison syllabique doit faire partie de l’inventaire des syllabiques possibles de la langue examinée:
I suggest that for metathesis to occur, two conditions must be met. First, there must be indeterminacy in the signal […] Second, the order of elements opposite to that occurring in the input must be an attested structure in the language.
172 Oreste Floquet
Il est assez remarquable que du côté de l’insertion vocalique, on a pu avan-cer plus ou moins les mêmes conditions. L’étude de Colantoni et Steele (2005), par exemple, propose une explication phonétique de l’apparition de la voyelle intrusive. Les attaques complexes sont assurément moins répan-dues et peuvent être simplifiées moyennant de multiples manières dont l’épenthèse. Dans cette perspective, l’ajout vocalique n’est qu’une stratégie de dissimilation: plus les deux segments ont des traits distinctifs en com-mun, plus la possibilité d’une insertion vocalique augmente38. A la base de cette explication, il y a encore une fois la théorie de Ohala (1992) pour qui la dissimilation n’est qu’une correction effectuée par l’auditeur en raison de la faible saillance perceptive des segments concernés. Puisqu’une telle dis-sociation ne peut pas être expliquée en termes d’amélioration articulatoire, il y a lieu plutôt d’invoquer la nature intrinsèque des traits: certaines sé-quences sont mieux perceptibles, d’autres, l’étant moins, deviennent poten-tiellement passibles d’être réinterprétées. On voit bien, donc, que l’on est en droit de rapprocher l’épenthèse et la métathèse; et la représentation phono-logique que Molinu (1999) donne de la métathèse du /r/ en sarde, envisa-gée non plus comme un simple problème d’ordre des éléments, mais plutôt comme le résultat de deux opérations plus profondes, permet, peut-être, de mieux saisir une telle ressemblance. D’après Molinu (1999), la métathèse est le fruit d’une élision et d’une insertion. L’élision, opère «dans le sens de la dissociation de /r/ de son unité temporelle»39. Au-delà des implications générales liées à la théorie des contraintes et des stratégies de réparations, il importe ici de constater que le changement de position du /r/ n’est que l’effet de son statut désormais flottant, du point de vue phonologique, et dont le corrélé phonétique, on peut le déduire aisément, est l’indétermination.
38 Dans un cadre théorique différent, mais où la dissimilation joue néanmoins un rôle
central, on signale l’interprétation des métathèses de /r/ en judéo-espagnol de Bradley (2007).
39 Molinu (1999: 158).
Hypothèses sur le e svarabhaktique 173
5 Considérations finales
Par-delà les aspects descriptifs, qui nécessitent des analyses toujours plus détaillées, le fil rouge de cette étude a été l’idée qu’un certain nombre de changements phonologiques du français médiéval ont une source phoné-tique commune concernant l’affaiblissement du /r/ dans le groupe CR. Il ne s’agit en aucun cas de soutenir que l’insertion vocalique dans les groupes CR, la métathèse de CR et de C R, ou l’alternance ferai ~ frai doivent fu-sionner dans une seule règle, mais plutôt que cette pluralité de stratégies de réparation et de ré-analyse morphologique ont probablement le même point de départ. Si une telle hypothèse est correcte, cela signifierait que, d’un point de vue diachronique, les premières transformations du /r/ – encore que non complètement abouties, aussi bien l’épenthèse d’une voyelle parasite que la métathèse étant toujours des tentatives de «restaurer» la sonorité du /r/– datent d’avant le XVIe siècle. Elles ne vont pas forcé-ment dans la direction de la postériorisation, mais peut-être dans la direc-tion de la dévibration ou de la fricativisation toujours dans la zone anté-rieure. D’un point de vue théorique, on peut ajouter qu’une telle explication implique tantôt l’émergence progressive du discontinu phonétique informel dans le continu structuré (la frontière phonétique/phonologie n’étant pas toujours très nette), tantôt la corrélation de la phonologie avec d’autres champs de recherche (notamment le domaine socioculturel, en ce qui con-cerne le e svarabhaktique), ce qui est, somme toute, en accord avec une approche constructiviste et holistique de la langue, de sa variation ainsi que de son histoire40.
40 Sur les approches phonologiques dites réalistes et continuistes, à la base de cette étude,
voir Albano Leoni (2009), Coleman (2002), Laks (2004).
174 Oreste Floquet
Bibliographie
Albano Leoni, F. (2009): Dei suoni e dei sensi: il volto fonico delle parole. Il Mulino, Bologna.
Andersson, H. (1899): «Réponse à M. J. Vising», Romania 28, 592-597. Andrieux, N. & Baumgartner, E. (1983): Systèmes morphologiques de l’ancien
français. Editions Bière, Bordeaux. Andrieux-Reix, N. & Pellat, J.-Ch. (2006): «Histoire d’É ou de la variation
des usages graphiques à la différenciation réglée». Langue française 151, 7-24.
Badiou, A. (2006): Logiques des mondes, Seuil, Paris. Blevins, J. & Garrett, A. (1998): «The Origins of Consonant-Vowel Meta-
thesis», Language 74, 508-556. Bradley, T. (2007): «Constraints on the metathesis of sonorant consonants
in Judeo-Spanish», Probus 19, 171-207. Calderone, B. & Bertinetto, P.M. (2006): «La sillaba come stabilizzatore di
forze fonotattiche. Una modellizzazione». Quaderni del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale di Pisa, http://linguistica.sns.it/QLL/ QLL06/Calderone_Bertinetto.PDF.
Chevrot, J.-P. & Mandelez, I. (1999): «L’effet Buben: de la linguistique dia-chronique à l’approche cognitive (et retour)», Langue française 124, 104-125.
Colantoni, L. & Steele, J. (2005): «Phonetically-driven epenthesis asymme-tries in French and Spanish obstruent-liquid clusters», in Gess, R. & Rubin, E. J., (éds), Theoretical and Experimental Approaches to Romance Lin-guistics. CILT 272, John Benjamins Publishing Company, Amster-dam/Philadelphia, 77-96.
Coleman, J. (2002): «Phonetic representation in the mental lexicon», in Durand, J. & Laks, B. (éds), Phonetics, Phonology and Cognition, Oxford University Press, Oxford, 96-130.
De Jong, Th. (2006): La prononciation des consonnes dans le français de Paris aux 13ème et 14ème siècles. Lot, Amsterdam.
Floquet, O. (2010): «Sur la nasale palatale et les rimes approximatives en anglo-normand», in Neveu, F., Muni Toke, V., Klingler, Th., Durand, J., Mondada, L. & Prévost, S., (éds), Actes du IIe Congrès Mondial de Linguis-
Hypothèses sur le e svarabhaktique 175
tique française, EDP Sciences, 1303-1315 (http://www.linguistiquefrancaise.org/).
– (à paraître): «Sull’ e parassita anglo-normanna nei nessi muta cum liquida», in Formisano, L. (éd), Culture, livelli di cultura e ambienti nel Medioevo occidentale, Atti del VII Convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza (Bologna, 5-8 ottobre 2009). Pàtron, Bologna.
Fouché, P. (1967): Le verbe français: étude morphologique. Klincksieck, Paris. Fox, J. (1958): «L’affaiblissement de R devant consonne dans la syllabe
protonique en moyen français», Revue de linguistique romane 22, 92-97. Görlich, E. (1882): Die südwestlichen Dialekte der Langue d’Oïl: Poitou, Aunis,
Saintonge und Angoumois. Gebr. Henningen, Heilbronn. Gossen, Th. (1970): Grammaire de l’ancien Picard. Klincksieck, Paris. Haden, E. F. (1955):«The uvular r in French», Language 31, 504-510. Hall, N. (2003): Gestures and Segments: Vowel Intrusion as Overlap. Doctoral
Dissertation, University of Massachusetts-Amherst, http://roa.rutgers.edu/view.php3?id=875.
– (2006): «Cross-linguistic patterns of vowel intrusion». Phonology 23, 387-429.
Hall, T.A. (1997): The Phonology of Coronals. CILT 149, John Benjamins Pub-lishing Company, Amsterdam/Philadelphia.
Hume, E. (2004): «The indeterminacy/Attestation Model of Metathesis», Language 80, 203-237.
Keller, H.-E. (1976): «Sur la possibilité de l’existence de traits phonétiques d’origine germaniques dans certains dialectes français de France», in Boudreault, M. & Möhren, F. (éds), Actes du XIIIème Congrès international de Linguistique et Philologie Romanes. Les Presses de l’Université de Laval, Québec, 499-514.
Laks, B. (1995): «A Connectionist Account of French Syllabification», Lin-gua 95, 56-75.
– (2004): «Phonétique et phonologie du continu au discontinu», Cahiers de Praxématique 42, 145-175.
– (2005): «La liaison et l’illusion», Langages 39, 101-125. Laver, J. (1994): Principles of Phonetics. Cambridge University Press, Cam-
bridge.
176 Oreste Floquet
Loporcaro, M. (2005): «La sillabazione di muta cum liquida dal latino al romanzo», in Kiss, S., Mondin L., et Salvi G., (éds), Latin et langues ro-manes: études de linguistique offertes à József Herman à l’occasion de son 80ème anni-versaire. Niemeyer, Tübingen, 419-430.
Lozachmeur, J.-Cl. (1976): «Contribution à l’étude de l’évolution de R», Revue de linguistique romane 40, 311-320.
Martinet, A. (1969): «R, du latin au français d’aujourd’hui», in Le Français sans fard. PUF, Paris, 132-143.
Molinu, L. (1999): «Métathèse et variation en sarde», Cahiers de grammaire 24, 153-181.
Morin, Y.-Ch. (1980): «Morphologisation de l’épenthèse en ancien français», Canadian journal of Linguistics 25, 204-225.
– (2005): «La naissance de la rime normande», in Murat, M. & Dangel, J. (éds), Poétique de la rime. Honoré Champion, Paris, 219-252.
Ohala, J. (1992): «What’s Cognitive, What’s Not, in Sound Change», Lingua e Stile 3, 321-362.
Pope, M.K. (1952): From Latin to Modern French with especial consideration of Anglo-Norman. Manchester University Press, Manchester.
Rothwell, W. (2004): «Ignorant scribe and learned editor: Patterns of textual error in editions of Anglo-French texts». http://www.anglo-norman.net/articlesA/.
Short, I. (2007): Manual of Anglo-Norman. Anglo Norman Text Society, London.
Straka, G. (1979): «Contribution à l’histoire de la consonne R en français», in Les sons et les mots, Klincksieck, Paris, 465-499.
Tanquerey, F. J. (1915): L’évolution du verbe en anglo-français. Champion, Paris. Vennemann, Th. (1988): Preference laws for syllable structure and the explanation of
sound change. Mouton de Gruyter, Berlin/New York. Vising, J. (1899): «L’amuïssement de l’R finale en français», Romania 28,
579-591. Weise, R. (2001): «The phonology of /r/», in Hall, T. A. (éd), Distinctive
feature theory. Mouton de Gruyter, Berlin, 335-368.