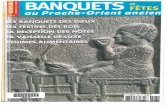Littérature et histoire du christianisme ancien
Transcript of Littérature et histoire du christianisme ancien
Eacuterudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composeacute de lUniversiteacute de Montreacuteal lUniversiteacute Laval et lUniversiteacute du Queacutebec agrave
Montreacuteal Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche Eacuterudit offre des services deacutedition numeacuterique de documents
scientifiques depuis 1998
Pour communiquer avec les responsables dEacuterudit eruditumontrealca
Article
Pierre Cardinal Serge Cazelais Eric Creacutegheur Lucian Dicircnca Steve Johnston Jonathan Ivon Kodar Paul-Hubert Poirier et Jennifer K WeesLaval theacuteologique et philosophique vol 64 ndeg 1 2008 p 169-207
Pour citer la version numeacuterique de cet article utiliser ladresse suivante httpideruditorgiderudit018539arNote les regravegles deacutecriture des reacutefeacuterences bibliographiques peuvent varier selon les diffeacuterents domaines du savoir
Ce document est proteacutegeacute par la loi sur le droit dauteur Lutilisation des services dEacuterudit (y compris la reproduction) est assujettie agrave sa politique
dutilisation que vous pouvez consulter agrave lURI httpwwweruditorgdocumentationeruditPolitiqueUtilisationpdf
Document teacuteleacutechargeacute le 3 feacutevrier 2010
laquo Litteacuterature et histoire du christianisme ancien raquo
Laval theacuteologique et philosophique 64 1 (feacutevrier 2008) 169-207
169
chronique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
En collaboration
Instrumenta studiorum
1 Reneacute HOVEN Lexique de la prose latine de la Renaissance Dictionary of Renaissance Latin from Prose Sources Deuxiegraveme eacutedition revue et consideacuterablement augmenteacutee avec la collabo-ration de Laurent GRAILET traduction anglaise de Coen MAAS revue par Karin RENARD-JADOUL Leiden Boston Koninklijke Brill NV 2006 LIX-683 p
Les eacutecrivains de la Renaissance ont creacuteeacute de nombreux neacuteologismes afin de nommer les innova-tions artistiques scientifiques litteacuteraires et juridiques de leur temps Quiconque srsquoaffaire agrave lire et agrave eacutetudier la litteacuterature de cette peacuteriode est confronteacute agrave ces nombreux mots latins inconnus de la langue classique et de la langue meacutedieacutevale et sent le besoin drsquoavoir recours agrave des outils de travail LrsquoA de ce lexique srsquoest donneacute comme mission de pallier ce manque
La premiegravere eacutedition de ce lexique en 1994 avait eacuteteacute bien reccedilue dans les milieux universitaires1 Cette deuxiegraveme eacutedition en ameacuteliore grandement lrsquoutiliteacute La nouveauteacute la plus remarquable est lrsquoinclu-sion drsquoune traduction anglaise destineacutee agrave laquo accroicirctre les possibiliteacutes de rayonnement de cette deuxiegraveme eacutedition raquo (p XIV) Il srsquoagit donc deacutesormais drsquoun lexique latin-franccedilais et latin-anglais Si 150 auteurs avaient eacuteteacute deacutepouilleacutes dans la premiegravere eacutedition la deuxiegraveme en compte maintenant plus de 230 cou-vrant la peacuteriode de Peacutetrarque (1304-1374) agrave Juste Lipse (dagger 1606) On note ainsi plusieurs nouveaux
Preacuteceacutedentes chroniques Laval theacuteologique et philosophique 45 (1989) p 303-318 46 (1990) p 246-268 48 (1992) p 447-476 49 (1993) p 533-571 51 (1995) p 421-461 52 (1996) p 863-909 55 (1999) p 499-530 57 (2001) p 121-182 337-365 563-604 58 (2002) p 357-394 613-639 59 (2003) p 369-388 541-582 60 (2004) p 163-177 363-378 61 (2005) p 175-205 363-393 62 (2006) 133-169 63 (2007) p 121-162
Ont collaboreacute agrave cette chronique Pierre Cardinal Serge Cazelais Eric Creacutegheur Lucian Dicircncă Steve Johnston Jonathan I von Kodar Paul-Hubert Poirier et Jennifer K Wees Cette chronique a eacuteteacute reacutedigeacutee par Eric Creacutegheur
1 Voir la recension critique et les remarques pertinentes au sujet de la deacutefinition du laquo neacuteo-latin raquo de Louis VALCKE dans Laval theacuteologique et philosophique 51 3 (1995) p 686-688
EN COLLABORATION
170
noms comme Giordano Bruno Copernic Paracelse et Veacutesale LrsquoA motive son choix des auteurs en affirmant qursquoil a chercheacute agrave privileacutegier ceux dont les œuvres ont eacuteteacute eacutediteacutees ou reacuteeacutediteacutees ces der-niegraveres deacutecennies et qui sont ainsi plus accessibles au public viseacute par ce lexique Le nombre de noti-ces passe de 8 500 agrave pregraves de 11 000 et inclut plus de 11 600 acceptions De plus ces notices sont mieux cibleacutees que dans la premiegravere eacutedition En effet Le Grand Gaffiot publieacute en 2000 avec son ap-port consideacuterable agrave la langue de lrsquoAntiquiteacute tardive bien que trop souvent deacutependant du Dictionnaire latin-franccedilais des auteurs chreacutetiens de Blaise a permis agrave lrsquoA et agrave son eacutequipe drsquoeacuteliminer quelques notices et acceptions de mots qui sont deacutesormais bien traiteacutees et documenteacutees dans le dictionnaire latin-franccedilais de base consacreacute agrave lrsquoAntiquiteacute LrsquoA mentionne tout de mecircme que cette deuxiegraveme eacutedi-tion compte encore pregraves de 1 600 mots qui sont preacutesents dans le Gaffiot mais qui sont employeacutes dans des sens diffeacuterents chez les auteurs de la Renaissance Ils sont preacuteceacutedeacutes du signe +
Chacune des entreacutees est preacutecise concise et srsquoattache agrave lrsquoessentiel le mot latin et ses principa-les variantes orthographiques le sens franccedilais et anglais puis une ou quelques reacutefeacuterences agrave une œuvre agrave un ou plusieurs auteurs ainsi que son origine eacutetymologique Agrave ce sujet un appendice inti-tuleacute laquo listes annexes reacutecapitulatives raquo est fort utile La premiegravere partie de cette annexe (p 605-618) classe les mots drsquoorigine non latine selon leur origine grecque proche-orientale (arabe arameacuteen heacutebreu perse turque) germanique romane slave hongroise et mecircme ameacuterindienne (par exemple chicha qui est une boisson fermenteacutee) Lrsquoappendice se poursuit ensuite jusqursquoagrave la page 655 avec des listes de diminutifs et de mots classeacutes drsquoapregraves divers suffixes ou terminaisons
Enfin lrsquoA offre en guise de couronnement aux pages 659-683 la reacuteeacutedition de son article intitu-leacute laquo Essai sur le vocabulaire neacuteo-latin de Thomas More raquo paru en 1998 dans Moreana 35 (1998) p 25-53
Il faut feacuteliciter et remercier Reneacute Hoven et son eacutequipe drsquoavoir produit un tel instrument de tra-vail remarquable tant par la qualiteacute de lrsquoinformation qursquoon y trouve que par celle de sa typographie et de sa mise en page Pour ma part je lrsquoutilise deacutejagrave avec un grand plaisir
Serge Cazelais
2 Cornelius MAYER eacuted Augustinus-Lexikon vol 3 fasc 34 Hieronymus-Institutio insti-tutum Reacutedaction par Andreas EJ Grote en association avec Robert Dodaro Franccedilois Dolbeau Volker Henning Drecoll Therese Fuhrer Wolfgang Huumlbner Martin Kloumlckener dagger Serge Lancel Goulven Madec Christof Muumlller James J OrsquoDonnell Alfred Schindler Antonie Wlosok Bacircle Schwabe AG Verlag 2006 col 321-640
Ce nouveau fascicule du lexique drsquoAugustin consacreacute agrave la fin de la lettre H et au deacutebut de la lettre I rassemble cinquante-six notices en plus de la fin de celle portant sur Jeacuterocircme et du deacutebut de lrsquoarticle laquo Institutio institutum raquo Comme il se doit toutes ces notices concernent Augustin drsquoune maniegravere ou drsquoune autre mais plusieurs drsquoentre elles deacutebordent le champ des eacutetudes augustiniennes et rejoindront un public plus large Ainsi celles qui sont reacuteserveacutees aux laquo Imperatores romani raquo ou agrave lrsquolaquo Imperium romanum raquo agrave laquo Historia raquo laquo Imago raquo laquo Idea raquo ou encore agrave des termes importants pour lrsquohistoire de lrsquoanthropologie chreacutetienne (laquo Homo raquo et laquo Inspiratio raquo) Parmi les quelques notices portant sur des eacutecrits notons celles de Franccedilois Dolbeau sur les deux listes anciennes des œuvres drsquoAugustin lrsquoIndiculum dont lrsquoexistence est attesteacutee par les Retractationes (II41) et lrsquoIndiculus qui figure agrave la fin de la Vita Augustini de Possidius Mentionnons aussi les deux contributions du re-gretteacute Serge Lancel sur laquo Hippo Diarrhytus raquo et surtout laquo Hippo Regius raquo le siegravege eacutepiscopal drsquoAu-gustin
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
171
3 Volker Henning DRECOLL eacuted Augustin Handbuch Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Theo-logen Handbuumlcher raquo) 2007 XIX-799 p
Cet laquo Augustin raquo qui paraicirct dans une collection de manuels consacreacutes agrave des theacuteologiens anciens et modernes se veut une introduction agrave la recherche augustinienne destineacutee aussi bien aux speacutecia-listes et aux eacutetudiants qursquoau large public des lecteurs drsquoAugustin Le plan qui a eacuteteacute retenu est sen-siblement le mecircme que pour le premier volume de la collection le Luther Handbuch Il se compose de quatre parties La premiegravere offre une orientation drsquoensemble dans la recherche sur Augustin et son œuvre On y trouvera une preacutesentation de la tradition manuscrite et des grandes entreprises eacutedi-toriales des outils de la recherche (bibliothegraveques dictionnaires et lexiques banques de donneacutees) et des institutions speacutecialiseacutees ainsi qursquoun bilan des acquis La deuxiegraveme partie est consacreacutee agrave la per-sonne drsquoAugustin le milieu (lrsquoAfrique romaine Rome et Milan) et la vie les traditions litteacuteraires philosophiques religieuses (dont le manicheacuteisme) theacuteologiques et eccleacutesiales qui ont forgeacute la per-sonnaliteacute drsquoAugustin son eacutevolution ses combats et les domaines ougrave il srsquoest illustreacute La troisiegraveme partie qui porte sur lrsquoœuvre est diviseacutee en trois sections La premiegravere constitue un inventaire suc-cinct des principaux eacutecrits drsquoAugustin la seconde une preacutesentation des grands thegravemes de sa penseacutee La derniegravere section de cette partie plus bregraveve examine quelques thegravemes laquo transversaux raquo dans la penseacutee drsquoAugustin comme le Dieu trinitaire lrsquoindividu et la communauteacute humaine lrsquoaction de Dieu dans lrsquohistoire La derniegravere partie de lrsquoouvrage est reacuteserveacutee agrave la Wirkungsgeschichte de lrsquoeacutevecirc-que drsquoHippone agrave son influence et agrave sa survie On y trouve des chapitres portant entre autres sur la Regula Augustini Anselme Abeacutelard les Sentences de Pierre Lombard lrsquoaugustinisme meacutedieacuteval Luther Calvin le mouvement arminien et lrsquoaugustinisme catholique de Baius agrave Janseacutenius Mecircme srsquoil preacutesente toutes les caracteacuteristiques drsquoun manuel cet ouvrage surtout dans ses troisiegraveme et qua-triegraveme parties est plutocirct une collection drsquoessais sur la personne drsquoAugustin et son œuvre Ce qui ne diminue en rien sa valeur ou son utiliteacute Il sera au contraire un bon compleacutement agrave lrsquoAugustinus-Lexikon dont la publication se poursuit agrave un rythme soutenu Avec ses bibliographies et ses index il constitue un Companion to Augustine qui rendra service agrave tous ceux de plus en plus nombreux qui freacutequentent les eacutecrits augustiniens
Paul-Hubert Poirier
Judaiumlsme helleacutenistique
4 Andrei A ORLOV The Enoch-Metatron Tradition Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Texts and Studies in Ancient Judaism raquo 107) 2005 XII-383 p
Andrei Orlov est connu pour avoir expliqueacute dans de preacuteceacutedents articles lrsquoeacutevolution de la fi-gure drsquoHeacutenoch agrave partir de lrsquoimage amplifieacutee qursquoen donne 2 Heacutenoch un pseudeacutepigraphe conserveacute en slavon2 Avec un ouvrage entier consacreacute agrave la question lrsquoA rassemble maintenant ses acquis et complegravete la deacutemarche qursquoil avait entreprise
LrsquoA fait remonter les origines de la tradition du septiegraveme patriarche jusqursquoen Meacutesopotamie conformeacutement agrave lrsquohypothegravese selon laquelle la liste sumeacuterienne des rois anteacutediluviens serait le teacute-moin le plus ancien de la tradition dont la liste biblique aurait heacuteriteacute Au septiegraveme rang de
2 Les articles de lrsquoA ont par la suite eacuteteacute regroupeacutes dans un mecircme volume sous le titre From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Leiden Brill (laquo Supplements to the Journal for the Study of Judaism raquo 114) 2007
EN COLLABORATION
172
diffeacuterentes versions de cette liste apparaicirct le roi Enmeacuteduranki qui preacutesente deacutejagrave plusieurs des com-peacutetences qui seront des siegravecles plus tard attribueacutees agrave Heacutenoch dans la litteacuterature apocryphe
Tout au long de la premiegravere partie du livre lrsquoA deacutegage les rocircles et les titres que lrsquoon peut re-connaicirctre au prophegravete Heacutenoch dans les textes ougrave il occupe une place importante Apregraves srsquoecirctre inteacute-resseacute au roi Enmeacuteduranki lrsquoA pose comme fondement repreacutesentatif de lrsquoidentiteacute du patriarche les descriptions contenues dans 1 Heacutenoch le Livre des Jubileacutes lrsquoApocryphon de la Genegravese et le Livre des Geacuteants Il srsquoen sert comme base de comparaison pour distinguer des anciens les nouveaux rocircles et titres que contient le Sefer Hekhalot (3 Heacutenoch) LrsquoA termine lrsquoanalyse des rocircles et des titres en eacutetudiant le Livre des secrets drsquoHeacutenoch (2 Heacutenoch) dans le but de montrer que ce livre constitue une eacutetape intermeacutediaire entre les facettes originales du patriarche et celles que la mystique juive attribuera plus tard agrave lrsquoange Meacutetatron LrsquoA nrsquoexclut pas pour autant que drsquoautres influences telles que les traditions concernant les anges Yahoeumll et Michaeumll aient pu contribuer agrave la formation de lrsquoidentiteacute de Meacutetatron Toutefois lrsquoA procegravede en deacuteclinant les rocircles et les titres qui sont explici-tement associeacutes agrave Heacutenoch (ou agrave un ecirctre ceacuteleste comparable) plutocirct que drsquoidentifier dans un premier temps les personnages auxquels ces titres et ces rocircles sont traditionnellement associeacutes Sont ainsi passeacutees sous silence certaines occurrences de ces deacutenominations qui apparaissent aussi dans des textes ougrave elles ne peuvent ecirctre relieacutees agrave la tradition drsquoHeacutenoch-Meacutetatron Pensons par exemple agrave laquo lrsquoEacutelu de Dieu raquo (4Q534) ou agrave drsquoautres formulations dont les manuscrits de Qumracircn rappellent le caractegravere messianique
Puisque lrsquoouvrage traite de la transformation de lrsquoimage drsquoHeacutenoch agrave travers le temps le lecteur devra srsquoattendre agrave ce qursquoil porte davantage sur les reacutecits qui deacutecrivent une ascension ou un voyage ceacuteleste du patriarche LrsquoA puise abondamment agrave la litteacuterature rabbinique ainsi qursquoagrave la litteacuterature Hekhaloth (lrsquoenseignement agrave propos de la Merkabah) incluant la tradition agrave propos du Shilsquour Qomah (la mesure du corps divin) En outre lrsquoauteur deacutemontre une connaissance intime de 2 Heacute-noch et de ses diverses influences Par ailleurs le lecteur francophone constatera avec eacutetonnement que lrsquoA ne renvoie aucunement aux travaux de Mgr Joseph Coppens sur la figure du Fils de lrsquohomme Il fut pourtant le premier avec Johannes Theisohn agrave avoir preacutesenteacute sous forme comparative les fonctions et les attributs des personnages de lrsquoEacutelu et du Fils de lrsquohomme dans le Livre des Para-boles ce qui mit en eacutevidence la grande similariteacute des deux titres3 Notons toutefois que Coppens consideacuterait comme tardive lrsquoassociation de ces deux deacutenominations avec le patriarche Heacutenoch
Dans la deuxiegraveme partie du livre lrsquoA met en relief lrsquoaspect poleacutemique du contenu de 2 Heacute-noch poleacutemique dirigeacutee contre les figures drsquoAdam de Noeacute et de Moiumlse Le reacutecit tenterait de mettre en valeur le prophegravete en extrapolant ses rocircles anteacuterieurs ou en reprenant agrave son compte les fonctions exerceacutees par ces personnages concurrents Fort de cette constatation lrsquoA montre comment ces po-leacutemiques ont eu pour effet drsquoamplifier les attributs et les qualiteacutes drsquoHeacutenoch jusqursquoagrave le hisser au ni-veau de sar happanim un ange capable de se tenir debout devant la face de Dieu pour le servir LrsquoA traite de lrsquoaspect poleacutemique entre Heacutenoch et le personnage de Noeacute en dernier lieu Il y trouve des indices suppleacutementaires pour soutenir que lrsquoœuvre est un eacutecrit juif de la peacuteriode du Second Temple Cette conclusion ferme la boucle puisqursquoen introduction lrsquoA entendait deacutemontrer que 2 Heacutenoch constituait laquo a bridge between the early apocalyptic Enochic accounts and the later mysti-cal rabbinic and Hekhalot traditions raquo (p 17) On deacuteplore toutefois que lrsquoA reprenne sans reacuteserve
3 laquo Le Fils drsquohomme danieacutelique et les relectures de Dan VII 13 dans les apocryphes et les eacutecrits du Nouveau Testament raquo Ephemerides Theologicae Lovanienses 37 (1961) p 5-51 de mecircme que lrsquoeacutecrit posthume La relegraveve apocalyptique du messianisme royal II Le Fils drsquohomme veacuteteacutero- et intertestamentaire Leuven Peeters (laquo Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium raquo 61) 1983 p 128 et suiv
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
Laval theacuteologique et philosophique 64 1 (feacutevrier 2008) 169-207
169
chronique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
En collaboration
Instrumenta studiorum
1 Reneacute HOVEN Lexique de la prose latine de la Renaissance Dictionary of Renaissance Latin from Prose Sources Deuxiegraveme eacutedition revue et consideacuterablement augmenteacutee avec la collabo-ration de Laurent GRAILET traduction anglaise de Coen MAAS revue par Karin RENARD-JADOUL Leiden Boston Koninklijke Brill NV 2006 LIX-683 p
Les eacutecrivains de la Renaissance ont creacuteeacute de nombreux neacuteologismes afin de nommer les innova-tions artistiques scientifiques litteacuteraires et juridiques de leur temps Quiconque srsquoaffaire agrave lire et agrave eacutetudier la litteacuterature de cette peacuteriode est confronteacute agrave ces nombreux mots latins inconnus de la langue classique et de la langue meacutedieacutevale et sent le besoin drsquoavoir recours agrave des outils de travail LrsquoA de ce lexique srsquoest donneacute comme mission de pallier ce manque
La premiegravere eacutedition de ce lexique en 1994 avait eacuteteacute bien reccedilue dans les milieux universitaires1 Cette deuxiegraveme eacutedition en ameacuteliore grandement lrsquoutiliteacute La nouveauteacute la plus remarquable est lrsquoinclu-sion drsquoune traduction anglaise destineacutee agrave laquo accroicirctre les possibiliteacutes de rayonnement de cette deuxiegraveme eacutedition raquo (p XIV) Il srsquoagit donc deacutesormais drsquoun lexique latin-franccedilais et latin-anglais Si 150 auteurs avaient eacuteteacute deacutepouilleacutes dans la premiegravere eacutedition la deuxiegraveme en compte maintenant plus de 230 cou-vrant la peacuteriode de Peacutetrarque (1304-1374) agrave Juste Lipse (dagger 1606) On note ainsi plusieurs nouveaux
Preacuteceacutedentes chroniques Laval theacuteologique et philosophique 45 (1989) p 303-318 46 (1990) p 246-268 48 (1992) p 447-476 49 (1993) p 533-571 51 (1995) p 421-461 52 (1996) p 863-909 55 (1999) p 499-530 57 (2001) p 121-182 337-365 563-604 58 (2002) p 357-394 613-639 59 (2003) p 369-388 541-582 60 (2004) p 163-177 363-378 61 (2005) p 175-205 363-393 62 (2006) 133-169 63 (2007) p 121-162
Ont collaboreacute agrave cette chronique Pierre Cardinal Serge Cazelais Eric Creacutegheur Lucian Dicircncă Steve Johnston Jonathan I von Kodar Paul-Hubert Poirier et Jennifer K Wees Cette chronique a eacuteteacute reacutedigeacutee par Eric Creacutegheur
1 Voir la recension critique et les remarques pertinentes au sujet de la deacutefinition du laquo neacuteo-latin raquo de Louis VALCKE dans Laval theacuteologique et philosophique 51 3 (1995) p 686-688
EN COLLABORATION
170
noms comme Giordano Bruno Copernic Paracelse et Veacutesale LrsquoA motive son choix des auteurs en affirmant qursquoil a chercheacute agrave privileacutegier ceux dont les œuvres ont eacuteteacute eacutediteacutees ou reacuteeacutediteacutees ces der-niegraveres deacutecennies et qui sont ainsi plus accessibles au public viseacute par ce lexique Le nombre de noti-ces passe de 8 500 agrave pregraves de 11 000 et inclut plus de 11 600 acceptions De plus ces notices sont mieux cibleacutees que dans la premiegravere eacutedition En effet Le Grand Gaffiot publieacute en 2000 avec son ap-port consideacuterable agrave la langue de lrsquoAntiquiteacute tardive bien que trop souvent deacutependant du Dictionnaire latin-franccedilais des auteurs chreacutetiens de Blaise a permis agrave lrsquoA et agrave son eacutequipe drsquoeacuteliminer quelques notices et acceptions de mots qui sont deacutesormais bien traiteacutees et documenteacutees dans le dictionnaire latin-franccedilais de base consacreacute agrave lrsquoAntiquiteacute LrsquoA mentionne tout de mecircme que cette deuxiegraveme eacutedi-tion compte encore pregraves de 1 600 mots qui sont preacutesents dans le Gaffiot mais qui sont employeacutes dans des sens diffeacuterents chez les auteurs de la Renaissance Ils sont preacuteceacutedeacutes du signe +
Chacune des entreacutees est preacutecise concise et srsquoattache agrave lrsquoessentiel le mot latin et ses principa-les variantes orthographiques le sens franccedilais et anglais puis une ou quelques reacutefeacuterences agrave une œuvre agrave un ou plusieurs auteurs ainsi que son origine eacutetymologique Agrave ce sujet un appendice inti-tuleacute laquo listes annexes reacutecapitulatives raquo est fort utile La premiegravere partie de cette annexe (p 605-618) classe les mots drsquoorigine non latine selon leur origine grecque proche-orientale (arabe arameacuteen heacutebreu perse turque) germanique romane slave hongroise et mecircme ameacuterindienne (par exemple chicha qui est une boisson fermenteacutee) Lrsquoappendice se poursuit ensuite jusqursquoagrave la page 655 avec des listes de diminutifs et de mots classeacutes drsquoapregraves divers suffixes ou terminaisons
Enfin lrsquoA offre en guise de couronnement aux pages 659-683 la reacuteeacutedition de son article intitu-leacute laquo Essai sur le vocabulaire neacuteo-latin de Thomas More raquo paru en 1998 dans Moreana 35 (1998) p 25-53
Il faut feacuteliciter et remercier Reneacute Hoven et son eacutequipe drsquoavoir produit un tel instrument de tra-vail remarquable tant par la qualiteacute de lrsquoinformation qursquoon y trouve que par celle de sa typographie et de sa mise en page Pour ma part je lrsquoutilise deacutejagrave avec un grand plaisir
Serge Cazelais
2 Cornelius MAYER eacuted Augustinus-Lexikon vol 3 fasc 34 Hieronymus-Institutio insti-tutum Reacutedaction par Andreas EJ Grote en association avec Robert Dodaro Franccedilois Dolbeau Volker Henning Drecoll Therese Fuhrer Wolfgang Huumlbner Martin Kloumlckener dagger Serge Lancel Goulven Madec Christof Muumlller James J OrsquoDonnell Alfred Schindler Antonie Wlosok Bacircle Schwabe AG Verlag 2006 col 321-640
Ce nouveau fascicule du lexique drsquoAugustin consacreacute agrave la fin de la lettre H et au deacutebut de la lettre I rassemble cinquante-six notices en plus de la fin de celle portant sur Jeacuterocircme et du deacutebut de lrsquoarticle laquo Institutio institutum raquo Comme il se doit toutes ces notices concernent Augustin drsquoune maniegravere ou drsquoune autre mais plusieurs drsquoentre elles deacutebordent le champ des eacutetudes augustiniennes et rejoindront un public plus large Ainsi celles qui sont reacuteserveacutees aux laquo Imperatores romani raquo ou agrave lrsquolaquo Imperium romanum raquo agrave laquo Historia raquo laquo Imago raquo laquo Idea raquo ou encore agrave des termes importants pour lrsquohistoire de lrsquoanthropologie chreacutetienne (laquo Homo raquo et laquo Inspiratio raquo) Parmi les quelques notices portant sur des eacutecrits notons celles de Franccedilois Dolbeau sur les deux listes anciennes des œuvres drsquoAugustin lrsquoIndiculum dont lrsquoexistence est attesteacutee par les Retractationes (II41) et lrsquoIndiculus qui figure agrave la fin de la Vita Augustini de Possidius Mentionnons aussi les deux contributions du re-gretteacute Serge Lancel sur laquo Hippo Diarrhytus raquo et surtout laquo Hippo Regius raquo le siegravege eacutepiscopal drsquoAu-gustin
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
171
3 Volker Henning DRECOLL eacuted Augustin Handbuch Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Theo-logen Handbuumlcher raquo) 2007 XIX-799 p
Cet laquo Augustin raquo qui paraicirct dans une collection de manuels consacreacutes agrave des theacuteologiens anciens et modernes se veut une introduction agrave la recherche augustinienne destineacutee aussi bien aux speacutecia-listes et aux eacutetudiants qursquoau large public des lecteurs drsquoAugustin Le plan qui a eacuteteacute retenu est sen-siblement le mecircme que pour le premier volume de la collection le Luther Handbuch Il se compose de quatre parties La premiegravere offre une orientation drsquoensemble dans la recherche sur Augustin et son œuvre On y trouvera une preacutesentation de la tradition manuscrite et des grandes entreprises eacutedi-toriales des outils de la recherche (bibliothegraveques dictionnaires et lexiques banques de donneacutees) et des institutions speacutecialiseacutees ainsi qursquoun bilan des acquis La deuxiegraveme partie est consacreacutee agrave la per-sonne drsquoAugustin le milieu (lrsquoAfrique romaine Rome et Milan) et la vie les traditions litteacuteraires philosophiques religieuses (dont le manicheacuteisme) theacuteologiques et eccleacutesiales qui ont forgeacute la per-sonnaliteacute drsquoAugustin son eacutevolution ses combats et les domaines ougrave il srsquoest illustreacute La troisiegraveme partie qui porte sur lrsquoœuvre est diviseacutee en trois sections La premiegravere constitue un inventaire suc-cinct des principaux eacutecrits drsquoAugustin la seconde une preacutesentation des grands thegravemes de sa penseacutee La derniegravere section de cette partie plus bregraveve examine quelques thegravemes laquo transversaux raquo dans la penseacutee drsquoAugustin comme le Dieu trinitaire lrsquoindividu et la communauteacute humaine lrsquoaction de Dieu dans lrsquohistoire La derniegravere partie de lrsquoouvrage est reacuteserveacutee agrave la Wirkungsgeschichte de lrsquoeacutevecirc-que drsquoHippone agrave son influence et agrave sa survie On y trouve des chapitres portant entre autres sur la Regula Augustini Anselme Abeacutelard les Sentences de Pierre Lombard lrsquoaugustinisme meacutedieacuteval Luther Calvin le mouvement arminien et lrsquoaugustinisme catholique de Baius agrave Janseacutenius Mecircme srsquoil preacutesente toutes les caracteacuteristiques drsquoun manuel cet ouvrage surtout dans ses troisiegraveme et qua-triegraveme parties est plutocirct une collection drsquoessais sur la personne drsquoAugustin et son œuvre Ce qui ne diminue en rien sa valeur ou son utiliteacute Il sera au contraire un bon compleacutement agrave lrsquoAugustinus-Lexikon dont la publication se poursuit agrave un rythme soutenu Avec ses bibliographies et ses index il constitue un Companion to Augustine qui rendra service agrave tous ceux de plus en plus nombreux qui freacutequentent les eacutecrits augustiniens
Paul-Hubert Poirier
Judaiumlsme helleacutenistique
4 Andrei A ORLOV The Enoch-Metatron Tradition Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Texts and Studies in Ancient Judaism raquo 107) 2005 XII-383 p
Andrei Orlov est connu pour avoir expliqueacute dans de preacuteceacutedents articles lrsquoeacutevolution de la fi-gure drsquoHeacutenoch agrave partir de lrsquoimage amplifieacutee qursquoen donne 2 Heacutenoch un pseudeacutepigraphe conserveacute en slavon2 Avec un ouvrage entier consacreacute agrave la question lrsquoA rassemble maintenant ses acquis et complegravete la deacutemarche qursquoil avait entreprise
LrsquoA fait remonter les origines de la tradition du septiegraveme patriarche jusqursquoen Meacutesopotamie conformeacutement agrave lrsquohypothegravese selon laquelle la liste sumeacuterienne des rois anteacutediluviens serait le teacute-moin le plus ancien de la tradition dont la liste biblique aurait heacuteriteacute Au septiegraveme rang de
2 Les articles de lrsquoA ont par la suite eacuteteacute regroupeacutes dans un mecircme volume sous le titre From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Leiden Brill (laquo Supplements to the Journal for the Study of Judaism raquo 114) 2007
EN COLLABORATION
172
diffeacuterentes versions de cette liste apparaicirct le roi Enmeacuteduranki qui preacutesente deacutejagrave plusieurs des com-peacutetences qui seront des siegravecles plus tard attribueacutees agrave Heacutenoch dans la litteacuterature apocryphe
Tout au long de la premiegravere partie du livre lrsquoA deacutegage les rocircles et les titres que lrsquoon peut re-connaicirctre au prophegravete Heacutenoch dans les textes ougrave il occupe une place importante Apregraves srsquoecirctre inteacute-resseacute au roi Enmeacuteduranki lrsquoA pose comme fondement repreacutesentatif de lrsquoidentiteacute du patriarche les descriptions contenues dans 1 Heacutenoch le Livre des Jubileacutes lrsquoApocryphon de la Genegravese et le Livre des Geacuteants Il srsquoen sert comme base de comparaison pour distinguer des anciens les nouveaux rocircles et titres que contient le Sefer Hekhalot (3 Heacutenoch) LrsquoA termine lrsquoanalyse des rocircles et des titres en eacutetudiant le Livre des secrets drsquoHeacutenoch (2 Heacutenoch) dans le but de montrer que ce livre constitue une eacutetape intermeacutediaire entre les facettes originales du patriarche et celles que la mystique juive attribuera plus tard agrave lrsquoange Meacutetatron LrsquoA nrsquoexclut pas pour autant que drsquoautres influences telles que les traditions concernant les anges Yahoeumll et Michaeumll aient pu contribuer agrave la formation de lrsquoidentiteacute de Meacutetatron Toutefois lrsquoA procegravede en deacuteclinant les rocircles et les titres qui sont explici-tement associeacutes agrave Heacutenoch (ou agrave un ecirctre ceacuteleste comparable) plutocirct que drsquoidentifier dans un premier temps les personnages auxquels ces titres et ces rocircles sont traditionnellement associeacutes Sont ainsi passeacutees sous silence certaines occurrences de ces deacutenominations qui apparaissent aussi dans des textes ougrave elles ne peuvent ecirctre relieacutees agrave la tradition drsquoHeacutenoch-Meacutetatron Pensons par exemple agrave laquo lrsquoEacutelu de Dieu raquo (4Q534) ou agrave drsquoautres formulations dont les manuscrits de Qumracircn rappellent le caractegravere messianique
Puisque lrsquoouvrage traite de la transformation de lrsquoimage drsquoHeacutenoch agrave travers le temps le lecteur devra srsquoattendre agrave ce qursquoil porte davantage sur les reacutecits qui deacutecrivent une ascension ou un voyage ceacuteleste du patriarche LrsquoA puise abondamment agrave la litteacuterature rabbinique ainsi qursquoagrave la litteacuterature Hekhaloth (lrsquoenseignement agrave propos de la Merkabah) incluant la tradition agrave propos du Shilsquour Qomah (la mesure du corps divin) En outre lrsquoauteur deacutemontre une connaissance intime de 2 Heacute-noch et de ses diverses influences Par ailleurs le lecteur francophone constatera avec eacutetonnement que lrsquoA ne renvoie aucunement aux travaux de Mgr Joseph Coppens sur la figure du Fils de lrsquohomme Il fut pourtant le premier avec Johannes Theisohn agrave avoir preacutesenteacute sous forme comparative les fonctions et les attributs des personnages de lrsquoEacutelu et du Fils de lrsquohomme dans le Livre des Para-boles ce qui mit en eacutevidence la grande similariteacute des deux titres3 Notons toutefois que Coppens consideacuterait comme tardive lrsquoassociation de ces deux deacutenominations avec le patriarche Heacutenoch
Dans la deuxiegraveme partie du livre lrsquoA met en relief lrsquoaspect poleacutemique du contenu de 2 Heacute-noch poleacutemique dirigeacutee contre les figures drsquoAdam de Noeacute et de Moiumlse Le reacutecit tenterait de mettre en valeur le prophegravete en extrapolant ses rocircles anteacuterieurs ou en reprenant agrave son compte les fonctions exerceacutees par ces personnages concurrents Fort de cette constatation lrsquoA montre comment ces po-leacutemiques ont eu pour effet drsquoamplifier les attributs et les qualiteacutes drsquoHeacutenoch jusqursquoagrave le hisser au ni-veau de sar happanim un ange capable de se tenir debout devant la face de Dieu pour le servir LrsquoA traite de lrsquoaspect poleacutemique entre Heacutenoch et le personnage de Noeacute en dernier lieu Il y trouve des indices suppleacutementaires pour soutenir que lrsquoœuvre est un eacutecrit juif de la peacuteriode du Second Temple Cette conclusion ferme la boucle puisqursquoen introduction lrsquoA entendait deacutemontrer que 2 Heacutenoch constituait laquo a bridge between the early apocalyptic Enochic accounts and the later mysti-cal rabbinic and Hekhalot traditions raquo (p 17) On deacuteplore toutefois que lrsquoA reprenne sans reacuteserve
3 laquo Le Fils drsquohomme danieacutelique et les relectures de Dan VII 13 dans les apocryphes et les eacutecrits du Nouveau Testament raquo Ephemerides Theologicae Lovanienses 37 (1961) p 5-51 de mecircme que lrsquoeacutecrit posthume La relegraveve apocalyptique du messianisme royal II Le Fils drsquohomme veacuteteacutero- et intertestamentaire Leuven Peeters (laquo Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium raquo 61) 1983 p 128 et suiv
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
170
noms comme Giordano Bruno Copernic Paracelse et Veacutesale LrsquoA motive son choix des auteurs en affirmant qursquoil a chercheacute agrave privileacutegier ceux dont les œuvres ont eacuteteacute eacutediteacutees ou reacuteeacutediteacutees ces der-niegraveres deacutecennies et qui sont ainsi plus accessibles au public viseacute par ce lexique Le nombre de noti-ces passe de 8 500 agrave pregraves de 11 000 et inclut plus de 11 600 acceptions De plus ces notices sont mieux cibleacutees que dans la premiegravere eacutedition En effet Le Grand Gaffiot publieacute en 2000 avec son ap-port consideacuterable agrave la langue de lrsquoAntiquiteacute tardive bien que trop souvent deacutependant du Dictionnaire latin-franccedilais des auteurs chreacutetiens de Blaise a permis agrave lrsquoA et agrave son eacutequipe drsquoeacuteliminer quelques notices et acceptions de mots qui sont deacutesormais bien traiteacutees et documenteacutees dans le dictionnaire latin-franccedilais de base consacreacute agrave lrsquoAntiquiteacute LrsquoA mentionne tout de mecircme que cette deuxiegraveme eacutedi-tion compte encore pregraves de 1 600 mots qui sont preacutesents dans le Gaffiot mais qui sont employeacutes dans des sens diffeacuterents chez les auteurs de la Renaissance Ils sont preacuteceacutedeacutes du signe +
Chacune des entreacutees est preacutecise concise et srsquoattache agrave lrsquoessentiel le mot latin et ses principa-les variantes orthographiques le sens franccedilais et anglais puis une ou quelques reacutefeacuterences agrave une œuvre agrave un ou plusieurs auteurs ainsi que son origine eacutetymologique Agrave ce sujet un appendice inti-tuleacute laquo listes annexes reacutecapitulatives raquo est fort utile La premiegravere partie de cette annexe (p 605-618) classe les mots drsquoorigine non latine selon leur origine grecque proche-orientale (arabe arameacuteen heacutebreu perse turque) germanique romane slave hongroise et mecircme ameacuterindienne (par exemple chicha qui est une boisson fermenteacutee) Lrsquoappendice se poursuit ensuite jusqursquoagrave la page 655 avec des listes de diminutifs et de mots classeacutes drsquoapregraves divers suffixes ou terminaisons
Enfin lrsquoA offre en guise de couronnement aux pages 659-683 la reacuteeacutedition de son article intitu-leacute laquo Essai sur le vocabulaire neacuteo-latin de Thomas More raquo paru en 1998 dans Moreana 35 (1998) p 25-53
Il faut feacuteliciter et remercier Reneacute Hoven et son eacutequipe drsquoavoir produit un tel instrument de tra-vail remarquable tant par la qualiteacute de lrsquoinformation qursquoon y trouve que par celle de sa typographie et de sa mise en page Pour ma part je lrsquoutilise deacutejagrave avec un grand plaisir
Serge Cazelais
2 Cornelius MAYER eacuted Augustinus-Lexikon vol 3 fasc 34 Hieronymus-Institutio insti-tutum Reacutedaction par Andreas EJ Grote en association avec Robert Dodaro Franccedilois Dolbeau Volker Henning Drecoll Therese Fuhrer Wolfgang Huumlbner Martin Kloumlckener dagger Serge Lancel Goulven Madec Christof Muumlller James J OrsquoDonnell Alfred Schindler Antonie Wlosok Bacircle Schwabe AG Verlag 2006 col 321-640
Ce nouveau fascicule du lexique drsquoAugustin consacreacute agrave la fin de la lettre H et au deacutebut de la lettre I rassemble cinquante-six notices en plus de la fin de celle portant sur Jeacuterocircme et du deacutebut de lrsquoarticle laquo Institutio institutum raquo Comme il se doit toutes ces notices concernent Augustin drsquoune maniegravere ou drsquoune autre mais plusieurs drsquoentre elles deacutebordent le champ des eacutetudes augustiniennes et rejoindront un public plus large Ainsi celles qui sont reacuteserveacutees aux laquo Imperatores romani raquo ou agrave lrsquolaquo Imperium romanum raquo agrave laquo Historia raquo laquo Imago raquo laquo Idea raquo ou encore agrave des termes importants pour lrsquohistoire de lrsquoanthropologie chreacutetienne (laquo Homo raquo et laquo Inspiratio raquo) Parmi les quelques notices portant sur des eacutecrits notons celles de Franccedilois Dolbeau sur les deux listes anciennes des œuvres drsquoAugustin lrsquoIndiculum dont lrsquoexistence est attesteacutee par les Retractationes (II41) et lrsquoIndiculus qui figure agrave la fin de la Vita Augustini de Possidius Mentionnons aussi les deux contributions du re-gretteacute Serge Lancel sur laquo Hippo Diarrhytus raquo et surtout laquo Hippo Regius raquo le siegravege eacutepiscopal drsquoAu-gustin
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
171
3 Volker Henning DRECOLL eacuted Augustin Handbuch Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Theo-logen Handbuumlcher raquo) 2007 XIX-799 p
Cet laquo Augustin raquo qui paraicirct dans une collection de manuels consacreacutes agrave des theacuteologiens anciens et modernes se veut une introduction agrave la recherche augustinienne destineacutee aussi bien aux speacutecia-listes et aux eacutetudiants qursquoau large public des lecteurs drsquoAugustin Le plan qui a eacuteteacute retenu est sen-siblement le mecircme que pour le premier volume de la collection le Luther Handbuch Il se compose de quatre parties La premiegravere offre une orientation drsquoensemble dans la recherche sur Augustin et son œuvre On y trouvera une preacutesentation de la tradition manuscrite et des grandes entreprises eacutedi-toriales des outils de la recherche (bibliothegraveques dictionnaires et lexiques banques de donneacutees) et des institutions speacutecialiseacutees ainsi qursquoun bilan des acquis La deuxiegraveme partie est consacreacutee agrave la per-sonne drsquoAugustin le milieu (lrsquoAfrique romaine Rome et Milan) et la vie les traditions litteacuteraires philosophiques religieuses (dont le manicheacuteisme) theacuteologiques et eccleacutesiales qui ont forgeacute la per-sonnaliteacute drsquoAugustin son eacutevolution ses combats et les domaines ougrave il srsquoest illustreacute La troisiegraveme partie qui porte sur lrsquoœuvre est diviseacutee en trois sections La premiegravere constitue un inventaire suc-cinct des principaux eacutecrits drsquoAugustin la seconde une preacutesentation des grands thegravemes de sa penseacutee La derniegravere section de cette partie plus bregraveve examine quelques thegravemes laquo transversaux raquo dans la penseacutee drsquoAugustin comme le Dieu trinitaire lrsquoindividu et la communauteacute humaine lrsquoaction de Dieu dans lrsquohistoire La derniegravere partie de lrsquoouvrage est reacuteserveacutee agrave la Wirkungsgeschichte de lrsquoeacutevecirc-que drsquoHippone agrave son influence et agrave sa survie On y trouve des chapitres portant entre autres sur la Regula Augustini Anselme Abeacutelard les Sentences de Pierre Lombard lrsquoaugustinisme meacutedieacuteval Luther Calvin le mouvement arminien et lrsquoaugustinisme catholique de Baius agrave Janseacutenius Mecircme srsquoil preacutesente toutes les caracteacuteristiques drsquoun manuel cet ouvrage surtout dans ses troisiegraveme et qua-triegraveme parties est plutocirct une collection drsquoessais sur la personne drsquoAugustin et son œuvre Ce qui ne diminue en rien sa valeur ou son utiliteacute Il sera au contraire un bon compleacutement agrave lrsquoAugustinus-Lexikon dont la publication se poursuit agrave un rythme soutenu Avec ses bibliographies et ses index il constitue un Companion to Augustine qui rendra service agrave tous ceux de plus en plus nombreux qui freacutequentent les eacutecrits augustiniens
Paul-Hubert Poirier
Judaiumlsme helleacutenistique
4 Andrei A ORLOV The Enoch-Metatron Tradition Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Texts and Studies in Ancient Judaism raquo 107) 2005 XII-383 p
Andrei Orlov est connu pour avoir expliqueacute dans de preacuteceacutedents articles lrsquoeacutevolution de la fi-gure drsquoHeacutenoch agrave partir de lrsquoimage amplifieacutee qursquoen donne 2 Heacutenoch un pseudeacutepigraphe conserveacute en slavon2 Avec un ouvrage entier consacreacute agrave la question lrsquoA rassemble maintenant ses acquis et complegravete la deacutemarche qursquoil avait entreprise
LrsquoA fait remonter les origines de la tradition du septiegraveme patriarche jusqursquoen Meacutesopotamie conformeacutement agrave lrsquohypothegravese selon laquelle la liste sumeacuterienne des rois anteacutediluviens serait le teacute-moin le plus ancien de la tradition dont la liste biblique aurait heacuteriteacute Au septiegraveme rang de
2 Les articles de lrsquoA ont par la suite eacuteteacute regroupeacutes dans un mecircme volume sous le titre From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Leiden Brill (laquo Supplements to the Journal for the Study of Judaism raquo 114) 2007
EN COLLABORATION
172
diffeacuterentes versions de cette liste apparaicirct le roi Enmeacuteduranki qui preacutesente deacutejagrave plusieurs des com-peacutetences qui seront des siegravecles plus tard attribueacutees agrave Heacutenoch dans la litteacuterature apocryphe
Tout au long de la premiegravere partie du livre lrsquoA deacutegage les rocircles et les titres que lrsquoon peut re-connaicirctre au prophegravete Heacutenoch dans les textes ougrave il occupe une place importante Apregraves srsquoecirctre inteacute-resseacute au roi Enmeacuteduranki lrsquoA pose comme fondement repreacutesentatif de lrsquoidentiteacute du patriarche les descriptions contenues dans 1 Heacutenoch le Livre des Jubileacutes lrsquoApocryphon de la Genegravese et le Livre des Geacuteants Il srsquoen sert comme base de comparaison pour distinguer des anciens les nouveaux rocircles et titres que contient le Sefer Hekhalot (3 Heacutenoch) LrsquoA termine lrsquoanalyse des rocircles et des titres en eacutetudiant le Livre des secrets drsquoHeacutenoch (2 Heacutenoch) dans le but de montrer que ce livre constitue une eacutetape intermeacutediaire entre les facettes originales du patriarche et celles que la mystique juive attribuera plus tard agrave lrsquoange Meacutetatron LrsquoA nrsquoexclut pas pour autant que drsquoautres influences telles que les traditions concernant les anges Yahoeumll et Michaeumll aient pu contribuer agrave la formation de lrsquoidentiteacute de Meacutetatron Toutefois lrsquoA procegravede en deacuteclinant les rocircles et les titres qui sont explici-tement associeacutes agrave Heacutenoch (ou agrave un ecirctre ceacuteleste comparable) plutocirct que drsquoidentifier dans un premier temps les personnages auxquels ces titres et ces rocircles sont traditionnellement associeacutes Sont ainsi passeacutees sous silence certaines occurrences de ces deacutenominations qui apparaissent aussi dans des textes ougrave elles ne peuvent ecirctre relieacutees agrave la tradition drsquoHeacutenoch-Meacutetatron Pensons par exemple agrave laquo lrsquoEacutelu de Dieu raquo (4Q534) ou agrave drsquoautres formulations dont les manuscrits de Qumracircn rappellent le caractegravere messianique
Puisque lrsquoouvrage traite de la transformation de lrsquoimage drsquoHeacutenoch agrave travers le temps le lecteur devra srsquoattendre agrave ce qursquoil porte davantage sur les reacutecits qui deacutecrivent une ascension ou un voyage ceacuteleste du patriarche LrsquoA puise abondamment agrave la litteacuterature rabbinique ainsi qursquoagrave la litteacuterature Hekhaloth (lrsquoenseignement agrave propos de la Merkabah) incluant la tradition agrave propos du Shilsquour Qomah (la mesure du corps divin) En outre lrsquoauteur deacutemontre une connaissance intime de 2 Heacute-noch et de ses diverses influences Par ailleurs le lecteur francophone constatera avec eacutetonnement que lrsquoA ne renvoie aucunement aux travaux de Mgr Joseph Coppens sur la figure du Fils de lrsquohomme Il fut pourtant le premier avec Johannes Theisohn agrave avoir preacutesenteacute sous forme comparative les fonctions et les attributs des personnages de lrsquoEacutelu et du Fils de lrsquohomme dans le Livre des Para-boles ce qui mit en eacutevidence la grande similariteacute des deux titres3 Notons toutefois que Coppens consideacuterait comme tardive lrsquoassociation de ces deux deacutenominations avec le patriarche Heacutenoch
Dans la deuxiegraveme partie du livre lrsquoA met en relief lrsquoaspect poleacutemique du contenu de 2 Heacute-noch poleacutemique dirigeacutee contre les figures drsquoAdam de Noeacute et de Moiumlse Le reacutecit tenterait de mettre en valeur le prophegravete en extrapolant ses rocircles anteacuterieurs ou en reprenant agrave son compte les fonctions exerceacutees par ces personnages concurrents Fort de cette constatation lrsquoA montre comment ces po-leacutemiques ont eu pour effet drsquoamplifier les attributs et les qualiteacutes drsquoHeacutenoch jusqursquoagrave le hisser au ni-veau de sar happanim un ange capable de se tenir debout devant la face de Dieu pour le servir LrsquoA traite de lrsquoaspect poleacutemique entre Heacutenoch et le personnage de Noeacute en dernier lieu Il y trouve des indices suppleacutementaires pour soutenir que lrsquoœuvre est un eacutecrit juif de la peacuteriode du Second Temple Cette conclusion ferme la boucle puisqursquoen introduction lrsquoA entendait deacutemontrer que 2 Heacutenoch constituait laquo a bridge between the early apocalyptic Enochic accounts and the later mysti-cal rabbinic and Hekhalot traditions raquo (p 17) On deacuteplore toutefois que lrsquoA reprenne sans reacuteserve
3 laquo Le Fils drsquohomme danieacutelique et les relectures de Dan VII 13 dans les apocryphes et les eacutecrits du Nouveau Testament raquo Ephemerides Theologicae Lovanienses 37 (1961) p 5-51 de mecircme que lrsquoeacutecrit posthume La relegraveve apocalyptique du messianisme royal II Le Fils drsquohomme veacuteteacutero- et intertestamentaire Leuven Peeters (laquo Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium raquo 61) 1983 p 128 et suiv
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
171
3 Volker Henning DRECOLL eacuted Augustin Handbuch Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Theo-logen Handbuumlcher raquo) 2007 XIX-799 p
Cet laquo Augustin raquo qui paraicirct dans une collection de manuels consacreacutes agrave des theacuteologiens anciens et modernes se veut une introduction agrave la recherche augustinienne destineacutee aussi bien aux speacutecia-listes et aux eacutetudiants qursquoau large public des lecteurs drsquoAugustin Le plan qui a eacuteteacute retenu est sen-siblement le mecircme que pour le premier volume de la collection le Luther Handbuch Il se compose de quatre parties La premiegravere offre une orientation drsquoensemble dans la recherche sur Augustin et son œuvre On y trouvera une preacutesentation de la tradition manuscrite et des grandes entreprises eacutedi-toriales des outils de la recherche (bibliothegraveques dictionnaires et lexiques banques de donneacutees) et des institutions speacutecialiseacutees ainsi qursquoun bilan des acquis La deuxiegraveme partie est consacreacutee agrave la per-sonne drsquoAugustin le milieu (lrsquoAfrique romaine Rome et Milan) et la vie les traditions litteacuteraires philosophiques religieuses (dont le manicheacuteisme) theacuteologiques et eccleacutesiales qui ont forgeacute la per-sonnaliteacute drsquoAugustin son eacutevolution ses combats et les domaines ougrave il srsquoest illustreacute La troisiegraveme partie qui porte sur lrsquoœuvre est diviseacutee en trois sections La premiegravere constitue un inventaire suc-cinct des principaux eacutecrits drsquoAugustin la seconde une preacutesentation des grands thegravemes de sa penseacutee La derniegravere section de cette partie plus bregraveve examine quelques thegravemes laquo transversaux raquo dans la penseacutee drsquoAugustin comme le Dieu trinitaire lrsquoindividu et la communauteacute humaine lrsquoaction de Dieu dans lrsquohistoire La derniegravere partie de lrsquoouvrage est reacuteserveacutee agrave la Wirkungsgeschichte de lrsquoeacutevecirc-que drsquoHippone agrave son influence et agrave sa survie On y trouve des chapitres portant entre autres sur la Regula Augustini Anselme Abeacutelard les Sentences de Pierre Lombard lrsquoaugustinisme meacutedieacuteval Luther Calvin le mouvement arminien et lrsquoaugustinisme catholique de Baius agrave Janseacutenius Mecircme srsquoil preacutesente toutes les caracteacuteristiques drsquoun manuel cet ouvrage surtout dans ses troisiegraveme et qua-triegraveme parties est plutocirct une collection drsquoessais sur la personne drsquoAugustin et son œuvre Ce qui ne diminue en rien sa valeur ou son utiliteacute Il sera au contraire un bon compleacutement agrave lrsquoAugustinus-Lexikon dont la publication se poursuit agrave un rythme soutenu Avec ses bibliographies et ses index il constitue un Companion to Augustine qui rendra service agrave tous ceux de plus en plus nombreux qui freacutequentent les eacutecrits augustiniens
Paul-Hubert Poirier
Judaiumlsme helleacutenistique
4 Andrei A ORLOV The Enoch-Metatron Tradition Tuumlbingen Mohr Siebeck (coll laquo Texts and Studies in Ancient Judaism raquo 107) 2005 XII-383 p
Andrei Orlov est connu pour avoir expliqueacute dans de preacuteceacutedents articles lrsquoeacutevolution de la fi-gure drsquoHeacutenoch agrave partir de lrsquoimage amplifieacutee qursquoen donne 2 Heacutenoch un pseudeacutepigraphe conserveacute en slavon2 Avec un ouvrage entier consacreacute agrave la question lrsquoA rassemble maintenant ses acquis et complegravete la deacutemarche qursquoil avait entreprise
LrsquoA fait remonter les origines de la tradition du septiegraveme patriarche jusqursquoen Meacutesopotamie conformeacutement agrave lrsquohypothegravese selon laquelle la liste sumeacuterienne des rois anteacutediluviens serait le teacute-moin le plus ancien de la tradition dont la liste biblique aurait heacuteriteacute Au septiegraveme rang de
2 Les articles de lrsquoA ont par la suite eacuteteacute regroupeacutes dans un mecircme volume sous le titre From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Leiden Brill (laquo Supplements to the Journal for the Study of Judaism raquo 114) 2007
EN COLLABORATION
172
diffeacuterentes versions de cette liste apparaicirct le roi Enmeacuteduranki qui preacutesente deacutejagrave plusieurs des com-peacutetences qui seront des siegravecles plus tard attribueacutees agrave Heacutenoch dans la litteacuterature apocryphe
Tout au long de la premiegravere partie du livre lrsquoA deacutegage les rocircles et les titres que lrsquoon peut re-connaicirctre au prophegravete Heacutenoch dans les textes ougrave il occupe une place importante Apregraves srsquoecirctre inteacute-resseacute au roi Enmeacuteduranki lrsquoA pose comme fondement repreacutesentatif de lrsquoidentiteacute du patriarche les descriptions contenues dans 1 Heacutenoch le Livre des Jubileacutes lrsquoApocryphon de la Genegravese et le Livre des Geacuteants Il srsquoen sert comme base de comparaison pour distinguer des anciens les nouveaux rocircles et titres que contient le Sefer Hekhalot (3 Heacutenoch) LrsquoA termine lrsquoanalyse des rocircles et des titres en eacutetudiant le Livre des secrets drsquoHeacutenoch (2 Heacutenoch) dans le but de montrer que ce livre constitue une eacutetape intermeacutediaire entre les facettes originales du patriarche et celles que la mystique juive attribuera plus tard agrave lrsquoange Meacutetatron LrsquoA nrsquoexclut pas pour autant que drsquoautres influences telles que les traditions concernant les anges Yahoeumll et Michaeumll aient pu contribuer agrave la formation de lrsquoidentiteacute de Meacutetatron Toutefois lrsquoA procegravede en deacuteclinant les rocircles et les titres qui sont explici-tement associeacutes agrave Heacutenoch (ou agrave un ecirctre ceacuteleste comparable) plutocirct que drsquoidentifier dans un premier temps les personnages auxquels ces titres et ces rocircles sont traditionnellement associeacutes Sont ainsi passeacutees sous silence certaines occurrences de ces deacutenominations qui apparaissent aussi dans des textes ougrave elles ne peuvent ecirctre relieacutees agrave la tradition drsquoHeacutenoch-Meacutetatron Pensons par exemple agrave laquo lrsquoEacutelu de Dieu raquo (4Q534) ou agrave drsquoautres formulations dont les manuscrits de Qumracircn rappellent le caractegravere messianique
Puisque lrsquoouvrage traite de la transformation de lrsquoimage drsquoHeacutenoch agrave travers le temps le lecteur devra srsquoattendre agrave ce qursquoil porte davantage sur les reacutecits qui deacutecrivent une ascension ou un voyage ceacuteleste du patriarche LrsquoA puise abondamment agrave la litteacuterature rabbinique ainsi qursquoagrave la litteacuterature Hekhaloth (lrsquoenseignement agrave propos de la Merkabah) incluant la tradition agrave propos du Shilsquour Qomah (la mesure du corps divin) En outre lrsquoauteur deacutemontre une connaissance intime de 2 Heacute-noch et de ses diverses influences Par ailleurs le lecteur francophone constatera avec eacutetonnement que lrsquoA ne renvoie aucunement aux travaux de Mgr Joseph Coppens sur la figure du Fils de lrsquohomme Il fut pourtant le premier avec Johannes Theisohn agrave avoir preacutesenteacute sous forme comparative les fonctions et les attributs des personnages de lrsquoEacutelu et du Fils de lrsquohomme dans le Livre des Para-boles ce qui mit en eacutevidence la grande similariteacute des deux titres3 Notons toutefois que Coppens consideacuterait comme tardive lrsquoassociation de ces deux deacutenominations avec le patriarche Heacutenoch
Dans la deuxiegraveme partie du livre lrsquoA met en relief lrsquoaspect poleacutemique du contenu de 2 Heacute-noch poleacutemique dirigeacutee contre les figures drsquoAdam de Noeacute et de Moiumlse Le reacutecit tenterait de mettre en valeur le prophegravete en extrapolant ses rocircles anteacuterieurs ou en reprenant agrave son compte les fonctions exerceacutees par ces personnages concurrents Fort de cette constatation lrsquoA montre comment ces po-leacutemiques ont eu pour effet drsquoamplifier les attributs et les qualiteacutes drsquoHeacutenoch jusqursquoagrave le hisser au ni-veau de sar happanim un ange capable de se tenir debout devant la face de Dieu pour le servir LrsquoA traite de lrsquoaspect poleacutemique entre Heacutenoch et le personnage de Noeacute en dernier lieu Il y trouve des indices suppleacutementaires pour soutenir que lrsquoœuvre est un eacutecrit juif de la peacuteriode du Second Temple Cette conclusion ferme la boucle puisqursquoen introduction lrsquoA entendait deacutemontrer que 2 Heacutenoch constituait laquo a bridge between the early apocalyptic Enochic accounts and the later mysti-cal rabbinic and Hekhalot traditions raquo (p 17) On deacuteplore toutefois que lrsquoA reprenne sans reacuteserve
3 laquo Le Fils drsquohomme danieacutelique et les relectures de Dan VII 13 dans les apocryphes et les eacutecrits du Nouveau Testament raquo Ephemerides Theologicae Lovanienses 37 (1961) p 5-51 de mecircme que lrsquoeacutecrit posthume La relegraveve apocalyptique du messianisme royal II Le Fils drsquohomme veacuteteacutero- et intertestamentaire Leuven Peeters (laquo Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium raquo 61) 1983 p 128 et suiv
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
172
diffeacuterentes versions de cette liste apparaicirct le roi Enmeacuteduranki qui preacutesente deacutejagrave plusieurs des com-peacutetences qui seront des siegravecles plus tard attribueacutees agrave Heacutenoch dans la litteacuterature apocryphe
Tout au long de la premiegravere partie du livre lrsquoA deacutegage les rocircles et les titres que lrsquoon peut re-connaicirctre au prophegravete Heacutenoch dans les textes ougrave il occupe une place importante Apregraves srsquoecirctre inteacute-resseacute au roi Enmeacuteduranki lrsquoA pose comme fondement repreacutesentatif de lrsquoidentiteacute du patriarche les descriptions contenues dans 1 Heacutenoch le Livre des Jubileacutes lrsquoApocryphon de la Genegravese et le Livre des Geacuteants Il srsquoen sert comme base de comparaison pour distinguer des anciens les nouveaux rocircles et titres que contient le Sefer Hekhalot (3 Heacutenoch) LrsquoA termine lrsquoanalyse des rocircles et des titres en eacutetudiant le Livre des secrets drsquoHeacutenoch (2 Heacutenoch) dans le but de montrer que ce livre constitue une eacutetape intermeacutediaire entre les facettes originales du patriarche et celles que la mystique juive attribuera plus tard agrave lrsquoange Meacutetatron LrsquoA nrsquoexclut pas pour autant que drsquoautres influences telles que les traditions concernant les anges Yahoeumll et Michaeumll aient pu contribuer agrave la formation de lrsquoidentiteacute de Meacutetatron Toutefois lrsquoA procegravede en deacuteclinant les rocircles et les titres qui sont explici-tement associeacutes agrave Heacutenoch (ou agrave un ecirctre ceacuteleste comparable) plutocirct que drsquoidentifier dans un premier temps les personnages auxquels ces titres et ces rocircles sont traditionnellement associeacutes Sont ainsi passeacutees sous silence certaines occurrences de ces deacutenominations qui apparaissent aussi dans des textes ougrave elles ne peuvent ecirctre relieacutees agrave la tradition drsquoHeacutenoch-Meacutetatron Pensons par exemple agrave laquo lrsquoEacutelu de Dieu raquo (4Q534) ou agrave drsquoautres formulations dont les manuscrits de Qumracircn rappellent le caractegravere messianique
Puisque lrsquoouvrage traite de la transformation de lrsquoimage drsquoHeacutenoch agrave travers le temps le lecteur devra srsquoattendre agrave ce qursquoil porte davantage sur les reacutecits qui deacutecrivent une ascension ou un voyage ceacuteleste du patriarche LrsquoA puise abondamment agrave la litteacuterature rabbinique ainsi qursquoagrave la litteacuterature Hekhaloth (lrsquoenseignement agrave propos de la Merkabah) incluant la tradition agrave propos du Shilsquour Qomah (la mesure du corps divin) En outre lrsquoauteur deacutemontre une connaissance intime de 2 Heacute-noch et de ses diverses influences Par ailleurs le lecteur francophone constatera avec eacutetonnement que lrsquoA ne renvoie aucunement aux travaux de Mgr Joseph Coppens sur la figure du Fils de lrsquohomme Il fut pourtant le premier avec Johannes Theisohn agrave avoir preacutesenteacute sous forme comparative les fonctions et les attributs des personnages de lrsquoEacutelu et du Fils de lrsquohomme dans le Livre des Para-boles ce qui mit en eacutevidence la grande similariteacute des deux titres3 Notons toutefois que Coppens consideacuterait comme tardive lrsquoassociation de ces deux deacutenominations avec le patriarche Heacutenoch
Dans la deuxiegraveme partie du livre lrsquoA met en relief lrsquoaspect poleacutemique du contenu de 2 Heacute-noch poleacutemique dirigeacutee contre les figures drsquoAdam de Noeacute et de Moiumlse Le reacutecit tenterait de mettre en valeur le prophegravete en extrapolant ses rocircles anteacuterieurs ou en reprenant agrave son compte les fonctions exerceacutees par ces personnages concurrents Fort de cette constatation lrsquoA montre comment ces po-leacutemiques ont eu pour effet drsquoamplifier les attributs et les qualiteacutes drsquoHeacutenoch jusqursquoagrave le hisser au ni-veau de sar happanim un ange capable de se tenir debout devant la face de Dieu pour le servir LrsquoA traite de lrsquoaspect poleacutemique entre Heacutenoch et le personnage de Noeacute en dernier lieu Il y trouve des indices suppleacutementaires pour soutenir que lrsquoœuvre est un eacutecrit juif de la peacuteriode du Second Temple Cette conclusion ferme la boucle puisqursquoen introduction lrsquoA entendait deacutemontrer que 2 Heacutenoch constituait laquo a bridge between the early apocalyptic Enochic accounts and the later mysti-cal rabbinic and Hekhalot traditions raquo (p 17) On deacuteplore toutefois que lrsquoA reprenne sans reacuteserve
3 laquo Le Fils drsquohomme danieacutelique et les relectures de Dan VII 13 dans les apocryphes et les eacutecrits du Nouveau Testament raquo Ephemerides Theologicae Lovanienses 37 (1961) p 5-51 de mecircme que lrsquoeacutecrit posthume La relegraveve apocalyptique du messianisme royal II Le Fils drsquohomme veacuteteacutero- et intertestamentaire Leuven Peeters (laquo Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium raquo 61) 1983 p 128 et suiv
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
173
lrsquohypothegravese selon laquelle un Livre de Noeacute aurait veacuteritablement existeacute Drsquoabord formuleacutee par Robert H Charles cette hypothegravese centenaire est pour le moins discutable4 Neacuteanmoins la thegravese geacuteneacuterale de lrsquoA voulant qursquoune partie importante du contenu de 2 Heacutenoch fucirct motiveacutee par des preacuteoccupations poleacutemiques fournit une preacutecieuse cleacute de compreacutehension pour lrsquoeacutetude de ce texte LrsquoA propose de faccedilon convaincante un nouveau cadre drsquoanalyse que les futures eacutetudes sur le sujet ne pourront ignorer
Il est cependant dommage que lrsquoA nrsquoait pas oseacute aborder la question de la datation du Livre des Paraboles ouvrage auquel il se reacutefegravere freacutequemment Le lecteur averti aurait sucircrement appreacutecieacute que lrsquoA montre de quelle maniegravere son approche peut contribuer agrave eacuteclairer un problegraveme encore discuteacute le Livre des Paraboles eacutetant absent des nombreuses copies du Livre drsquoHeacutenoch retrouveacutees agrave Qumracircn Apregraves avoir releveacute le traitement particulier reacuteserveacute dans cette œuvre agrave certains titres dont celui de Fils de lrsquohomme lrsquoA nous laisse sans conclusion sur lrsquoeacutepoque de sa reacutedaction Souhaitons qursquoil traite de cette question difficile lors drsquoun prochain article On doit signaler agrave lrsquoattention du futur lec-teur que Birger A Pearson a fait connaicirctre le texte de lrsquoApocryphon copte drsquoHeacutenoch dans un livre paru vraisemblablement trop tard pour qursquoOrlov puisse en tenir compte dans le sien5 La lecture de ce texte constitue un compleacutement pertinent agrave The Enoch-Metatron Tradition
Pierre Cardinal
5 Eacutetienne NODET La crise maccabeacuteenne Historiographie juive et traditions bibliques Preacuteface par Marie-Franccediloise Baslez Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Œuvre de Flavius Josegravephe et eacutetudes raquo 6) 2005 X-446 p
Dans cet essai lrsquoA invite agrave une relecture subversive des sources entourant la crise macca-beacuteenne afin de poser un regard nouveau sur la fondation du judaiumlsme et sur la peacuteriode du Second Temple Marie-Franccediloise Baslez qui signe la preacuteface (p VII-X) lrsquoexprime de belle faccedilon en souli-gnant que Nodet manie volontiers le paradoxe et qursquoil aime agrave provoquer son lecteur afin de lrsquoinviter agrave remettre en cause certaines ideacutees reccedilues
Selon lrsquoA la crise maccabeacuteenne ne serait pas due agrave une reacuteaction conservatrice devant la me-nace drsquoinvasion drsquoune culture eacutetrangegravere mais constituerait plutocirct lrsquoacte de fondation drsquoun judaiumlsme jeacuterusaleacutemitain qui se dresse devant la religion palestinienne Il srsquoagirait donc avant tout du point de deacutepart drsquoun ordre nouveau plutocirct que la restauration drsquoanciennes normes religieuses Il srsquoen serait suivi la creacuteation de nouvelles fecirctes et lrsquoattribution de nouvelles significations agrave des fecirctes tradition-nelles LrsquoA donne en exemple la fecircte de Hanoukka qui prit agrave partir de cette eacutepoque une ampleur significative alors que lrsquoeacuteveacutenement qursquoelle ceacutelegravebre nrsquoaurait peut-ecirctre pas eacuteteacute si important
En plus des fecirctes cette nouvelle reacutealiteacute religieuse jeacuterusaleacutemitaine aurait contribueacute agrave lrsquoeacutetablisse-ment du canon des Eacutecritures tel que le judaiumlsme rabbinique lrsquoa reccedilu Parmi les ideacutees mises de lrsquoavant par lrsquoA on note en effet la remise en question des origines du Pentateuque qui se serait formeacute pro-gressivement quelques geacuteneacuterations seulement avant la crise La forme finale qui se serait imposeacutee agrave
4 Elle fut drsquoailleurs reacutecemment contesteacutee par Cana WERMAN laquo Qumran and the Book of Noah raquo dans Pseu-depigraphic Perspectives The Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls Leiden Brill (laquo Studies on the Texts of the Desert of Judah raquo 31) 1999 p 171-181 et Devorah DIMANT laquo Two ldquoScientificrdquo Fictions The so-called Book of Noah and the alleged Quotation of Jubilees in CD 163-4 raquo dans Studies in the Hebrew Bible Qumran and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich Leiden Brill (laquo Supplements to Vetus Testamentum raquo 101) 2006 p 230-249
5 Voir le chapitre 6 de son livre Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt New York T amp T Clark International (laquo Studies in Antiquity amp Christianity raquo) 2004 p 153-197
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
174
certains milieux de scribes serait agrave situer agrave lrsquoeacutepoque ougrave les Lagides controcirclaient la Judeacutee sous le pontificat des Oniades avec en tecircte le Grand Precirctre Simon le Juste (~200 AEC) agrave qui une tradition orale recueillie dans le traiteacute Pirqeacute Avoth accorde un rocircle preacuteeacuteminent dans la ligne de reacuteception et de transmission de la Torah Du mecircme coup lrsquoA invite agrave une nouvelle datation de la LXX qursquoil situe apregraves 150 AEC et agrave une datation basse du Pentateuque Samaritain laquo au plus tocirct au IIe siegravecle raquo (p 206) Les Samaritains ne seraient pas non plus des schismatiques de la religion judeacuteenne mais plutocirct les teacutemoins drsquoune ancienne reacutealiteacute israeacutelite
En conclusion lrsquoA soulegraveve deux questions La premiegravere qui est celle drsquoune possible influence grecque sur la reacutedaction finale de la Bible heacutebraiumlque ressort lrsquoancien deacutebat dont nous trouvons des eacutechos chez les apologistes chreacutetiens et dans le Contre Apion de Josegravephe voulant que Platon se soit inspireacute de Moiumlse LrsquoA propose alors que soit examineacutee en sens inverse cette tradition La seconde question se demande quelle instance aurait eacuteteacute en mesure de contribuer agrave la formation de la collec-tion de livres bibliques qui suivent le Pentateuque Consideacuterant drsquoune part que la collection deuteacutero-nomique est nettement projudeacuteenne et que de nombreux extraits des prophegravetes louent ceux qui sont en exil agrave Babylone tout en fustigeant ceux qui sont resteacutes et ceux qui ont fuit en Eacutegypte lrsquoA pose alors deux hypothegraveses ou bien il srsquoagit de lrsquoEacutetat asmoneacuteen ou bien drsquoune entiteacute adverse ayant une autoriteacute supeacuterieure En ce sens on souligne que 2 M 214 situe lrsquoactiviteacute litteacuteraire judeacuteenne apregraves la crise sous lrsquoautoriteacute de Judas Ce dernier eacuteleacutement nrsquoeacutetant probablement pas suffisant agrave expliquer lrsquoimportance que prit lrsquoEacutecriture apregraves ces eacuteveacutenements lrsquoA propose alors de faire intervenir les laquo fils de Sadoq raquo qui peuvent ecirctre ou bien des esseacuteniens ou bien des sadduceacuteens
Le meacuterite de ce livre est de bien faire comprendre le caractegravere pluriel de lrsquounivers religieux pa-lestinien agrave lrsquointeacuterieur mecircme des multiples courants du judaiumlsme Le style caracteacuteristique drsquoEacutetienne Nodet et son eacutecriture serreacutee et vive se reconnaissent tout au long du livre Nodet a le don de tenir son lecteur en haleine et de soutenir un suspens qui le rend impatient de poursuivre sa lecture comme srsquoil srsquoagissait drsquoun essai journalistique drsquoenquecircte Mais ce trait qui me plaicirct personnellement peut devenir une faiblesse pour drsquoautres dans la mesure ougrave il laisse trop souvent le lecteur agrave lui-mecircme Le neacuteophyte ou lrsquoeacutetudiant de premier cycle srsquoy perdra presque agrave coup sucircr Il faut en effet ecirctre deacutejagrave un bon connaisseur de la litteacuterature juive ancienne et de la litteacuterature classique pour suivre lrsquoA dans ses nombreux deacuteveloppements Dans la mesure ougrave on est preacutevenu il ne srsquoagit alors peut-ecirctre plus drsquoun deacutefaut
Serge Cazelais
Histoire litteacuteraire et doctrinale
6 John BEHR The Way to Nicaea Crestwood New York St Vladimirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 1) 2001 XII-261 p et ID The Nicene Faith Part One True God of True God Part Two One of the Holy Trinity Crestwood New York St Vladi-mirrsquos Seminary Press (coll laquo Formation of Christian Theology raquo 2) 2004 XVII-259 p et XI-245 p
Philosophe de formation John Behr eacutetudie la theacuteologie agrave Oxford avec comme centre drsquointeacuterecirct la formation de la penseacutee chreacutetienne primitive Il a obtenu un doctorat en theacuteologie patristique6 avec
6 John Behr srsquointeacuteresse agrave la penseacutee anthropologique et asceacutetique drsquoIreacuteneacutee de Lyon et de Cleacutement drsquoAlexan-drie Ses recherches doctorales ont eacuteteacute publieacutees sous le titre Ascetism and Anthropology in Irenaeus and Clement New York Oxford University Press 2000
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
175
des approches anthropologiques et sociologiques Dans les ouvrages qui font lrsquoobjet de cette recen-sion lrsquoA consacre peu drsquoespace au contexte historique institutionnel culturel ou intellectuel afin de se concentrer sur les questions theacuteologiques qui ont contribueacute agrave la formation de la theacuteologie chreacute-tienne La question de deacutepart de ses recherches est laquo Qui dites-vous que je suis (Mt 1515) raquo ques-tion que Jeacutesus lui-mecircme a poseacutee aux disciples agrave Ceacutesareacutee de Philippe Agrave travers sa compreacutehension drsquoIreacuteneacutee lrsquoA preacutesente soigneusement les reacuteponses apostoliques postapostoliques et des deux pre-miers conciles œcumeacuteniques agrave cette question eacutevangeacutelique Ainsi il nous introduit au cœur de la foi chreacutetienne quant agrave lrsquoidentiteacute de Jeacutesus Christ et nous fait deacutecouvrir le point de deacutepart de la theacuteologie dogmatique des quatre premiers siegravecles du christianisme Cependant lrsquoA lui-mecircme reconnaicirct que ses recherches ne repreacutesentent pas une entreprise archeacuteologique ni une histoire complegravete des dogmes chreacutetiens ni un survol narratif du deacuteveloppement theacuteologique ni non plus un manuel de la theacuteolo-gie patristique (vol I p 3-5) De plus les titres de ces volumes The Way to Nicaea et The Nicene Faith ne sont pas agrave prendre dans le sens que Niceacutee serait le moment deacutecisif ougrave toute la reacuteflexion theacuteologique anteacuterieure et posteacuterieure aurait trouveacute son aboutissement Lrsquointention de lrsquoA est plutocirct de nous aider agrave mieux comprendre pourquoi Niceacutee est devenu un eacuteveacutenement cleacute dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens La tradition dans laquelle ces volumes ont eacuteteacute eacutecrits est celle de lrsquoEacuteglise ortho-doxe par conseacutequent certains theacuteologiens ont eacuteteacute choisis en fonction de cette tradition et des sensi-biliteacutes christologiques et trinitaires speacutecifiques aux byzantins
Le premier volume The Way to Nicaea traite des trois premiers siegravecles de lrsquoegravere chreacutetienne Ce faisant le lecteur est ameneacute agrave mieux comprendre comment les eacuteleacutements de base du projet theacuteolo-gique se sont deacuteveloppeacutes ensemble et comment certaines questions plutocirct que drsquoautres ont retenu lrsquoattention des theacuteologiens La premiegravere partie est consacreacutee agrave la tradition apostolique et nous fait deacutecouvrir comment se sont eacutetablis le canon des Eacutecritures la succession apostolique et la proclama-tion du keacuterygme chreacutetien Dans la deuxiegraveme partie nous peacuteneacutetrons deacutejagrave dans la penseacutee des premiers Pegraveres postapostoliques Ignace drsquoAntioche Justin le Martyr et Ireacuteneacutee de Lyon Le point commun qui les unit est leur compreacutehension du Christ comme Logos de Dieu et le caractegravere salvifique de son incarnation de sa mort et de sa reacutesurrection Enfin la troisiegraveme partie nous conduit de Rome agrave Alexandrie et drsquoAlexandrie agrave Antioche afin de deacutecouvrir les deacutebats christologiques dans ces grands centres de reacuteflexion theacuteologique Nous sommes eacutegalement sensibiliseacutes agrave la penseacutee de leurs protago-nistes agrave savoir Hippolyte de Rome Origegravene et Paul de Samosate La question centrale qui preacuteoc-cupe ces theacuteologiens est drsquoune part celle de lrsquoeacuteterniteacute et de la subsistance propre du Logos et drsquoau-tre part la vraie humaniteacute et la vraie diviniteacute de Jeacutesus Christ Fils de Dieu incarneacute pour notre salut
Le second volume The Nicene Faith explore en deux parties la reacuteflexion theacuteologique du qua-triegraveme siegravecle peacuteriode ougrave le christianisme devient laquo christianisme niceacuteen raquo (vol II p XV) La pre-miegravere partie intituleacutee True God of True God analyse tout particuliegraverement les deacutebats theacuteologiques preacute- et postathanasiens Lrsquoobjectif de lrsquoA est de nous preacutesenter la reacuteflexion theacuteologique de ceux qui ont preacutepareacute drsquoune faccedilon incontournable la voie des conciles de Niceacutee et de Constantinople et qui ont contribueacute par leurs travaux agrave expliquer le contexte propre du Credo de Niceacutee-Constantinople et son interpreacutetation Pour ce faire il commence par nous preacutesenter une vision drsquoensemble des controver-ses du quatriegraveme siegravecle (ch 1) quelques figures cleacutes qui se situent agrave la fin du troisiegraveme et au deacutebut du quatriegraveme siegravecle comme Meacutethode drsquoOlympe Lucien drsquoAntioche et Eusegravebe de Ceacutesareacutee (ch 2) une bregraveve vue drsquoensemble de lrsquohistoire des nombreux synodes reacuteunis entre 318-382 (ch 3) les deacute-buts de la laquo crise arienne raquo et la confrontation theacuteologique qui opposa Arius agrave son eacutevecircque Alexandre drsquoAlexandrie et au premier concile œcumeacutenique tenue agrave Niceacutee en 325 (ch 4) Il preacutesente ensuite le personnage drsquoAthanase et la contribution theacuteologique qursquoil a apporteacutee agrave lrsquointeacuterieur mecircme du deacutebat doctrinal antiarien (ch 5) Dans une centaine de pages Behr nous offre lrsquoessence mecircme de la doctrine
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
176
athanasienne en reacuteaction agrave lrsquoarianisme agrave travers ses œuvres fondamentales Contre les Paiumlens et Sur lrsquoincarnation du Verbe Trois discours contre les Ariens Lettre agrave Marcellin et Vie drsquoAntoine
La seconde partie intituleacutee One of the Holy Trinity est consacreacutee agrave lrsquoeacutetude des Cappadociens Basile de Ceacutesareacutee (ch 6) Greacutegoire de Nysse (ch 7) et Greacutegoire de Nazianze (ch 8) ainsi que de leurs opposants Marcel drsquoAncyre Aetius Eunome et Apollinaire de Laodiceacutee Tout en deacutefendant la foi niceacuteenne les Cappadociens ont contribueacute agrave jeter les bases de la formulation de la foi trinitaire agrave tra-vers lrsquoexpression laquo μία οὐσία τρεῖς ὐποστάσεις raquo (Basile de Ceacutesareacutee Lettre 381) Le Pegravere le Fils et le Saint Esprit sont trois reacutealiteacutes distinctes et subsistantes constituant lrsquounique Dieu vrai vivant et tout-puissant La personne et lrsquoœuvre du Christ contempleacute laquo theacuteologiseacute raquo conduit agrave le confesser vrai Fils de Dieu et vrai Fils de lrsquohomme Dieu de la substance mecircme du Pegravere coeacuteternel et coglori-fieacute avec lui LrsquoEsprit-Saint est eacutegalement confesseacute implicitement par Niceacutee et explicitement par Constantinople pleinement divin comme le Fils et le Pegravere La distinction des personnes divines nrsquoest pas seulement eacuteconomique comme le voulait Marcel drsquoAncyre mais aussi theacuteologique Bref Jeacutesus Christ en tant que vrai Fils de Dieu et lrsquoEsprit-Saint en tant qursquoEsprit de Dieu ne partagent pas la vie divine comme des ecirctres ayant une origine exteacuterieure agrave Dieu mais ils sont des ecirctres consti-tutifs de lrsquounique diviniteacute confesseacutee comme Pegravere Fils et Saint Esprit
Deux points ressortent agrave la lecture de ces volumes Drsquoune part la reacuteponse agrave la question laquo Qui dites-vous que je suis raquo implique deux affirmations correacutelatives le Christ est le Christ crucifieacute et ressusciteacute personne du mystegravere pascal et le Christ est le Logos de Dieu crsquoest-agrave-dire pleinement Dieu Ces deux affirmations empecircchent la theacuteologie de se deacutetacher de la priegravere dans laquelle le Christ est rencontreacute comme le crucifieacute et le Seigneur ressusciteacute De plus ces deux affirmations empecircchent aussi la theacuteologie de se deacutetacher de la liturgie ougrave le peuple se trouve devant Dieu en tant que Corps du Christ Drsquoautre part ce travail inteacuteresse tout particuliegraverement les penseurs chreacutetiens qui font lrsquoeffort de rendre intelligible la confession apostolique sur le Christ mais aussi tout fidegravele qui veut srsquoapproprier drsquoune faccedilon adulte sa foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde et pour la divinisation de lrsquohomme Les lecteurs chreacutetiens qui nrsquoont jamais eu accegraves agrave une connais-sance approfondie de la foi niceacuteenne seront bien servis par cet excellent livre Behr nous fournit une seacuterie drsquoessais originaux compreacutehensibles et perspicaces de la theacuteologie des protagonistes cleacutes de la foi niceacuteenne Il nous preacutesente une vision accessible de la theacuteologie chreacutetienne centreacutee sur le Christ agrave la fois dans son mystegravere pascal et comme reacuteveacutelateur de la Triniteacute en tant que seconde personne de la diviniteacute En ce sens le chercheur nous offre une eacutetude acadeacutemique bien documenteacutee et de grand calibre
Lucian Dicircncă
7 Asteacuterios ARGYRIOU coord Chemins de la christologie orthodoxe Textes reacuteunis Paris Des-cleacutee (coll laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo 91) 2005 395 p
La collection laquo Jeacutesus et Jeacutesus-Christ raquo srsquoenrichit en publiant ces textes de grands theacuteologiens orthodoxes contemporains reacuteunis par Argyriou sous le titre Chemins de la christologie orthodoxe Comme le souligne Mgr Joseph Doreacute dans la preacutesentation qursquoil fait de lrsquoouvrage il eacutetait plus qursquour-gent que la collection consacre au moins un de ses volumes agrave laquo un panorama de la christologie or-thodoxe raquo parce qursquoelle nrsquoavait encore pu honorer qursquoune part fort limiteacutee de ce vaste champ Les theacuteologiens qui ont contribueacute agrave ce volume sont repreacutesentatifs de la geacuteographie des Eacuteglises ortho-doxes qui ont en commun lrsquolaquo orthodoxie raquo de la foi au Christ mort et ressusciteacute pour le salut du monde Ils nous preacutesentent une christologie tregraves coheacuterente qui se fonde principalement sur les affir-mations dogmatiques des premiers conciles œcumeacuteniques sur la tradition theacuteologique patristique et sur lrsquoEacutecriture assise de toute doctrine christologique Du point de vue de la meacutethode theacuteologique
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
177
lrsquoorthodoxie ne distingue ni ne traite agrave part le Jeacutesus historique et le Christ professeacute par la foi des premiers croyants Mais laquo lrsquoorthodoxie confesse le Christ comme vrai Dieu et vrai homme comme le Sauveur divin et le Seigneur du monde Cette foi dans le Christ theacuteanthropique est la veacuteritable lu-miegravere pour toute lecture orthodoxe de la Sainte Eacutecriture raquo (p 157) Crsquoest pourquoi lrsquooccidental pourra voir des coups de griffes contre la meacutethode exeacutegeacutetique trop critique voire soupccedilonneuse allant jus-qursquoagrave deacutevelopper une christologie qui nrsquoa plus rien agrave faire avec la doctrine de lrsquoEacuteglise (cf p 163-165)
Une fois les articles recueillis M Argyriou et Mgr Joseph Doreacute ont eu pour tacircche de les mettre dans un ordre coheacuterent en fonction des diverses sphegraveres de la christologie orthodoxe dont prove-naient les contributions Ils ont ainsi eacutetabli le plan du livre en quatre parties Lrsquoouvrage srsquoouvre avec lrsquohomeacutelie du patriarche Ignace IV drsquoAntioche prononceacutee en Allemagne agrave lrsquooccasion de la fecircte de lrsquolaquo Exaltation de la Croix raquo Ensuite la premiegravere seacuterie drsquoarticles est regroupeacutee sous le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de la Triniteacute raquo Le Dieu incompreacutehensible et inaccessible en son essence nous est reacuteveacuteleacute par Jeacutesus Christ Fils et Verbe de Dieu incarneacute dans la pluraliteacute des personnes du Pegravere du Fils et du Saint Esprit Les orientaux portent en eux la certitude ineacutebranlable que tous les hommes naissent avec le deacutesir de Dieu et que la foi au Christ comble ce deacutesir en offrant agrave lrsquohumaniteacute la gracircce de parti-ciper agrave la vie mecircme de Dieu Lrsquoadage des Pegraveres grecs laquo Dieu srsquoest fait homme pour que lrsquohomme devienne dieu raquo est le fondement de toute doctrine christologique orthodoxe qui est inseacuteparable de la doctrine trinitaire Du coup le mystegravere de lrsquoincarnation du Christ seconde personne de la Triniteacute est la cleacute de toute interpreacutetation biblique orthodoxe parce qursquoil est lieacute directement et neacutecessairement avec les mystegraveres fondamentaux de la vie chreacutetienne la Triniteacute le salut lrsquoEacuteglise
La seconde seacuterie drsquoarticles porte comme titre laquo Le Christ dans son mystegravere de lrsquoincarnation raquo La confession de foi orthodoxe en lrsquoincarnation est profondeacutement lieacutee agrave lrsquoeacuteconomie du salut divin qui trouve son sommet dans la mort et la reacutesurrection du Christ pour la vie du monde (p 115-130) Dans cette eacuteconomie les personnes divines travaillent ensemble pour la creacuteation le salut et la sanc-tification de lrsquohomme De lagrave vient la neacutecessiteacute pour les orthodoxes de faire le lien entre le Christ et les autres personnes de la Triniteacute afin drsquoeacuteviter de tomber dans les piegraveges doctrinaux contre lesquels lrsquoEacuteglise des premiers siegravecles a ducirc lutter agrave savoir patripassianisme monarchianisme arianisme etc Selon la foi orthodoxe il y a quatre faccedilons de parler du Christ selon les diffeacuterentes eacutetapes de lrsquoœuvre salvifique avant lrsquoincarnation ougrave le Christ est preacuteexistant avec le Pegravere et est de la mecircme substance que lui au moment de lrsquoincarnation pour indiquer lrsquoappauvrissement de Dieu et la deacuteification de lrsquohomme apregraves lrsquoincarnation afin de montrer lrsquounion hypostatique entre le Verbe de Dieu et notre nature humaine et enfin apregraves la reacutesurrection en lien avec la destineacutee eschatologique de lrsquohomme vivre eacuteternellement en Dieu (cf p 174-175)
La troisiegraveme partie regroupe des textes touchant au laquo Christ dans le mystegravere de sa reacutesurrec-tion raquo La meacuteditation orthodoxe de la passion et de la mort du Christ sur la croix ouvre la foi en lrsquoespeacuterance de la reacutesurrection Le Christ nrsquoa pas revecirctu la nature angeacutelique mais il a voulu prendre la nature humaine crsquoest-agrave-dire mortelle afin de la conduire agrave son accomplissement ultime la divi-nisation Le baptecircme est ce bain sacramentel de reacutegeacuteneacuteration de lrsquohomme qui le fait participer agrave la mort du Christ afin drsquoavoir part avec lui agrave sa reacutesurrection Les textes chanteacutes par la liturgie ortho-doxe hymne acathiste eacutepitaphios threacutenos octoegraveque pentecostaire ne font qursquoexprimer le mystegravere de lrsquoincarnation et celui de la reacutedemption apporteacutee par la reacutesurrection du Christ Devenu homme dans lrsquohistoire Dieu nrsquoa pas recours agrave une deacutemonstration empirique de sa reacutesurrection mais il opte pour lrsquoabsence du teacutemoignage oculaire sacrifiant le prestige de lrsquoobjectiviteacute historique agrave la foi des premiers croyants
Enfin la quatriegraveme partie porte le titre laquo Le Christ dans le mystegravere de lrsquoEacuteglise raquo La liturgie de lrsquoEacuteglise orthodoxe inspireacutee de la lecture biblique des reacuteflexions patristiques et de la mystique
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
178
monacale des heacutesychastes est le lieu par excellence de la christologie Dans la liturgie sous toutes ses formes les fidegraveles participent agrave la vie mecircme du Christ en se rendant identiques au Christ selon la gracircce Simeacuteon le Nouveau Theacuteologien disait cela avec beaucoup drsquoaudace dans une de ses hymnes laquo Nous sommes membres du Christ et le Christ est nos membres main est le Christ pied est le Christ pour le pauvre de moi et main du Christ et pied du Christ je suis moi le miseacuterable raquo (p 314) Dans lrsquoEacuteglise et dans la vie liturgique dont le sommet est laquo la Divine Liturgie raquo a lieu notre laquo chris-tification raquo nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ nous devenons par la simi-litude agrave Dieu des dieux par la gracircce en progressant sur la voie de la ceacuteleacutebration des mystegraveres (cf p 381-389)
La lecture de ces articles nous permet agrave nous les occidentaux trop marqueacutes par la theacuteologie de saint Augustin et par la philosophie carteacutesienne de constater principalement deux choses Premiegravere-ment le discours orthodoxe sur le Christ nrsquoest jamais seacutepareacute de la theacuteologie trinitaire eccleacutesiolo-gique et soteacuteriologique et srsquoimpose avec insistance comme une christologie purement confessante Selon Mgr Doreacute cela peut constituer agrave la fois laquo sa grande richesse et sa limite raquo (p 13) Deuxiegraveme-ment pour appuyer leurs affirmations les theacuteologiens orthodoxes puisent leur argumentation uni-quement au patrimoine patristique grec sans aucune reacutefeacuterence aux grands noms latins Tertullien Cyprien Ambroise ou encore moins Augustin
Lucian Dicircncă
8 Michel FEacuteDOU La voie du Christ Genegraveses de la christologie dans le contexte religieux de lrsquoAntiquiteacute du IIe siegravecle au deacutebut du IVe siegravecle Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Cogitatio Fidei raquo 253) 2006 553 p
La confession de foi au Christ ressusciteacute par les premiers chreacutetiens srsquoest fait dans un milieu marqueacute par une grande diversiteacute de pratiques de croyances de sagesses et de spiritualiteacutes Crsquoest pourquoi degraves lrsquoorigine les chreacutetiens ont ducirc rendre compte de leur foi au Christ et de sa signification universelle Aux premiers siegravecles du christianisme comme aujourdrsquohui la mecircme question traverse la penseacutee des theacuteologiens comment tenir ensemble agrave la fois lrsquoaffirmation de la reacuteveacutelation biblique confessant le Christ seul Sauveur du monde et reconnaicirctre drsquoautres voies conduisant agrave une expeacuterience du divin Dans ce livre Michel Feacutedou se propose drsquoeacutetudier la litteacuterature du christianisme ancien sous cet angle afin de nous offrir une synthegravese de haut niveau de sa lecture de nombreux textes patristiques qui vont du deuxiegraveme au deacutebut du quatriegraveme siegravecle Son objectif est de nous preacutesenter la reacuteponse des theacuteologiens de cette peacuteriode agrave la question tout en sachant que pour eux lrsquoautoriteacute suprecircme et leacutegitime eacutetait lrsquoEacutecriture inspireacutee Pour mieux encore situer lrsquooriginaliteacute de son travail lrsquoA mentionne dans lrsquointroduction trois chercheurs qui drsquoune faccedilon ou drsquoune autre ont abordeacute la question de la confession des premiers chreacutetiens au Christ et celle de leur originaliteacute dans le monde de leur temps L Capeacuteran avec son ouvrage Le problegraveme du salut des infidegraveles J Danieacutelou et sa tri-logie Theacuteologie du judeacuteo-christianisme Message eacutevangeacutelique et culture helleacutenistique au IIe et IIIe siegrave-cles Les origines du christianisme latin et A Grillmeier avec son classique Le Christ dans la tra-dition chreacutetienne Dans ses recherches lrsquoA srsquointerroge eacutegalement sur les racines antijuives qursquoon peut discerner dans la litteacuterature patristique Une des pistes de reacuteflexion qui nous est proposeacutee est drsquoeacuteliminer la tendance que nous avons trop souvent drsquoappliquer agrave ces theacuteologiens des concepts mo-dernes pour plutocirct faire ressortir lrsquointeacuterecirct que les Pegraveres ont eu pour le sens de lrsquoAlliance entre Dieu et le peuple drsquoIsraeumll et pour la reconnaissance du rocircle unique joueacute par ce peuple dans lrsquohistoire de lrsquohumaniteacute
Situeacutees dans le contexte drsquoune grande diversiteacute culturelle et religieuse ces recherches tentent de preacutesenter la singulariteacute du christianisme parmi les religions et les cultes qui se sont deacuteveloppeacutes
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
179
dans le monde meacutediterraneacuteen Justifiant leur croyance en Jeacutesus de Nazareth confesseacute comme Fils Monogegravene de Dieu les Pegraveres de lrsquoEacuteglise du deuxiegraveme jusqursquoau deacutebut du quatriegraveme siegravecle ont ap-porteacute une contribution essentielle agrave la reacuteflexion theacuteologique sur la christologie la soteacuteriologie et la doctrine trinitaire Ainsi agrave travers deacutebats et disputes theacuteologiques ils ont su privileacutegier la singu-lariteacute de laquo la voie du Christ raquo en conformiteacute avec la reacuteveacutelation biblique et avec la tradition eccleacutesias-tique en train de se mettre en place Pour faire ressortir avec plus de clarteacute agrave la fois les deacutebats portant sur le Christ et la voie privileacutegieacutee par les Pegraveres pour dire leur attachement et leur foi au Verbe de Dieu incarneacute pour notre salut et notre divinisation lrsquoA nous propose un parcours en sept eacutetapes constituant les sept chapitres de lrsquoouvrage
Tout drsquoabord il commence par eacutevoquer les principaux eacutecrits qui ont marqueacute les deacutebuts de la litteacuterature patristique Il srsquoagit des Pegraveres dits apostoliques en raison de leur proximiteacute chronologique avec les Apocirctres Cleacutement de Rome Ignace drsquoAntioche et Polycarpe de Smyrne Nous y trouvons eacutegalement drsquoautres eacutecrits fondamentaux du deacutebut du christianisme tels que le Symbole des Apocirctres et la Didachegrave des eacutecrits apocryphes neacutes simultaneacutement ou tout juste apregraves les eacutecrits canoniques des reacutecits des premiers martyrs et des poeacutesies chreacutetiennes comme les Odes de Salomon et les Oracles sibyllins Ensuite la place est faite agrave la litteacuterature apologeacutetique chreacutetienne du deuxiegraveme siegravecle Ce genre litteacuteraire qui est neacute afin de reacutefuter les accusations souvent porteacutees contre les chreacutetiens a permis de deacutevelopper toute une reacuteflexion sur les eacutenonceacutes centraux de la foi chreacutetienne son rite et son culte La troisiegraveme eacutetape nous introduit agrave lrsquointeacuterieur mecircme du contexte gnostique de la fin du deuxiegraveme et du deacutebut du troisiegraveme siegravecle afin de suivre la meacutethode theacuteologique drsquoIreacuteneacutee de Lyon qui a eacutelaboreacute une penseacutee christologique sur le Logos de Dieu en opposition aux gnostiques marcionites Tout le quatriegraveme chapitre est consacreacute agrave Cleacutement drsquoAlexandrie analyseacute sous lrsquoangle bien particulier de sa reacuteflexion theacuteologique sur le Christ en rapport avec drsquoautres traditions cultu-relles et religieuses du christianisme ancien Au cinquiegraveme chapitre lrsquoA aborde les positions chris-tologiques et trinitaires de quatre theacuteologiens du deacutebut du troisiegraveme siegravecle agrave savoir Tertullien en opposition agrave Marcion et agrave Praxeacuteas Hippolyte de Rome et sa lutte laquo antimodaliste raquo et laquo antipatri-passienne raquo dont les repreacutesentants de marque eacutetaient Noeumlt et Sabellius Novatien qui agrave cause de son rigorisme chreacutetien intransigeant est alleacute jusqursquoagrave fonder agrave Rome une Eacuteglise schismatique et Cyprien surtout connu par son adage qui a traverseacute les siegravecles jusqursquoagrave aujourdrsquohui laquo Hors de lrsquoEacuteglise point de salut7 raquo Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave lrsquoincontournable Origegravene laquo lrsquoune des plus gran-des figures du christianisme ancien raquo (p 375) LrsquoA un speacutecialiste du maicirctre alexandrin8 nous in-troduit dans lrsquoacircme de la theacuteologie origeacutenienne agrave la fois apologeacutetique dans le Contre Celse et dog-matique dans le Peacuteri Archocircn Lrsquoangle sous lequel Origegravene est envisageacute est celui de la reacuteponse qursquoil propose au deacuteveloppement de sa theacuteologie du Christ face aux divers deacutebats et traditions preacutesents dans lrsquoAlexandrie de son temps Enfin lrsquoouvrage se termine par une analyse qui nrsquoest pas exhaus-tive de la litteacuterature patristique de la seconde moitieacute du troisiegraveme et deacutebut du quatriegraveme siegravecle Nous rencontrons deux auteurs de langue latine Arnobe et Lactance et un auteur de langue grecque Meacutethode drsquoOlympe La seconde partie de ce mecircme chapitre est consacreacutee agrave la reacuteflexion sur lrsquoexpeacute-rience monastique qui prit naissance dans le deacutesert drsquoEacutegypte agrave cette eacutepoque Ici Feacutedou se sent obli-geacute de deacutepasser un peu la limite qursquoil avait imposeacutee agrave ses recherches en faisant appel agrave un eacutecrit de la seconde moitieacute du quatriegraveme siegravecle la Vie drsquoAntoine drsquoAthanase drsquoAlexandrie LrsquoA justifie ce
7 Sur lrsquointerpreacutetation de cet adage dans lrsquohistoire voir le reacutecent ouvrage de Bernard SESBOUumlEacute laquo Hors de lrsquoEacuteglise pas de salut raquo Histoire drsquoune formule et problegravemes drsquointerpreacutetation Paris Descleacutee 2004 auquel Feacutedou renvoie souvent dans ce chapitre
8 Michel FEacuteDOU La Sagesse et le monde Essai sur la christologie drsquoOrigegravene Paris Descleacutee 1995 Chris-tianisme et religions paiumlennes dans le laquo Contre Celse raquo drsquoOrigegravene Paris Beauchesne 1989
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
180
choix en affirmant qursquoil permet laquo de voir comment la relation avec le Christ eacuteclaire la destineacutee de saint Antoine et comment lrsquoexpeacuterience ainsi veacutecue suscite par lagrave mecircme un renouvellement du lan-gage christologique raquo (p 514) Par contre lrsquoA choisit intentionnellement de ne pas avoir recours agrave lrsquoHistoire eccleacutesiastique drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee pour exposer les faits historiques de son exposeacute en raison de sa reacutedaction au deacutebut du quatriegraveme siegravecle et parce que cela demanderait un examen plus eacutelargi de lrsquoarianisme et de la reacuteaction de Niceacutee
Le lecteur qursquoil soit apprenti theacuteologien ou tout simplement inteacuteresseacute par les deacutebats theacuteologi-ques du deacutebut du christianisme trouvera dans cet ouvrage une reacuteflexion intellectuelle rigoureuse et accessible qui lui permettra de mieux comprendre ou du moins de saisir les raisons qui ont conduit les premiers theacuteologiens agrave privileacutegier laquo la voie du Christ raquo dans un contexte pluriculturel et plurire-ligieux La singulariteacute de ce choix trouve sa raison ultime dans la reacuteveacutelation biblique interpreacuteteacutee dans la tradition de lrsquoEacuteglise qui se met en place progressivement LrsquoA exprime sa conviction que les reacuteponses deacuteceleacutees chez les Pegraveres de lrsquoEacuteglise quant agrave leur penseacutee theacuteologie sur le Christ laquo ne se-ront pas seulement instructives pour notre connaissance de la christologie ancienne mais qursquoelles contribueront pour leur part agrave eacuteclairer notre propre reacuteflexion sur la voie du Christ parmi les diverses traditions de lrsquohumaniteacute raquo (p 30)
Lucian Dicircncă
9 Philippe HENNE Introduction agrave Hilaire de Poitiers suivie drsquoune Anthologie Paris Les Eacutedi-tions du Cerf (coll laquo Initiation aux Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo) 2006 238 p
Apregraves avoir consacreacute un preacuteceacutedent ouvrage agrave Origegravene9 Philippe Henne en publie un second portant sur Hilaire de Poitiers laquo avec lequel commence la grande theacuteologie latine raquo (p 13) construit sur le mecircme modegravele une preacutesentation de lrsquohomme et de sa theacuteologie suivie drsquoune anthologie de ses textes La preacuteface du livre a eacuteteacute reacutedigeacutee par Mgr Albert Rouet lrsquoactuel archevecircque de Poitiers Parce qursquoil a contribueacute au quatriegraveme siegravecle agrave stopper lrsquoexpansion de lrsquoarianisme et agrave promouvoir le Sym-bole niceacuteen on a fait drsquoHilaire lrsquolaquo Athanase de lrsquoOccident raquo agrave savoir lrsquoincarnation de la foi niceacuteenne laquo Non seulement il eacutecrit mais il se bat pour la foi et pour lrsquoeacutevangeacutelisation Seul au milieu drsquoun eacutepiscopat sans courage il affirme la foi de Niceacutee raquo (p 14)
Lrsquoouvrage est structureacute en trois parties Dans la premiegravere partie nous sommes drsquoabord intro-duits au milieu politique social et religieux qui a vu naicirctre le futur eacutevecircque de Poitiers et qui a in-fluenceacute le deacuteveloppement sa penseacutee theacuteologique Les eacuteveacutenements majeurs agrave retenir de cette peacuteriode sont lrsquoarriveacutee au pouvoir de Constantin et avec lui la fin des perseacutecutions contre les chreacutetiens de mecircme que la quasi-imposition du christianisme comme religion officielle de lrsquoEmpire LrsquoA suit en-suite Hilaire dans sa formation intellectuelle et sa conversion jusqursquoagrave son eacutelection sur le siegravege eacutepis-copal de Poitiers Sa recherche drsquoabsolu et drsquoun principe unique et indivisible le conduit agrave rencon-trer le christianisme et agrave recevoir le baptecircme de reacutegeacuteneacuteration vers 345 Lrsquoeacutepiscopat lui fut accordeacute vers 353 Enfin nous sommes sensibiliseacutes aux premiers combats de cet eacutevecircque occidental qui comme Athanase en Orient nrsquoa pas eacutechappeacute agrave la condamnation et agrave lrsquoexil pour sa deacutefense de la foi niceacuteenne La deuxiegraveme partie nous fait deacutecouvrir en profondeur un eacutevecircque qui se bat pour la veacuteriteacute et qui deacutefend la vraie diviniteacute du Verbe de Dieu fait homme pour notre salut Exileacute en Phrygie Hilaire poursuit son combat theacuteologique et deacutemontre la fausseteacute de la doctrine arienne et lrsquoimpieacuteteacute qursquoelle entraicircne envers notre Seigneur Jeacutesus Christ vrai Dieu et vrai homme De cette peacuteriode nous gardons ses grands eacutecrits dogmatiques Sur les Synodes et Sur la Triniteacute Le premier ouvrage est la
9 Introduction agrave Origegravene suivie drsquoune Anthologie Paris Cerf 2004
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
181
constitution drsquoun dossier faisant le point sur toute la querelle arienne depuis ses deacutebuts vers 318 jusqursquoen 358 date de la composition de lrsquoouvrage Le second est une premiegravere pour la theacuteologie oc-cidentale sur une question aussi vaste et difficile laquo Hilaire srsquoeacutelegraveve au-dessus des querelles et des disputes et essaie drsquoembrasser le sujet dans toute son eacutetendue raquo (p 79) Enfin la troisiegraveme partie trace les eacutetapes qui ont conduit agrave la deacutecadence de lrsquoarianisme apregraves ses anneacutees de gloire Hilaire revient agrave Poitiers et contribue de toutes ses forces au reacutetablissement de lrsquoorthodoxie en Gaule Plu-sieurs ouvrages eacutecrits dans la derniegravere peacuteriode de sa vie nous font connaicirctre en Hilaire un homme de foi nourri de lrsquoEacutecriture et un pasteur drsquoacircmes avec lesquelles il veut partager sa passion et son amour pour le Christ le Verbe de Dieu fait chair pour nous
LrsquoAnthologie qui suit cette introduction agrave la vie et agrave la penseacutee drsquoHilaire de Poitiers retrace agrave partir des textes son cheminement spirituel le deacuteveloppement de sa penseacutee theacuteologique et les com-bats qui furent siens pour la deacutefense de la foi niceacuteenne La lecture de ces textes nous permet de mieux situer Hilaire dans lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise du quatriegraveme siegravecle en relation avec des theacuteologiens et leur penseacutee christologique et trinitaire Sans preacutetendre agrave lrsquoexhaustiviteacute cet exposeacute empreint de clarteacute et de rigueur scientifique permet mecircme aux lecteurs moins familiers avec les deacutebats theacuteologiques du grand siegravecle patristique de saisir lrsquoapport et lrsquoinfluence de lrsquoeacutevecircque de Poitiers pour lrsquoannonce de la veacuteriteacute sur le Christ confesseacute par les chreacutetiens apregraves Niceacutee consubstantiel au Pegravere
Lucian Dicircncă
10 Bernard MEUNIER dir La personne et le christianisme ancien Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006 360 p
Lrsquoouvrage qui fait lrsquoobjet de cette recension nrsquoest pas un regroupement de plusieurs articles mais est plutocirct un travail collectif sur un mecircme sujet En effet ce livre est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs de la Faculteacute de Theacuteologie de Lyon qui ont travailleacute pendant trois ans sous la direction de Bernard Meunier agrave lrsquoeacutelaboration drsquoune eacutetude commune Les recherches historiques philosophiques et theacuteologiques ont conduit le groupe drsquoeacutetude agrave reacutepondre agrave la question quelle fut la contribution de la notion de laquo persona raquo en latin laquo prosocircpon raquo et laquo hypostasis raquo en grec agrave lrsquoeacutemer-gence progressive du sujet moderne Pour ce faire les auteurs se sont inteacuteresseacutes aux deacutebats theacuteolo-giques autour de la Triniteacute un Dieu en trois personnes et du Christ Dieu et homme en une seule personne Ils sont arriveacutes au constat que crsquoest agrave cause de la theacuteologie chreacutetienne que laquo le destin des deux premiers srsquoest trouveacute reacuteuni agrave celui du troisiegraveme et cette interfeacuterence a pu influer sur leur pro-pre eacutevolution raquo (p 15) Selon le reacutecit de Gn 126 Dieu a creacuteeacute lrsquohomme personnel agrave son image et le christianisme nous enseigne que lrsquohomme en regardant la Triniteacute deacutecouvre la notion de personne pour se penser lui-mecircme Les auteurs de lrsquoouvrage ont voulu soumettre cette laquo thegravese seacuteduisante raquo (p 11) agrave lrsquoeacutepreuve des textes philosophiques et theacuteologiques de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne afin de voir si crsquoest bien le christianisme antique qui a engendreacute la notion de laquo personne raquo Une des preacutecautions meacute-thodologiques a eacuteteacute de ne pas remonter dans lrsquohistoire agrave partir de la conception moderne de laquo per-sonne raquo pour en chercher des eacutebauches dans la litteacuterature patristique Le choix des chercheurs a plutocirct eacuteteacute de privileacutegier quelques mots cleacutes laquo persona raquo laquo prosocircpon raquo laquo hypostasis raquo et de suivre leur des-tineacutee dans des textes chreacutetiens de Tertullien au deuxiegraveme siegravecle agrave Jean Damascegravene au huitiegraveme siegrave-cle Drsquoautres termes avoisinants font surface dans ces recherches laquo substance raquo laquo nature raquo laquo subsis-tance raquo et laquo individu raquo La structure du travail se laisse deacutecouvrir drsquoelle-mecircme et constitue quatre dossiers
Le premier consacreacute au terme laquo persona raquo ouvre le cycle de ces recherches Le choix de ce terme pour commencer lrsquoanalyse srsquoexplique drsquoune part par la continuiteacute lexicale entre le terme latin laquo persona raquo et sa traduction franccedilaise laquo personne raquo et drsquoautre part par le fait que ce terme offre une
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
182
base solide pour penser lrsquoindividualiteacute Ce dossier nous fait deacutecouvrir lrsquousage du terme laquo persona raquo que Tertullien Hilaire et Augustin font dans leurs eacutecrits consideacutereacutes comme repreacutesentatifs des theacuteologiens latins La continuiteacute seacutemantique a de quoi frapper le lecteur Les theacuteologiens mention-neacutes nous font deacutecouvrir que laquo persona raquo nrsquoest pas un concept et qursquoil ne le devient pas non plus dans la litteacuterature chreacutetienne tardive laquo malgreacute son passage par la theacuteologie trinitaire et la christo-logie raquo (p 101) Le deuxiegraveme dossier qui analyse le mot grec laquo prosocircpon raquo nous fait deacutecouvrir lrsquoeacutevolution de ce terme des origines jusqursquoagrave la fin de lrsquoAntiquiteacute Des auteurs paiumlens Aristophane Platon et Plutarque et des auteurs chreacutetiens Ignace drsquoAntioche Justin Origegravene Marcel drsquoAncyre Eusegravebe de Ceacutesareacutee Athanase et les Cappadociens sont analyseacutes afin drsquoextraire lrsquoessentiel de leur penseacutee quant agrave lrsquoemploi du terme laquo prosocircpon raquo De plus la traduction grecque de la Bible (LXX) et des auteurs juifs helleacuteniseacutes font lrsquoobjet drsquoenquecircte dans ce dossier Les auteurs concluent de leur analyse que la theacuteologie chreacutetienne agrave partir du troisiegraveme siegravecle fixe son attention sur le mot laquo prosocircpon raquo fait de lui lrsquoeacutequivalent latin laquo persona raquo et lrsquoapplique agrave la doctrine trinitaire et christologique Par ce processus laquo prosocircpon raquo devient ainsi un terme theacuteologique technique Le but sous-jacent des auteurs est de voir si lrsquoemploi theacuteologique du terme trois personnes dans la Triniteacute et lrsquounique personne du Christ en deux natures conduit agrave lrsquoengendrement de lrsquoexpression anthropologique de laquo personne humaine raquo Le troisiegraveme dossier enquecircte sur laquo hypostasis raquo terme deacutejagrave effleureacute dans les deux pre-miers dossiers Nous sommes ici familiariseacutes avec les donneacutees theacuteologiques de ce terme agrave travers les deacutebats trinitaires une ou trois hypostases en Dieu et christologiques une ou deux hypostases en Christ Bien que ce terme ne puisse ecirctre deacutetacheacute des deux autres lrsquolaquo hypostasis raquo joue tout de mecircme un rocircle qui lui est propre et connaicirct sa propre eacutevolution Les auteurs portent leur attention sur les premiers emplois du terme dans la litteacuterature classique grecque dans la Bible de la LXX et dans la theacuteologie trinitaire et christologique Les reacutesultats de cette enquecircte sont surprenants et tregraves reacuteveacutela-teurs Le sens concret laquo deacutepocirct raquo laquo seacutediment raquo laquo fondement raquo devient sens abstrait dans les premiers siegravecles du christianisme laquo une sorte de concept ontologique (ldquoexistencerdquo ldquosubsistancerdquo) raquo (p 235) Ce sens se prolongera dans la philosophie tardive Crsquoest avec les deacutebats trinitaires du quatriegraveme siegravecle que le terme retrouve son sens premier et en vient agrave deacutesigner les trois dans la Triniteacute Enfin le qua-triegraveme et dernier dossier pose la question La laquo personne raquo est-elle un concept ontologique Pour y reacutepondre les chercheurs font tout drsquoabord appel agrave la deacutefinition boeacutetienne de laquo persona raquo en essayant drsquoen deacutegager agrave la fois les influences Augustin et Marius Victorinus et lrsquooriginaliteacute Il srsquoensuit une enquecircte sur laquo hypostasis raquo dans la controverse christologique aux sixiegraveme-septiegraveme siegravecles notamment dans les eacutecrits de Jean de Ceacutesareacutee Leacuteonce de Byzance Leacuteonce de Jeacuterusalem et Maxime le Confesseur On en arrive au constat que la litteacuterature patristique tardive avec ses controverses trinitaires et christologiques a joueacute un rocircle tregraves feacutecond dans lrsquohistoire de la penseacutee Enfin le qua-triegraveme dossier se clocirct sur lrsquoanalyse des termes laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo dans les Dialectica de Jean Damascegravene On srsquointerroge plus particuliegraverement sur sa faccedilon de comprendre et drsquoutiliser les deux termes dans ses deacuteveloppements theacuteologiques Chez ce Pegravere byzantin on deacutecouvre une faccedilon originale drsquounir laquo hypostasis raquo et laquo prosocircpon raquo qui conduit agrave confeacuterer un appui plus fort aux dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ Cette eacutetude pourrait ecirctre eacutegalement laquo utile aux recherches theacuteologi-ques actuelles raquo (p 331) et agrave lrsquoanthropologie
Lrsquoouvrage en lui-mecircme nrsquoa pas la preacutetention drsquoecirctre un exposeacute suivi et deacutetailleacute de lrsquoanthropolo-gie philosophique ou theacuteologique Il ne veut pas ecirctre non plus une histoire des dogmes sur la Triniteacute et sur le Christ vus agrave travers le prisme du terme technique laquo personne raquo Le but de lrsquoeacutetude est beau-coup plus preacutecis laquo Examiner les mots et les concepts qui agrave un moment ou agrave un autre dans les deacutebats theacuteologiques anciens ont eacuteteacute ameneacutes agrave exprimer lrsquoindividualiteacute en Dieu ou dans lrsquohumaniteacute et sont susceptibles drsquoavoir permis ensuite agrave long terme une penseacutee de la personne raquo (p 16) Crsquoest pour-quoi mecircme le lecteur moins initieacute aux grands deacutebats patristiques autour des dogmes fondamentaux
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
183
du christianisme trouvera dans les pages de ce livre des synthegraveses et des monographies accessibles qui lui permettront de se familiariser avec le rocircle qursquoaurait joueacute le christianisme dans lrsquoeacutemergence de lrsquoindividu au sein drsquoune culture antique qui raisonnait surtout en termes collectifs
Lucian Dicircncă
11 Xavier MORALES La theacuteologie trinitaire drsquoAthanase drsquoAlexandrie Paris Institut drsquoEacutetudes Augustiniennes (coll laquo Eacutetudes Augustiniennes raquo seacuterie laquo Antiquiteacute raquo 180) 2006 609 p
Dans lrsquohistoire des dogmes chreacutetiens Athanase drsquoAlexandrie (298-373) est connu comme le deacutefenseur acharneacute devant la crise arienne de la foi niceacuteenne en la pleine diviniteacute et humaniteacute du Verbe de Dieu fait chair par philanthropie pour notre divinisation laquo Le Verbe de Dieu srsquoest fait homme pour que nous devenions Dieu raquo (Sur lrsquoincarnation 543) Si cette conviction de foi lui a valu les plus grands honneurs par exemple ceux de Greacutegoire de Nazianze qui voit en lui le laquo pilier de lrsquoEacuteglise alexandrine raquo et ceux de Basile de Ceacutesareacutee qui le compare au laquo Meacutedecin capable de gueacuterir les maladies dont souffre lrsquoEacuteglise raquo son intransigeance face aux heacutereacutetiques fut par contre la cause de plusieurs bannissements loin de son siegravege eacutepiscopal Les derniegraveres deacutecennies ont eacuteteacute marqueacutees par un deacutesir de la part des chercheurs de faire connaicirctre davantage ce Pegravere de lrsquoEacuteglise Avec lrsquoouvrage de Xavier Morales preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat agrave Paris en 2003 nous avons pour la premiegravere fois une vue drsquoensemble de la penseacutee trinitaire drsquoAthanase laquo resteacutee largement inexplo-reacutee raquo (p 9) jusqursquoici Lui-mecircme auteur de textes theacuteologiquement denses sur la Triniteacute et sur chacune des personnes divines Athanase est celui qui ouvrit la porte aux trois theacuteologiens cappadociens Basile de Ceacutesareacutee Greacutegoire de Nazianze et Greacutegoire de Nysse que la posteacuteriteacute considegravere comme les premiers grands theacuteologiens de la Triniteacute
Avec cet ouvrage Morales se propose de relever le langage theacuteologique employeacute par Athanase pour exprimer agrave la fois la diversiteacute et lrsquouniteacute de la diviniteacute Avec cette intention lrsquoA divise tout na-turellement son travail en deux parties Dans la premiegravere partie il tente de reacutepondre agrave la question laquo Comment Athanase parle-t-il de la distinction reacuteelle entre les personnes divines raquo tandis que dans la seconde il cherche agrave savoir laquo Comment Athanase parle-t-il de lrsquouniteacute des personnes divines entre elles voire de lrsquouniciteacute du Dieu trinitaire raquo (p 11) Ces deux parties sont structureacutees autour de deux termes techniques en theacuteologie trinitaire ὑπόστασις pour exprimer la diversiteacute reacuteelle des personnes et οὐσία pour indiquer lrsquouniteacute de la diviniteacute
laquo Athanase est-il un theacuteologien des trois hypostases raquo voilagrave la question de fond qui traverse toute la premiegravere partie du livre Le chercheur constate qursquoun regard rapide jeteacute sur les œuvres atha-nasiennes entraicircne une reacuteponse neacutegative Crsquoest pourquoi il se propose dans un premier temps de relever les occurrences du terme ὑπόστασις dans le corpus athanasien afin de confirmer ce preacutejugeacute et drsquoapporter des eacuteleacutements de reacuteflexion permettant drsquoinseacuterer le langage theacuteologique drsquoAthanase agrave lrsquointeacuterieur mecircme des deacutebats theacuteologiques et dogmatiques qui ont fait le renom du quatriegraveme siegravecle Agrave Niceacutee en 325 les termes ὑπόστασις et οὐσία sont pris pour des synonymes synonymie preacutesente eacutegalement sous la plume drsquoAthanase jusqursquoen 362 date de la reacutedaction de la synodale drsquoAlexan-drie le Tome aux Antiochiens Cependant lrsquoeacutevecircque alexandrin ne deacutement jamais dans ses eacutecrits sa croyance en la Triniteacute des personnes divines et en la subsistance propre de chacune drsquoentre elles sans confusion comme le voulaient les sabelliens et sans hieacuterarchisation comme le soutenaient les ariens La doctrine de la correacutelation divine veut que le Pegravere soit Pegravere eacuteternellement En tant que Pegravere eacuteternel il doit donc neacutecessairement avoir un Fils eacuteternel et il doit y avoir un Esprit-Saint eacuteternel qui unit le Pegravere au Fils depuis toute eacuteterniteacute La doctrine des processions dans la diviniteacute est eacutegalement un argument biblique solide qui permet agrave Athanase drsquoexposer la distinction personnelle dans la Triniteacute sans laquo faire appel agrave la techniciteacute des termes trinitaires deacuteveloppeacutee par la theacuteologie orientale
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
184
et cappadocienne raquo (p 231) Le terme οὐσία constitue le centre drsquointeacuterecirct du chercheur pour la seconde partie de son travail Le terme est freacutequent chez Athanase surtout dans les œuvres poleacute-miques contre les ariens diviseacutes en diffeacuterents partis homeacuteens homoiousiens anomeacuteens Agrave la base de cette diversiteacute parmi les ariens se trouve le terme technique laquo consubstantiel raquo qui constitue lrsquoori-ginaliteacute du premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Dans lrsquoeacutelaboration de sa theacuteologie trinitaire lrsquoeacutevecircque drsquoAlexandrie doit confronter sa propre conception de ce terme face aux extreacute-mismes des anomeacuteens et chercher des compromis avec les homoiousiens et les homeacuteens Le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit Saint doivent neacutecessairement partager lrsquounique substance divine afin drsquoeacuteviter agrave la fois le polytheacuteisme et la hieacuterarchie ontologique en Dieu Dans des mots simples mais argumenteacutes en srsquoappuyant constamment sur lrsquoEacutecriture Athanase laisse agrave la posteacuteriteacute lrsquoimage drsquoun eacutevecircque theacuteo-logien qui a su offrir agrave ses ouailles la nourriture cateacutecheacutetique neacutecessaire pour garder lrsquointeacutegriteacute de la foi heacuteriteacutee de la preacutedication des Apocirctres envoyeacutes par le Christ sur toute la terre en leur ordonnant drsquoaller et de faire laquo des disciples de toutes les nations les baptisant au nom du Pegravere et du Fils et du Saint Esprit raquo (Mt 2819)
Le dogme de la Triniteacute ne fait plus problegraveme parmi les chreacutetiens drsquoaujourdrsquohui Le Cateacutechisme les manuels de theacuteologie les formules dogmatiques sont lagrave pour maintenir et soutenir notre confes-sion de foi trinitaire Le grand meacuterite de cet ouvrage est de nous faire deacutecouvrir qursquoil nrsquoen a pas eacuteteacute toujours ainsi mais que drsquoincessantes luttes theacuteologiques ont ducirc avoir lieu afin que lrsquoEacuteglise puisse cristalliser au fil des eacuteveacutenements sa croyance en Dieu Un et Trine agrave la fois Le lecteur assoiffeacute de connaicirctre les deacutebats qui ont conduit agrave la cristallisation du dogme de la Triniteacute sera bien servi en li-sant cet ouvrage Crsquoest pourquoi il peut ecirctre une base solide pour les apprentis theacuteologiens qui srsquoin-teacuteressent agrave la theacuteologie patristique orientale en particulier Nous deacuteplorons toutefois le fait que lrsquoA nrsquoait pas investi davantage dans une mise en forme simplifieacutee de ses recherches doctorales afin de rendre lrsquoouvrage accessible au plus grand nombre
Lucian Dicircncă
12 Sara PARVIS Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 New York Oxford University Press (coll laquo Oxford Early Christian Studies raquo) 2006 XI-291 p
Preacutesenteacute drsquoabord comme thegravese de doctorat deacutefendue agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg cet ouvrage a eacuteteacute enrichi par trois anneacutees suppleacutementaires de recherches postdoctorales avant drsquoarriver agrave sa publi-cation Le principal objectif de Sara Parvis dans cette eacutetude meacuteticuleuse et savante est de nous mon-trer que les deux partis en opposition ariens sous la tutelle drsquoArius et niceacuteens sous la tutelle drsquoAlexandre drsquoAlexandrie et de son successeur Athanase ont continueacute leurs disputes christologi-ques mecircme apregraves la dogmatisation des expressions laquo de la substance du Pegravere raquo et laquo consubstantiel au Pegravere raquo par le premier concile œcumeacutenique reacuteuni agrave Niceacutee en 325 Le personnage cleacute autour duquel ces recherches sont concentreacutees est le controverseacute eacutevecircque drsquoAncyre Marcel Preacutesent au concile il soutient Athanase en 335 au synode de Tyr alors qursquoil est deacutejagrave assez acircgeacute Deacuteposeacute en 336 il fut condamneacute en Orient degraves 341 et en Occident agrave partir de 345 comme proche de la doctrine de Sabel-lius Agrave travers lrsquoeacutetude de ce personnage lrsquoA poursuit un double but drsquoune part nous familiariser avec les positions doctrinales de Marcel souvent deacutecrit laquo comme ayant introduit des doctrines reacutevo-lutionnaires10 raquo dans lrsquoEacuteglise et drsquoautre part nous sensibiliser avec le contenu dogmatique et doctri-nal des deacutebats interconciliaires Niceacutee 325 et Constantinople 381 en lien avec la crise arienne En effet le Symbole de foi signeacute agrave Niceacutee nrsquoa pas calmeacute les esprits des opposants Au contraire se sont
10 SOZOMEgraveNE Histoire eccleacutesiastique II331 trad Andreacute-Jean Festugiegravere Paris Cerf (coll laquo Sources Chreacute-tiennes raquo 306) p 377
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
185
succeacutedeacutees des peacuteriodes entremecircleacutees drsquoexcommunications et de reacutetablissements tantocirct des niceacuteens Athanase et Marcel tantocirct des ariens Arius et Asteacuterius Il faut savoir aussi que tout cela se produi-sait avec le concours du pouvoir impeacuterial en place
LrsquoA nous propose un plan en cinq chapitres Le premier chapitre est consacreacute agrave une vue drsquoen-semble de la figure de Marcel sa formation son eacutepiscopat et sa theacuteologie Les ouvrages majeurs qui nous permettent de reconstituer et reconsideacuterer la doctrine de Marcel sont le Contre Asteacuterius eacutecrit vers 330 et dont drsquoimportants fragments ont surveacutecu et la Lettre agrave Jules de Rome eacutecrite vers 341 LrsquoA nous donne des traductions ineacutedites de diffeacuterents autres textes disseacutemineacutes surtout chez des Pegraveres de lrsquoEacuteglise qui ont combattu sa theacuteologie comme Eusegravebe et Basile deux eacutevecircques de Ceacutesareacutee Au deuxiegraveme chapitre nous deacutecouvrons un Marcel qui se veut deacutefenseur rigoureux de la foi de Niceacutee Ce rigorisme le fait tomber dans lrsquoautre extrecircme doctrinal condamneacute deacutejagrave quelques deacutecen-nies auparavant dans la personne de Sabellius Il srsquoagit principalement de la neacutegation drsquoune subsis-tance propre accordeacutee au Verbe de Dieu et par conseacutequent de la neacutegation de lrsquoexistence indivi-duelle des personnes trinitaires Si Niceacutee est tregraves clair sur le fait que le Pegravere le Fils et lrsquoEsprit sont trois laquo subsistants raquo une certaine confusion peut tout de mecircme exister en raison de la synonymie entre les deux termes techniques laquo ousia raquo et laquo upostasis raquo Apparemment Marcel nrsquoa pas signeacute le Symbole niceacuteen une des anciennes listes des signataires preacutesentant plutocirct un certain Pancharius drsquoAncyre peut-ecirctre un precirctre ou un diacre accompagnant son eacutevecircque (p 91) Le troisiegraveme chapitre nous fait suivre le deacutebat sur la diviniteacute du Christ de Niceacutee (325) agrave la mort de Constantin (336) Les eacuteveacutenements marquants de cette peacuteriode sont minutieusement analyseacutes deacuteposition drsquoEustathe drsquoAn-tioche comme sabellianisant et retour drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee poleacutemique de Marcel contre Asteacuterius le Sophiste deux synodes tenus agrave Tyr et agrave Constantinople qui ont condamneacute Athanase et Marcel en 335 mort drsquoArius juste avant sa reacutehabilitation et mort de Constantin en 337 Lrsquoavant-dernier chapitre est consacreacute agrave la peacuteriode qui va du retour de Marcel drsquoexil au synode drsquoAntioche dit laquo de la Deacutedicace raquo probablement tenu le 6 janvier 341 (p 160-162) En effet le synode drsquoAntioche marque un point tournant dans la controverse arienne la theacuteologie de Marcel devenant le point sur lequel se focalisent les forces du parti drsquoEusegravebe Le dernier chapitre nous fait voyager avec Marcel du synode de Rome en mars 341 ougrave il est reacutehabiliteacute par le pape Jules (p 192) au synode de Sardique en 342 ou 343 (p 210-218) qui semblait ecirctre la victoire deacutefinitive des ariens mais qui selon Athanase Tome aux Antiochiens 5 eacutecrit en 362 nrsquoavait produit aucun document officiel (p 236) Apregraves ce dernier synode Marcel disparaicirct de la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle Il devient une personna non grata tant pour lrsquoOrient que pour lrsquoOccident Seul Athanase pour lrsquoeacutetonnement de tous surtout de Basile de Ceacutesareacutee ne se prononce jamais explicitement contre la doctrine de lrsquoeacutevecircque drsquoAncyre
Ce livre fourmille des renseignements historiques et theacuteologiques sur une peacuteriode fondamen-tale et productive au niveau theacuteologique Lrsquoouvrage contient eacutegalement plusieurs annexes qui per-mettent au lecteur de se familiariser avec les noms des lieux et des personnes dont ont fait lrsquoobjet plusieurs synodes mentionneacutes au fil du livre De plus une bibliographie assez fournie permet aux inteacuteresseacutes de poursuivre plus en profondeur leur inteacuterecirct pour les deacutebats traiteacutes par lrsquoA Nous souli-gnons enfin la mine de renseignements et les prises des positions solidement argumenteacutees que lrsquoA nous offre sur cet eacutevecircque drsquoAncyre disparu aussi vite qursquoil eacutetait apparu sur la scegravene theacuteologique du quatriegraveme siegravecle
Lucian Dicircncă
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
186
13 Jean-Marc PRIEUR La croix chez les Pegraveres (du IIe au deacutebut du IVe siegravecle) Strasbourg Uni-versiteacute Marc Bloch (coll laquo Cahiers de Biblia Patristica raquo 8) 2006 228 p
La croix eacutetait reconnue comme un instrument de torture laquo tenu pour exceptionnellement cruel repoussant et humiliant raquo (p 5) dans lrsquoAntiquiteacute romaine preacute- et postchreacutetienne Crsquoest avec Constan-tin au quatriegraveme siegravecle que nous assistons agrave lrsquoabolition de ce supplice (p 10) Crsquoest pourquoi le christianisme du premier siegravecle a eu besoin drsquoun Paul rabbin juif zeacuteleacute ayant fait une expeacuterience forte du Crucifieacute ressusciteacute sur la route de Damas pour precirccher aux nations paiumlennes un Messie crucifieacute laquo Le langage de la croix en effet est folie pour ceux qui se perdent mais pour ceux qui sont en train drsquoecirctre sauveacutes il est puissance de Dieu [hellip] Nous precircchons un Messie crucifieacute scan-dale pour les Juifs folie pour les paiumlens mais pour ceux qui sont appeleacutes tant Juifs que Grecs il est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu raquo (1 Co 118-24) La tradition chreacutetienne degraves le deacutebut a donc tenu la croix comme partie importante de son heacuteritage Ainsi la croix du Christ se voit tregraves vite attribuer une interpreacutetation theacuteologique des plus profondes la barre verticale unit le ciel et la terre Dieu et lrsquohomme tandis que la barre horizontale unit les humains entre eux Le Christ eacutetendu sur le bois de la croix nous offre la cleacute de lecture pour comprendre le dessein drsquoamour de Dieu pour lrsquohomme sa creacuteature qursquoil appelle agrave participer agrave sa vie intradivine
LrsquoA de ce livre se propose de collectionner et de commenter des textes qui expliquent la ma-niegravere dont les chreacutetiens ont reccedilu interpreacuteteacute et transmis la signification de la croix du Christ du deu-xiegraveme au deacutebut quatriegraveme siegravecle Le choix des textes est limiteacute agrave la croix elle-mecircme et non pas au supplice ou agrave la crucifixion en geacuteneacuteral ni agrave la reacutesurrection La limite chronologique est eacutegalement voulue par lrsquoauteur pour deux raisons principales premiegraverement par souci pratique lrsquoextension aux siegravecles suivants neacutecessitant un travail beaucoup plus volumineux et deuxiegravemement par souci drsquointeacuterecirct car selon lrsquoA la peacuteriode choisie produit des textes apologeacutetiques qui deacutefendent la pratique chreacutetienne et sa croyance en un Crucifieacute ressusciteacute Les textes retenus au deacutebut du livre tentent de preacutesenter le Christ accompagneacute de la croix agrave trois moments cleacutes de lrsquohistoire du salut agrave son retour glorieux agrave sa sortie du tombeau et au moment de sa monteacutee vers le ciel (p 11) LrsquoA nous preacutesente ensuite des perles de la litteacuterature chreacutetienne sur la signification typologique de la croix chez Ignace drsquoAntioche Polycarpe de Smyrne le Pseudo-Barnabeacute Justin et dans trois eacutecrits apocryphes de la premiegravere moitieacute du deuxiegraveme siegravecle (Preacutedication de Pierre Ascension drsquoIsaiumle Odes de Salo-mon) la Croix-limite laquo la notion de limite eacutetant drsquoailleurs prioritaire par rapport agrave celle de croix raquo (p 67) dans les eacutecrits de Valentin et de ses disciples le paradoxe et le scandale de la crucifixion du Christ chez Meacuteliton de Sardes des preacutefigurations veacuteteacuterotestamentaires de la croix chez Ireacuteneacutee de Lyon diffeacuterentes visions de la croix dans les Actes apocryphes de Pierre drsquoAndreacute de Paul et de Thomas le souci de preacutesenter la croix du Christ comme lrsquoaccomplissement des propheacuteties de lrsquoAn-cien Testament chez Hippolyte de Rome le deacuteveloppement de la theologia crucis au troisiegraveme siegravecle dans la tradition alexandrine chez Cleacutement et Origegravene et dans le monde latin chez Tertullien Cyprien Lactance etc Lrsquoouvrage se conclut par une bregraveve seacutelection de textes de Nag Hammadi preacutesentant deux points de vue opposeacutes le Christ crucifieacute dans lrsquoEacutevangile de Veacuteriteacute lrsquoInterpreacutetation de la Gnose lrsquoEacutepicirctre apocryphe de Jacques lrsquoEacutevangile selon Thomas et la Lettre de Pierre agrave Phi-lippe et le Christ non crucifieacute dans lrsquoEacutevangile des Eacutegyptiens la Procirctennoia Trimorphe lrsquoApoca-lypse de Pierre et le Deuxiegraveme traiteacute du grand Seth Une riche bibliographie sur le sujet permet au lecteur drsquoapprofondir ses connaissances sur la mise en place drsquoune theacuteologie de la croix dans les premiers siegravecles du christianisme et de se familiariser avec les enjeux et les deacutefis drsquoune telle entre-prise Plusieurs index nous aident agrave mieux nous repeacuterer dans le livre et eacuteventuellement eacuteveille notre deacutesir drsquoaller chercher les textes proposeacutes par lrsquoA dans leur contexte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
187
M Prieur preacutesente un livre facilement accessible tant au novice en theacuteologie qursquoau lecteur en geacuteneacuteral gracircce agrave un langage volontairement simple Chaque texte citeacute est preacutesenteacute par des commen-taires et par des renvois agrave des notes bibliographiques plus approfondies La compreacutehension du livre est eacutegalement faciliteacutee par des deacutetails sur la position geacuteneacuterale de tel ou tel texte citeacute ou auteur preacute-senteacute ce qui fait ressortir avec plus de clarteacute la penseacutee dominante quant agrave la croix du Christ
Lucian Dicircncă
14 Christoph AUFFARTH Loren T STUCKENBRUCK eacuted The Fall of the Angels Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Themes in Biblical Narrative raquo laquo Jewish and Christian Tradi-tions raquo VI) 2004 IX-302 p
Christoph Auffarth professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Bremen et Loren T Stuckenbruck professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Durham sont les eacutediteurs de ce sixiegraveme volume de la collection Themes in Bibli-cal Narrative Ce volume recueille douze articles qui sont le reacutesultat des travaux effectueacutes sur le thegraveme de la chute des anges lors drsquoun seacuteminaire tenu agrave Tuumlbingen du 19 au 21 janvier 2001 Les ar-ticles qui composent le preacutesent recueil sont reacutedigeacutes en anglais agrave lrsquoexception de trois articles qui sont en allemand Les diffeacuterentes contributions srsquointeacuteressent principalement agrave lrsquoorigine agrave lrsquoeacutevolution et agrave la reacuteception du mythe de la chute des anges Puisque ce mythe exerccedila une influence consideacuterable dans la penseacutee juive chreacutetienne et musulmane de lrsquoAntiquiteacute jusqursquoau Moyen Acircge les contributions sont diversifieacutees ce qui a comme avantage de donner un portrait drsquoensemble plutocirct inteacuteressant
Les trois premiers articles srsquointeacuteressent agrave la question de lrsquoorigine du mythe de la chute des anges en explorant la mythologie du Moyen-Orient Ronald HENDEL explore les parallegraveles possibles entre le reacutecit biblique de Gn 61-4 et les traditions cananeacuteennes pheacuteniciennes meacutesopotamiennes et grec-ques Selon lui le reacutecit biblique de Gn 61-4 nrsquoincorpore qursquoune petite partie drsquoun mythe israeacutelite plus deacuteveloppeacute Jan N BREMMER postule que le mythe des titans eacutetait connu des Juifs et qursquoil fut une source drsquoinspiration pour eux Certains passages bibliques (2 S 51822 Jdt 166 1 Ch 1115) et 1 Eacutenoch 99 font drsquoailleurs directement reacutefeacuterence aux titans Les reacutecits de lrsquoenchaicircnement des an-ges deacutechus au Tartare de Jubileacutees de 1 Eacutenoch de Jude 6 et de 2 P 24 constituent aussi un parallegravele frappant avec le mythe des titans Selon Matthias ALBANI Is 1412-13 ne reflegravete pas le mythe de Helel mais plutocirct une critique de la notion royale de lrsquoapotheacuteose des rois deacutefunts tregraves reacutepandue chez les Cananeacuteens les Eacutegyptiens et les Babyloniens Lrsquoauteur drsquoIs nous dit que ces rois qui deviennent des eacutetoiles apregraves leur mort ne surpasseront jamais le Dieu drsquoIsraeumll Crsquoest lrsquoarrogance royale qui est deacutenonceacutee le deacutesir des rois de devenir supeacuterieur agrave Dieu Selon lrsquoauteur drsquoIs cette apotheacuteose est plutocirct une chute Le texte drsquoIs 1412-13 fut ensuite interpreacuteteacute comme un reacutecit de la chute de Satan ou Lu-cifer par sa conjonction avec le mythe de la chute des anges (Vie drsquoAdam et Egraveve 15 2 Eacutenoch 294-5)
Les quatriegraveme et cinquiegraveme contributions analysent le mythe de la chute des anges dans la lit-teacuterature apocalyptique Loren T STUCKENBRUCK srsquoattarde agrave lrsquointerpreacutetation de Gn 61-4 que font les auteurs de la litteacuterature apocalyptique juive Selon lui le texte biblique nrsquoautorise pas agrave conclure que les laquo fils de Dieu raquo de Gn 61 sont maleacutefiques comme le conclut lrsquoauteur de 1 Eacutenoch par exem-ple Certaines sources semblent deacutemontrer que les geacuteants ont surveacutecu au deacuteluge (Gn 108-11 Nb 1332-33) Par exemple les fragments du Pseudo-Eupolegraveme conserveacutes par Eusegravebe de Ceacutesareacutee (Preacuteparation eacutevangeacutelique 9172-9) deacutemontrent non seulement que les geacuteants ont surveacutecu au deacute-luge mais qursquoils auraient aussi joueacute un rocircle deacuteterminant dans la propagation de la culture jusqursquoagrave Abraham Ainsi les auteurs des eacutecrits apocalyptiques tels que 1 Eacutenoch preacutesentent simplement une autre lecture du mythe de Gn 61-4 Pour eux les geacuteants ne jouent aucun rocircle dans la propagation du savoir Ce sont plutocirct des ecirctres maleacutefiques qui nrsquoont surveacutecu au deacuteluge que sous la forme drsquoes-prit mauvais Hermann LICHTENBERGER se penche quant agrave lui sur les relations qursquoentretient le
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
188
mythe de la chute des anges avec le chapitre 12 de lrsquoAp Selon lui le mythe de la chute des anges preacutesenteacute dans lrsquoAp 12 sous la forme drsquoune bataille entre les anges et le reacutecit de la chute du dragon ne servent qursquoagrave exprimer la notion reacutepandue de la chute des ennemis de Dieu Par conseacutequent le motif de la chute des anges a pour fonction de preacutedire la chute de lrsquoEmpire romain et drsquoaffirmer la victoire du Christ
Le sixiegraveme article propose une petite excursion au cœur de la mythologie gnostique Gerard P LUTTIKHUIZEN veut deacutemontrer comment les gnostiques attribuent lrsquoorigine du mal au Deacutemiurge En reacutealiteacute cet article donne un reacutesumeacute du mythe de lrsquoApocryphon de Jean du codex de Berlin en met-tant en lumiegravere le caractegravere deacutemoniaque du Dieu qui exerce son gouvernement sur le monde ma-teacuteriel Ce Dieu est le fils de la Sophia deacutechue le Dieu des Eacutecritures qui se proclame agrave tort le seul Dieu Les actions de ce Dieu et de ses acolytes sont toujours dirigeacutees agrave lrsquoencontre de lrsquohumaniteacute qursquoils cherchent agrave garder dans lrsquoignorance du Dieu veacuteritable Ainsi selon Luttikhuizen le Dieu creacuteateur de lrsquoApocryphon de Jean est une figure dont la malice surpasse celle du Satan de lrsquoapoca-lyptique juive et chreacutetienne
Les trois contributions suivantes discutent de la reacuteception du mythe de la chute des anges dans la litteacuterature meacutedieacutevale qui tente de deacutelimiter les frontiegraveres entre lrsquoorthodoxie et lrsquoheacutereacutesie Baumlrbel BEINHAUER-KOumlHLER analyse certaines parties du reacutecit cosmogonique du Umm al-Kitāb livre drsquoun groupe musulman du huitiegraveme siegravecle Dans ce texte le motif de la chute des anges a pour fonction de deacutepartager le monde et lrsquohumaniteacute en deux parties Drsquoun cocircteacute les sunnites le groupe majoritaire qui sont perccedilus comme des infidegraveles qui nrsquoeacutechapperont pas agrave la damnation de lrsquoautre cocircteacute les shiites qui seront potentiellement sauveacutes gracircce agrave leur connaissance du monde veacuteritable cacheacute aux sunnites Quant agrave Bernd-Ulrich HERGEMOumlLLER il montre comment le mythe de la chute des anges a eacuteteacute uti-liseacute pour creacuteer un rituel fictif destineacute agrave accuser les cathares de ceacuteleacutebrer des messes sataniques La pre-miegravere contribution des deux contributions de Christoph AUFFARTH tente drsquoailleurs de reconstruire les discussions derriegravere cette controverse entre les cathares et les autres chreacutetiens Les cathares se consi-deacuteraient comme des anges tandis qursquoils consideacuteraient les autres chreacutetiens comme les anges deacutechus Ainsi les cathares se servaient eux aussi du mythe de la chute des anges dans leur poleacutemique contre lrsquoEacuteglise Ceci est particuliegraverement clair dans lrsquoInterrogatio Iohannis ougrave Eacutenoch est transformeacute en serviteur du Diable
Les deux articles suivants ne srsquointeacuteressent pas au mythe de la chute des anges drsquoun point de vue historique mais adoptent plutocirct une approche theacuteologique Crsquoest le questionnement sur lrsquoorigine du mal qui est au cœur des contributions de Burkhard GLADIGOW et drsquoEilert HERMS Le premier dis-cute de la tension qui existe entre le motif de la chute des anges et le concept de monotheacuteisme Comment concilier ces deux conceptions contradictoires Le second tente drsquoexpliquer lrsquoorigine du mal agrave partir de la preacutemisse que tout ce qui arrive dans le monde provient de Dieu qui a creacuteeacute volon-tairement le monde Selon lui lrsquohumain est la seule creacuteature qui peut faire des choix Il peut choisir le bien ou le mal sans que le mal ait pour autant une existence ontologique
Le dernier article du recueil est signeacute par Christoph AUFFARTH et il constitue une conclusion qui prend la forme drsquoun commentaire de diffeacuterentes repreacutesentations iconographiques de la chute des anges ce qui contraste avec lrsquoapproche tregraves theacuteorique des autres contributions Le recueil se termine par un index des textes anciens utiliseacutes La parution de cet ouvrage manifeste encore une fois lrsquoex-trecircme complexiteacute mais aussi toute la feacuteconditeacute de lrsquoanalyse du motif de la chute des anges Mecircme si ce livre nrsquoapporte rien de vraiment nouveau sur la question les articles qui le composent sont de bonne qualiteacute et chaque lecteur devrait y trouver son compte Ces contributions srsquoajoutent donc agrave lrsquoimmense dossier sur ce reacutecit intriguant qui continue de frapper notre imaginaire
Steve Johnston
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
189
15 Barbara ALAND Fruumlhe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen Heiden und Haumlre-tikern Berlin Walter de Gruyter (coll laquo Hans-Lietzmann-Vorlesungen raquo 8) 2005 XI-48 p
Ce petit volume offre les textes de la dixiegraveme seacuterie des laquo Confeacuterences Hans-Lietzmann raquo preacute-senteacutees les 15 et 16 deacutecembre 2004 aux universiteacutes de Jena et de Berlin Tenues sous lrsquoeacutegide de lrsquoAca-deacutemie des sciences de Berlin-Brandenburg en lrsquohonneur du grand philologue et historien du christia-nisme ancien Hans Lietzmann (1875-1942) ces confeacuterences sont confieacutees agrave des speacutecialistes qui drsquoune maniegravere ou drsquoune autre ont une relation avec la personne ou lrsquoœuvre de celui qursquoelles veulent honorer Dans son laquo Vorwort raquo le prof Christoph Markschies recteur de lrsquoUniversiteacute de Berlin preacutesente la carriegravere scientifique de Barbara Aland en mettant en lumiegravere les domaines ougrave elle srsquoest illustreacutee dans la fouleacutee de Lietzmann la philologie classique le christianisme oriental la critique textuelle et la lexicographie du Nouveau Testament la recherche sur la gnose et le travail eacuteditorial Barbara Aland avait choisi comme thegraveme commun agrave ses trois confeacuterences celui des premiers affron-tements directs entre chreacutetiens paiumlens et heacutereacutetiques Drsquoougrave les trois titres retenus Celse et Origegravene Ireacuteneacutee et les gnostiques Plotin et les gnostiques Dans le premier essai lrsquoauteur cherche essentiel-lement agrave comprendre pourquoi Celse vers 180 srsquoest donneacute la peine drsquoentreprendre une reacutefutation aussi deacutetailleacutee du christianisme une religion que pourtant il meacuteprisait et consideacuterait comme nrsquoayant aucune valeur sur le plan intellectuel et proprement religieux Mme Aland retient trois eacuteleacutements qui agrave ses yeux constitue le cœur de laquo lrsquoinquieacutetude raquo de Celse par rapport au christianisme le grand nombre des chreacutetiens et lrsquoattrait exerceacute par leur eacutethique et leur meacutepris de la mort la capaciteacute des chreacutetiens agrave attirer toutes les cateacutegories drsquohommes et agrave leur donner accegraves agrave une formation approprieacutee alors que la παιδεία des philosophes eacutetait reacuteserveacutee agrave une eacutelite leur doctrine de la connaissance de Dieu de sa possibiliteacute et de sa neacutecessaire conjonction avec un comportement moral adeacutequat Sur ce dernier point Barbara Aland observe tregraves justement que Celse et Origegravene se rejoignent dans la me-sure ougrave lrsquoun et lrsquoautre reconnaissent la neacutecessiteacute pour acceacuteder agrave la connaissance du divin drsquoune sorte drsquoillumination ou de gracircce Pour Celse qui reprend la doctrine de la Lettre VII de Platon (341c-d) la veacuteriteacute jaillit dans lrsquoacircme au terme drsquoune longue freacutequentation (ἐκ πολλῆς συνουσίας) laquo comme la lumiegravere jaillit de lrsquoeacutetincelle raquo laquo soudainement (ἐξαίφνης) raquo alors que pour Origegravene crsquoest lrsquoincarna-tion du Logos qui permet lrsquoaccegraves agrave la veacuteriteacute Dans lrsquoun et lrsquoautre cas on retrouve une certaine laquo pas-siviteacute raquo au terme de la deacutemarche La seconde confeacuterence consacreacutee au duel entre Ireacuteneacutee et les gnosti-ques oppose la preacutesentation que lrsquoeacutevecircque de Lyon fait de ceux-ci et ce que nous en reacutevegravelent les eacutecrits gnostiques notamment trois traiteacutes retrouveacutes agrave Nag Hammadi et eacutetudieacutes par Klaus Koschorke lrsquoApo-calypse de Pierre (NH VII3) le Teacutemoignage veacuteritable (NH IX3) et lrsquoInterpreacutetation de la gnose (NH XI1) Il ressort de cette comparaison entre autres choses que le portrait qursquoIreacuteneacutee trace des gnostiques comme des gens preacutetentieux et pleins drsquoeux-mecircmes nrsquoest nullement corroboreacute par les sources directes Agrave vrai dire Ireacuteneacutee ne cherche pas agrave eacutetablir un veacuteritable dialogue avec ses adversai-res contrairement agrave ce que lrsquoon peut entrevoir chez Cleacutement drsquoAlexandrie ou Origegravene La troisiegraveme contribution repose en bonne partie sur la monographie de Karin Alt (Philosophie gegen Gnosis Mainz Stuttgart Franz Steiner 1990) et elle met en lumiegravere les deux thegravemes qui deacutefinissent lrsquoaffron-tement entre Plotin et les gnostiques le cosmos son origine et sa signification lrsquohonneur agrave rendre au cosmos et aux dieux Destineacutees agrave un public de non-speacutecialistes ces trois confeacuterences reposent sur une longue freacutequentation des textes et recegravelent nombre drsquoobservations inteacuteressantes
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
190
16 Derek KRUEGER Writing and Holiness The Practice of Authorship in the Early Christian East Philadelphia The University of Pennsylvania Press (coll ldquoDivinations Rereading Late Ancient Religionrdquo) 2004 296 p
All writing serves a purpose a purpose informed by the bias(es) of the writer whether it is a poem a letter a romance or as in this book hagiography The end result however does not always reflect the reason for writing Krueger contends that writing about a holy person ascribing authority and power to him or her and the aim of humility of the subject created a tension in the portrayal of that person ie it violated ldquothe saintly practices that hagiographers sought to promoterdquo (p 2) The act of writing itself became of necessity a holy activity an act of piety
Krueger explores this activity through the examination of various aspects of hagiography in 9 chapters 1) Literary Composition as a Religious Activity 2) Typology and Hagiography Theo-doret of Cyrrhusrsquos Religious History 3) Biblical Authors The Evangelists as Saints 4) Hagiogra-phy as Devotion Writing in the Cult of the Saints 5) Hagiography as Asceticism Humility as Au-thorial Practice 6) Hagiography as Liturgy Writing and Memory in Gregory of Nyssarsquos Life of Macrina 7) Textual Bodies Plotinus Syncletica and the Teaching of Addai 8) Textuality and Redemption The Hymns of Romanos the Melodist 9) Hagiographical Practice and the Formation of Identity Genre and Discipline The book ends with a list of abbreviations 57 pages of endnotes (rather extensive so one must flip back and forth on occasion but very well marked for easy lookup) and a 30-page bibliography with a large selection of Acts and Lives in the Primary Sources section as well as but of course not restricted to various Letters and Homilies
Chapter one functions as a kind of introduction discussing the Christian negotiation of ldquoa dis-tinct relationship between writing and the religious liferdquo (p 1) and the use of writing toward the edification of both the writer and the audience be they readers or listeners Chapter two looks at the links between hagiography and scripture using Theodoret of Cyrrhusrsquos Religious History as an ex-ample and whether or not those links were implicit or explicit Chapter three deals with the asso-ciation of miracle workers and saints with the evangelistsrsquo compositions of the life of Jesus and the adaptation of evangelists to the standards associated with holy men in late antiquity Chapters four five and six move into the domain of the writing of the gospels and hagiographies lauding other holy individuals male and female and how the very act of writing these texts came to be inter-preted as devotional liturgical or ascetic Chapter seven deals with texts as substitutions for the bodies the presence of the individuals praised within the texts and its pre-Christian origin with the example of Platorsquos Phaedrus ldquoEvery discourse must be organized like a living being with a body of its own as it were so as not to be headless or footless but to have a middle and members com-posed in fitting relation to each other and the wholerdquo (246c trans p 133) Other Neo-Platonic ex-amples such as Plotinus are discussed Chapter eight deals with redemption how the texts are not just devotional liturgical and ascetic but the completion can lead to further redemption They are both the means and the end Chapter nine rounds out the path taken by writers in terms of estab-lishment of identity via the text or the writing of the text Authors wrote from a particular perspec-tive as ldquodisciple monk priest deacon devotee pilgrim prophet and evangelist and even sinnerrdquo (p 191) After they had passed on the Church sometimes established identities for them as well such as ldquosaintrdquo
Kruegerrsquos book is well organized with diverse examples some well known others less so of hagiography dealing with both writers and subjects Lacking in explicatory back-story of most of the cast of characters it is not for newcomers to the subject and as such is aimed at scholars al-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
191
though it is not so abstruse as to appeal only to specialists of subject or locale Any academic with an interest in late antique Christianity will find something of interest here
Jennifer K Wees
Eacuteditions et traductions
17 A Graeme AULD Joshua Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus Leiden Boston Konin-klijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 1) 2005 XXIX-236 p
N Clayton CROY 3 Maccabees Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Com-mentary Series raquo 2) 2006 XXII-143 p
David A DESILVA 4 Maccabees Introduction and Commentary on the Greek Text in Co-dex Sinaiticus Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Septuagint Commentary Series raquo 3) 2006 XLIV-303 p
Ces trois ouvrages sont les premiers volumes drsquoune nouvelle collection chez Brill la Septuagint Commentary Series Lrsquoapproche de cette nouvelle seacuterie se distingue de celle partageacutee par ses eacutequi-valents franccedilais11 allemands ou autres En effet le but de la Septuagint Commentary Series nrsquoest pas la reconstruction artificielle et hypotheacutetique drsquoune laquo unique raquo traduction grecque de la Septante mais plutocirct lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire drsquoun seul teacutemoin manuscrit de chacun des tex-tes de la Septante Le choix de ce manuscrit est laisseacute agrave la discreacutetion du chercheur auquel est confieacute le travail
Le premier volume de la collection est consacreacute au livre de Josueacute Lrsquoeacutedition la traduction et le commentaire de ce texte furent confieacutes agrave A Graeme Auld professeur et speacutecialiste de la Bible heacute-braiumlque agrave lrsquoUniversiteacute drsquoEacutedimbourg Pour son eacutedition de Josueacute lrsquoA a choisi le texte grec du Codex Vaticanus un des plus anciens grands codices (quatriegraveme siegravecle de notre egravere) Cette traduction grecque fut produite agrave partir drsquoune version heacutebraiumlque de Josueacute qui diffegravere beaucoup du texte heacutebreu avec lequel nous sommes aujourdrsquohui familiers LrsquoA se reacutejouit drsquoailleurs drsquoavoir enfin la chance drsquoeacutetudier ce texte pour lui-mecircme et non pas seulement comme teacutemoin de lrsquoeacutevolution de la tradition heacutebraiumlque de ce livre Dans une courte introduction lrsquoA aborde la question de lrsquoorigine du Codex Vaticanus puis celle de la division du texte qursquoil considegravere comme une interpreacutetation en soi Il est inteacuteressant de noter que le texte grec de Josueacute du Codex Vaticanus comporte quatre systegravemes de division marqueacutes agrave mecircme le manuscrit Le plus reacutecent est notre division moderne en vingt-quatre chapitres (sans lrsquoindication des versets) Ensuite viennent deux systegravemes plus anciens qui divisaient respectivement le texte en cinquante-cinq et quarante-huit sections Enfin le manuscrit porte encore la trace de la division originale de Josueacute par le scribe en cent trois sections de longueurs variables systegraveme qursquoa retenu lrsquoA pour son eacutedition et sa traduction Fort utile un tableau des correspondan-ces entre ces quatre systegravemes a eacuteteacute reacutealiseacute par lrsquoA Auld passe ensuite agrave la preacutesentation de son eacutedition du texte grec de Josueacute en notant au passage quelques particulariteacutes du grec trouveacute dans le Codex Vaticanus Puis il preacutesente sa traduction qursquoil annonce assez litteacuterale Auld nrsquoa pas precircteacute at-tention agrave ce qursquoaurait pu ecirctre le texte original avant sa traduction en grec mais aux caracteacuteristiques propres agrave la traduction Il srsquoest efforceacute de traduire le grec laquo standard raquo en anglais laquo standard raquo et le grec laquo non standard raquo en anglais laquo non standard raquo Cette meacutethode a neacutecessairement des reacutepercussions sur la traduction de certains noms propres et expressions consacreacutees Ainsi les noms heacutebraiumlques qui
11 Comme la collection La Bible drsquoAlexandrie qui paraicirct depuis 1986 aux Eacuteditions du Cerf
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
192
ont eacuteteacute greacuteciseacutes sont traduits par la forme dans laquelle ils sont connus en anglais Jesus Moses etc et non Iēsous Moyses etc Cependant pour la grande majoriteacute des noms propres que le traduc-teur nrsquoa que translitteacutereacutes en grec Auld applique une translitteacuteration en anglais agrave partir drsquoun tableau drsquoeacutequivalences entre les lettres grecques heacutebraiumlques et latines Une traduction plus litteacuterale lrsquoA nous avertit-il reacutesulte inexorablement dans la perte de certains points de repegravere tregraves familiers Par exemple laquo ark of the convenant raquo devient poeacutetiquement laquo the chest of the disposition raquo LrsquoA ter-mine son introduction en traitant rapidement de lrsquohistoire de la recherche sur le Josueacute des Septante des liens entre Josueacute et le Pentateuque et sur le vocabulaire de Josueacute Une courte bibliographie clocirct lrsquointroduction Le texte grec et la traduction anglaise de Josueacute se font face ce qui facilite grandement les sondages dans le texte original Chacune des cent trois sections qui divisent le texte est preacuteceacutedeacutee drsquoun titre qui agreacutemente une lecture parfois difficile en raison de la lourdeur drsquoune traduction lit-teacuterale Un commentaire tregraves eacutetoffeacute suit les cent trois sections Il srsquoouvre geacuteneacuteralement sur des remar-ques drsquoordre linguistique et philologique pour ensuite srsquoattarder aux eacuteleacutements davantage historiques doctrinaux ou litteacuteraires Un index des reacutefeacuterences bibliques et un court index geacuteneacuteral concluent le volume
Le deuxiegraveme volume de la seacuterie est quant agrave lui consacreacute au troisiegraveme Livre des Maccabeacutees un des apocryphes veacuteteacuterotestamentaires les plus neacutegligeacutes par les chercheurs La tacircche drsquoeacutediter de tra-duire et de commenter ce texte fut confieacutee agrave N Clayton Croy professeur associeacute au Trinity Lutheran Seminary LrsquoA divise lrsquointroduction agrave son eacutedition sa traduction et son commentaire en neuf parties Il commence drsquoabord par preacutesenter briegravevement le contenu de 3 Maccabeacutees et sa trame narrative en trois eacutepisodes la bataille de Raphia la visite de Jeacuterusalem par Ptoleacutemeacutee IV Philopator et la per-seacutecutions des Juifs drsquoAlexandrie par Ptoleacutemeacutee LrsquoA traite ensuite des questions relatives au titre donneacute agrave lrsquoœuvre (singulier dans la mesure ougrave le texte ne renvoie agrave aucun des membres de la famille maccabeacuteenne ni ne se soucie de lrsquoeacutepoque de la reacutevolte des Maccabeacutees) agrave son statut laquo canonique raquo (dans les trois grands codices onciaux 3 Maccabeacutees ne se trouve que dans lrsquoAlexandrinus) et agrave ses autres teacutemoins textuels (plus de deux douzaines de manuscrits contiennent 3 Maccabeacutees en entier ou en partie) LrsquoA se penche ensuite sur lrsquoauteur de 3 Maccabeacutees (anonyme) la date de sa compo-sition (entre le deuxiegraveme siegravecle AEC et le premier siegravecle de notre egravere) et sa provenance (drsquoEacutegypte probablement drsquoAlexandrie) sur sa langue (le grec) et sur son style (que Croy qualifie de laquo neacutegli-gent raquo) sur son genre (classeacute par lrsquoA comme une historical romance) son historiciteacute (plausible pour certains faits) et ses liens litteacuteraires (Esther 2 Maccabeacutees et la Lettre drsquoAristeacutee) Pour ce qui est de lrsquointeacutegriteacute du texte lrsquoA comme plusieurs autres avant lui soutient et explique qursquoil est fort probable que le deacutebut de 3 Maccabeacutees tel qursquoil nous est parvenu manque aujourdrsquohui Au septiegraveme point lrsquoA discute de la theacuteologie de 3 Maccabeacutees qui reflegravete selon lui un judaiumlsme orthodoxe (le caractegravere sacreacute de la Loi lrsquoinviolabiliteacute du Temple lrsquoimportance des traditions anciennes et le statut unique drsquoIsraeumll sont des thegravemes chers agrave lrsquoauteur) et de ses objectifs (3 Maccabeacutees est un texte ex-hortatif apologeacutetique poleacutemique et eacutetiologique) LrsquoA traite ensuite de lrsquoinfluence de 3 Maccabeacutees qui est minime (3 Maccabeacutees fut traduit en syriaque et en armeacutenien) et de son impact sur le deacuteve-loppement du christianisme ancien qui est peu significatif (3 Maccabeacutees est peu connu des auteurs chreacutetiens) Enfin lrsquoA preacutesente les particulariteacutes du texte grec de 3 Maccabeacutees retenu pour lrsquoeacutedition (celui de lrsquoAlexandrinus) et celles de sa traduction (plus litteacuterale que litteacuteraire) Comme pour lrsquoeacutedi-tion de Josueacute lrsquointroduction est suivie du texte grec de 3 Maccabeacutees preacutesenteacute en regard de la tra-duction anglaise Un commentaire deacutetailleacute de 3 Maccabeacutees suit lrsquoeacutedition et la traduction Une im-portante bibliographie un index theacutematique et un index des textes anciens ferment lrsquoouvrage
Le troisiegraveme volume de la collection est consacreacute au quatriegraveme Livre des Maccabeacutees Crsquoest agrave David A deSilva qui enseigne le grec et le Nouveau Testament au Ashland Theological Seminary que fut confieacutee la tacircche drsquoeacutediter de traduire et de commenter ce texte Pour ce faire il a choisi le
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
193
Codex Sinaiticus (quatriegraveme siegravecle) Dans lrsquointroduction lrsquoA aborde les questions relatives aux prin-cipaux teacutemoins (Codex Sinaiticus et Alexandrinus) agrave lrsquoauteur de 4 Maccabeacutees (lrsquoattribution agrave Fla-vius Josegravephe par les anciens ne tient plus aujourdrsquohui) et au titre (qui reflegravete le deacutesir de lrsquoauteur de re-grouper son eacutecrit avec les traditions maccabeacuteennes mecircme si le texte ne fait en aucun endroit mention de la famille de Judas Maccabeacutee ou de ses exploits) LrsquoA srsquointeacuteresse ensuite agrave la datation de 4 Macca-beacutees (entre le tournant de lrsquoegravere chreacutetienne et le deacutebut du deuxiegraveme siegravecle) agrave son origine (si les pre-miegraveres recherches liaient 4 Maccabeacutees et le judaiumlsme alexandrin notre A penche plutocirct pour une origine quelque part entre lrsquoAsie mineure et Antioche de Syrie) et au public viseacute (des Juifs assez helleacuteniseacutes pour lire du grec litteacuteraire qui cherchent drsquoun cocircteacute agrave conserver leur heacuteritage mais qui de lrsquoautre deacutesirent entrer en relation avec le milieu culturel grec dans lequel ils eacutevoluent) LrsquoA traite eacutega-lement du genre litteacuteraire de 4 Maccabeacutees (un meacutelange entre le discours philosophique et lrsquoenco-mium) de sa strateacutegie rheacutetorique (stimuler une adheacutesion aux traditions juives dans un environne-ment qui est propice aux accommodements et mecircme favorable agrave lrsquoabandon de la foi juive) et de ses sources (la traduction grecque des eacutecritures juives et 2 Maccabeacutees) LrsquoA se penche ensuite sur les influences exerceacutees par 4 Maccabeacutees Pour deSilva 4 Maccabeacutees nrsquoa eu que peu drsquoimpact sur le ju-daiumlsme au deuxiegraveme siegravecle la plus importante influence srsquoeacutetant exerceacutee sur lrsquoauteur des Lamenta-tions du Midrash Rabbah Par contre lrsquoinfluence de 4 Maccabeacutees sur le christianisme primitif fut beaucoup plus importante notamment sur le Nouveau Testament (Eacutepicirctre aux Heacutebreux et les eacutepitres pastorales) et tregraves fortement sur la litteacuterature hagiographique (Ignace drsquoAntioche le Martyre de Polycarpe lrsquoExhortation au martyre drsquoOrigegravene la Passion de Perpeacutetue et de Feacuteliciteacute etc) Avant de passer au texte et agrave la traduction de 4 Maccabeacutees lrsquoA preacutecise les particulariteacutes du texte dans le Codex Sinaiticus (les aspects mateacuteriels les divisions du textes les abreacuteviations etc) Le lecteur du texte de 4 Maccabeacutees tel qursquoil se trouve dans le Codex Sinaiticus fera dit-il lrsquoexpeacuterience drsquoun texte plus vif et plus dynamique que celui drsquoune eacutedition critique principalement en raison du choix des verbes du vocabulaire et de la preacutecision de deacutetails plus speacutecifiques Comme pour lrsquoeacutedition de Josueacute et de 3 Maccabeacutees le texte grec de 4 Maccabeacutees est ensuite preacutesenteacute en regard de la traduction an-glaise Lrsquoeacutedition et la traduction sont suivies par un commentaire deacutetailleacute dont les preacuteoccupations sont autant drsquoordre linguistique et philologique que doctrinale historique et litteacuteraire Une biblio-graphie eacutetoffeacutee de mecircme qursquoun index des auteurs modernes et des textes anciens citeacutes concluent le volume
Ces trois ouvrages comblent un besoin eacutevident de la recherche agrave savoir celui de lrsquoeacutetude des textes non plus comme teacutemoins drsquoun texte original unique qui sera toujours hypotheacutetique mais plu-tocirct comme objet reccedilu et lu agrave part entiegravere par une communauteacute Nous nous devons de souligner la qualiteacute de ces eacutetudes et de les recommander agrave quiconque srsquointeacuteresse agrave lrsquohistoire des diffeacuterents textes dont se compose la Septante
Eric Creacutegheur
18 FULGENCE DE RUSPE La regravegle de la foi (De Fide ad Petrum) Introduction traduction notes guide theacutematique glossaire et index par M Olivier COSMA Paris Migne (coll laquo Les Pegraveres dans la foi raquo 93) 2006 137 p
La regravegle de foi en latin De fide ad Petrum est destineacutee agrave un certain Pierre inconnu par les prosopographies anciennes Celui-ci aurait demandeacute agrave lrsquoeacutevecircque Fulgence disciple drsquoAugustin de reacutediger un manuel de la foi catholique qui lui permettrait de se preacuteserver contre toute heacutereacutesie eacuteven-tuelle dans son voyage agrave Jeacuterusalem Le genre litteacuteraire choisi pour reacutepondre agrave une telle demande est celui de la laquo regravegle raquo le rapprochant ainsi du ceacutelegravebre ouvrage de Tyconius Liber regularum La carac-teacuteristique principale de ce genre litteacuteraire est lrsquoeacutenumeacuteration des regravegles de foi agrave suivre (laquo Tiens pour
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
194
tregraves certain sans en douter le moins du monde raquo) afin drsquoeacuteviter toute deacuterive dogmatique ou theacuteolo-gique Lrsquoexposeacute des quarante regravegles de foi est articuleacute en quatre parties principales la foi la Triniteacute le Fils et la Creacuteation preacuteceacutedeacutees drsquoun long prologue et suivies drsquoune bregraveve conclusion
Le preacutesent ouvrage se veut donc une laquo regravegle de la foi catholique raquo contre les doctrines eacutetrangegrave-res agrave lrsquoEacuteglise Lrsquoarianisme est la premiegravere doctrine viseacutee par Fulgence Selon cette doctrine la Tri-niteacute ne jouit pas de lrsquoeacutegaliteacute substantielle des personnes qui la composent car le Pegravere est plus grand que le Fils (cf Jn 1428) Lrsquoauteur se propose donc de deacutemontrer argumentation biblique agrave lrsquoappui lrsquoeacutegaliteacute du Fils avec le Pegravere et par conseacutequent la consubstantialiteacute de la Triniteacute Le peacutelagianisme est une autre doctrine que Fulgence combat dans son eacutecrit La volonteacute et le libre arbitre humains tant exalteacutes par Peacutelage sont secondaires par rapport agrave la gracircce que Dieu offre agrave lrsquohomme en Jeacutesus Christ mort et ressusciteacute Augustin vient au secours de son disciple afin de combattre agrave la fois lrsquoaria-nisme et le peacutelagianisme Drsquoautres doctrines sont combattues dans cet ouvrage lrsquoapollinarisme niant lrsquoexistence drsquoune acircme raisonnable dans le Christ lrsquoencratisme et ses deacuteriveacutes lrsquoadamisme et lrsquoapos-tolisme qui mettaient lrsquoaccent sur un asceacutetisme extrecircme allant jusqursquoagrave la condamnation des unions conjugales le maceacutedonianisme qui niait la diviniteacute de lrsquoEsprit-Saint le nestorianisme qui ne re-connaicirct ni la double nature dans lrsquounique personne du Christ ni le titre Theacuteotokos que le concile drsquoEacutephegravese en 431 avait accordeacute agrave Marie le monophysisme postchalceacutedonien favoriseacute par la femme de lrsquoempereur Justinien Theacuteodora apregraves la mort de Fulgence le sabellianisme qui resurgit encore parmi ses contemporains
La lecture de cet ouvrage pose deux difficulteacutes majeures au lecteur initieacute aux deacutebats theacuteologi-ques des cinquiegraveme et sixiegraveme siegravecles Drsquoune part on se posera la question Fulgence deacutefend-il un augustinisme radical Drsquoautre part quelle position Fulgence prend-il devant le Filioque Lrsquoauteur de La regravegle de la foi vit agrave une eacutepoque ougrave on constate une tension entre la promotion drsquoun augusti-nisme radical dans lequel la preacutedestination est rigoureusement deacutefendue et un augustinisme mitigeacute dans lequel tous les peuples sont appeleacutes au salut laquo Fulgence en repreacutesente le courant radical dont les tenants reacuteaffirment mdash voire durcissent encore mdash les positions les plus dures drsquoAugustin et qui aboutira au janseacutenisme raquo (p 20-21) Quant au Filioque Fulgence ne fait que reprendre les argu-ments deacuteveloppeacutes par Augustin en faveur de la procession eacuteternelle de lrsquoEsprit-Saint du Pegravere et du Fils Ainsi il apporte une pierre de plus au deacutebat filioquiste opposant lrsquoOrient et lrsquoOccident chreacutetien apregraves lui et qui ira jusqursquoagrave la seacuteparation des deux Eacuteglises en 1054
Lrsquoeacuterudition et la personnaliteacute de Fulgence en ont impressionneacute plus drsquoun agrave son eacutepoque et dans la posteacuteriteacute Au dix-huitiegraveme siegravecle Bossuet le deacutesignait comme laquo le plus grand theacuteologien et le plus saint eacutevecircque de son temps raquo (p 24) Son attachement aux veacuteriteacutes fondamentales de la foi chreacutetienne a fait de lui un pilier de lrsquoorthodoxie contre lequel toutes les heacutereacutesies srsquoeffondrent Cependant les chercheurs modernes sont plus nuanceacutes lorsqursquoils deacutecouvrent lrsquoaugustinisme radical qui se deacutegage de son œuvre La propagation des ideacutees de son maicirctre a fait de lui le maillon par lequel lrsquoaugustinisme extrecircme a eacuteteacute transmis aux meacutedieacutevaux contribuant ainsi agrave lrsquoeacutelargissement du fosseacute entre lrsquoEacuteglise orientale et lrsquoEacuteglise occidentale
La traduction offre la possibiliteacute au lecteur moins familier avec les arguties du latin de sentir la capaciteacute inouiumle de Fulgence de jouer avec les mots les concepts et les expressions faisant de lui un digne disciple drsquoAugustin Lrsquointroduction les notes le guide theacutematique le glossaire et lrsquoindex sont eacutegalement autant drsquooutils mis agrave la disposition du lecteur afin de lrsquointroduire dans le contexte histo-rique social et theacuteologique qui a vu naicirctre un homme drsquoune grande culture et drsquoun grand deacutesir de perfection de vie chreacutetienne et un grand eacutevecircque qui a su mettre ses dons intellectuels et spirituels au service du peuple de Dieu
Lucian Dicircncă
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
195
19 ST PETER CHRYSOLOGUS Selected Sermons Volume 3 Translated by William B PALARDY Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 110) 2005 XVIII-372 p
This volume represents all of Chrysologusrsquos sermons now available in the English language The translation as noted in the Preface is based upon the text edited by Dom Alejandro Olivar in CCL 24A and 24B Palardy makes use of Olivarrsquos extensive notes in the CCL edition which he cross-references with terms found in the Chrysologus corpus to point out the parallels in the patris-tic and classical texts in order to underscore contemporary works As in Volume 2 he also makes use of the Opere di San Pietro Crisologo by Gabriele Banterle (Scrittori dellrsquoarea santambrosiana series) that corrects and provides helpful notes to the CCL text This monograph completes the col-lection of sermons from 72A through to 179 The Hebrew Bible citations follow the Vetus Latina and Septuagint in numbering It should be kept in mind that the main collection of Chrysologusrsquos sermons is the Felician collection arranged in the eighth-century a few of these have not been translated in this volume because they are judged to be spurious A detailed study on the textual history and authenticity on some of the sermons in the CCL has been undertaken by A Olivar in his Los sermons de san Pedro Crisoacutelogo Estudio criacutetico (Montserrat Abadiacutea de Montserrat 1962) Sermons previously designated in the CCL as ldquobisrdquo and ldquoterrdquo (eg Sermon 99bis is designated as ldquo99ardquo) are designated respectively ldquoardquo and ldquobrdquo in keeping with Palardyrsquos previous volume (FOTC 109) The following symbols ldquo[ ]rdquo and ldquolt gtrdquo respectively indicate additions made to the sermon text or titles by Palardy and Olivar From these sermons one can discern issues that were first and foremost on the minds of his listeners the religious debates political climate belief and practice in fifth-century Ravena and everyday concerns The Gospel texts are of course the basis of the homilies he delivered during important liturgical seasons Lent Easter Pentecost the period prior to Christmas Christmas and Epiphany cycle Of note is the most ancient witness to a Roman practice the Pascha annotinum (one-year anniversary of Baptism for initiates from the previous Easter) found in Sermon 73 an observation advanced by Franco Sottocornola in Lrsquoanno liturgico nei sermoni di Pietro Crisologo (p 83-84 188-190) Sermon 142 ltA Secondgt on the Annunciation of the Lord most likely preached before Christmas (and as Palardy states seems to be a continua-tion of another sermon no longer extant which concluded with a comment on Lk 130) is a good example of the depth and breadth of the Scriptural pool from which Chrysologus typically draws for each sermon mdash in this case he makes use of Genesis Isaiah Romans Luke and John More im-portantly Palardy alerts us to observations such as the allusion in the same sermon that Mary is the new Eve (1429 see also Sermons 743 1404 and 1485) In Sermon 1467 Chrysologus finds sig-nificance in the Latin name for Mary maria a reference to the seas that are the source of life It is of note that Jacques de Voragine (Iacopo da Varagine) revives this theme eight centuries later in his celebrated Leacutegende doreacutee (Legenda Aurea initially titled Legenda Sanctorum) Chrysologusrsquos use of the term misceri (1421) may be mistaken as a monophysite view of Christ however Palardy translates this as ldquomingledrdquo and explains that Leo the Great uses the same term to indicate the union of the human and divine in Christ (CCL 138103) Chrysologusrsquos language is rich in meaning and theological significance one can discern a shift in meaning when we compare his earlier Ser-mon 403 (FOTC 1787) in which he states that Christ decided and had the power to offer his own life in Sermon 1103 Christ is the agent of his own Resurrection Sermon 12610 underscores Chrysologusrsquos wordplay when he refers to the gentiles as elect (electi) and to the Jews as derelict (relicti) Similarly in Sermon 1422 he makes use of in virgine hellip virga an allusion to the Virgin as a thin twig that ought not be broken under the full weight ldquoof the construction from heavenrdquo In Sermons 1643 1067 and 1371 he employs farming imagery to makes the Jews stand in sharp contrast to the gentiles Sermon 157 A Second on Epiphany reveals how some words held theo-
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
196
logical meanings that transcended traditions of the East and the Occident in his interpretation of Epiphany Chrysologus makes use of the phrase ldquothe day of his Illuminationhelliprdquo which Palardy notes is a direct drawing of his knowledge of the Eastern tradition Many of the sermons are inter-spersed with expositions of Paulrsquos letters Throughout this volume Palardy provides the reader with first rate insight (eg Sermon 72b he gives a valuable reference to the modern work of Benericetti Il Cristo nei Sermoni di S Pier Crisologo at other times he references ancient authors such as the first-century CE writer M Manilius Sermon 1645) making this final collection of sermons by Chrysologus truly an important addition to the study of Patristics
Jonathan Ignatius von Kodar
20 DIDYMUS THE BLIND Commentary on Zechariah Translated by Robert C HILL Washington The Catholic University of America Press (coll ldquoThe Fathers of the Churchrdquo 111) 2006 XI-372 p
This monograph is quite unique as it is the only complete commentary by Didymus extant in Greek on a biblical book where authenticity is confirmed it comes to us by direct manuscript tradi-tion and the work has been critically edited by L Doutreleau12 This volume is its first appearance in English It was not until 1941 that this work was discovered in Tura Egypt We know from Jerome that in 386 he embarked on a trip to Alexandria to visit with the ldquoSeerrdquo so that he may gain insight to the obscure book of Zechariah (in particular chapters 9 through 14 often referred to as Deutero-Zechariah echoing other protoapocalyptic texts such as Joel 228-321 and Isaiah 24-27) Didymus was admired by both Athanasius and Antony the hermit He was alive when the ecumeni-cal councils of Nicea and Constantinople I were convened Among his pupils and guests were Rufinus Palladius the historian (who refers to him as a συγγραφεύς) Jerome and Paula He also had support of the church historians Socrates and Theodoret Being a follower of Origen may have contributed to the absence of his work throughout the ages When Jerome took aim at Origenism and quarrelled with Rufinus he no longer claimed to have been a disciple of Didymus and regretted the praises he had given him in the past The works of Didymus were first condemned in 553 at the fifth ecumenical council Eutychus of Constantinople subsequently issued a decree that would anathematize both Didymus and Evagrius Ponticus in the condemnation of Origenists by the sixth and seventh councils This censure was not applied to his person but to his doctrine The commen-tary looks at the biblical text allegorically common to the Alexandrian tradition His work is im-bued with layers of theological meaning often requiring reflection on etymological and numero-logical symbolism to appreciate the hermeneutical presentation In Jeromersquos De viris illustribus the commentary is mentioned and Doutreleau suggests 387 as the date of composition Commentaries by the Antiochenes Theodore and Theodoret as well as by the Alexandrian Cyril offers a broader context to what Jerome refers to as this obscurissimus liber Zachariae prophetae Even though Jerome states that Hippolytus also composed a commentary on Zechariah Doutreleau is adamant that Didymus ldquone doit rien agrave Hippolyterdquo His work clearly follows Alexandrian hermeneutical prin-ciples often referring to the now deceased Athanasius as the διδάσκαλος of the church of Alexan-dria to Peter as the mentor of Mark and affords Mary a level of prominence not equalled by the Antiochenes (99) It appears that he targeted a learned audience people who are able to reference and chose different interpretations In 120 he suggests that the ldquofour craftsmenrdquo are the four evan-gelists but also advances the idea that this same passage could be referring to ldquoangels sent to gather
12 DIDYME LrsquoAVEUGLE Sur Zacharie texte ineacutedit drsquoapregraves un papyrus de Tours introduction texte critique traduction et notes de Louis Doutreleau Paris Cerf (coll ldquoSources Chreacutetiennesrdquo 83-85) 1962
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
197
Godrsquos elect from the four windsrdquo In 1210 Didymus admits he is not versed in Hebrew Hill points out that Didymus does not regularly check his LXX version against the Hebrew text in Origenrsquos Hexapla nor against the ancient versions associated with Theodotian and Aquila Even Simonetti complains about ldquola scarsezza di riferimenti agli altri traduttori del testo ebraico [hellip]rdquo in his article in Vetera Christianorum (1983) 20 p 346 However Fernaacutendez Marcos (The Septuagint in Con-text) feels that Didymus is remarkably faithful to the Alexandrian group in his commentary on Zachariah We do know from Jerome (praef in Paralipp) that during his time there existed three forms of the LXX namely those from Alexandria Constantinople-Antioch and ldquothe provinces in-betweenrdquo That being said it is not reasonable to expect of a blind man what scholars with vision would consider diligent textual criticism as visual gymnastics Didymus not only makes ample ref-erence to Isaiah Psalms Song of Songs and Paul but also to the deuterocanonical books of the He-brew Bible such as Judith Tobit and the additions to Daniel Like the Antiochenes he avoids the use of the book of Esther He also cites some of the early Christian texts such as the Shepherd of Hermas the Acts of John and the Epistle of Barnabas In 84-5 Didymus dismisses what is said in Joel 228 namely ldquoyour sons and your daughters shall prophesyrdquo and suggests that the reference applies to ldquoold men holding sticks in their handsrdquo and not really to old women In 75-7 Didymus makes use of Joel 115 not from the viewpoint of Zechariahrsquos penitential practices of a restored community but one that reinforces his argument about good and bad fasting in the case of the lat-ter he refers to those who abstain from the bread of life and the flesh of Jesus (Cf John 633 35) Of course he does not always stray from the original message contained in the Hebrew Bible In 79-10 he remains true to the prophetrsquos message and expounds in detail the theme of ethical transgression It is interesting to note that the Antiochenes have little to say about this verse Here we see why this volume is an interesting read mdash Hillrsquos keen eye for detail he notes accurately that Didymus seems to erroneously attribute the phrase ldquoHold no grudge in your hearts each of you against your neighbourrdquo to Jeremiah and by Jerome repeating this incorrect reference underscores his close dependence on Didymus (see also 813-15 where Didymus replaces the word ldquohandsrdquo with ldquoheartsrdquo and Jerome once again adopts an error) Hill also notes that Didymus (and the Antiochene commentators) is at a complete loss in interpreting the opening versus of Chapter 12 (Cf Ralph L Smith Michah to Malachi p 225 and Paul D Hanson The Dawn of Apocalyptic p 369) Didy-mus seems to be unaware that the book is actually comprised of two separate works Hill describes Didymusrsquo hermeneutical style as interpretation-by-association a case in point is Hillrsquos humorous note on 813-15 where Didymus references in the following order Genesis 2 Timothy Numbers Galatians Matthew Acts Daniel Amos Luke 2 Corinthians John Ecclesiastes and 1 Samuel mdash Hill refers to this as a ldquoconcatenation of textsrdquo and a ldquoKaleidoscopic exerciserdquo Didymus apologizes for straying not from the Zechariah text but from the Genesis subtext Hill sates that unlike the An-tiochenes who are adept in rhetoric (Cf C Schaumlublin Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen Exegese) Didymus excels in philosophical terms and categories of the Stoics Epicureans and Pythagoreans It is clear that Didymus is not concerned with the story of the exiles and the restored community While he does tackle literalhistorical issues he is more inclined to the spiritual and Christological interpretation which Hill identifies as his discernment (θεωρία) proc-ess a process clearly abhorred by Diodore who according to P Ternant (La θεωρία drsquoAntioche dans le cadre de sens de lrsquoEacutecriture Biblica 34 [1953]) is deliberately skewing the Alexandrian position Diodore does find θεωρία acceptable providing the literal sense progresses to an ldquoelevated senserdquo based on the literal To Didymus the literal sense to a text may sometimes be inappropriate and he invites his readers to seek other interpretations Hill states that Didymus is actually following Ori-genrsquos three-fold pattern and two different variations of this pattern with the factual moral and (Christ and the Church) mystical and mystical (soul as spouse of the Word) and spiritual (see H de Lubac on
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
198
Le triple sens de lrsquoEacutecriture and the Deux faccedilons in Histoire et Esprit lrsquointelligence de lrsquoEacutecriture drsquoapregraves Origegravene Paris Aubier [coll ldquoTheacuteologierdquo 16] 1950) For Theodore any spiritual sense that distorted ἱστορία is unsubstantiated The hermeneutical devices of etymology and number symbol-ism employed by Didymus did not sit well with the Antiochenes neither side under stood Hebrew well enough to avoid errors (17) and his etymology seemed at times hard to accept At any given opportunity he is able to insert comments against those professing heretical Trinitarian and Chris-tological views In 128 he attacks the docetists Paul of Samosata Photinus the Galatian Artemas Theodotus and adds Apollinaris and Marcellus of Ancyra In 1113 he attacks the Manicheans and Gnostics The importance of this commentary for Hill is that Didymus offers a mirror for his readers ldquoin which they can see reference to their own livesrdquo and as Didymus states in 38-9 ldquothe person who understands it is a seerrdquo
Jonathan Ignatius von Kodar
21 A Syriac Encyclopaedia of Aristotelian Philosophy Barhebraeus (13th c) Butyrum sapien-tiae Books of Ethics Economy and Politics A critical edition with introduction translation commentary and glossaries by P JOOSSE Leiden Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aris-toteles Semitico-Latinus raquo 16) 2004 VIII-289 p
Aristotelian Rhetoric in Syriac Barhebraeus Butyrum sapientiae Book of Rhetoric By John W WATT with Assistance of Daniel ISAAC Julian FAULTLESS and Ayman SHIHADEH Lei-den Boston Koninklijke Brill NV (coll laquo Aristoteles Semitico-Latinus raquo 18) 2005 X-484 p
Presque un exact contemporain de Thomas drsquoAquin (1225 -1274) Greacutegoire Abū rsquol-Farağ dit Barhebraeus neacute en 1225 ou 1226 et deacuteceacutedeacute en 1286 fut laquo maphrien de lrsquoOrient raquo ou primat de lrsquoEacuteglise syrienne orthodoxe (jacobite) pour les provinces orientales avec son siegravege pregraves de Mossoul (aujourdrsquohui en Irak) au couvent de Mar Mattaiuml Un des derniers grands eacutecrivains syriaques Barhe-braeus fut de son temps un esprit universel Ses œuvres couvrent agrave peu pregraves tous les domaines de la connaissance theacuteologie philosophie meacutedecine grammaire astronomie matheacutematiques histoire liturgie On lui doit mecircme un laquo livre des contes amusants raquo recueils de sentences et de memorabilia de philosophes sages et ascegravetes Ce qui nous est livreacute dans ces deux volumes de lrsquoAristote seacutemitico-latin est une tranche importante drsquoune vaste encyclopeacutedie de philosophie aristoteacutelicienne intituleacutee par Barhebraeus Le livre de la cregraveme de la science ( ܘܬ qui couvre tous les ( ܕchamps de la philosophie agrave la maniegravere drsquoune veacuteritable somme comme lrsquoOccident meacutedieacuteval en con-naicirct agrave la mecircme eacutepoque Lrsquointeacuterecirct de ce monumental ouvrage deacutepasse largement le domaine des eacutetu-des syriaques et crsquoest pour lrsquohistoire de lrsquoaristoteacutelisme meacutedieacuteval et de sa transmission au monde arabe qursquoil revecirct la plus grande importance On comprend degraves lors que les eacutediteurs de lrsquoAristoteles semitico-latinus lui aient reacuteserveacute une place de choix dans le programme de cette collection Outre les deux volumes que nous preacutesentons maintenant un troisiegraveme avait paru en 2004 qui portait sur la laquo meacute-teacuteorologie aristoteacutelicienne en syriaque raquo et donnait lrsquoeacutedition des livres de la Cregraveme de la science consacreacutes agrave la mineacuteralogie et agrave la meacuteteacuteorologie (H Takahashi vol 15 de la collection) Les volu-mes eacutediteacutes par P Joosse pour le premier et par JW Watt et ses collaborateurs pour le second suivent tous deux le mecircme plan introduction texte critique et traduction commentaire glossaires Les introductions accordent une attention particuliegravere aux sources de Barhebraeus Pour les trois livres portant sur la laquo philosophie pratique raquo soit lrsquoeacutethique lrsquoeacuteconomique et la politique lrsquoencyclo-peacutediste syriaque est surtout redevable au savant persan al-ūsī Pour la rheacutetorique il a paraphraseacute deux sources la Rheacutetorique drsquoIbn Sīnā et celle drsquoAristote Les commentaires des eacutediteurs permet-tent de prendre la mesure de la dette de Barhebraeus agrave lrsquoendroit de ses sources comme aussi de son originaliteacute Particuliegraverement preacutecieux sont les glossaires qui accompagnent ces eacuteditions syriaque-
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
199
persanarabe dans le premier cas syriaque-grec-arabe (Barhebraeus-Aristote-Ibn Sīnā) grec-sy-riaque (Aristote-Barhebraeus) et arabe-syriaque (Ibn Sīnā-Barhebraeus) dans le second Ces lexiques rendront service non seulement aux speacutecialistes de lrsquoaristoteacutelisme mais aussi agrave tous ceux qui srsquointeacute-ressent aux problegravemes de traduction du grec de lrsquoarabe ou du persan en syriaque Les deux volumes ont eacuteteacute preacutepareacutes avec beaucoup de soin mecircme si lrsquoeacutedition de Watt qui dispose lrsquoapparat critique en bas de page sous le texte est plus facile agrave utiliser que celle de Joosse qui le reporte agrave la suite de lrsquoeacutedition
Paul-Hubert Poirier
22 EUSEBIUS Onomasticon The Place Names of Divine Scripture Including the Latin edition of Jerome translated into English and with topographical commentary by R Steven NOTLEY and Zersquoev SAFRAI Leiden Koninklijke Brill NV (coll laquo Jewish and Christian Perspectives Series raquo IX) 2005 XXXVII-212 p
Ce que lrsquoon appelle lrsquoOnomasticon drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee et dont le titre exact est laquo Au sujet des noms de lieux qui se trouvent dans la divine Eacutecriture raquo (περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ) est un lexique explicatif de tous les toponymes noms de fleuves ou de montagnes que lrsquoon trouve dans les Eacutecritures Lrsquoouvrage est organiseacute selon lrsquoordre des vingt-quatre lettres de lrsquoalphabet grec et agrave lrsquointeacuterieur de chaque section alphabeacutetique les lemmes sont classeacutes selon les livres bibli-ques en commenccedilant par la Genegravese (ou le Pentateuque) pour finir par les Eacutevangiles Au total on compte 983 notices dont un certain nombre sont toutefois des doublons Le contenu des notices est le plus souvent tireacute des passages bibliques ougrave les noms sont citeacutes mais on y retrouve aussi quantiteacute drsquoinformations toponymiques geacuteographiques ou administratives qui font de lrsquoOnomasticon une source essentielle pour la connaissance de la Palestine agrave lrsquoeacutepoque romaine et speacutecialement au qua-triegraveme siegravecle Drsquoougrave lrsquointeacuterecirct qursquoil a toujours susciteacute non seulement chez les biblistes mais aussi au-pregraves des historiens et des archeacuteologues Dans lrsquoAntiquiteacute lrsquoouvrage jouissait deacutejagrave drsquoune grande po-pulariteacute comme en teacutemoignent la traduction-adaptation que Jeacuterocircme en fit en latin et lrsquoexistence drsquoune version syriaque partielle reacutecemment publieacutee13 Le texte grec et la version latine ont pour leur part fait lrsquoobjet drsquoune eacutedition critique synoptique au deacutebut du vingtiegraveme siegravecle14 qui a deacutefiniti-vement remplaceacute les preacuteceacutedentes y compris celle de Paul de Lagarde15 Une traduction anglaise de lrsquoOnomasticon dans ses deux versions accompagneacutee drsquoun index annoteacute drsquoeacutetudes et de cartes a eacutega-lement paru reacutecemment16 Par rapport agrave celle-ci lrsquoeacutedition de Notley et Safrai se distingue par le fait qursquoelle reacuteimprime en synopse sans les apparats les textes grec et latin drsquoErich Klostermann en les accompagnant drsquoune traduction anglaise du seul texte grec drsquoougrave le qualificatif de laquo triglotte raquo que lrsquoon lit dans le titre Cette traduction donne eacutegalement entre parenthegraveses la forme que prennent les lemmes dans la Septante (en principe identique agrave ceux du texte euseacutebien) et dans le texte massoreacute-tique des reacutefeacuterences bibliques additionnelles ainsi que les renvois internes en particulier dans le cas des lemmes doubles ou triples Une annotation infrapaginale parfois assez deacuteveloppeacutee et portant sur
13 S TIMM Eusebius von Caesarea Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Edition der syrischen Fas-sung mit griechischem Text englischer und deutscher Uumlbersetzung Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur raquo 152) 2005
14 E KLOSTERMANN Eusebius Werke III Band 1 Haumllfte Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen Berlin Akademie Verlag (coll laquo Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte raquo 11 1) 1904
15 P DE LAGARDE Onomastica sacra Goumlttingen L Horstmann 1887 16 GSP FREEMAN-GRENVILLE RL CHAPMAN III JE TAYLOR Palestine in the Fourth Century The Ono-
masticon by Eusebius of Caesarea Jerusalem Carta 2003
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
200
la plupart des lemmes fournit des indications topographiques historiques et archeacuteologiques visant agrave identifier et agrave situer chaque fois que la chose est possible les toponymes reacutepertorieacutes par Eusegravebe Les reacutefeacuterences aux auteurs anciens dont Flavius Josegravephe et agrave la litteacuterature rabbinique sont indi-queacutees lorsqursquoelles permettent drsquoeacuteclairer le texte drsquoEusegravebe Un tableau comparatif des noms sur six colonnes (le nom [1] en traduction anglaise tel que le donnent [2] Eusegravebe et [3] le texte massoreacute-tique sa forme ou son eacutequivalent [4] byzantin et [5] moderne ainsi que le cas eacutecheacuteant [6] des notes) reprend selon lrsquoordre de leur occurrence la totaliteacute des lemmes Deux index toponymique et des sources citeacutees dans lrsquoannotation terminent lrsquoouvrage Inseacutereacutee dans le plat infeacuterieur de la reliure on trouvera une tregraves belle carte en couleur (90 times 60 cm) de la laquo Palestine biblique selon Eusegravebe raquo qui situe les routes mentionneacutees par Eusegravebe (y compris celles qui nrsquoont pas encore eacuteteacute identifieacutees) les frontiegraveres administratives les villes et les villages (en distinguant les sites juifs et les sites chreacutetiens et ceux qui sont signaleacutes comme abandonneacutes) les lieux saints les garnisons et les montagnes Une introduction substantielle preacutesente lrsquoOnomasticon et examine les problegravemes poseacutes par les doubles entreacutees et la localisation des sites mentionneacutes par Eusegravebe Les eacutediteurs concluent que celui-ci posseacute-dait une bonne connaissance de la terre drsquoIsraeumll Le caractegravere unique de lrsquoOnomasticon au sein de la litteacuterature chreacutetienne ancienne reacutedigeacute avant que lrsquoEmpire ne devicircnt chreacutetien et que ne se deacuteveloppacirct un inteacuterecirct prononceacute pour la Terre Sainte les amegravenent en outre agrave formuler lrsquohypothegravese qursquoEusegravebe a utiliseacute des sources juives pour construire sa compilation Si une telle hypothegravese est vraisemblable les auteurs sont loin drsquoen faire la deacutemonstration Quoi qursquoil en soit cet ouvrage bien conccedilu permet un accegraves facile agrave lrsquoOnomasticon sous sa double forme tout en fournissant au lecteur une information bibliographique agrave jour Les auteurs auraient ducirc se meacutefier de leur traitement de texte car agrave tous les endroits dans la traduction anglaise ougrave un toponyme heacutebraiumlque composeacute de deux mots est partageacute entre la fin drsquoune ligne et le deacutebut de la ligne suivante les deux parties du mot se retrouvent dispo-seacutees agrave lrsquoenvers17
Paul-Hubert Poirier
23 BEgraveDE LE VEacuteNEacuteRABLE Histoire eccleacutesiastique du peuple anglais (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) Tome II (Livres III-IIII) et Tome III (Livre V) Introduction et notes par Andreacute CREacutePIN texte critique par Michael LAPIDGE traduction par Pierre MONAT et Philippe ROBIN Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 490 et 491) 2005 423 p et 251 p
Agrave la suite du tome I paru en 2005 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 489) et qui comportait lrsquointroduc-tion geacuteneacuterale et les livres I et II de lrsquoHistoire eccleacutesiastique de Begravede le veacuteneacuterable (673-735) voici les tomes II et III qui megravenent agrave son terme cette remarquable eacutedition drsquoune œuvre marquante de lrsquohistorio-graphie chreacutetienne agrave la jonction de lrsquoAntiquiteacute tardive et du haut Moyen Acircge Lrsquohistoire du texte de lrsquoHistoire a eacuteteacute faite au t I (p 49-69) et les principes de la nouvelle eacutedition y ont eacuteteacute exposeacutes (p 69-72) Rappelons que celle-ci repose sur trois manuscrits du huitiegraveme siegravecle qui deacuterivent drsquoun mecircme original proche du manuscrit autographe de Begravede Il a eacuteteacute tenu compte de la traduction vieil-anglaise qui nous est parvenue en quatre manuscrits du dixiegraveme siegravecle Les livres III agrave V couvrent la peacuteriode allant de 633 agrave 731 anneacutee de lrsquoachegravevement de lrsquoHistoire eccleacutesiastique Ils exposent les progregraves du christianisme dans les royaumes de Northumbrie de Wessex de Kent drsquoEst-Anglie de Mercie et drsquoEssex (livre III) deacutecrivent lrsquoorganisation de lrsquoEacuteglise drsquoAngleterre sous Theacuteodore archevecircque de Canterbury de 668 agrave 690 (livre IV) et racontent les eacuteveacutenements marquants survenus depuis la mort de saint Cuthbert abbeacute de Lindisfarne en 687 jusqursquoen 731 Ces livres accordent une grande atten-
17 Ainsi p 36 (lemme no 144) p 38 (no 156) p 39 (no 164) p 48 (no 211) p 56 (no 265) p 62 (no 301) p 109 (no 583 ougrave on corrigera רי en די) p 114 (no 618) p 120 (no 657) p 156 (no 916)
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
201
tion aux divergences dans les usages liturgiques relatifs au comput pascal et agrave la forme de la ton-sure Les miracles des saints eacutevecircques et abbeacutes tiennent aussi une place preacutepondeacuterante De nombreux documents sont citeacutes dont des textes synodaux des hymnes et des eacutepitaphes Lrsquoannotation qui accompagne la traduction vise surtout agrave expliquer les noms de lieux mdash dont les eacutequivalents moder-nes sont signaleacutes lorsqursquoils sont connus mdash et ceux des nombreux personnages qui peuplent le reacutecit de Begravede18 Le tome III se termine par trois index (scripturaire onomastique et analytique) qui reacuteca-pitulent ceux des deux tomes preacuteceacutedents Chacun des volumes reproduit en finale une tregraves utile carte de lrsquoAngleterre telle que la fait connaicirctre lrsquoHistoire eccleacutesiastique Cette belle eacutedition srsquoinscrit dans lrsquoeffort des laquo Sources Chreacutetiennes raquo pour rendre disponible lrsquoensemble de la litteacuterature historiogra-phique de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne depuis Eusegravebe de Ceacutesareacutee jusqursquoagrave Theacuteodoret de Cyr en passant par Socrate de Constantinople et Sozomegravene
Paul-Hubert Poirier
24 Les Apophtegmes des Pegraveres Tome III Collection systeacutematique Chapitres XVII-XXI Texte critique traduction et notes par dagger Jean-Claude GUY sj Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 498) 2005 470 p
Avec ce volume srsquoachegraveve lrsquoeacutedition de la collection systeacutematique des Apophtegmes entreprise par le Pegravere Jean-Claude Guy et presque meneacutee agrave son terme par lui avant son deacutecegraves survenu en jan-vier 1986 Le premier volume a paru en 1993 (laquo Sources Chreacutetiennes raquo 387) la mise au point de lrsquoeacutedition ayant eacuteteacute assureacutee par Bernard Flusin le deuxiegraveme volume devait suivre en 2003 (laquo Sour-ces Chreacutetiennes raquo 474) sous la responsabiliteacute de Bernard Meunier qui srsquoest eacutegalement chargeacute de preacuteparer le troisiegraveme Lrsquointroduction du premier volume exposait le genre litteacuteraire la typologie et la genegravese des collections drsquoapophtegmes preacutesentait le centre monastique de Sceacuteteacutee dressait la pro-sopographie des moines sceacutetiotes et formulait quelques hypothegraveses sur la date et le lieu de compo-sition des grandes collections drsquoapophtegmes Elle rappelait les conclusions de lrsquoeacutetude de la tradi-tion manuscrite grecque de la collection systeacutematique meneacutee par J-C Guy dans ses Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum (Bruxelles Socieacuteteacute des Bollandistes 1962 19842) conclusions sur lesquelles repose la preacutesente eacutedition et que B Flusin avait leacutegegraverement infleacutechies pour le premier volume en accordant plus de poids agrave la traduction latine de la collection systeacutema-tique Pour les deuxiegraveme et troisiegraveme volumes B Meunier a cependant cru bon de ne pas privileacute-gier agrave tout coup lrsquoaccord de lrsquoancienne version latine avec tel ou tel manuscrit grec Comme lrsquoessen-tiel avait eacuteteacute dit dans le premier volume le troisiegraveme ne comporte pas drsquointroduction propre mais ainsi que cela avait eacuteteacute annonceacute en 1993 se termine sur plus de 250 pages par une concordance entre les collections alphabeacutetique et systeacutematique des Apophtegmes des index scripturaire des noms de lieux et de personnes et des mots grecs la concordance et les index portant sur les trois volumes Une liste drsquoerrata pour les volumes 1 et 2 termine lrsquoouvrage Avec lrsquoachegravevement posthume du travail du P Guy on dispose enfin drsquoune eacutedition scientifique de lrsquointeacutegraliteacute de la collection systeacutematique ce qui nrsquoest pas encore le cas pour sa voisine la collection alphabeacutetique mecircme si les traductions fran-ccedilaises de Solesmes permettent drsquoavoir accegraves agrave la totaliteacute de son contenu Rappelons que la collec-tion systeacutematique exploite en bonne partie des mateacuteriaux qursquoelle a en commun avec lrsquoalphabeacutetique et la collection anonyme mais en disposant les piegraveces selon un ordre (plus ou moins) systeacutematique ou raisonneacute en 21 chapitres Le troisiegraveme volume contient les derniers chapitres sur la chariteacute les vieillards clairvoyants les vieillards thaumaturges la conduite vertueuse des diffeacuterents pegraveres et en
18 Peacutepin le bref pegravere de Charlemagne est habituellement deacutesigneacute comme Peacutepin III et non comme Peacutepin II comme on lit agrave la note 2 de la p 57 du t III crsquoest Peacutepin de Heacuteristal (ou Herstal) qui est appeleacute Peacutepin II
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
202
conclusion les laquo apophtegmes des pegraveres qui vieillirent dans lrsquoascegravese montrant comme en reacutesumeacute leur eacuteminente vertu raquo Comme crsquoeacutetait le cas pour les volumes 1 et 2 lrsquoannotation de la traduction est reacuteduite agrave lrsquoessentiel mais des reacutefeacuterences marginales signalent tous les parallegraveles dans la collec-tion alphabeacutetico-anonyme et dans les autres sources monastiques Il convient de souligner le meacuterite des personnes qui ont permis agrave lrsquoœuvre du P Guy de voir le jour dans drsquoaussi excellentes conditions
Paul-Hubert Poirier
25 FAUSTIN et MARCELLIN Supplique aux empereurs (Libellus precum et Lex augusta) preacute-ceacutedeacute de FAUSTIN Confession de foi Introduction texte critique traduction et notes par Aline CANELLIS Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 504) 2006 261 p
Le quatriegraveme siegravecle chreacutetien consideacutereacute comme laquo lrsquoacircge drsquoor des Pegraveres de lrsquoEacuteglise raquo fut surtout une peacuteriode de crise et de querelles eccleacutesiastiques et dogmatiques agrave la suite du concile de Niceacutee Un tel eacutetat de choses ne peut ecirctre mieux illustreacute que par les deux documents eacutediteacutes et traduits dans ce livre une supplique (libellus) adresseacutee aux empereurs Theacuteodose I et ses collegravegues par deux precirc-tres laquo ultra-niceacuteens raquo Faustin et Marcelin en faveur des partisans de Lucifer de Cagliari qui srsquoeacutetaient seacutepareacutes de lrsquoEacuteglise drsquoOccident apregraves le double synode de Rimini et Seacuteleucie de 359 et le rescrit im-peacuterial (lex) eacutedicteacute en reacuteponse agrave leur requecircte Celle-ci fut preacutesenteacutee officiellement entre le 25 aoucirct 383 et le 11 deacutecembre 384 et le rescrit fut promulgueacute vers la fin de cette peacuteriode au plus tocirct en jan-vier 384 Ces deux textes sont preacuteceacutedeacutes dans la preacutesente eacutedition de la confession de foi produite par Faustin agrave la demande de lrsquoempereur Theacuteodose Avec le Deacutebat entre un Lucifeacuterien et un Ortho-doxe de Jeacuterocircme qursquoelle a eacutediteacutee dans les laquo Sources Chreacutetiennes raquo au volume 473 Aline Canellis professeur agrave lrsquoUniversiteacute de Reims-Champagne Ardenne nous procure maintenant lrsquoessentiel du dossier sur le schisme lucifeacuterien qui a troubleacute lrsquoOccident entre 360 et 400 Lrsquointroduction de lrsquoou-vrage restitue de faccedilon claire et richement documenteacutee le contexte historique dans lequel se situent le libellus et la lex impeacuteriale celui des seacutequelles de la crise arienne en Occident et de la reacuteaction des niceacuteens intransigeants mobiliseacutes autour de Lucifer de Cagliari Suit une analyse du libellus agrave la fois document juridique plaidoyer et œuvre de combat qui campe un monde laquo en noir et blanc raquo et met de lrsquoavant une laquo partition simplificatrice de lrsquoEacuteglise voire du monde ougrave les ldquobonsrdquo sont magnifieacutes et les ldquomeacutechantsrdquo punis par Dieu raquo (p 58) Tout en observant strictement les conventions du genre de la requecircte agrave lrsquoautoriteacute impeacuteriale Faustin deacuteploie dans sa supplique une rheacutetorique de facture clas-sique avec un exorde une argumentation et une peacuteroraison Cette composition laquo se double drsquoune progression chronologique drsquoune reacuteeacutecriture de lrsquohistoire de lrsquoEacuteglise en sept eacutetapes relatant les faits depuis le concile de Niceacutee jusqursquoaux eacuteveacutenements contemporains du scripteur raquo (p 48) Une telle re-construction personnelle des faits a surtout pour but de montrer que les lucifeacuteriens qui refusent drsquoailleurs drsquoecirctre ainsi deacutesigneacutes sont les seuls laquo vrais catholiques raquo et qursquoils sont injustement traiteacutes au meacutepris des lois des empereurs chreacutetiens Le libellus exprime aussi une certaine ideacutee de lrsquoempire mdash qui devient mecircme tactique drsquointimidation mdash selon laquelle il ne peut que courir agrave sa perte srsquoil ne veut pas reconnaicirctre et proteacuteger les laquo vrais catholiques raquo La lecture de ce dossier eacuteclaireacutee par lrsquoin-troduction et lrsquoannotation fait voir la crise arienne en Occident du point de vue de lrsquoun de ses prota-gonistes Dans le cas de Faustin (Marcellin joue tout au plus le rocircle de cosignataire) il srsquoagit drsquoun acteur plein de zegravele et de talent et remarquablement informeacute mecircme srsquoil met cette information au service de la cause qursquoil deacutefend avec vigueur Lrsquoeacutedition de Mme Canellis preacutesenteacutee comme une laquo edi-tio maior raquo remplacera avantageusement toutes celles qui ont preacuteceacutedeacute y compris la plus reacutecente de M Simonetti dans le Corpus Christianorum
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
203
26 CYPRIEN DE CARTHAGE Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise (De Ecclesiae catholicae unitate) Texte critique du CCL 3 (M Beacutevenot) introduction par Paolo SINISCALCO et Paul MATTEI traduction par Mi-chel POIRIER apparats notes appendices et index par Paul MATTEI Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 500) 2006 XVIII-334 p
On ne pouvait mieux ceacuteleacutebrer la constante progression de la collection des laquo Sources Chreacutetien-nes raquo qursquoen reacuteservant sa 500e parution au De Ecclesiae catholicae unitate de Cyprien de Carthage une des œuvres majeures de lrsquoAntiquiteacute chreacutetienne dont la pertinence theacuteologique reacuteaffirmeacutee par le concile Vatican II ne srsquoest jamais deacutementie Cet opuscule nrsquoest toutefois pas un traiteacute drsquoeccleacutesiolo-gie comme le soulignent agrave juste titre le preacutefacier et les eacutediteurs Il srsquoagit plutocirct drsquoun eacutecrit engageacute avant tout pastoral laquo un cri drsquoalarme et un appel passionneacute agrave lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise auquel lrsquoeacutevecircque Cy-prien a probablement donneacute un retentissement public agrave lrsquooccasion du synode provincial qui srsquoest tenu agrave Carthage vers la fin de lrsquoanneacutee 251 raquo (p VI) au moment ougrave il srsquoagissait de srsquoentendre sur les mesures agrave prendre agrave lrsquoeacutegard des chreacutetiens qui avaient renieacute leur foi durant la perseacutecution de Degravece en 249 ceux qui avaient laquo failli raquo durant le combat et que lrsquoon appellera lapsi La possibiliteacute et les conditions de leur reacuteinteacutegration dans la communion de lrsquoEacuteglise constituait alors un problegraveme pasto-ral ineacutedit qui allait avoir de graves reacutepercussion dans lrsquoEacuteglise drsquoAfrique et jusqursquoagrave Rome Il nrsquoeacutetait pas facile de proposer une nouvelle eacutedition de Lrsquouniteacute de lrsquoEacuteglise de Cyprien quand on considegravere lrsquoample litteacuterature auquel ce traiteacute a donneacute lieu et mecircme les controverses qursquoil a susciteacutees en raison de la double reacutedaction des chapitres 4 et 5 portant sur le primat de lrsquoapocirctre Pierre On en admirera que davantage la maicirctrise avec laquelle les eacutediteurs se sont acquitteacutes de leur tacircche Lrsquointroduction des prof Siniscalco et Mattei commence par camper lrsquoeacutepoque et le milieu dans lesquels se situe le De unitate lrsquoEmpire du troisiegraveme siegravecle aux prises avec une crise aux divers aspects militaire po-litique institutionnel eacuteconomique et deacutemographique qui favorisera sous Degravece lrsquoeacutemergence drsquoune politique religieuse conservatrice dont les chreacutetiens feront les frais Les laquo circonstances et objectifs du De unitate raquo (chap 2) sont deacutetermineacutes par ce contexte La reacutedaction du traiteacute peut ecirctre situeacutee laquo agrave la fin du printemps ou au deacutebut de lrsquoeacuteteacute 251 alors que le concile carthaginois eacutetait acheveacute raquo (p 24) Eacutelu eacutevecircque dans les premiers mois de 249 Cyprien avait ducirc srsquoeacuteloigner de sa citeacute au deacutebut de 250 et demeurer cacheacute jusqursquoagrave la fin du printemps de 251 en raison de la perseacutecution Exil volontaire que drsquoaucuns lui reprocheront et qui le mettra laquo en porte-agrave-faux par rapport agrave sa communauteacute qursquoil doit continuer de gouverner et plus encore par rapport aux confesseurs qui souffrent pour lrsquoEacuteglise raquo (p 27) Il doit mecircme faire face au schisme de ceux qui trouvent agrave redire aux conditions de son eacutelec-tion mdash Cyprien a eacuteteacute promu par acclamation populaire mdash et au fait qursquoil ait apparemment aban-donneacute son troupeau Agrave cela srsquoajoute la question de la reacuteinteacutegration de ceux qui avaient sacrifieacute les sacrificati excommunieacutes par lrsquoeacutevecircque et pour certains drsquoentre eux reacuteadmis par lrsquointervention des confesseurs Ainsi donc laquo agrave son retour drsquoexil Cyprien se trouve dans lrsquoobligation de reconstruire lrsquoidentiteacute mecircme drsquoune fraction de son Eacuteglise il lui faut trouver un point drsquoeacutequilibre entre laxistes et rigoristes en reacuteadmettant les lapsi repentants apregraves une peacuteriode de peacutenitence et en excluant les re-belles raquo (p 32) Les chapitres 3 et 4 de lrsquointroduction sont consacreacutes aux aspects litteacuteraires et theacuteo-logiques de De unitate Sur le plan du genre lrsquoopuscule est deacutefini comme une epistula exhortatoria qui recourt agrave la terminologie technique de la pareacutenegravese et qui fidegravele agrave la tradition classique et ciceacute-ronienne laquo adhegravere aux modes drsquoun style ldquophilosophiquerdquo qui deacutedaigne les artifices rheacutetoriques raquo (p 41) Mais crsquoest neacuteanmoins laquo un style converti du monde agrave Dieu raquo (p 43) dont lrsquoEacutecriture est la norme Mecircme si le De unitate nrsquoest pas un traiteacute drsquoeccleacutesiologie on y trouve neacuteanmoins les grandes lignes de la penseacutee eccleacutesiologique de Cyprien en ce qui concerne notamment la reacutealiteacute des Eacuteglises particuliegraveres ou locales les synodes ou la colleacutegialiteacute les rapports entre lrsquoEacuteglise de Carthage et celle de Rome Le chapitre 5 est tout entier consacreacute au problegraveme de la laquo double reacutedaction raquo du traiteacute dans le fameux passage (49-510) sur le rocircle reconnu au Siegravege romain Apregraves avoir rappeleacute lrsquohistoire de
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
204
la question et le reacutesultat des travaux de Maurice Beacutevenot P Siniscalco procegravede agrave une comparaison minutieuse des deux reacutedactions le laquo Primacy Text raquo (PT) et le laquo Textus Receptus raquo (TR) pour repren-dre la terminologie de Beacutevenot et il conclut drsquoune part que Cyprien connaicirct et utilise le terme pri-matus avant et apregraves de De unitate et qursquoil lui donne le sens drsquolaquo une ldquoprimogeacuteniturerdquo une anteacute-rioriteacute chronologique [de Pierre] par rapport aux autres apocirctres raquo (p 112) et drsquoautre part que du PT au TR la doctrine de base est absolument identique et rejoint celle de la correspondance Degraves lors mecircme si la question de lrsquoauthenticiteacute reste ouverte il semble bien que les deux reacutedactions soient attribuables agrave Cyprien et que le PT est anteacuterieur au TR laquo la reacutedaction du premier daterait du printemps 251 celle du second de la controverse baptismale raquo (p 115) crsquoest-agrave-dire de 256 agrave un moment ougrave Cyprien doit affirmer son autoriteacute face agrave lrsquoEacuteglise de Rome Dans la laquo note sur le texte latin raquo Paul Mattei effectue un retour sur les travaux de Beacutevenot consacreacutes agrave la tradition manuscrite et agrave la transmission des traiteacutes de Cyprien dont les reacutesultats sont geacuteneacuteralement admis Le texte latin qui est imprimeacute et traduit dans la preacutesente eacutedition est en conseacutequence celui de Beacutevenot paru dans la series latina du Corpus Christianorum (vol 3 1972) apregraves un reacuteexamen des donneacutees drsquoun Vero-nensis deperditus Le texte latin srsquoaccompagne drsquoun apparat seacutelectif qui fournit toutes les variantes du Veronensis et situe le texte de Beacutevenot face agrave celui de ses preacutedeacutecesseurs ainsi que drsquoun apparat des laquo lieux parallegraveles raquo chez Cyprien et dans la tradition indirecte La traduction franccedilaise a eacuteteacute con-fieacutee agrave un speacutecialiste reconnu de Cyprien Michel Poirier Lrsquoannotation de P Mattei se prolonge dans des notes critiques (Appendice 1) et des notes compleacutementaires portant sur quelques termes et no-tions cleacutes de lrsquoeccleacutesiologie de Cyprien (Appendice 2) LrsquoAppendice 3 rassemble les testimonia au De unitate chez une douzaine drsquoauteurs depuis Optat de Milegraveve jusqursquoagrave lrsquoAnonymus Antigregoria-nus de la fin du onziegraveme siegravecle Avec ses quatre index dont un preacutecieux index analytique cette eacutedi-tion met agrave la disposition de tous un des chefs-drsquoœuvre de la litteacuterature latine chreacutetienne et de la theacuteologie ancienne
Paul-Hubert Poirier
27 JUSTIN Apologie pour les chreacutetiens Introduction texte critique traduction et notes par Char-les MUNIER Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 507) 2006 390 p
Professeur honoraire de la Faculteacute de theacuteologie catholique de lrsquoUniversiteacute Marc-Bloch de Stras-bourg Charles Munier srsquointeacuteresse depuis longtemps aux Apologies de Justin On lui doit en effet une eacutetude drsquoensemble de celles-ci dans laquelle il expose sa thegravese de lrsquouniteacute de lrsquoApologie de Jus-tin agrave savoir que ce qursquoon appelle communeacutement la Deuxiegraveme Apologie constituerait en fait la suite et la fin de la Premiegravere apologie lrsquoune et lrsquoautre formant une œuvre unique que la tradition ma-nuscrite mdash essentiellement le codex Parisinus graecus 450 seul teacutemoin indeacutependant des deux eacutecrits mdash aurait inducircment partageacutee en deux19 Une premiegravere reacuteeacutedition par C Munier tirait les conseacutequen-ces de la thegravese de lrsquouniteacute en donnant lrsquoune agrave la suite de lrsquoautre les deux apologies sans aucune marque de division et avec une numeacuterotation continue des chapitres de 1 agrave 68 pour la Premiegravere et de 69 agrave 83 pour la Deuxiegraveme Apologie20 La preacutesente eacutedition repose sur les mecircmes principes tout en gardant pour des raisons pratiques le reacutefeacuterencement traditionnel de I1-68 et II1-15 Autre particu-lariteacute de lrsquoeacutedition de Munier il renonce agrave la faccedilon de faire instaureacutee par Dom P Maran dans son eacutedition de 1742 qui transposait le chapitre 8 de lrsquoApologie II apregraves le chapitre 2 ce qui produisait
19 Voir LrsquoApologie de saint Justin philosophe et martyr Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Pa-radosis raquo 38) 1994
20 Saint Justin Apologie pour les chreacutetiens Eacutedition et traduction Fribourg Suisse Eacuteditions universitaires (coll laquo Paradosis raquo 39) 1995 sur ces deux ouvrages cf P-H POIRIER Gaeacutetan GUAY laquo Justin apologiste Agrave propos de deux publications reacutecentes raquo Laval theacuteologique et philosophique 52 (1996) p 837-844
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
205
un deacutecalage dans la numeacuterotation des chapitres 3 agrave 7 Sur ce dernier point on donnera volontiers raison agrave Munier de srsquoen tenir aux donneacutees de la tradition manuscrite Si la chose est plus difficile agrave trancher en ce qui concerne lrsquouniteacute de lrsquoApologie la thegravese de Munier fondeacutee sur une solide analyse rheacutetorique de lrsquoœuvre me semble emporter la conviction Agrave tout le moins permet-elle de lire les deux Apologies drsquoune seule venue sans solution de continuiteacute Quant agrave lrsquoeacutedition elle-mecircme elle repose sur une nouvelle lecture du manuscrit parisien et de sa copie du seiziegraveme siegravecle conserveacutee agrave Londres (British Library Loan 3613) et elle tient compte de la tradition indirecte repreacutesenteacutee par les citations drsquoEusegravebe de Ceacutesareacutee dans lrsquoHistoire eccleacutesiastique et de Jean Damascegravene dans les Sa-cra Parallela Lrsquoeacutedition de Munier se veut laquo la plus fidegravele possible agrave la tradition manuscrite tout en reacuteservant le meilleur accueil aux conjectures les mieux eacuteprouveacutees des anciens philologues raquo (p 93) Elle se distingue ainsi radicalement et heureusement de celle de M Marcovich21 qui corrige agrave ou-trance un texte somme toute attesteacute par un seul teacutemoin
Lrsquoeacutedition et la traduction de lrsquoApologie sont preacuteceacutedeacutees drsquoune introduction qui aborde les points suivants 1) lrsquoapologiste Justin sa vie et son œuvre 2) lrsquoApologie de Justin (datation de lrsquoouvrage en 153-154) 3) la structure litteacuteraire de lrsquoApologie 4) la deacutemarche apologeacutetique de Justin 5) chris-tianisme et philosophie 6) les eacutecrits judeacuteo-chreacutetiens (les sources utiliseacutees par Justin bibliques ou autres) 7) la tradition manuscrite 8) les principes de lrsquoeacutedition La traduction est accompagneacutee drsquoune annotation qui fournit des indications bibliographiques et des parallegraveles essentiellement sur les thegrave-mes abordeacutes par Justin dans lrsquoApologie Cette annotation est tireacutee drsquoun commentaire que Munier destinait agrave lrsquoeacutedition des laquo Sources Chreacutetiennes raquo mais qui nrsquoa pu y trouver place Il a fort heureuse-ment eacuteteacute publieacute ailleurs dans son inteacutegraliteacute22 mettant ainsi agrave la disposition du lecteur une abondante documentation comparative et bibliographique Gracircce au travail de Charles Munier nous disposons maintenant drsquoune eacutedition moderne de lrsquoApologie de Justin qui repose sur de sains principes criti-ques Pour le lecteur francophone elle remplace celle de Louis Pautigny23 qui a rendu des services meacuteritoires et qui demeure encore utile La preacutesente traduction repose sur celle que Munier a fait pa-raicirctre en 1995 tout en srsquoen eacutecartant agrave plusieurs endroits dans un souci de plus grande exactitude24 Lrsquoannotation est en geacuteneacuteral pertinente et elle eacuteclaire le vocabulaire rheacutetorique juridique et doctrinal de Justin En I183 le renvoi agrave Socrate de Constantinople (Histoire eccleacutesiastique III13) comme teacutemoin de laquo la pratique paiumlenne de lrsquoimmolation drsquoenfants aux fins de divination raquo (p 179 n 7) est anachronique sans compter que sur ce point lrsquohistorien est consideacutereacute comme peu creacutedible par les reacutecents traducteurs de lrsquoHistoire25 Le commentaire sur le κόρος de I572 selon lequel laquo Justin re-flegravete bien ici lrsquoespegravece de lassitude geacuteneacuterale de vide moral et spirituel qui taraude la socieacuteteacute romaine sous le Haut-Empire raquo (p 281 n 3) relegraveve du clicheacute En I6110 (p 292-293) lrsquoaffirmation de Justin agrave lrsquoeffet que le baptecircme nous permet laquo de ne point demeurer des enfants de la neacutecessiteacute et de
21 Iustini Martyris Apologiae pro Christianis Berlin New York Walter de Gruyter (coll laquo Patristische Texte und Studien raquo 38) 1994
22 Justin Martyr Apologie pour les chreacutetiens Introduction traduction et commentaire Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Patrimoines raquo seacuterie laquo Christianisme raquo) 2006
23 Justin Apologies Paris Librairie Alphonse Picard et Fils (coll laquo Textes et documents pour lrsquoeacutetude his-torique du christianisme raquo) 1904
24 En I61 (p 141) il faut traduire τοῦ ἀληθεστάτου par laquo du Dieu tregraves veacuteritable raquo en I463 et 4 (p 251 et 253) la mecircme expression μετὰ Λόγου est rendue par laquo selon le Logos raquo et par laquo avec le Logos raquo en I534 (p 269) ἄλλα πάντα γένη ἀνθρώπεια est traduit par laquo toutes les autres nations raquo alors que laquo toutes les autres races humaines raquo serait plus exact en I605 (p 287) τὴν μετὰ τὸν πρῶτον θεὸν δύναμιν doit ecirctre rendu simplement par laquo la puissance qui vient apregraves le premier Dieu raquo et non gloseacute par laquo apregraves Dieu le premier principe la seconde puissance raquo (formulation reprise de Pautigny)
25 P PEacuteRICHON P MARAVAL Socrate de Constantinople Histoire eccleacutesiastique Livres II-III Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 493) 2005 p 304
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
EN COLLABORATION
206
lrsquoignorance mais de devenir au contraire des enfants de la liberteacute et de la science raquo meacuterite drsquoecirctre mise en parallegravele avec celle de Theacuteodote (Extraits 781-2) qui reconnait lui aussi que laquo le bain raquo deacutelivre de la laquo fataliteacute raquo mais ajoute que laquo ce nrsquoest drsquoailleurs pas le bain seul qui est libeacuterateur mais crsquoest aussi la gnose raquo on a sans doute lagrave de Justin agrave Theacuteodote une mecircme affirmation deacutejagrave tradi-tionnelle du pouvoir du baptecircme sur la fataliteacute astrale
Paul-Hubert Poirier
28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin agrave Theacuteodose II (312-438) Volu-me I Code Theacuteodosien livre XVI Texte latin par Theodor MOMMSEN traduction par dagger Jean ROUGEacute introduction et notes par Roland DELMAIRE avec la collaboration de Franccedilois RICHARD et drsquoune eacutequipe du GRD 2135 Paris Les Eacuteditions du Cerf (coll laquo Sources Chreacutetiennes raquo 497) 2005 524 p
Publieacute en 438 par lrsquoempereur drsquoOrient Theacuteodose II le recueil officiel du droit romain qui porte son nom a conserveacute quelque 320 lois concernant directement la religion et promulgueacutees entre 313 et 438 auxquelles il faut ajouter une quinzaine de lois eacutemises pendant la mecircme peacuteriode et qui ne figurent pas dans le Code Theacuteodosien mais ne sont attesteacutees que par le Code Justinien La plus grande partie de ces lois sont regroupeacutees au livre XVI du Code Theacuteodosien Ce sont celles-ci qui font lrsquoobjet de la preacutesente publication un second volume devant regrouper les autres Le texte latin reproduit celui de lrsquoeacutedition de Theodor Mommsen Paul Meyer et Paul Kruumlger parue en 1904-1905 Pour le reste introduction traduction notes glossaire et index lrsquoouvrage repreacutesente le reacutesultat du travail du regretteacute Jean Rougeacute poursuivi dans le cadre drsquoune eacutequipe de recherche du CNRS sous la direction de Franccedilois Richard Lrsquointroduction drsquoune centaine de pages preacutesente tout drsquoabord laquo le Code Theacuteodosien et ses problegravemes raquo (historique du Code types de constitutions ou de lois destina-taires difficulteacutes poseacutees par des erreurs sur le nom de lrsquoempereur ou des empereurs sur le nom et le titre des destinataires dans le formulaire de souscription sur le lieu drsquoeacutemission ou sur la datation) puis fournit une vue drsquoensemble de la leacutegislation sur la religion connue par le Code On y trouvera un tableau recensant sur seize pages la totaliteacute des lois contenues dans le Code Theacuteodosien mdash plus celles attesteacutees uniquement par le Code Justinien mdash avec lrsquoindication de leur date de leur auteur et de leur objet selon qursquoelles visent le christianisme le paganisme ou le judaiumlsme Suivent des preacute-sentations syntheacutetiques des mesures visant la laquo vraie religion raquo les privilegraveges des Eacuteglises et des clercs les heacutereacutetiques et les schismatiques (incluant les manicheacuteens et les astrologues) les paiumlens et les apostats les Juifs La leacutegislation conserveacutee par le Code Theacuteodosien montre la succession de deux phases dans la politique des empereurs des quatriegraveme et cinquiegraveme siegravecles agrave lrsquoendroit de la religion de 312 agrave 379 la leacutegislation est inspireacutee de la politique constantinienne visant agrave accorder aux chreacutetiens des droits identiques agrave ceux dont jouissaient les cultes publics romains et les Juifs agrave partir de 379 avec lrsquoavegravenement de Theacuteodose le premier empereur agrave ne pas prendre le titre de pon-tifex maximus les choses changent radicalement dans la mesure ougrave le christianisme est deacutesormais consideacutereacute comme religion officielle (lois du 28 feacutevrier 380 Code Theacuteodosien XVI12) Lrsquoeacutedition et la traduction preacutesentent les lois dans lrsquoordre ougrave elles se suivent dans le livre XVI chacune eacutetant ac-compagneacutee drsquoune notice sur la date et le destinataire drsquoune bibliographie et drsquoune annotation Quatre annexes facilitent la lecture de ces textes parfois tregraves techniques I un index des heacutereacutesies et schismes mentionneacutes dans le livre XVI on y trouvera aussi bien des personnages historiques que les noms connus par les heacutereacutesiologues les notices de cet index ne preacutetendent pas faire le point sur la reacutealiteacute historique de tous ces groupuscules mais plutocirct syntheacutetiser ce qursquoen disent les sources an-ciennes reacutefeacuterences agrave lrsquoappui II la date des lois sur les Juifs adresseacutees agrave Eacutevagrius (probablement le 18 octobre 329) III les lois contre les donatistes (17 juin 141 et 30 janvier 415) IV des notes sur Code Theacuteodosien XVI2020 agrave propos des sacerdotales paganae superstitionis les precirctres du culte
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier
LITTEacuteRATURE ET HISTOIRE DU CHRISTIANISME ANCIEN
207
impeacuterial Les annexes sont suivies drsquoun reacutepertoire des empereurs de 313 agrave 438 et drsquoun tregraves preacutecieux glossaire des termes du vocabulaire juridique qui apparaissent dans les textes ainsi que des titres des divers responsables civils ou militaires Lrsquoouvrage se termine par trois index nominum geacuteogra-phique et theacutematique seacutelectif Le livre XVI du Code Theacuteodosien constitue un teacutemoignage unique non seulement de lrsquoascension et de lrsquoaffirmation progressive de la laquo vraie religion raquo mais aussi de la diversiteacute religieuse qui subsiste malgreacute la reconnaissance du christianisme comme religion offi-cielle en 380 On y voit les efforts reacutepeacuteteacutes des empereurs pour favoriser lrsquoEacuteglise chreacutetienne mais aussi pour la controcircler comme en teacutemoignent entre autres les nombreuses dispositions concernant les heacuteritages et leur appropriation par les clercs Comme lrsquoeacutecrit Roland Delmaire laquo le recircve de Theacuteo-dose de voir tous les sujets reacuteunis dans la religion chreacutetienne deacutefinie agrave Niceacutee restera un vœu pieux les heacutereacutesies et les schismes neacutes au IVe siegravecle finiront par srsquoeacuteteindre drsquoautres ne tarderont pas agrave ap-paraicirctre qui diviseront tout autant une chreacutetienteacute incapable de faire son uniteacute mecircme avec lrsquoappui du bras seacuteculier raquo (p 107)
Paul-Hubert Poirier