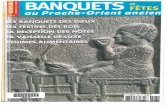Scepticisme ancien et moderne chez Bayle
Transcript of Scepticisme ancien et moderne chez Bayle
Scepticisme ancien et moderne chez Bayle Gianluca Mori (Università del Piemonte Orientale, Vercelli) 1. Depuis désormais quatre décennies, toute discussion sur le rapport
que le scepticisme moderne entretient avec ses sources anciennes renvoie inéluctablement à l’ouvrage de Richard H. Popkin sur l’histoire du scepticisme d’Érasme à Descartes – prolongé jusqu’à Spinoza à partir de l’édition de 1979. La traduction récente en français de cet ouvrage a donné une nouvelle impulsion au débat1. Popkin soutient, comme on le sait, que l’essor du scepticisme à l’âge moderne se doit, d’une part, à la réédition des textes des sceptiques anciens (et notamment des Hypotyposes pyrrhoniennes et du Adversus mathematicos de Sextus, respectivement par Henri Estienne et par Gentian Hervet), de l’autre à la tentative de la Contre-Réforme catholique de contraster le rationalisme que l’on attribuait de manière plus ou moins légitime aux protestants. Ce cocktail explosif donnerait lieu à une nouvelle alliance, absolument inattendue, entre les sceptiques grecs et les apologistes chrétiens, alliance qui fournirait le contexte des ouvrages de Montaigne, de La Mothe Le Vayer, de Gassendi, de Pascal.
En réalité, Popkin ne fut pas le premier qui se posa cette question. Les sceptiques «modernes» eux-mêmes ne manquèrent pas d’y songer, et d’ailleurs une dimension diachronique, sinon historique et doxographique, est de quelque manière essentielle au scepticisme. L’identité sceptique se constitue dans l’histoire et par rapport à l’histoire; ainsi, chaque scepticisme semble trouver sa raison d’être à l’intérieur d’une généalogie
1 R.H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza [1ère éd. 1960], Berkeley-Los Angeles 1979, trad. fr.: Histoire du scepticisme d’Érasme à Spinoza, Paris 1995 (notons que même en Italie l’ouvrage de Popkin n’a été traduit qu’en 1995: La storia dello scetticismo da Erasmo a Spinoza, Milano 1995). Sur les questions ouvertes par l’ouvrage de Popkin, voir Revue de Synthèse, 1998, n. 2-3, «Histoire du scepticisme de Sextus Empiricus à Richard Popkin», prés. par P.-F. Moreau et E. Brian. Voir aussi J.-P. Cavaillé, «Le retour des sceptiques», Revue philosophique, 1998, p. 197-220.
2
plus ou moins élaborée. C’est le cas de La Mothe le Vayer, qui écrit «à l’imitation des anciens»; de Huet, qui insère dans son Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit humain une esquisse d’histoire du scepticisme; de Simon Foucher, qui est l’auteur d’une Apologie des académiciens (1686) dont il se présente comme l’héritier. Ce retour du scepticisme sous des formes diverses mais toujours en relation avec son passé fut remarqué également par les adversaires des sceptiques, comme l’attestent dès leurs titres les ouvrages de Pierre de Villemandy, auteur du Scepticismus debellatus […] adversus scepticos quosque veteres ac novos (1697)2, et de Jean-Pierre de Crousaz, qui publie en 1733 un épais Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne3.
La catégorie de «scepticisme moderne» n’est donc pas une création des historiens des idées du XXe siècle. En 1743, Johann Jacob Brucker consacre un chapitre entier de son Historia critica philosophiae aux «sceptici recentiores»4. On y lit une analyse très proche de celle de Popkin : le scepticisme moderne se caractériserait à son début par ses liens avec la religion chrétienne et, en particulier, avec la polémique anti-protestante des théologiens de la Contre-Réforme – comme il est clair, dit Brucker, à partir de la dédicace dont Hervet fait précéder son édition de Sextus5. Parmi les représentants les plus en vue de ce scepticisme, on retrouve Sanchez, La Mothe Le Vayer, Huet, Bayle, mais aussi un abbé praguois moins connu qu’eux, Hieronymus Hirnhaim (lequel, entre autres, soutient des thèses irrationalistes assez proches de celles que Bayle mettra dans la bouche de son «abbé pyrrhonien»)6. Brucker précise pourtant que les «diversae viae» du scepticisme doivent être soigneusement distinguées, car, malgré la bonne foi d’une partie de ses tenants modernes, elles peuvent aussi mener à l’irréligion. C’est le cas de Collins et de Toland, mais aussi – «si plerosque audis» – de Pierre Bayle7.
Au contraire, selon Popkin8, Bayle est un croyant sincère, quoique tiède, qui voit dans le recours à une foi aveugle et irrationnelle la seule
2 P. de Villemandy, Scepticismus debellatus, seu Humanae cognitionis ratio ab imis radicibus explicata ; ejusdem certitudo adversus scepticos quosque veteres ac novos invicte asserta […], Lugduni Bat. 1697. 3 J.-P. de Crousaz, Examen du pyrrhonisme ancien et moderne, La Haye 1733. 4 J.J. Brucker, Historia critica philosophiae , t. IV-1, Lipsiae 1743, l. III, ch. 1, p. 536-609. 5 Ibid., p. 604 sq. 6 Ibid.. p. 543 sq. (cf. H. Hirnhaim, De Typho generis humani, Pragae 1676). 7 Ibid., p. 538-540, 607. 8 Dans la 1ère éd. de son History of Scepticism, Popkin ne parlait de Bayle qu’en passant; la nouvelle éd. en préparation s’étendra au contraire from Savonarola to Bayle précisément. On y retrouvera des analyses que Popkin avait déjà proposées dans l’introduction à son anthologie anglaise du Dictionnaire (1965) et dans l’article «The High Road to Pyrrhonism» (1965, puis dans R.H. Popkin, The High Road to Pyrrhonism, San Diego 1980). La contribution de Popkin
3
réponse possible au doute sceptique, qu’il a poussé jusqu’à ses dernières conséquences. Bayle constituerait en effet le point d’aboutissement extrême du scepticisme moderne, qui parvient enfin à nier la possibilité même d’un «critère de la vérité». Avec Bayle, la raison humaine devient entièrement impuissante, elle mène «au pyrrhonisme intégral» (complete Pyrrhonism), elle n’est pas en mesure de «résoudre aucune question». Les conclusions de la raison se fondent en effet sur des notions évidentes dont on peut prouver la fausseté – ce que les sceptiques anciens n’avaient pas osé avancer. Ainsi, bien qu’il soit plus proche d’Arriaga et de Maimonides que de Sextus, le «super-sceptique» Bayle accomplirait le projet pyrrhonien de destruction de la raison, en ne laissant aux hommes égarés qu’une seule ressource: celle de la foi et de la révélation9.
Plus récemment, Frédéric Brahami est revenu sur ces mêmes questions. Il concorde avec Popkin sur le lien du scepticisme de Bayle avec la religion et surtout avec la théologie chrétienne, ce caractère étant à son avis aussi la grande nouveauté de la position de Bayle par rapport à ses prédécesseurs. Il avoue également que Bayle aboutit à la destruction de la raison naturelle, c’est-à-dire au constat que «l’évidence même est fausse», ce qui «excède» les bornes du pyrrhonisme ancien; cependant, à son avis, le résultat de la démarche de Bayle est moins le fidéisme qu’une sorte de nouvelle épistémologie de la croyance, qui remplace l’idéal cartésien de l’évidence discursive. De ce point de vue, Bayle ne représenterait qu’un maillon de la chaîne qui relie Montaigne à Hume10.
Ces interprétations ne manquent pas d’arguments et d’appuis textuels significatifs. Cependant, elles ne couvrent qu’une partie de la position de Bayle, alors que le rapport de cette partie avec le reste de sa pensée nous semble demeurer problématique et digne d’une analyse ultérieure. Celle-ci concernera moins la question de l’adhésion de Bayle au scepticisme que celle de sa lecture de l’évolution du scepticisme, et notamment du rapport entre le scepticisme moderne et le scepticisme ancien. Cette question est analysée surtout à l’article «Pyrrhon» du Dictionnaire historique et critique, mais des allusions à son égard traversent toute la biographie au recueil Pierre Bayle: le philosophe de Rotterdam, éd. P. Dibon, Amsterdam-Paris 1959 («Pierre Bayle’s Place in XVIIth-Century Scepticism», p. 1-19), contient une lecture différente, et plus problématique, du fidéisme baylien, qu’il n’a pas reprise par la suite. 9 R.H. Popkin, The High Road to Pyrrhonism, p. 25-35; Id., « The ‘Incurable Scepticism’ of Henry More, Blaise Pascal and Søren Kiekegaard », in R.H. Popkin - C.B. Schmitt [éds.], Scepticism from the Renaissance to the Enlightenment, Wiesbaden 1987, p. 169-184 (p. 177). 10 F. Brahami, Le travail du scepticisme: Montaigne, Hume, Bayle, Paris 2001, p. 119-121 et passim. J. Maia Neto a vu dans le scepticisme de Bayle une résurgence du mode sceptique de l’épochè associé au probabilisme académique (mais il avoue lui-même que cette lecture se heurte à plusieurs difficultés, voir son «Bayle’s Academic Scepticism», in J.E. Force - D.S. Katz [éds.], Everything Connects: In Conference with R.H. Popkin, Leiden 1999, p. 264-275).
4
intellectuelle de Bayle, des écrits de jeunesse jusqu’aux dernières polémiques avec Le Clerc et Jaquelot.
2. En général, on remarque chez Bayle – comme chez la plupart des
auteurs de son temps et du nôtre, y compris Popkin –, un usage assez flou du terme «sceptique». D’un côté, il considère comme «sceptique» toute sorte de doute, même lorsque ce doute ne concerne que quelques croyances particulières (en particulier les croyances religieuses), sans remettre en question la possibilité d’une connaissance rationnelle de type démonstratif11. De l’autre côté, il ne tient pour proprement «sceptique» que la position de ceux qui nient l’existence d’un critère de la vérité et qui soutiennent la nécessité de la suspension du jugement (épochè) sur toute question12. Bayle réduit le scepticisme, pris dans ce dernier sens, à l’affirmation de «l’incertitude de toutes choses», sans se montrer particulièrement sensible à l’égard des distinctions entre les différentes écoles sceptiques de l’Antiquité, qu’il connaît pourtant bien13. A son avis, Arcésilas «n’était pas pour le doute avec plus d’ardeur» que Pyrrhon («rien n’était plus facile que de les mettre d’accord: il ne fallait que leur demander qu’ils s’expliquassent nettement et sincèrement»)14 et la troisième Académie «ne différait point» de la seconde («car, à quelques adoucissements près, qui n’étaient propre qu’à jeter de la poudre aux yeux, [Carnéade] était défenseur de l’incertitude aussi ardemment qu’Arcési-las»)15.
Bien qu’il dispose d’une connaissance assez étendue de la tradition sceptique ancienne, Bayle s’appuie moins sur les Hypotyposes de Sextus16 11 Voir par exemple Bayle à Naudis, 8 sept. 1698 (Nouvelles lettres de M. Pierre Bayle, La Haye 1739, t. II, p. 398): «les philosophes chrétiens qui parlent sincèrement disent tout net qu’ils sont chrétiens ou par la force de l’éducation, ou par la grâce de la foi que Dieu leur a donnée, mais que la suite des raisonnements philosophiques et démonstratifs ne serait capable que de les rendre sceptiques à cet égard toute leur vie». 12 Voir P. Bayle, Dictionnaire historique et critique [1ère éd. 1697, 2ème éd. 1702], Amsterdam 1740 [dorénavant: Dict.], art. «Pyrrhon», rem. A. 13 Comme l’atteste sa lettre à Minutoli de 1673 (citée ci-après, note 17). 14 Dict., «Pyrrhon», A. 15 Dict., «Carnéade» , B. 16 Voici une liste des citations de Sextus dans le Dictionnaire, tirée du cd-rom qui se trouve en annexe à H.H.M. van Lieshout, The Making of Pierre Bayle’s Dictionnaire historique et critique, Amsterdam 2001: Dict., «Achille», P; «Anaxagoras»; «Arcesilas», F, H; «Aristarque (philos.)», A; «Ariston», A; «Carneade», C; «Chrysippe (fils)», D; «Chrysippe (philos.)», O; «Critias», H; «Democrite»; «Diagoras (athée)», D; «Diogene (cyn.)», P; «Hipparchia», C, D; «Leucippe», A; «Metrodore (de Chios)», A; «Pythagoras», I; «Pythias», A, B; «Prodicus», G;
5
que sur Cicéron, Diogène Laërce et Lactance, dont il discute longuement les témoignages en s’attardant souvent sur des questions bio-bibliographiques. Les premiers textes de Bayle sur le pyrrhonisme ancien, et notamment sa lettre à Minutoli de janvier 1673, tiennent en effet plutôt de la doxographie que de la philosophie17. Cet aspect ne disparaîtra pas de ses productions ultérieures. Dans plusieurs articles du Dictionnaire («Arcésilas», «Carnéades», «Lacyde», «Métrodore de Chios»), les questions soulevées par les sceptiques ne sont pas analysées, mais seulement rapportées de manière impartiale. Cette reconstruction historique du scepticisme ancien s’associe cependant dans d’autres articles («Pyrrhon», «Xénophanes», «Zénon d’Élée», «Zénon, philosophe épicurien») à un questionnement philosophique qui devient de plus en plus pressant. Dans ces articles, Bayle s’efforce également de retracer les origines conceptuelles du scepticisme, en montrant que la doctrine de l’incompréhensibilité de toutes choses (acatalepsie) est le résultat cohérent du monisme des Éléates, qui posant l’immutabilité de l’Un ne sont pas en mesure de justifier les changements visibles dans le monde et sont obligés de rejeter «le témoignage des sens»18.
De toute manière, quelque équitable que puisse être la description que Bayle donne du scepticisme ancien, son jugement demeure en général tout à fait négatif d’un point de vue strictement philosophique. Bayle croit en effet que le scepticisme – entendu, au sens susdit, comme négation de la possibilité d’accéder au critère de la vérité –, se heurte à des contre-exemples de poids, notamment le cogito19 et les «notions communes» de la tradition philosophique, c’est-à-dire les axiomes de la logique, de la mathématique et de la morale20. Selon Bayle, douter de ces notions (comme l’avait fait Carnéade)21, c’est s’engager dans des débats stériles et inutiles. Il s’agit en effet de propositions attestées par l’expérience la plus commune: «si Gassendi avait fait un livre où […] il eût entrepris de faire voir que le tout n’est pas plus grand que sa partie […], il n’eût persuadé à
«Rufin», C; «Spinoza», N; «Thales», D; «Xenophanes», A, B, D, L; «Zenon (d'Elée)», B, E, G, K. 17 Bayle à Minutoli, 31 janvier 1673, dans Correspondance de Pierre Bayle, éd. dirigée par E. Labrousse, t. I, Oxford 1999, p. 184 sq. (lettre n° 31). 18 Voir surtout Dict., «Xénophanes», B, L; «Zénon d’Élée», K. 19 Voir Dict., «Zénon», in corp., et «Métrodore de Chios», in corp. Voir aussi P. Bayle, Œuvres diverses, La Haye 1727-1731 [dorénavant: OD], t. IV, p. 480: «Ce principe est le premier de tous pour convaincre les pyrrhoniens» (Cours, Métaphysique). 20 Pour plus de détails à cet égard, voir G. Mori, «Pierre Bayle on Scepticism and ‘Common Notions’», in The Return of Scepticism from Hobbes and Descartes to Bayle, actes du colloque de Vercelli de mai 2000, éd. G. Paganini, sous presse chez Kluwer, Dordrecht. 21 Voir Dict., «Carnéades», C.
6
personne que sa cause fût soutenable»22. Ou encore: «l’on n’oserait dire sans craindre de se rendre ridicule, qu’il y a eu des gens qui se sont persuadés que le tiers d’un tout est égal à la moitié…»23. Ainsi, Bayle soutient qu’il existe un petit nombre de propositions évidentes dont la vérité est incontestable. On se bornera ici à un seul exemple, mais particulièrement probant: celui des axiomes de la morale.
Tout scepticisme – ancien aussi bien que moderne – se caractérise par une prise de position caractéristique à cet égard: les axiomes moraux ne sont pas universels et univoques, ils dépendent de l’éducation, des préjugés, de la coutume, ils sont sujets aux disputes et au jeu des opinions humaines. C’est le dixième mode d’Énésidème, rapporté par Sextus24 et repris ensuite, à l’âge moderne, par Montaigne et par les libertins érudits, dont La Mothe le Vayer. Être sceptique, c’est nier l’universalité et la nécessité des normes morales, soit qu’elles se présentent sous la forme d’un commandement divin, soit qu’elles soient conçues comme des lois absolues indépendantes de toute volonté créée ou incréée. Comme le dit Bayle à l’article «Arcésilas» du Dictionnaire, «dès qu’on assure qu’il n’y a rien de certain, et que tout est incompréhensible, on déclare qu’il n’est pas certain qu’il y ait des vices et des vertus»25. Dans le corps de l’article «Pyrrhon», il précise: «quelque abominable que soit ce dogme, il coule naturellement de ce principe pyrrhonien, que la nature absolue et intérieure des objets nous est cachée»26.
C’est contre cette position que s’insurgent au dix-septième siècle Grotius et Pufendorf, suivis par leur éditeur et traducteur Barbeyrac. A ce propos, il n’est pas nécessaire de se prononcer ni sur l’origine essentiellement anti-sceptique du jusnaturalisme (thèse soutenue par Richard Tuck)27 ni sur la vocation essentiellement morale du scepticisme. Il suffit de remarquer – c’est là une donnée de fait – que Grotius et Pufendorf présentent leur doctrine du droit naturel comme une réponse aux sceptiques: Carnéades est leur ennemi commun. Dans son introduction aux Droit des gens de Pufendorf, Barbeyrac renchérit sur cette position en évoquant les spectres des sceptiques modernes, surtout Montaigne et
22 Dict., «Pomponace», F. Voir aussi Dict., «Maldonat», M. 23 OD III, 936a. 24 Esquisses pyrrhoniennes, Liv. I, 14, éd. P. Pellegrin, Paris 1997, p. 133 sq. 25 Dict., «Arcésilas», K. 26 Dict., «Pyrrhon», in corp.; voir aussi ibid., rem. I. 27 Voir R. Tuck, «The ‘Modern’ Theory of Natural Law», in The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, éd. A. Pagden, Cambridge 1987, p. 99-119. Interprétation discutée par C. Larrère, «Droit naturel et scepticisme», dans Le Scepticisme au XVIe et au XVIIe siècle (dans la série: «Le retour des philosophies antiques à l’Âge classique», sous la dir. de P.-F. Moreau, t. II), Paris 2001, p. 293-308.
7
Charron, qu’il rapproche à juste titre, sur ce point, des sceptiques de l’antiquité28. On peut en revanche se demander s’il peut être légitime d’ajouter Pierre Bayle à ces auteurs, comme il arrive à Barbeyrac de le faire. Apparemment, étant un admirateur des sceptiques anciens et un grand sceptique lui-même, Bayle devrait soutenir que les valeurs morales sont relatives et dépourvues d’universalité… En raisonnant ainsi, Barbeyrac présente l’image d’un Bayle-Carnéade sceptique à l’égard de la morale, image qui ne manquera pas d’être reprise par les lecteurs modernes de son introduction, même les plus avertis (dont Tuck lui-même)29.
Notons cependant que Barbeyrac, tout en étant un très bon connaisseur des ouvrages de Bayle, n’est pas en mesure de citer aucun texte attestant un éventuel penchant de ce dernier pour le scepticisme moral. Il se borne à rapporter un passage que Bayle tire, à son tour, de l’Essai de logique de Mariotte, où il n’est cependant pas question de nier l’existence de principes moraux généraux et indubitables – cette existence étant admise par Mariotte également –, mais de remarquer la difficulté de donner des jugements moraux fiables concernant les actions des hommes, au vu de la complexité des facteurs en jeu30. Cet embarras où se trouve Barbeyrac lorsqu’il essaie de faire de Bayle un sceptique à l’égard des principes de la morale est aisément explicable. C’est que Bayle soutient en toutes lettres, et à plusieurs reprises, la position opposée, c’est-à-dire une forme de rationalisme moral très proche de celui de Grotius, et cela de ses premiers ouvrages jusqu’à la fin de sa vie. Les citations pourraient se multiplier de manière spectaculaire:
– (1675) «Il y a une certaine loi de la nature, que les hommes entendent tous sans
règles et sans préceptes, et qui met de la différence entre le bien et le mal. Il y a donc par rapport aux moeurs quelques principes dont la lumière naturelle suffit pour connaître la vérité» (OD IV, 255)
– (1686) «Il faut soûmettre toutes les loix morales à cette idée naturelle d' équité,
qui, aussi bien que la lumiere métaphysique, illumine tout homme venant au monde» (Commentaire philosophique, ch. 1)
– (1704) «Je m’en tiens à la doctrine de Grotius: il me semble que l’homme est tout
autant obligé de se conformer aux idées de la droite raison dans les actes de sa volonté, que de suivre les règles de la logique dans les actes de son
28 Voir J. Barbeyrac, Préface, dans S. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, éd. de Bâle 1732, § 3-4 (t. I, p. 22-34). 29 R. Tuck, «The ‘Modern’ Theory of Natural Law», p. 107-8. Voir aussi P. Rétat, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au dix-huitième siècle, Paris 1971, p. 39 sq. (Pierre Rétat a bien vu, par ailleurs, la différence entre la position mi-volontariste de Barbeyrac et celle de Bayle, qui se rapproche plutôt de Grotius, voir ibid., p. 40). 30 Barbeyrac, Préface, § 3, p. 26; cf. Bayle, OD III, 705b et E. Mariotte, Essai de Logique [1678], Paris 1992, p. 110 sq.
8
entendement»; «[les principes moraux] émanent de la nécessité de la nature et […] imposent une obligation indispensable» (OD III, 409, 406a)
Or, a-t-on jamais vu un sceptique – ancien ou moderne – soutenir
qu’il y a des règles morales éternelles et universelles et donner une liste de ces règles indubitables et certaines?31 Bayle va jusqu’à défendre sa position contre les arguments tirés de la variété des coutumes et des sociétés humaines, qui «fournissent – dit-il – des armes au Pyrrhonisme». A cet égard, dit-il, il suffit de montrer: «que les règles les plus générales des mœurs se [sont] conservées presque partout et que, pour le moins, elles se [sont] conservées dans toutes les sociétés où l’on cultivait l’esprit»32.
Malgré cela, on a soutenu que ces prises de position rationalistes ne constitueraient pas le fondement véritable de la pensée de Bayle, ce fondement étant plutôt fourni par la théorie subjectiviste (et sceptique) des droits de la conscience errante qu’il énonce dans le Commentaire philosophique33. Cependant, le scepticisme du Commentaire ne porte que sur les dogmes religieux, sans toucher aux axiomes généraux de la raison34. N’étant pas susceptible selon Bayle de vrai ou de faux, la religion dépend du goût, de l’instinct, de la «conscience» entendue au sens de Malebranche (c’est-à-dire comme un pur «sentiment intérieur» qui s’oppose par définition aux idées claires et distinctes de la raison)35. C’est ce scepticisme – que les adversaires de Bayle interprètent aussitôt et à juste titre comme une forme d’indifférentisme religieux – qui ouvre la voie à la position des droits de la conscience errante. Il n’en reste pas moins que, si ces droits sont bien des droits inviolables et presque sacrés, moralement parlant, et non pas des revendications subjectives, soumises au même doute qui frappe les croyances religieuses, cela se doit uniquement à l’existence d’un axiome général strictement rationnel et évident comme celui «qu’il ne faut pas agir contre sa propre conscience», axiome que Bayle mentionne au
31 Voir les passages rassemblés par E. Labrousse, Pierre Bayle, t. II, La Haye 1964, p. 259. 32 OD III, 407a. Voir aussi Dict., «Jonas (A.)», A. 33 F. Brahami, LeTravail des sceptiques, p. 241: «bien que le narrateur du Commentaire philosophique fasse souvent référence à la "loi éternelle" du dictamen de la conscience, on ne peut pas en inférer que les droits de la conscience errante soient fondés sur un absolu rationnel à valeur morale posé antérieurement à la conscience». 34 Voir par exemple OD II, 396b (Commentaire philosophique, éd. Gros, Paris 1992, p. 189): «Chacun sait que l’évidence est une qualité relative; c’est pourquoi nous ne pouvons guère répondre, si ce n’est à l’égard des notions communes, que ce qui nous semble évident le doit paraître aussi à un autre». F. Brahami cite lui-même ce passage (p. 242), mais ne considère pas l’exception posée par Bayle (en italiques ci-dessus). 35 Voir G. Mori, Bayle philosophe, Paris 1999, p. 295 sq.
9
début de son ouvrage et qu’il considère lui-même comme le fondement ultime et indiscutable de sa position36.
Il est vrai, certes, que l’affirmation d’un principe subjectiviste comme celui des droits de la conscience en matière de religion ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences sur le plan moral également, les maximes religieuses étant souvent en contraste avec celles de la morale rationnelle. Or, il est frappant de constater que Bayle fut le premier à s’apercevoir de ce contraste possible entre «conscience» et raison, en le résolvant de la manière la plus claire à la fin de sa vie, lorsqu’il opposera explicitement la conscience «bien instruite», fondée sur la loi éternelle de la raison et typique des athées, et la conscience religieuse, fondée sur l’instinct et sur l’obéissance aveugle aux commandements divins37. Ainsi, loin d’utiliser sa conception de la foi (et de la conscience) pour nier l’universalité des lois morales, Bayle ne cèdera pas un pouce de terrain sur le caractère nécessaire de ces dernières, en préférant plutôt borner le «principe de conscience» à une simple condition nécessaire, mais non suffisante, de la moralité38. Tout cela atteste, encore une fois, la profondeur de son adhésion à la position rationaliste de Grotius, qu’il ne met jamais sérieusement en doute (d’un point de vue strictement philosophique) tout au long de sa biographie intellectuelle.
3. C’est Bayle lui-même qui a donné la meilleure définition de sa
propre position philosophique (c’est-à-dire indépendante de toute doctrine révélée) autour des questions ouvertes par les sceptiques anciens et modernes. Il dit en effet en toutes lettres – et il le répète même deux fois dans l’une de ses dernières répliques à Jaquelot (fin 1706) – qu’il admet que l’évidence est le critère de la vérité, tout en ajoutant en même temps qu’à son avis il existe des degrés différents d’évidence. Ses expressions sont formelles: 1) «je reconnais, avec tous les dogmatiques, que l’évidence est le caractère de la vérité»; 2) «toutes les propositions évidentes ne me paraissent pas également évidentes». Il faut donc distinguer entre le niveau des notions communes (ou des «vérités éternelles» de la mathématique et de la morale) et celui des propositions qui concernent les essences des choses hors de nous. Dans ce sens, comme il le précise aussitôt, une
36 Voir la Préface du Supplément du Commentaire philosophique, OD II, 497b: «C’est une notion de sens commun, et supposée comme un principe dans tous les traités de morale». 37 OD III, 985-987 (Réponse aux questions d’un provincial, pt. III, ch. 29). 38 Sur cette évolution de la pensée de Bayle, voir G. Mori, Bayle philosophe, p. 307-312.
10
proposition telle que «la matière est incapable de penser» est évidente, mais non pas aussi évidente que «deux et deux font quatre»39.
Bayle refuse donc aussi bien un scepticisme absolu et destructif de toute certitude qu’un rationalisme dogmatique qui ferait de la raison humaine un instrument susceptible de nous faire accéder aux essences réelles des choses. Ce refus d’un scepticisme destructif est tout à fait compatible avec le topos de la faiblesse de la raison, sur lequel Bayle revient à toute occasion à l’aide d’un bon nombre de métaphores célèbres et percutantes40. Cette faiblesse ne concerne en effet que l’usage de la raison, en particulier à l’égard d’objets infinis dans l’espace et dans le temps (le problème de la divisibilité de la matière, la définition du temps et de l’éternité), non pas sa possibilité d’atteindre la certitude par rapport à un nombre limité de questions. Cette distinction entre des niveaux différents d’évidence – distinction assurément anti-cartésienne, mais, au fond, tout à fait traditionnelle41 – nous permet également de mieux comprendre l’approche de Bayle aux questions soulevées par les pyrrhoniens anciens et modernes dans les deux articles du Dictionnaire où il a abordé cette question de la manière la plus approfondie: les articles «Pyrrhon» et «Zénon», qui constituent sans doute le point d’orgue de toute sa réflexion sur le scepticisme.
Presque oublié, selon Bayle, depuis le Moyen Age jusqu’au début du XVIIe siècle42, le scepticisme aurait trouvé à l’âge moderne deux alliés de poids: la «nouvelle philosophie» issue de la révolution scientifique, notamment dans sa version cartésienne43, et la religion chrétienne. Ce diagnostic est en l’apparence paradoxal, car Bayle soutient également que le cartésianisme est le plus grand rempart contre le scepticisme44 et que la foi est incompatible avec le doute sceptique45, mais il est fondé sur des considérations dignes d’un examen plus approfondi. Il faut à cette fin 39 OD III, 1070b et 1074a (Réponse aux questions d’un provincial, pt. IV, ch. 24-25)). 40 Il décrit tour à tour la raison humaine comme «une poudre corrosive» (Dict., «Acosta», G), «une véritable Pénélope qui, pendant la nuit, défait la toile qu’elle avait faite le jour» («Bunel», E); «un instrument vague, voltigeant, souple, et qu’on tourne de toutes manières comme une girouette» («Hipparchia», D); «un principe de destruction et non pas d’édification» («Manichéens», D); «une foire où les sectes le plus diamétralement opposées vont faire leur provision d’armes» (OD IV, 23a). 41 Elle est utilisée également par P. de Villemandy, Scepticismus debellatus, p. 237. Voir à cet égard C. Borghero, «Scepticism and Analysis: Villemandy as a Critic of Descartes», à paraître dans The Return of Scepticism…, éd. G. Paganini, cit. 42 Voir Dict., «Pyrrhon», B: «à peine connaissait-on dans nos écoles le nom de Sextus Empiricus; les moyens de l’épochè qu’il a proposés si subtilement n’y étaient pas moins inconnus que la Terre Australe…». 43 Voir Dict., «Pyrrhon», B: «le cartésianisme a mis la dernière main à l’œuvre», etc. 44 Voir les passages cités ci-dessus, note 19. 45 Sur ce dernier paradoxe, voir notre article cité ci-dessus, note 20.
11
établir quels sont – selon l’«abbé pyrrhonien»46 auquel Bayle donne la parole à la remarque B de l’article «Pyrrhon» – les avantages que la «nouvelle philosophie» et le christianisme donnent aux sceptiques, et quel est l’effet théorique et pratique de leurs contributions respectives.
Pour ce qui concerne la philosophie moderne, le mécanisme et la doctrine cartésienne de la connaissance constituent sans aucun doute, aux yeux de Bayle, deux positions qui finissent par favoriser le scepticisme. Bayle met à contribution surtout Simon Foucher, dont la polémique contre Malebranche lui fournit la plupart de ses objections. Selon Foucher, comme selon Bayle, la doctrine cartésienne des idées dresse un écran entre le monde des choses et celui de nos perceptions, en nous empêchant de connaître avec une pleine certitude l’essence des corps (et même d’être assurés de leur existence)47. Cette incertitude est commune à la philosophie moderne dans son ensemble, en tant qu’elle se fonde sur la distinction, nécessaire à la science mécaniste, entre qualités primaires et secondaires (pour utiliser la terminologie qui sera de Locke). Les cartésiens voudraient y échapper par leur idée claire et distincte d’étendue/matière; cependant, d’après Bayle, cette idée est soumise aux mêmes doutes qui frappent les autres idées de notre esprit et en particulier les perceptions sensibles48. De ce point de vue, le scepticisme des modernes lui apparaît comme le prolongement de celui des anciens, qui pouvaient s’appuyer sur le mécanisme atomiste de Démocrite pour démontrer l’impossibilité de connaître les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes49.
Le doute sur la correspondance entre nos «idées» et les choses hors de nous est suffisant pour détruire toute confiance dans la notion de matière aussi bien que dans celle de pensée50. Ce doute, cependant, ne concerne que des propositions dont l’évidence n’est pas comparable à celle des notions communes. Certes, à l’article «Zénon d’Élée» (comme aussi dans une remarque de l’article «Leucippe» consacrée à la question du vide), Bayle
46 En réalité, cette expression n’apparaît pas à l’art. Pyrrhon du Dictionnaire (où l’on parle d’un «abbé philosophe»). Bayle l’utilisera plus tard, voir OD IV, 14b, 16b, etc. 47 Sur la polémique Malebranche-Foucher autour de la «cartesian way of ideas», voir R.A. Watson, The Breakdoxn of Cartesian Metaphysics (Atlantic Highlands, NJ, 1987), dont les jugements sont à revoir à la lumière des analyses d’E. Scribano, «Foucher and the Dilemmas of Representation: A ‘Modern’ Problem?», à paraître dans The Return of Scepticism…, éd. G. Paganini, cit. 48 Voir surtout Dict., «Pyrhon», B. 49 Voir Dict., «Démocrite», in corp.: «c’est encore Démocrite qui a fourni aux Pyrrhoniens tout ce qu’ils ont dit contre le témoignage des sens car […] il soutenait qu’il n’y avait rien de réel que les atomes et le vide, et que tout le reste ne consistait qu’en opinion. C’est ce que les cartésiens disent aujourd’hui touchant les qualités corporelles, la couleur, l’odeur…», etc. 50 Sur cette dernière question, voir par exemple Dict., «Simonide», F: «nous ne savons pas quelle est la nature de l’être dont les modifications sont des pensées», etc.
12
soutient que la crise de la physique cartésienne ne manque pas de donner des armes nouvelles aux tenants de l’«acatalepsie», c’est-à-dire de l’incompréhensibilité de toutes choses: sur la question de la divisibilité de la matière, sur celle de l’existence du vide, sur la définition même du mouvement et du temps, les philosophes se partagent en sectes opposées, chacune prétendant disposer d’une théorie évidente et d’objections insolubles contre les autres. Il s’ensuit qu’un disciple moderne de Zénon pourrait aller jusqu’à démontrer que la matière n’existe pas et que nos sens sont trompeurs51. Cependant, encore une fois, la définition de l’étendue, qui est l’enjeu de ces débats, n’est pas une «notion commune» au sens stricte du terme, et aucun philosophe n’a jamais prétendu la considérer comme telle52. Bayle la présente, il est vrai, comme une «notion très claire» et même comme la plus évidente de toutes, mais l’équivoque est purement verbale (il en va tout de même chez Descartes)53 et cela d’autant plus qu’il montre le désaccord des philosophes à l’égard de cette même notion (car le désaccord atteste nécessairement, aux yeux de Bayle, l’évidence seulement relative d’une proposition ou d’une idée)54.
Au fond, tout l’article «Zénon d’Élée» vise surtout à établir (suivant une ligne de pensée qui réapparaît également aux articles «Leucippe» et «Zénon, phil. épicurien») l’impossibilité de considérer la mathématique comme un instrument fiable en physique: l’idée d’étendue est le «fondement des mathématiques», mais elle s’est avérée inadéquate, selon Bayle, pour la compréhension des phénomènes55. A cet égard, il refuse aussi bien la fondation cartésienne axée sur la véracité divine (car si Dieu trompe les hommes à l’égard des sens, comme Descartes l’avoue, «rien n’empêche qu’il les trompe à l’égard de l’étendue»)56 que la fondation malebranchiste, consistant dans la doctrine de la vision en Dieu (qu’il traite toujours de chimérique)57, alors que la négation lockienne de la
51 Voir Dict., «Zénon d’Élée», remarques G, H et I; «Leucippe», G. 52 Voir par exemple la liste de notions communes dont font état, respectivement, Descartes (dans l’abrégé more geomentrico des Méditations, qui se trouve à la fin des réponses aux Deuxièmes Objections) et Gassendi, Opera, Lugduni 1658, t. I, p. 104. 53 Descartes utilise le terme de «notion» aussi bien pour les «natures simples» (comme le concept d’étendue) que pour les axiomes de la logique et de la métaphysique (voir à cet égard H. Gouhier, La Pensée métaphysique de Descartes, IIIe éd., Paris 1978, p. 275). 54 Voir par exemple Dict., «Pomponace», F: ce qui paraît évident aux cartésiens (en l’occurrence l’immortalité de l’âme) «ne le paraît pas à tant d’autres philosophes…». 55 Dict., «Leucippe», G. 56 Dict., «Pyrrhon», B. Même constat dans Dict., «Rimini», B. 57 Voir les lettres à J. Turner du 15 mars 1697 (inédite: le passage sur Malebranche est cité par E. Labrousse, Pierre Bayle, t. II, 157 sq.) et à Des Maizeaux du 16 oct. 1705 (OD IV, 862a).
13
connaissabilité des substances lui semble constituer moins une solution des difficultés qu’un aveu d’impuissance58.
Bayle oppose ainsi une stricte fin de non recevoir à toute métaphysique substantialiste fondée sur une connaissance adéquate des essences des choses hors de nous. Mais ce n’est pas là ni le scepticisme de Pyrrhon et d’Arcésilas ni l’«acatalepsie» de Zénon – que Bayle se garde bien d’ailleurs de faire sienne, sinon sous la forme d’une argumentation ad hominem. C’est plutôt le «scepticisme» – si l’on veut encore utiliser ce terme – de Mersenne, de Gassendi ou de Simon Foucher59. De même que ces auteurs, Bayle borne le domaine de la certitude à un petit nombre d’affirmations évidentes que personne ne saurait remettre en question: le cogito, les principes de la logique et de la mathématique, les axiomes moraux, toutes les «vérités éternelles» qui ne dépendent que du rapport entre des idées, mais qui concernent néanmoins des «objets»60, par rapport auxquels nos évidences sont nécessairement vraies en tant que réglées par le principe de non-contradiction. Ces notions, tout en ne nous disant rien concernant les choses hors de nous, nous permettent de raisonner, de tirer des conséquences, d’argumenter une pensée morale, de faire progresser notre connaissance hypotétique de la nature fondée sur la comparaison critique des différentes explications possibles des phénomènes61.
En ce sens, on ne peut ne pas remarquer l’absence chez Bayle de toute utilisation sceptique du doute «hyperbolique» de Descartes, sinon dans le cadre d’un questionnement strictement théologique remettant en cause non pas, en général, la possibilité d’une connaissance rationnelle évidente et certaine, mais la compatibilité d’une telle connaissance avec l’existence d’un Dieu tout-puissant et libre62. Bayle renverse exactement, à cet égard, la démarche de Descartes: à son avis, un éventuel athée ne devra pas craindre pour la certitude de ses théorèmes et de ses syllogismes, et, de même, un physicien incroyant n’aura aucune raison de supposer que la matière éternelle veuille changer ses lois63; c’est plutôt le philosophe chrétien qui ne pourra jamais être assuré de ses connaissances, vu qu’il doit 58 Voir Dict., «Zénon d’Élée», I et OD III, 941 sq. 59 Voir par exemple les passages de Foucher sur le «critère de la vérité» cités par Watson, The Breakdown of Cartesian Metaphysics, p. 39. 60 Voir le passage cité ci-dessus, note 26. 61 Voir à cet égard Dict., «Pyrrhon», B: «il nous doit suffire qu’on s’excerce à chercher des hypothèses probables, et à recueillir des expériences…», etc. 62 Voir Dict., «Rimini», B-C. Voir cependant OD IV, 474 sq. (Cours, Métaphysique), où Bayle se borne à résumer la position de Descartes. 63 Voir OD III, 348b (la matière des athées est «destituée de connaissance, et incapable par conséquent d’aucune envie de se soustraire aux lois de l’ordre») et 406ab (les athées «attribuaient à la même nécessité de la nature l’établissement des rapports que l’onvoit entre les choses»; les règles du syllogisme sont «justes et véritables […] en elles-mêmes, et toute entreprise de l’esprit humaine contre leur essence serait vaine et ridicule»).
14
supposer l’existence d’un être infini doué d’un pouvoir absolu et arbitraire sur les principes logiques et sur les lois de la nature64.
4. Ce n’est donc pas la philosophie moderne, issue de la révolution
scientifique, qui détruit la raison humaine et qui conduit à ce «scepticisme complet» dont Popkin à parlé à propos de Bayle. En ce sens, un sceptique moderne – tel l’abbé mis en scène par Bayle lui-même à la Remarque B de l’article «Pyrrhon» – peut tranquillement «renoncer aux avantages que la nouvelle philosophie vient de procurer aux pyrrhoniens»65. Il s’agit en effet d’avantages partiels, qui ne lui permettent pas d’attaquer le critère de la vérité. Cette tâche revient expressément à la religion chrétienne, qui s’avère être la ressource principale du scepticisme à l’âge moderne: «Arcésilas, s’il revenait au monde, et qu’il avait à combattre nos théologiens, serait mille fois plus terrible qu’il ne l’était aux dogmatiques de l’ancienne Grêce: la théologie chrétienne lui fournirait des arguments insolubles»66.
Dans le reste de cette même Remarque B, Bayle montre que les principales «notions communes» de la raison sont en contraste avec les dogmes de la religion chrétienne. Or, la vérité de ces dogmes étant indubitable pour tout chrétien, il s’ensuit que les notions communes qui s’y opposent, dont le principe de non-contradiction, doivent être tenues pour fausses67. Il en va tout de même des principes de la morale, tels que «Il est évident qu’on doit empêcher le mal si on le peut, et qu’on pèche si on le permet lorsqu’on peut l’empêcher». Cette proposition évidente est renversée par la conduite du Dieu chrétien à l’égard des ses créatures: «notre théologie nous montre que cela est faux: elle nous enseigne que Dieu ne fait rien qui ne soit digne de ses perfections, lorsqu’il souffre tous les désordres qui sont au monde, et qu’il lui était facile de prévenir»68. Si ces exemples ne démontrent pas que toute évidence est nécessairement fausse, ils sont cependant suffisants pour montrer que l’évidence, et même l’évidence des notions communes, peut être fausse («puisqu’elle convient à
64 Sur la position de Bayle à l’égard de la question de la liberté de Dieu, voir G. Mori, Bayle philosophe, p. 78-81, 140-149, 232-234. 65 Dict., «Pyrrhon», B. 66 Dict., «Pyrrhon», B. Voir aussi ibid., note 28 (la maxime qui fait de l’évidence le critère de la vérité «était autrefois plus invincible, entre les mains, par exemple, des stoïciens, qu’elle ne l’est depuis qu’on peut soutenir ad hominem aux théologiens, qu’il y a des propositions évidentes qui sont fausses»). 67 Dict., «Pyrrhon», B. Sur le principe de non-contradiction, voir OD III, 767a (note m). 68 Dict., «Pyrrhon», B.
15
des faussetés»)69, ce qui la rend un critère peu fiable, en nous plongeant enfin dans le pyrrhonisme.
Il semblerait, en tout cas, que la raison humaine ait enfin trouvé une limite indépassable et qu’elle soit désormais prête à embrasser la foi, en suivant la démarche typique – selon Popkin – du «scepticisme chrétien». Et pourtant, il n’en est rien. Car Bayle entend d’une manière bien différente par rapport à Popkin la relation entre foi chrétienne et scepticisme. Chez Bayle, ce n’est pas le scepticisme qui conduit à la foi: c’est plutôt l’inverse qui se produit, comme on vient de le voir. Car c’est bien la foi, et en particulier la foi chrétienne, qui conduit nécessairement au scepticisme et au rejet de toute évidence rationnelle. Ainsi, ce que Bayle démontre dans ces pages bien connues n’est pas que l’évidence ne saurait être le caractère de la vérité. Il démontre plutôt que les axiomes principaux de la raison, évidents et incontestablement vrais d’un point de vue philosophique, sont incompatibles avec le christianisme70.
C’est ce qu’atteste également, dans cette même Remarque B, l’analyse que l’on y trouve de la question de l’identité personnelle. Selon Bayle, ce qui fait difficulté n’est pas la possibilité de concevoir évidemment l’unité de l’ego tout au long de son existence (comme ce sera bientôt le cas chez Hume). La crise du concept d’identité personnelle ne dépend en revanche que d’un dogme théologique71: si l’on croit que la conservation des créatures est une création continuée, la certitude de son identité personnelle deviendra douteuse (car «qui vous a dit que ce matin Dieu n’a pas laissé retomber dans le néant l’âme qu’il avait continué de créer jusques alors, depuis le premier moment de votre vie?»)72. Il s’ensuit que ce «scepticisme complet» que Popkin et d’autres attribuent à Bayle n’est pas la conclusion d’un itinéraire intégralement philosophique. Un philosophe dépourvu de préjugés religieux n’aurait aucun besoin de nier les principes moraux sous prétexte qu’ils sont contredits par la théodicée chrétienne, ou de douter de son identité personnelle parce qu’elle entre en conflit avec la toute-puissance divine. L’athéisme, et non pas le scepticisme, constitue en effet le débouché le plus cohérent, selon Bayle, d’une réflexion faite suivant les axiomes de la philosophie sans aucun
69 Dict., «Pyrrhon», B. 70 Ce point a été entrevu également par C.B. Brush, Montaigne and Bayle: Variations on the Theme of Skepticism, The Hague 1966, p. 264-266, qui en donne pourtant une interprétation différente. 71 L’«abbé pyrrhonien» de Bayle le déclare au début de son intervention: «J’argumente sur les principes de notre théologie…», etc. (Dict., «Pyrrhon», B) 72 Dict., «Pyrrhon», B.
16
égard aux dogmes révélés73, alors que l’adhésion à ces derniers implique le scepticisme le plus radical que l’histoire humaine ait connu.
Notons cependant qu’il n’est jamais question chez Bayle d’un «scepticisme chrétien»: cette formule est absente, et pour cause, de ses écrits. Un vrai sceptique, selon Bayle, ne peut être «chrétien» par définition: un sceptique ne peut être que sceptique, sans rien affirmer (ni nier) en matière de religion74. C’est dire que le «scepticisme moderne» issu du christianisme n’est pas, à proprement parler, un scepticisme. Car l’adhésion au christianisme, tout en obligeant le croyant à être radicalement sceptique à l’égard de sa raison, l’oblige en même temps à demeurer dogmatique à l’égard de sa croyance, de sa «conscience», de son éducation, au fond, de ses préjugés. C’est dans ce sens que Bayle peut écrire que l’examen et le doute sont incompatibles avec toute sorte de culte religieux: «la religion ne souffre pas l’esprit académicien: elle veut que l’on affirme, ou que l’on nie»75. Cette alliance inattendue des deux extrêmes, du scepticisme le plus radical (à l’égard de la raison) et du dogmatisme le plus aveugle (à l’égard de tout ce qui touche à la religion), constitue selon Bayle l’essence du fidéisme76 chrétien, qui détruit la raison pour ériger la croyance en maître indiscutable des actions humaines.
5. Bayle ne se borne pas à constater que la religion chrétienne constitue
le caractère différentiel du scepticisme «moderne». Il montre également à ses lecteurs quelles sont les conséquences, au niveau théorique et pratique, de ce scepticisme nouveau et inouï, fondé sur l’adhésion dogmatique à des notions révélées dont les sceptiques de l’Antiquité n’avaient pas eu vent. Ces conséquences, Bayle les a toujours bien vues, à partir de ses premiers écrits.
Comment distinguer les vrais miracles d’avec les faux – se demande-t-il dès 1681 dans les Pensées diverses sur la comète? Cette distinction ne
73 Voir, à cet égard, G. Mori, Bayle philosophe, ch. 1 et 5. 74 Ainsi, selon Bayle, un sceptique est un athée, car, à son avis, pour être athée il suffit de ne pas affirmer l’existence de Dieu (OD III, 932b). Voir aussi l’art. «Rufin» du Dictionnaire, sur Sextus Empiricus: «les pyrrhoniens, sous prétexte de ne combattre que les raisons des dogmatiques à l’égard de l’existence de Dieu, sapaient effectivement le dogme même» (rem. C). 75 Dict., «Chrysippe», G. 76 Nous utilisons, faute de mieux, cette expression anachronique (il n’est pas question de «fidéisme» avant le XIX siècle) pour décrire une conception de la foi de type paulinien – fondée sur la soumission de la raison humaine aux dogmes chrétiens – telle que Bayle la décrit, par exemple, dans l’Éclaircissement sur les pyrrhoniens du Dictionnaire.
17
peut être effectuée, d’après Bayle, que par la raison, qui nous montre que certains prodiges seraient indignes de Dieu et contradictoires avec sa bonté et avec sa sagesse. En revanche, toute référence aux «droits inconnus» de Dieu, donc à un code moral différent et opposé au nôtre, nous conduirait au «plus étrange pyrrhonisme qui fut jamais», car elle détruirait nos idées de bonté et de justice, en nous empêchant de reconnaître la main de Dieu dans le monde77. Une conception paulinienne de la foi, fondée sur l’incompréhensibilité divine, pourrait donc avoir des conséquences dévastatrices pour la religion, car celle-ci suppose nécessairement un rapport cognitif entre l’homme et Dieu, fondé en dernière instance sur la raison. Dans le Commentaire philosophique de 1686, le fidéisme paulinien est décrit comme une doctrine autofalsifiante, qui porte à douter de cette même maxime qui la fonde, c’est-à-dire la maxime de la véracité de Dieu. L’adhésion au captivantes intellectum de saint Paul entraîne ainsi à la fois la destruction de la raison et celle du christianisme: «Adieu toute notre foi […] Ce serait le plus épouvantable chaos, et le pyrrhonisme le plus exécrable qui se puisse imaginer»78.
Ce diagnostic reviendra dans les mêmes termes vingt ans après, dans le dernier écrit de Bayle. Le résultat inévitable de l’anti-rationalisme chrétien, il le décrit en effet sans le moindre détour dans les Entretiens de Maxime et de Thémiste, là où il remarque que son adversaire Jaquelot est contraint, comme tous les autres théologiens chrétiens, à embrasser le principe de la «prééminence de Dieu», en avouant l’incompatibilité de la théologie avec les notions communes de la raison humaine79. Or, de cette manière, il devient impossible de croire en un Dieu comme celui du christianisme: on ne pourra plus dire qu’il n’est pas la cause du mal, qu’il est bon, qu’il est sage, car pour le faire on devrait utiliser cette même raison que l’on veut captiver sous le joug de la foi: «vous croyez sortir par là d’un grand labyrinthe, et vous ne vous apercevez pas que vous tombez dans un autre beaucoup plus affreux…». Voici donc que la destruction du critère de l’évidence comporte «l’introduction du plus affreux pyrrhonisme», dont les suites, au dire de Bayle, sont «épouvantables»80.
Aux textes que nous venons de citer, on peut également ajouter un passage de la Réponse aux questions d’un provincial, où Bayle remarque que la thèse cartésienne de la création des vérités éternelles – qu’il juge nécessaire pour la théologie chrétienne – implique l’écroulement de la 77 Pensées diverses sur la comète, § 225 (éd. Prat, Paris 1911-12, t. II, p. 224 sq.). 78 Commentaire philosophique, pt. I, ch. 1, éd. citée, p. 96-97. 79 OD IV, 72 sq. 80 Ibid. Notons que Bayle renvoie lui-même son lecteur à la rem. B de l’article «Pyrrhon», en mettant ainsi en relation directe ses prises de position sur le scepticisme issu du christianisme (voir OD IV, 72b, note m).
18
raison naturelle, et donc l’impossibilité de garantir l’universalité et la nécessité des axiomes de la logique, de la mathématique et de la morale. On découvre ici que le christianisme mène au scepticisme non seulement de par ses dogmes révélés, mais aussi du point de vue de sa théologie rationnelle, qui devant justifier la liberté absolue de Dieu finit par détruire les notions communes de la raison humaine, en «ouvrant la porte au pyrrhonisme le plus outré»81.
Peut-on dresser un bilan de ces prises de position de Bayle? Vus en perspective, ses jugements autour du scepticisme radical qui constitue l’issue nécessaire du fidéisme (et de la théologie chrétienne en général) présentent une homogénéité frappante, d’un point de vue conceptuel aussi bien que rhétorique et expressif:
1682: le plus étrange pyrrhonisme qui fut jamais 1686: le pyrrhonisme le plus exécrable qui se puisse imaginer 1705: le pyrrhonisme le plus outré 1706: le plus affreux pyrrhonisme Pourquoi ces adjectifs et ces superlatifs? C’est que le scepticisme
fidéiste ouvre le chemin à des croyances inhumaines et horribles: même les augustiniens, dit Bayle, rejetteraient «avec horreur» la plupart de leurs dogmes, si ceux-ci n’étaient pas attestés par la Révélation…82 Le fidéisme implique en effet une mise entre parenthèse des notions morales les plus claires, ce qui le rend susceptible de justifier toute action faite au nom de Dieu: si la «conscience» d’un croyant «lui dictait qu’il faut qu’il vous tue, il vous tuerait sur le champ, car il croirait que le Saint-Esprit le lui commande»83. Le résultat de cela ne peut être que le fanatisme des persécuteurs, qui «foulent aux pieds toutes les lois de la morale» pour établir une soi-disant orthodoxie sur les ruines des croyances minoritaires84. On découvre par là un autre trait distinctif du «scepticisme moderne»: son caractère essentiellement subversif. Au contraire du sceptique classique, qui, tout en étant un «perturbateur du repos publique des philosophes»85, ne fait rien contre la société et se conforme aux mœurs et aux lois de son pays,
81 OD III, 675b (et voir ci-dessus, note 64). 82 OD III, 1073b. 83 OD III, 986a. 84 OD III, 955b. Sur ces questions, voir G. Mori, Bayle philosophe, p. 273-320. Voir aussi Crousaz, Examen du pyrrhonisme, p. 311 sq., sur l’impossibilité de distinguer, chez Bayle, la religion de l’enthousiasme des fanatiques (voir en particulier p. 313: «M. Bayle, ce fidèle rapporteur, ne propose pas là la moindre ouverture pour se tirer de ce labyrinthe; que conclure de cela, si ce n’est qu’il écrivait pour y enfoncer ses lecteurs»?). 85 Dict., «Arcésilas», E.
19
le fidéiste embrasse une foi aveugle, conjuguée au refus de tout contrôle rationnel, qui le pousse à suivre ses dogmes sans avoir aucun égard aux contraintes politiques ou sociales. La croyance religieuse, de plus, n’admet pas toutes les contre-mesures qui empêchent l’adoption d’un doute philosophique intégral. Car le scepticisme qui naît du christianisme s’installe d’emblée dans une dimension transcendante qui exclut toute forme d’examen et de critique : il ne peut pas être arrêté par le sens du ridicule, au contraire du scepticisme ancien, qui admet d’ailleurs les objections, les discussions, la réfutation par l’expérience…86
L’énigme de Bayle réside en ce qu’il ne craindra pas de faire sien, avec un coup de théâtre final anticipé par l’Eclaircissement sur les Pyrrhoniens87, ce scepticisme typiquement moderne, mais à la fois «outré», «affreux», «étrange» et «exécrable» qui est le résultat de l’adhésion à la foi chrétienne, tout en étalant en même temps les conséquences d’un tel choix irrationaliste. Ce choix final et fatal échappe à toute interprétation directe et tranchante, tant il est contraire à sa position constante à l’égard des maximes de la raison. Oscillation, contradiction, schizophrénie88, ou plus simplement hypocrisie? Comment juger un homme qui déclare presque en souriant qu’il faut «envoyer au billon» – comme autant de monnaies défectueuses ou fausses89 – toutes les maximes logiques, métaphysiques et morales de la raison, ces mêmes maximes dont il avait toujours affirmé le caractère nécessaire et absolu? Vis-à-vis de cet énigme insoluble, qui a fait depuis toujours le charme de Bayle, on est presque forcé d’adopter le non liquet – prophétique – de son ami Jacques Basnage: la position personnelle de Bayle à l’égard de la religion, écrit-il en janvier 1707, est «une chose dont on parlera dans toute l’Europe et peut-être dans les siècles à venir avec beaucoup d’incertitude: si M. Bayle a été pyrrhonien pendant sa vie, on le sera sur son chapitre après sa mort»90.
86 Voir par example Dict., «Arcésilas», E. 87 Sur ce texte élusif, que Bayle écrit, il ne faut pas l’oublier, pour répondre à ses censeurs, voir A. McKenna, «L’Éclaircissement sur les pyrrhoniens, 1702», dans Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières, éd. H. Bots, Amsterdam & Maarssen 1998, p. 297-321. 88 Voir R. Whelan, The Anatomy of Superstition, Oxford 1989, p. 197. 89 OD IV, 55a. Selon le Dictionnaire de l’Académie [éd. 1798], le terme de billon «se prend aussi pour: le lieu où l'on porte toutes les monnaies défectueuses». 90 J. Basnage à Noailles, lettre du 3 janvier 1707 (J. Basnage, Corrispondenza da Rotterdam, éd. M. Sylvera, Amsterdam-Maarssen 2000, p. 245).