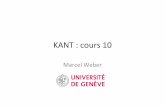Vom Glashaus zum gläsernen Menschen. Transparenz als Ideologie der Moderne
L’albigéisme chez les juristes méridionaux de l’époque moderne
-
Upload
u-clermont1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L’albigéisme chez les juristes méridionaux de l’époque moderne
Les juristes méridionaux, en règle générale, parlentpeu de l’albigéisme. Au fond, cela n’est pas étonnant,vu la faible part que prend l’hérésie albigeoise et sarépression dans la construction juridique de l’inquisi-tion, « la Croisade [faisant] alors passer au secondplan les aspects juridiques de la répression de
l’hérésie »1. Un tour d’horizon des textes législatifs touchant l’inqui-sition fait apercevoir que les principales décrétales sont étrangères àla croisade des albigeois à deux titres. En raison de leur date, aucunene couvrant la période 1208-1229 (Ad abolendam 1184, Licet Helieet Vergentis 1199, Cum dilecti 1205, Qualiter et quando 1206,Excommunicamus 1231, Ille humani generis 1233). Et en raison deleur destination : ces décrétales sont adressées aux autorités deViterbe, de Crémone, d’Aragon, voire d’Arles, mais non à celles deToulouse ou du Languedoc. On peut donc affirmer sans trop d’audaceque la crise albigeoise n’a pas de conséquence directe sur la législa-tion pontificale2.
Parmi les textes juridiques propres à la croisade des albigeois sedistinguent les lettres d’indulgence, du 9 octobre 1208 et du11 novembre 12093, les canons du IVe concile du Latran et ceux des
Cyrille DOUNOTUniversité Toulouse I
L’albigéisme chez les juristes méridionauxde l’époque moderne
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page363
conciles de Toulouse de 1219 et 1229. Les décrets de celui-ci sont lesplus importants. Si les premiers canons reproduisent les règles poséespar le concile d’Avignon de 12094, le canon 9 permet à tout unchacun, ce qui constitue une nouveauté, de rechercher les hérétiquessur des terres ne lui appartenant pas. Nous trouvons là la seuleinfluence, majeure, de l’albigéisme sur le droit canonique. Mais cessources n’ont pas suscité de commentaires juridiques.
C’est ici que survient une limite à notre sujet, car les textescommentés par les juristes sont ceux des recueils officiels, où, làencore, la place de l’albigéisme est maigre. Malgré les « innombrableslettres » consacrées à la croisade albigeoise, bien peu furentremployées dans le Liber extra5. Pourtant, au XVIIe siècle, la connais-sance des textes d’Innocent III fait une avancée remarquable. Lesdeux premiers livres des registres d’Innocent III avaient été publiésà Rome par Sirlet en 1543 ; Bosquet donne, en 1635, l’édition deslivres XIII à XVI, mais sans commentaire, contrairement à ce qui estindiqué en page de titre, et répandu depuis6 ; Baluze publie dix livresen 1682 (I, II, V et X à XVI), et plusieurs annexes. Il faudra attendre1791 pour voir publiés les livres III et V à IX. Mais les juristes ne fontpas leur miel de ces éditions, qu’ils connaissent par ailleurs. Aussi,faut-il étendre la recherche non seulement aux décrétales officielles,lues dans les universités, mais aussi aux textes connexes, qui traitentde l’office du juge, de l’hérésie, de la procédure criminelle.
Nous nous proposons de faire le tour des juristes (canonistes, arrê-tistes, feudistes et criminalistes) qui abordent l’albigéisme, afin de voircomment ils en parlent et à quelle occasion. Tous n’en traitent pas, tants’en faut ! Les juristes du XVIe siècle sont assez silencieux, àcommencer par Alciat et Cujas. Alciat aborde assez longuementl’inquisition, en traitant de l’office du juge (commentaire du titre VI,1, 16, De officio ordinarii). Mais pas une seule fois le nom oul’exemple de l’hérésie albigeoise n’est évoqué au long des95 colonnes7. De même pour ses Commentaria in Decretalium, quiportent entre autres sur le titre X, 1, 29, De officio et potestate judicisdelegati, et qui sont tout aussi muets8. Cujas, certes, ne commente pasle livre 5 des Décrétales de Grégoire IX, consacré à la procédure
364 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page364
pénale. Mais il n’aborde pas plus le sujet dans les Recitationes in libridecretalium (ed. Lyon, 1614), ou dans ses divers commentaires de droitromain, comme l’atteste a silencio le très copieux Index locupletis-simus (Naples, 1727, 672 p.). Or les textes du droit romain furent abon-damment glosés par les canonistes, notamment pour modérer par lamiséricorde certaines peines prévues par les décrétales9.
I. LES CANONISTES
Un des premiers canonistes à effleurer la question est JeanNicolas (ou Nicolai) d’Arles, docteur in utroque. Il publie à Lyon, en1536, un De haereticis aureus tractatus dédié à Barthélémy deChasseneuz, alors président du Parlement de Provence, région enproie aux agissements des vaudois du Lubéron. Il analyse la situationjuridique des hérétiques, et les nombreuses incapacités dont ils sontfrappés. Malgré le contexte de rédaction de l’ouvrage, les noms deshérétiques des siècles passés ne s’y trouvent pas. Ni albigeois, nivaudois, ni cathares. Dans les dix-huit folios de son traité, une seuleallusion voilée, sur la manière de discerner un hérétique. L’auteurconsidère tels « ceux qui s’adorent, montrant une déférence à leurmanière » ou ceux qui reçoivent « consolationem vel communionemab haereticis », pratiques caractéristiques des albigeois10.
Pierre Grégoire de Toulouse est moins taiseux, et sa connaissancede l’hérésie méridionale est assez exacte, puisqu’il ne confond pas lesalbigeois avec les cathares antiques mentionnés au Décret deGratien11. Il aborde l’albigéisme au titre De haereticis de sesPartitiones iuris canonici12. Il définit l’hérétique, les différentesespèces d’hérétiques puis la distinction des peines à opérer entre euxet « leurs hôtes, leurs visiteurs, leurs associés, quand bien même il n’yaurait pas d’adoration, comme disent les hérétiques ». Il explicite alorsce passage tiré de la décrétale Accusatus (VI, 5, 2, 8), au sujet de leursrites : « ce mode d’adoration était une coutume des hérétiques. Ceux
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 365
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page365
qui voulaient les rejoindre devaient le demander, à genoux et devantun hérésiarque, qui imposait alors les mains ou les Évangiles sur leurstêtes. Ainsi fut fait du temps des hérétiques Albigeois, comme je l’aiappris des témoignages solennels issus des auditions et des enquêtesde cette époque. Ceux-ci me furent donnés par le R. P. Esprit Rotier,inquisiteur de la dépravation hérétique à Toulouse, auprès duquel j’aipassé quelques années quand j’étais jeune »13.
Jean de Lacoste est sensiblement plus prolixe. Dans sesSummaria et Commentarii des décrétales, on trouve deux renvois àl’albigéisme. Au sujet des pouvoirs des juges (Quum non ab homine,X, 1, 1, 10), il dépeint la croisade des albigeois, le traité de Meaux-Paris, les soulèvements postérieurs du comte de la Marche et deRoger de Foix et la soumission feinte de Raymond VII auprès deBlanche de Castille. Cette nouvelle guerre prit fin, nous dit-il, par « lessoins et l’empressement de l’évêque Raymond [du Falga] », auteurd’une constitution trouvée dans un manuscrit fourni par GuillaumeCatel14. Ce mandement épiscopal autorise le juge civil d’appréhenderet de connaître des clercs criminels (meurtre, vol, maléfice, évasion),dérogation déjà prévue par le canon 7 du 1er concile de Mâcon (581)15.Lacoste justifie cette exception par les circonstances singulières del’hérésie, et rappelle que les juges civils n’ont pas là un droit propre,mais une délégation épiscopale prévue par la décrétale Ut famae(X, 5, 39, 35), ne crimina remaneant impunita.
Le second renvoi à l’albigéisme intervient au sujet des peinespécuniaires (décrétale Novit, X, 1, 1, 13), que les juges ecclésiastiquesne peuvent infliger aux laïcs. Louis VIII fit exception à ce principe àl’encontre des « contempteurs de l’excommunication »16. Saint Louisfit de même dans le traité de paix, suivi par Philippe III dans la consti-tution Cupientes, « mais ce droit doit être dit local, et limité dans letemps, tant que n’était pas éteinte la dépravation des Albigeois »17.
Innocent de Ciron, éditeur de la Compilatio quinta composée desdécrétales d’Honorius III, évoque deux fois les Albigenses fideiturbatores. En commentant la décrétale Illius Regis pacifici (Va, 1, 17,1), il glose les mots « pacis vel fidei turbatores ». Les violateurs dela paix, nous dit-il, sont différents des perturbateurs de la foi que sont
366 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page366
« les Pétrobrusiens, les Henriciens, les Albigeois et toutes les immon-dices hérétiques de ce genre qui affligèrent aussi la Gascogne »18. Cesroutiers « et hommes de mal pillent, brûlent et détruisent indistinc-tement le sacré et le profane, et violent la paix et la trêve de Dieu ».Cette nécessaire distinction remonte à Alexandre III, « ad vitandamerrorem Autorum, qui communiter confundunt Ruptarios […] cumAlbigensibus & aliis haereticis ».
Ciron se sert de l’albigéisme d’un point de vue pratique, et nonjuridique. Pour ce juriste méridional, pas plus que pour les autres, laCroisade n’est envisagée comme désastreuse ou inconvenante. Bienau contraire, elle apparaît comme le pendant des Croisades organiséesen Terre-Sainte. Ainsi loue-t-il Gautier II évêque d’Autun d’avoir été« bien pieux dans l’expédition Sarrasine et contre les Albigeois »19.Ceci l’amène à présenter le cardinal de Saint-Ange sous un jourfavorable : « envoyé comme légat en France par notre Honoriusaprès la mort de Philippe Auguste, où par sa prudence il conduisitLouis VIII à prendre la croix. Il excommunia le Comte de Toulousefauteur d’hérétiques au synode de Bourges »20.
Ses commentaires juridiques sont moins probants. Les titres Dehaereticis (X, 5, 7) et De accusationibus, inquisitionibus et denun-ciationibus (X, 5, 1) ne contiennent nulle mention de l’albigéisme.Une timide utilisation est faite au titre De sagittariis (X, 5, 15), surl’interdiction des armes trop cruelles. Ciron précise que les papes« n’ont jamais pensé les prohiber contre les infidèles », et ajoute queles condamnations des arbalètes et arquebuses ne valent pas àl’encontre des routiers (Ruptarios), « ou bien de ceux qui ne diffèrentpas d’eux, associés des hérétiques Albigeois »21. S’il semble ici asso-cier ceux qu’il dissociait auparavant, c’est par facilité, reprenantl’étymologie des ruptarii donnée par les Praeclara facinora ComitisMontisfortis.
L’index de ses Paratitla comporte une entrée Albigensium secta,dont le renvoi se révèle assez pauvre, ne concernant que le titre Desumma Trinitate & fide catholica (X, 1, 1). La mention des albigeois,incidente et assez fautive, sert à contextualiser la multiplicationeffroyable des hérésies du temps d’Innocent III : celle de Joachim de
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 367
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page367
Flore « et celle d’Amaury [de Chartres], qui adhéra à la secte desAlbigeois […] dont une des pensées impie fut que le corps du Christn’est pas autrement dans le pain de l’autel que dans toutes les autreschoses, ce qui était une des doctrines des Albigeois comme il ressortdu concile du Latran [IV] »22.
Venons-en à une autre figure intellec-tuelle du Midi, Pierre de Marca. Dans saConcordia sacerdotii et imperii, ilmentionne cinq fois l’albigéisme ou sesconséquences. Ainsi est-ce en tant que« fauteur d’Albigeois » que Raymond VIperdit la possession du comté de Mauguio,qui passa sous la domination du SiègeApostolique23. Marca signale le cas deConrad d’Urach, légat d’Honorius IIIadversus Albigenses24. Au sujet des légats,cette croisade lui sert à défendre son pointde vue gallican. Le seul exemple qu’ildonne de la trop grande fréquence deslégations est celui du cardinal de Saint-Ange, venu en France « pour donner suiteaux demandes de Raymond, dernier comtede Toulouse, dont les biens furent confis-qués à cause de l’hérésie des Albigeois,dont il était fauteur ». Marca loue l’Eglise
gallicane d’avoir contrecarré ce légat au concile de Bourges de 1225,en refusant à « celui qui venait s’occuper des affaires des Albigeoiset du Comte de Toulouse » qu’il s’octroie la réserve apostolique dedeux prébendes25, et se réjouit de ce que le concilium convoqué parle légat se terminât en simple consilium.
En parallèle, l’albigéisme est un prétexte au refus de comparer lajuridiction ecclésiastique de son temps avec celle du début du XIIIe
siècle. Bien qu’à l’époque, elle s’occupât « de rebus saecularibus »26,la raison en était la condamnation par Alexandre III de l’hérésiealbigeoise, mais aussi la déprédation de la Narbonnaise, contre
368 CAHIERS DE FANJEAUX 49
Portrait de Pierre de Marca
(1594-1662),dans Charles Perrault,
Les Hommes illustres quiont paru en Francependant ce siècle,
Paris, 1696.
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page368
laquelle Innocent III et le roi de France ont lutté. Adoptant les vuesétatiques, Marca prétend que le roi a abandonné la « quaestio eccle-siastica » au concile, afin de délibérer sur l’hérésie deRaymond. Comme Simon de Montfort a réduit par les armes cetteprovince sous les auspices du roi, il fallait s’assurer que la conditionpréalable de l’hérésie du comte de Toulouse fût remplie. Ce que seulle concile pouvait. Derrière cette utilisation maladroite de l’albi-géisme, on ne voit poindre qu’une volonté gallicane d’abaisser la juri-diction de l’Église.
Le plus volubile des juristes méridionaux est Antoine Dadined’Auteserre, qui parle de la Croisade dans cinq de ses œuvres, dontses commentaires des Clémentines et des décrétales d’Innocent III.Il aborde la question par le biais des évêques, faisant valoir qu’il leurrevient de s’occuper des hérétiques27. Et d’ajouter : « Mais à cause dela négligence des évêques dans la recherche et la répression deshérétiques, au sujet de laquelle les évêques de Toulouse ont unemauvaise réputation […], le Siège Apostolique a institué des inqui-siteurs de la dépravation hérétique »28.
La décrétale Per inquisitionem (X, 1, 6, 26) lui permet de retracerles événements consécutifs à la mort de Fulcrand, évêque deToulouse, vers 1201, et l’élection de Raymond de Rabastens. Lapreuve de la simonie ayant été apportée par le chancelier Mascaronpar serment fait « aux enquêteurs spécialement délégués par le SiègeApostolique dans la cause des Albigeois »29. La décrétale In causis(X, 1, 6, 30), adressée aux abbés de Grandselve et Belleperche en vuede trouver un candidat idoine au siège épiscopal de Toulouse, luipermet de gloser sur ce mot : « idoine pour expurger l’hérésie, quipullulait dans le diocèse par la négligence malheureuse de sonévêque »30.
Consulté sur l’étendue des moyens de défense accordés à unexcommunié, le pape répond par la décrétale Cum inter (X, 2, 25, 5)que l’appel lui est ouvert, mais non la reconvention. Notre juristerebondit : « d’autant plus que [Savary de Mauléon] est excommuniéen tant que défenseur des hérétiques Albigeois, qu’il protégea par lesarmes »31.
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 369
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page369
Traitant du concile du Latran, commenté à travers la décrétaleExcommunicamus itaque (X, 5, 7, 13), il évoque ce nouveau genre decroisade en « la guerre décrétée par Innocent III contre les hérétiquesAlbigeois, qui avaient pris naissance dans le diocèse de Toulouse. […]parce que les fidèles sont bien plus attirés par une guerre sacrée, ilsprirent la croix à l’encontre des hérétiques, le pontife leur ayant accordéles mêmes privilèges et indulgences qu’aux croisés de Jérusalem »32.
L’Historia Albigensis est invoquée pour montrer le caractèreféodal « de la sainte expédition de la Croisade contre les Albigeois »,dont la durée est celle du ban, soit 40 jours33. Mais elle sert surtout àcamper les personnages, Pierre de Castelnau en premier lieu. Troisfois on voit Auteserre répéter le bien qu’il pense du légat, « envoyécontre les Albigeois »34. Il parle de « l’hérésie des Albigeois, quiinfectait au plus haut point le diocèse de Toulouse. Pour en venir àbout, Innocent III fit la grâce d’envoyer comme légats Pierre deCastelnau et Raoul, moines cisterciens. Ils commencèrent leur léga-tion par Toulouse, en tant que citadelle de l’hérésie, comme l’écritPierre des Vaux de Cernay »35. D’après ses autres ouvrages, il connaîtbien cette œuvre, et les citations en sont nombreuses, quoique loind’embrasser uniquement la cause de l’albigéisme36. Dans ses Annalesd’Aquitaine, il emploie cette source à sept reprises pour donner desrenseignements topographiques (situer Saint-Antonin-Noble-Val37,Agen38 ; donner l’origine du nom d’Albi39 ou de Montauban40 ;évoquer Castres41 ; donner l’étymologie des Alpes pennines42). Lamanière dont il situe Muret, si elle n’est pas surprenante, démontre àl’envi la pensée de cet auteur : « le castrum de Muret, au bord de laGaronne, d’un souvenir éternel où le bienheureux Simon de Montfortse battit contre les Albigeois, et où Pierre, roi d’Aragon, fut tué »43.
Auteserre ne ménage pas les comtes de Toulouse. D’abord ils’insurge contre leur titulature inaccoutumée, prétendant être instituéspar Dieu lui-même44. Ils se dirent « Ducs et Comtes par la grâce deDieu, en tant qu’attributaires immédiats de Dieu, au mépris des Rois,honorant Dieu d’une nouvelle souillure ». Sur les quatre exemples,figure en bonne place celui de Raymond VI, qui dans une chartemanuscrite de 1217 s’intitula « Raimundus Dei gratia Dux Narbonae,
370 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page370
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 371
Buste funéraire d’Antoine Dadine d’Auteserre (1602-1682), Toulouse, église Notre-Dame de Nazareth.
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page371
Comes Tolosae […] »45. Ensuite, Auteserre blâme la volonté bellicistedes comtes, manifestée par leurs clientèles, leurs forteresses et leursgrands domaines bâtis au mépris des droits du roi. Le seul exempledonné ici est celui de Raymond VI, « qui dépensa de grandes sommespour briller par tant de châteaux, qu’il énumérait chaque année, ayantperdu la foi »46. Raymond VI est malmené au sujet de son rapport àl’argent. Auteserre accuse le comte, d’après un rescrit d’Innocent III,d’être « un collecteur très avare de l’impôt [gabelle], comme entémoigne le privilège d’immunité de Beaucaire concédé […] en1217, par lequel la ville fut affranchie de toutes taxes, sauf du péagedu sel »47. L’avarice et la duplicité du comte, « feignant de sesoumettre au jugement de l’Eglise pour éviter de perdre sa domina-tion », sont à nouveau invoquées en commentant la décrétale Superquibusdam (X, 5, 40, 26)48.
En bon juriste, il s’étend sur le jus confiscationis bonorum. Aprèsdes développements consacrés à la part des biens conservée auxenfants et à l’épouse, il expose que de son temps, les biens confisquéspassent entièrement au fisc49. Afin de prouver que ce droit n’est pasnouveau, il invoque un précédent ayant eu lieu sous les Capétiensdirects : « alors que se répandait dans ces contrées la tache de l’hérésiedes Albigeois dans laquelle était tombé Raymond, comte de Toulouse,les biens des condamnés pour hérésie ont passé dans les mains duroi »50. Auteserre scrute l’intention des pontifes qui ont décrété cela« pour mieux s’adjoindre le concours de Philippe Auguste afin devenir à bout de l’hérésie, de sorte que par un vœu égal du Pontife etdu Roi, les possessions du Comte et des siens furent données en proieà qui les occuperaient »51.
Lorsqu’il reprend à son compte l’assimilation bougres-héré-tiques-sodomites, il le fait à partir de la chronique de Matthieu Paris52.Il est intéressant de noter qu’Auteserre opère le glissement de laluxure au péché contre nature, ce que le chroniqueur ne dit pas53. Etil est d’autant plus remarquable qu’il ne dise mot des albigeois, pour-tant concernés par cette comparaison dès l’Historia Albigensis dePierre des Vaux de Cernay54. Auteserre préférant donner un exempleplus tardif (1389), tiré de la chronique de Jean Froissart55.
372 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page372
En définitive, Auteserre connaît l’albigéisme, mais ne s’y arrêtepas. Il tient même des propos équivoques, parlant de cette « impurehérésie des Vaudois, que l’on dit encore Albigeois, tirant leur nom dusynode d’Albi où ils furent condamnés »56.
Jean Doujat ne garde pas de l’albigéisme un souvenir prégnant.Ses œuvres ne renferment que peu de références, le plus souventdescriptives. Dans ses Praenotiones canonicae, il mentionne deux foisl’albigéisme, pour les conciles de Latran III et IV. Il souligne que lecanon 27 du troisième concile du Latran, flétrissait « les Vaudois (ditsaussi Pauvres de Lyon) qui ressemblent à l’hérésie des Albigeois (quisont appelés Cathares ou Patarins) »57. Ici, il répète le canon lui-même.Il détaille ensuite le contenu de ces hérésies, les rapprochant duprotestantisme : « ils se moquaient en outre des indulgences, duPurgatoire, de l’invocation des Saints, toutes choses que les hérétiquesd’aujourd’hui ont pareillement rejetées »58. Ces « hérésies desAlbigeois », au nombre de quatorze, incluent la métempsycose, lacréation du monde par les démons, l’inutilité du baptême des enfants,l’interdiction de l’allaitement, et « à cela ils ajoutaient la détestationde tous les sacrements, et le mépris des Écritures ». En juriste, ilrenvoie le lecteur au canon Sicut ait (X, 5, 7, 8). Quant au quatrièmeconcile du Latran, Doujat indique qu’il y fut « décidé de réprimer leshérétiques, tant par des peines temporelles que spirituelles […].Furent aussi condamnées les hérésies des albigeois, en même tempsqu’était affermie la doctrine de la transsubstantiation »59.
Dans son index chronologique des ordres religieux, à l’entréeDominicani, sive Praedicatores, il exalte « saint Dominique […] quis’empressa de fonder une œuvre remarquable contre les hérétiquesalbigeois »60. Enfin, il fait naître la légation d’Avignon de « lacondamnation de Raymond, Comte de Toulouse, en tant que fauteurdes hérétiques albigeois »61.
Jean Cabassut traite de l’albigéisme dans sa Notitia ecclesiastica.Il y présente les hérétiques protégés par le comte de Toulouse et PierreII d’Aragon, « tous deux infectés de cette peste »62. Ces derniersarment cent mille soldats contre la « sainte armée » lancée parInnocent III, regroupée derrière Simon de Montfort, ses 800 chevaliers
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 373
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page373
et ses 1 000 fantassins. Par l’assistance divine (divino praesidio), labataille de Muret tourne à l’avantage des croisés, et donne lieu à une« victoire mémorable »63. Cabassut revient sur le sujet dans sa présen-tation des conciles. Celui de Toulouse de 1229 est précédé d’une brèveanalyse de la situation du comte de Toulouse, où il reproduit les prin-cipaux canons « pro haeresi profliganda », parfois assortis d’un brefcommentaire. Tel le canon 13, qui durcit la règle générale de lacommunion annuell fixée en 1215: « dans le Toulousain, en vued’éliminer l’hérésie, ce concile prescrivit une triple communionannuelle, pour éviter que les hérétiques ne se cachent »64.
D’autres canonistes ne font qu’exceptionnellement mention del’albigéisme, sans jamais tirer à conséquence, comme FrançoisFlorent qui donne pour équivalents les noms de cathares et d’albi-geois. C’est un simple obiter dictum expliquant que la décrétaleoriginelle est scindée en deux, la première partie (Ad abolendam, X,5, 7, 9) traitant des « nouvelles hérésies qui naquirent à cette époque,surtout en Aquitaine », et les condamnant à l’anathème65.
II. LES ARRÊTISTES
Cependant, il n’y a pas que les canonistes à traiter le sujet, et lesarrêtistes toulousains ne sont pas en reste. Le premier à mentionnerl’albigéisme, Jacques de Puymisson, en fait une utilisation simple-ment rhétorique dans un plaidoyer du 31 mai 160766. Géraud deMaynard, dans ses Notables questions de droit, donne souvent unecoloration historique à l’arrêt rendu par le Parlement. Il exhibel’exemple albigeois dans une affaire d’appel comme d’abus touchantun couvent de dominicaines67. Ou encore dans une réplique concer-nant les duels, en évacuant un grief au nom de la juridiction duconnétable, tirant exemple de la connétablie donnée en récompenseà Amaury de Montfort68. Il arrive aussi à Maynard d’invoquerl’histoire à partir des mémoires du procureur général du roi Pierre de
374 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page374
Beloy. Ainsi au sujet du droit de régale de l’église cathédrale d’Albi,où il juge cette cause « digne de la connaissance de la Cour », envertu d’un usage ininterrompu « depuis unze cens ans »69. Lesmémoires, reproduits in extenso, retracent alors brièvement l’histoirede l’hérésie albigeoise, avec pour objectif de montrer que « la juris-diction haute, moyenne & basse de ladite ville d’Alby, est demeureeacquise à l’Evesque » depuis la donation faite alors par le vicomtede Béziers70.
Beloy, dans une interprétation de l’édit d’Henri IV sur l’union deson ancien patrimoine mouvant au domaine de la Couronne de 1607,invoque l’albigéisme à titre de preuve. L’union des provinces est juri-diquement assise sur divers exemples « l’un desquels & des pluscelebres est celuy du Comté de Tholose, par la paix & reconciliationqui fut faite avec Raimond, dernier Comte, en consideration dumariage de Jeanne sa fille avec M. Alphons de France »71. Ce traitéa pour cause « l’heresie des Albigeois dont parlent Alexandre III &Innocent III en leurs Epistres decretales », notamment la décrétale Incausis (X, 1, 6, 30). Cet argument de la licéité de l’incorporation audomaine de la Couronne vaut a fortiori pour les confiscations. Et saintLouis « acquit aussi par mesme moyen sur le Comté de Fois, laseigneurie de Mirepoix, le Comté de Carcassonne, le Vicomté deBeziers & pays de la basse Marche de Provence, à cause de l’heresiedes Albigeois, de laquelle ledit Comte se trouva entaché »72.
Simon d’Olive, auteur de Questions notables, n’aborde l’albi-géisme qu’une seule fois, dans un chapitre traitant des gouverneursdes villes. Il prend l’exemple de Moissac, ville soumise par Simon deMontfort en 1212. Les sources citées sont les Praeclara Francorumfacinora et l’Histoire des comtes de Toulouse de Catel. D’Olivesouligne que la ville conserva ses privilèges en passant de la sujétiondu comte de Toulouse à celle de Montfort : « elle ne perdit rien de sesavantages par ce changement, au contraire elle reçut de nouvellesgrâces de la bonté de ses nouveaux Maîtres […] Philippe le Bel, noncontent de conserver aux habitants de cette ville leurs anciens privi-lèges, leur octroya de plus cette grâce d’être toujours et immédiate-ment gouvernés par les sénéchaux du pays »73.
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 375
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page375
Toujours dans le monde du Palais, Bernard de La Roche-Flavin(1552-1627) entend l’albigéisme comme une source historique bienlointaine. Dans ses Treze livres des Parlemens de France, il se sert del’épisode albigeois sans y porter une attention flagrante, notammenten traitant des officiers de France. Pour marquer que le connétable estd’abord un comte, il cite « la promesse faite par les Barons de France,au Roy Louys VIII de le servir en la guerre des Albigeois, en Janvier1225, [où] le Connestable est nommé après plusieurs Contes ». Et ilrapporte un arrêt du parlement de Paris de 1274 déboutant Gui deMirepoix « du tiltre de Mareschal de la Foy, par luy pretendu here-ditaire en sa maison, à cause qu’un de ses predecesseurs avoit estéMareschal en l’armée de la Foy de Simon de Montfort, contre lesAlbigeois »74.
La Roche-Flavin use encore de l’exemple albigeois, sans trop defidélité, au sujet des irrégularités des clercs contractées par le port desarmes. Il le fait de seconde main, d’après l’historien italien PaulEmile (1460-1529) en affirmant d’une part que les parlements neconnaissent pas de ce délit, et d’autre part, qu’il faut exclure en « laguerre saincte & où il y va de la Religion ». Le deuxième exemple estplacé « du temps du Pape Eugene III », « où il se trouve que lesFrançois, tant clercs que lays firent la guerre aux Albigeois pres dedouze ans entiers »75.
III. LES FEUDISTES
Une autre utilisation de l’albigéisme, bien plus référencée etsérieuse, est donnée par les feudistes dans l’affaire du franc-alleu. C’estune affaire de résistance fiscale, dans laquelle les juristes méridionauxtentent de s’opposer à l’instauration de la directe universelle76. Elleéclate en 1629, quand Michel de Marillac prétend imposer sur tout leroyaume l’adage « nulle terre sans seigneur », alors que le Midi est régipar le principe opposé « nul seigneur sans titre », l’allodialité étant la
376 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page376
règle. Cette affaire va concerner l’albigéisme à travers les Statuts dePamiers, donnés par Simon de Montfort en 121277. Nombre d’auteursvont prendre part à cette querelle érudite : Galland, Caseneuve,Dominici, Defos, Casevieille, Boutaric, Furgole.
Auguste Galland est le premier à prendre la plume, d’une manièrecaractéristique dont l’albigéisme est exploité. Son mémoire visant àcorroborer le Code Michau est publié en 1629 sous le titre Contre lefranc-Alleu sans tiltre prétendu par quelques provinces au préjudicedu Roy, vite suivi d’une seconde édition au titre rallongé et éloquent :Avec le texte des lois ordonnées au pays d’Albigeois et autres, parSimon, comte de Montfort. Son usage de l’albigéisme est orienté, maisil connaît tant les sources méridionales (Guillaume de Puylaurens,Pierre des Vaux de Cernay) que septentrionales (Guillaume le Breton)pour affirmer que « Raymond, Comte de Tholose, ayant embrassé leparty des Albigeois, ses biens furent mis en proye »78. Il fait reposerson argumentation sur deux points principaux : l’alleu est une conces-sion, un affranchissement royal ; l’alleu est proscrit par la coutumede Paris, appliquée dans le Midi par les Statuts de Pamiers sous le nomde coutumes ou lois générales79. Par une rhétorique habile, il étendconsidérablement la portée de ces statuts à toutes les terres prises parles croisés. Puis, il assimile toutes les terres conquises à des fiefs.Enfin, il rapporte diverses pièces tendant à prouver l’usage continuelde ces coutumes dans les fiefs de tout le Languedoc80. Il conclut sonargumentation par une liste d’« exemples et raisons pour montrerl’usage de la Coutume de Paris en Albigeois », depuis l’an 1212 etpar tout le Languedoc, prend-il soin de préciser81. Malheureusementpour Galland, l’on sait que ces vues historiques sont fantaisistes, cescoutumes ayant été abrogées par Raymond VI dès 1219 comme« noviter inductas », et qu’on ne vit « jamais le roi s’appuyer en droitsur les statuts de Pamiers, qui sont ainsi restés lettre morte »82.
Le deuxième juriste à intervenir dans ce débat est David Defos,contrôleur du domaine de Castres. Il rédige en 1633 un traité sur lecomté de Castres ayant pour objet de montrer au roi les droits dont ilpeut et doit jouir sur ce comté83. Pour ce faire, il puise dans les
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 377
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page377
archives du comté, dont il est aussi le gardien. Aussitôt l’intentionexprimée, il en vient aux faits, et à cette « hérésie des Albigeois » atti-rant « à soy plusieurs Princes & grands Seigneurs »84. Après un longéloge du « grand Simon », de ses origines et de ses conquêtes85, il envient au problème juridique des Statuts : « l’usage de cette coustumea esté comme abrogé, n’ayant esté pratiquée ny observée depuis laconstitution d’icelle ; il semble que par cette desuetude, ou desac-coutumance, telle coustume doive manquer & dechoir de son autho-rité »86. Mais, ajoute-t-il, « par aucun rescript ou édict du Prince il n’ya esté particulièrement dérogé, et s’ensuit que, ledict comté ayant estéuny au domaine en sa première et primitive nature, que ladite cous-tume doit estre restablie, sinon en tous les chefs d’icelle, du moins ence qui regarde les droicts du domaine de Sa Majesté ». Les cinquantepages qui suivent retracent l’histoire de ces terres depuis que le« Languedoc fut honorablement annexé, & depuis réuni à laCouronne »87, et reproduisent des pièces d’archive étayant ses propos.Voilà un méridional opposé au franc-alleu sur le fondement desStatuts de Pamiers, mais dont la manière de constituer le terrier dudomaine royal, toute de prudence et de modération, eut pour résultatd’apaiser les esprits et gagner l’estime de ses contemporains88.
La réédition du traité de Galland, en 1637, pousse les États deLanguedoc à faire rédiger une réplique par Pierre Caseneuve. En1640, il donne au public ses Instructions pour le franc-alleu de laprovince de Languedoc, rééditées et augmentées en 1645. Cettemême année, Marc-Antoine Dominici publie en latin une défense dufranc-alleu89. Ces réponses visent à démontrer la persistance du droitromain dans les pays de droit écrit, comme justification de l’allodia-lité. Dominici ira trop loin dans cette voie, réputant allodiales toutesles terres languedociennes, et son compatriote Auteserre rectifiera sonerreur90. Seul Caseneuve combat sur le terrain des statuts appaméens,y consacrant plusieurs chapitres91. Dans un premier temps, il restreintl’étendue territoriale de cette coutume. Ensuite, il excipe de ce que lespremières coutumes écrites de Paris ne datant que de 1510, elles n’ontpu avoir d’influence sur celles de 1212. Une longue exégèse du textedes Statuts limite leur application aux seuls fiefs, et non aux autres
378 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page378
terres, laissées par les rois sous l’emprise du droit romain : « leComte de Monfort n’a jamais entendu faire des establissemens quiallassent à la ruine d’une liberté appuyée sur tant de Justice »92.Enfin, il réduit le plus possible le nombre des fiefs soumis à cerégime juridique, car « le nombre des Heretiques n’estoit pas sigrand dans ces Pays », et « il y a un grand nombre de Fiefs qui sontpossédés du chef des Seigneurs, dont les Terres ne furent pointconfisquées pour raison de l’Heresie, ny par conséquent inféodées parle Comte de Monfort aux Barons de France & autres »93. Bien loin dedénigrer l’œuvre de Montfort, il le lave même des accusations d’impé-rialisme et de confiscations arbitraires : « il ne faut point doubterque Simon, Comte de Monfort ne fut accusé des desordres qui sepouvoient faire dans la persécution des Heretiques, puisque mesmeon voulut imputer au Pape d’alors l’injustice des confiscations qui sefeirent des biens de certains Gentils-hommes du Pays de Tolose & deCarcassonne »94. Et de citer à l’appui un poème de Peire Vidal ! Sesderniers développements servent à relativiser les pouvoirs du comtede Toulouse de cette époque, Raymond ou Simon, de toute façon bienincapable de changer le droit de toute une région95.
Jean de Cambolas, à peine plus tard, n’aura pas de peine àdéfendre le franc-alleu en démontrant la continuelle soumission duLanguedoc au droit écrit, et la franchise romaine des terres nontenues en fief96. Mais il n’emploie pas l’argument albigeois, secontentant de mentionner « les conventions de paix faites entre le RoyS. Louis & le Comte Raymond »97.
François de Boutaric, professeur de droit français à l’Universitéde Toulouse, participe à la querelle au XVIIIe siècle. Pour réfuterl’existence des droits de lods sur les fiefs nobles, Boutaric combat lecontre-exemple de la coutume de Béziers et de Carcassonne :« l’origine de ces Lods, dans ces deux Sénéchaussées, provenoit deconcessions particulières, que fit Simon, Comte de Montfort, lors dela guerre des Albigeois, de certaines terres dont ils avoit dépoüillé desSeigneurs Hérétiques »98. Et de rappeler l’antique liberté des terresméridionales, restées « dans leur franchise naturelle, & sous la Loigénérale du Languedoc ».
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 379
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page379
Le dernier juriste à prendre part à cette controverse est l’avocattoulousain Furgole. Dans son Traité de la seigneurie féodale univer-selle et du franc-alleu naturel, il établit par de solides arguments leprivilège de sa région. Il prouve l’utilisation du droit romain dans leMidi par une ordonnance de Saint Louis, datée de 1254, « qui ordonnela confiscation des biens de Hérétiques Albigeois qui infectoient cesdeux Provinces [Guyenne et Languedoc], sans préjudice des femmes& des créanciers, conformément au Droit écrit, comme étant la Loide ces Pays »99. Citant Auteserre, il juge la réunion du Languedoc àla Couronne faite « seulement sous la condition que cette Provinceseroit régie par le droit écrit […] & que d’ailleurs on n’a jamaisopposé au Franc-alleu de la Guienne, les Loix de Simon, Comte deMonfort, que les ennemis du Franc-alleu ont opposé à celui duLanguedoc »100.
IV. LES CRIMINALISTES
La partie la plus surprenante de cette étude concerne les crimi-nalistes. Surprenante car ce sont les juristes qui travaillent journelle-ment avec la procédure inquisitoire qui s’y intéressent le moins, et nementionnent jamais le phénomène albigeois. Ce n’est pas pourtant quele Midi manquât de juristes versés dans l’étude du droit pénal. Maisces juristes soit n’en parlent pas en abordant l’inquisition ou l’hérésie,soit ne traitent tout simplement pas de ces sujets.
Antoine d’Espeisses, au XVIIe siècle, a laissé un volumineux Dela pratique criminelle, faisant le pendant de sa Pratique civile, etjamais le mot ou la chose n’apparaissent. Les Conférences de Philippede Bornier, qui sont des commentaires des ordonnances de Louis XIV(dont l’ordonnance criminelle) rapportées aux textes anciens, ne trai-tent pas du tout de notre sujet. Du Rousseaud de Lacombe, auteur d’unTraité des matières criminelles paru en 1740 est tout aussi muet queses contemporains
380 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page380
Jean-Antoine Soulatges, avocat toulousain auteur d’un Traitédes crimes en trois volumes, ne dit mot de l’albigéisme. Ses propossur l’hérésie ne remontent pas plus haut que l’ordonnance de 1560 quifait de ce crime un cas privilégié relevant de la compétence du jugeecclésiastique101. Le perpignanais Jean de Noguer, docteur en droit etpraticien, a laissé au milieu du XVIIIe siècle un Traité des crimessuivant la jurisprudence de la cour du conseil souverain de Roussillonmanuscrit, qui ne mentionne pas l’albigéisme, et qui ne parle del’Inquisition que pour dire qu’elle n’existe plus. Marc-Antoine Rodier,avocat carcassonnais, avait projeté un commentaire de l’ordonnancecriminelle de 1670 qui ne parut jamais102.
CONCLUSION
Les juristes septentrionaux, quoique hors de notre propos, ont uneattitude très proche de celle des méridionaux. Ils se contentent demaigres appréciations souvent fautives, et demeurent tributaires dessources imprimées. Jean Quintin, au milieu du XVIe siècle, a laisséun commentaire du De verborum significatione, titre comportantl’importante décrétale Super quibusdam (X, 5, 40, 26) par laquelleInnocent III expose au comte de Toulouse ce qu’est un hérétiquemanifeste. Ce texte est commenté en termes techniques uniquement,sans mention de l’albigéisme103. Autre exemple avec ÉtiennePasquier, qui se sert de l’épisode cathare pour exalter la figure royale,et comparer Philippe Auguste à Clovis, celui-ci chassant les ariens,celui-là les albigeois104. Il n’y a guère que Louis Thomassin pouraborder souvent l’albigéisme, mais seulement en tant qu’exemplehistorique105.
Les juristes étrangers apportent un éclairage remarquable au trai-tement juridique de l’albigéisme, comme Carena qui édite une consul-tation de Guy Foucois dans son Tractatus de officio sanctissimaeinquisitionis (1669)106. Limborch publie en 1692 une Historia
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 381
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page381
Inquisitionis à laquelle il joint l’édition du Liber SententiarumInquisitionis Tolosanæ. C’est un connaisseur de la question de l’hérésieméridionale, mais lorsqu’il étudie les « peines et pénitences salutairesimposées à ceux qui abjurent » (lib. 4, cap. 32), il mentionne la confis-cation des biens en ne l’illustrant que d’exemples espagnols, puisés chezGonsalvius107. Il ne juge pas expédient de se référer aux confiscationssubies par les fauteurs d’albigéisme, alors qu’il évoque ailleurs les péni-tences infligées aux hérétiques de la région toulousaine, comme lesaumônes, les jeûnes ou les pèlerinages108.
Le bilan que l’on peut dresser de ce panorama aux allures de cata-logue est le suivant : les canonistes et les arrêtistes sont assez peuprolixes, se servant principalement de l’albigéisme comme d’unexemple parmi d’autres ; les criminalistes sont muets, semblantignorer cet épisode ; les feudistes enfin sont les moins diserts. Maisleur intention est avant tout matérielle, puisqu’il s’agit d’éviter depayer un nouvel impôt. Les sources médiévales utilisées par cesjuristes de l’époque moderne sont l’Histoire albigeoise de Pierre desVaux de Cernay et la chronique de Guillaume de Puylaurens. N’ayantque rarement recours aux manuscrits (deux exemples), les juristes sonttrès largement dépendants des éditions imprimées, réciproquementcelles de Camusat en 1615 et de Catel en 1623. C’est la raison pourlaquelle l’albigéisme, ignoré au XVIe siècle, commence à être exploitépar les juristes au milieu du XVIIe siècle.
En définitive, ces juristes languedociens, même ceux qui ontconnu les éditions des lettres d’Innocent III, ne tirent presque aucu-nement profit de l’albigéisme dans leur argumentation. On ne trouveni chauvinisme, ni animosité envers le pouvoir royal. La Croisade desalbigeois n’est pour eux qu’un épiphénomène, plus largement exploitépar les controversistes opposés aux huguenots. Les juristes neconstruisent rien autour de cette mémoire, lui accordant une placeminime, celle d’un exemple de lutte courageuse contre l’hérésie. Etce qui est vrai des juristes cités dans cette étude l’est encore plus deceux, fort nombreux (au moins plus du double) qui n’abordent mêmepas ce thème. Ce tour d’horizon des juristes méridionaux de l’époque
382 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page382
moderne montre à quel point ils sont généralement désintéressés del’albigéisme. Indifférents à une lecture régionaliste, ils sont totalementétrangers au mythe de l’impérialisme capétien sur le Midi109. À ce titre,ils ressemblent fort à leurs collègues, septentrionaux ou allogènes, quine tirent pas de conclusion juridique de cet épisode historique.
Notes
Sigles et abréviations
Sources
– Auteserre, De ducibus : A. Dadine d’Auteserre, De ducibus et comitibus provin-cialibus Galliae, t. 5, Naples, 1777.
– Auteserre, Rerum : A. Dadine d’Auteserre, Rerum Aquitanicarum, Opera omniat. 4-1, Naples, 1777.
– Auteserre, Innocent III : A. Dadine d’Auteserre, Commentarius perpetuus insingulas decretales Innocentii III, Opera omnia, t. 10, Naples, 1780.
– Cabassut, Notitia : J. Cabassut, Notitia ecclesiastica historiarum conciliorum,Lyon, 4e ed., 1725.
– Cambolas, Décisions : J. de Cambolas, Décisions notables sur diverses questionsdu droit jugées par plusieurs arrests de la Cour de Parlement de Tolose,Toulouse, 1659.
– Caseneuve, Franc-alleu : P. Caseneuve, Le Franc-alleu de la province deLanguedoc, establi et defendu, Toulouse, 1645.
– Ciron, Quinta compilatio : I. de Ciron, Quinta compilatio epistolarum decreta-lium Honorii III, Toulouse, 1645.
– Ciron, Paratitla : I. de Ciron, Paratitla in quinque libros decretalium GregoriiIX, Toulouse, 1645.
– Defos, Castres : D. Defos, Traicté du comté de Castres, des seigneurs et comtesd’iceluy, Toulouse, 1633.
– Doujat, Praenotionum : J. Doujat, Praenotionum canonicarum libri quinque,Venise, 1769.
– Furgole, Seigneurie : J.-B. Furgole, Traité de la seigneurie féodale universelleet du franc-alleu naturel, Paris, 1767.
– Galland, Franc-alleu : A. Galland, Du franc-aleu, et origine des droicts seigneu-riaux, Paris, 1637.
– Grégoire, Partitiones : P. Grégoire de Toulouse, Partitiones iuris canonici seupontificii in quinque libros digestae, Lyon, 1594.
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 383
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page383
– Lacoste, Summaria : J. de Lacoste, In Decretales Gregorii IX. PP. Summaria etCommentarii, Paris, 1676.
– La Roche-Flavin, Parlements : B. de La Roche-Flavin, Treze livres des Parlemensde France, Genève, 1621.
– Limborch, Historia : Ph. van Limborch, Historia Inquisitionis, Amsterdam,1692.
– Marca, Concordia : P. de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, seu de liber-tatibus ecclesiae gallicanae libri octo, Paris, 1704.
– Maynard, Questions : G. de Maynard, La troisiesme partie des notables et singu-lieres questions du droict escrit, Paris, 1628.
Travaux
– Bastier, « Franc-alleu » : J. Bastier, « Une résistance fiscale du Languedoc sousLouis XIII : la querelle du franc-alleu », Annales du Midi, 86, 1974, p. 253-273.
– DHJF : P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique desjuristes français (XIIe-XXe s.), Paris, 2007.
– Foreville, « Innocent III » : R. Foreville, « Innocent III et la croisade des albi-geois », Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc, Cahiers de Fanjeaux, 4,Toulouse, 1969, p. 184-217.
– Zerner, « Court moment » : M. Zerner, « Du court moment où l’on appela leshérétiques des “bougres” et quelques déductions », Cahiers de civilisationmédiévale, 32, 1989, p. 305-324.
1. Y. Dossat, Les crises de l’Inquisition toulousaine au XIIIe siècle, Bordeaux, 1959,p. 107.2. Y. Dossat, « La répression de l’hérésie par les évêques », Le Credo, la moraleet l’Inquisition, Cahiers de Fanjeaux 6, Toulouse, 1971, p. 224-225.3. Foreville, « Innocent III », p. 194.4. J. Dahyot-Dolivet, Le ministère public, Rome, 1974, p. 93.5. Foreville, « Innocent III », p. 186.6. L. Delisle, Mémoire sur les actes d’Innocent III, Paris, 1857, p. 8.7. A. Alciat, Opera quae typis nostris hactenus non fuerant excusa, Lyon, chezGryphe, 1548, col. 475-560.8. A. Alciat, Lucubrationes in ius civile et pontificum, t. VI, Bâle, 1571, pars III,col. 1095-1220.9. Il s’agit notamment de faire échec à « l’exhérédation des descendants ortho-doxes », cf. H. Maisonneuve, « Le droit romain dans la doctrine inquisitoriale »,Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, 1965, t. 2,p. 940.10.J. Nicolas Arelatanus, De haereticis aureus tractatus, Lyon, 1536, Notabile V,f. 67 v°.
384 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page384
11. P. Grégoire de Toulouse, De republica libri sex et viginti, Lyon, 1596, lib. 13,cap. 1, § 10, p. 846 : « Tels furent autrefois les Cathares, qui s’appelèrent ainsi enraison de la pureté, se faisant une gloire de leurs mérites », avec citation du canonQuidam autem, au paragraphe Cathari (C. 24, q. 3, c. 41).12. Il est à noter qu’il n’en traite que dans ce titre, et n’en dira mot dans le De accu-sationibus, inquisitionibus et denunciationibus (lib. 5, tit. 9).13. Grégoire, Partitiones, lib. 2, cap. 3, note c, p. 154.14. « Parlementaire très honorable et très érudit », J. de Lacoste, Summaria etCommentarii, Paris, 1676, p. 321. 15. Il prend soin de préciser, dans une logique gallicane, que « id Romani Pontificesnon probarunt […] hoc tamen jure concilii Matisconensis hodie utimur ».16. Lacoste, Summaria, p. 348. Guillaume de Puylaurens fait mention de cetteconstitution, chap. 36.17. Lacoste, Summaria, p. 349.18. Ciron, Quinta compilatio, p. 51, note f.19. Ciron, Quinta compilatio, p. 6, décrétale Ex parte (Va, 1, 1, 5), note c.20. Ciron, Quinta compilatio, p. 118, décrétale Cum causam (Va, 2, 19, 1), note b.21. Ciron, Paratitla, p. 404.22. Ciron, Paratitla, p. 4.23. Marca, Concordia, lib. 2, cap. 3, § III, col. 103.24. Marca, Concordia, lib. 5, cap. 54, § V, col. 801.25. Marca, Concordia, lib. 4, cap. 9, § I, col. 391.26. Marca, Concordia, lib. 4, cap. 16, § VI, col. 446-448.27. A. Dadine d’Auteserre, Commentarii in libros Clementinarum, Opera omniat. 5, Naples, 1777, Clem. 5, 3, Multorum, p. 211.28. Le rôle attribué aux évêques est fondé sur la décrétale Ad abolendam (X, 5, 7,9), la mauvaise réputation des Toulousains sur In causis (X, 1, 6, 30), le mandatspécial confié aux inquisiteurs sur Filii (VI, 5, 2, 3), Super eo (VI, 5, 2, 4) et Nealiqui (VI, 5, 2, 10).29. Auteserre, Innocent III, p. 100. Raymond de Rabastens s’assura des votes deses amis, or la simonie est contractée « non modo interveniente pretio, sed etiamprecibus ».30. Auteserre, Innocent III, p. 109.31. Auteserre, Innocent III, p. 413. La source est encore l’Historia Albigensis.32. Auteserre, Innocent III, p. 805. 33. Auteserre, Innocent III, p. 568. D’ailleurs, il n’assimile pas cette croisade à unvœu, contrairement aux expéditions de Syrie et d’Espagne, commentaire sur Quodsuper his (X, 3, 34, 8), id., p. 627.34. Auteserre, Innocent III, p. 762. Cf. Id., p. 431.35. Auteserre, Innocent III, p. 109.36. Par exemple dans son Asceticon, Opera omnia t. 2, Naples, 1777, lib. 1, cap.12, p. 28, il s’en sert d’exemple à la propagation des chanoines réguliers, citant ceux
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 385
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page385
de Carcassonne ; dans Innocent III, p. 514, il glose sur l’étymologie du mot« stalle ».37. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 6, p. 15.38. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 12, p. 28.39. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 7, p. 15.40. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 8, p. 18.41. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 7, p. 16.42. Auteserre, Rerum, lib. 2, cap. 17, p. 76.43. Auteserre, Rerum, lib. 1, cap. 17, p. 38.44. Auteserre, De ducibus, lib. 3, cap. 5, p. 100.45. Aussi ne dit-il rien de Simon de Montfort, qui s’intitule plus sobrement, dansle contrat de mariage de son fils Guy avec Pétronille de Bigorre en 1216 : « Nos,Simon, Dei providentia Dux Narbonae, Comes Tholosae, etc… ».46. Auteserre, De ducibus, lib. 3, cap. 15, p. 118. Sa seule source est l’historio-graphe de Philippe Auguste, Guillaume le Breton. Ce fait est révélateur d’un étatd’esprit largement partagé, très éloigné d’une vision régionaliste.47. Auteserre, De ducibus, lib. 2, cap. 2, p. 55.48. Auteserre, Innocent III, p. 926.49. Ce qui n’était pas le cas cinquante ans auparavant, d’après le témoignage deGrégoire, Partitiones, Lib. 2, cap. 7, note gg, p. 159 : « j’ai vu à Toulouse que lesinquisiteurs avaient coutume de mettre aux enchères les biens des condamnés, soità la chapelle de l’Inquisition, soit à celle de l’évêque. Cela leur permettait d’obtenirrapidement l’argent et d’être débarrassés des affaires de la foi ». Il oppose cettecoutume à ce qui se pratiquait ailleurs, « même en Espagne », où la traditionnelletripartition Église romaine-évêque-inquisiteur a laissé place à une mainmise du fiscroyal.50. Auteserre, De ducibus, lib. 2, cap. 10, p. 80.51. Auteserre cite alors les canons Excommunicamus (X, 5, 7, 13) et Quumsecundum (VI, 5, 2, 19) et la Philippide de Guillaume le Breton. Par ce droit,Alphonse de Poitiers concéda de nombreux fiefs possédés à titre d’incours, « idestbona caduca ob crimen haeresis ».52. A. Dadine d’Auteserre, De ecclesiasticae jurisdictionis, Opera omnia t. 1,Naples, 1777, p. 108. On trouve encore cette assimilation ailleurs : « Bugeres dictihoc loco haeretici, nostris Bougres, quod laborarent vitio sodomiae, Matth. Paris.ad ann. 1236 », Auteserre, Innocent III, p. 803.53. Zerner, « Court moment », p. 324.54. Zerner, « Court moment », p. 322, n. 96.55. J. Froissart, Chroniques, t. 14, éd. Kervyn de Lettenhove (reprint Biblio Verlag,Osnabrück, 1967), p. 69.56. Auteserre, Innocent III, p. 926.57. Doujat, Praenotionum, lib. II, cap. 6, § 9, p. 99.58. L’édition originale des Praenotionum date de 1688, année de la mort de
386 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page386
Doujat, et aussi de la publication de l’Histoire des variations des églises protes-tantes de Bossuet, avec qui il était lié. Sur ce mouvement, v. R. Darricau, « Del’histoire théologienne à la grande érudition : Bossuet (XVIe-XVIIIe siècle) »,Historiographie du catharisme, CF 14, Toulouse, 1979, p. 85-117.59. Doujat, Praenotionum, lib. II, cap. 6, § 12, p. 100.60. Doujat, Praenotionum, p. 437.61. J. Doujat, Specimen juris ecclesiastici apud Gallos usu recepti, Paris, 1684,praef., cap. XIV, p. 80.62. Cabassut, Notitia, Ecclesiae decimi tertii saeculi historica synopsis, § 7, p. 434.63. L’index locupletissimus contient une longue entrée Albigenses : « CommeSimon et tous les siens avaient reçu les sacrements de la confession et de l’eucha-ristie, précédés de la Croix de Saint Dominique, faisant irruption hors de la ville,ils firent un grand carnage de tous ces ennemis si horribles ».64. Cabassut, Notitia, p. 463.65. Commentaire sur Praeterea (X, 3, 38, 23), dans Fr. Florent, Opera juridica,Tractatus de jure patronatus, Paris, 1679, t. 2, p. 297.66. La bibliothèque tolosane, t. 1er, Notables et singulieres questions du droictescrit, Paris, 1638, Livre onziesme des notables et singulieres questions […] quicontient les Plaidoyez de M. Jacques de Puymisson, Premier plaidoyer, col. 2335.67. Il s’agit là d’une pure digression sans aucun intérêt juridique, cf. id., col. 2011 s.68. Maynard, Questions, col. 2057.69. Maynard, Questions, col. 1792. 70. Maynard, Questions, col. 1795.71. Maynard, Questions, col. 2073.72. Maynard, Questions, col. 2081.73. S. d’Olive, Questions notables du droit, décidées par divers arrests duParlement de Toulouse, Toulouse, 1682, liv. 1er, chap. 42, p. 226.74. La Roche-Flavin, Parlements, lib. 7, cap. 19, p. 521.75.La Roche-Flavin, Parlements, lib. 13, cap. 47, § 12, p. 1025.76.Bastier, « Franc-alleu ».77. P. Ourliac, « Les Statuts de Pamiers », À cheval entre histoire et droit.Hommage à Jean-François Poudret, Lausanne, 1999, p. 75-91.78.Galland, Franc-alleu, p. 137.79.« Et sy je montre que cet usage est demeuré constant mesme en Languedoc &que la coutume de Paris n’a jamais reçu le franc-aleu sans preuve, je me prometsque la proposition faite par le païs de Languedoc sera rejettée », p. 136.80. « Avant passer outre, je suis obligé d’insister sur l’usage continué ez terresappartenant à Simon de Montfort, & faire cognoistre que ces loix n’ont point estédes ombres, ou establissement momentanée, mais que, comme très solides &fermes, elles ont estées reçeues & conservées », p. 141. Il déroule alors sur22 pages sa démonstration, fondée sur des contrats de mariage, des actes de chan-cellerie et des généalogies.
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 387
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page387
81. Galland, Franc-alleu, p. 163-173.82. P. Timbal, Un conflit d’annexion au Moyen Âge. L’application de la coutumede Paris au pays d’Albigeois, Toulouse-Paris, 1950, p. 29. L’auteur parle plus loind’un « échec […] rapidement consommé » (p. 31), tout en évoquant ensuite ledomaine d’application aux « terres de conquêtes ». Il s’agit uniquement des terrestenues à fief, dans les vigueries ou châtellenies d’Albi, de Cabardès, de Montréal,de Minervois, de Gignac, de Béziers, de Carcassonne, de Termenès et de Limoux.83. Defos, Castres, p. 2.84. Defos, Castres, p. 3. Il s’agit d’une « imposture & nouveauté (suivant l’ordi-naire de toutes heresies) » et d’une « mauvaise créance ».85. Sa mort est contée de manière hagiographique : « Voilà comment après tant debeaux exploicts & conquestes, ce grand Simon vray heritier de la vertu du RoyRobert finit sa vie, qu’il avoit employée si utilement & si glorieusement à laprotection & défense de la foy Chrestienne & Catholique, & à la destruction del’heresie. Les mesmes Historiens [P. de Vaux de Cernay, G. de Puylaurens,M. Paris, N. Gilles, J. du Tillet] ont marqué pour un témoignage certain de l’assis-tance du S. Esprit en la prospérité & conduite des armes dudit de Montfort », p. 8.86. Defos, Castres, p. 6.87. Defos, Castres, p. 11.88. Bastier, « Franc-alleu », p. 264.89. M.-A. Dominici, De Praerogativa allodiorum in provinciis, quae jure scriptoreguntur, Narbonensi et Aquitanica historica disquisitio, Paris, 1645.90. L.-A. Bergougnioux, L’esprit de polémique et les querelles savantes vers lemilieu du XVIIe siècle. Marc-Antoine Dominici (1605 ?-1650). Un controversistequercynois ami de Pascal, Paris, 1936, p. 322.91. Il affirme de ses adversaires que « leur argument le plus fort, & sur lequel ilsfondent la principale espérance de nostre défait, est tiré des Loix (ainsi les appel-lent-ils d’ordinaire) ou Coustumes établies par Simon Comte de Monfort, lesquellesobligent une partie de la Province, & quelques seigneurs du Pays, de suivre encertains chefs l’usage de celles du Viscomté de Paris, où ils présupposent qu’il ya de quoy détruire la liberté de nostre Franc-Alleu », Caseneuve, Franc-alleu,p. 187.92. Caseneuve, Franc-alleu, p. 196.93. Caseneuve, Franc-alleu, p. 199.94. Caseneuve, Franc-alleu, p. 201.95. Il attaque ses adversaires sur le terrain de la lèse-majesté, blessée par l’attri-bution aux comtes de prérogatives royales par essence, comme celle de donner laloi, id., p. 202-210.96. Cambolas, Décisions, appendice La province de Languedoc est en possessionde jouir du franc-alleu, p. 725-742.97. Cambolas, Décisions, p. 726.
388 CAHIERS DE FANJEAUX 49
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page388
98. Fr. de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales,Toulouse, 1751, p. 123.99. Furgole, Seigneurie, chap. XI, § 163, p. 215.100. Furgole, Seigneurie, chap. XII, § 170, p. 222-223.101. J.-A. Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, 1752, t. 1, p. 351 s.102. DHJF, p. 673.103. J. Quintin, Iuris Analecta In tit. De verborum significatione, libro V Decretal.Greg. IX, Paris, 1544, fol. 74-77 v°.104. E. Pasquier, Les recherches de la France, Amsterdam, 1723, liv. IX,chap. VIII, col. 901-902.105. Huit mentions dans son Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, I, 1, 45,16 ; I, 1, 46, I, 2, 10, 11 ; I, 2, 87, 5 ; II, 1, 100, 6 ; III, 1, 31, 4 ; III, 1, 43, 5 ; III,3, 46, 16.106. P. Ourliac, « La société languedocienne au XIIIe siècle et le droit romain »,Le Credo, la morale et l’Inquisition, CF 6, Toulouse, 1971, p. 212.107. Limborch, Historia, p. 333-334. Il est d’ailleurs significatif que son Syllabusauctorum ne comporte aucun juriste français.108. Limborch, Historia, p. 336.109. Cf. M.-B. Bruguière, « Un mythe historique : “l’impérialisme capétien” dansle Midi aux XIIe et XIIIe siècles », Annales du Midi, 97, 1985, p. 245-267.
L’ALBIGÉISME CHEZ LES JURISTES MÉRIDIONAUX… 389
03 3° partie 325-444:- 18/03/14 15:36 Page389






























![[2012] « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne »](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cac175a0be56b6e0e50f9/2012-la-cour-de-france-fabrique-de-normes-vestimentaires-a-lepoque-moderne.jpg)