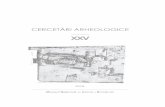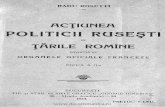La symbolique de larchitecture romane et gothique
Transcript of La symbolique de larchitecture romane et gothique
La symbolique de l’architecture des églises comme expression de foi?
1) Introduction
2) Le romanA partir du XIe siècle, la société évolue et le
christianisme gagne en influence. Le nombre de fidèlesaugmente et les villes commencent à s’articuler autourd’églises et de monastères. Les villes doivent s’agencerdifféremment pour supporter la démographie galopante toutcomme le clergé doit agrandir l’espace pour accueillir lesfidèles dans les églises.
L’appellation « art roman » date du 18e siècle,utilisée pour la première fois par Charles de Gerville enréférence à l’expression « more romano », « dans lacoutume romaine ». Auparavant, ce style était tombé dansl’oubli, comme dédaigné, mais on recommence à s’yintéresser et restaurer ces églises qui n’intéressaientplus personne depuis 5 siècles.
Au niveau de la datation, on notera une énergieconstructrice considérable entre la fin du XI et le débutdu XIIe siècle. En effet, un grand nombre d’entre elles,voire la majorité ont été construites ou entamées pendantcette période.
Ce style a une étendue géographique impressionnantedans toute l’Europe jusque dans ses pays les plus éloignéspour l’époque comme la Pologne, l’Ecosse ou le Portugal.Cette étendue est due notamment aux pèlerinages fréquentsà l’époque et grâce à ces déplacements de foules, denombreux échanges culturels, d’idées et de progrèstechniques. Cette particularité rend une définitionprécise assez difficile tant au niveau de la chronologiequ’au niveau purement architectural, d’autant plus que laconstruction d’une église prenait souvent plus d’un siècleà cette époque. En plus des pèlerinages, le jeu desconquêtes a beaucoup joué dans la répartitionterritoriale de ce style. Par exemple, la cathédrale de
Durham en Angleterre a été construite sous l’influence deGuillaume le Conquérant, qui a ainsi importé le styleroman de Normandie en Angleterre.
- influences des styles antérieurs
On ne peut pas considérer les églises romanes sans avoirun aperçu des influences des styles antérieurs.D’ailleurs, la plupart des églises romanes ont étéconstruites sur les bases ou sur les ruines d’édificescarolingiens ou mérovingiens.
Carolingien : On peut voir dans le style roman unerestructuration de la façade ouest des églises de stylecarolingien. Cette particularité, aussi appelé« Westwerk »i, est la construction d’une façadeoccidentale avec deux tours et une structure centralesaillante à plusieurs étages. A l’époque carolingienne,cette façade ouest était fréquemment une tribune delaquelle l’empereur pouvait parler à la foule. Pendantcette ère, l’église a quelque peu perdu sa destinationliturgique. Il faudra attendre le roman pour que cetteutilisation de l’église comme légitimation du pouvoirdisparaisse en transformant ce balcon en tour monumentaleabritant un clocher. Ce modèle connaitra des variantestrès intéressantes principalement dans la région de laSaxe : on verra dans ces églises un équilibre subtil entreun bâtiment imposant et simplifié à la fois (*st Micheld’Hildesheim et église de Trèves).
Il y a aussi dans le roman une recherche d’équilibre etd’harmonie des proportions sûrement inspirées du systèmeconstructif romain. De plus, bon nombre d’églises romanesétaient construites en briques consolidées avec un mortierde chaux, cela marque un retour vers les techniques del’antiquité qui ont été comme oubliées depuis la chute del’empire romain. A l’instar des temples romains, leséglises romanes étaient presque entièrement peintes. Lessculptures et le westwerk extérieur étaient recouvertes de
peintures chatoyantes, tandis que l’intérieur étaithabillé de nombreuses fresques. Avec les siècles cespeintures se sont évidemment effacées, donnant à cesédifices un aspect nettement plus froid et austère.
- La technique
Pour aborder cette partie, il est préférable de connaîtrequelques notions du vocabulaire architectural :
Coupe d’une arche
Plan au sol
1. clef d'arc2. claveau3. sommier4. naissance de
l'arc ou ligne d'imposte
5. imposte6. pied-droit7. intrados8. flèche
La principale caractéristique du roman au point de vuetechnique est le plan au sol : jusqu’alors on voyaitprincipalement des plans rectangulaires, octogonaux oucirculaire. Le roman a apporté le plan en croix, nettementplus pragmatique tant pour l’accueil des fidèles que pourles rituels liturgiques. A cette période, seule la nefétait consacrée aux laïcs. Dans nos régions, les églisesromanes ont souvent la particularité d’avoir la travée etles transepts de même largeur. Cela donne une croiséecarrée. Une autre particularité de nos régions est que lanef est singulièrement plus haute que les transepts, cequi permet l’ouverture de fenêtres illuminant la croiséeet le chœur.
La croisée est d’habitude surélevée afin que l’assembléedes fidèles puisse mieux voir le clergé pendant lesoffices et de manière à ce que leur voix porte jusqu’aufond de la nef. De plus, l’élévation de la croiséefacilite la construction de la crypte qui se situe presquetoujours en dessous. Ces cryptes, surtout en Belgique, ontune retombée très originale qui donne une impression delégèreté au point qu’on a l’impression que les colonnessont suspendues à la voûte et non que la voûte soitsupportée par les colonnes.
On ne peut pas caractériser l’architecture romane par lasimple utilisation d’arcs en plein cintre pour deuxraison. La première est que cette définition seraiterronée. En effet quelques exemples d’arcs brisés sontprésents dans ce courant (l’arc brisé n’est donc pas nonplus la caractéristique du gothique). La deuxième est quede nombreuses églises romanes ont un plafond plat, et nonvoûté. Ce sont alors des linteaux qui aident à supporterle poids du toit, mais le répartissent alors de manièreégale sur toute la longueur du mur porteur. Cetterépartition uniforme a le désavantage de nécessiter un murlarge, lourd et ne permettant pas de grandes ouvertures.En fait, une technique d’élévation du mur courante àl’époque était de construire deux murs côte à côte.L’observateur attentif remarquera que dans de nombreuseséglises d’apparence romane, les bas-côtés sont voûtés enarcs brisés de style gothique, mais ce sont souvent desrestaurations datant du XVe ou du XVIe siècle
- La symbolique
A l’origine, les églises romanes étaient fréquemmentbâties sur des carrefours. Le carrefour est le lieu,l’étape du voyage où s’impose un moment de repos, unepause. Comme si un moment de réflexion, de recueillementsacré était nécessaire avant de poursuivre son chemin. Or,l’église veut être le support de la pensée du chrétien.C’est pour cela que la symbolique qui l’habite estextrêmement importante parce qu’elle va guider le croyantdans son cheminement. A partir de là, on peut affirmer quel’église est l’expression de la foi chrétienne, ou aumoins celle de son bâtisseur et/ou de son mécène.
Une des majeures caractéristiques des églises dans le lienentre la technique et la symbolique est le jeu deslumières. Dans le cas du roman, cette particularités’exprime sous la forme suivante : le système constructifne permet pas l’ouverture de grandes fenêtres le long dela nef. Mais en surélevant cette dernière par rapport aux
transepts, on sait obtenir une sorte de halo autour de lacroisée et du cœur. En outre, on remarque aussi souventque la plupart des lignes de fuite sont orientées verscette croisée. Cette convergence vers un rayonnementprovoque, chez le spectateur qui se déplace vers le centrede l’église, une impression d’écrasement qui se rapprochede l’oppression. Ensuite, lorsqu’il arrive à hauteur de lacroisée, il est illuminé comme par une « lumière divine ».De ce point, les perspectives du spectateur s’élargissentaux transepts. Il se produit alors un renversement totaldes perspectives. Les lignes de fuite ont disparu. Toutesles lignes architecturales de l’église convergent surl’homme qui se trouve au milieu de l’église. On peut voirici une métaphore de la conversion au christianisme. Selonmoi, c’est là l’avancée du roman dans l’histoire del’architecture.
Jusqu’à présent, je n’ai parlé dans mon exposé que de lapartie architecturale de l’art roman, mais pour biencomprendre la symbolique de ce courant, en vue d’eninterpréter l’expression de foi, je ne pouvais manquer dem’arrêter sur ses sculptures et ses fresques. Avantd’aborder cette partie, il est nécessaire de savoir queles artistes romans avaient pour but de nous représentercomme dans un miroir, ou plutôt représenter ce qui sepasse l’intérieur de l’homme. C’est pour cela qu’il fautinterpréter à peu près toutes les sculptures et lespeintures romanes de manière métaphorique.
Les bâtisseurs et les artistes romans étaient très friandsde symboles (sym-bole). Ce mot vient du grec et signifie« ce qui relie », « ce qui unit ». On peut interprétercette attitude comme une volonté de se réconcilier avecDieu, de retrouver son identité spirituelle après l’avoirperdue par la chute du paradis. Le mot symbole est àmettre en opposition au diable (dia-bole) qui vient aussidu grec et signifie « ce qui divise ».
ii
Au niveau de la sculpture, le style roman apporte unrenouveau après plusieurs siècles d’immobilité durantlesquels la sculpture avait un peu perdu sa raison d’être.La sculpture romane avait fréquemment un rôle éducatif. Onpeut dire qu’elle était la bande dessinée de l’époque quijouait le rôle de sermon figuratif. Comme la majorité descroyants ne savaient pas lire à cette époque, lessculpteurs utilisaient leur art comme média pourtransmettre quantité d’informations à tous les types despectateurs. Les tympans des portes et les chapiteauxiii
des colonnes d’une église romane regorgent de haut-relief.Cette sculpture reflète en outre la manière de concevoirDieu et le Christ. Un des exemples remarquables de cetteexpression de foi est la sculpture du Christ dans lamandorleiv avec ses quatre évangélistes, dans l’égliseSaint-Sernin de Toulouse. Le sculpteur a réussi à donnerune expression profondément humaine et concrète à sasculpture grâce à l’effet de relief de la draperie et dubras bénissant. Sur ce bas-relief, Jésus est représentéentouré des quatre symboles religieux des apôtres : letétramorphev.
Dans le roman, le Jésus est souvent représenté comme leChrist en Majesté. Cette habitude conjugue la traditionromaine de l'iconographie impériale montrant les empereursdebout, la main droite levée, et la vision de Jean dansl'Apocalypse : le personnage assis sur le trône entourédes Quatre Vivants sera interprété par la traditionchrétienne comme le Christ entouré par les quatreévangélistes figurés par les animaux-symboles (le
tétramorphe). Le Christ est dans la position de celui quia autorité, celui qui règne. Encore une fois, on constatela forte influence romaine dans le roman. Cette positiond’autorité de Jésus reflète bien l’image que les croyantsavaient de Dieu à cette époque : une divinité qui écrasel’homme……
vi
On remarque aussi dans la sculpture romane un nombreimpressionnant de créatures et monstres fantastiquesdignes de légendes. Selon les croyances de l’époque, ellespeuplaient les régions inexplorées. Dans ce bestiairemonstrueux, on observe souvent des centaures ou d’autrescréatures mi-homme mi-animal. Ces représentations ont pourbut d’illustrer le combat intérieur entre notre natureanimale et notre nature humaine. De même, lesreprésentations de bêtes monstrueuses nous montrent lesdésirs sombres que nous avons à maitriser en nous-même. Ouencore, on observe de nombreuses sculptures sur deschapiteaux d’hommes qui portent des animaux comme desbrebis ou des veaux sur leurs dos. Ils peuvent représenterd’une part le berger soucieux de son troupeau, métaphoredu clergé qui veille sur les chrétiens. D’autre part, ilpeut représenter l’être humain qui doit porter sa partieanimale et vivre avec celle-ci et la domestiquer. Encontrôlant cette partie bestiale en nous, on se rendmaître des forces destructrices souvent représentées sousla forme d’un carnassier.
A l’époque du roman, le christianisme prônait une vie plusspirituelle au l’âme prévalait sur le corps. En effet onpeut interpréter dans de nombreuses sculptures que
l’enveloppe charnelle est responsable de nombreux péchés.Par exemple, on observe de nombreux hommes sculptés dontla langue se divise en deux ou en de multiplesramifications. La langue se référant à la parole, cessculptures dénoncent ceux qui ont un double langage, ouencore ceux qui se perdent dans des paroles inutiles quiéloignent de la parole de Dieu.
Suivant les superstitions de l’époque, l’apocalypse prévuepar Jean aurait lieu à l’an mille. Ces croyances étaientrenforcées par l’instabilité des régimes en place àl’époque. En effet, c’est à la période du roman que denombreuses guerres se sont passées. Cet état d’esprits’est traduit dans les églises à travers la sculpture. Onvoit de nombreuses représentations de l’apocalypse et dela Jérusalem Céleste. Je prends ici en exemple un tympan
représentant le jugement dernier. Au centre, le Christ enMajesté Christ accueillant les élus d’un mouvement du brasdroit levé. Le mouvement de la main gauche abaissée, pourdésigner l’enfer aux réprouvés. Le Christ trône dans unemandorle entouré de ses anges. Son visage allongé exprimela gravité du Souverain-Juge. En bas à gauche, le paradisreprésenté sous la forme de la Jérusalem Céleste où siègeAbraham tenant dans ses bras deux enfants, les saintsInnocents. Il est encadré par des personnages groupés parpaire sous chaque arcade. Ici règne l’ordre et la sérénitédu paradis. En bas à gauche, sont représentés l’enfer etles sept péchés capitaux. On peut y voir Tout un peuplehideux de démons, présidé par Satan, s’emploie à châtierles auteurs des péchés capitaux.
3) Le gothiqueL’architecture gothique apparaît au XIIe siècle etperdurera même jusqu’au XXe siècle sous des formesdérivées comme le néo-gothique. Ce style a donc existé enmême temps que le roman, on ne peut dès lors pas inscrirel’un comme successeur de l’autre. Le style étaitoriginellement appelé « art français », ou « francigenumopus », en raison de sa région d’origine, la France. Cestyle a acquis le nom qu’on lui connait durant larenaissance, ce sont les italiens de cette époque qui ontcomparé les courbures des arcs brisés aux bois utilisésdans les huttes primitives des forêts germaniques. Laprincipale raison de ce déni est que les artistes de larenaissance voulaient retourner aux canons gréco-romainsviii alors que le gothique marque une rupture parrapport à ces canons. Les hommes de la renaissancen’avaient peut-être pas compris qu’une rupture nesignifiait pas forcément un retour en arrière mais uneévolution vers quelque chose de différent.
Au point de vue géographique, la première église gothiqueest construite à Saint Denis en France. Ensuite, le style
se répand rapidement hors de sa région d'origine, ens'adaptant de manière plus ou moins prononcée àl'architecture locale. En effet, ce style, comme beaucoupd’autres, varie selon les régions. Une phrase illustrebien l’étendue de ce style : on dit qu’à cette époque,« l’Europe tout entière est recouverte d’un blanc manteaud’église ». Encore aujourd'hui, des édifices gothiques sedressent aux quatre coins de l'Europe, du Portugal, auRoyaume-Uni, en passant par la Suède, ou l’Italie. Commepour le roman, cette répartition est largement due auxpèlerinages.
-La technique
La technique gothique a l’avantage d’être apparent et doncfacilement observable. Comme dans tous les bâtiments, lebut principal est de soutenir le poids du toit au moyen demurs ou de piliers. Le système trouvé par les bâtisseursgothiques est très ingénieux : on réparti le poids sur lespiliers et non sur les murs, et ce au moyen d’arcsdiagonaux et d’une croisée d’ogive.
Sur ce schéma, la croisée d’ogive est l’intersection desdeux lignes oranges. Comme on eut le constater, les toutes
lignes de poussée convergent vers la colonne. Ceci est unedes caractéristiques majeures du style et se retrouve danstoutes les églises du courant. Grâce à cette techniquehabile, les bâtisseurs peuvent élever des murs très finset ouvrir de larges baies sur les murs, que des verriersgarniront alors de splendides vitraux. C’est grâce à celaque les églises gothiques sont si lumineuses comparées auxromanes. Mais la simple concentration des forces dans lespiliers ne suffit pas à équilibrer l’ensemble. C’estpourquoi les églises gothiques sont flanquées d’arcs-boutants. Ceux-ci ont pour fonction de neutraliser laforce qui pousse la colonne sur le côté.
Sans ces renforts, les murs de ces églises sefissureraient. Les contreforts massifs et sans ouverturesdu système roman se sont donc traduits dans le gothiquepar des arcs-boutants aériens. Certains édifices de cecourant sont élevées tellement haut qu’elles nécessitentdeux rangées d’arcs boutants, ce qui donne des églisesavec quatre bas-côtés, aussi appelées églises à 5 nefs.Ces arcs-boutants étaient souvent surmontés de pinaclesix
ayant deux fonctions majeures. La première, est d’alourdirle contrefort et lui donner de la sorte une poussée versle bas supplémentaire pour être moins affectée par lapoussée perpendiculaire. La deuxième fonction estornementale, en effet le pinacle ajoute de la hauteur etde la verticalité à l’ensemble. Grâce à toutes ces
techniques, les bâtisseurs gothiques sont parvenus àatteindre des cathédrales de hauteur vertigineuse commepar exemple, la cathédrale Saint Pierre de Beauvais dontle plafond de la nef se situe à 48.5 mètres au-dessus dusol !
On notera aussi que c’est à l’époque du gothique que leverre commence à être utilisé fréquemment, bien cettetechnique soit connue en occident depuis plus de cinqsiècles. Les nouvelles cathédrales sont des lieuxprivilégiés pour l’épanouissement de cet art grâce auxlarges ouvertures de leurs murs. Les vitraux deviennent unespace supplémentaire pour faire passer les messagessymboliques et illuminent l’église dans une atmosphèretotalement nouvelle
Outre l’utilisation intensive du verre, le gothique faitaussi beaucoup appel au fer. Comme le montre cette coupede la cathédrale d’Amiens, l’arc du bas-côté exerce unepoussée sur le pilier principal qui endommage l’ensemblede la structure. C’est le bâtisseur français PierreTarisel qui trouva la solution pour la cas de lacathédrale d’Amiens. Au moyen de fortes barres de fer auniveau du triforiumx et tenues entre elles par desclavettesxi, il parvient à stabiliser la poussée néfaste. Al’occasion de restaurations de la cathédrale de Beauvais
on a même découvert dans les arcs un renfort en fer ayantpour but de rigidifier le plafond. C’est d’ailleurs detechnique qu’est né le gothique dit rayonnant. Grâce àl’utilisation intensive de renforts en fer pour lastructure en pierre (technique aussi appelée « pierrearmée ») le bâtisseur rend les murs presque immatériels,ce qui laisse un place encore plus grande pour les largesbaies vitrées.
Grâce à toutes ces explications, on se rend compte que leschefs-d’œuvre gothiques sont réalisés grâce à un équilibretrouvé entre les poussées et que c’est là le véritablegénie des bâtisseurs. Si un des éléments est négligé,c’est tout l’édifice qui s’en trouve affaibli etendommagé.
La symbolique
Pour bien comprendre cette partie, il faut avoir àl’esprit que la plupart des techniques du gothique étaientdéjà connues à l’époque du roman. Ceci nous indique que lechangement de style est autant dû à une évolution de lapensée qu’à une évolution de la technique. Du point de vuehistorique, cela nous pousse à réfléchir à la dialectiqueentre la philosophie et la science. En outre, le gothiques’inscrit clairement dans la suite du roman, tant auniveau chronologique qu’au niveau de sa pensée. Mais suitene veut pas dire continuité, c’est-à-dire qu’on ne peutenvisager l’un sans l’autre malgré qu’ils sontrelativement opposés.
Ce qui frappe le plus entre les deux styles, c’est ladifférence des lumières. Pour bien illustrer l’importancede la lumière et la manière dont elle est perçue dans cestyle, on peut lire la phrase de l’abbé Suger,entrepreneur de la première église gothique à Saint-
Denis : «Dieu est lumière et c'est dans Sa lumière quel'homme trouve la vérité ». D’ailleurs, Le terme français« Dieu » vient du latin deus, lui-même issu de la racineindo-européenne deiwos qui signifie «Lumière du ciel ou dujour». Chez le roman, l’église est plus sombre et metl’Homme à genoux devant Dieu, tandis que l’église gothiqueresplendit de lumière et invite l’Homme à se relever.C’est grâce à toutes les techniques décrites précédemmentque le bâtisseur peut créer un jeu de lumières qui poussel’homme vers le haut, vers le ciel, vers le divin. Avec legothique, il y a un mouvement ascendant du temporel versle spirituel qui s’exprime par la volonté de hauteur, delégèreté des structures gothiques. Ceci qui représente uneconversion énorme par rapport l’homme du roman qui a unevision métaphysique du monde, c'est-à-dire à un mouvementdescendant du Ciel vers la Terre, le Principe céleste verssa manifestation terrestre. Ce mouvement du spirituel versle temporel se traduit par une descente de la légèretécéleste jusqu'à la pesanteur terrestre. D'où, la structurerelativement massive des édifices roman. L’avènement del’architecture gothique est donc une véritable révolutionintellectuelle qui affecte tout le monde chrétien del’époque.
On remarquera d’ailleurs que tout dans le gothique tented’élever l’Homme vers Dieu. C’est là qu’entre en jeu larecherche de verticalité du batisseur. Si les lignes defuites étaient dirigées vers le chœur dans une égliseromane, elles sont dirigées vers le haut dans une églisegothique. Cet effet est renforcé, entre autres, par lespinacles qui semblent indiquer le ciel en une flèche ouencore par les tours quand elles sont pointues. Avectoutes ces tentatives de l’homme de rejoindre latranscendance, il est inévitable de penser à une influenceplatonicienne dans ce style. Au cours de ce qu’on appelle
le siècle des cathédrales, c’est-à-dire le XIIIe siècle,l’homme aspire à cette métaphysique et tente d’en fairel’expérience à travers la construction de cathédrales quise veulent toujours plus parfaites. Concrètement, on n’aqu’à regarder l’obsession du bâtisseur à toujours vouloirplus évider les murs, à toujours vouloir élever sacathédrale plus haut,etc…
On remarque de fortes allusions à la nature dans leséglises gothiques. Par exemple, bon nombres des édificesde cette période ont des colonnes aux chapiteauxCorinthiensxii ou compositesxiii. Cet aspect est sensérappeler la végétation d’un jardin et plusparticulièrement du jardin d’Eden. La pensée gothiqueassocie en effet la nature au sacré car elle voit en ellela perfection de la création de Dieu. En insérant desmotifs naturels, le sculpteur gothique veut faire del’église une image de la Jérusalem céleste. Autrefois dansle roman, on représentait le paradis tel quel dans lasculpture, maintenant c’est l’édifice tout entier qui enest la représentation. C’est ici encore une volontéd’élever l’homme à Dieu en lui montr ant une image de latranscendance.
Le visiteur attentif remarquera parfois, dans certaineséglises gothiques comme Amiens ou Chartres, le sol estorné d’un labyrinthe. Celui-ci est censé représenter lecheminement intérieur du croyant qui se trompe, doit fairedemi-tours, arrive à des culs-de-sac, etc… le labyrintheest aussi la métaphore du pèlerinage. De fait, lescroyants qui ne pouvaient pas se le permettreaccomplissaient symboliquement un pèlerinage à genoux dansl’église
Pour finir, la Cathédrale se veut être une image réduitede la création et les lois qui président à sa constructionparaissent identiques à celles qui ont permis à l’universde se manifester. L’édifice est la synthèse de la créationavec le ciel représenté par le plafond et les fenêtres quinous illuminent de leur lumière considérée comme divine àcette époque. Ensuite vient la terre ornée de motifsvégétaux, c’est aussi le lieu où les hommes vivent. Puisvient la crypte qu’on peut considérer comme le mondesouterrain. Pour le bâtisseur, l’harmonie des formes, desespaces, des forces et des lumières représente aussitoutes les lois qui régissent l’univers, et que l’on tented’équilibrer.
i Westwerk : aussi appelé ouvrage Ouest, il désigne la façade ouest d’une églisesouvent agrémentée d’un porche imposant et flanqué d’une ou deux tours.ii À gauche : représentation du tétramorphe sur le tympan de l’église de Perse d’Espalion. À droite : tympan de l’église Saint Pierre de Moissac, représentant aussi Jésus dans la mandorle entouré du tétramorphe.iii Chapiteau d’une colonne : partie supérieure et évasée d’une colonne qui lui transmet les charges. iv Mandorle : sorte de cadre en forme d’amande ou d’ovale dans lequel est souventreprésenté un personnage sacré. Dans l’art roman, une mandorle représentant Jésus est souvent entourée du tétramorphe (cfr iv).v Le tétramorphe : représentation symbolique des évangélistes en animaux ailés : Marc en lion, Luc en taureau, Jean en aigle et Matthieu en homme ailé.vi À gauche : homme portant un agneau, chapiteau de l’église St Marcellin de Chanteuges. Au milieu : monstres dévorants, chapiteau de l’église St Martin de Plaimpied ; A droite : centaure, église Notre-Dame de Chatillons.vii Chef-d’œuvre de la sculpture romane : tympan du portail de l’abbatiale de Sainte Foy.viii Un canon : dans le domaine des arts visuels désigne une règle de proportionsdes dimensions des éléments permettant d'obtenir une beauté idéale en sculpture et en peinture. ( wikipédia)ix Pinacle : sorte de chapiteau surmontant un renfort ou une tour. x Triforium : passage étroit aménagé dans l'épaisseur des murs au niveau de la galerie sur les bas-côtés de la nefxi Clavette, moyen de relier solidement deux barres de ferxii Chapiteau corinthien : type de chapiteau d’une colonne qui est orné de motifsvégétaux, souvent des feuilles d’acanthe.xiii Chapiteau composite : type de chapiteau d’une colonne composé à la fois de feuilles d’acanthes et de volutes typique de l’ordre ioniques