QU'EST-CE QUE LA MONNAIE ? LES COURANTS CONTEMPORAINS ET MAURICE ALLAIS
" Si tu ne sais pas ce qu'est l'écriture ". La corporalité de l'acte d'écrire à travers...
-
Upload
univ-poitiers -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of " Si tu ne sais pas ce qu'est l'écriture ". La corporalité de l'acte d'écrire à travers...
« Si tu ne sais pas ce qu’est l’écriture ».La corporalité de l’acte d’écrire à travers l’iconographie romaneEva Caramello
doctorante, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers
Résumé
Aux frontières de l’iconographie, de l’épigraphie et de la paléographie,cette communication propose une analyse de l’implication corporelle del’acte d’écrire à l’époque médiévale. À travers l’étude des images sculptées etpeintes d’époque romane, nous chercherons à reconstruire l’environnementet les conditions de travail d’un scribe ; grâce aux quelques études modernesde psychologie et de médecine, nous chercherons ensuite à montrercomment les outils du scripteur médiéval impliquent directement le corps.Pour mettre en perspective les images analysées, nous « écouterons » la voixdes scribes qui, dans les colophons des manuscrits, se plaignent de lasouffrance induite par leur travail, et nous donnent l’image d’un corpssensible, souffrant durant cette pratique. À la lumière du rôle de l’écriture àl’époque romane, du contexte religieux de production de la plupart desmanuscrits, et des vers laissés par les scribes eux-mêmes, cette commu-nication montrera que, tout au long du Moyen Âge, le corps devient unmoyen non seulement de la réalisation de l’écrit, mais aussi (ou surtout) unmoyen pour le scribe de s’élever vers le ciel à travers une imitation dessouffrances physiques du Christ sur la Croix.
Abstract
On the borders between iconography, epigraphy and palaeography, thispaper provides an analysis of bodily involvement of the act of writing inmedieval times. Through the study of carved and painted Romanesqueimages, we will try to reconstruct the environment and working conditionsof a scribe; through the few studies of modern psychology and medicine,we then try to show how tools of the medieval writer directly involve thebody. To put into this perspective the images analyzed, we will «hear» the
161
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page161
voice of the scribes in the colophons, which complain of pain induced bytheir work, which give us the image of a sensitive body, suffering duringthis practice. Considering the role of writing in Roman times, the religiouscontext of production of most of the manuscripts, and the scribes’ versesthemselves, this paper will show that, throughout the Middle Ages, bodybecomes not only a means of achieving the writing, but also (or especially)means for the scribe to rise towards the skies, alike the physical suffering ofChrist on the Cross.
** *
Le manuscrit médiéval fait l’objet de l’analyse de plusieurs disciplinesdites «auxiliaires» de l’histoire. Cependant chacune d’entre elles a des intérêtsdifférents : la codicologie consiste en une approche du manuscrit du pointde vue matériel, en étudiant sa forme, sa structure et les matériaux qui lescomposent ; la paléographie est une étude spécialement consacrée à sonécriture ; l’histoire et la littérature consistent en un examen du contenu destextes qu’il préserve ; enfin l’histoire de l’art est une observation plutôtconcentrée sur l’enluminure ainsi que la décoration de la page.
L’analyse qui suit se propose d’adopter une démarche alternative, enassociant toutes ces disciplines et en cherchant à dépasser leur méthodeclassique : le scribe médiéval, sera au cœur de l’étude qui visera à dévoilerl’implication corporelle de ce dernier dans la production du livre médiévalet de présenter la valeur symbolique que l’acte d’écrire avait dans la périoderomane. L’enquête sera menée sur trois plans : l’analyse de l’image, d’époqueromane et issue de plusieurs domaines (notamment peint et sculpté), nouspermettra de voir comment l’écrivain était perçu selon l’imaginaire médiéval; les études modernes de psychologie et de médecine expliqueront en termesscientifiques la participation du corps au moment de l’écriture ; enfin cetteétude rendra sa voix au scribe par l’analyse des colophons de manuscrits,véritables témoignages de ce travail.
1. L’iconographie
Les seules mentions écrites médiévales parvenues jusqu’à nos jours sur lapratique de l’écriture, voire sur le métier de scribe, peuvent être ramenées àune épigramme du XIIe siècle, décrivant, d’une façon autant poétique quepeu détaillée, les outils nécessaires au scribe : « Au sujet de ce qui touche àl’écriture : quatre choses conviendront à tout scribe : l’oie, le taureau, le mouton,l’épine. L’oie donne la plume, la corne provient du bœuf, le mouton apporte la
162
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page162
peau, l’épine produit d’habitude l’encre ».1 Ces vers étant insuffisants pourcomprendre le métier du copiste, il nous sera nécessaire d’avoir recours àl’image « aussi indispensable à la documentation littéraire que l’ornement àl’édifice et la sculpture à nos cathédrales », pour reprendre les mots de RéginePernoud.
Tout au long du Moyen Âge on trouve « une tradition iconographiquecodifiée du portrait de l’auteur-scribe »2 : c’était l’auteur lui-même qui devaitêtre représenté dans l’acte d’écrire, même si, à cette époque, il était rare quel’auteur était aussi le réalisateur du texte ; mais ce sont les auteurs quibénéficiaient du plus haut degré d’auctoritas, c’est-à-dire à la fois l’autorité,le pouvoir d’écrire des textes principalement chrétiens et de la même façon,l’importance du texte dérivée de son auteur. Les personnages privilégiés parla tradition constituent un éventail de personnalités généralement liées à lareligion, surtout à l’époque romane : Saint Grégoire3, par exemple, auquella tradition attribue le statut de scribe, bien qu’il n’ait jamais vraiment nicomposé ni copié des textes, est représenté habituellement accompagné parla colombe du Saint Esprit, lui faisant la dictée. Les Évangélistes sont aussides figures récurrentes et ils sont souvent facilement reconnaissables, carprésentés selon un schéma stéréotypé, selon lequel l’auteur est assis de faceou de trois quarts, accompagné de son symbole, parfois en écrivant sur destablettes de cire plutôt que sur des livres. Toutefois à côté des auteursprestigieux, la tradition transmet aussi des reproductions d’auteurs moinsconnus de nous mais célèbres dans la société intellectuelle de l’époque : il
était donc reconnus étant dignes derecevoir le portrait de scribe suite à lacomposition d’œuvres non proprementliturgiques mais répandues dans lemilieu autant ecclésiastique que laïc,comme par exemple les textes hagio-graphiques4. Les messages délivrés parces images de scribe sont multiples.Concernant notamment notre analyse,elles apportent principalement desinformations sur le matériel utilisé pourl’écriture, du mobilier aux outilspratiques, ainsi que sur la posturephysique du scribe et ses conditions detravail.
163
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
Fig.1 : « Saint Grégoire et trois scribes », ivoire, autour 968-980,
Vienna Kunsthistorisches Museum.
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page163
De l’observation du Saint Grégoire merveilleusement sculpté sur l’ivoirede la reliure en figure 1, nous apprenons beaucoup sur les conditions detravail du copiste médiéval, en distinguant les personnages des deux registres.Le Saint sur le premier registre, visiblement courbé sur le livre maisconfortablement assis sur une chaise avec un petit dossier, le pied gauchereposant sur un scabellum ; dans sa main droite il tient la plume et avec lagauche il maintient les pages du livre pour qu’il reste ouvert. La position dece personnage au centre de la composition et la présence de la colombe surson épaule permettent d’identifier avec une certaine facilité ce moine commesaint Grégoire. Ses dimensions, l’espace occupé par sa figure et le choix dumobilier qui rend plus aisée son activité renforcent l’importance dupersonnage. Dans la zone sous-jacente, trois copistes l’aident : ils sontprésentés sans pupitre5, ni scabellum, ni dossier pour soulager leur dos, maisils écrivent en se posant directement sur une écritoire et le scribe au centreoccupe ses deux mains, l’une avec la plume, l’autre avec l’encrier nécessaireà tous les trois. Comme déjà dit spécifiquement pour la figure de saintGrégoire, nous pouvons élargir la réflexion à la reliure en général, en
164
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
Fig.2 : « Hildebertus et Everwinus », dans Augustin, De civitate Dei, Ms. Kap.A XXI, f° 133r°, 1140environs, Bibliothèque du chapitre de Prague.
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page164
soulignant le fait que la disposition des acteurs dans l’espace sculpté et leurposition physique, précisent leurs liens hiérarchiques aussi : saint Grégoire,titré de l’auctoritas, est installé plus aisément que ses trois commis ; laprésence dans le premier registre d’un certain type de mobilier et son absencedans le deuxième soulignent la différence entre le maître et son disciple.
L’autoportrait du peintre Hildebertus (Fig.2) offre un panorama plutôtcomplet sur l’équipement du scribe-copiste : Hildebertus, assis sur un banc,« un siège étroit et long, dépourvu de dossier »6 mais rendu plus confortablepar un coussin, travaille sur une écritoire7 soutenue par un lion. Celle-ci estcreusée sur la partie supérieure droite, afin de glisser à l’intérieur des trousles cornes servant d’encrier et plusieurs plumes, chacune employée pour unecouleur différente, pour l’écriture ou pour la décoration du livre (Hildebertusest plutôt célèbre pour ses enluminures), bien qu’il soit ici représentétravaillant en face d’un livre écrit, apparemment par lui). La main droite estlibérée de la plume, qu’il porte à l’oreille, pour chasser le rat qui mange à satable ; dans sa main gauche il tient encore le grattoir, un « instrument forméd’une lame de métal tranchante, fixée à un manche »8 d’usage habituel,nécessaire soit pour maintenir ouverte la feuille de parchemin sans la toucherni l’abîmer, soit pour gratter, et donc effacer, les erreurs éventuelles.Everwinus – comme Hildebertus, il est identifié par son prénom écrit àl’encre rouge au-dessus de sa tête –, dans la partie inférieure, travaillant doncaux pieds du maître, semble plutôt utiliser un calame, une « tige végétalecreuse ou [un] tuyau de métal à l’extrémité effilée, employée pour écrire à
165
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
Fig.3 : Tympan de l’église paroissiale de Saint-Fiacre à Mervilliers, (Cl. E. Caramello)
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page165
l’encre », ici utilisée pour décorer sa page. Comme dans l’exemple précédent,la composition de la figure se divise en deux registres, chacun réservé à unpersonnage bien défini.
Le tympan de l’église paroissiale deSaint-Fiacre à Mervilliers (Fig.3) attirel’attention de l’observateur sur ledétail du scribe représenté dans l’angleinférieur droit de la composition(Fig.4) : il est installé devant sonécritoire, qu’il pose sur ses genoux etsur laquelle tombe le parcheminmaintenu par la main gauche ; il estassis sur une chaise à accoudoirs,calame en mains et deux petitsencriers à sa droite. L’intérêt de cetexemple dérive de la nature différentede l’écriture : si jusqu’à maintenant lesscribes étudiés étaient chargés de laproduction du manuscrit, ici l’acteur« écrit une inscription ». Ainsi, bienque le contexte de production soitdifférent, la posture de l’écrivain etl’équipement restent les mêmes,puisque l’on cherche plutôtl’évocation de l’idée du scribe et non
la reproduction de l’artisan qui s’est concrètement occupé de la gravure duphylactère9.
Tous les portraits des scribes considérés dans cette analyse, malgré leurdiversité, ont des caractères communs : l’écrivain est souvent peint le dosplié vers la page, ses deux mains sont la plupart des fois occupées, son espacede travail est limité.
2. Les études scientifiques modernes
C’est seulement la littérature moderne qui, dans une nouvelle perspectivepluridisciplinaire, commence à s’intéresser à l’acte d’écrire commephénomène physique, et donc à en étudier les effets musculaires etcérébraux. En résumant quelques-unes de ces études, nous expliqueronscomment l’écriture est possible grâce à la collaboration entre la main, lesyeux et le cerveau, comme le montre le titre d’un colloque qui a eu lieu en199010.
166
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
Fig.4 : détail du scribe représenté dans l'angle inférieur droit du tympan,
(Cl. E. Caramello)
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page166
Dans l’introduction de cet ouvrage de référence, plusieurs auteurssoulignent la nécessité, que nous partageons ici même, d’un usageprécautionneux d’un tel type d’études : il s’agit en fait d’analyses scientifiquestestées sur des « matériaux modernes », qui n’ont rien à voir avec lesmatériaux médiévaux. Il faut reconnaître l’importance de la démarchemoderne pour tenter de comprendre la participation du corps à l’acted’écrire, mais sans jamais oublier les conditions différentes dans lesquellesle scribe médiéval opérait.
Paolo Viviani11 développe trois facteurs déterminant l’organisation dugeste de l’écriture : les propriétés spécifiques du système moteur, lescontraintes liées à la présence d’un code linguistique et la nature desinstruments et des matériaux utilisés. Pour amplifier ce schéma, JacquesPaillard12 propose une analyse très détaillée, dans la lignée de ses théoriesselon lesquelles la physiologie est à la base de la psychologie. Il considèrel’acte d’écrire d’un double point de vue : le premier cognitif, soit une habilitémanuelle complexe, acquise par apprentissage, où la main représente uninstrument moteur polyvalent et le cerveau s’occupe des fonctionssymboliques du langage ; le deuxième plus physique, comme unenchaînement de mouvements coordonnés des doigts, de la main et du bras,nécessaires pour déplacer le marqueur sur le support.
Cette activité principale, soit le déplacement du stylet, résulte de lacomposition de trois générateurs principaux : l’oscillation (dite antéro-postérieure) dans le sens longitudinal de la feuille, résultat des articulationsdigitales, notamment des trois doigts qui prennent le stylet permettant detracer la forme des lettres ; l’oscillation latérale, dans le sens transversal dela feuille, qui dérive du mouvement du poignet, laquelle, en association avecune translation horizontale, assure la progression de la ligne écrite par lesmouvements proximales de l’épaule.
Des activités adjointes peuvent être portées à la lumière pour compléterl’analyse, comme les retours en arrière à la fin d’un mot, pour intégrer lessignes de ponctuation ou d’abréviations ainsi que les barres des t ou lespoints des i, par exemple ; ou aussi les retours en fin de lignes à une nouvelleposition ; et encore une stabilisation de l’extrémité distale, assurée par l’appuide la main et la pression du marqueur sur le support en même temps quepar les forces de friction qui s’opposent au mouvement. Afin de garantirtoutes ces activités, l’intervention coordonnée de l’autre main peut êtrenécessaire.
La main, déjà à partir de l’adoption de la position érigée de l’homme,devient l’instrument privilégié de l’interaction entre le cerveau et sonenvironnement, en transformant de cette façon les architectures nerveuses.
167
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page167
Le cortex moteur pourvoie à l’augmentation du contrôle différencié desmuscles des doigts et de la main ; l’articulation de l’épaule aussi subit undéveloppement de son contrôle, permettant un déplacement orienté du bras,un positionnement et une stabilisation de la main dans l’espace de saisiemanuelle, ainsi que l’enrichissement de la bouche néo-cérébelleuse quicontrôle le cortex moteur même ; enfin, le guidage visuel des activités dubras et de la main est amélioré par une spécialisation des secteurs du cortexassociatif pariétal.
Les mécanismes décrits s’insèrent dans l’acte qui est à la base de l’écriture,voire la tenue de la plume qui change par rapport à plusieurs facteursexternes au corps mais implicites dans l’action, comme par exemplel’obligation d’écrire plus ou moins rapidement, le respect de l’orthographeet de la grammaire, la pression de la main sur la page dérivant, entre autres,de la nature du support même, ou encore le respect des formes conven-tionnelles.
Ces réflexions de Rosemary Sasson13 sur la tenue de l’outil moderned’écriture peuvent être déclinées (d’une façon simple, sans qu’il soit nécessaired’être un spécialiste du sujet) pour l’écriture médiévale : le scribe devaits’imposer des mouvements obligés par le support (le parchemin) et l’outilmême (la plume, le calame...) : la plume d’oie utilisée pour l’écriture (sur leparchemin comme sur papier), par exemple, demande des mouvementsobligés du haut vers le bas, sans quoi, en remontant, la plume s’accroche ausupport en versant toute l’encre, en impliquant sensiblement l’épaule ; enfin,l’écriture avait lieu la plupart du temps dans des endroits mal illuminés, doncfatiguant pour les yeux, et froids pour tout le corps – comme les notes enmarge déjà citées en témoignent ; l’écrivain pouvait être obligé à écrire en seposant sur ses propres genoux, en gravant fortement le dos.
L’implication physique et cérébrale de l’écriture est forte aujourd’hui etl’était encore plus au Moyen Âge quand c’était au scribe de s’adapter auxoutils de travail, plutôt que le contraire.
3. La voix du scribe : les colophons
La plupart du temps, le scribe médiéval est un copiste qui s’occupe, donc,de la reproduction d’un ouvrage existant, n’ayant (pour éviter la répétitionligne suivante) pas beaucoup de place dans le manuscrit pour l’expressionpersonnelle. Les seules parties où il trouve la place pour insérer des élémentspropres sont les colophons, des brefs paragraphes finals mentionnantd’habitude simplement le lieu ou la date de la copie, ou l’un et l’autre, et lesmarges blanches du texte.
168
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page168
Les notes marginales autour du feuillet offrent des confirmations à lathèse de la complexité du travail du scribe au Moyen Âge, notamment parrapport à ses conditions. Ces notes techniques en marge de page, exprimantles difficultés auxquelles le copiste doit se confronter, sont rares mais quandmême présentes, on trouve ainsi par exemple « Cette lampe éclaire mal », ou« Ce parchemin est certainement pelucheux » ; parfois le copiste y justifie unrésultat peu satisfaisant « Cette page n’a pas été copiée lentement ».
La partie la plus utilisée par le scribe est surtout le colophon, où il ajoutequelquefois des informations complémentaires aux données citées en haut,dont des commentaires ou de nombreuses plaintes, selon des formules plusou moins poétiques.
« Si tu ne sais pas ce qu’est l’écriture, tu pourras croire que la difficulté estlégère, mais si tu veux une explication détaillée, laisse-moi te dire que le travailest rude : il brouille la vue, courbe le dos, écrase le ventre et les côtes, tenaille lesreins et laisse tout le corps douloureux. […] Comme le marin regagnant enfinle port, le scribe se réjouit d’arriver à la dernière ligne » : attestée déjà à partirdu milieu du VIe siècle, c’est l’expression la plus utilisée au sein desmonastères médiévaux, fort en vogue à l’époque romane et employéejusqu’au XVe siècle. Ce modèle spécifique, pris du colophon du Beatus deSilos du XIIe siècle, ne représente pas un exemple unique, il s’agit aucontraire d’une formule présente dans les livres médiévaux de toute l’Europe,avec quelques variantes.
Des nuances sont proposées dans un manuscrit du Mont-Cassin du XIe siècle, où le copiste écrit : « Comme celui qui navigue désire le port, ainsile scribe le dernier vers. Celui qui ne sait pas écrire, il pense que ce n’est pas dutravail. Mais celui (qui écrit) a les yeux fixés, et le cou courbé : trois doigtsécrivent, mais tout le corps travaille »14 ; ou encore le scribe d’un manuscritwisigothique du VIIIe siècle, qui, s’adressant directement au lecteur dansune sorte de prière, écrit : « O lecteur bienheureux, lave tes mains et prendsaussi le livre, tourne doucement les feuilles et pose ton doigt loin de la lettre.Celui qui ne sait pas écrire –, peut penser que ce n’est pas du travail. O commeest pénible l’écriture : elle fatigue les yeux, brise les reins, fait souffrir tous lesmembres. Trois doigts écrivent, tout le corps travaille »15. À côté de ces formules,d’autres remarques sont faites dans les colophons, comme par exemples –les mots de Lion de Novare qui, en parlant de l’écriture, dit : « […] elle arquele dos, les côtes se rétracter et elle cause au corps chaque sort de gêne »16.
Une dernière source d’information à citer, qui s’éloigne sensiblement dela nature des renseignements offerts par les attestations analysées jusqu’àmaintenant, mais qui reste intéressante dans le présent contexte d’étude, estl’eulogie, une bénédiction présente au début et/ou à la fin des manuscrits,
169
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page169
mais aussi des cahiers ou des chapitres, par laquelle les copistes demandentl’aide de Dieu pour l’accomplissement de leur travail.
« Que l’aide me vienne de Dieu, qui a fait le ciel et la terre » ; « Béni soit leSeigneur qui m’a conduit au port de cette œuvre. Je bénis aussi le roi du Cielqui m’a permis d’aller sans dommage jusqu’au bout de ce livre. Amen » ; « Bénisoit celui qui donne la force à celui qui est fatigué et augmente le courage decelui qui n’a plus d’énergie ». Il est intéressant de noter que, dans la règle devie de Saint Benoît, au chapitre dédié au travail manuel et à la lecture, ilindique clairement : « D’autre part, quand ils se mettent au travail, soit de laterre soit d’un métier quelconque, ils ne commenceront qu’après avoir fait uneoraison et ils finiront de même par une oraison »17. L’écriture de ces prières àl’intérieur du livre pourrait être vue comme le transfert de la pratiquequotidienne monastique dans la structure du livre même, objet produit ausein du monastère et chargé d’une valeur spirituelle forte.
4. Le corps du scribe au service de Dieu
Une meilleure connaissance de l’environnement culturel où laproduction manuscrite médiévale s’insère devient utile à ce moment de notreanalyse pour comprendre la valeur que l’écriture, en tant que geste maisaussi que production du livre, avait au Moyen Âge, en remettant dans soncontexte historique le rôle du scribe médiéval.
« Le livre majeur de la culture médiévale occidentale est sans aucun doute laBible », écrit Eric Palazzo18. Pendant tout le Haut Moyen Âge et la périoderomane, la production manuscrite a eu un caractère surtout religieux : lesmoines copiaient des livres liturgiques19 servant au monastère même ou auxéglises des alentours pour la prière et la célébration de la messe. Pour avoirune production écrite laïque il faudra attendre la naissance et la diffusiondes universités au XIIIe siècle.
Le livre comme objet, qu’il soit la Bible ou l’un des livres liturgiquesutilisés pendant les offices, assume donc une valeur spirituelle haute : il estdestiné au cœur de l’église ; il sera posé sur l’autel pendant la liturgie ; àtravers la lecture des mots écrits dans ce même livre, le prêtre permet ladescente de Dieu parmi les hommes. Plusieurs auteurs ont insisté surl’importance matérielle du Livre médiéval par excellence ; Pierre Bersuireparle de la Bible en soutenant que « pour le Christ c’est une sorte de livre écritdans la peau de la Vierge », en renvoyant au parchemin qui accueille l’écriture,cette peau qui, pour les exemplaire les plus précieux, venait de l’agneaumort-né, car de meilleure qualité. Dans un monde dominé par le
170
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page170
Christianisme comme l’était le monde médiéval, l’usage d’une peau surlaquelle écrire le Livre Sacré, assume une valeur importante : l’agneau duSacrifice meurt pour recevoir les mots du Christ.
Thomas de Celano décompose encore plus l’objet-livre, et la lettre, entant qu’unité base du discours écrit, assume une portée profonde : « Commeles reliques d’un Saint dans la cathédrale, les lettres mêmes étaient sacréesintrinsèquement pour Saint François d’Assise, qui disait avoir recueilli et sauvéchaque morceau de parchemin qu’il avait trouvé pendant ses voyages, car Litteraesunt quibus componitur gloriosissimum domini Dei nomen [les lettres sont lesobjets dont le nom le plus glorieux de Dieu est composé]) »20. D’ailleurs le renvoià l’Écriture est intrinsèquement présent aussi dans la Bible elle-même : « écritavec les doigts de Dieu » (Exode, 31,18) ou le Psaume 44 : « Mon cœur aproduit une bonne parole, c’est au Roi que j’adresse mes ouvrages, ma langue estle calame d’un scribe rapide ».
Dans cette perspective, la grande importance attribuée au livre commeobjet prend forme à partir de son contenu, car au Moyen Âge le livre étaitun objet porteur d’un langage transcendant expliquant le monde, et,l’Écriture, voire l’acte d’écrire la Bible, devient métaphore du système devérité signifiée, donc de la Divinité.
« L’idée du livre, qui renvoie toujours à une totalité naturelle, estprofondément étrangère au sens de l’écriture. Elle est la productionencyclopédique de la théologie […] contre la disruption de l’écriture, contre sonénergie aphoristique et […] contre la différence en générale »21 : ces mots deJacques Derrida résument toute la conception typiquement médiévale del’écriture, de sa production et de son produit. La Bible est à cette périodeLiber […] in quo totum continetur, livre où le tout est contenu et livre grâceauquel on rend Dieu présent sur la terre.
Il est donc possible d’affirmer que le livre religieux produit au MoyenAge n’était pas un objet quelconque, mais il était chargé d’une valeurspirituelle importante, donnée par son contenu, par son usage et par l’actionqu’il exerçait au quotidien. Le scribe ne se considérait et n’était pas considérépar les autres gens comme un artiste, ni même comme un artisan ou unexécuteur tout simple ; il était le constructeur de l’objet sacré véhiculant lesavoir et surtout permettant la présence de Dieu parmi les hommes. Parailleurs, les récits, disséminés dans tout le manuscrit, entre les lignes descolophons, dans les notes marginales, racontant les difficiles conditions detravail de l’écrivain médiéval provoquant la souffrance physique ne sont pasconçues comme de simples plaintes. Les eulogies aussi s’insèrent dans cetteconception spirituelle du livre, où celui qui est chargé de sa rédaction abesoin du soutien divin pour accomplir son œuvre.
171
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page171
Il faut aussi rappeler que la culture latine naît orale puis devient écrite :dans cette évolution historique, le geste corporel de l’écriture est doncprofondément différent par rapport au geste intellectuel du discours et parconséquence la copie est vue comme une tâche servile et exténuante. Maisen même temps, cette complexité intrinsèque est compréhensible seulementpour les rares hommes capables d’écrire, presque des élus, elle amène doncl’écrivain à se réjouir intimement pour la souffrance dérivant de son travail.
Les châtiments du scribe lui permettent de s’approcher du même supplicevécu par le Christ sur la croix : le scribe, à sa façon, s’immole pour leshommes, pour tous les fidèles qui ont besoin de se joindre à Dieu, mais enmême temps il donne ses mains, ses yeux, toutes ses membres à Dieu.
Dans cette perspective, le corps du scribe médiéval assume une doublevalence : il devient instrument pratique de construction de l’objetpermettant la présence concrète de Dieu à travers la lecture des mots tracéssur le parchemin ; mais il devient aussi moyen d’élévation au ciel et derapprochement à la souffrance divine, par la difficulté de l’écriture. L’acted’écrire au Moyen Age, avec toute la souffrance qu’il impliquait, est donc lemoyen le plus humble pour celui qui l’exerce de s’élever vers le ciel et Dieu.
172
LE CORPS ET SES REPRÉSENTATIONS À L’ÉPOQUE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page172
NOTES1. « De his quae ad scriptorem pertinent : omni convenient scriptori quatuor : anser, Taurus, ovis, spina, si notetillud homo. Anser dat pennam, cornu fit de bove, pellem fert ovis, incaustum promere spina solet ».Staatbibliothek Berlin, Ms. Phillipps 1694.2. Eric Palazzo, Portraits d’écrivains, la représentation de l’auteur dans les manuscrits et es imprimés du MoyenÂge et de la première Renaissance, Paris, 2002, p. 25.3. Pape Grégoire I le Grand (590-604), responsable du développement de la liturgie à travers une fortestructuration des textes et des rites liturgiques pendant son pontificat ; ça suffit à lui donner l’auctoritas nécessairepour être représenté en train d’écrire.4. Les laïques recevront la dignité pour être présentés comme écrivains seulement en époque plus tardive,notamment à partir du bas Moyen Âge.5. « Une table avec une inclinaison variable, passant de l’horizontal à un angle de 60° », Denis Muzerelle,Vocabulaire codicologique : répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, Paris, 1985, p. 212.6. D. Muzerelle, Vocabulaire […], op. cit., p. 211-212, comme deuxième acception du terme.7. Pupitre, écritoire et banc peuvent être utilisés comme synonymes, même si Muzerelle les distingue sensiblementlorsqu’il évoque le pupitre ou la table (voir note 5 ; l’écritoire est plutôt un « meuble fixe ou planchette portativefournissant un plan de travail pour écrire » ; le banc, enfin, est une « table de travail horizontal ». D. Muzerelle,Vocabulaire […], op. cit., p. 211-212.8. D. Muzerelle, Vocabulaire […], op. cit., p. 215.9. Pour une analyse détaillée du tympan, voir Cécile Voyer, « Le geste efficace : le don du chevalier au saint sur letympan de Mervilliers (XIIe siècle) », dans Aurell Martin et Gibrea Catalina (dir.), Chevalerie et christianismeaux XIIe et XIIIe siècles, Renne, 2011, p. 101-121. 10. Cette partie s’appuie surtout sur : « L’écriture : le cerveau, l’œil, la main », Actes du colloque international duCentre de la recherche Scientifique. Paris, Collège de France, 2, 3 et 4 mai 1988, organisé par l’Institut de laRecherche et l’Histoire des Textes sous la présidence de son directeur Luis Holtz et par Colette Sirat, Jean Irigoinet Emmanuel Poulle, dans Bibliologia. Elementa ed librorum studia pertinentia. Vol 10, Turnhout, 1990.11. Professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève.12. Neurophysiologiste français, créateur de l’Institut de neurophysiologie et de psychophysiologie (INP) duCNRS en 1957, décédé en 2006. 13. Consultant de l’écriture pour les enfants au Royaume-Uni.14. « Sicut qui navigat desiderat portum, ita scriptor novissimum versum.Qui nescit scribere putat nullum esselabore. Sed qui habet intentos oculus et inclinam cervicem : tria digita scribunt, sed totum corpus laborat ».15. « O beatissime lector, lava manus tuas et sic librum adprehende,leniter folia turna, longe a littera digito pone.Quia nescit scribere, putat hoc esse nullum labore. O quam gravis est scriptura: oculos gravat, renes frangit, simulomnia membra contristat. Tria digita scribunt, totus corpus laborat ».16. « [...] dorsum inclinat, costas in ventrem mergit et omne fastidium corporis nutrit ».17. « Nam ipsum laborem aut terrenum aut cuiusuis artis cum incoat, oratione praecedente incipiant, aedemsemper oratone et finiant », pris de Adalbert de VOGÜÉ, La règle du maître, Paris, 1964, p.232-233 : il s’agit dumodèle suivi par Saint Benoît pour sa règle bénédictine. Elle entre dans les détails de la vie communautaire, nouspermettant ainsi de compléter notre connaissance de la vie quotidienne dans les monastères de l’époque et demieux distinguer l’originalité de Saint Benoît.18. E. Palazzo, Portraits […], op. cit., p.29.19. Pour un panorama général de la production de livres liturgiques médiévaux voir : Eric Palazzo, Le Moyenâge: des origines au XIIIe siècle, Paris, 1993.20. Pierre Bersuire, Repertorium morale, dans Jesse M. Gellrich, The idea of the Book in the Middle Ages.Language theory, mythology and fiction, Londres, 1985, p. 17. 21. Jacques Derrida, De la Grammatologie, Paris, 1967, p. 30-31.
173
« SI TU NE SAIS PAS CE QU’EST L’ÉCRITURE »LA CORPORALITÉ dE L’ACTE d’ÉCRIRE À TRAVERS L’ICONOGRAPHIE ROMANE
A000038_Interieur_Mise en page 1 05/06/14 14:44 Page173

















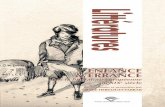




!["La philosophie comme expérience de l'immortalité, sur Christian Jambet, Qu'est-ce que la philosophie islamique ? ", Critique, décembre 2012, N°787, pp. 1075-1090 [Epreuves non-corrigées]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6333df6f7a687b71aa086bbe/la-philosophie-comme-experience-de-limmortalite-sur-christian-jambet-quest-ce.jpg)



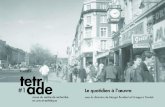


![Qu'est-ce que la propriété ? Une approche reinachienne [What is ownership? A Reinachian approach]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63307ecbebc01eab2101585a/quest-ce-que-la-propriete-une-approche-reinachienne-what-is-ownership-a-reinachian.jpg)




