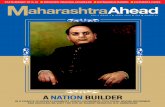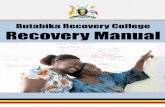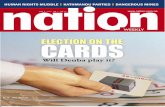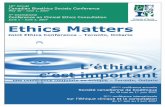La postérité du concept renanien de nation : héritage et actualité de la conférence Qu'est-ce...
-
Upload
univ-poitiers -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La postérité du concept renanien de nation : héritage et actualité de la conférence Qu'est-ce...
Université de Rennes 1Faculté de Droit et de Science PolitiqueCentre d’Histoire du Droit
LA POSTERITE DU CONCEPT RENANIEN DE NATION
Héritage et actualité de la conférence Qu’est-ce qu’une nation ?
Mémoire de Master II en Histoire du Droit (2012/2013)Présenté et soutenu par
Alexis ROBIN le 28 Juin 2013
Jury :
Directeur de Recherche : Monsieur Edouard RICHARDMaître de conférence à l’université de Rennes 1
Suffragant : Monsieur Sylvain SOLEILProfesseur à l’université de Rennes 1
Allégorie de la nation par VM Fck
REMERCIEMENTS
Si selon Socrate la maïeutique se fait dans la douleur, alors nos remerciements s’adressent naturellement au maïeuticien qui en l’apaisant par sa patience, ses conseils et sa précision, permit de produire ce mémoire : Edouard Richard, Maître de conférence à l’Université de Rennes 1.
Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement Monsieur Franck Bouscau, Professeur à l’Université de Rennes 1 pour l’aide qu’il nous a apportée en extrayant de ses étagères, quelques livres oubliés et Monsieur Shlomo Sand, Professeur à l’Université de Tel Aviv avec qui il nous a été permis d’échanger longuement par téléphone, ce qui contribua à interpréter ses textes le plus conformément à l’esprit de leur auteur. Nos remercions aussi le Professeur Lobato, Coordenador de Curso à l’université fédérale de Rio Grande, qui nous aida pour les textes et auteurs portugais, et Monsieur Maurice Gasnier, Maître de conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, sans l’intervention duquel, nos annexes n’auraient put être complètes. Plus largement, nous remercions toutes les personnes qui ont pu nous aider dans notre travail.
Nous tenons enfin à remercier Monsieur Sylvain Soleil, Professeur à l’Université de Rennes 1, pour nous avoir fait l’honneur de former le jury auquel nous avons soumis ce mémoire.
« Il n’y a pas de petits problèmes dans la science […] il n’est pas d’étude, quelque mince que
paraisse son objet, qui n’apporte son trait de lumière à la science du tout. […] Puisse l’esprit
de la recherche patiente et laborieuse ne pas s’éteindre parmi nous ! Puisse-t-on comprendre
que la science est une religion et que tout ce qui y touche est sacré ! »
Ernest Renan
« Mes élèves avaient le droit de lire dans la langue qu’ils maîtrisaient. Il est clair que le texte
"Qu’est-ce qu’une nation ?" fut choisi en premier, car il continue encore aujourd’hui
d’éveiller une grande curiosité grâce à sa pertinence et à sa fraîcheur. »
Shlomo Sand
SOMMAIREINTRODUCTION : .................................................................................................................... 1 PARTIE 1 : LE CONSTAT DE L’OUBLI DE LA NATION RENANIENNE ....................... 15
Chapitre 1 : La liquidation de l’héritage intellectuel renanien et sa dissolution entre ses héritiers politiques ................................................................................................................. 15
Section 1 : La succession de la droite monarchiste et nationaliste ................................... 16 Section 2 : Le faire valoir d’une République en construction ........................................... 21
Chapitre 2 : Un oubli mâtiné de rappels ponctuels de la définition renanienne de la nation à l’époque contemporaine ........................................................................................................ 27
Section 1 : Un oubli interrompu ponctuellement dans l’espace socio-politique ............... 27 Section 2 : L’oubli dans le milieu intellectuel et universitaire .......................................... 36
Chapitre 3 : La raison de l’oubli : la péremption de la théorie de Renan ............................. 44 Section 1 : La caducité de la définition face aux nouveaux courants ............................... 44 Section 2 : Les nouvelles définitions de la nation. ............................................................ 50
PARTIE 2 : LES ENJEUX DES ETUDES CONTEMPORAINES SUR L’IDEE DE NATION CHEZ RENAN ......................................................................................................................... 58
Chapitre 1 : Le Renan raciste et « fasciste » ......................................................................... 58 Section 1 : la définition de la nation renanienne comme base du colonialisme ................ 59 Section 2 : Renan : l’antisémite qui préfigura le fascisme. ............................................... 67
Chapitre 2 : La nation contractuelle de Renan ...................................................................... 78 Section 1 : La quasi unanimité des auteurs sur le lien « nation renanienne » et « nation contractualiste » ................................................................................................................ 78 Section 2 : L’incohérence du lien « nation renanienne » et « nation contractualiste » par l’évolution de la pensée de Renan ..................................................................................... 83
Chapitre 3 : Renan et son idée de nation vu par le prisme politique ..................................... 90 Section 1 : L’influence politique dans les travaux sur la nation selon Renan ................... 90 Section 2 : Une conférence politisée en raison de son ambiguïté ..................................... 94
CONCLUSION ....................................................................................................................... 100 SOURCES ............................................................................................................................... 102 BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 108 ANNEXES .............................................................................................................................. 114 TABLE DES MATIERES ...................................................................................................... 121
INTRODUCTION :
Alors « qu’il se trouve que l’Algérie c’est la France, parce qu’il se trouve que les
départements de l’Algérie sont des départements de la République Française »1, « peut-on dire
cependant, comme le croient certains partis, que les limites d’une nation sont écrites sur la
carte et que cette nation a le droit de s’adjuger ce qui est nécessaire pour arrondir certains
contours […] ? Je ne connais pas de doctrine plus arbitraire et plus funeste. Avec cela on
justifie toutes les violences »2. Si « le musulman, volontiers assimilé à « l’intégriste », et dont
la religion est jugée, par 74% des Français, intolérante et incompatible avec la société
française »3, il est pourtant notable que « chacun croit et pratique à sa guise, ce qu’il peut,
comme il veut. Il n’y a plus de religion d’Etat ; on peut être français, anglais, allemand, en
étant catholique, protestant, israélite, en ne pratiquant aucun culte »4. Nous pourrions
continuer ainsi en excipant d’autres critères, tels que la race, ou encore la langue, mais déjà,
ce petit mælström de citations mises en miroir, reflète un certain malaise, une crise qui débute
au milieu du XXe siècle, et qui se prolonge encore aujourd’hui. Cette crise, c’est celle de la
Nation, qui est selon Alain Dieckhoff « dans tous ses Etats »5. Si elle était latente pendant
plusieurs années, celle-ci a pourtant manifesté quelques symptômes comme la réforme du
code de nationalité de 19936, afin de restructurer les conditions d’accès à la nationalité
française ou la création du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale
et du Développement solidaire7 pour tenter de définir ce qu’est la nationalité (et par voie de
conséquence ce qu’est la nation) française. Pourtant ces débats sur le fondement du concept
de nation ne sont pas nouveaux. Ces tentatives de définition les plus abouties sont faites au
XIXe siècle, par des Allemands et des Français, notamment un, que nous avons cités tout à
l’heure sans le nommer et dont les phrases tirées du passé font écho à celles du présent :
Ernest Renan. Dans une conférence prononcée en Sorbonne le 11 mars 1882, intitulée Qu’est-
ce qu’une nation ?, cet auteur va proposer une définition originale de la nation, en récusant
celles proposées par les Allemands, ce qui va avoir une forte influence sur la pensée politique
française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Mais avant de plonger plus en avant
dans les développements ou même d’exposer cette définition, il convient de présenter cet
auteur à la personnalité ambiguë et aux idées novatrices pour son siècle, afin de justement
comprendre les développements ultérieurs.
1 F. Mitterrand, Ministre de l’Intérieur, Discours à l’Assemblée Nationale, 25 novembre 1954, in M. Mopin, Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, Paris, la documentation française, 1988, p. 312.2 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011, pp. 72-73.3 G. Courtois, « Les crispations alarmantes de la société française », Le Monde, 24 janvier 2013.4 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 71.5 A. Dieckohff, La Nation dans tous ses Etats, Paris, Flammarion, 2000, réédité en 2012.6 Loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, JORF, n° 168, 23 juillet 1993, p. 10342.7 Décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement, JORF, n° 115, 19 mai 2007, p. 9714.
- 1 -
Joseph-Ernest Renan, est né le 28 février 1823 à Tréguier, dans les Côtes-d’Armor
(anciennement Côtes-du-Nord). Il est le benjamin d’une famille de trois enfants8 issue de
l’union entre Philibert Renan, capitaine au long cours, et Magdelaine Féger dite Manon9. Cet
enfant, conçu lors d’une escale de son père, est arrivé prématuré et en mauvaise santé10. Il
restera en mauvaise santé toute sa vie11 puisqu’à nouveau il tombera malade au séminaire12, et
sera prématurément atteint de goutte vers la fin de sa vie. De plus, le cadre familial n’est pas
le plus propice à accueillir un enfant aussi fragile que lui. En effet en 1808, Philibert Renan,
qui a repris le commerce d’épicerie de son père avec sa femme, le fait péricliter puis décliner.
Tant et si bien qu’en 1808, à cause de sa mauvaise gestion, la famille croulant sous les dettes
est acculée par les créanciers, obligeant Philibert à reprendre le cabotage sur les côtes
bretonnes et normandes pour subvenir aux besoins de sa famille, et désintéresser les
créanciers13. Mais le tragique ne s’arrête pas là puisque, le 1er juillet 1828, alors qu’Ernest est
âgé de 5 ans, la dépouille de son père est retrouvée à Lanruen, celui-ci étant porté manquant
par son équipage depuis le 12 juin. Sa mère s’arrange alors avec les créanciers, et la famille
part s’installer à Lannion, chez la grand-mère de Renan. Celui-ci fréquentera l’école des
Frères, pendant que l’aîné partira travailler comme commis de banque à Paris. Deux ans plus
tard, Ernest, Henriette et leur mère reviendront à Tréguier, et Ernest intégrera l’école des
Frères Lamennais14.
Peu après, à la rentrée 1832-1833, il intègre l’école ecclésiastique de Tréguier grâce à ses
réussites scolaires, dans le but affirmé de devenir prêtre. Mais il apparaît dissipé lors des
messes et semble ne s’intéresser qu’à l’étude, si bien que déjà à ce moment là, certains
estiment qu’il rêvait « moins en réalité de sainteté que d’excellence »15. Il suivra dans cette
école, une scolarité brillante, maintenant sa première place au tableau d’honneur et remportant
tous les prix. C’est aussi à cette époque que se manifeste le tempérament doux, réservé, timide
et presque gauche, que beaucoup décriront tout au long de sa vie. Ce comportement
s’explique notamment par la santé de l’enfant qui ne lui permet pas de se mêler aux jeux de
ses camarades. Son excellence, et les échos des enseignants sur cet élève atypique, arrivent 8 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, Paris, Fayard, 2012, pp. 13-14. Ces deux pages contiennent un arbre généalogique complet des ascendants et descendants d’Ernest Renan. On y apprend qu’il a un frère aîné Alain, né le 10 Janvier 1809, ainsi qu’une sœur Henriette qui, nous le verrons, jouera un rôle important dans la vie de l’auteur, née le 22 juillet 1811. Nous ne nous référerons qu’à cette biographie, car elle reprend les mêmes éléments que celles antérieurs en ajoutant des textes inédits.9 Ibid., p. 17 : marié le 31 décembre 1807 à Lannion.10 Ibid., p. 20. E. Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, 1883, in L. Rétat, Renan : Histoire et parole, Paris, Robert Laffont, 1984, p. 835 : « Je naquis avant terme et si faible que, pendant deux mois, on crut que je ne vivrais pas ».11 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., p. 21. Renan tomba gravement malade au printemps 1831 : « Quarante jours durant, fièvre et délire font craindre pour sa vie ».12 Ibid., p. 28. Il était atteint d’une sorte de dépression semble-t-il.13 Ibid., pp. 18-19.14 Ibid., pp. 20-22.15 Ibid., p. 23. Ce sont ici les termes employés par l’auteur de cette biographie. Bien que les avis doivent être mesurés, au vu des lettres et textes collectés et présentés pour étayer cette affirmation, et au vu des doutes qui assailliront le jeune Renan plus tard, nous ne pouvons que tomber d’accord avec cette affirmation.
- 2 -
aux oreilles de l’abbé Dupanloup, qui vient de créer un petit séminaire afin de recruter les
meilleurs élèves du pays destinés à la prêtrise. Leur scolarité est payée par les frais
d’inscription des fils de bonne famille n’ayant pas cette vocation religieuse, afin de former la
future élite du clergé16. En 1838, l’abbé lui accorde une bourse, et c’est le 7 septembre
qu’Ernest Renan intégrera le petit séminaire de Saint-Nicolas-Du-Chardonnet, pour
poursuivre sur la voie des vœux.
Dans cette école, le niveau n’est pas le même qu’à Tréguier, et Renan, habitué à la
place de premier, se retrouve plusieurs places derrière celle d’excellence. Mais travaillant plus
qu’à l’accoutumé, il remonte au fur et à mesure jusqu’à se retrouver dans les cinq premières
places. Pourtant, cela ne l’empêche pas de redoubler son année de seconde alors qu’il est âgé
de 16 ans, et de décider dans la foulée de prendre la robe17. A Saint Nicolas, Renan apparaît
comme un élève fort croyant, réellement destiné à la prêtrise. Il y développe aussi son
caractère « bûcheur »18, sa soif de connaissance et son amour pour l’étude. Mais, lors de sa
dernière année à Saint-Nicolas, il commence à douter de son envie d’intégrer le séminaire. Il
redoute en effet le grand séminaire Saint-Sulpice, pour diverses raisons telles que le niveau
d’étude, mais aussi et surtout en raison des doutes qu’il nourrit sur sa propre foi, qu’il a
commencé à remettre en cause quelques mois avant la fin de l’année scolaire. Ces doutes vont
se manifester dès les premiers jours : « C’est donc dès les premières semaines du grand
séminaire, que le doute vient troubler la foi encore naïve du jeune clerc » affirme Jean-Pierre
van Deth, en exposant des lettres de Renan où il exprime ses turpitudes19. Cette période
apparaît alors comme l’une des plus riches dans la formation de la pensée de Renan.
Premièrement, parce que le niveau y est plus élevé qu’au petit séminaire et que l’approche de
l’enseignement y est radicalement différente. Cette exigence, ainsi que des matières
proposées, telles que l’Hébreux, accroissent le désir d’apprendre du jeune clerc, et permettent
à son exigence intellectuelle d’atteindre un autre niveau, en confrontant les textes d’origines
et les traductions sur lesquels s’est fondée l’Eglise catholique20. C’est aussi pendant cette
période que sa sœur l’initie à la culture allemande. Elle l’encourage à lire les ouvrages des
philosophes allemands, que Renan a découvert pendant les vacances de sa première année au
grand séminaire. Il éprouvait déjà une forte attirance à l’égard de ces philosophes dont il avait
brièvement étudié les œuvres lors de sa dernière année au petit séminaire. De plus, sa sœur
lui parle de l’intolérance religieuse et de l’antisémitisme en Pologne. Selon Jean-Pierre van
Deth ces échanges épistolaires entre le frère et la sœur, abordent pour la première fois les
16 Ibid., p. 25.17 Ibid., p. 30.18 « C’est un bûcheur, racontent ses camarades […] » (Ibid., p. 31). A tel point qu’il en développe un trouble obsessionnel compulsif : se frapper les dents avec le revers de son pouce ou de son index, la force et la vitesse variant en fonction de la difficulté du sujet.19 Ibid., pp. 39-40.20 Ibid., pp. 51-56. Sont relevées ici les erreurs de traduction qu’a trouvées Renan et le regret que celui-ci éprouve face au refus d’accepter ces erreurs de ses enseignants.
- 3 -
deux sujets qui influenceront la pensée de Renan, à savoir les philosophes allemands et la
religion21. Mais en réalité il faut étendre ce constat à toute la période qu’il passera à Saint-
Sulpice. Ces lettres ne sont que les prémices de sa pensée, car les erreurs qu’il décèle dans les
traductions des textes saints le mettent mal à l’aise. Et ce malaise ne peut pas disparaître avec
l’idée selon laquelle ces traductions seraient erronées, car il s’avère tellement brillant étudiant
en Hébreux, qu’il obtient la place de son professeur d’Hébreux pour le cours des débutants en
grammaire hébraïque en 1844. Malgré tout, il met ses doutes en sommeil et se fait tonsurer
dans le plus grand secret le 23 septembre 184322. La situation ne manque pas d’ironie puisque
« c’est au plus fort de cette confusion, au moment même où l’anticléricalisme paraît sur le
point de renaître, que Renan commence son parcours de "clerc tonsuré" »23. Mais cette
nouvelle vie d’homme d’église sera cependant de courte durée, car c’est finalement le
cartésianisme de la science, les philosophes allemands et les doutes attisés par les lettres de sa
sœur qui l’encourage à prendre des décisions réfléchies en fonction de sa volonté et non de
celle des autres, qui l’emportent et le poussent à quitter le séminaire en affirmant qu’il ne sera
jamais non croyant, qu’il doutera uniquement de la religion, jamais de Dieu et du Christ24.
Lui qui prévoyait de se rendre en Allemagne pour y poursuivre ses études et rompre en
douceur avec le séminaire, il partira en fait précipitamment et trouvera finalement une place à
la pension de monsieur Crouzet. C’est là qu’il rencontrera celui qui deviendra son ami de
toujours, Marcelin Berthelot25. Voisins de chambre, les deux hommes se rencontrent au
moment où l’un préparait son baccalauréat tandis que l’autre était maître d’étude pour les
jeunes bacheliers de la pension26. Ils s’apprécient mutuellement très rapidement, parce qu’ils
sont animés du même goût pour le travail et de la même passion pour les études. Cependant,
ils sont aussi proches sur certains points qu’ils sont éloignés sur d’autres, comme la
politique27. Outre cette rencontre avec Berthelot, cette période est très riche pour Renan. Il
passe tous ses grades universitaires (Baccalauréat, Licence et Agrégation), avec une thèse en
français sur l’Histoire des études grecques chez les peuples orientaux et celle en latin sur
Averroès et l’averroïsme en Occident. Il les obtiendra les uns après les autres, ainsi que deux 21 Ibid., p. 44.22 Ibid., pp. 56-57. Il a repoussé ce moment déjà plusieurs fois, et lorsqu’il l’accepte enfin, il ne l’annonce par courrier à sa mère que le 19 septembre 1843, attendant le début de la retraite préparatoire, au cas où il se serait désisté avant le moment fatidique.23 Ibid., p. 62.24 Ibid., p. 68. L’auteur de cette biographie tire cette conclusion en citant Essai psychologique sur Jésus-Christ, écrit par E. Renan et édité à Paris en 1921, et une lettre datée du 11 avril 1845, publiée dans Correspondance Générale, textes réunis, classés et annotés par Jean Balcou, 1836-1845, Paris, Librairie Honoré Champion, 1995, t. 1, p. 580.25 Ibid., pp. 78-79. J.-P. Clément, « Renan et Berthelot : une amitié profonde entre convergences et divergences », in J. Balcou (dir.), Marcelin Berthelot (1827-1907) : Sciences et politique, Rennes, PUR, 2010, p. 119.26 J.-P. Clément, « Renan et Berthelot : … », op. cit., p. 119.27 Ibid., pp. 120-128. En effet, Renan sera plus proche d’une monarchie qu’il veut éclairer, alors que Berthelot sera lui un fervent républicain. Ils s’opposent aussi dans le choix des disciplines universitaires qu’ils choisissent, puisque Renan décidera d’étudier les langues (et sera un philologue réputé), alors que Berthelot étudiera les sciences naturelles et deviendra chimiste.
- 4 -
prix Volney, trois ans seulement après avoir quitté le séminaire Saint-Sulpice28. Cette rapidité
fulgurante, inhabituelle car il ne laissera pas un an entre le baccalauréat et la licence comme il
est de coutume, et sera agrégé alors qu’il passe l’épreuve pour la première fois, accroît sa
notoriété dans le milieu intellectuel. Politiquement, le jeune Renan est aussi à un carrefour de
sa pensée. Dans une lettre à sa mère de 1848, il exprime son hésitation entre la Monarchie et
la République29, et n’exclut pas certaines idées socialistes, sans pour autant verser dans le
communisme auquel il n’adhère pas30. Il reste tout de même méfiant voire hostile vis-à-vis du
suffrage universel, non pas en son principe mais parce qu’il donne du pouvoir à une
population que Renan estime non instruite. Ainsi ce suffrage qui « a brutalement gonflé le
corps électoral de deux cent cinquante mille à plus de neuf million de voix »31, inclut dans la
vie politique des sujets qui selon Renan sont manoeuvrables. Dans sa jeunesse, Renan
n’apparaît donc pas si conservateur et monarchiste qu’on ne le pense. Il n’a pas rejeté la
démocratie mais simplement l’application qui en a été faite en 184832. C’est pour cela qu’on
trouve dans L’Avenir de la science, ouvrage débuté en 1848-1849, qui s’avère être pour
l’auteur un exposé de ses réflexions et opinions du moment, des idées « républicaines » que
certains critiqueront ou contesteront en les mettant sur le compte de la jeunesse33.
Après l’obtention de ses diplômes, alors qu’il avance dans ses recherches sur les
langues, il annonce ses fiançailles avec Cornélie Scheffer, qu’il rencontre rue Chaptal lors des
« salons mondains » organisés par son oncle. Ce projet de mariage va ternir les relations que
Renan entretenait avec sa sœur jusqu’alors, cette dernière allant jusqu’à tenter de faire échec à
ce projet d’union34. Finalement, il signe son contrat de mariage le mercredi 10 septembre
1856, le mariage civil est célébré à la mairie du IIe arrondissement le jeudi 11 et le samedi 13,
ils se marient religieusement en l’église de Saint-Germain-des-Prés d’abord, puis au temple de
l’Oratoire35. Cette même année, le 5 décembre, il est élu à l’institut des inscriptions et belles-
lettres avec vingt voix en sa faveur. Un an après, le 28 octobre 1857, naît son premier enfant 28 J. –P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., p.114.29 Lettre d’E. Renan à sa mère, 25 février 1848, Correspondance générale, t. 2, p. 500 in J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., p. 105. Voici ce que dit l’auteur de cette biographie à propos d’un des fragments de cette lettre : « Son jugement politique s’avère tout aussi clairvoyant que celui qu’il exerce dans ses études critiques : " La révolution est faite et irrévocablement faite ; il n’y a plus de retour possible des hommes d’autrefois, écrit-il à sa mère, et pourtant, ces pauvres gens croient être libres à tout jamais, ils ne songent pas que l’égoïsme les exploitera encore comme il les a déjà exploités. " ».30 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., pp. 110-112.31 Ibid., pp. 116-117.32 « Ainsi n’est-ce évidemment pas le principe même de la démocratie que Renan rejette, mais seulement l’application qui en a été faite en 1848, lorsqu’on a prétendu donner le droit de vote à une population majoritairement inculte et analphabète, manipulable à l’excès » (Ibid., pp. 129-130).33 « Le livre de la Réforme intellectuelle et morale […] représente, au contraire, la somme abstraite et, pour ainsi dire, la quintessence de ses idées politiques. On peut penser que Renan fut toujours antidémocrate, sauf à deux moments de sa vie », l’un de ces moments étant dans son Avenir de la science » ( La Gazette de France, 11 septembre 1902, in C. Maurras, Dictionnaire politique et critique, Paris, A. FAYARD et Cie, 1933, p. 384).34 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., pp. 199-204. Se référer à ces pages pour avoir l’essentiel des lettres et écrits de Henriette manifestant son désaccord avec cette union.35 Puisqu’en effet, Cornélie Scheffer était protestante et que les familles souhaitaient un mariage célébré sous les deux dogmes.
- 5 -
prénommé Ary. Malgré son succès, la bonne fortune du jeune auteur élu à l’institut à l’âge de
trente-trois ans, tourne rapidement. En effet, le 23 septembre 1861, alors qu’il est en voyage
d’étude en Syrie avec sa sœur, ils sont atteints d’une crise de paludisme dont cette dernière
succombera, l’injection de quinine n’ayant pas réussi à la guérir contrairement à son frère36.
La mort subite de sa sœur sera une tragédie pour Renan. Cette mort s’ajoute à celle
d’Ernestine Renan, la benjamine des enfants Renan née en 1859 qui décède la même année
qu’Henriette. Enfin, le 11 Janvier 1862 il est nommé professeur de langue hébraïque,
chaldaïque et syriaque au Collège de France. Il donne sa première leçon le 22 février qui va
faire scandale parce qu’il proclame que « Jésus "est un homme incomparable […]" ». Cela
engendre très rapidement un vif débat entre libéraux et catholiques, partisans de Renan et ses
détracteurs, ainsi que la suspension de son cours le 26 février.
Renan ne périclite pas pour autant, et finit la rédaction de la Vie de Jésus qui sera
publiée en 1863. Ce livre, qui est l’un des plus connu de Renan, sinon celui qui le fera
connaître auprès d’un plus large public, notamment étranger, lui permettra au moins d’asseoir
sa notoriété. C’est également l’ouvrage le plus critique qu’il ait écrit. En effet il l’utilise
comme arme contre ses détracteurs cléricaux, ce qui déclenchera les passions et consommera
la rupture (intellectuelle à tout le moins) entre Renan et les catholiques, mais aussi avec son
passé de séminariste et sa vie de scientifique37. Il formule aussi ses premières critiques contre
l’enseignement supérieur en France qui selon lui a décliné depuis Louis XIV. Il propose de le
réformer afin de faire venir de grands savants comme c’est déjà le cas dans les universités
allemandes38. Enfin politiquement, Renan éprouve en 1867 le même sentiment contradictoire
qu’il éprouvait en 1848 et en 1851 que nous avons précédemment évoqué. Il est notamment
préoccupé « par la défense des libertés publiques » d’un côté et « par les risques du suffrage
universel » d’un autre39. C’est pourquoi Renan penche pour une monarchie constitutionnelle
qui serait garante du développement des libertés publiques et préviendrait les risques du
suffrage universel, idée qu’il développera aussi dans La Monarchie Constitutionnelle en
France. C’est avec cette idée qu’il se présentera à la députation, mais il perdra les élections le
6 juin 186940.
Le 2 mars 1870, il est à nouveau élu au Collège de France, mais l’Impératrice Eugénie
refusera sa nomination. Renan part malgré tout en voyage vers le cercle polaire avec
l’Empereur et sa famille. C’est alors que la guerre éclate, après un ultimatum demandant
l’éviction d’un cousin du prince Guillaume comme prétendant au trône de France41. Renan
36 Ibid., pp. 268-269.37 Ibid., pp. 284-303.38 Ibid., pp. 310-311.39 Ibid., p. 333.40 Ibid., pp. 331-346. Pour plus de précisions sur le déroulement de la campagne, ses concurrents et ses idées, se référer à ces pages.41 Ibid., pp. 349-351.
- 6 -
rentre alors en toute hâte à Paris, et met à l’abri sa famille qu’il rejoindra plus tard. Pendant
toute la durée de la guerre et même après la défaite il soutiendra la pensée allemande et
plaidera pour la clémence de la part des vainqueurs afin que la France puisse se reconstruire et
s’allier avec eux. Mais cette position, qui prend sa source dans l’admiration que Renan porte
depuis le séminaire pour la philosophie allemande, va être balayée quand il comprend, avec la
publication des lettres à Strauss, les intentions bellicistes et impérialistes des allemands, qui
est la résultante de leur tentative d’unification menée par Bismarck42. La défaite de Sedan, et
la révélation de la vraie nature des intentions allemandes seront le ciment des ouvrages
ultérieurs de Renan, tels que La réforme intellectuelle et morale en 1871, Caliban en 1878 où
il se rallie, dit-on, à la République, ou encore ses conférences Qu’est-ce qu’une nation ?
prononcée en 1882 et Le Judaïsme comme race et comme religion prononcée en 1883 sur
lesquelles nous reviendrons plus tard. C’est aussi à cette période qu’il est enfin nommé
Professeur au Collège de France, le 17 novembre 1870, grâce à Berthelot qui avait approché
Jules Simon, alors ministre, et intercédé en sa faveur. Il rencontre aussi pour la première fois
l’Empereur du Brésil Don Pedro II, lors du voyage à Paris de ce dernier, qui dura du 15
décembre 1871 au 31 Janvier 187243. Les deux hommes sympathisent vite, d’autant plus
qu’ils ont les mêmes idées monarchistes44, ce qui permettra entre autres aux idées de Renan de
s’exporter au Brésil.
Autre preuve de sa renommée à l’étranger, c’est son voyage en Sicile le 24 septembre
1875, qui durera dix jours et pendant lequel il sera acclamé par la foule car, selon les éléments
que rapporte Jean-Pierre van Deth : « sa célébrité était immense en Sicile […] »45. La même
année, le 9 Juillet, Renan écrit une lettre dans laquelle il prône ce qui préfigurera les réformes
de l’enseignement supérieur. On constate que ce qui anime l’auteur, ce n’est pas la politique
mais l’indépendance d’esprit des universités46. C’est en partie parce qu’elle peut garantir cette
liberté dans l’enseignement supérieur, qu’il va se « convertir » à la République. On constate
également qu’il a longuement hésité durant la période 1871-1878, en fonction des divers
retournements politiques, entre une monarchie orléaniste et la République47. C’est en 1878,
42 Ibid., pp. 353-355.43 J. Balcou, « Renan et le Brésil », Ernest Renan et le Brésil, actes du colloque organisé par l’ERIMIT, université Rennes II octobre 2005 in Bulletin des études renaniennes, s.l, s.n, n° 111, janvier 2005, p. 16. Pour plus de détails sur toutes les relations, rencontres et interconnexions entre les deux hommes se reporter aux pages 14 à 18.44 « Même en politique les points de vue n’étaient pas si divergents tant Renan mit de temps à ne plus succomber au mirage monarchien et à ne plus se méfier du pouvoir populaire. Citons la lettre du 22 mars 1871, laquelle est une réponse à celle du 25 février de Don Pedro, où, à propos de La Réforme intellectuelle et morale de la France, […] Gobineau notait, une fois de plus, la perspicacité de son auguste destinataire à l’égard de Renan : "D’après l’opinion très juste que Votre Majesté s’est faite de lui et la vérité vraie qu’elle a comprise, Renan déteste la République et a une horreur profonde et instinctive aussi bien que raisonnée de tout ce qui est impiété. Les partis jacobins lui sont donc odieux"» (Ibid., p. 23).45 J.-P. Van Deth, Ernest Renan :…, op. cit., pp. 383-385.46 Ibid., pp. 395-396.47 Ibid., pp. 392-404. Pour plus de précision sur ces retournement de situation politique, se reporter aux pages mentionnées.
- 7 -
date à laquelle il est élu à l’Académie Française, qu’on considère qu’il se rallie à la
République, avec la publication de Caliban qui est vu comme une sorte « d’ode » au régime
républicain pour les uns, un reniement de sa vraie nature de monarchiste pour d’autres. Mais
le vieux philosophe ne se cachera jamais d’avoir soutenu le régime républicain sur le tard48.
Quatre ans après Caliban, il prononcera une conférence restée célèbre dont nous avons déjà
mentionné le nom : c’est Qu’est-ce qu’une nation ? Dans cette conférence prononcée en
Sorbonne le 11 mars 1882, Renan tente de définir ce qu’est, selon lui, une nation.
Succinctement, car cette définition sera explicitée ultérieurement, Renan estime que les
critères dit « objectifs » de la nation, comme la langue ou la race, ne peuvent être l’adjuvant
des individus qui se regroupent en nation. C’est pourquoi il explicite le premier ce qu’on
appelle les critères « subjectifs », car non tangibles. Il s’agit par exemple, de l’héritage
historique ou de la volonté de vivre ensemble, ce qu’il nomme le « plébiscite de tous les
jours »49. L’année suivante il prononcera une autre conférence devant le Cercle Saint Simon
intitulée Le Judaïsme comme race et comme religion. Les dernières années avant sa mort,
Renan publie quelques livres tels que L’histoire d’Israël achevé en 1891, et en critique
quelques uns comme les Huit jours chez M. Renan écrit par Barrès50. Il décède finalement le 2
octobre 1892 à 6 h 20 du matin, après une longue agonie.
L’étude de la biographie d’Ernest Renan nous a permis d’examiner l’évolution de sa
pensée. Mais pour mieux appréhender l’originalité de sa définition de la nation, et ainsi cerner
notre sujet, il convient de l’expliciter. La définition du philosophe s’oppose à ce que l’on
appelle communément la « conception allemande » de la nation, que l’on peut également
appeler « conception objective ». On la qualifie d’allemande car elle a été initialement établie
par des philosophes d’Outre-Rhin tels que Herder ou Fichte. On peut utiliser les textes de ce
dernier51 pour mieux aborder cette conception. Dans ses Discours à la Nation Allemande,
série de conférences prononcées en 1807 après la victoire napoléonienne et publiées par la
suite, Fichte (1762-1814) base sa définition sur trois critères. Le premier c’est la race, ou ce
que nous appellerions aujourd’hui l’origine ethnique : « Quand on les considère [les
individus] comme un peuple, ils sont un peuple originaire, ils sont tout simplement le peuple,
des Allemands. Tous ceux qui se résignent à être quelque chose de second, de dérivé, […]
considérés comme peuple, ils sont extérieurs au peuple originaire ; pour celui-ci, ce sont des
inconnus et des étrangers »52. De cette phrase sibylline il faut comprendre qu’un peuple
48 « Je suis bien un républicain du lendemain, ce qui n’empêche pas que je crois être un ami sincère de la République » (E. Renan, Lettre à D. Rebité, 29 décembre 1878, Œuvres Complètes, Paris, Calmann-Lévy, 1947-1961, t. 10, p. 787).49 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 75.50 M. Barrès, Huit jours chez M. Renan, Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. SANTOS et Cie, éd. 4e, 1904.51 J. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation, Siebente Rede, dans Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke, Hrsg. Von I. H. Fichte, Berlin, Veit & Comp., 1845-1846, Band VII, p. 372-375 ; trad. fr. Patrice Canivez in P. Canivez, Qu’est- ce que la nation ?, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2004, pp. 87-90.52 P. Canivez, Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., pp. 89-90.
- 8 -
source, les germains, dont les successeurs en droite ligne sont les allemands, s’est disséminé
en Europe mais qu’à un moment de l’histoire, des individus de ce peuple se sont constitués en
peuple autonome. Dès lors, pour définir un allemand, il faut qu’il soit l’héritier de ces
germains et qu’il se reconnaisse comme appartenant à ce « peuple originaire », c’est-à-dire à
cette race. Les autres, qui ont fait scission ou qui ne sont pas issus de ce peuple (les peuples de
langue sémitique, les peuples de langue latine) c’est-à-dire issus d’une autre race, sont alors
des étrangers. Le second critère est celui de la langue avec une particularité sur laquelle nous
reviendrons : « Celui qui croit à la spiritualité et à la liberté de cette spiritualité, et veut le
perfectionnement éternel de cette spiritualité par la liberté, celui-là, où qu’il soit né et dans
quelque langue qu’il parle, est de notre espèce, il nous appartient et il se joindra à nous. Celui
qui croit en l’immobilité, à la régression, […] quelle que soit la langue qu’il parle, n’est pas
allemand. C’est un étranger pour nous »53. On comprend ici que Fichte réfute une idée
communément admise par les théoriciens allemands de la nation, et qui perdure encore
aujourd’hui quand on présente la « conception allemande », qui est l’importance de la langue.
Fichte estime alors que la volonté des étrangers issus du peuple originaire de revenir bâtir
l’Allemagne, prime sur la langue. Mais la position de Fichte, qui inclut l’élément subjectif
qu’est la volonté, sera minoritaire. En effet, quand Bismarck voudra réaliser l’unité
allemande, face à des duchés protestants et catholiques, dirigés par des princes différents, il ne
lui reste pour rassembler le peuple, que l’idée d’une race et d’une langue commune. Enfin,
Fichte introduit le critère de l’Histoire : « C’est donc la source de toutes ses pensées et
jugements ultérieurs sur son espèce, considérée dans son passé, l’histoire, dans son avenir, les
attentes à son égard, et dans son présent […] » 54. Ce critère théoriquement subjectif, est ici
« objectivisé » par sa relation avec la race. En effet, comme nous l’avons vu avec les extraits
précédents, tous les peuples seraient issus du peuple germain originel. Ceux qui s’en sont
séparés ont créé leur propre histoire qui en réalité, contribue à l’histoire du peuple germain et
de ses descendants, le peuple allemand, si bien que s’ils veulent accepter cet état de cause et
revenir dans le giron de la France, ils le peuvent. On peut penser que Fichte était de bonne foi
quand il prononçait ces mots et qu’il ne développait pas les mêmes idées que l’interprétation
dérivée que nous venons de livrer ici. Pourtant, c’est bien ce que retiendront les penseurs
allemand de la fin du XIXe siècle, qui utiliseront alors ces arguments pour justifier le
rattachement de l’Alsace Moselle à l’Empire Austro-hongrois, comme le constate Renan dans
sa Lettre A M. Strauss : « Vos germanistes fougueux allèguent que l’Alsace est une terre
germanique, injustement détachée de l’Empire Allemand »55. Mais citer Fichte pour illustrer
cette pensée « allemande » était plus intéressant que de citer un autre auteur, car sa pensée est
53 Ibid., p. 90.54 Ibid., p. 88. Ici le critère de l’histoire sera entendu comme un critère faussement subjectif, et non comme un critère objectif tel qu’il est entendu à l’entrée « Nation » dans le dictionnaire de P. Raynaud (dir.), S. Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996, p. 411.55 E. Renan, « Lettre A M. Strauss, 13 septembre 1870 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, Paris, Calmann-Lévy, 1947, t. 1, p. 445. Renan reprend cette même idée dans sa conférence Qu’est-ce qu’une nation ?. Voir E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 61.
- 9 -
relativement proche de celle de Renan, si on la compare à celle d’Herder par exemple56. La
définition renanienne de la nation est donc la suivante : tout d’abord, Renan écarte les critères
dit « objectifs » car il considère qu’on ne peut fonder une nation sur ces notions qui ne sont
pas stables, intemporelles, on pourrait presque ajouter, qui ne sont pas « universelles » au sens
que lui donne la philosophie. Ainsi « De nos jours, on commet une erreur plus grave : on
confond la race avec la nation […] »57, une erreur car « la vérité est qu’il n’y a pas de race
pure et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une
chimère. Les plus nobles pays, […] sont ceux ou le sang y est le plus mêlé »58. Ainsi, ce qu’on
appelle vulgairement la « fusion des races », empêche un peuple de se prévaloir d’une origine
ethnique certaine. Il faut aussi écarter la langue pour fonder une nation, car « la langue invite
à se réunir ; elle n’y force pas. […] l’Amérique espagnole et la France parlent la même langue
et ne forment pas une seule nation. Au contraire, la Suisse, si bien faite parce qu’elle a été
faite par l’assentiment de ses différentes parties, compte trois ou quatre langues »59. Si Renan
relève en fait cette particularité, qui pourtant aujourd’hui divise le pays pris en exemple par
lui, c’est que des nations peuvent se constituer alors qu’elles sont polyglottes, ce qui récuse
dans les faits la théorie allemande selon laquelle la langue fonde une nation. Ce qu’il dit de la
langue, il le constate aussi dans la religion : « de nos jours, la situation est parfaitement claire.
Il n’y a plus de masses croyant d’une manière uniforme »60. Il rejette aussi les intérêts
(entendu ici plutôt au sens commercial du terme) en affirmant qu’ « un Zollverein n’est pas
une patrie »61, et la géographie qui est un critère pouvant se modifier au gré des invasions et
des revendications62. Si la nation n’est pas tout cela, on peut alors légitimement s’interroger
sur ce qu’elle est. En fait, selon Renan, c’est « une âme, un principe spirituel. Deux choses
qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le
passé, l’autre est dans le présent. L’une est la possession d’un riche legs de souvenirs ; l’autre
est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir
l’héritage qu’on à reçu indivis »63. Dans cette partie de la conclusion, Renan annonce les deux
critères qui fondent selon lui la nation : l’histoire que les peuples ont reçue en héritage de
leurs ancêtres, et la volonté de vivre ensemble, qu’il appelle un peu plus loin le « plébiscite de 56 H. Beaudin, L’idée de nation, Thèse, Philosophie, Paris IV, 2013, pp. 190-191, pp. 195-196 et p. 201. Hervé Beaudin partage l’idée d’Alain Renaut selon laquelle Fichte était proche de la pensée de Renan puisqu’en fait, il rejetterait à la fois les Lumières et le romantisme allemand. Ainsi « Fichte aurait-il d’avantage complété Renan que Herder […] » selon monsieur Beaudin. Puis dans sa note il explique : « Par anticipation inconsciente, naturellement, compte tenu de la postérité de l’historien de Tréguier sur le philosophe d’Iéna ». On peut accepter cette analyse un peu développée par Patrick Canivez dans Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., pp. 91-105., parce qu’on sait que Renan connaissait les œuvres de Fichte, qu’il cite dans E. Renan, « Lettre A M. Strauss, 13 septembre 1870 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, op. cit., p. 448 : « votre admirable Fichte […] ».57 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 50. La phrase continuant par : « et l’on attribue à des groupes ethnographiques ou plutôt linguistiques une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants ».58 Ibid., p. 63.59 Ibid., pp. 67-68.60 Ibid., p. 71.61 Ibid., p. 72 . Une note nous explique qu’un Zollverein est une « union douanière et commerciale formée par une majorité des Etats de la confédération allemande en 1833-1834 ».62 Ibid., pp. 72-74.63 Ibid., p. 74.
- 10 -
tous les jours »64. Ce plébiscite a pour pivot cette histoire autour de laquelle tous se
rassemblent, avec pour objectif commun de faire fructifier cet héritage. C’est ainsi qu’il
résume la nation, en l’inscrivant dans une échelle temporelle : « Avoir des gloires communes
dans le passé [l’histoire], une volonté commune dans le présent [le plébiscite de tous les
jours] ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore [L’envie de progrès
commun], voilà les conditions essentielles pour être un peuple »65. Ce sont les fameux critères
« subjectifs » de la Nation, qui sont abstraits, et plus malléables que ceux dit objectifs. Ces
deux définitions, bien que la dernière semble plus intemporelle que la première, doivent être
replacées dans le contexte particulier du XIXe siècle.
Le XIXe siècle est effectivement riche en évènements qui auront une influence sur
Renan ou l’interprétation que l’on fera de ses travaux. Tout d’abord les Allemands
connaissent l’invasion des français après les victoires napoléoniennes, ce qui les pousse à
s’interroger sur le concept de nation. Suite à la chute de l’Empire après les « Cent-Jours » et
l’échec de « la benjamine »66, la Restauration, qui avait été interrompue par cette courte
résurgence de l’Empire, peut enfin s’installer et faire appliquer la Charte constitutionnelle du
4 juin 1814, en vigueur avant cette parenthèse67. Cette Restauration, amènera une idée
nouvelle, celle de légitimité et dans la prolongation de celle-ci, le courant légitimiste, qui se
réclame des descendants directs des anciens Bourbons régnants. René Rémond, exprime cette
idée en expliquant qu’avant 1789, personne ne contestait le régime. Mais parce que le peuple
s’est soulevé et que la Révolution a eu lieu, le retour à la monarchie doit en quelque sorte se
justifier, si bien qu’on tente de le légitimer. C’est pourquoi « tout au long du XIXe siècle, le
principe de légitimité va sous-tendre la pensée contre-révolutionnaire, la politique des régimes
conservateurs et les efforts de certaines écoles politiques pour restaurer, à l’encontre du
mouvement de l’histoire, les institutions héritées de l’Ancien Régime »68. Cette période voit
apparaître deux grands courants de pensée. D’un côté les libéraux, qui restent attachés à la 64 Ibid., p. 75.65 Ibid., pp. 74-75. Comme annoncé dans l’exposé de la pensée de Fichte, on constate la proximité de la pensée des deux auteurs, cette phrase étant presque un calque de celle de Fichte dans le Discours à la Nation Allemande que nous avons cité plus haut et dont la référence se trouve sous la note 61.66 Les « Cent-Jours » sont le retour de Napoléon en France qui a quitté l’Île d’Elbe entre le 1er mars 1815 et le 21 juin 1815. « La benjamine » quant à elle, est le nom donné à l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire du 22 avril 1815, en raison du nom de son auteur, Benjamin Constant, dont certains estiment qu’il s’agit d’un bon mot fait avec le nom de l’auteur en raison du peu de temps que cet acte trouva à s’appliquer.67 Pour un bref mais concis résumé du mécanisme de cette Charte, se référer à P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Orléans, Paradigme, éd. 14e, 2008-2009, pp. 143-144.68 R. Rémond, « Le XIXe siècle : 1815-1914 », Introduction à l’histoire de notre temps, Paris, Le Seuil, 1974, t. 2, pp. 12-13. Nous ferons principalement référence à cet ouvrage, mais pour la période de la Restauration, on peut compléter l’analyse avec les ouvrages suivants : S. et P. Coquerelle, Les débuts de l’époque contemporaine : 1789-1848, Paris, Hatier, 1960. Il faut plus précisément se reporter aux chapitres 17 pour le contexte politique, social et industriel au niveau mondial ; 19 pour avoir le contexte social et politique de la Restauration et 21 pour la montée du nationalisme entre 1815 et 1840. Enfin, J. Droz, De la Restauration a la révolution : 1815-1848, Paris, Armand Colin, 1970. Cet ouvrage traite de la période à l’échelle européenne et mondiale, mais on trouve beaucoup d’éléments sur la philosophie de la Restauration (chapitre 1), sur l’évolution économique (chapitre 2) et aussi sur la Charte de la Restauration et le contexte dans lequel elle s’inscrit (chapitre 5, pages 107 à 122).
- 11 -
Révolution et tentent d’aller jusqu’au bout de ce qu’elle a entrepris en ne reconnaissant pas les
traités de 181569. De l’autre, les ultras, qui prônent une restauration intégrale, qui considèrent
la Révolution et ses conséquences comme une catastrophe et qui, comme la Révolution a
voulu faire table rase du passé monarchiste, entendent faire table rase de la Révolution70. Ce
régime s’éteint avec Charles X, qui maintiendra un ultra, Jules de Polignac, comme chef du
gouvernement, et fera voter des lois restrictives de liberté, notamment vis-à-vis de la presse,
ou encore redéfinissant le calcul du cens afin de favoriser les ultras dont il est proche. Ceci
déclanchera les « Trois Glorieuses » des 27, 28 et 29 juillet 1830, à la suite desquels Charles
X abdiquera en faveur de Louis-Philippe d’Orléans qui instaurera la « Monarchie de
juillet »71. Ce régime, sous lequel Renan fera toutes ses études ecclésiastiques, se veut plus
libéral que le précédent72. Mais Louis-Philippe, à l’instar de Charles X, va lui aussi peu à peu
essayer de paralyser les institutions pour régner en monarque plus ou moins absolu73, si bien
que le 24 février 1848, une nouvelle révolution éclate. Rappelons que c’est à ce moment que
Renan envisage son Avenir de la science, qu’on peut donc supposer influencé par les idées
républicaines qui soutiennent cette révolte ouvrière. Le régime de la Seconde République, qui
décevra Renan et le convaincra de se tourner vers les courants monarchistes, va être de courte
durée. Il va être remplacé par le Second Empire dès le 2 décembre 1851, avec le coup d’Etat
réalisé par Louis Napoléon Bonaparte. C’est sous cette République éphémère et sur toute la
période du Second Empire naissant, que se propage une idée nouvelle : le communisme. En
effet aux ultras et aux libéraux vont s’ajouter les communistes, dont la doctrine est expliquée
de manière simple dans le Manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels et publié
en février 184874. Cette doctrine, qui se veut historique et scientifique, explique qu’il y a une
superstructure composée des lois, de la religion ou encore des institutions politiques, qui
servirait d’instrument de domination aux bourgeois qui entretiendraient les prolétaires, c’est-
à-dire les ouvriers pauvres, dans un état de dépendance. Mais, pour les auteurs, comme le
montre l’évolution historique75, le prolétariat se soulèvera et renversera la bourgeoisie pour 69 Ibid., pp. 19-20.70 Ibid., p. 19.71 P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 144.72 R. Rémond, « Le XIXe siècle : 1815-1914 », op. cit., p. 35. Pour plus de précisions sur la Monarchie de Juillet S. et P. Coquerelle, Les débuts de l’époque contemporaine : 1789-1848, op. cit., pp. 346-363 ; J. Droz, De la Restauration a la révolution […], op. cit. Mais aussi J. Chastenet, Une époque de contestation : La monarchie bourgeoise (1830-1848), Paris, Librairie Académique Perrin, 1976. Ce dernier est le plus complet sur le sujet.73 P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., pp. 145-146. Sur la Révolution de février, se référer à A. Crémieux, La Révolution de Février : Etude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24 Février 1848, Genève, Mégariotis Reprints, réimpression de l’édition de 1912.74 K. Marx et F. Engels, Manifeste du Parti communiste, Paris, Edition Générale Française, 1973. Cette version publiée en livre de poche est particulièrement intéressante, car on y trouve adjoint la Critique du programme de Gotha, texte ultérieur et une introduction faite par François Châtelet, qui explique le contexte dans lequel ce manifeste a été rédigé, et développe ce que Marx et Engels ont fait après les révolutions de 1848 et avant la Critique du programme de Gotha. Car la France n’a pas été la seule touchée par une révolution et rappelons par exemple, la modification constitutionnelle de Charles-Albert qui fait appliquer un texte copiant, en la remaniant, la Charte de 1830 dans le Piémont.75 Ibid., pp. 51-68. C’est l’exemple des premières pages, sur le rapport entre citoyens romains et esclaves ainsi que seigneurs féodaux et serfs. Mais finalement on note une évolution dans ces rapports qui ont conduit au rapport Bourgeois/Prolétaires. Dans la suite du chapitre premier il explique comment les Bourgeois se sont
- 12 -
réaliser sa destinée historique. Une fois le pouvoir pris par les prolétaires, l’Etat devient un
organe transitoire destiné à disparaître de lui-même et alors naîtra le communisme. Ce
courant, contre lequel Renan se place en 1848, aura une influence grandissante tout au long du
XIXe et du début du XXe siècle, créant des crises et des détracteurs de la pensée renanienne.
Le Second Empire a les prétentions du premier, mais ne réussira pas à les réaliser. La défaite
de Sadowa76 porta un premier coup au régime qui s’aperçut que le système éducatif allemand
avait contribué à la victoire. Mais le coup de grâce vint après la défaite de Sedan. Le clivage
entre monarchistes et républicains va alors se cristalliser autour du nouveau régime naissant
qui sera la Troisième République, mise en place par les lois constitutionnelles de 1875, et
autour de la perte de l’Alsace Moselle. C’est à cette période que Renan nous l’avons vu, passe
du courant monarchiste avec La Réforme intellectuelle, au courant républicain avec Caliban,
et surtout, fait évoluer ses théories sur la race, la langue et la religion pour créer un concept de
nation dégagé de ces entraves, afin de dénoncer l’annexion forcée de l’Alsace Moselle au IIe
Reich77. Ce régime acta des lois qui se voulaient progressistes, comme la loi Jules Ferry
portant sur l’école laïque et obligatoire en 1881, plus tard, la séparation de l’Eglise et de l’Etat
en 1905 ou la loi sur les associations de 1091. Mais ce fut aussi le régime de la colonisation et
des scandales comme celui de Panama. Renan décédera avant la fin du régime, mais ce
dernier n’oubliera pas l’auteur Breton pour autant.
Ce contexte, riche en découvertes et en évènements, tout comme la définition apportée
par Renan aux débats sur la nation, nous paraissent bien lointains. Pourtant, le contexte actuel
est tout aussi riche, et place au cœur des débats contemporains, la question de la nation et de
sa définition. En effet, nous avons connu une décolonisation qui s’est étalée sur toute la
seconde moitié du XXe siècle. L’immigration croissante78, associée à un fort taux de
chômage, font naître le ressentiment de la population vis-à-vis de ceux qu’elle ne reconnaît
pas comme faisant partie de la nation, parce qu’ils ont une origine ou une religion différente79.
Il faut ajouter à cela le constat que la mondialisation, qui aurait du créer un mouvement
transcendant les nations, a au contraire renforcé le nationalisme et les revendications
arrogé ce pouvoir et comment ils ont réussi à couper l’ouvrier de son travail.76 Pour les détails de cette bataille : J. Tulard (dir.), Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995, entrée « Sadowa », pp. 1152-1153.77 Sur cette idée et ce contexte voir l’introduction de Shlomo Sand in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 27-30. M. Thom, « Tribes within nations : the ancient Germans and the history of modern France », in H. K. Bhabha (dir.), Nation and narration, London, Routledge, 1990, pp. 23- 43.78 C. Tavan, « Les immigrés en France : une situation qui évolue », INSEE Première, 2005, n° 1042. Cet article consultable en ligne via le site www.insee.fr, montre l’évolution constante de l’immigration en France entre 1962 et 1999, et propose une analyse de l’intégration de ces immigrés dans la société. 79 En effet, dans l’article de G. Courtois, « Les crispations alarmantes de la société française », Le Monde, 24 Janvier 2013, on constate en se basant sur un sondage de l’Insee, que 70% des interrogés trouvent « qu’il y a trop d’étrangers en France », et 62% qu’ « on ne se sent plus chez soit comme avant ». Et dans celui de S. Le Bars, « La religion musulmane fait l'objet d'un profond rejet », Le Monde, 24 Janvier 2013, on constate que 74% des sondés considèrent la religion musulmane comme intolérante.
- 13 -
nationales80. Ainsi, alors que le contexte actuel est riche en évènements qui imposent un
nouveau débat sur le concept de nation, on peut légitimement s’interroger sur la place
qu’occupe Ernest Renan et sa définition dans ces discussions.
Cependant, il est difficile de retracer pratiquement cent soixante-cinq ans d’Histoire,
en partant de l’émancipation intellectuelle de Renan en 1848 jusqu’à nos jours, de même qu’il
est difficile de ne se concentrer que sur les dix ou les vingt dernières années parce que cela
reviendrait à ignorer le contexte dans lequel s’est forgée son idée et son cheminement jusqu’à
nos jours. Qui plus est, plus on avance dans le temps, plus il est difficile de trouver des
références directes pertinentes sur le travail de l’auteur. Enfin, non seulement la majorité des
travaux sur Renan traitent de ses travaux sur la religion et les langues, mais en plus les
quelques travaux sur le « Renan politique » portent sur sa place au XIXe siècle.
L’enjeu n’est donc pas de faire un pandectes des ouvrages traitant de la place de
l’auteur au XIXe tel qu’on la voit de nos jours, mais de constater que dès la mort de Renan on
assiste à une récupération politique puis à un oubli de l’auteur, oubli relatif qui se perpétue
aujourd’hui dans la classe politique et dans les travaux sur la nation (Partie 1). Ce constat
permettra alors de constater que les travaux minoritaires découlant du prisme selon lequel on
perçoit l’auteur, soulèvent de nouvelles questions tout en en taisant d’autres auxquelles nous
tenterons de trouver une réponse (Partie 2).
80 A. Dieckohff, La Nation dans tous ses Etats, op. cit., pp. 20-21 et p. 23. L’auteur résume sa pensée ainsi : « Autrement dit le nationalisme se trouverait dépassé par l’évolution de l’histoire mondiale. […] comment expliquer, a contrario, la concomitance entre l’approfondissement graduel de la mondialisation et l’essor des revendications nationalistes ? ». Cette idée est partagée par Jean-Pierre Rioux dans La France perd la mémoire, Paris, Perrin, 2010, pp. 7-9.
- 14 -
PARTIE 1 : LE CONSTAT DE L’OUBLI DE LA NATION RENANIENNE
Ernest Renan était un des auteurs les plus influents, mais aussi peut être un des plus
prolixes de son temps, si bien que Laurent Theis le qualifie de « pontife pachydermique aux
grâces désuètes »81. Le mot « désuet », utilisé par Laurent Theis, est très révélateur. En effet,
cet auteur à l’œuvre littéraire conséquente, semble être peu à peu tombé en désuétude, oublié
de tous et relégué au rang des auteurs dont on ne se rappelle l’existence que quand on
emprunte les rues qui portent leurs noms. C’est en tout cas ce que constatent certains
chercheurs, qui montrent que Renan fut récupéré par les courants politiques de la fin du XIXe
et au début XXe siècle avant d’être finalement abandonné par eux (Chapitre 1). Depuis, les
choses ne semblent pas avoir changé. A l’exception d’événements politiques particuliers, il
semble que l’auteur ait disparu du paysage social, politique et universitaire, bien que ce
constat puisse être nuancé (Chapitre 2). En réalité, le fait que l’auteur soit aujourd’hui
largement oublié s’expliquerait par la caducité d’une partie de la définition renanienne de la
nation (Chapitre 3).
Chapitre 1 : La liquidation de l’héritage intellectuel renanien et sa dissolution entre ses
héritiers politiques
Peu de travaux ont étés consacrés à l’analyse de la récupération politique de l’auteur
breton. Les deux plus importants sont les thèses de Maurice Gasnier sur La destinée posthume
de Renan de 1892 à 1923 : essaie sur une réception idéologique, et d’Edouard Richard Ernest
Renan, un penseur traditionaliste ?, plus précisément en sa troisième partie. Les deux auteurs
tombent d’ailleurs d’accord car l’un affirme que « l’héritage intellectuel de Renan est en effet
caractérisé par la diversité des courants politiques dont ses héritiers se portent fort »82, et
l’autre parle du « renanisme, que nous pourrons définir comme l’ensemble des interprétations
abusives de la pensée de Renan, mieux : la récupération d’une œuvre savante à des fins
partisanes »83. Ces deux ouvrages et quelques autres moins conséquents, donnent un bon
aperçu du détournement des idées de Renan en fonction des sensibilités politiques. Dès lors,
après avoir analysé la récupération par la droite monarchiste et nationaliste (Section 1), il
conviendra de se pencher sur celle faite par ce qu’on appelle par convention la « gauche
républicaine », et la gauche socialiste et communiste (Section 2).
81 L. Theis, « Rubrique littéraire », Nouvel Observateur, décembre 1992, p. 132.82 E. Richard, Ernest Renan : un penseur traditionaliste ?, Aix-Marseille, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 1996, p. 307.83 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : essai sur une réception idéologique, Thèse, Lettres, Brest, 1998, p. 4.
- 15 -
Section 1 : La succession de la droite monarchiste et nationaliste
Il apparaît évident à beaucoup d’auteurs que Renan doit être classé dans les courants
de droite du XIXe siècle. C’est le constat que font Edouard Richard et Jean-François Sirinelli,
le premier en affirmant que « la pensée de Renan paraît avoir chronologiquement plus de
poids à droite (celle-ci la réclamant jusqu’à la période vichyste) qu’à gauche […] »84, et le
second en intégrant Renan dans son triptyque Histoire des droites en France et en en faisant
une sorte de « père fondateur spirituel » d’une partie (si ce n’est de toute) de la droite
française du XIXe siècle à nos jours85. Il convient alors de constater qu’effectivement les
idées de l’auteur, notamment les idées monarchistes, ont étés récupérées par une fraction de la
droite (§1), mais qu’une autre n’a pas réussi à surmonter son aversion pour l’auteur qui
critiqua l’Eglise catholique, et qu’ainsi, après avoir récupéré des bribes de l’idée renanienne
de nation sans l’affirmer ouvertement, la droite dans son ensemble a oublié l’auteur (§2).
§ 1 : La récupération des idées monarchistes de Renan
Avant de montrer comment la droite française a fait sienne certaines idées de Renan, il
convient de déterminer si ce dernier était ou non effectivement proche des différents courants
de droite de son époque86. En premier lieu, il faut noter que Renan écrivait dans des journaux
et dans des revues monarchistes à tendance orléaniste, notamment Le Journal des Débats87, ou
encore la fameuse Revue des Deux Mondes88. Toujours dans le domaine littéraire, Jean-Yves
Mollier estime qu’on peut classer les éditeurs en fonction de leurs tendances politiques. Celui-
ci remarque alors que « Michel Lévy, [est un] orléaniste notoire »89. Or Michel Lévy n’est
autre que l’éditeur de Renan, et ce jusqu’à la mort de l’auteur, qui lui était resté fidèle malgré
84 E. Richard, Ernest Renan : un penseur traditionaliste ?, op. cit., p. 307.85 J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992. Ce travail collectif se compose de trois tomes : 1. Politique ; 2. Culture ; 3. Sensibilité. Pour le premier tome, nous utiliserons la réédition du texte de 1992 sous un nouveau titre : Les droites françaises : De la Révolution à nos jours.86 Ici, nous nous référerons, par souci de simplicité, aux ouvrages dirigés par J.-F. Sirinelli, mais pour compléter l’analyse, il faut se reporter aux thèses d’E. Richard et M. Gasnier citées en préambule, ainsi qu’à certains textes de Renan comme La Réforme intellectuelle et morale ou La monarchie constitutionnelle en France.87 « La droite Orléaniste dispose, pour distiller ses idées, de relais importants dans la société cultivée. Le Journal des Débats réunit une pléiade remarquable de journalistes, d’écrivains et surtout d’universitaires sous la direction de Silvestre de Sacy (qui se rallia dans les années suivantes) ; Cuvillier Fleury, ancien précepteur du duc d’Aumale, Saint-Marc Girardin, Laboulaye, Taine, Renan, Littré, […]. L’opposition du Journal des Débats demeure toutefois feutrée pour ne pas encourir la censure et elle se borne à la défense de l’Université et de la liberté des cultes. Le journal n’en est pas moins une puissance morale au début de l’Empire » (B. Ménager, « Autorité ou liberté », Les droites françaises : De la Révolution à nos jours, J.-F. Sirinelli (dir.), Paris, Gallimard, 1992, p. 259).88 O. Corpet, « La revue » J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures », pp. 174-176. Quant à la Revue des Deux Mondes, elle est elle aussi un vecteur des idées de droite. Or, on note que Renan y contribue : « On ne compte plus les collaborations importantes et suivies d’auteurs aussi différents que Renan, Mérimée, […] ».89 J.-Y. Mollier, « L’édition. 1815-1914 », J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures », p. 228.
- 16 -
la reprise de l’affaire par Calmann, le frère de Michel, après le décès de ce dernier90. La
coïncidence ne s’arrête pas ici puisque sorti du monde de l’édition et du journalisme, Renan
fréquentait des salons, dont un doit particulièrement retenir notre attention. En effet l’auteur
aurait été fréquemment invité à dîner par la comtesse de Loynes (une des faveurs les plus
attendues de ce salon), dans ce que Pascal Ory estime être « le plus célèbre, le plus commenté
et le plus avéré des salons de droite et [de] l’histoire contemporaine française […] »91.
Au-delà de ses accointances avec le milieu orléaniste, Renan exprime ouvertement ses
penchants plus généralement monarchistes dans certains de ses ouvrages. Premièrement, rien
que le titre La monarchie constitutionnelle en France annonce la teneur des idées développées
dans ce livre, et plus largement, celles de l’auteur. Ensuite, on trouve dans La Réforme
intellectuelle et morale, plusieurs idées monarchistes. La première est l’idée d’anti-
républicanisme ou contre-révolutionnaire de l’auteur, qui affirme qu’ « énervée par la
démocratie, démoralisée par sa prospérité même, la France a expié de la manière la plus
cruelle ses années d’égarement »92, sous entendu ses années post-révolutionnaires. Il va
jusqu’à affirmer que « le jour ou la France coupa la tête de son roi, elle commit un suicide »93
et que « la démocratie fait notre faiblesse militaire et politique ; elle fait notre ignorance, notre
sotte vanité […] »94. A cela s’ajoutent d’autres critiques de la démocratie et incidemment, des
républicains, défenseurs de ce système. La seconde idée, est l’affirmation ouverte de sa
sympathie pour le système monarchique. Il le fait à plusieurs reprises, mais la phrase la plus
éloquente est la suivante : « Corrigeons nous de la démocratie. Rétablissons la royauté,
rétablissons dans une certaine mesure la noblesse […] »95. Cependant, cette affirmation qui
semble, à la lumière de la première partie de l’ouvrage, refléter la pensée de Renan, doit être
appréciée avec circonspection. Car l’auteur sème le doute en faisant tenir ces propos
monarchistes par un personnage, qu’il définit comme le « bon esprit et un bon patriote, plus
jaloux d’être utile à ses concitoyens que de leur plaire »96, et dont les propos sont nuancés par
le « très-honnête citoyen » qui, admettant que la démocratie et la République ne sont pas des
concepts politiques parfaits, ou en tout cas pas aussi parfait que la Monarchie, affirme que
c’est peut être la vocation de la France que de se différencier par ce système et de prendre
ainsi une revanche originale sur l’Allemagne plutôt que de la copier97. De la confrontation de
ses deux personnages, Renan se place en retrait après toutes les critiques qu’il exprime à
l’encontre du régime démocratique en disant : « Peut-être, en effet, le parti qu’a pris la France
90 Pour les relations entre Renan et son éditeur, voir H. Silvestre, « Ernest Renan et ses éditeurs Michel et Calmann Lévy. A propos d’un livre récent », Revue belge de philosophie et d’histoire, v. 65, n° 65-2, 1987, pp. 301-312.91 P. Ory, « Le salon », J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures », pp. 121-122.92 E. Renan, La Réforme intellectuelle et morale et autres écrits, textes choisis et commentés par Alain de Benoist, Paris, Albatros/Valmonde Editeur, 1982, p. 24.93 Ibid., p. 27.94 Ibid., p. 54.95 Ibid., p. 54.96 Ibid., p. 54.97 Ibid., p. 62. En la copiant signifie en restaurant une monarchie et en appliquant la politique Bismarckienne.
- 17 -
sur le conseil de quelques hommes d’Etats qui la connaissent bien, d’ajourner les questions
constitutionnelles et dynastiques est-il le plus sage. Nous nous y conformons »98. Or cette
mise en retrait de l’auteur qui peut semer un doute dans l’esprit d’un lecteur attentif, peut
passer inaperçue lors d’une lecture rapide ou orientée, voire, être minorée ou détournée à des
fins partisanes. C’est précisément ce qu’ont fait certains auteurs, particulièrement Charles
Maurras.
Né à Martigues le 20 Avril 1868, Charles Maurras fut un des grands représentants de
la droite royaliste et monarchiste en France, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. A tel
point que certains ont put dire de lui qu’il avait « longtemps exercé une véritable hégémonie
intellectuelle sur la pensée royaliste, […] » en étant le « créateur d’une synthèse politique
originale où le royalisme prétend couronner le nationalisme, […] »99. Le directeur de l’Action
Française, quotidien nationaliste fondé en 1908, estime dans un article publié le 12 mars 1923,
que « la pensée de Renan n’a eu d’importance qu’en matière religieuse »100. Pourtant, il est
indéniable que l’auteur breton ait influencé l’auteur provençal, notamment sur les idées
monarchistes101. Maurras reconnaît d’une part, l’influence que le breton a eue dans la critique
contre-révolutionnaire : « Il reste à constater que Renan a dressé une critique rigoureuse de la
Révolution et de la démocratie. Eussions nous dû la négliger, nous ne l’aurions pas pu : un
certain nombre d’entre nous étaient venus à la contre-révolution précisément par la voie de
cette critique. […] »102. D’autre part, bien qu’il critique Renan sur ses sensibilités plus
germanistes que romanistes103, on peut considérer qu’il admet l’influence de Renan sur sa
pensée et qu’il estime que l’auteur de la Réforme intellectuelle et morale devrait être lu par
tous, comme il l’exprime dans le journal Soleil du 3 mai 1901 : « Qu’on relise si on en doute
la réforme intellectuelle et morale de la France. […] le nationalisme devrait en faire son
aliment quotidien »104. Dès lors, il ne fait plus aucun doute que Maurras voit Renan comme un
antidémocrate et un monarchiste : « Le livre de la Réforme intellectuelle et morale […] 98 Ibid., p. 63.99 Ces extraits sont tirés du travail de F. Bouscau, Maurras et la pensée contre-révolutionnaire, Paris, Action Familiale et Scolaire, 2009, p. 3. Cet ouvrage contient aussi une courte biographie de l’auteur provençal à laquelle nous renvoyons pour avoir de plus amples informations sur celui-ci. Pour des éléments biographiques plus exhaustifs, nous renvoyons aux trois ouvrages cités par Monsieur Bouscau : Y. Chiron, La Vie de Maurras, Paris, Perrin, 1991. H. Massis, MAURRAS et notre Temps, Paris-Genève, La Palatine, 1951, t. 2. E. Vatré, Charles MAURRAS, Un Itinéraire spirituel, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1978. Enfin, nous renvoyons aussi à l’ouvrage de P. Boutang, MAURRAS : La destinée et l’œuvre, Paris, Plon, 1984.100 C. Maurras, Dictionnaire politique et critique, op. cit., p. 382.101 C’est ce que pense M. Gasnier par exemple dans La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : […], op. cit., p. 312. Mais aussi H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 149.102 C. Maurras, Dictionnaire politique et critique, op. cit., p. 382. Et la phrase se poursuit par « Pour un peuple qui a besoin de toutes les forces et de toutes les lumières afin d’ouvrir les yeux et de parvenir à voir clair, comment négliger ce secours ? En annonçant aux Français démocrates ou libéraux les vérités antidémocrates et anti-libérales, comment se priver de l’ascendant décisif contenu dans la simple déclaration de cette référence : - Ce n’est pas nous qui prétendons cela ! C’est votre Renan qui l’a dit, montré et démontré » !103 Ibid., p. 382. Pour résumé brièvement ces courants, les germanistes soutenait l’importance des invasions des barbares venu d’Allemagne dans la création de l’Europe après la chute de Rome, alors que les romanistes soutenaient que les romains avaient eu une plus forte influence, notamment par leur droit.104 Ibid., p. 384.
- 18 -
représente, au contraire, la somme abstraite et, pour ainsi dire, la quintessence de ses idées
politiques. On peut penser que Renan fut toujours antidémocrate, sauf à deux moments de sa
vie »105, lors de la rédaction de l’Avenir de la Science et quand il se présenta aux élections afin
d’obtenir un siège de député.
Outre Maurras, on peut également citer Louis Dimier, également proche de l’Action
Française. En effet, il semble que Dimier aurait rattaché Renan à l’Action Française quand
cette dernière cherchait à associer à son nom des historiens qu’elle voyait comme proches de
son courrant : « La science est une pièce indispensable de la contre-révolution. Taine et Renan
sont les deux autres môles auxquels s’amarrent les conceptions historiographiques de l’Action
française. Le second demeure l’objet de réticences. De La vie de Jésus, Dimier dénonce la
« faiblesse de psychologie imaginaire » ; […] de surcroît, Dimier voit en Ernest Renan un
praticien de la méthode positive inspirée d’Auguste Comte et que Charles Maurras prétend
poursuivre »106. La droite se serait donc aussi attachée l’homme de science qu’était Renan, en
plus de l’auteur monarchiste.
Ainsi, nous pouvons en conclure que Renan est bien apparenté à certains courants de
droite.
§ 2 Une récupération discutée et une définition de la nation partiellement assumée
En effet, on peut remarquer que « Toutes les droites dépendant, précisons-le d’emblée,
ne se reconnaissent pas en Dieu, n’ont pas besoin de Dieu. Ernest Renan, Hippolyte Taine
appartiennent tous deux à cette droite du XIXe siècle, autoritaire et antirépublicaine, qui rend
explicite son rejet du christianisme et de ses croyances »107. Car Renan, ne l’oublions pas, est
aussi l’auteur de la Vie de Jésus et des livres qui l’ont suivi et qui visaient à critiquer
objectivement le dogme catholique par des traductions débarrassées de leurs erreurs. Ainsi,
comme nous l’avons montré précédemment, bien que Renan soit resté croyant jusqu’à la fin
de sa vie et perçu comme tel par son entourage108, il fut vilipendé par les catholiques tout au
long de sa vie comme après sa mort. C’est lors de la cérémonie de Tréguier qu’on trouve bon
nombre de critiques comme celle-ci : « après avoir, tout en satisfaisant ses rancunes de
défroqué, servi de son mieux les vues du rationalisme biblique, il est mort dans les bras du
cléricalisme protestant, qui a appelé à la rescousse le cléricalisme juif et la maçonnerie
105 Ibid., p. 384. Cette page reproduit l’article de La Gazette de France du 11 septembre 1902, dans lequel ces propos ont été tenus.106 O. Dumoulin, « Histoire et historiens de droite », J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, op. cit., t. 2 « Cultures », p. 352. Nous ne citerons ici que la conclusion, mais pour les extraits des écrits de Dimier conduisant à celle-ci nous renvoyons à la page 352 et aux notes qui sont associées aux citations.107 P. Boutry, « Dieu », J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, op. cit., t. 3 « Sensibilités », p. 213.108 M. Barrès, Huit jours chez M. Renan, op. cit., pp. 22-23 et pp. 40-41.
- 19 -
sectaire pour transformer ses funérailles en manifestation anticatholique »109. C’est pourquoi il
n’influença que la droite nationaliste et agnostique et non la droite monarchiste catholique110.
De cette influence, on remarque que « l’argumentation des traditionalistes reposera
essentiellement sur les Questions contemporaines, la Monarchie constitutionnelle en France,
les Essais de morale et de critique, et sur La Réforme intellectuelle et morale, […] »111. Mais
« essentiellement » ne veux pas dire exclusivement. Par exemple le deuxième point du tableau
comparatif entre les propos tenus sur Jeanne d’Arc et ceux tenus sur le mythe juif dressé par
Michel Winnock112, met au crédit de la sainte « L’unité nationale »113, cette même unité qui
fait l’objet de la conférence de Renan en 1882. On peut joindre à la référence précédente, un
corollaire : le culte des ancêtres. En effet, la période de la Troisième République a vu fleurir
des références à des figures historiques, ces références rentrant plus largement dans le culte
des ancêtres pratiqué par chaque courrant politique pour se légitimer. Mais au contraire des
républicains, les nationalistes prônent le retour à la vie d’avant, celle de l’époque à laquelle
appartiennent ces « idoles ». Ainsi, en disant « je ne puis vivre que selon mes morts »114,
Barrès résume à la perfection cette idée d’ancestralité115, véhiculé par Renan qui estime que
« le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ». Il ajoute même que « les ancêtres nous
ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, […] voilà le capital
social sur lequel on assied une idée nationale », et on en déduit aisément que c’est d’eux que
nous héritons le « riche legs de souvenirs » 116.
Cette conférence Qu’est-ce qu’une nation ? recèle d’autres arguments que la droite
monarchiste et (ou) nationaliste, pourrait extraire pour forger sa doctrine et lutter contre les
républicains, comme par exemple les propos de Renan sur la formation de la nation sous
l’action des rois de France117. Pourtant on ne peut qu’être d’accord avec les propos précédents
concernant les références de la droite à Renan. Rarement, on pourrait même dire en réalité
jamais la conférence n’est citée comme référence directe. Le tout est toujours masqué, comme
Barrès le fait en disant que « personne n’a mieux parlé de la patrie […] que Renan »118, mais
en ne faisant pas référence à celui-ci quand il aborde sa propre définition de la nation, alors
que tous savent que Barrès était un disciple de Renan. On peut aussi citer Louis Le Fur,
écrivain catholique, qui dans l’article Race et Nationalité, développe une idée de la nation très
109 Journal de Rennes, 12 octobre 1892.110 Pour plus de détails voir E. Richard, Ernest Renan, penseur traditionaliste ?, op. cit., pp. 309-307.111 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : […], op. cit., p. 312.112 M. Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, éditions du Seuil, 1982, pp. 146-152. Michel Winock inclut aussi Renan dans des « piliers » du nationalisme français. Pour cela voir le même ouvrage pages 99 à 105.113 Ibid., p. 148.114 M. Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, Paris, Félix Juven, 1902, t. 1, p. 12.115 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., pp. 144-146. Pour un résumé de l’idée de nation barrésienne.116 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 74.117 Ibid., p. 56.118 M. Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, op. cit., p. 78.
- 20 -
proche de celle développée dans la conférence de Renan, sans jamais le citer119. Et on peut
comprendre que la droite ait du mal à réutiliser cette conférence, car on y trouve d’autres
arguments qui vont eux, donner du crédit aux thèses des républicains. Cela explique sans
doute que l’on constate que les références à Renan dans les mouvances de droite se font
moins nombreuses jusqu’en 1923120, et atteignent leur niveau le plus bas vers 1940121.
Section 2 : Le faire valoir d’une République en construction
A l’autre bout de l’échiquier politique se situent les républicains, les socialistes et les
communistes. Pourtant, ces groupes politiques vont à leur tour s’emparer des textes de Renan
à la même époque, mais pour leur faire dire l’opposé de ce qu’exprime la droite du XIXe et du
début du XXe siècle. C’est pourquoi il faut s’interroger sur la manière dont les républicains se
sont appropriés les textes de Renan afin de l’ériger comme une de leurs références (§1), pour
comprendre comment l’idée de nation renanienne fut reprise par ce courant qui l’oublia plus
tôt que la droite (§2).
§ 1 : La « glorification » du Renan de Caliban
Le terme de glorification parait à première vue un peu excessif. Pourtant, c’est bien le
mot qu’il convient d’utiliser122, puisque les républicains vont se mobiliser pour inscrire Renan
dans les mémoires par tous les moyens disponibles, comme le démontre Maurice Gasnier
dans sa thèse123. Mais avant d’aborder ce point, il faut comprendre pourquoi les républicains
s’emparent de la pensée d’un auteur qui, nous l’avons vu, se rattache plus aisément aux
courants de droite.
En fait, deux points retiennent principalement l’attention des républicains : la science
et l’anti-catholicisme. Un troisième point, marginal celui-ci, est le ralliement tardif de Renan à
la République124 avec son ouvrage Caliban125. La science est effectivement le fer de lance de
la pensée politique républicaine, parce qu’elle permet de lutter contre l’Eglise qui la
119 L. Le Fur, « Race et Nationalité », Revue catholique des Institutions et des Droits, Lyon, J. Perroud, 1921. On constate la même chose dans son ouvrage Races, Nationalités, Etats, Paris, Librairie Félix Alcan, 1922. Ce livre est disponible sur le site www.archives.org. 120 « Nous avons fixé comme […] terme 1923. Ma destinée posthume de Renan ne s’arrête certes pas là, mais du moins Renan cesse-t-il d’être, à ce moment, une référence obligée pour l’intelligentsia française » (M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : […], op. cit., p. 2).121 « la droite des années 1940 cesse partiellement d’invoquer Renan » (E. Richard, Ernest Renan, penseur traditionaliste ?, op. cit., p. 321).122 Terme au demeurant déjà utilisé par Maxime Lefranc dans Pourquoi nous glorifions Renan, Réponse à Jean des Buttes, Brest, Imprimerie de la Dépêche, 1903 et par Barrès voir infra., p. 22.123 C’est d’ailleurs, nous pouvons le dire, l’objet de sa thèse. C’est pourquoi il est intéressant de l’opposer à celle d’Edouard Richard qui lui s’intéresse moins à la récupération de Renan par les républicains.124 E. Richard, Ernest Renan, penseur traditionaliste ?, op. cit., pp. 277-303. Ce chapitre intitulé « la recherche du meilleur régime ou la République par défaut », traite de ce ralliement tardif.
- 21 -
condamne. Or cet engouement pour la science, la recherche et l’éducation, et le combat pour
que tout cela se retrouve en tête des priorités politiques, on le retrouve chez Renan dans son
ouvrage de jeunesse L’Avenir de la Science126. Dans cet ouvrage on trouve des phrases qui
auraient pu être prononcées par des scientifiques tels que Berthelot ou d’autres républicains
ayant foi en la science : « Sans doute la science ne formule pas ses résultats comme la
théologie dogmatique : […] Ce sont de délicats aperçus, des vues fugitives et indéfinissables,
des manières de cadrer sa pensée plutôt que des données positives, des façons d’envisager les
choses, une culture de finesse et de délicatesse plutôt qu’un dogmatisme positif »127. On y
trouve également une critique de la religion : « la religion européenne se résume en ce mot :
combat le mal. […] Les clairvoyants remarqueront que c’est ici le nœud du problème entre les
vieilles et les nouvelles idées de théisme et de morale »128. Et dans cette lutte une chose est
sûre c’est que « les théories du progrès sont inconciliables avec la vieille théodicée, qu’elles
n’ont de sens qu’en attribuant à l’esprit humain une action divine, en admettant en un mot
comme puissance primordiale dans le monde le pouvoir réformateur de l’esprit »129. On
comprend alors pourquoi les républicains se réfèrent à ce livre qui allie éloge de la science et
remise en cause de la foi catholique, plutôt qu’à La Réforme intellectuelle et morale, qui bien
que contenant une proposition de réforme de l’enseignement scientifique130, fait cette fois ci
l’éloge de l’aristocratisme monarchique131.
Le second point retenu par les républicains, c’est la critique de la religion. En effet les
républicains retiennent aussi de l’auteur sa Vie de Jésus, tentative de réécriture de la vie du
fils de Dieu, qui provoqua un scandale dans le milieu catholique et valut à Renan d’être
qualifié de « blasphémateur européen »132 par Pie IX. La récupération de Renan se fera à
proportion des critiques que les catholiques émettront envers l’auteur, accroissant ainsi le
mouvement de glorification de l’auteur. C’est ce que fait remarquer très justement Barrès :
« l’initiative de votre glorification a été prise par un amiral et par M. Dayot. Ils sont soutenus
par un ministère qui veut ennuyer les catholiques bretons… Ne craignez rien, cher maître, les
anticléricaux tiennent la corde. La municipalité de Tréguier écartera radicalement la
protestation de l’archiprêtre Legoff »133.
Voici les deux liens majeurs que font les républicains entre leur doctrine et la pensée
de Renan. Et c’est ce qui les conduit à magnifier la personne de l’auteur et à lui rendre un
culte par tous les moyens possibles. Les trois procédés marquants que relève Maurice Gasnier
125 Pour plus de précision sur cet ouvrage et le lien entre celui-ci et la République que nous expliciterons plus tard, voir infra., pp. 81-82126 E. Renan, L’avenir de la Science, Paris, Calmann Lévy, 1890.127 Ibid., p. 54.128 Ibid., p. 32.129 Ibid., p. 32.130 E. Renan, La Réforme intellectuelle et morale et autres écrits, op. cit., pp. 68-75.131 Voir supra., p. 17.132 Cf. G. Monod, Renan, Taine, Michelet : les maîtres de l’histoire, Paris, Calmann Lévy, 1894, p. 21.133 M. Barrès, M. Renan au purgatoire, in M. Barrès, Huit jours chez M. Renan, op. cit., pp. 67-68.
- 22 -
sont : les rues, plaques et bustes ; la statue de Tréguier ; la loge Ernest Renan134, par les
républicains qui ont dans l’idée que « pour rallier la Bretagne à la République, il faudra
imposer aux Bretons un homme au-dessus de tout soupçon, l’enfant du pays, Ernest
Renan »135.
Insistons sur l’érection de la statue de Tréguier, représentant cet homme qui a mené
« une admirable vie de sage, pourquoi ne pas dire de saint ? »136, car c’est à ce moment que la
sanctification de l’homme, et indirectement des valeurs républicaines qu’on veut lui attacher
est la plus forte. Cela transparaît dans les discours prononcés à cette occasion, comme celui
d’Anatole France qui est remarquable à et égard. Il commence par dire que « Renan, avec une
perspicacité sans égale et un rare courage intellectuel, appliquait au langage et aux religions,
la critique historique […] »137, et que dès le séminaire « Renan avait l’esprit fait pour sentir
très vite la difficulté de croire »138. Cette description d’un Renan plus ou moins
fondamentalement républicain parce qu’ayant compris que la science primait sur toute autre
considération se poursuit en faisant référence à L’avenir de la Science139 et atteint son
paroxysme avec cette phrase : « plutôt que de sacrifier la science à la démocratie, Renan eût
sacrifié la démocratie à la science. Mais dès qu’il s’aperçut que la science avait moins à
perdre avec Caliban qu’avec Prospéro, il préféra Caliban »140. L’astuce est habile, car France
fait passer Renan pour un républicain dans l’âme, qui s’est trompé en choisissant la monarchie
comme moyen d’accéder à ses fins, et qui a lavé son hérésie en reconnaissant sa nature
profonde, celle d’un républicain. Le discours de Berthelot141 est plus axé sur le Renan critique
de la religion catholique, mais est de la même teneur que celui d’Anatole France, bien qu’il
admette sans nuance mais sans insister non plus, que Renan était bien devenu un monarchiste
convaincu après la chute de la Seconde République142.
Dès lors, avec ce seul exemple, on constate que les républicains ont réussi à opposer
aux monarchistes et aux nationalistes de droite l’auteur dont ils se prévalent. Mais ils vont
aller plus loin. Ils vont aller jusqu’à récupérer l’idée de nation de Renan bien plus
ouvertement et habilement que les courants de droite, jusqu’à ce que cette récupération divise
et qu’on oubli l’auteur afin de maintenir la cohésion et l’apparence.
134 Il s’agit en fait des subdivisions du chapitre 2 de la thèse de M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., pp. 32-81.135 Ibid., p. 34.136 A. Dumas, La Gazette de France, 8 octobre 1892.137 A. France, Discours prononcé à l’inauguration de la statue de Renan à Tréguier, le 13 septembre 1903, version illustrée par Serge de Solomko, Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud et F. Ferroud successeur, 1922 p. 6. Cet ouvrage est consultable en ligne via le site www.archives.org. 138 Ibid., p. 6.139 Ibid., pp. 8-9.140 Ibid., p. 40. Pour plus de détails sur les personnages de Caliban et de Prospero voir infra., pp. 81-82.141 Discours de Marcelin Berthelot in R. D’Ys, Ernest Renan en Bretagne, Paris, Emile-Paul, éd. 2e, 1904, pp. 442-451. Cet ouvrage est consultable en ligne via le site www.archives.org142 Ibid., p. 444.
- 23 -
§ 2 : L’adoption de la définition de la nation renanienne comme définition républicaine de la nation.
Au-delà de ces deux références (bien qu’une soit liée à celle que nous allons
développer), les républicains ajoutent celle de la nation renanienne. Ici, il est plus facile de le
constater, car les références y sont faites directement. Par exemple, Anatole France lors de son
discours au Trocadéro pour le centenaire de la naissance de Renan, fait une allusion directe à
la conférence : « Renan s’était souvent demandé ce qui constitue une nation, et quelle est sa
raison d’être. Il a résumé ses réflexions sur ce grand sujet dans un discours d’une trentaine de
pages […] il l’a insérée [dans] : Discours et conférences »143. Puis il la résume et en vante les
mérites plutôt que de la blâmer. Ainsi c’est un « discours d’une trentaine de pages d’une
portée incalculable et qui assurerait la tranquillité des peuples si ceux qui les gouvernent
voulaient s’en inspirer dès que la paix est menacée »144 qu’il résume en disant : « Voilà l’idée
la plus belle, la plus pacifique, la plus conforme à l’équité qu’on ait encore donnée de la
patrie. Puisse-t-elle entrer un jour dans tous les esprits et dans tous les cœurs »145. Une autre
référence directe sera faite lors de l’hommage de la ligue de la République à Montpellier146.
Les républicains vont aussi se référer indirectement à cette conférence et en faire une
application concrète. En effet, beaucoup d’auteurs déduisent que la loi sur l’école gratuite et
laïque, appelée communément « loi Jules Ferry », serait en réalité une transposition ou une
concrétisation des idées de Renan sur l’enseignement147. Cette affirmation est étayée par ce
qui était enseigné aux enfants dans ces écoles148 : dix fondateurs de la République149, dix bons
rois de France qui l’ont fondé150 et un héros suprême en la personne de Vercingétorix151 un de
« nos ancêtres les gaulois ». Ces figures sont complétées de leçons civiques sur les valeurs
143 Le Temps, 12 mars 1923.144 Ibid.145 Ibid.146 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., pp. 120-121.147 « C’est donc par un singulier contresens que Renan fut considéré comme un des maîtres à penser de l’école laïque, même si le culte qu’il vouait à la science et son intérêt pour l’enseignement supérieur servirent la démopédie républicaine » (Ibid., p. 286). Mais aussi E. Richard, Ernest Renan, penseur traditionaliste ?, op. cit., pp. 337-338. J.-P. Rioux, La France perd la mémoire, op. cit., p. 230. Plus largement voir F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique : éducation et intégration, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2003, p. 13 et p. 54. L’auteur rapproche la définition de la nation selon Renan et l’exploitation qui en est faite par l’école de la IIIe République, l’exploitation plus générale faite par cette IIIe République. P.-E. Fageol, « Le patriotisme au lycée de Saint-Denis de la Réunion avant la Grande Guerre (1870-1914) », Histoire de l’éducation, n° 133, janvier-mars 2012, pp. 43-64.148 L’Histoire : « 1500 ans d’histoires de France : les dates, les héros, les légendes », mars 2013, pp. 31-66. Il s’agit d’un ensemble d’articles basés sur le programme scolaire de la Troisième République. Les différents auteurs montrent comment la République s’est servie des programmes scolaires notamment à des fins politiques.149 M. Agulhon, « La République a besoin de grands hommes » in ibid., pp. 38-42.150 O. Loubes « Les Héros » in ibid., pp. 44-45.151 C. Goudineau, « Le Héros », L’Histoire, n° 282, pp. 34-39 in ibid., p. 43. Cette page montre comment sous Napoléon III puis la IIIe République, Vercingétorix fut utilisé pour fédérer les français contre les allemands en faisant de lui le premier héros national.
- 24 -
républicaines comme la devise de la France, ou des chants républicains152. Or, cela correspond
à différents points de la définition de Renan : la nation fédérée par les rois153, la création de la
cohésion nationale autour d’une histoire orientée154 sur des personnages à admirer et imiter155,
et enfin la nation basée sur le « plébiscite de tous les jours », ici entendu comme une adhésion
volontaire rousseauiste à ce groupement humain.
Si l’idée de nation renanienne est bien récupérée et acquise par les républicains156, cet
héritage va être vite contesté et camouflé. En effet, dès l’inauguration de la statue de Renan à
Tréguier, des voix s’élèvent contre l’hommage rendu par les républicains. Et ces voix sont des
voix républicaines. C’est le cas, par exemple, de Jules Lemaître qui écrira « Ce Renan
acclamé aujourd’hui par le "bloc" et que les Apaches du gouvernement doivent considérer
comme un vieux frère "un vrai, un bon", était fort suspect de religiosité ; […]. Et si Taine a
écrit les "Origines de la France contemporaine" Renan a écrit la "Réforme intellectuelle et
morale" et la "réponse à M. Claretie" […] »157. A ces propos, un lecteur de l’article notera
dans une lettre « Oui, voilà où en est Jules Lemaître ; il enrage d’avoir raison contre les siens ;
[…] »158. Les républicains, mêmes étrangers159, ne sont donc pas tous d’accord avec cette
récupération ce qui divise le mouvement et fragilise la référence.
Dans les autres factions de ce qu’on pourrait appeler la gauche de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle, les critiques fusent aussi, notamment chez les communistes. En effet
pour eux « Tout le monde sait en effet que Renan jouit d’une médiocre faveur dans les
milieux officiels, et que cette manifestation de sympathie à son égard est l’effet d’un remord
plutôt que d’une admiration spontanée »160. Il est aussi « un bourgeois français de la meilleure
époque. Il a tenu par toutes ses fibres à l’ancienne société bourgeoise, […] »161.
En fait, c’est parce que les autres écrits de Renan étaient plus proches de la pensée de
la droite monarchiste et nationaliste, que comme le pensait Maurras « Renan fut toujours
antidémocrate, sauf à deux moments de sa vie »162, parce que c’est un libéral, un bourgeois163,
que la gauche dans son ensemble a arrêté de se référer à l’auteur vers 1923, c’est-à-dire dix-152 Epreuve qui restera obligatoire pour le certificat d’étude jusqu'à sa suppression. Pour un condensé du programme que nous venons d’évoquer, se référer à la liste des épreuves accessible sur le site suivant : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2289153 Supra., p. 20. et infra., pp. 97-99.154 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 56-57.155 Ibid., pp. 74-75.156 « Qu’est-ce qu’une nation ?, qui créera la théorie de la nation officielle de la République » (M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., pp. 378-379).157 J. Lemaitre, Deux Statues : un mot aux intelligents, Montréal, W. Boucher, 1903, pp. 5-6. Il s’agit en réalité de la reproduction de l’article de Lemaitre « Le scandale de Tréguier », mais auquel est ajouté une lettre à propos de cet article, adressée à une « dame de Montréal ». 158 Ibid., p. 11.159 C’est apparemment le cas de Mazzini. Sur ce point voir E. Richard, Ernest Renan, penseur traditionaliste ?, op. cit., p. 344.160 L’Humanité, 3 septembre 1923.161 A. Dunois, L’Humanité, 12 mars 1923.162 La Gazette de France, 11 septembre 1902, in C. Maurras, Dictionnaire politique et critique, op. cit, p. 384.
- 25 -
sept ans avant la droite. Mais, comme nous l’avons vu, Renan « a effectivement servi les
intérêts de partis idéologiquement opposés »164, et a finalement été oublié de ces deux partis,
oubli qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
163 C’est dans cette catégorie là que semble le ranger Félix Ponteil dans Les classes bourgeoises et l’avènement de la démocratie, Paris, Albin Michel, 1989, pp. 36-40.164 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., p. 272.
- 26 -
Chapitre 2 : Un oubli mâtiné de rappels ponctuels de la définition renanienne de la
nation à l’époque contemporaine
Alors que Renan semble avoir eu une influence importante de son vivant, puis, après
sa mort, pendant une partie de XXe siècle, il semble qu’aujourd’hui celle-ci décline.
S’opposent alors ceux qui pensent que Renan est une référence incontournable voire qu’il
s’agit d’un « retour d’Ernest Renan »165, à ceux qui, au contraire, pensent qu’après 1923, les
écrits au sujet de l’auteur, les mentions de ses œuvres ou simplement ses idées ont subit une
lente désuétude jusqu’à avoir été pratiquement oubliés de nos jours166.
En réalité, les deux positions sont justes, mais il faut les placer dans des milieux
différents. Si le constat de l’oubli et de la désuétude de Renan et plus précisément de sa
définition de la nation peut se tenir pour le milieu social, culturel et politique (Section 1), il
convient de relativiser ce propos dès lors qu’on se place dans le milieu universitaire et plus
largement intellectuel (Section 2).
Section 1 : Un oubli interrompu ponctuellement dans l’espace socio-politique
Alors que Renan semble avoir été une référence incontournable tant pour les
républicains que pour les nationalistes167, il semble qu’aujourd’hui la classe politique, et plus
largement les citoyens, ont oublié l’auteur de Qu’est-ce qu’une nation ?. Ils ont même oublié
l’auteur d’écrits politiques et religieux.
C’est pourquoi après avoir dressé le constat et proposé une raison ce cet oubli (§1),
nous remarquerons que Renan ressurgit lors de questions spécifiques (§2).
§ 1 : L’oubli généralisé de Renan dans la classe politique
On pourrait s’attendre à ce que celui qui est considéré comme le créateur de la
conception subjective de la nation soit une référence incontournable dans la société du XXIe
siècle. N’est-ce pas d’ailleurs pas parce qu’on retient sa définition de la nation qu’on parle de
« conception française » ? Pourtant, il ne semble pas être resté à la postérité.
165 P. Birnbaum, « Le retour d’Ernest Renan », Critique, n° 697-698, 2005/6, pp. 518-523.166 « Nous avons fixé comme […] terme 1923. La destinée posthume de Renan ne s’arrête certes pas là, mais du moins Renan cesse-t-il d’être, à ce moment, une référence obligée pour l’intelligentsia française » (M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., p. 2). Voir aussi le graphique joint en annexe 1, intitulé « Etudes consacrées à Renan de 1892 à 1923 d’après Thieme » et J.-P. Rioux, La France perd la mémoire, op. cit.167 Supra., pp. 15-26. et infra., pp. 66-77.
- 27 -
N’oublions pas que Renan a parfois été cité dans des articles de journaux et que lui-
même écrivait dans divers journaux et revues. La presse et plus largement les médias traitent
encore de sujets que Renan avait abordés comme la religion, l’orientalisme ou la nation, si
bien qu’on pourrait croire qu’il s’agit d’une référence incontournable faisant couler autant
d’encre qu’à son époque. Pourtant, il semble que la presse ne mentionne plus Renan non plus.
Si l’on prend les archives mises en ligne par L’Express, qui regroupent les articles des années
quatre-vingt-dix à 2013, quarante-trois articles mentionnent le nom de Renan entre 1994 et
2013. Sur ces quarante trois articles, sans compter ceux publiés deux fois dans la base
numérique, moins d’une dizaine sont consacrés à Renan et la nation, les autres ne
mentionnant que ses travaux sur la religion, son point de vue d’historien sur l’Orient ou son
point de vue sur les juifs, et des adresses ou établissements publiques portant son nom. Son
nom est également mentionné dans des articles traitant d’autres auteurs, simplement pour
rappeler qu’ils étaient contemporains ou que l’un avait influencé l’autre168. L’Humanité qui
avait vivement critiqué l’auteur breton169, semble s’être trouvé d’autres antagonistes à
critiquer. Si les archives numériques de L’Humanité, qui vont de 1990 à 2013, annoncent cent
soixante neufs résultats sur cette période, ce n’est pas pour autant que les résultats sont
meilleurs. En effet, contrairement à L’Express qui associe à son moteur de recherche une
fiche d’auteur, ce qui permet de trouver les articles mentionnant la personne voulue,
L’Humanité n’utilise pas cette technique si bien qu’apparaissent tous les articles dans lesquels
nom « Renan » apparaît. Il faut alors séparer le bon grain de l’ivraie, en retirant les articles
parlant du chanteur Renan Luce, des sportifs comme Renan Lavigne, ou de politiques comme
Pierrette Renan170. Au final, proportionnellement à la quantité d’articles, on peut formuler les
mêmes remarques que pour le journal L’Express, bien qu’il semble qu’il y ait un peu plus
d’articles consacrés à Renan et la nation dans L’Humanité171. Nous ne détaillerons pas plus les
archives de Libération qui rencontrent les mêmes problèmes que celles de l’Humanité, et
proposent cent soixante-douze articles mentionnant le nom « Renan » entre 1994 et 2013,
mais dont la plupart sont aussi à propos de Renan Luce, ou mentionnent Renan parce qu’il
figure dans un tableau, parce que des écoles portent son nom ou parce qu’un étudiant du
Prytanée a lu l’intégralité de son œuvre172. Les rares articles sur Renan ou s’intéressant a lui
168 Pour la mention des travaux religieux de Renan voir notamment C. Claude-Michel, « Relire Renan », L’Express, 20 juillet 1995. Sur la mention de rue ou bâtiment portant le nom d’Ernest Renan voir la dépêche de l’AFP publiée sous le titre « Privés de manuels scolaires pour des impayés de cantine », L’Express, 13 septembre 2011 et pour l’influence de Renan sur des auteurs sujets d’un article voir G. Kauffmann, « Michel Winock, Flaubert et le mal du siècle », L’Express, 24 mars 2013. Pour visionner toutes les archives voir le lien suivant : http://www.lexpress.fr/recherche/recherche.asp .169 Supra., p. 25.170 Pour Renan Lavigne, voir la rubrique sport, « Dans l’actualité », l’Humanité, 18 juin 2007. Pour madame Renan voir dans la rubrique société E. Rive, « visite interdites au centre de rétention », l’Humanité, 12 janvier 2007. 171 Pour accéder à la totalité des articles mentionnant le nom « Renan » dans L’Humanité, voir http://www.humanite.fr/search/sinequa_search/Renan/from?rows=10&sinequasort=score .172 C. Devarrieux « Antoine Compagnon, la martiale éducation », Libération, 14 novembre 2012. V. Noce, « Orsay enfin rénové de fonds en combles », Libération, 19 octobre 2011. Pour accéder aux archives, taper le nom « Renan » dans la page d’accueil du site http://www.liberation.fr/ .
- 28 -
étant toujours à propos de « Renan et les juifs » ou « Renan et la religion ». Cependant, les
archives d’un journal, mais d’un seul, Le Figaro, proposent un nombre important d’articles
faisant référence à l’auteur. Cent cinquante-huit articles mentionnant le nom « Ernest Renan »
entre 1997 et 2013. Autre particularité qui fait de ce journal l’exception du phénomène que
nous venons de décrire, c’est que malgré les restrictions auxquels sont sujettes ces archives,
les titres, résumés ou quelques phrases des articles en question démontrent que le Renan
politique y tient une place importante. Il est en effet autant cité dans des articles concernant la
question européenne ou l’identité nationale, que dans des articles mentionnant simplement
une rue portant son nom ou son appartenance à l’Académie Française173.
Renan ne fait pas non plus partie des références classiques du personnel politique
contemporain. Dans la base de données des archives de l’Assemblée Nationale, si l’on
cherche « Ernest Renan » pour affiner les résultats et ne pas tomber sur des députés portant le
même nom que l’auteur, on trouve trente-quatre résultats, dont seulement huit mentionnent
l’auteur et non une rue ou un lycée, et six, le concept de nation renanien174. Bien que toutes les
archives de l’Assemblée Nationale ne soient pas accessibles, car non numérisées ou
disponibles uniquement à la bibliothèque de l’Assemblée, notons néanmoins qu’au Sénat les
références sont plus importantes. En tapant la même entrée, et en choisissant le filtre « depuis
20 ans », on trouve soixante et un dossiers législatifs, huit rapports d’information, trois
questions parlementaires et vingt et un comptes-rendus des débats175. Cependant certains
textes concernent la matière fiscale ou les échanges réciproques entre pays, si bien que nous
devons les écarter du propos, ce qui réduit le nombre de dossiers législatifs à prendre en
compte. De même une des questions au gouvernement concerne un lycée176, et quelques
comptes-rendus des débats mentionnent aussi des lycées ou Renan mais sans le lier à l’idée de
nation177. Ainsi, si l’on exclut les dossiers législatifs, le nombre de références directes à Renan
et son idée de nation au Sénat se situe autour d’une petite vingtaine en vingt ans, soit, en
moyenne une par an. Et encore, dans les deux hémicycles, la majeure partie des citations se
contentent de rappeler le « plébiscite de tous les jours » ou le « vouloir vivre ensemble ». Cela
est certes compréhensible car les citations viennent appuyer un propos, mais un tel raccourci
risque de nuire à la compréhension de la totalité de l’idée de l’auteur, voire de la contredire.
Ce qui peut expliquer ce relatif oubli, c’est que l’idée de Nation sur laquelle la
Troisième République s’est fondée, n’est plus. De nos jours, il n’y a plus de cohésion autour
173 Pour ce constat voir directement les archives via http://recherche.lefigaro.fr/recherche/recherche.php?ecrivez=Ernest+Renan&page=articles&next=1 174 Voir http://archives.assemblee-nationale.fr/175 Voir http://www.senat.fr/leg/archives.html176 « Question orale sans débat, n° 1336S de M. Ronan Kerdraon », Journal Officiel, Sénat, 19 mai 2011, p. 1279177 Par exemple la séance du 12 juillet 2011 via http://www.senat.fr/seances/s201107/s20110712/s20110712004.html et celle du 22 février 2010 via http://www.senat.fr/seances/s201002/s20100222/s20100222005.html
- 29 -
de valeurs reconnues ou d’un objectif futur. Cette idée, c’est celle de Jean-Pierre Rioux.
Comme Renan, cet auteur considère que ce qui fait le ciment de la France, ce qui permet au
peuple de s’unir, ce sont son histoire et sa culture, « car mieux connaître et mieux faire
connaître les souvenirs communs qui ont accompagné, authentifié et signalé ce peuple de
siècle en siècle, voila ce qui m’a si longtemps ému et passionné, […] pour avoir compris que
les mots et les mythes, les héros et les martyrs, sans oublier les saints et les salauds, nous
dressent et nous arment »178. Mais à cause de divers phénomènes179, Jean-Pierre Rioux estime
que « les Français aujourd’hui ne s’aiment plus guère, ou plus assez, parce que leur mémoire
collective a pris du gîte et risque de sombrer »180, parce que ces phénomènes empêchent
d’avoir des valeurs et une histoire communes qui fédéreraient les individus. Puis, il consacre
une partie de son analyse à Renan, en reprenant sa définition et en analysant sa conférence car
pour Jean-Pierre Rioux, la définition renanienne de la nation est celle qui énonce « deux
points fondamentaux qui nous ont ancrés nationalement »181. Ces deux points sont l’histoire
commune et les valeurs à travers lesquelles les individus reconnaissent la nation. Or, pour
l’auteur nous sommes en passe de perdre les deux et d’oublier Renan. Il invoque six raisons
de l’oubli de la nation renanienne. La première c’est la crise de la temporalité, la rapidité des
échanges et la mise en accusation du passé, comme la remise en cause des figures fondatrices
de la Révolution ou de la Troisième République, qui fait qu’il n’y a plus de repères sur
lesquels fonder la nation. Il y a aussi une crise spatiale, car nous ne savons plus si nous
devons nous inscrire dans la France ou dans l’Europe par exemple, ou dans la cohabitation
des deux. Il arrive même que la crise temporelle et spatiale se mélange. Par exemple, « le
rapport à l’universalisme républicain et l’exemplarité des valeurs républicaines l’une et l’autre
mis à mal (la décolonisation et ses suites, la difficulté à confirmer une France outre-mer) ou
impuissants à maîtriser un avenir (régulation du néolibéralisme, enjeux climatiques et
écologiques) »182. La troisième raison, c’est la nécessité pour les individus de laisser
s’exprimer certaines diversités, ce qui peut fissurer la cohésion nationale, car certains groupes
expriment leur individualité en voulant la raccrocher à la nation, ce qui revient parfois à
vouloir en faire une valeur nationale qui n’existait pas avant, ou à l’inverse à critiquer une
valeur nationale déjà existante. La quatrième raison, c’est l’exigence conjointe de sécurité et
de liberté qu’exigent les individus. La cinquième raison, c’est la montée de l’individualisme et
du « je », qui s’oppose au holisme plus ou moins fort qu’exige une nation (et les fameux
sacrifices dont parle Renan). Enfin, la dernière raison est la « conséquence de tout les points
précédents, la conscience qu’il faut reprendre la réflexion sur la laïcité, cette règle du jeu du
178 J.-P. Rioux, La France perd la mémoire, op. cit., pp. 12-14.179 Ibid., pp. 7-9. Il s’agit de la mise en accusation du passé, la crise de temporalité et la perturbation du jeu des échelles spatiales. Monsieur Rioux complète ces points à la fin de son ouvrage, nous reprendrons ces points. Voir infra., p. 32.180 Ibid., p. 21.181 Ibid., p. 227. Pour l’analyse de la conférence de Renan voir ibid., pp. 227-231.182 Ibid., p. 233.
- 30 -
vivre ensemble si exclusivement française »183. Toutes ces raisons qui expliquent pourquoi
nous avons oublié les sacrifices qu’exigent une nation, sur quoi et autour de quoi doit-on la
bâtir, qui remettent en cause la définition de la nation, et finalement remettent en cause ce que
proposait Renan, se traduisent notamment par un amalgame sémantique. Pour Monsieur
Rioux, la nation est une notion clé, source de l’interprétation de nombreux mots, comme
l’ « Etat » qui chez nous a précédé la nation et non l’inverse, ou le mot « Patrie ». Il ne faut
pas non plus confondre « nation » avec la nationalité. En effet, selon lui : « la nationalité
française n’est pas la reconnaissance d’une identité particulière importée ni d’une identité
nouvelle octroyée, mais une technique juridique d’attribution à un individu, à une personne
humaine, d’un statut, celui de citoyen français. Et […] elle légalise l’appartenance nationale,
plus ou moins bien, plus ou moins vite, c’est l’évidence, par le sol, par la filiation, par le
mariage ou par la résidence, mais jamais au nom d’une quelconque "identité" individuelle,
collective ou communautaire »184. Il ne faut pas non plus confondre « nation » et « identité »,
les deux n’étant pas synonymes, car l’identité serait un terme pluriel parce qu’il est centré sur
l’individu et non le groupe. Or, il n’y a qu’une nation mais des identités. Dès lors Jean-Pierre
Rioux se demande si la confusion n’est pas irrémédiablement faite entre les deux termes, avec
la création en 2007 du « ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et
du Développement solidaire »185.
Ce constat pourrait être qualifié d’outrancier, si les chiffres d’un récent sondage
d’Ipsos186 ne venaient pas corroborer l’analyse de Jean-Pierre Rioux. En effet, un article du
Monde consacré à l’analyse de ce sondage et intitulé « Les crispations alarmantes de la société
française »187, pointe du doigt ce « mal être national ». Ainsi, à propos de la crise spatiale
évoquée précédemment, l’article nous parle de la « tentation du repli national » parce que les
Français « sont plus nombreux encore – trois sur cinq – à voir dans la mondialisation "une
menace pour la France" et à juger que "la France doit se protéger davantage du monde
d’aujourd’hui" ». Et si les Français semblent ne pas vouloir quitter l’Union Européenne et
l’avoir intégrée dans leur quotidien, il faut noter que « deux sur trois, en revanche, souhaitent
"renforcer les pouvoirs de décision de notre pays, même si cela doit conduire à limiter ceux de
l’Europe" ». Il semble alors que les Français sentent que la nation perd de sa cohésion et de ce
fait, de son autorité, autorité qui fait d’ailleurs partie des valeurs reconnues par les Français et
qui est selon 86% d’entre eux, tous bords politiques confondu, « une valeur qui est trop
souvent critiquée aujourd’hui ». De même, selon le même procédé de sondage, il semble que
« 87% des sondés sont d’accord pour dire que l’"on a besoin d’un vrai chef en France pour
remettre de l’ordre" ». A la crise spatiale, la crise des valeurs, le manque d’une figure autour
de laquelle tous doivent se rassembler, il faut ajouter une « crispation » religieuse et
183 Ibid., pp. 232-237.184 Ibid., p. 223.185 Ibid., p. 222.186 Enquête Ipsos intitulée « France 2013 : les nouvelles fractures ».187 G. Courtois, « Les crispations alarmantes de la société française », op. cit.
- 31 -
xénophobe. En effet, l’article ajoute que « quant à la crispation identitaire, elle n’est pas
moins impressionnante. Depuis une trentaine d’années, elle s’était cristallisée sur la question
de l’immigration. Celle-ci ne s’est pas effacée, loin de là : « 70% des sondés […] jugent qu’il
y a "trop d’étrangers en France" et 62% que l’on "ne se sent plus chez soi comme avant" », et
que « le musulman, volontiers assimilé à "l’intégriste", et dont la religion est jugée, par 74%
des Français, intolérante et incompatible avec la société française »188. L’article conclut sur ce
que relevait Jean-Pierre Rioux, à savoir que certains groupes politiques ou associatifs qui
utilisent l’Histoire et ce qu’ils considèrent comme les valeurs de la France de manière
détournée, attisent ce clivage de la société. On constate aussi cet oubli des préceptes renaniens
quand, au plus haut de la hiérarchie gouvernementale, le titulaire de la magistrature suprême
déclare que « La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d’origine
étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d’un fonctionnaire […]. La
nationalité française se mérite et il faut pouvoir s’en montrer digne »189. Cette phrase est
révélatrice du changement de conception de la nation opérée par les dirigeants. Alors que pour
Renan tous peuvent intégrer la nation, ici, on voit clairement qu’un naturalisé n’a pas la même
place qu’une personne « née française ». Et cette personne naturalisée ne serait jamais
considérée comme française puisque toute sa vie, si elle commet un crime grave, elle peut être
déchue de sa nationalité nouvellement acquise. On assiste donc à une catégorisation
hiérarchique des citoyens en Français de souche et en « sous » Français, qui sont les
naturalisés. Ainsi l’origine ethnique, la religion, le territoire, la puissance économique et
d’autres critères objectifs tous rejetés par Renan semblent avoir pris le pas sur sa définition
qui invitait tout individu de quelque origine que ce soit à intégrer la nation de son choix s’il en
acceptait l’histoire, la culture et l’envie de réaliser le projet d’avenir de celle-ci. A-t-on oublié
complètement Renan et ses principes ? Il semble que non et que l’auteur breton resurgisse de
l’ombre dans des moments particuliers.
§ 2 : Une résurgence ponctuelle de l’idée de nation renanienne lors de situations particulières
Il convient de nuancer quelque peu le propos précédent en développant un point sur
lequel nous ne nous sommes pas attardé. En effet, si la majorité des articles de journaux ne
traitent pas du concept de nation chez Renan, nous en déduisons qu’une minorité en parlent. Il
en va de même pour la classe politique : si il y a peu de références à Renan et la nation, elles
ont le mérite d’exister.
188 Sur l’exploitation des résultats du sondage à propos des questions religieuses, voir S. Le Bars, « La religion musulmane fait l’objet d’un profond rejet de la part des Français », op. cit.189 Il s’agit de propos tenus après que des individus naturalisés aient tiré sur des fonctionnaires de police. Voir « La Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la lutte contre la criminalité, la délinquance et l'immigration illégale, à Grenoble le 30 juillet 2010 » disponible sur le site http://discours.vie-publique.fr/notices/107001771.html .
- 32 -
Intéressons nous en premier lieu aux journaux. Dans les archives de l’Express, outre
un article consacré à un ouvrage de Michel Winock où l’on parle de la cohésion qu’impose la
nation renanienne pour exprimer le but de l’ouvrage de l’historien, le premier article
mentionnant le concept de nation selon Renan date de 2004190. Il s’agit d’un article consacré à
ce que l’auteur appelle les « ennemis de la République », c’est-à-dire les fondamentalistes
musulmans et les partis d’extrême droite français, qui se sont manifestés lors des débats
autour de la loi sur le voile islamique. Pour l’auteur, l’islamophobie irait croissante dans la
société française, d’une part à cause des mouvements intégristes musulmans qui refusaient la
loi sur le voile pour des raisons religieuses non compatibles, selon les politiques de l’époque,
avec la laïcité ; et d’autre part, à cause de l’extrême droite qui aurait utilisé l’amalgame
« islam/immigration » pour développer l’idée suivante : tous les immigrés magrébins et arabes
sont des islamistes qui ne respectent pas les lois de la République, et leur nombre la fait
vaciller. Et l’auteur, face à ces deux extrêmes qui, selon lui usent des mêmes méthodes pour
ébranler la République, conclut : « Tenaillée par les intégristes et les extrémistes, qui
d’horizons différents soufflent sur les mêmes braises, elle traverse une sorte de guerre civile
de velours, dont dépend l’avenir d’un modèle qui est une exception. L’idée de nation édictée
par Ernest Renan, ce partage de mêmes valeurs sur un même territoire, est en péril. La
cohésion républicaine, cet accord tacite sur la démarcation des espaces public et privé, du
politique et du spirituel, est menacée ». Trois autres articles concernent l’élection
présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, la constatation de la déliquescence de la cohésion
nationale en 2008 et le débat sur l’identité nationale et 2009. Dans le premier, qui recueille
l’avis de Michel Winock sur l’élection, ce dernier formule une critique à propos de ce terme
d’« identité » nationale, proche de celle de Jean-Pierre Rioux191 : « L’identité nationale est une
expression détestable parce qu’elle se réfère en général à une définition ethnique de la nation.
En son temps, Ernest Renan opposait la conception "allemande" de la nation, précisément
fondée sur les caractères ethniques, vrais ou supposés, du peuple allemand, et la conception
française, selon laquelle la nation est d’abord le fruit d’un contrat politique : la volonté de
vivre ensemble, d’adhérer à des valeurs communes, enrichies de souvenirs communs »192.
Dans le second article, la définition de la nation renanienne est utilisée en insistant sur « le
legs de souvenir » et les souffrances communes ainsi que sur la « volonté de vivre ensemble »
qu’avait évoquée l’auteur, pour faire ressortir la faiblesse de chacun de ces points dans l’état
actuel de la société française, faisant de la nation française, une nation en danger193. Le dernier
article fait quant à lui référence aux propos d’Alain Jupé qui aurait affirmé ne pas vouloir du
190 C. Barbier, « Enquête sur les ennemis de la République », L’Express, 26 janvier 2004.191 Supra., pp. 32-33.192 C. Makarian, « La gauche est historienne, pas la droite », L’Express, 3 mai 2007. La critique basée sur Renan continue ainsi : « Quand Le Pen se targue d'être du "terroir" face à un Sarkozy fils d'immigré, il défend cette idée "zoologique", comme disait Renan, de la nation. Mais il oublie qu'une immense partie du peuple français est constituée d'enfants ou de descendants d'étrangers devenus français. Nos ancêtres parlaient surtout de patriotisme. Plutôt que d'invoquer l'identité nationale, Nicolas Sarkozy aurait mieux fait de réhabiliter le patriotisme ».193 C. Barbier, « Ensemble, c’est tout », L’Express, 26 décembre 2008.
- 33 -
débat sur l’identité nationale en postant sur son blog : « Citant le philosophe Ernest Renan, il
définit la Nation comme "un principe spirituel, une famille spirituelle, non un groupe
déterminé par la configuration du sol". Et il en conclut : "Tout est dit. A quoi bon relancer un
débat" »194 ?
On trouve dans les archives de Libération, des articles plus anciens, pointant aussi du
doigt, le souci d’intégration à la nation des nouveaux immigrants. C’est le cas par exemple
d’un article de 1996, à propos d’un livre de Christian Jelen, traitant de cette crise de
l’intégration195. L’idée générale est que la France serait plus souple qu’avant avec les
immigrés ce qui expliquerait que ces derniers s’intègrent mal ou refusent l’intégration. A la
fin du résumé on trouve l’idée de monsieur Jelen et l’opinion du journaliste à ce sujet, ce
dernier posant alors cette question : « La France peut-elle encore emporter ce "plébiscite de
tous les jours", dans lequel Renan voyait le génie de la nation française ? ». On trouve aussi
deux articles qui font état des fréquentes références à Renan lors des débats parlementaires à
propos de la réforme du code de nationalité196. Enfin, toujours dans les archives de Libération,
on trouve quelques articles à propos encore une fois du débat sur l’identité nationale
mentionnant à cette occasion la pensée de Renan à propos de la nation, ou de manière
lapidaire le simple « plébiscite de tous les jours »197.
Ces journaux, comme Le Figaro et d’autres mentionnent donc des débats
parlementaires et la réflexion menée par le gouvernement Fillon sur l’identité nationale. Et en
effet, on constate que parfois Renan est évoqué lors des débats. C’est le cas dans une première
séance du 12 mai 1993, dont l’objet était la reprise des débats à propos d’une proposition de
loi adoptée par le Sénat sur le « droit de la nationalité »198. Lors de cette séance, le député
RPR Henri Cuq rappelle que « la France est, aujourd’hui comme hier, reconnue dans le
monde comme un pays d’accueil et de générosité, qui donne à tous la possibilité d’entrer dans
sa communauté de rêve qu’a parfaitement théorisé Ernest Renan : "Une nation est une âme,
un principe spirituel. […] le désir de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l’héritage
qu’on a reçu indivis" ». Mais s’il ne remet pas en cause ce principe, qui est pour lui acquis, il
estime cependant que modifier les conditions d’obtention de la nationalité n’est pas aller
contre le « "vouloir vivre en commun" d’Ernest Renan ». Bien au contraire, « refuser le
194 T. Andriamanana, « Le débat sur l’identité nationale critiqué par une partie de la majorité », L’Express, 29 octobre 2009.195 Tribune de J.-L. Allouche, « La République, en l’aimant. Christian Jelen, "La France éclatée ou les Reculades de la République", Nil éditions, 288 pp., 120F. », Libération, 17 septembre 1996.196 B. Bantman, « Le débat sur le code de la nationalité s'est ouvert hier. Bataille à l'Assemblée sur la nouvelle façon d'être Français. La ministre de la Justice a défendu face aux ténors de la droite la possibilité pour les enfants nés en France de parents étrangers d'être naturalisés dès l'âge de 13 ans », Libération, 27 novembre 1997. B. Bantman, « La réforme du code de la nationalité n'excite plus le Sénat. Badinter a rappelé que tous les immigrés pouvaient être intégrés », Libération, 14 janvier 1998.197 On peut citer de manière non exhaustive l’article de V. Soulé, « Il ne faut pas refuser le débat sur l’identité nationale », Libération, 12 mai 2007, mais aussi l’interview de C. Bonal, « l’identité nationale, pour la droite, c’est l’immigration, l’étranger », Libération, 26 octobre 2009. Ou l’éditorial de L. Joffrin, « il y a aussi du rouge dans le drapeau tricolore », Libération, 27 octobre 2009 ou enfin l’article de P. Virot, « Saison de grogne en sarkosie », Libération, 2 novembre 2009. 198 Journal officiel, Assemblée nationale, 13 mai 1993, n° 15. pp. 387-404.
- 34 -
caractère éminemment évolutif de ce droit aboutirait à scléroser notre système juridique […] »
et oublier alors cette volonté de Renan de vivre ensemble199. George Sarre, dans la fin des
débats, reprendra lui aussi Renan, mais pour étayer une position opposée à celle du député
Cuq, puisque pour lui cette réforme risque de stigmatiser les personnes naturalisées, et plus
généralement cherche à instituer une nouvelle conception de la nation qui « rompt la
continuité d’une nation qui transcende la volonté individuelle ». Et il ajoute pour renforcer ce
raisonnement que Renan a prononcé sa conférence dans un contexte particulier, celui de
l’annexion de l’Alsace et de la Moselle, et que si l’on appliquait ce raisonnement d’interroger
les populations avec la question « voulez-vous être français ? » comme le propose Renan à
travers son plébiscite (et il oublie d’ajouter « et à la fin de sa conférence »), alors les corses et
d’autres régions feraient sécession200. Enfin, Daniel Colin, député UDF, cite à son tour Renan,
pour avancer que selon lui, comme Renan parle de volonté, les étrangers nés sur le territoire
français devraient choisir leur nationalité et non la subir de naissance201. On trouve ensuite
concentré sur les années 1996 et 1997, plusieurs références à Renan et toujours en relation
avec des débats portant sur l’immigration. Lors de la séance de l’Assemblée du 19 décembre
1996, portant sur « diverses dispositions relatives à l’immigration », c’est le ministre de
l’Intérieur Jean-Louis Debré qui mentionne Renan, en remplaçant le « legs des ancêtres », et
en traduisant les idées équivalentes de la conférence par « les lois de la République »202. Lors
des deux séances du 26 novembre 1997, il est cité par le Garde des Sceaux alors en fonction,
Elisabeth Guigou, toujours à propos du débat sur la nationalité, mais aussi à plusieurs reprises
par François Bayrou, alors député UDF, Jacques Floch et Bruno Le Roux, députés PS, Nicole
Catala, député RPR et quelques autres203. Pour le Sénat, que nous ne traiterons pas ici, on
constate aussi que la majorité des références à la conférence de 1882, se situent dans les
années 1997 et 1999 et 2004 et 2010204.
Après avoir exposé les références à Renan et son idée de nation tant dans les journaux
que dans les débats parlementaires, on constate que les dates coïncident. Les articles de
journaux se situent dans la même période que les références à Renan dans les débats
parlementaires. La conclusion que l’on peut en tirer est qu’en réalité Renan a bien été
largement oublié dans la société française actuelle, mais que lorsque le gouvernement décide
de modifier les lois définissant la nationalité, ou plus largement s’interroge sur ce qui fait la
nation française et comment ce contenu doit être enseigné aux immigrés, alors on fait de
nouveau appel à Renan, chacun s’en réclamant différemment afin de soutenir des thèses
diamétralement opposées. Il apparaît alors que si Renan n’a pas été complètement oublié et
199 Ibid., p. 389.200 Ibid., pp. 398-399.201 Ibid., p. 400.202 Séance de l’assemblée nationale du 19 mai 1996, p. 25. 203 Séance de l’assemblée nationale du 26 novembre 1997.204 Voir archives numériques du Sénat depuis vingt ans sur le site du Sénat.
- 35 -
qu’il apparaît dans des situations importantes, il semble en revanche qu’on ne sache plus
utiliser la définition de l’auteur de manière aussi uniforme que sous la Troisième République.
Section 2 : L’oubli dans le milieu intellectuel et universitaire
Si Renan semble avoir été oublié de la majorité des individus, on peut s’attendre à ce
qu’il existe un dernier rempart qui lutte en cherchant à faire connaître cette conception. Ce
rempart, c’est le milieu universitaire. Mais, en excluant les études sur la philologie et le style
de Renan que l’on trouve dans les facultés de lettres, on constate que le « foyer renanien »,
n’est pas entretenu par les universitaires français (§ 1), mais par les chercheurs et auteurs
étrangers (§2).
§ 1 : L’oubli de Renan dans la définition française contemporaine de la nation
Dans les dictionnaires tout d’abord, à l’entrée « Nation », on peut espérer trouver
l’auteur mentionné, une phrase de sa conférence citée ou tout au moins, sa définition
synthétisée. Pourtant il n’en est rien.
Si l’on prend Le petit Larousse et qu’on l’ouvre à « Nation », voici la définition qui
nous est proposée : « NATION n. f. (lat. natio). 1. Grande communauté humaine, le plus
souvent installée sur un même territoire et qui possède une unité historique linguistique,
culturelle, économique plus ou moins forte. […] 2. DR. Communauté politique distincte des
individus qui la composent et titulaire de la souveraineté »205. Or, Renan a bien exclu
totalement ou partiellement de sa définition le territoire et la langue206. Il ressort de sa
définition que l’histoire, peut-être la culture bien que ce terme ne se réfèrent pas
spécifiquement à un pays et ses habitants comme le « legs des ancêtres » de Renan pourrait le
laisser entendre207. Quant à l’économie elle est absente de sa définition. Prenons alors un
dictionnaire un peu plus spécialisé. Dans le Dictionnaire de droit constitutionnel de Michel de
Villiers et Armel Le Divellec, on trouve sur deux pages de définition une brève mention de
l’auteur après une définition générale : « Nation : Au sens le plus général, le terme de nation
désigne le groupe humain qui, à côté du territoire et d’une organisation politique, conditionne
le plus souvent l’existence de l’Etat » puis « 1. En tant que groupement historique, toute
nation est singulière ce que rend problématique d’en préciser la définition. […]. Dans sa
conception française, l’essentiel est ce "plébiscite de tous les jours" (E. Renan) où se
205 Le petit Larousse, Paris, Larousse, 2001, « Nation », p. 687.206 Pour le terme « territoire », cf. E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 72-74. Pour le terme « langue », cf. ibid., pp. 67-70.207 Il y a par exemple les cultures locales (bretonne, corse, basque ou alsacienne), les cultures nationales (française, allemande, espagnole, anglaise), mais aussi les cultures transnationales (européenne, magrébine, arabe, orientale, asiatique, anglo-saxonne) voire mondiales nées avec la mondialisation des échanges (par exemple la « culture » des réseaux sociaux ou du marché globalisé).
- 36 -
rejoignent une histoire commune et "un rêve d’avenir partagé" (G. Burdeau) »208. Ici on trouve
bien une mention de l’auteur, mais outre le fait que la définition générale souffre à peu près de
la même critique que celle formulée à l’encontre du dictionnaire Le petit Larousse, on peut
ajouter que la définition de la nation est non seulement peu claire, car la notion de plébiscite
n’est pas réellement expliquée, mais en plus, son explication est tronquée par une phrase de
George Burdeau alors que la même idée se trouve dans la conférence de Renan. Il aurait été
plus logique de garder la formulation originale de l’auteur plutôt que de lui en adjoindre une
autre. Prenons alors un troisième dictionnaire spécialisé qui fait office de référence pour les
étudiants en droit, le Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu. Dans celui-ci, à l’entrée
« Nation » au sens le plus général, voici ce qui est écrit : « 1. Dans l’analyse des éléments
constitutifs de l’Etat : la collectivité des individus qui forment un même peuple et sont soumis
à l’autorité d’un même *gouvernement ; communauté généralement fixée sur un territoire
déterminé dont la réalité résulte de caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles, de
coutumes sociales, de traditions historiques et religieuses, tous facteurs qui développent un
sentiment d’appartenance et des aspirations politiques trouvant leur manifestation essentielle
dans la volonté collective de s’ériger en corps politique souverain au regard du droit
international ». Encore une fois figure aux côtés des critères subjectifs relevés par Renan, des
critères objectifs, alors que celui-ci les avait écartés ou minorés. Même si l’on ne peut
s’attendre à ne voir que la définition de Renan à côté du mot nation, ni l’opposition
« définition allemande » et « définition française », on constate cependant que les éléments
des deux définitions sont agglomérés entre eux, comme si on avait oublié le rôle de Renan
dans cette définition et la primauté qu’ont occupé les critères subjectifs de Qu’est-ce qu’une
nation ? dans la définition de la nation française sous la Troisième République et jusqu’au
milieu du XXe siècle209.
Si les dictionnaires semblent avoir oublié Renan dans leur définition de la nation et
réciproquement oublié que Renan avait écrit Qu’est-ce qu’une nation ?210 , peut être a-t-on
plus de chance de trouver des mentions de Renan et de sa conférence dans des manuels
universitaires ?
On trouve dans un manuel d’histoire des idées politiques de 1970, trois pages
consacrées à Renan, dont une s’intéresse à « l’historien d’Israël » et une autre à « la définition
de la nation »211. Dans la bibliographe de ce manuel on trouve même la phrase suivante :
« Renan. – Les deux textes qui intéressent le plus directement la politique sont La réforme
208 M. de Villiers et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 6e, 2007, « Nation », p. 211.209 Infra., pp.58-67. et pp. 79-101.210 Le petit Larousse, op., cit., « Renan (Ernest) », p. 1624. Dans cet article, il n’est fait mention que des travaux de Renan portant sur la religion. Voir aussi Larousse thématique : Dictionnaire de la Philosophie, Paris, France Loisir, 1984, « Renan Ernest », pp. 257-258. Dans cet article sont abordés les travaux sur la religion et quelques autres écrits mais pas la conférence de 1882.211 M. Prélot, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, éd. 4e, 1970, pp. 547-549.
- 37 -
intellectuelle et morale, 1871 […] et Qu’est-ce qu’une nation ? […] »212. Dans les ouvrages
plus contemporains, on trouve un nombre de références à Renan inégal, mais comme point
commun que la conférence de 1882 n’est pas particulièrement exploité. Dans certains
ouvrages, on trouve quelques pages sur l’auteur dont certaines parties sont consacrées à la
définition de la nation, mais ce qui est écrit à propos de cette définition n’est qu’un simple
résumé sans réflexion autour de celle-ci213. Dans d’autres, on trouve plusieurs référence à
Renan, mais la conférence n’est que simplement citée214.
On peut aussi s’étonner de constater qu’en droit constitutionnel, alors qu’il est admis
que le pouvoir appartient à la nation, on ne trouve pas plus de développements sur elle et sur
Renan.
Il y a tout d’abord des ouvrages dans lesquels on ne trouve aucun développement sur
la nation et sur Renan. C’est le cas par exemple, du manuel de Bernard Chantebout dans les
six éditions publiées entre 2007 à 2012 alors qu’est abordée la question de la souveraineté
nationale215. On trouve aussi des ouvrages de droit constitutionnel qui parlent de la nation,
mais en donnant une définition très courte, sans grands développements. Comme il n’y a pas
de développements, l’opposition de la définition de Renan et celle des auteurs allemands n’est
évidement pas évoquée. C’est le cas des ouvrages de Patrick Fraisseix216, et de messieurs
Francis Hamon et Michel Troper. Dans le manuel de ces derniers, on trouve un amalgame
équivalent à celui des dictionnaires. En effet, à propos de la souveraineté nationale, voici la
définition de la nation faite par l’auteur : « la nation, c’est-à-dire une entité tout-à-fait
abstraite, qui n’est pas composée seulement des hommes vivant sur le territoire à un moment
donné, mais qu’on définit en prenant en compte la continuité des générations ou un intérêt
général qui transcenderait les intérêts particuliers »217. Les auteurs incluent donc la dimension
ethnique et territoriale dans leur définition, puisqu’ils prennent en compte la « continuité des
générations » et en partie les « hommes vivant sur le territoire à un moment donné ». Car si la
« continuité des générations », associée à l’abstraction, peut être entendue comme la
reformulation du critère subjectif que Renan appelait le « legs » ou « l’héritage » des ancêtres,
on peut aussi entendre la formulation de manière concrète et estimer qu’il s’agit d’une
212 Ibid., p. 712.213 J.-C. Ricci, Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, ed. 2, 2011, pp. 284-287.214 J. Touchard, Histoire des idées politiques du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, PUF, 2005, t. 2, pp. 690-691 et p. 712. Le nombre de page faisait référence à Renan est de vingt-deux.215 Les six éditions sont les suivantes : B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 24e, août 2007, p. 9. et p. 83. B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 25e, août 2008, p. 9 et p. 83. B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 26e, août 2009, p. 9 et p. 83. B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 27e, août 2010, p. 9. et p. 83. B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 28e, août 2011, p. 9. et p. 83. B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 29e, août 2012, p. 9 et p. 83.216 Constat réalisé sur les quatre éditions suivantes de son manuel : P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 2e, 2009, pp. 17-43. P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 3e, 2010, pp. 17-43. P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 4e, 2011, pp. 15-39. P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 5e, 2012, pp. 17-41.217 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, éd. 30e, 2007, p. 195.
- 38 -
continuité ethnique, et donc, de l’association de « la race » dans la définition. Toujours à
propos de la souveraineté nationale, les auteurs ont des formulations intéressantes : « Il est
donc compréhensible que les gouvernants se servent eux aussi de cette construction et
justifient le pouvoir qu’ils exercent en se présentant comme des représentants de son titulaire
véritable, le souverain, qui peut être le peuple, la nation ou toute autre entité »218. Or, comme
pour tous les ouvrages de droit constitutionnel mentionnés précédemment, il convient de
formuler une critique à la lecture de cette explication. En effet, la nation est ici à la fois mêlée
et distinguée du « peuple » et de « toute autre entité ». Mais, dès lors que l’on parle de la
souveraineté populaire et de la souveraineté nationale, comment distinguer clairement ces
deux concepts s’il n’a pas été au préalable défini ce qu’était la nation ? Sans un prérequis du
lecteur, c’est impossible, car l’amalgame « peuple » et « nation » est fréquent, notamment à
cause du raccourci qui est fait à propos de la Révolution française et du contrat social : les
Révolutionnaires influencés par Rousseau ont donné le pouvoir démocratique au peuple, qui a
pu exercer sa souveraineté nationale. Il est possible d’opposer à cette argumentation que le
droit constitutionnel est un droit technique, et que les manuels s’attachent à en étudier les
mécanismes juridiques de la matière. Mais nous maintiendrons que dès lors qu’est abordée la
question de la Révolution et des constitutions qui en découlent ; que dès qu’est abordée la
question de la souveraineté et des modes de suffrages qui sont ou non ouverts aux étrangers
ou aux ressortissants de l’Union Européenne, alors la question de la nation devrait être étudiée
sous toutes ses formes afin que le lecteur comprenne clairement les distinctions opérées par
l’auteur. Et la base de cette présentation, c’est l’opposition « conception allemande » et
« conception française », qui permet de comprendre l’évolution des recherches et ce qu’on
entend par le mot « nation » en France.
Certains auteurs l’ont bien compris et poussent un peu plus la démonstration. C’est le
cas d’Anne-Marie Le Pourhiet qui dans son manuel de droit constitutionnel, écrit : « A cette
thèse organiciste et ethnocentriste, s’oppose la thèse "française" issue de la philosophie des
Lumières et de la Révolution qui ne néglige nullement les facteurs objectifs mais insiste
cependant sur un élément subjectif essentiel à ses yeux : le vouloir vivre collectif. C’est le
sentiment des individus d’appartenir à une collectivité différente des autres et leur volonté
corrélative de constituer une entité commune et distincte qui constitue le critère principal de la
nation. Celle-ci serait donc avant toute chose et essentiellement un vouloir vivre ensemble, un
"plébiscite de tous les jours" (Renan) »219. Bien que nous puissions contester la définition
proposée220, sa présentation des débats entourant la nation et les définitions proposées font
comprendre au lecteur quelle est la définition retenue pour la suite de l’ouvrage, et lui
permettent donc de comprendre des explications telles que : « L’article 3 de la Constitution de 218 F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, éd. 32e, 2011, pp. 183-184.219 La formulation est la même dans différentes éditions de son manuel que nous donnons ici : A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 2e, 2008, p. 5. A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 3e, 2010, p. 5. A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 4e, 2012, p. 5.220 Voir infra pp. 79-90.
- 39 -
1958 affirme : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne
peut s’en attribuer l’exercice". Elle s’inscrit ainsi dans la tradition qui remonte à la
Déclaration de 1789 dont l’article 3 affirme aussi solennellement "Le principe de toute
souveraineté réside dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en
émane expressément" »221. Enfin, la définition de la nation reprenant cette fois expressément
Renan et se fondant en partie sur sa définition, est celle qu’on trouve dans le manuel de
Marie-Anne Cohendet, qui écrit : « Le concept de nation est défini de manière variable selon
les pays. En France, la conception de Renan reste célèbre. "Une nation est une âme, un
principe spirituel. Deux choses qui n’en font en réalité qu’une la constituent : l’une est la
possession en commun d’un riche legs de souvenirs, l’autre est le consentement actuel, le
désir de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis". Ce concept
reçoit une acception variable selon les valeurs de ceux qui l’évoquent, et celles de Renan
étaient marquées », et « S’agissant d’un sentiment, la nation n’est pas un concept strictement
juridique. Cependant, il est souvent évoqué en droit, parce qu’il peut avoir une influence sur
le fonctionnement du droit, et particulièrement sur le choix de l’organisation de l’Etat
[…] »222.
Ainsi, si les universitaires français semblent avoir gardé parfois une trace de l’idée de
l’auteur dans leurs propres réflexions, il est intéressant de constater que Renan est mentionné
dans des travaux aux thématiques particulières et surtout, par des auteurs étrangers.
§ 2 : L’importance de l’idée de nation renanienne dans les travaux étrangers
Les travaux à propos de Renan qui abordent la question de la nation renanienne,
concernent le champ très particulier du colonialisme et de l’antisémitisme. En effet, Renan
France pour certains auteurs comme l’un des pères de l’antisémitisme du milieu du XIXe et
du début du XXe siècle, ainsi que le fer de lance du colonialisme qui se serait fondé, sur ses
propos sur les « races sémites » et sur son idée de nation223. On constate que les travaux les
plus importants ont été réalisés par un français d’origine marocaine Maurice-Ruben Hayoun,
mais aussi par l’Israélien Zeev Sternhell, ainsi qu’Edward Wadie Said, un auteur palestinien
naturalisé américain.
221 La formulation est la même dans différentes éditions de son manuel que nous citons ici : A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 2e, 2008, p. 273. A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 3e, 2010, p. 275. A.-M. Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 4e, 2012, p. 277.222 La formulation est la même dans différentes éditions de son manuel que nous citons ici : M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 3e, 2006, pp. 157-158. M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 4e, 2008, pp. 187-188. M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 5e, 2011, pp. 202-203.223 Pour plus de détails sur ces études et sur les auteurs que nous allons citer, voir infra, pp. 58-78.
- 40 -
Sur des travaux qui concernent spécifiquement la nation ou la nationalité, on trouve
des articles qui se basent plus ou moins fortement sur Renan. En Suisse par exemple, on
trouve un article d’Eleanor Cashin Ritaine, une avocate d’origine irlandaise qui fut un temps
directrice de l’Institut de droit comparé de Lausanne et qui en introduction, fait référence à
Renan pour présenter brièvement les différentes conceptions de la nation224. On trouve aussi
une mention de Renan faite par Andreas Wimmer, aujourd’hui professeur à l’Université de
Californie Los Angeles, dans un article qu’il écrivit alors qu’il était encore en Suisse à
l’Université de Zurich. La mention qui sert d’introduction fait une dizaine de lignes et
rappelle la définition de Renan et le contexte dans laquelle elle a été formulée225. En Israël,
outre Zeev Sternhell, on trouve des mentions sur Renan faites par Shlomo Sand. Dans son
ouvrage Comment le peuple juif fut inventé, qui a pour but d’essayer de définir ce qu’est la
nation israélienne, si tant est qu’elle existe, cet enseignant de l’Université de Tel-Aviv évoque
plusieurs fois Renan. Dans cet ouvrage il reconnaît que Renan a été un précurseur des travaux
sur la nation même si selon lui les travaux les plus importants sont ceux d’Ernest Gellner,
pour rappeler qu’il avait affirmé que le monothéisme n’était pas le fait du christianisme, mais
bien du judaïsme, ou simplement pour lier sa pensée à celle d’autres auteurs226. Il est aussi le
premier auteur israélien à avoir traduit en hébreux les conférences Qu’est-ce ce qu’une
nation ? et Le judaïsmes comme race et comme religion, prononcées par Ernest Renan en
1882 et en 1883, afin que ses étudiants puissent avoir accès à ces textes227. Il accompagne
également sa traduction de trois articles explicatifs, sur Renan et les deux conférences228.
Renan est également mentionné par des auteurs anglais. Ernest Gellner justement,
d’origine tchèque mais qui étudia, vécut et fit toute sa carrière universitaire en Angleterre,
mentionne Renan dans ses ouvrages. C’est le cas par exemple de Nation et nationalisme, où il
critique la définition de Renan qu’il trouve incomplète229, ou dans Culture, Identity and
Politics, ouvrage dans lequel il cite Renan sans le traduire230. On peut aussi mentionner
Nation et nationalisme depuis 1780 d’Eric Hobsbawm. Dans cet ouvrage, cet universitaire
anglais d’origine autrichienne fait lui aussi référence à Renan, mais au contraire de Gellner,
pour admirer la qualité de sa conférence par rapport aux travaux sur la nation des autres
224 E. Cashin Ritaine, « Nationalité étatique : un état des lieux juridique », La nationalité dans le sport - enjeux et problèmes, Université de Neuchâtel, Editions du CIES, 2006, p. 15-30.225 A. Wimmer, « L’Etat-nation, une forme de fermeture sociale », Archives Européenne de Sociologie, t. 37, p. 163.226 S. Sand, Comment le peuple juif fut inventé : de la bible au sionisme, Paris, Flammarion, 2010, pp. 75-76, p. 160, pp. 177-179, p. 295 et pp. 505-506.227 S. Sand, « Note aux lecteurs français » in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 113-114.228 S. Sand, « Renan l’inclassable », in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 9-19. S. Sand, « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 21-30. S. Sand, « D’Ernest Renan à Raymond Aron », E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 31-43.229 E. Gellner, nations et nationalisme, traduit par Bénédicte Pineau, Paris, Payot, 1999, p. 84.230 E. Gellner, Culture, Identity and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 6-12 et pp. 24-27.
- 41 -
auteurs du XIXe siècle231. Il faut aussi mentionner la traduction de Qu’est-ce qu’une nation ?
et l’article à son sujet de Martin Thom, professeur à l’université de Birmingham, dans Nation
and narration de Homi K. Bhabha. La traduction qui se trouve dans cet ouvrage est la seule
qui ait été faite en anglais, ce qui en fait la traduction de référence dans les milieux
universitaires anglo-saxons232. Quant à l’article qui suit cette traduction, il concerne les
possibles influences qu’auraient exercées d’autres auteurs, comme Fustel de Coulanges, sur
Renan et qui permettraient ainsi d’expliquer la conférence en la replaçant dans son contexte233.
Pour terminer sur cette liste non exhaustive de travaux et d’auteurs anglais, citons Maurizio
Viroli, professeur à l’université de Princeton, qui mentionna Renan dans son ouvrage For
Love of Country234.
Enfin, il faut mentionner les travaux que nous qualifierons de « réception indirecte »
sur Renan. Ces travaux abordent Renan mais en s’intéressant non pas à Renan directement,
mais à d’autres auteurs qui ont étés influencés par les travaux de Renan. C’est le cas par
exemple du livre de M. A. Font et A. W. Quiroz, à propos de José Martí. Selon les travaux de
ces deux auteurs, José Marti, un révolutionnaire cubain du XIXe siècle, aurait traduit une
partie de la conférence de Renan Qu’est-ce qu’une nation ? deux semaines après que celle-ci
eut été prononcée : « In Martí’s translation of a brief excerpt of Renan’s famous speech,
"Qu’est-ce qu’une nation ?" only two weeks after Renan delivered it, […] »235. Ce qui
intéresse les auteurs n’est pas tant que Renan ait été traduit aussi rapidement, mais que Martí
admette que Renan a eu une influence décisive sur sa conception de la nation : « In 1885,
Martí reveals the influence of Ernest Renan on his own political conception when he refers to
the nation as : that communion of spirits, […] »236.
Une autre réception indirecte de Renan est faite en étudiant un auteur brésilien : Mário
de Andrade. Cet intellectuel brésilien a écrit un court article dans le journal militaire O Fanal,
intitulé « Noção de Pátria »237. Rita Olivieri-Godet qui s’intéresse à cet article, note
l’existence de similitudes de structure et de propos entre l’article d’Andrade et la conférence
de Renan. De plus, il est attesté que Andrade possédait un exemplaire de Qu’est-ce qu’une 231 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, Paris, Gallimard, 1992, p. 13, pp. 23-24, pp. 32-33, p. 52, p. 75, pp. 87-88 et p. 167. 232 M. Thom, « What is a nation? », in H. K. Bhabha (dir.), Nation and narration, London, Routledge, 1990, pp. 8-22.233 M. Thom, « Tribes within nations : the ancient Germans and the history of modern France », in ibid., pp. 23-43.234 M. Viroli, For Love of Country: An Essay On Patriotism and Nationalism, s.l., Oxford University Press, 1997, p. 160.235 M. A. Font et A. W Quiroz, The Cuban Republic and José Martí, Oxford, Laxington Books, 2006, pp. 120-120. « Dans la traduction de Martí d’un bref extrait de la fameuse conférence de Renan "Qu’est-ce qu’une nation ?" seulement deux semaines après que Renan l’ait prononcée, […] ».236 « En 1885, Martí révèle l’influence d’Ernest Renan sur sa propre conception politique quand il fait référence à la nation comme : cette communion des esprits, […] » (Ibid., p. 120). Nous n’avons pu retrouver le texte original en espagnol, car l’intégralité des Obras Completas de José Martí ne sont pas disponibles en France. Nous renvoyons donc aux traductions et références faites par Messieurs Font et Quiroz dans leur ouvrage.237 Voir le texte joint en annexe 2. Pour une biographie de Andrade, voir M. De Andrade, Macounaïma, Paris, Stock/ Unesco/ ALLCA XX, traduction française de Jacques Thiériot, 1996, pp. 9-15.
- 42 -
nation ? dans sa bibliothèque sans que l’on soit sûr qu’il l’ait lu. Mais en s’intéressant aux
points de concordance entre les deux textes, l’auteur laisse entendre qu’Andrade aurait bien lu
la conférence238 et que sa vision de la nation, à une exception près, aurait subi l’influence de
Renan.
Il apparaît alors que les chercheurs étrangers font bien plus référence à Renan que
leurs homologues français. L’une des raisons est peut être que l’auteur est français et que de
son vivant il faisait déjà l’objet de critiques et commentaires, sa définition nous semble
évidente. Comme si nous l’avions intériorisé, convaincus que sa définition était naturelle,
alors que pour des étrangers elle semble novatrice parce que moins usuelle, et plus
intéressante quand ils découvrent que leurs propres auteurs de référence ont été influencés par
Renan. Pourtant, le fait que Renan soit évoqué quand il s’agit de réfléchir au concept de
Nation et de l’intégrer dans notre corpus législatif, et surtout l’incohérence entre les
références qui sont faites à l’auteur, montre alors que cette définition n’est pas maîtrisée à la
perfection. Si elle sème le trouble et que son évocation n’est pas aisée, c’est peut être parce
que cette définition renanienne de la nation n’est plus applicable en tout ou partie de nos
jours.
238 R. Olivieri-Godet, in Ernest Renan et le Brésil, op. cit., pp. 115-128.
- 43 -
Chapitre 3 : La raison de l’oubli : la péremption de la théorie de Renan
Si Renan est aujourd’hui largement oublié alors qu’il était l’un des auteurs les plus
prolifiques de sa génération, ce n’est pas à cause d’un effet de mode. Si on se souvient
d’auteurs comme Platon, Descartes, ou plus contemporains comme Orwell, c’est parce que
leurs textes et les idées qu’ils contiennent, font écho à la société contemporaine. Mais il ne
suffit pas de faire écho, et ainsi, bien que « "Qu’est-ce qu’une nation ?" […] continue encore
aujourd’hui d’éveiller une grande curiosité grâce à sa pertinence et à sa fraîcheur »239, il lui
manque une qualité essentielle : son intangibilité. En effet, la définition renanienne de la
nation serait insuffisante en soit, et de nouvelles écoles de pensée seraient apparues proposant
d’autres fondements à l’idée de Nation que ceux proposés par Renan ou s’intéressant à des
aspects que celui-ci ignorait (section 1). Mais bien que ces nouveaux auteurs proposent des
définitions de la nation plus actuelles, il n’en demeure pas moins qu’elles restent attachées à
la conception renanienne (section 2).
Section 1 : La caducité de la définition face aux nouveaux courants
Plusieurs auteurs contemporains critiquent la définition de la nation posée par Renan.
Ces critiques résultent de divergences dans l’interprétation, d’analyses d’échecs, ou sur des
erreurs de fond qu’aurait commis l’auteur (§1). Une fois l’analyse des critiques effectuée, il
conviendra alors d’exposer la pensée de chacun des auteurs, pour voir sur quoi il faudrait,
selon eux, fonder la nation (§2).
§ 1 : La critique de la définition renanienne de la nation
Pour comprendre l’objet des critiques, il faut partir d’un constat qui se dresse en lisant
la conférence à rebours. Tout à la fin de sa conférence, Renan prophétise que « les nations ne
sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération
européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous
vivons »240. Finalement dans cette idée de « congrès des France d’Europe, jugeant les nations,
s’imposant à elles, […] »241, appelé aussi « fédération européenne » qui « peut ainsi offrir une
base de médiation semblable à celle que l’Eglise offrait au Moyen-Age »242, beaucoup y ont
vu l’annonce de l’Union Européenne actuelle. Partant, on pourrait penser que Renan,
visionnaire, entrevoit la mondialisation comme terme de cette fin des nations puisqu’il est aisé
d’opérer une translation de l’idée à un domaine plus large. En réalité, certains crient haro sur
239 S. Sand, « Note aux lecteurs français » in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 113.240 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 76.241 E. Renan, « Lettre A M. Strauss, 13 septembre 1870 », Œuvres complètes, op. cit., p. 446.242 Ibid., p. 446.
- 44 -
ce faux prophète. On a pu, par exemple, constater que « cette vision candide, qui veut que la
multiplication des échanges économiques, la constitution de réseaux de communication
mondiaux, la diffusion d’une culture de masse standardisée conduisent à une dilution des
spécificités nationales, un effacement progressif entre les peuples […] »243, est loin de
produire les résultats espérés car d’une part « les frontières prolifèrent alors même que la
mondialisation progresse »244, et que, d’autre part, si « le nationalisme se trouv[ait] dépassé
par l’évolution de l’histoire mondiale. […] comment expliquer, a contrario, la concomitance
entre l’approfondissement graduel de la mondialisation et l’essor des revendications
nationalistes ? »245. Ce constat selon lequel la mondialisation accroît le sentiment national au
lieu de le dissoudre comme cela avait été annoncé, n’est pas propre à Alain Dieckhoff. Patrice
Canivez dresse le même constat d’une résistance à la mondialisation246. Anne-Marie Thiesse
quant à elle, admet que « les nouvelles formes de la vie économique exigent la constitution
d’ensembles plus vastes que les Etats-nations » mais constate que « l’identité supranationale
de l’Union européenne devient un espace juridique, économique, financier, policier,
monétaire : ce n’est pas un espace identitaire. […] Et si les pères de l’Europe l’avaient
instituée en oubliant de la construire ? »247.
En fait, ce constat annonce la première et la plus grande des critiques. En réalité, la
prévision de Renan est juste, si on admet l’idée générale de sa conférence selon laquelle une
nation est fondée sur des critères subjectifs, dont l’adhésion volontaire à la construction
d’ensemble. Dans ce cas, effectivement, il suffit que la majorité ou la totalité des citoyens de
deux ou plusieurs nations soient d’accord pour fusionner dans un ensemble plus grand pour
que cela fonctionne. Selon certains auteurs, le problème serait alors le fait qu’une nation ne
puisse pas se fonder uniquement sur des éléments subjectifs. La base de cette critique, c’est le
débat qui existe entre les auteurs qui considèrent que Renan exclut les critères objectifs248 et
ceux qui pensent qu’il ne les exclut pas totalement mais que pour lui, ces éléments ne sont pas
243 A. Dieckhoff, La Nation dans tous ses Etats, op. cit., p. 20. Alain Dieckhoff est directeur de recherche au CNRS et enseigne à SciencesPo Paris.244 Ibid., p. 20.245 Ibid., p. 21.246 P. Canivez, Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., pp. 45-65. Ce professeur de Philosophie nous livre entre ces pages une analyse de la façon dont la culture nationale se forme et comment se crée le rapport entre Etat, nation et démocratie, tout en confrontant son analyse à la mondialisation.247 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, éditions du Seuil, 2001, p. 18.248 M. Viroli, For Love of Country: An Essay On Patriotism and Nationalism, op. cit., p. 160 : « As Renan remarks, the idea of the nation as a combination of a political principle and a culture made of people’s memories of sacrifices and suffurings reflects eighteenth-century universalism. The doctrines that give priority to culture, race, or language over the political ideal of the republic are, on the contrary, to be regarded as an intellectual and moral degeneration ». « Comme le remarque Renan, l’idée d’une nation comme une combinaison de principes politiques et d’une culture créée par le souvenir des sacrifices et des souffrances des individus, reflète l’universalisme du dix-huitième siècle. Les doctrines qui donnent la priorité à la culture, la race ou la langue par rapport à l’idéal politique de la république sont, au contraire, à considérer comme une dégénérescence intellectuelle et morale». C’est aussi l’idée de Marcel Prélot dans Histoire des idées politiques, op. cit. et celle de Patrice Canivez dans Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., p. 29.
- 45 -
fondamentaux ou autosuffisants249. Nous ne le trancherons pas ici, mais nous garderons à
l’esprit l’existence de ce débat. Nous ne pouvons cependant que constater, comme la plupart
des auteurs, que la définition de Renan confine au tautologisme. Cette boucle est parfaitement
résumée dans la phrase suivante : « la force de cette définition subjective, c’est l’évidence
qu’il n’y a pas de nation sans conscience nationale. Sa faiblesse, c’est qu’on ne voit pas
comment il pourrait y avoir conscience nationale si les individus n’avaient rien de concret en
commun »250. Et, en effet, la critique est juste car, pour vivre ensemble, il faut une base.
Renan, nous le savons, prend l’Histoire comme référence de base, mais c’est le « riche legs »
de nos ancêtres, et ce legs est bien constitué par la langue, la race, la religion, ou tout autre
critère objectif. Cette carence ayant d’ailleurs déjà été relevée par les récipiendaires de l’idée,
dès 1882. A cette époque José Martí, en traduisant la conférence de Renan deux semaines
après qu’il l’ait prononcée, interpole le texte en valorisant le rôle de la langue, ou en
supprimant les passages la critiquant251. Plus tard, le brésilien Andrade reprendra l’idée en y
incluant la notion de race252.
Autre critique, qui est corrélée à la précédente et qui expliquerait ce débat et cette
erreur de l’auteur, c’est que sa conférence était circonstanciée. En effet, certains pensent que
la conférence de Renan était en fait une simple critique de la pensée allemande et une
justification du retour de l’Alsace et de la Moselle dans le giron de la France. Cet événement
en est la source pour Alain Dieckohff qui estime que « cette vision binaire [conception
objective et subjective], est née, comme on le sait, dans les circonstances historiques bien
particulières des années 1870, autour de la question de l’Alsace-Moselle. Aux historiens
allemands [...] leurs homologues français (Renan, Fustel de Coulanges) répondirent en
défendant le droit des Alsaciens de demeurer français si tel était leur choix politique »253. Ces
circonstances seraient même fondamentales pour comprendre la conférence de Renan selon
Martin Thom254, mais aussi selon Hervé Beaudin255 et selon Shlomo Sand256. Enfin pour
Maurice Gasnier, cette conférence n’est qu’une simple expression de l’opinion de Renan sur 249 S. Sand, « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 25-26. F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit.,, p. 13. E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 24. H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 148., pp. 224-223 et pp. 228-229.250 P. Canivez, Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., p. 29. Pour cette même idée voir H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 240. E. Gellner, nations et nationalisme, op. cit., p. 83-84. E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 23.251 M. A. Font et A. W Quiroz, The Cuban Republic and José Marti, op. cit., pp. 119-121.252 Voir annexe 2.253 A. Dieckhoff, La Nation dans tous ses Etats, op. cit., p. 58.254 M. Thom, « Tribes within nations : the ancient Germans and the history of modern France », in H. K. Bhabha (dir.), Nation and narration, , op., cit., p. 23 : « Une plus profonde compréhension de la position de Renan en 1882, requerrait une analyse des débats polémiques entre les savants et les politiciens Français, Allemands, Anglais et Italiens, dans l’après guerre Franco prussienne, au regard de la dispute portant sur l’Alsace et la Lorraine, […] ».255 « Pour bien comprendre les idées de Renan sur la nation, il faut se replacer dans le contexte de l’époque où elles furent énoncées. Renan intervient plus de onze ans après la défaite de Sedan […] et la perte concomitante de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine (la Moselle) au bénéfice de la Prusse. Il lui faut donc prouver que ces territoires, de race et de langue germaniques, n’en sont pas moins éminemment français, de cœur et de raison » (H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 218).256 S. Sand, « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 27-30.
- 46 -
le refus de l’annexion des territoires français par le Reich257. Cette conférence serait alors
fortement connotée ce qui expliquerait que Renan maquille les critères objectifs avec un faux
rejet. Cela accrédite la thèse selon laquelle Renan ne rejette pas complètement les critères
objectifs, et en ce cas permet de comprendre pourquoi la conception de Renan semble
présenter des carences.
La dernière critique adressée à la théorie de Renan est double. D’une part, celle-ci ne
développe pas la façon dont la cohésion nationale, qui mène au plébiscite, se crée et que,
d’autre part, elle est obsolète car, du fait qu’elle est inscrite dans son siècle, elle ne prend de
facto pas en compte les évolutions de la société qui ne pouvaient être anticipées.
Le premier point est développé par Eric Hobsbawm qui remarque qu’au début du
XIXe siècle, on ne savait pas qui pouvait se constituer en nation parmi tous les peuples
d’Europe, et parmi les Etats existants qui avait un caractère national. Il constate alors que les
réflexions sur la nation sont entourées d’un « surprenant flou intellectuel »258 car les auteurs
libéraux de l’époque « présumai[en]t qu’il n’était pas nécessaire de l’énoncer puisqu’il [le
problème] était déjà évident »259. Ainsi, puisque les enjeux autour du problème sont connus,
alors effectivement ce n’est pas la peine de formuler ce qui est évident pour tous. De là
découle le fait que « des observateurs comme J. S. Mill et E. Renan ne s’inquiétaient guère
des éléments qui constituaient le "sentiment national" – ethnie (en dépit de l’intérêt passionné
des victoriens pour la "race"), langue, religion, territoire, histoire, culture et le reste -, parce
que, politiquement, le fait d’attribuer à tel ou tel autre de ces éléments un rôle plus décisif
qu’aux autres n’avait pas encore beaucoup d’importance »260. Shlomo Sand aussi constate que
les travaux de Renan ne sont pas complets : « malheureusement, aucun de ces deux auteurs
[Mill et Renan] n’a écrit d’œuvre systématique et étendue sur la nation. Le XIXe siècle n’était
pas encore mûr pour cela »261.
Enfin, le second volet de la critique adressée à ce texte, est qu’il est dépassé. En effet,
comme nous l’avons vu au début de ce paragraphe, la société de la fin du XXe et du début du
XXIe siècle, est confrontée à la mondialisation, phénomène qui n’était pas connu des penseurs
du XIXe siècle. Et quand bien même d’aucuns argueraient que la colonisation est une forme
de mondialisation, que les deux dernières guerres ont été mondiales, et qu’il existait des
systèmes de communication comme le télégraphe, cela n’est pas comparable avec une société
avec des réseaux sociaux et des téléphones permettant des échanges instantanés, une
économie mondialisée et une culture standardisée. Un autre oubli est l’économie. Pour Renan,
nul trace du développement économique comme facteur de développement d’une nation, alors
que les auteurs contemporains constateront l’importance de ce facteur262. De même, le 257 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., p. 114.258 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 53.259 Ibid., p. 53. Pour le développement complet voir aussi la p. 52.260 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 87.261 S. Sand, Comment le peuple juif fut inventé : de la bible au sionisme, op. cit., p. 76.262 Comme Gellner par exemple dans E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit.
- 47 -
philosophe n’aborde pas la question de l’éducation nationale dans sa conférence, ce qui
rejoint la critique sur les carences de sa définition. En effet, lui qui réclamait une réforme de
l’éducation aurait du prévoir qu’une éducation nationale serait un catalyseur du sentiment
national263.
Dès lors que la critique est faite, voyons comment les différents auteurs que nous
avons cités envisagent la nation, en voyant sur quels points chacun envisage son approche de
ce qui fonde le sentiment national dont Renan aurait oublié de parler.
§ 2 : Les nouveaux fondements de la nation : une redéfinition des bases.
La définition renanienne de la nation serait donc imparfaite et de ce fait, partiellement
ou totalement surannée. C’est pourquoi différents auteurs ont proposé de nouveaux éléments
comme base de la nation, ou en ont fait ressortir d’autres qui existaient déjà.
Le premier auteur à proposer une définition originale est Ernest Gellner (1925-1995).
Celui qui enseigna à la London School of Economics, puis à Cambridge, proposa une
définition novatrice de la nation dans Nation and Nationalism264. Il est alors le premier à lier
le développement économique avec le développement du sentiment national. Pour en arriver à
cette conclusion, il part de ce qu’on pourrait appeler « l’état de nature des nations », qui se
situe à l’époque agraire, c’est-à-dire aux alentours du Moyen-âge. A cette période, la société
est divisée entre l’élite intellectuelle (les clercs et les nobles) et le peuple, majoritairement
composé de paysans, dont le principal souci est de ne pas communiquer avec la même langue.
En effet, chaque territoire va développer un patois local, alors que l’élite elle va parler une
langue transitive, en l’occurrence le latin265. De ce fait, il ne peut y avoir de développement
d’une culture commune entre tous les habitants d’un pays, puisque chacun développe une
culture locale qu’il ne peut échanger avec les autres faute de parler un même langage. Il y a
donc plusieurs codes culturels et linguistiques. Cependant, au fil de l’évolution historique, les
dirigeants vont chercher à accroître leurs possessions et à maximiser leurs profits afin de
rivaliser avec les autres royaumes. Ils commencent donc à essayer d’unifier les cultures et les
langues autour d’un référentiel commun266. Mais il faut en réalité attendre l’époque
industrielle pour que cette unité soit réalisée, parce que c’est à cette époque que la langue et la
culture communes se forgent réellement267. La raison est qu’en fait l’industrialisation impose
une sorte de division du travail aux individus268. Ces derniers deviennent dès lors
263 Ibid. Voir aussi P.-E. Fageol, « Le patriotisme au lycée de Saint-Denis […] », Histoire de l’éducation, op. cit., pp. 43-64. J. P. Rioux, La France perd la mémoire, op. cit., p. 230 et supra., pp. 15-26.264 E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit.265 Ibid., pp. 25-26.266 Ibid., pp. 38-39.267 Ibid., p. 39, pp. 53-55.268 Ibid., p. 42.
- 48 -
interchangeables. En effet, les nouveaux métiers créés par l’industrialisation sont plus
perméables que ceux du milieu agraire puisqu’ils jouissent d’une culture et d’un langage
technique proches qui, une fois acquis, permettent aux individus de se comprendre et de
travailler en groupe à différents postes269. Mais pour que cela soit réalisé, il faut un élément
indispensable et qui n’apparaît qu’à l’époque industrielle : une école nationale qui va
apprendre ce référentiel commun à toute la population, afin de standardiser les individus et de
créer un sentiment national270.
D’autres auteurs estiment eux aussi qu’une école nationale est essentielle dans la
construction de la nation. C’est la position de Françoise Lorcerie pour qui l’école, notamment
celle de la Troisième République, a été fondamentale dans le développement du sentiment
national271. Pour elle, l’élément primordial de cette construction n’est cependant pas
l’économie, qu’elle n’intègre pas dans son analyse, mais le critère ethnique inculqué par cette
école. Pour elle, l’ethnicité « désigne le fait qu’une partition est instaurée socialement entre
Eux et Nous, partition référée à une "différence" naturalisée »272. Ce critère se révèlerait le
plus important puisque « de fait, les processus ethniques ont un lien étroit avec l’Histoire
nationale. Les croyances ethniques qui ont le plus d’emprise sociale sont celles qui ont une
consistance historico-politique »273 et que cette notion d’ethnie recouvrerait une grande partie
des autres critères qui pourraient fonder la conscience nationale274. Cette ethnicité serait donc
attisée par l’école qui nous apprendrait à distinguer « Nous » de « Eux ».
Une autre critique formulée à l’encontre de Gellner est celle d’Eric Hobsbawm : « Si
je devais exprimer une critique concernant le travail [de Gellner], ce serait qu’il a privilégié la
perspective de la modernisation par en haut, ce qui le gêne pour apporter l’attention voulue à
la vision par le bas »275. Et cette construction « par le bas », viendrait en grande partie de la
langue276. En effet les langues régionales étaient alors appelées à disparaître, car en accord
avec Gellner, il considère que pour forger une nation, il faut une langue transitive apportée par
l’école277. Pour autant, les langues régionales n’ont pas toutes disparu car certains Etats
continuèrent à favoriser des productions littéraires dans ces langues. L’auteur pense que c’est 269 Ibid., pp. 88-89.270 Ibid., pp. 55-61.271 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 13 et p. 65.272 Ibid., p. 11.273 Ibid., p. 12.274 Ibid., p. 14.275 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 29. Puis il ajoute « Cette vision de la nation par en bas, c’est-à-dire du point de vue non pas des gouvernements ou des porte-parole et militants des mouvements politiques (nationalistes ou non), mais par les gens ordinaires qui sont objet de leur action et de leur propagande, est extrêmement difficile à découvrir ».276 Ibid, pp. 35-49. En effet il développe l’étymologie du mot « nation » dans différentes langues, les aspects que ce mot recouvre et donc comment en fonction de la signification de ce mot les peuples perçoivent la nation.277 Ibid., p. 119. Cependant toujours dans la critique envers Gellner, il estime que l’acquisition de la langue par l’école est un processus tardif : « c’est en général par le biais de l’instruction publique et d’autres mécanismes administratifs que la langue officielle ou culturelle des dirigeants et de l’élite finit par devenir la langue des Etats modernes. Cependant, ce n’est là qu’une évolution tardive. Elle n’affecte qu’à peine la langue du petit peuple à l’époque prénationaliste et, en tout cas, avant que ce peuple n’ait accès à l’instruction ».
- 49 -
parce qu’elles ne faisaient pas concurrence à la langue nationale278, mais on peut penser
comme Anne-Marie Thiesse, que ces productions étaient faites pour rattacher les nations à un
passé identitaire279. Eric Hobsbawm n’oublie cependant pas qu’il existe d’autres critères280, et
va jusqu’à reconnaître que parfois la langue n’est pas le socle fondamental de l’identité
nationale et que d’autres critères jouent281. Enfin, selon lui, la langue reste malgré tout le
moyen le plus simple de fonder une nation notamment quand elle est pluriculturelle au sens
large du terme, comme le montrent les exemples de l’Albanie ou de la France282.
Enfin283, une autre théorie plus proche de celle de Renan se base sur l’Histoire. En
effet cette fameuse Histoire qui donne des héros aux nations, une culture propre à chacune
d’entre elles, serait ce sur quoi elle se fonde. Anne-Marie Thiesse développe cette idée dans
La création des identités nationales, Europe XVIIIe-XXe siècle. Si elle admet que l’évolution
sociale et économique est effectivement une part non négligeable de la formation d’une nation284, elle estime que ce qui prime, c’est tout le collectage285 initié par les différents pays, qui va
constituer « l’héritage commun » dont parle Renan286. Ainsi une nation se construirait sur un
patrimoine de chant287, ou de contes et légendes avant tout autre chose. Cette idée ce
rapproche de celle de Jean-Pierre Rioux que nous avons développée précédemment.
Section 2 : Les nouvelles définitions de la nation.
Il n’y a pas que les fondements de la nation qui changent. En effet, dès lors qu’on
admet que la définition de la nation de Renan est incomplète et qu’on tente d’y ajouter des
éléments constitutifs du sentiment national, c’est plus largement la définition de la nation qui
est remise en cause (§1). Pourtant, malgré ce changement, il semble que la définition de
Renan, bien que partiellement dépassée, serve toujours de fondement à toutes les autres
définitions (§2).
278 Ibid., pp. 71-75279 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, op. cit. Plus largement madame Thiesse s’intéresse à tout le champ du collectage, c'est-à-dire aussi bien l’écrit que le champ, l’image.280 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., pp. 76-77.281 Ibid., p. 100.282 Ibid., pp. 103-104.283 En réalité deux autres auteurs au moins auraient pu être inclus dans ce paragraphe, mais par souci de simplicité et d’espace, nous ne les traiterons pas ici, mais nous renvoyons à leurs écrits. Il s’agit de Benedict Anderson dans B. Anderson, Imagined communities, London, Verso, 2006 et Hervé Beaudin qui établit une critique de chaque auteur que nous venons d’aborder, mais dont le développement de la pensée aurait mérité un paragraphe entier qui se serait éloigné du sujet. Pour ces citriques voir H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit.284 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, op. cit., p. 15.285 Terme désignant généralement l’action de collecter, mais ici plus précisément le fait de chercher d’anciennes musiques, d’anciennes histoires, légendes, ou tout autre chose appartenant à la culture d’une région. 286 Ibid., p. 173.287 Ibid., pp. 169-171.
- 50 -
§ 1 : L’alliance de la conception objective et subjective de la nation
Comme nous l’avons vu, la plupart des auteurs considèrent que, dans la définition de
Renan, il manque l’explication de la naissance du « sentiment national », laquelle ne peut être
réalisée qu’à partir de critères objectifs ou de l’Histoire, que nous considérons ici plus comme
un élément subjectif puisqu’elle peut être interprétée en fonction des références choisies.
Pourtant, tous admettent que de simples critères objectifs ne suffisent pas. Pour Gellner, la
culture, qui est chez lui un critère objectif, n’est pas suffisante pour définir une nation : « les
limites culturelles sont parfois précises, parfois floues ; les modèles sont parfois directs et
simples, parfois tortueux et complexes »288. Eric Hobsbawm est encore plus direct : « les
critères utilisés dans ce but [définir la nation] – langue, ethnie, etc. – sont eux aussi flous,
mouvants, ambigus, et aussi inutiles pour l’orientation du voyageur que la forme des nuages
comparée au relief terrestre »289. Il serait donc logique de déduire de cette affirmation que
finalement, malgré les critiques, seul le critère subjectif est valide. Pourtant en ajoutant des
critères objectifs pour expliquer comment se créee l’identité nationale, nous savons que tous
admettent que ce critère n’est pas auto-suffisant. La raison principale est que ce critère est
trop large, comme le fait remarquer Hobsbawm : « De plus, elles peuvent amener les
imprudents aux extrêmes du volontarisme, à cette conclusion que pour créer une nation, il
n’est besoin que de le vouloir : s’il se trouve assez d’habitants dans l’île de Wight qui
veuillent appartenir à une nation wightienne, il y en aura une »290. Cette même raison est
invoquée par Gellner : « Si nous définissons les nations comme des groupes qui veulent
persister en tant que communautés, la définition que nous avons lancée telle un filet à la mer
fera une prise bien trop abondante »291. L’autre raison est la pratique. En effet, on constate que
toutes les tentatives d’unions volontaires n’ont pas fonctionné, comme en Yougoslavie292.
Pourtant ce critère n’est pas non plus entièrement récusé : « Il n’y a pas de doute que la
volonté ou le consentement constitue un facteur important dans la formation de la majorité
des groupes grands ou petits »293 nous dit Gellner qui pourtant a bien critiqué ce critère. Anne-
Marie Thiesse constate aussi qu’il est incontournable : « La véritable naissance d’une nation,
c’est le moment où une poignée d’individus déclare qu’elle existe et entreprend de le
prouver »294.
La conclusion qui s’impose est alors la suivante : si « ni les définitions objectives ni
les définitions subjectives ne sont satisfaisantes, et les unes comme les autres sont
trompeuses »295, alors il faut dépasser le clivage traditionnel « nation allemande » et « nation
288 E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 85.289 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 20.290 Ibid., p. 23.291 E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 84. Et il ajoute « (malheureusement pour cette définition), cela s’applique également à beaucoup d’autres clubs, groupes de conspirateurs, bandes, équipes, […] ».292 A. Dieckhoff, La Nation dans tous ses Etats, op. cit., p. 40 et p. 180.293 Ibid., p. 83.294 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, op. cit., p. 11.295 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 25.
- 51 -
française », « critères objectifs » et « critères subjectifs ». C’est notamment ce que constate
Françoise Lorcerie pour qui il n’y a pas de distinction nette entre ces deux conceptions, et il
n’y en aurait jamais eu depuis la Troisième République : « La doctrine "républicaine"
française, telle qu’issue de la troisième République, est elle-même en fait intrinsèquement
hybride à cet égard : elle valorise l’égalité individuelle, proclamée par la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, mais elle l’encadre toujours par une référence à la
communauté qui constitue la nation, une communauté qui vient de loin »296. Anne-Marie
Thiesse dresse aussi le même constat : « Il est devenu usuel aujourd’hui d’opposer les
conceptions "à la française" et "à l’allemande" de la nation, la communauté de citoyens et le
"Volk". Les deux coexistant pourtant depuis le XIXe siècle, et la Troisième République va les
développer concomitamment »297. Ainsi, chacun propose, en fonction de ce qui constitue pour
lui le ciment de la nation, sa synthèse.
Selon Ernest Gellner, la nation c’est « d’une part, la volonté, l’adhésion et
l’identification volontaires, la fidélité, la solidarité ; d’autre part, la crainte, la coercition, la
contrainte, »298. Dans son analyse, il postule qu’ « il se peut qu’un petit nombre de
communautés reposent exclusivement, ou de manière très prédominante, sur l’une ou l’autre.
Mais ces cas doivent être assez rares. La plupart des groupes qui perdurent se fondent sur un
mélange […] »299. Pour Françoise Lorcerie, cette synthèse se fait dès la définition du concept
d’ethnicité qui pour elle crée le sentiment d’appartenance à la nation, car l’ethnicité se fonde
sur une unité de base qui est la « croyance ethnique, c’est-à-dire le sentiment subjectif qu’ont
les individus, qu’ils appartiennent ou que d’autres appartiennent à une communauté d’origine
[…] »300 que cette communauté ait réellement existé ou non. On comprend clairement que le
critère objectif est mêlé au critère subjectif. Cela se traduit aussi dans l’activité de l’Etat-
nation qui à l’aide de « l’activité politique y fabrique un Nous ancré dans un territoire qui
nous appartient de tout temps, supposément, avec des ancêtres ou au moins une histoire
profonde, des ennemis aussi, une langue propre, etc. »301. L’effet de cette action est que
« l’Etat-nation se caractérise typiquement par une unité double, juridico-institutionnelle et
culturelle, et par une cohésion subjective qui fonde ou perpétue la séparation de l’unité en
question d’avec son environnement »302. On peut alors résumer sa pensée ainsi : c’est parce
que la communauté a décidé, de manière subjective, que telle terre ou tel groupe d’individus
appartient au groupe appelé nation et que ceux exclus du groupe, qui sont alors identifiés
comme une autre nation ou simplement comme un autre groupe, reconnaissent que ces
296 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 54.297 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, op. cit., p. 173.298 E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 83.299 Ibid., p. 83.300 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique : […], op. cit., p. 11.301 Ibid., p. 13.302 Ibid., p. 53.
- 52 -
éléments ne leur appartiennent pas, qu’ils deviennent dans la conscience d’une nation, des
éléments objectifs qui leur sont intrinsèquement liés.
La dernière synthèse claire et qui mérite notre attention par son originalité, c’est celle
proposée par Hervé Beaudin. Celui-ci envisage la nation avec des groupes. Ces groupes sont
de deux types : les « groupes concentriques » et les « groupes transversaux ». Le premier est
« un regroupement (ou une collectivité) d’êtres humains capable d’inclure entièrement (ou
d’être inclus entièrement dans) un autre groupe concentrique »303. Ces groupes concentriques
sont « reliés entre eux par une relation d’ordre »304 et inclus dans d’autres plus grands. Le
second groupe, est « un regroupement (ou une collectivité) d’êtres humains qui « traverse »
les groupes concentriques. Les groupes transversaux sont donc reliés aux groupes
concentriques par une relation d’intersection »305. Ces groupes transversaux sont par
exemple : « la classe sociale, le genre, la classe d’âge, l’association juridique (par exemple les
syndicats professionnels) ou la religion forment-ils des groupes transversaux. »306. Enfin, il
faut noter que ces groupes ne sont pas forcément exclusifs, ils peuvent s’interpénétrer dans
certains cas. En effet, « tout groupe concentrique est le transversal d’un ou plusieurs groupes
transversaux »307. Il prend ainsi l’exemple de la nation qui « peut être considérée comme
"traversant" la classe sociale, la classe d’âge, le genre, la religion »308. Mais la nation peut
aussi être un groupe concentrique, créant ainsi une réciprocité : « si la nation est considérée
comme concentrique avec la classe sociale (la nation comprend les différentes classes
sociales), elle se met à traverser chacune de ces classes sociales »309. Il tire de cette analyse
une première conclusion, en affirmant que les nationalistes seraient des gens qui voient la
nation comme une chose concentrique, à l’inverse des internationalistes, qui la verraient
comme quelque chose de transversale310.
Mais son analyse va au-delà de cette simple formulation. Si Beaudin estime lui aussi
que la division classique « allemande » et « française » de la nation est insatisfaisante et que
ces conceptions peuvent être synthétisées311, il dépasse cette simple fusion pour proposer la
définition originale. La nation, considérée comme une notion concentrique interagissant avec
les groupes transversaux312 serait intrinsèquement liée à l’Etat313. L’Etat-nation serait alors
composé de trois critères fondamentaux : « Tout Etat-nation repose sur trois critères, qui
doivent être réunis : 1) Un critère ethnoculturel (un peuple doté d’une langue, d’une religion
et d’une histoire partagée) ; 2) Un critère géopolitique (le territoire) ; 3) Un critère
303 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 23.304 Ibid., pp. 23-24.305 Ibid., p. 24.306 Ibid., p. 24.307 Ibid., p. 25.308 Ibid., p. 25.309 Ibid., p. 25.310 Ibid., p. 27.311 Ibid., pp. 463-475.312 Ibid., p. 494.313 Ibid., pp. 505-512.
- 53 -
sociopolitique (la citoyenneté) s’appliquant à un peuple »314. Ces critères sont essentiels et
interviennent dans n’importe quel ordre, certains étant apportés par l’Etat, d’autres par la
nation. En revanche, Nation et Etat sont complémentaires : « L’Etat est l’instrument de la
nation ; la nation est une construction de l’Etat. Les deux œuvrent simultanément. Aucun
n’existe sans l’autre. Lorsque la nation n’a pas d’Etat c’est que seul le premier critère, celui
de la culture, est présent »315. Hervé Beaudin, après s’être interrogé sur le fondement, note
qu’il est aussi indispensable qu’une nation comporte en elle un sentiment national, et autour
d’elle, une reconnaissance internationale de son Etat316. La conclusion de l’idée de nation chez
monsieur Beaudin est alors la suivante : « En définitive, la nation est un droit de propriété
politique sur un territoire historiquement délimité. Ce droit de propriété est soit individuel
lorsqu’il est dévolu à un principe (monarchie), soit collectif lorsqu’il est dévolu à l’ensemble
des citoyens (république). […] La nation est donc le lieu optimal de la liberté et de la
propriété politiques dont bénéficie chaque homme dans l’exercice de la face collective de
son existence. »317.
Pourtant, même cette définition qui est des plus originales, se trouve associée à Renan,
tout comme les travaux des autres auteurs que nous avons présentés ici.
§ 2 : La nation renanienne : un fondement incontournable ?
Bien que la définition de Renan à propos de la nation soit vivement critiquée par les
auteurs contemporains, et que ces critiques soient justifiées, il apparaît qu’aucun d’entre eux
n’arrive à dépasser la définition qu’il propose.
La raison, nous venons de le voir, c’est qu’aucun d’entre eux ne propose de définition
novatrice de la nation, si ce n’est Hervé Beaudin, quoique cette affirmation soit quelque peu
discutable. Car si les critères subjectifs de la nation peuvent être attribués à Renan, que la
volonté de constituer une nation est traduite, selon ces auteurs, par le « plébiscite de tous les
jours » renanien et que cette notion est incontournable. Enfin, si la seule alternative proposée
soit une synthèse de critères subjectifs et objectifs, tout cela nous amène à la conclusion
suivante : la définition renanienne de la nation est fondamentale dans les approches
contemporaines.
Cela est d’autant plus vrai que tous, à un moment donné se réfèrent à Renan. Ernest
Gellner, la référence actuelle dans le domaine de la nation, met en note sous sa phrase « Si
nous définissons les nations comme des groupes qui veulent persister en tant que
communautés[1] […] »318, la référence suivante : « Ernest RENAN, "Qu’est-ce qu’une 314 Ibid., p. 505.315 Ibid., p. 506.316 Ibid., p. 516-519.317 Ibid., pp. 520-521.318 E. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 84.
- 54 -
Nation" in Œuvres complètes, tome 1, Paris Calmann-Lévy, 1974, pp. 886-906. »319.
Françoise Lorcerie fait elle aussi plusieurs fois référence à Renan pour voir quel est le poids
de sa conférence dans le concept d’ethnicité qu’elle développe320. Hervé Beaudin est sans
doute le critique de Renan qui le cite le plus dans sa thèse. Il le cite quand il s’agit de
l’opposer à des auteurs comme Fichte321, Herder322, Barrès323 ou Gellner324. Il consacre même
quelques pages à l’analyse de sa pensée qu’il associe avec celle de Fustel de Coulanges325, et
dans son dernier chapitre, résume quelques critiques qu’il a formulées à propos de la pensée
de l’auteur326.
D’autres se réfèrent à lui comme à l’un des pionniers de la définition de la nation,
voire un de ceux ayant fourni la définition la plus complète, la plus riche, de son époque.
C’est le cas d’Alain Dieckhoff pour qui Renan, mentionné brièvement, fait partie des auteurs
ayant défini la nation à cause de la crise politique engendrée par l’annexion de l’Alsace-
Moselle327, tout comme Shlomo Sand pour qui rappelons le, Renan est, avec Mill, une des
références du XIXe siècle, parce que tous deux ont su identifier « le noyau démocratique au
cœur de la formation de la nation »328, mais qui n’a pas écrit d’œuvres solides. Cependant il
constate que certains auteurs du XIXe siècle avaient déjà tenté de corriger la définition de
Renan329, et que sa conférence a le mérite de constituer « à plus d’un titre, une gifle cinglante
pour tous ceux qui veulent mélanger le racisme théorique […] avec la nationalité
politique »330, ce qui fait de sa pensée novatrice pour le XIXe siècle (à défaut de l’être pour le
XXe), une réflexion qui « continue encore aujourd’hui d’éveiller une grande curiosité grâce à
sa pertinence et à sa fraîcheur »331.
N’oublions pas Eric Hobsbawm, qui estime contrairement à Sand, que : « Notre liste
de lectures ne contiendrait que très peu d’ouvrages de la période classique du libéralisme au
XIXe siècle, pour des raisons que nous exposerons plus tard, mais aussi parce qu’on n’écrivait
alors que très peu de choses allant au-delà de la rhétorique nationaliste et raciste. Les
meilleurs textes de cette période sont en fait très brefs : […] le célèbre discours d’Ernest
Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? »332. Ainsi, bien qu’il critique, comme nous l’avons
319 Ibid., n. 1, p. 84.320 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 13, p. 54 et pp. 66-67.321 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., pp. 17-18.322 Ibid., p. 110.323 Ibid., pp. 144-146, p. 148 et p. 160.324 Ibid., pp. 249-260. Plusieurs mentions de Renan et certaines oppositions de la pensée de ce dernier à celle de Gellner sont faites.325 Ibid., pp. 217-233. Mais à la lecture, l’analyse est essentiellement centrée sur Renan.326 Ibid., pp. 498-504 et p. 513.327 A. Dieckhoff, La Nation dans tous ses Etats, op. cit., p. 58.328 S. Sand, Comment le peuple juif fut inventé, op. cit., p. 76.329 Ibid., p. 79.330 S. Sand, « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 30.331 S. Sand, « Note aux lecteurs français » in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 113.332 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., pp. 12-13.
- 55 -
précédemment démontré, la vision purement subjective de la nation chez Renan333, et le fait
qu’il n’insiste pas, comme ses contemporains, sur le sentiment national334, l’auteur breton
occupe une place importante dans sa réflexion. Par exemple, il rappelle une question que
Renan et tous les auteurs de son époque se posent à propos de la formation des nations, à
savoir « "pourquoi la Hollande est-elle une nation, tandis que le Hanovre ou le grand-duché
de Parme n’en sont pas une ?" »335. L’interprétation de la réponse à cette question est la
suivante : « L’objectif immédiat de la question de Renan sur le Hanovre et le grand-duché de
Parme n’était pas finalement de les opposer à n’importe quelle nation, mais aux autres Etats-
nations du même ordre de grandeur modeste, à la Hollande ou à la Suisse par exemple »336.
Outre la « réhabilitation » de l’auteur, il admet que l’importance de l’oubli chez Renan est une
vision juste337, et que le « plébiscite » de Renan est toujours présent dans la conception
française de la nation : « la conception française de la "nation" en tant que plébiscite ("un
plébiscite de tous les jours" comme le disait Renan), n’a pas non plus perdu son caractère
essentiellement politique. La nationalité française, c’est la citoyenneté française : ethnie,
histoire, langue, ou patois parlé chez soi n’ont aucune incidence sur la définition de la
"nation" »338.
Nous pouvons conclure ce chapitre en affirmant que Renan a certes produit une
définition qui n’est pas parfaite, parce qu’elle est France. Par exemple, nous ne savons
toujours pas s’il rejette complètement les critères objectifs de la nation, s’il les accepte
partiellement ou complètement mais leur ajoute des éléments subjectifs. Et s’il les rejette on
ne peut que se ranger du côté de la définition contemporaine qui cherche à allier les deux
définitions, ou alors à jouer avec des nouvelles notions englobant les précédentes. Elle insiste
aussi peu sur ce qui constitue le sentiment national si ce n’est l’Histoire et/ou l’héritage des
ancêtres, et encore, sans préciser ce qu’on doit intégrer dans ces notions. Mais sa définition
apparaît comme le fondement, le soubassement de la réflexion de tous les auteurs
contemporains.
Ainsi comme le fait remarquer Hervé Beaudin, bien que « le postulat de Gellner, […]
a été repris par de nombreux auteurs contemporains, sociologues, historiens et spécialistes de
littérature. On peut même dire qu’il est devenu le postulat à la mode, celui qu’un esprit éclairé
doit automatiquement faire sien pour acquérir la légitimité intellectuelle qui lui permette de
discourir sur l’idée de nation »339, la définition renanienne de la nation fait partie de ces « lois
fondamentales » comment on en trouve en physique. Et comme la théorie de l’électrostatisme
ou de la gravité, elle fait partie intégrante de toute nouvelle théorie sur la nation, la place
333 Ibid., pp. 32-33.334 Ibid., pp. 87-88.335 Ibid., p. 52.336 Ibid., p. 75.337 Ibid., pp. 32-33.338 Ibid., p. 163.339 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 257.
- 56 -
qu’elle occupe dans le « calcul » du chercheur variant selon la démonstration, faisant de la
définition de Renan comme plus largement de la définition de la nation, une chose malléable
qui variera selon « les stratégies des acteurs »340.
340 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 54. L’idée de l’auteur ne concerne originalement que la notion de nation, mais elle convient aussi parfaitement à la manière dont Renan est utilisé par chaque chercheur.
- 57 -
PARTIE 2 : LES ENJEUX DES ETUDES CONTEMPORAINES
SUR L’IDEE DE NATION CHEZ RENAN
Bien que Renan ait été largement oublié, il reste tout de même une référence (plus ou
moins importante selon les auteurs) dans les travaux universitaires. Alors que peu de travaux
sur le Renan politique sont encore réalisés de nos jours, il convient de s’intéresser à des
mentions de l’auteur politique dans des travaux particuliers, ou d’examiner certains avis
partagés par la majorité, qui semblent pourtant discutables. Nous nous intéresserons plus
particulièrement aux travaux portant sur le colonialisme et l’antisémitisme, mouvements sur
lesquels certains chercheurs estiment que Renan a eu un certain poids (Chapitre 1). Il faut
aussi se demander pourquoi la majorité de la doctrine voit Renan comme un démocrate, en
mettant en exergue le « plébiscite de tous les jours », car cette idée semble déterminante dans
les recherches contemporaines (chapitre 2). Enfin, nous nous interrogerons sur la méthode
contemporaine, sur la valeur des travaux qui semblent ne pas prendre en compte la pensée de
l’auteur dans sa globalité, tout comme elle semble liée au sentiment politique (chapitre 3).
Chapitre 1 : Le Renan raciste et « fasciste »
La colonisation comme la décolonisation sont des champs de recherche restés
longtemps ignorés. Ce n’est réellement qu’au début du XXIe siècle que les travaux sur
l’esclavage et la colonisation se multiplient, et que les politiques commencent à intégrer cette
période de l’Histoire dans l’histoire nationale341. On peut notamment citer comme exemple la
loi du 10 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime
contre l’humanité, dite « loi Taubira »342. La question de l’antisémitisme en France, est elle
aussi récente. Bien que l’étude des périodes du début du XXe siècle et de la Seconde Guerre
Mondiale était plus répandue que l’Histoire coloniale, elle restait cantonnée à l’étude de la
pensée antisémite en Allemagne et en Italie, berceaux du nazisme et du fascisme. Etudier
l’antisémitisme en France était en effet mal aisé car la reconstruction nationale s’est faite sur
le manichéisme « la France résistante » face aux « Allemands antisémites », la collaboration
étant une parenthèse passée sous silence.
Il est dès lors intéressant de noter que, depuis, le tabou a été partiellement levé sur ces
deux champs d’études, permettant aux chercheurs de tenter de remonter aux origines du
colonialisme et de l’antisémitisme français. Ces deux courants remontent ainsi jusqu’à Ernest
Renan. C’est pourquoi nous expliciterons ces théories et leurs conclusions rattachant Renan à
341 Sur ce point voir M. Winock, « La nouvelle guerre coloniale », in 1500 ans d’histoires de France, op. cit., pp. 80-83.342 Loi du 10 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, JORF 23 mai 2001, n°0119, p. 8175.
- 58 -
ces courants, en s’intéressant d’abord à la question du colonialisme et du racisme (Section 1),
pour voir le cas plus particulier de l’antisémitisme (Section 2).
Section 1 : la définition de la nation renanienne comme base du colonialisme
Le réflexe qui vient naturellement en lisant l’association « Renan-colonialisme » ou
« Renan-racisme », est de se demander « comment l’auteur d’une nation élective rejetant tout
fondement sur la race peut-il être associé à la colonisation ». Pourtant, les travaux sur la
question mettent en lien certains écrits de Renan avec la colonisation (§1). Mais Renan n’était
ni le seul, ni le plus raciste de ses contemporains, et sans la récupération républicaine de ses
idées, jamais le nom de Renan n’aurait été associé de la sorte à la colonisation (§2).
§ 1 : Le racisme renanien comme légitimation de la colonisation
Pour comprendre la relation entre Renan et la colonisation, il faut énoncer le constat
qui part de l’ethnicité, cette notion englobant la race mais étant plus large que cette dernière.
Bien que le colon français soit imprégné de la philosophie des Lumières, il apparaît que « la
conquête coloniale, pur rapport de forces au départ, fut ensuite très vite élaborée
symboliquement en rapport "Européens"-"indigènes", c’est-à-dire en rapport ethnique,
composante importante de la domination coloniale »343. De ce rapport va naître un sentiment
de taxinomie chez le colonisateur. Ainsi « l’administration coloniale se donne pour tâche
première de "mettre de l’ordre" dans cette jungle de sociétés souvent très dissemblables […].
"Mettre de l’ordre", c’est donc nommer, différencier, classer, hiérarchiser, ces sociétés ; c’est
aussi, par souci d’optimisation de la production administrative, créer des frontières là où
parfois il n’y en avait pas »344. En revanche il faut noter que le colon n’est pas le pur créateur
des identités ethniques : « la thèse de l’ethnie comme pure "invention" coloniale doit donc
être réfutée, et cela pour deux raisons au moins. […] parce qu’elle postule que le colonisateur
aurait été capable de créer ex nihilo des ethnies qui n’existaient pas avant son arrivée et qui
n’existeraient pas sans son intervention. Or, même en admettant qu’il l’ait fait, les tenants de
cette thèse oublient que pour "inventer" une ethnie, il faut qu’il y ait le minimum de substrat
historique nécessaire à la cristallisation, d’un sentiment d’être différent »345. En effet, il
apparaît que « ce travail d’imposition identitaire et de catégorisation ethnique aura pour
résultat de figer des identités qui préexistaient fréquemment à la conquête européenne, mais
qui se caractérisaient par leurs caractère fluide, fluctuant, labile »346. Mais s’il n’en est pas le
343 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit.,, p. 12.344 R. Otayek, « L’Afrique au prisme de l’ethnicité : perception française et actualité du débat », Revue internationale et stratégique, n° 43, 2001/3, p. 134.345 Ibid., p. 135.346 Ibid., p. 134.
- 59 -
créateur, le colon entretient cette distinction et l’exacerbe « en créant un statut indigène,
[alors] la politique coloniale a institutionnalisé des groupes minoritaires sur une base ethnique
à des fins de domination », division coloniale qui aurait été facilitée par le fait que « les
ressortissants des Etats nationaux partageaient, virtuellement au moins, une définition
ethnique d’eux-mêmes, sublimée par la symbolique de la citoyenneté […] »347. Cela se traduit
en pratique par la soumission de « l’indigène » à un « statut inférieur de jure et de facto, sans
lui reconnaître un rattachement national propre : la doctrine inventera pour lui le statut de
"sujet" »348, comme on le voit par exemple en feuilletant les anciens recueils Dalloz dans
lesquels des pans entiers sont consacrés au statut des indigènes349.
Cette taxinomie raciale et la création de nouvelles frontières pour délimiter les
territoires sur lesquels vivent ces ethnies, se sont intrinsèquement liées à l’idée de nation du
colon. En effet, les colons vont se trouver face à des modes d’organisation sociale qui leur
sont inconnus comme les nomades, ou encore au Maghreb, imprégné de la religion
musulmane, le rassemblement des individus autour de la Umma, la communauté mère, et du
système du califat, qui n’a cependant pas réussi à s’implanter de manière continue en Afrique
du nord, et qui fut remplacé parfois par des Sultanats ou des Janissaires350. C’est donc les
colons qui apportent l’idée de nation chez les colonisés par la transposition de leurs
perceptions de la nation, créant ainsi un sentiment national chez les colonisés qui prennent
conscience de leur identité en tant que nation351. Et sans cet « entrepreneur identitaire
hégémonique »352, jamais les populations musulmanes n’auraient pu développer un tel
sentiment national353. La raison de l’importation, puis de l’imposition du concept de nation et
du sentiment national est le sentiment de supériorité sur tous les plans des européens sur les
populations colonisées. En effet, la construction nationale apparaît comme une organisation
politique plus évoluée que ce que les colons voient comme des organisations tribales dignes
de l’époque barbare ou qu’ils interprètent à tort comme des organisations féodales (bien que
dans des pays comme le Japon, l’interprétation soit juste). Cela se traduira par « le devoir de
civiliser les races inférieures »354, c’est-à-dire d’apporter une organisation politique
européenne aux pays colonisés. Dès lors, on peut faire le lien avec Ernest Renan et sa
conférence Qu’est-ce qu’une nation ?.
347 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., pp. 55-56.348 Ibid., p. 63.349 Notamment les recueils 1938-1945, on l’on reprend les statuts de chacun en cherchant à les préciser, à cause de la politique raciale de l’occupant Nazi, et du gouvernement de Vichy.350 Sur la Umma, et le système du califat et son influence, voir L. Millot et F.-P. Blanc, Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, Dalloz, 2001, pp. 23-76.351 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 64.352 R. Otayek, « L’Afrique au prisme de l’ethnicité», op. cit., p. 138.353 L. Millot et F.-P. Blanc, Introduction à l’étude du droit musulman, op. cit., p. 75.354 J. Ferry, discours à la chambre des députés du 28 Juillet 1885, M. Mopin, Les grands débats, op. cit., p. 287.
- 60 -
Certains auteurs constatent que Renan « gomme entièrement la question coloniale »355
dans sa conférence, parce qu’ « il n’applique pas aux populations des colonies conquises par
la France à la même époque le principe démocratique du droit à l’autodétermination qu’il a
fait sien »356. Cela se constate dès les premiers mots de l’auteur : « Les formes de la société
humaine sont des plus variées. Les grandes agglomérations d’hommes à la façon de la Chine,
de l’Egypte, de la plus ancienne Babylonie ; - la tribu à la façon des Hébreux, des Arabes ;
[…] – les nations comme la France, l’Angleterre et la plupart des modernes autonomies
européennes : […] »357. Puis après avoir pris en exemple la France, l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Italie et l’Espagne qui seraient progressivement devenues des nations depuis l’invasion
barbare à cause des croisements de population, il constate que « dans les pays que nous
venons d’énumérer, rien d’analogue à ce que vous trouverez en Turquie où le Turc, le Slave,
le Grec, l’Arménien, l’Arabe, le Syrien, le Kurde sont aussi distincts aujourd’hui qu’au jour
de la conquête »358. Ainsi c’est parce qu’il n’y a pas de fusion conduisant à créer un peuple qui
se reconnaît en une nation que « la politique turque de la séparation des nationalités d’après la
religion a eu de bien graves conséquences : elle a causé la Ruine de l’Orient »359. Renan
estime donc que « l’Italie est une nation, et la Turquie, hors de l’Asie Mineure, n’en est pas
une »360. Ainsi, la Turquie n’est pas une nation, et aucun exemple de pays colonisé n’est pris
comme exemple de nation. On ne trouve que des exemples européens ainsi que les France
d’Amérique. Toujours dans cette conférence, on peut considérer qu’on y trouve un fondement
raciste. En effet, Renan exprime bien que la notion de race ne peut fonder à elle seule une
nation. Mais il ne dit pas qu’il n’existe pas de race. En effet « la vérité est qu’il n’y a pas de
race pure et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur
une chimère »361. Cependant « les plus nobles pays, l’Angleterre, la France, l’Italie, sont ceux
où le sang est le plus mêlé »362. La conclusion à tirer de ce passage s’accorde avec les
partisans de l’acceptation des critères objectifs par Renan dans sa conférence, car pour Renan
il n’y a pas de race « pure », de race Aryenne, mais il y a bien des races qui forment par
l’oubli et l’Histoire, des peuples différents. Le « sang mêlé » étant une métaphore pour dire
« mixité raciale ». Il s’agit donc plus d’une atténuation du racisme de Renan qu’une négation
de celui-ci363.
355 K. Aggarwal, Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme, Paris-Montréal, l’Harmattan, 1996, p. 27.356 S. Sand, « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 30.357 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 49.358 Ibid., p. 53.359 Ibid., p. 57.360 Ibid., p. 58.361 Ibid., p. 63.362 Ibid., p. 63.363 C’est notamment ce qui est exprimé dans l’article M. Vaillant, « Carole REYNAUD-PALIGOT, la République raciale, 1860-1930. Paradigme racial et idéologie républicaine une critique de Michaël Vaillant », Raison Publique, n° 5, octobre 2006, pp. 121-130. L’analyse de la position de Renan se trouve en fin de texte, mais celui-ci est disponible sur le site http://www.raison-publique.fr/article151.html qui propose deux versions non paginées dont une en PDF. Nous précisons donc que les pages du document PDF concernés sont les pages 10 et 11. Lors des futures citations du document, nous donnerons la pagination de la version PDF de l’article.
- 61 -
En effet, Renan avait exprimé des idées colonialistes et racistes bien avant cette
conférence. Relativement proche de son discours prononcé en Sorbonne, on trouve dans La
Réforme intellectuelle et morale, écrit en 1871, un paragraphe univoque, dont voici les
premières lignes : « la colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier
ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du
riche et du pauvre. La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y
établit pour le gouverner, n’a rien de choquant. L’Angleterre pratique ce genre de colonisation
dans l’Inde, au grand avantage de l’Inde, de l’humanité et à son propre avantage »364. Il ajoute
aussi un peu plus en avant dans le texte « Autant les conquêtes entre races égales doivent être
blâmées, autant la régénération des races inférieures ou abâtardies par les races supérieures est
dans l’ordre providentiel de l’humanité »365. Avec cette dernière phrase, on peut consolider
l’idée d’évolution de pensée que nous avons développée tout à l’heure à partir de la
conférence de Renan, selon laquelle il n’y a pas de races pures. Donc toutes les races qui
composent l’Europe sont impures mais toutes en tant que races européennes sont dominantes.
C’est d’ailleurs déjà ainsi qu’il les présente dans La Réforme366. Dès lors les races
européennes évoluées ont créé la nation, là ou les races inférieures sont restées au stade du
groupement humain. De même, nous reviendrons sur la question de l’antisémitisme chez
Renan, mais on trouve dans son Histoire générale et système comparé des langues sémitiques,
publiée bien plus tôt, en 1855, la phrase suivante « dans la structure de la phrase comme dans
toute leur construction intellectuelle, il y a chez les Sémites une complication de moins que
chez les Ariens. Il leur manque un des degrés de combinaison que nous jugeons nécessaires
pour l’expression complète de la pensée »367. Ainsi, outre son discours sur la nation, ses autres
écrits et ses liens avec Gobineau dont il admira le travail intellectuel et avec qui il collabora
un temps368, c’est ce livre qui eut une influence immense sur les philologues du XIXe siècle,
et qui, pour nombre d’auteurs, permet de qualifier Renan de raciste, et de plus permet de lui
imputer une part de responsabilité dans les événements ultérieurs en raison de l’influence de
son ouvrage369.
Enfin, les chercheurs constatent que l’influence de la classification de l’administration
coloniale, et son idée de nation ont perduré après la décolonisation, modelant la politique des
pays d’Afrique370 et même de l’Algérie, pays qu’on aurait pu croire le plus réfractaire à la
364 E. Renan, La Réforme intellectuelle et morale et autres écrits, op. cit., p. 67.365 Ibid., p. 67.366 « une race de maître et de soldats, c’est la race européenne » (Ibid., p. 67).367 E. Renan, Histoire générale et systèmes comparés des langues sémitiques, Paris, Calmann-Lévy, éd. 3e, 1863, p. 21.368 Voir notamment « Lettre de Renan à Gobineau », 26 juin 1856, in Ernest Renan, Œuvres complètes, Paris, Calmann-Lévy, 1961, t. 9, p. 203. Renan a aussi annoté l’Essai sur l’inégalité des races, mais nous n’avons pu retrouver le texte original afin d’y renvoyer le lecteur, que des mentions de cette annotation.369 C’est notamment ce qui est exprimé dans l’article M. Vaillant, « Carole REYNAUD-PALIGOT, la République raciale, 1860-1930», op. cit., p. 9.370 R. Otayek, « L’Afrique au prisme de l’ethnicité», op. cit., pp. 137-142.
- 62 -
pensée française après la décolonisation371. Et effectivement, il apparaît dans les pratiques et
écrits contemporains, des références à Renan et à sa définition de la nation dans les pays
africains, notamment dans le mouvement national Oromo en Ethiopie372, et plus largement les
pays d’Afrique qui se reconnaissent dans la définition renanienne de la nation373.
§ 2 : L’interaction entre la IIIe République colonialiste et Renan autour la nation.
A elle seule, la pensée raciste de Renan n’aurait jamais pu sortir du milieu intellectuel.
La première raison, c’est qu’il n’est pas le seul raciste à cette époque. Par exemple, bien que
postérieur à l’ Histoire générale et systèmes comparé des langues sémitiques de Renan, De
l’origine des espèces par sélection naturelle374 de Charles Darwin publié en 1859 a eu bien
plus d’impact sur la société, et a fondé toutes les études sur la race et son évolution dont vont
s’inspirer les colons, donnant naissance à la « raciologie » et à ses praticiens les
« raciologues » qui vont peu à peu s’immiscer dans la Société d’anthropologie de Paris et se
servir d’elle afin de diffuser des théories sur la race375. On peut associer Darwin à Franz
Joseph Gall (1758-1828), inventeur de la phrénologie, science reposant sur l’étude de la
morphologie crânienne afin d’établir une carte du cerveau censée indiquer le comportement
des individus et dont le prolongement se fait dans l’étude des crânes des indigènes afin de
déterminer leurs capacités intellectuelles. Rappelons aussi l’influence de Cesare Lombroso,
légiste de Turin inspiré par Darwin, qui décrit le morphotype du criminel dans l’Uomo
371 S. Laurens, « L’immigration : une affaire d’Etat. Conversion des regards sur les migrations algériennes (1961-1973) », Culture & Conflit, n° 69, printemps 2008, pp. 39-41. L’auteur de cet article analyse les débats autour des accords d’Evian, et rapporte un fait étrange : le ministre de l’époque, Louis Joxe, cite Renan le 25 mai 1961 (voir les notes de l’articles pour les références), face à une délégation algérienne qui parle de la terre, mais aussi et surtout d’une nation algérienne antérieure à la colonisation. Ils ont donc intégré l’idée de Renan selon laquelle une nation se rattache à un passé glorieux. On voit alors ici se confronter deux partis ayant intégré différentes acceptions de la même idée renanienne de la nation.372 A. H. Gnamo, «Islam, the orthodox Church and Oromo nationalism (Ethiopia) », Cahiers d’étude africaines, n° 165, 2002, p. 101. « The majority of the Oromo nationalists believe that they will build their future on their common heritage, history, memory and what unite them rather than a minor particularism that separate and the hope and destiny they share for the present and the future. This is generally what makes a nation as a French scholar, Ernest Renan (1934: 88), defined in his famous lecture of 1882 at the Sorbonne »373 H. Dia, Poésie Africaine et engagement, Châtenay-Malabry, Acoria, 2003, pp. 72-73. La définition de Renan est admise par cet auteur africain qui semble l’étendre à un plus large public : « Pour fonder le concept de littérature nationale en droit, il faut d’abord montrer l’existence des nations en Afrique ; et c’est précisément ce concept de nation qui est hautement problématique. […] C’est cette idée de nation ainsi conçue [basée en partie sur la conférence de Renan] qui fonctionne implicitement dans le concept de littérature nationale et qui justifie qu’on parle de littératures nationales béninoise, camerounaise, sénégalaise, […] ».374 C. Darwin, De l’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des êtres organisés , Paris, Guillaumin et compagnie et Victor Masson et fils, traduit par Clémence Royer, 1866.375 « l’année 1885 marque le point culminant de l’offensive publique des "raciologues". Cette année-là, la Société d’anthropologie de Paris compte un maximum de 757 membres oeuvrant collectivement à la diffusion, dans la sphère publique, d’une authentique culture raciale vulgarisée via revues, conférences et manuels scolaires » (M. Vaillant, « Carole REYNAUD-PALIGOT, la République raciale, 1860-1930», op. cit., p. 2). Pour une constatation de ce prosélytisme raciste, nous renvoyons aux Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, et notamment pour prendre l’année citée, celui de 1885, à la communication de P. Topinard, « Eléments d’anthropologie générale », p. 15 : « il est inutile de dire que je m’inspire largement des grandes idées de Buffon, […] et de leur continuateur, Darwin ».
- 63 -
deliquente qui notamment doit posséder un petit crâne et donc un petit cerveau376. On peut
aussi citer nombre de scientifiques français, bien plus républicains que Renan, qui ont
également mené des études sur la race allant bien plus loin que les simples mentions faites par
Renan. Par exemple Paul Broca (1824-1880), médecin fondateur de la Société
d’anthropologie de Paris ou son disciple Paul Topinard (1830-1911), qui écrivit notamment
Etude sur les races indigènes de l’Australie377 en 1872.
Outre des scientifiques ou des intellectuels aux réflexions sur le racisme plus poussées
et qui étaient politiquement plus proche du régime que Renan, on peut noter que si Renan est
toujours raciste, et qu’il s’agit bien d’une évolution décroissante de cette pensée raciste, alors
on s’étonne qu’il ait eu autant de succès pour le colonisateur. Surtout quand dans Qu’est-ce
qu’une nation ?, il se met à critiquer la recherche scientifique raciste de son époque : « le fait
de la race, capital à l’origine, va donc toujours perdant de son importance. L’histoire humaine
diffère essentiellement de la zoologie. La race n’y est pas tout, comme chez les rongeurs ou
les félins, et on n’a pas le droit d’aller par le monde tâter le crâne des gens puis les prendre à
la gorge en disant : "Tu es notre sang ; tu nous appartiens !" »378. Et d’autant plus quand il
renvoie à des études erronées qu’il impute à l’ennemi Allemand : « tenez, cette politique
ethnographique n’est pas sûre. Vous l’exploitez aujourd’hui contre les autres ; puis vous la
voyez se tourner contre vous-même. Est-il certain que les Allemands qui ont élevé si haut le
drapeau de l’ethnographie, ne verront pas les Slaves venir analyser, à leur tour, […] et
demander compte des massacres et des ventes en masse que les Othons firent de leurs
aïeux ? »379. D’autant que cette critique de la science raciste et son rattachement à la France
est bien antérieure à la conférence, puisqu’on la retrouve dans sa Nouvelle lettre à M. Strauss
du 15 septembre 1871380.
Ces points, qui auraient pu fragiliser sa position en matière de colonisation, la
Troisième République va réussir à les tenir éloigné du raisonnement politique, en développant
une double échelle : d’une part elle va prôner officiellement l’idée de nation débarrassée de
l’idée de race et de religion, basée uniquement sur le volontarisme renanien et d’autre part,
elle accentue les études sur la race, créant des catégories administratives pour l’étranger de
manière plus officieuse. La résultante de tout cela est qu’elle va créer un prisme qui va
376 Pour un résumé de l’idée de la criminologie positiviste au XIXe siècle, voir M. Cusson, La criminologie, Paris, Hachette, éd. 4e, 2005, pp. 33-42. On y trouve notamment un résumé de la théorie de Lombroso, une mention de Gall, et surtout cela permet de voir à quel point l’étude de la morphologie était prégnante au XIXe siècle.377 P. Topinard, Etude sur les races indigènes de l’Australie, Paris, Typographie A. Hennuyer, 1872.378 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 66.379 Ibid., pp. 66-67.380 « Notre politique, c’est la politique du droit des nations ; la vôtre, c’est la politique des races : nous croyons que la nôtre vaut mieux. La division trop accusée de l’humanité en races, outre qu’elle repose sur une erreur scientifique, […] ne peut mener qu’à des guerres d’extermination, des guerres "zoologiques", permettez moi de le dire, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie » (E. Renan, « Nouvelle lettre à M. Strauss, 15 septembre 1871 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, op. cit., p. 456). Et : « Défiez-vous donc de l’ethnographie, ou plutôt ne l’appliquez pas trop à la politique » (Ibid., p. 457).
- 64 -
orienter les esprits de manière à ce que le lien ne soit pas fait entre l’application des théories
raciales de manière concrète, et l’enseignement de la nation renanienne comme définition de
la nation républicaine pour la faire rentrer abstraitement dans l’imaginaire collectif.
Cette « schizophrénie » est constatée par plusieurs chercheurs. Car nous le savons, la
IIIe République a « récupéré » la définition de la nation de Renan pour la faire sienne. Mais
comme elle ne pouvait pas adopter entièrement cette conception sous peine de renier la
construction ethniciste sur laquelle elle était en train de se construire, la Troisième République
a alors mélangé de manière très subtile conception objective et conception subjective dès ses
origines : « Le XIXe siècle français a vu s’opposer divers registres d’éloges de la France, du
registre contre-révolutionnaire conservateur célébrant la nation organique, corps vivant de la
tradition, à celui de nation association de citoyens libres prenant en charge leur destin, la
nation de la fête de la Fédération […]. La troisième République commençante va s’appliquer
à son tour à hybrider les deux conceptions opposées. Simultanément, elle réoriente l’œuvre
coloniale de l’Empire en adoptant, à des fins de domination, une politique de colonisation qui
institue une définition ethnique de "l’indigène" d’une part, du Français et de l’Européen
d’autre part, et symétriquement »381.
Mais elle renvoyait l’image qu’ont certains chercheurs selon laquelle Renan rejette en
bloc tout critère objectif pour ne garder que les subjectifs. En fait la colonisation est
« conduite au nom des Lumières et de l’universalisme, […] » alors qu’en réalité « […] la
colonisation ne ressemble que de très loin à l’œuvre de civilisation dont elle se revendique :
ne met-elle pas en scène une France double, universaliste en métropole et différencialiste dans
ses colonies ; une France qui nie ici le différencialisme au nom du primat absolu de la nation,
et l’institutionnalise là, au nom de la nation à inventer »382 ? Et cette négation de la réalité,
remplacée dans l’imaginaire collectif par la volonté d’adhésion à la nation qu’on trouve chez
Renan va très loin, puisqu’Anne-Marie Thiesse rapporte que dès 1852, des ordres sont donnés
pour que les chants créoles et cajuns entrent dans le collectage devant recenser les diverses
cultures régionales qui composent la France et font partie de son identité383. C’est ce qui lui
fait dire, à elle aussi qu’ « il est devenu usuel aujourd’hui d’opposer les conceptions "à la
française" et "à l’allemande" de la nation, la communauté de citoyens et le "Volk". Les deux
coexistant pourtant depuis le XIXe siècle, et la Troisième République va les développer
concomitamment »384. Pour elle, cette double acception se retrouve dans la conférence de
Renan385, que nous savons utilisée par les républicains. Cela explique pourquoi d’une part on
intègre certains chants coloniaux dans ce qui compose l’identité nationale, puisque la nation
381 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 66. Voir aussi R. Otayek, « L’Afrique au prisme de l’ethnicité», op. cit., pp. 136-137.382 R. Otayek, « L’Afrique au prisme de l’ethnicité», op. cit., pp. 136-137.383 A.-M. Thiesse, La création des identités nationales, op. cit., pp. 172-173.384 Ibid., p. 173.385 Ibid., p. 173.
- 65 -
intègre tout ceux qui veulent en faire partie, mais d’autre part on continue à séparer les
« nègres » des « blancs », les « indigènes » des « colons » et des « métisses ».
Enfin, l’instrument de prédilection de la République pour véhiculer ce travestissement
de l’idée renanienne de nation, c’est l’école. Pour mieux comprendre le mécanisme, il faut
s’intéresser aux écoles dans les colonies. « En effet, l’école de la Troisième République veut
inculquer des valeurs sociales et morales valorisant l’Etat-Nation. […] Dans ce processus
d’acculturation nationale "l’école traduit la volonté du colonisateur d’assimiler le colonisé et
de lui imposer ses valeurs". En qualité d’appareil idéologique d’Etat, les établissements
scolaires de l’île de La Réunion, colonie française depuis le XVIIe siècle, ont ainsi participé à
cette œuvre de redressement national et mis en exergue les vertus patriotiques à inculquer aux
élèves de la colonie »386. Au lycée Saint-Denis de la Réunion, lors de la remise des prix de fin
d’année, « les élèves sont invités à suivre des leçons édifiantes d’éducation et d’instruction
civiques, leur permettant d’élever leur cœur et leur esprit "à la hauteur et dans l’amour de la
Patrie". Les discours ainsi prononcés mettent en évidence à la fois le dévouement à la mère
Patrie et l’honneur et la gloire des colonies car on ne "sépare pas la France et la Réunion, qui
ne font qu’une pour nous tous" selon les propos du gouverneur Beauchamp en 1898 »387. On
voit donc que le programme est d’intégrer la population réunionnaise dans la nation française,
ce qui ne semble pas aller de soit puisqu’on est obligé de faire le lien comme on le voit dans
ce discours, et non simplement de dire « ici, en France ». Cette assimilation qui repose
pourtant sur une distinction se fait bien entendu en se basant sur Ernest Renan qui est au
programme des enseignements : « les discours reprennent ainsi la conception française
traditionnelle où la nationalité est l’effet d’une volonté partagée qui se manifeste sur la base
d’un pacte social et civique. Reprenant les termes d’Ernest Renan dans sa conférence sur la
Nation de 1882, les enseignants inculquent cette idée que "le consentement actuel, [le] désir
de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis"
constituent le principe spirituel du sentiment d’appartenance nationale »388. Mais cette vision
de la nation renanienne entre en contradiction avec deux actions du colon Français. La
première, c’est la tentative d’éradiquer la langue créole comme l’école tente de le faire en
métropole avec le Breton, le Basque ou l’Alsacien, parce que les colonisateurs pensent que
« l’unité linguistique serait un facteur essentiel de l’unité nationale »389, là ou pour Renan « la
langue invite à se réunir ; elle n’y force pas »390. La seconde action est liée à celle de la
langue. C’est la mission colonisatrice, camouflée par le mot « civilisatrice », des enfants
réunionnais. En effet, dans les années 1880-1890, la France envisage de coloniser
Madagascar, et le fer de lance de cette colonisation ce sont les enfants de La Réunion qui vont
386 P.-E. Fageol, « Le patriotisme au lycée de Saint-Denis […] », Histoire de l’éducation, op. cit., p. 43.387 Ibid., p. 45.388 Ibid., p. 46. Autre référence à Renan à La Réunion : « Ma logique discursive reprend les principes d’un patriotisme républicain où transpirent les références aux chantres du nationalisme de cette fin de siècle comme Numa Fustel de Coulanges, Ernest Renan ou Maurice Barrès » (ibid., p. 45.).389 Ibid., pp. 47-52.390 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 67.
- 66 -
s’engager volontairement pour la Patrie391, sous les discours patriotiques des enseignants.
Mais pour coloniser il faut parler correctement le français afin de « civiliser correctement
l’indigène »392. On retrouve alors bien l’idée de race, ici associée étroitement avec les valeurs
de la nation, la nation elle-même, enseignées par la Troisième République aux réunionnais,
puisque ces derniers, pour la gloire de la nation française et pour l’apporter aux malgaches
inférieurs, doivent coloniser cette île. Or, les deux îles étant proches, on peut se demander
combien de réunionnais à qui on a inculqué ces valeurs et qui y ont adhéré, avaient des
origines malgaches plus ou moins lointaines ? On assiste donc à l’expression de ce
bipolarisme de la Troisième République au sein de l’école. C’est pourquoi on peut dire
qu’ « en définitive, les chemins de la construction du sentiment national à l’école de Bourbon
correspondent à une rencontre réussie entre une volonté politique d’origine métropolitaine et
un ensemble de désirs de reconnaissance de la part des élites réunionnaises »393, avec « aux
sources de cette construction idéologique, les enseignants [qui] ont joué un rôle de premier
plan en adaptant les discours patriotiques à la réalité du monde colonial »394.
Ainsi, si Renan a bien été raciste, sa position sur le sujet a décliné jusqu’à ce que
finalement il devienne le « moins » raciste de ses contemporains influencés par la
classification des races. Cette position était alors relativement incompatible avec la pensée
républicaine, pourtant celle-ci, en faisant sienne une partie des idées de Renan dont la nation,
a dénaturé sa pensée ou en tout cas l’a réinterprétée afin qu’elle s’adapte à la volonté
politique. Elle l’a fait si bien qu’aujourd’hui on associe Renan et la colonisation, association
légitime, mais qui n’aurait jamais pu se faire sans la manipulation des textes et idées de
l’auteur par les républicains.
Mais une autre association est faite, cette fois-ci entre Renan et les juifs. On peut
légitimement penser que si Renan est raciste, il est par voie de conséquence antisémite.
Pourtant rien n’est moins sur.
Section 2 : Renan : l’antisémite qui préfigura le fascisme.
Selon le Petit Larousse, la définition de l’antisémitisme participe d’une « doctrine ou
attitude d’hostilité systématique à l’égard des juifs »395. C’est la définition la plus simple et la
plus connue de tous. Elle concernerait ainsi une sorte de racisme particulier, stigmatisant
uniquement une « race », en l’occurrence la « race » sémitique dont font partie les juifs, à 391 « systématiquement, la levée de bataillons de volontaires pour servir la cause de la France a rencontré un écho favorable au sein de l’établissement. Les lycéens ont ainsi toujours été prompts à s’engager pour défendre la Patrie et assumer leur devoir de citoyen patriote » (P.-E. Fageol, « Le patriotisme au lycée de Saint-Denis […] », Histoire de l’éducation, op. cit., p. 63).392 Ibid., pp. 48-49.393 Ibid., p. 63.394 Ibid., p. 63.395 Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2001, « antisémitisme », p. 73.
- 67 -
l’inverse du simple racisme qui lui est un concept universel au sens philosophique du terme.
Mais cette notion en bien plus large. En effet, il faut rappeler qu’à l’origine le terme
« Sémites » tel que définit au XIXe siècle notamment par Renan, englobe les juifs et les
musulmans396. C’est pourquoi nous traitons l’antisémitisme à part, car l’on peut être raciste
mais philosémite, comme réciproquement antisémite mais aimer les autres « races ». Il faut
dès lors analyser de la même manière que nous l’avons fait pour le « racisme renanien »,
« l’antisémitisme renanien », en exposant les théories développées par les chercheurs
contemporains et leurs fondements (§1), pour ensuite pouvoir les confirmer ou les infirmer
(§2).
§ 1 : L’antisémitisme de Renan comme source de Vichy
Certains auteurs qui ont travaillé sur le nationalisme, l’antisémitisme, et sur le
fascisme et le national socialisme, ont émis l’idée que Renan était à l’origine de tout ou partie
de ces courants, au moins en France, en créant une sorte d’arbre généalogique dont le tronc de
toutes les arborescences nationalistes serait l’auteur breton. Pour comprendre cette théorie, il
faut partir du constat selon lequel Renan serait « un antisémite savant »397, selon l’expression
de Djamel Kouloughli. Ce Professeur rattaché au Laboratoire des Théories Linguistiques de
l’université Paris-Diderot, crée ce qualificatif en analysant différents ouvrages de Renan, et
plus particulièrement De l’origine du langage, L’avenir de la Science, Histoire générale et
systèmes comparés des langues sémitiques, et « de la part des peuples sémitiques dans
l’histoire de la civilisation » (son discours inaugural au Collège de France en date du 23
février 1862, lorsqu’il obtient la chaire d’hébreux). Pour lui, dans De l’origine du langage,
« on le voit, la conception d’ensemble est en fait déjà entièrement donnée : il s’agira de
systématiser l’idée d’un contraste radical entre les langues sémitiques, "simples, et dénuées
des outils grammaticaux permettant la pensée analytique et rationnelle", et les langues indo-
européennes qui en sont l’exact opposé, et de tirer toutes les conclusions anthropologiques de
ces analyses »398. Mais Renan ne s’arrêterait pas à une simple opposition. Il mettrait en
corrélation la langue avec le schéma de pensée des peuples, instituant ainsi une hiérarchie
raciale par la linguistique399. Et selon l’analyse de la leçon inaugurale prononcée par Renan,
396 « l’archéologisme polémique que décrit Cust est, dans une certaine mesure, une version érudite de l’antisémitisme européen. L’expression "Sémites modernes", qui devait comprendre à la fois les musulmans et les juifs (et qui a son origine dans le domaine dit sémitique ancien, dont Renan a été le pionnier), porte sa bannière raciste avec ce qui voulait sans doute être une ostentation décente » (E. W. Said, L’orientalisme : l’Orient créé par l’occident, Paris, Edition du Seuil, 1980, p. 293). Pour confirmer ce constat se reporter à l’ensemble d’E. Renan, Histoire générale et systèmes comparé des langues sémitiques, op. cit.397 D. Kouloughli, « Ernest Renan : un antisémite savant », Histoire Epistémologie Langage, 29/II, 2007, p. 91.398 Ibid., p. 96.399 « On a déjà, dans ces quelques extraits de OL [De l’origine du langage], des éléments essentiels de la conception de Renan : Langue et pensée sont dans un rapport d’étroite interdépendance entre elles, mais aussi avec tous les autres éléments de la vie sociale et culturelle des peuples qui parlent. La philologie comparée va donc constituer le fondement d’une anthropologie scientifique permettant de situer les peuples le long d’un
- 68 -
l’homme indo-européen ne devrait rien aux juifs et aux musulmans car ils n’ont ni art, ni
philosophie, ni droit que nous devons aux grecs et aux romains400. Il tempère néanmoins son
propos à l’égard des juifs en accordant à leur actif l’écriture alphabétique, qui serait la source
de l’écriture moderne, et le monothéisme bien que les catholiques aient récupéré le concept
pour l’améliorer401. Après cette analyse, Djamel Kouloughli tire cinq caractéristiques de
l’antisémitisme de Renan. Le premier c’est que « l’antisémitisme de Renan a un fondement
complexe », car « son fondement n’est pas simplement "épidermique" comme l’est celui du
racisme vulgaire. Il est bien plus sophistiqué. Ce racisme est, si l’on peut risquer l’expression,
un « racisme ethno-linguistique » : c’est l’appartenance à une famille linguistique donnée qui
constitue la vraie signature de l’appartenance raciale »402. Le second est que « l’antisémitisme
de Renan est "hiérarchique" », puisque « Renan oppose une "race supérieure", la race aryenne
à l’ensemble des autres races humaines globalement considérées comme "inférieures". Ce
racisme, donc, ne se contente pas d’établir entre les peuples une partition disjonctive. La
division qu’il postule est hiérarchique, en sorte que l’on peut reconnaître entre deux races
distinctes des proximités, voire des affinités qui les séparent des autres races »403.
Troisièmement et quatrièmement l’antisémitisme de Renan est « "systématique" »404 et
« permet des prédictions » car « l’image extrêmement "typée" et systématique que Renan se
fait de ce que sont les Sémites et leurs cultures lui permet de formuler diverses prédictions sur
ce que l’on peut identifier, a priori, comme étant un quelconque de leurs avatars »405. Enfin,
l’antisémitisme de Renan serait « "fixiste", c’est-à-dire a-historique »406. C’est sur ce même
constat que se base Edward W. Said dans son ouvrage L’orientalisme : l’Orient créé par
l’Occident407. Pour lui Renan serait bien raciste, du fait des liens qu’il entretient avec
Gobineau en intégrant les études de ce dernier dans son France408 et en raison d’une certaine
parenté entre les œuvres des deux auteurs409. Il serait aussi raciste tout simplement parce qu’il
propose une division des races dans le chapitre I de l’Histoire des langues sémitiques410. Mais
raciste, en incluant les sémites, faisant de lui un raciste et un antisémite411, « savant » de
surcroît412. Ce qui importe n’est pas le fait qu’Edward Said partage l’opinion de Djamel
Kouloughli, mais les conséquences qu’il tire de ce constat. Pour lui, Renan a eu une influence
continuum révélant leurs aptitudes intellectuelles et, par-delà, leur capacité à contribuer à la civilisation humaine » (Ibid., p. 97).400 Ibid., pp. 97-102.401 Ibid., pp. 102-103.402 Ibid., p. 104.403 Ibid., pp. 104-105.404 Ibid., p. 105.405 Ibid., p. 109.406 Ibid., p. 110.407 E. W. Said, L’orientalisme, op. cit.408 Ibid., p. 175.409 « Nous pouvons citer de grand ouvrages orientalistes faisant preuve d’une véritable science, […] mais il nous faut aussi remarquer que les idées sur les races de Renan ou de Gobineau participaient du même mouvement, ainsi que beaucoup de romans pornographiques victoriens […] » (Ibid., p. 20). Voir aussi ibid., p. 118.410 Ibid., p. 158. Pour voir le chapitre 1 de l’ouvrage prit en exemple par l’auteur, voir E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, op. cit., pp. 1-26.411 E. W. Said, L’orientalisme, op. cit., pp. 164-167, p. 197, p. 293 et p. 336.
- 69 -
immense sur les penseurs et hommes politiques de son époque, même étrangers413. Cela s’est
fait par les travaux de Renan, qui pâtiraient d’une méthodologie peu rigoureuse consistant à
plaquer des notions qui étaient contemporaines à l’auteur sur des choses qui ne recouvraient
pas ce sens414, afin de créer un modèle basé sur des méthodes et un ensemble « d’idées
reçues », une praxis415, ce qui permettait la diffusion de ces « clichés » sur l’Orient en rendant
accessible les études sur le sujet416. Ainsi, Renan aurait créé de toute pièce l’Orient
sémitique417, ne s’intéressant « pas seulement [au] contenu de ce qu’il voit, mais, […],
comment il voit, la manière, parfois horrible, mais toujours attirante, que semble avoir l’Orient
de se présenter lui-même »418, lui permettant ainsi d’affirmer des choses sur l’Orient
conformément à la praxis culturelle développée par la philologie419, afin de récolter les
glorieux fruits de sa création. Une fois cette « modélisation » du sémite effectuée, il fallait
bien donner du poids à cette création. Pour ce faire Renan va rattacher sa création à des bases
scientifiques420, afin de faire passer la philologie pour la meilleure discipline scientifique421.
La conséquence, comme nous l’avons dit, va être l’influence considérable de Renan sur les
courants orientalistes422 et antisémites423. Edward W. Said va jusqu’à dire que l’islamophobie
actuelle découlerait d’une translation de la vision du juif avant l’ère nazie, basée en partie sur
les travaux de Renan424. Cette dernière analyse se rapproche quelque peu de la vision de Zeev
Sternhell. L’auteur Israélien qui enseigna à l’université hébraïque de Jérusalem pense lui aussi
que les travaux de Renan ont eu une grande influence puisque « c’est avec Renan que le
matérialisme est devenu non seulement un facteur déterminant de l’explication historique,
mais aussi un instrument de combat contre la démocratie »425, travaux à la teneur raciste et
antisémite426. Le postulat de monsieur Sternhell est en fait que Renan était la source
412 « Les opinions de Renan sur les Sémites orientaux sont, naturellement, moins du domaine des préjugés populaires et de l’antisémitisme courant que de celui de la philologie orientale scientifique. En lisant Renan et Silvestre de Sacy, nous pouvons facilement observer comment les généralités culturelles se sont mises à prendre une armature d’énoncés scientifiques et une atmosphère d’étude rectificatrice » (Ibid., p. 174).413 Ibid., p. 54 et p. 293414 Ibid., p. 58.415 Ibid., p. 145.416 Ibid., p. 194.417 Ibid., p. 164.418 Ibid., p. 214.419 Ibid., p. 305.420 Ibid., p. 145 et p. 174.421 Ibid., p. 157.422 Ibid., pp. 154-155, p. 226 et p. 273.423 Ibid., p. 293, p. 323 et p. 336.424 « En effet, le juif de l’Europe prénazie a bifurqué : ce que nous avons maintenant, c’est un héros juif, construit à partir d’un culte reconstruit de l’orientaliste-aventurier-pionnier (Burton, Lane, Renan) et de son ombre rampante, mystérieusement redoutable, l’Arabe oriental. Isolé de tout sauf du passé qu’a créé pour lui la polémique orientaliste, l’Arabe est enchaîné à une destinée qui le fixe et le condamne à une série de réactions périodiquement châtiées par ce que Barbara Tuchman appelle, d’un nom théologique, "l’épée terrible et rapide d’Israël" » (Ibid., p. 320).425 Z. Sternhell (dir), L’Eternel Retour, Paris, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, 1994, p. 24.426 « Drumont, cependant, n’était pas le seul disciple de Gobineau. Renan avait soigneusement annoté l’Essai, et s’en était même inspiré » (Z. Sternhell, La droite révolutionnaire : 1885-1914 les origines françaises du fascisme, Paris, Seuil, 1978, p. 154).
- 70 -
d’influence des nationalistes français427, voire étrangers comme Mussolini428 de par la teneur
antidémocratique et antirévolutionnaire de ses travaux429 ainsi que leur teneur raciste et
antisémite430. La conclusion est qu’ensuite, après avoir influencé Taine et de Soury431,
directement ou par le biais de ces deux récipiendaires, Renan aurait influencé Paul Déroulède
qui exprime les idées de Renan à travers un projet de programme scolaire432 et en le
vulgarisant433. Par le même procédé, il aurait encore influencé les nationalistes que sont
Maurras, Sorel, Paul Bourget, ou Barrès434. De plus, Renan aurait influencé l’antisémitisme de
ce dernier435, comme celui de Drumont par le biais de Gobineau436. Zeev Sternhell va même
plus loin en créant une filiation entre Renan et Vichy par le biais du matérialisme dont nous
avons parlé précédemment. En effet, Renan représente pour lui un partisan de
l’antimatérialisme, par opposition au matérialisme des Lumières437. Or, « chez Renan, c’est
encore et toujours le matérialisme qui porte la responsabilité de la décadence de la culture
européenne. En France, cette conviction sera répétée à l’envie, d’une manière pratiquement
identique, soixante-dix ans plus tard, lors de la débâcle de 1940 : c’est toujours le
matérialisme qui ronge le corps de la nation »438, ce qui explique que « l’antimatérialisme
constitue la colonne vertébrale et le dénominateur commun de toutes les tendances qui, de
Sedan à Vichy, entrent en révolte contre l’héritage du XVIIIe siècle, contre l’utilitarisme
libéral ou socialiste »439.
On pourrait penser que cette filiation est excentrique, si des auteurs comme Michel
Winock ne relevaient pas eux aussi des références à Renan, voire une inspiration de ce dernier
dans l’œuvre majeure de Drumont440. Et nous même ne pouvons que relever ces mentions. 427 Ibid., pp. 83-83.428 « Les pères intellectuels et les chefs du nouveau nationalisme – et de son corollaire, le socialisme national –, Déroulède, Barrès, Maurras, Sorel, ne s’y trompent pas qui voient dans l’auteur de La Réforme intellectuelle et morale leur maître à penser. Et ce n’est certainement pas l’effet du hasard si Mussolini insiste sur les "illuminations préfasciste"de Renan » (B. Mussolini, La Doctrine du fascisme, Florence, Vallechi, 1937, p. 34. Ibid., p. 84).429 Z. Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit., pp. 80-83. Z. Sternhell (dir), L’Eternel Retour, op. cit., pp. 24-25.430 Z. Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit., p. 154 et p. 163.431 Ibid., p. 163.432 Ibid., pp. 80-83.433 Ibid., p. 89.434 Ibid., pp. 83-84.435 Ibid., p. 163.436 Ibid., p. 154. En réalité, Zeev Sternhell n’exprime pas directement cette idée. Il nous dit : « C’est dans Gobineau, mais aussi dans Le Bon et chez le blanquiste Tridon que Drumont a puisé les principes de son racisme dont, très rapidement, il a fait une arme extrêmement redoutable. Drumont, cependant, n’était pas le seul disciple de Gobineau. Renan avait soigneusement annoté l’Essai, et s’en était même inspiré ». Cependant, on peut en déduire aisément que si Drumont a lu l’Essai, on peut supposer qu’il a lu les annotations de Renan et dès lors, qu’il a pris connaissance des idées de l’auteur, comme d’ailleurs le démontrent certaines mentions dans son livre La France juive sur lequel nous allons revenir.437 Sternhell (dir), L’Eternel Retour, op. cit., pp. 26-27.438 Ibid., p. 27.439 Ibid., p. 25.440 M. Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, op. cit., p. 125. En effet Winock estime qu’une des particularités du nationalisme Français, c’est l’antisémitisme. Il prend comme références entre autres,
- 71 -
Ainsi, Drumont écrit par exemple en citant l’Histoire générale et systèmes comparé des
langues sémitiques : « Renan a distingué beaucoup de ces points. "La race sémitique, selon
lui, se reconnaît presque uniquement à des caractères négatifs, elle n’a ni mythologie, ni
épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni arts plastiques, ni vie civile, en tout, absence
de complexité de nuance, sentiment exclusif de l’unité" »441. Il dit encore que « sur cet état
d’esprit du Juif, Renan encore est précieux à consulter »442. Le constat selon lequel
l’antisémitisme de Barrès était influencé par celui de Renan est aussi dressé par d’autres
auteurs tels Hervé Beaudin443. Il influença même des chercheurs moins connus, comme on le
voit dans la thèse de Gasnos, soutenue en 1897, dans laquelle Renan figure parmi les sources444. De plus, certaines idées développées par Renan, notamment l’ostracisation des Juifs à
cause de leurs textes saints qui les inciteraient à ne pas se mélanger445. Enfin, il semble que le
lien Renan-Vichy soit pour partie fondé, car Xavier Vallat par exemple, connu pour son
soutien au régime du Maréchal Pétain, cite Renan par une citation d’André Tardieu : « "J’ai
gardé, pour clore cette liste, deux écrivains à qui nos démocrates ont élevé des statues. M.
Renan, dont le Bloc des Gauches inaugurait naguère le monument à Tréguier […], avait écrit
"L’élection produit une moyenne d’opinion inférieure à la portée d’esprit du souverain le plus
médiocre. La chimère démocratique du règne de la volonté populaire aboutit à un régime
d’intolérables bassesses morale ". […]" »446. Il est donc fait référence, par un vichyste, au
Renan antidémocrate, ce qui montre une possible filiation entre Renan et Vichy.
§ 2 : Le passage de l’anti-sémitisme au philosémitisme par la réflexion sur la nation
Il semble que Renan fut bien antisémite, et qu’il ait influencé les auteurs nationalistes
sur le sujet. Pourtant, d’autres écrits de Renan viennent semer le doute quant à cette certitude.
L’un des plus significatifs, sur lequel nous porterons notre attention, c’est la conférence
Drumont, qui écrivit La France juive. Dans cet ouvrage, il fait référence à celui de Renan écrit en 1855, sa fameuse Histoire générale et Système comparé des langues sémitiques, qui apparaît selon Winock, comme une œuvre majeure de la pensée antisémite de Drumont. Renan aurait donc, directement ou indirectement influencé les nationalistes antisémites.441 E. Drumont, La France Juive, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éd. 43e, s. d., t. 1, p. 14.442 Ibid., p. 84.443 Pour une approche critique plus large de cette filiation intellectuelle, voir H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., pp. 161-166.444 X. Gasnos, Etudes historiques sur la condition des juifs dans l’ancien droit français, Thèse, Rennes, 1897, p. II. dans la bibliographie, apparaît Renan : « Renan. – Etude sur les rabbins français (Histoire littéraire de la France, t. XXVII) ».445 « Il est nécessaire d’exposer brièvement le caractère de la législation mosaïque ; elle a constitué même après la dispersion des Juifs à être la base de leurs codes, et elle a laissé en eux des traces si profondes qu’elle seule peut expliquer certaines parties de leur histoire au moyen âge. Contraints par elle à rester isolés pendant des siècles et à regarder comme sacrilège toute fusion avec des étrangers, les Juifs ont contractés l’habitude de cet isolement qui est devenu une nécessité, une loi ethnique de leur race. Grâce à elle, ils ont pu conserver jusqu’à nos jours leur nationalité distincte » (Ibid., pp. 6-7).446 X. Vallat, « Xavier Vallat 1891-1972 », Les amis de Xavier Vallat, s. l., s. n., 1977, p. 57.
- 72 -
prononcée au Cercle Saint-Simon le 27 Janvier 1883 intitulée Le judaïsme comme race et
comme religion447. L’objet de la conférence était de déterminer le lien entre la religion juive et
la « race juive »448. Renan expose alors qu’il existe une distinction entre les religions
universelles et les religions nationales, et affirme que le judaïsme était à l’origine une religion
nationale qui est devenu pour un temps universelle à cause de son prosélytisme sous
l’antiquité grecque et romaine, jusqu’à environ l’an 200 de notre ère449. Ensuite, bien qu’il
affirme que cette religion n’est pas sans défauts, il l’encense comme il ne l’avait jamais fait
avant : « L’histoire du peuple juif est une des plus belles qu’il y ait, et je ne regrette pas d’y
avoir consacré ma vie. Mais que ce soit une histoire absolument sans tâche, je suis loin de le
prétendre ; […]. De même, parce qu’on trouve que le peuple juif a été l’apparition peut-être la
plus extraordinaire de l’histoire, on n’est pas obligé pour cela de nier qu’il ne se trouve dans
sa longue vie de peuple des faits regrettables »450. On trouve aussi cette phrase : « la race
israélite a rendu au monde les plus grands services »451. Ainsi d’un côté, il vilipende les
sémites, et de l’autre il porte presque les juifs aux nues. Que penser de ce sentiment
contradictoire ?
Dans un premier temps, il faut remettre en question le modèle sternhellien. Ce modèle
semble solide tant dans la méthode qui l’a construit que dans ses conclusions452. Il n’est
pourtant pas exempt de critiques. Ainsi, bien que l’on reconnaisse la qualité et la quantité des
lectures qu’il présente pour forger son système et la remise en question de l’historiographie et
des schémas classiques sur les courants de droite en France, poussant certains chercheurs à
admettre l’existence d’un fascisme français453, deux objections peuvent être faites.
La première est la trop grand influence qu’accorde Zeev Sternhell à certains auteurs ou
courants minoritaires, et la seconde, d’avoir ignoré les autres mouvances nationalistes dans
d’autres pays européens comme l’Italie, pays berceau du fascisme et l’Allemagne, celui du
nazisme454. Effectivement, cette démonstration ne tient pas, si nous reprenons Drumont. 447 E. Renan, Le judaïsme comme race et comme religion, Paris, Flammarion, 2011 in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 79-111.448 « Que le judaïsme soit une religion et une grande religion, cela est clair comme le jour. Mais on va d’ordinaire plus loin. On considère le judaïsme comme un fait de race, on dit : "la race juive" ; on suppose, en un mot, que le peuple juif, qui, à l’origine créa cette religion, l’a toujours gardée pour lui seul. On voit bien que le Christianisme s’en est détaché à une certaine époque ; mais on se laisse aller volontiers à croire que ce petit peuple créateur est resté toujours identique à lui-même, si bien qu’un juif de religion serait un juif de sang. Jusqu’à quel point cela est-il vrai ? Dans quelle mesure ne convient t-il pas de modifier une telle conception ? Nous allons l’examiner » (Ibid., p. 82).449 Ibid., pp. 83-98.450 Ibid., p. 100.451 Ibid., p. 111.452 F. Germinario, « Fascisme et idéologie fasciste : problème historiographique et méthodologique dans le modèle de Zeev Sternhell », Revue française d’histoire des idées politiques, Paris, Picard, n°1, 1er semestre 1995, p. 40.453 Ibid., pp. 51-53.454 « Deux objections ont été opposées à ce propos au chercheur israélien qui, à notre avis, ne sont nullement marginales, mais, au contraire, apparaissent révélatrices des limites qui sous-tendent l’ensemble du modèle de Sternhell. En effet, on a reproché à Sternhell aussi bien la tendance à accroître démesurément l’influence de certains cercles intellectuels et de certaines publications qui restèrent minoritaire et à tout prendre marginales
- 73 -
Rappelons que selon l’idée de Sternhell, Renan est source de l’antisémitisme français, et par
lui-même ou l’intermédiaire de ses disciples, il aurait alors influencé tous les grands auteurs
antisémites ultérieurs. On peut donc penser à Drumont, qu’il cite implicitement en le
rapprochant de Gobineau. Mais si la citation est implicite, c’est que Drumont à lui seul fait
s’effondrer le modèle. En effet, Drumont critique vivement Renan, puisque ce dernier soutient
publiquement les Juifs à cause de son « désir de plaire aux Juifs »455. Mais ce n’est pas tout,
car Drumont nous annonce, très prometteur, que « nous verrons, dans ce livre, Renan tombé
plus bas encore »456. Ainsi il se tromperait en affirmant qu’il y avait eu des conversions au
judaïsme457, et aurait commis le crime de s’associer avec les juifs pour obtenir le prix biennal
de l’Académie des Belles Lettres458. D’autres critiques de l’auteur mettent en avant le peu
d’estime que porte Drumont à Renan, qui est finalement pour lui quelqu’un ayant eu quelques
idées brillantes qu’il a reniées pour d’obscures raisons. On trouve même chez d’autres
auteurs, une assimilation de Renan à tout ce qui sera honni par les cagoulards et les vichystes :
la Maçonnerie et les Juifs459. Une autre incohérence dans la pensée de Sternhell, c’est
l’opposition radicale entre la pensée générale de Renan et la politique de Vichy. Bien que
nous sachions maintenant que les nationalistes ont repris Renan en orientant les lectures,
notamment une lecture inclusive de certains critères de composition de la nation, l’opposition
suivante nous apparaît difficilement camouflable : « En 1940, Pétain dénonçait la corruption
des esprits et le laxisme des mœurs de la civilisation urbaine, en 1871, Ernest Renan
dénonçait, avec sa Réforme intellectuelle et morale, la corruption des valeurs de la terre par le
matérialisme paysan et l’inaptitude intellectuelle du paysan, comme l’ouvrier, à sélectionner
dans une démocratie égalitaire l’aristocratie du savoir à qui devait revenir l’exercice des
destinées nationales »460. Dès lors, si comme nous l’avons démontré les nationalistes préfèrent
se référer à La Réforme, plutôt qu’à Qu’est-ce qu’une nation ? (ou en tout cas en admettre une
version déformée et implicite) pour fonder leurs nationalismes, les nationalistes n’ont pu
ignorer ce fait. C’est donc cette inadéquation de schéma général, qui fait qu’on ne trouve que
des références indirectes à Renan dans de rares écrits de quelques vichystes. Or, cette
raréfaction des références, montre bien la gêne des collaborateurs de Vichy à utiliser l’auteur,
et si gêne il y a, c’est peut-être parce qu’ils ne se reconnaissent pas en lui, et que de facto, il
n’est pas la « source » de Vichy.
dans la pensée politique française, que sa sous-évaluation des tendances antidémocratiques analogues qui sont développées dans les pays de langue allemande et en Italie pendant ces mêmes décennies où Barrès lançait en France le mouvement socialiste national » (Ibid., p. 54).455 E. Drumont, La France Juive, op. cit., p. 16.456 Ibid., p. 17.457 Ibid., p. 87.458 E. Drumont, La France Juive, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éd. 43e, s. d., t. 2, p. 218.459 Voir sur ce point M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., pp. 23-24. Dans ces pages Maurice Gasnier expose des extraits de journaux de 1892 où Renan est considéré comme un « judaïsant ».460 P. Barral, « la terre », in J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, op. cit., t. 3 « Sensibilités », p. 55.
- 74 -
Outre la critique du système sternhellien, certains auteurs doutent de la réalité de
l’antisémitisme de Renan, certains pensant même qu’il n’était pas antisémite, et n’accordant
ainsi pas ou peu de crédit aux postulats posés par l’auteur israélien. Par exemple Jean-Pierre
Van Deth pense que « sorties de leur contexte, ou lues trop rapidement, de telles assertions
pourraient faire craindre le pire. Mais accuser Renan de racisme, prétendre, comme
Brunetière, qu’il fut "l’un des patrons ou des fauteurs de l’antisémitisme", c’est faire preuve
d’une singulière légèreté, pour de pas dire de mauvaise foi »461. Il ajoute même que Renan ne
peut pas être antisémite parce qu’il parle de Spinoza en des termes élogieux lors d’une
conférence du 12 février 1877, à La Haye, pour le bicentenaire de la mort du philosophe462, et
parce qu’il se serait servi de la conférence prononcée au Cercle Saint-Simon, avec laquelle
nous avons introduit le propos, afin de « rétablir la vérité, une vérité qu’il n’a d’ailleurs cessé
de proclamer : qu’il n’y a pas de race juive »463. Béatrice Philippe présente une position plus
nuancée qui rappelle que, bien que Renan se soit interrogé sur la « race sémitique », et conclut
que Jésus ne pouvait pas appartenir à cette « race inférieure », ce dernier s’est tout de même
interrogé en 1883 lors de la conférence au Cercle Saint-Simon sur le point de savoir s’il
existait une « race juive » ou une « race sémitique ». Sa conclusion serait alors qu’il n’en
existerait pas vraiment464. Mais l’idée la plus intéressante, c’est celle basée sur le paradoxe
suivant : les Juifs qui sont décrits comme des « Sémites », ne sont en réalité pas des
« Sémites », parce que cette « race » n’existeraient plus465. Cette affirmation semble justifiée,
et entre dans les contradictions de la pensée de Renan, que relève Maurice-Ruben Haydoun :
« Le philosophe-historien n’a pas reculé devant les déclarations contradictoires ; et il a
souvent apporté à des développements – parfois très substantiels – des conclusions si
déroutantes que l’on s’interroge légitimement sur ses intentions profondes : avait-il vraiment
des idées claires sur ce thème précis des juifs et de leur judaïsme ? »466. De cette interrogation
sur la « bonne foi antisémite » de Renan, deux choses sont certaines selon lui, c’est qu’il
détestait leurs traditions orales et les pharisiens467, et nous pourrons ajouter leurs textes,
notamment le Talmud. En analysant plus en profondeur les textes de Renan, Maurice-Ruben
Haydoun parvient à la conclusion qu’en réalité, Renan ne serait pas antisémite.
En premier lieu parce qu’il critiquait les Juifs de l’Antiquité, qu’il estimait
dogmatiques et sectaires, et non pas les Juifs qui lui étaient contemporains et avec qui, il
semblait entretenir de bonnes relations, comme certains de ses collègues de l’Académie des
Belles Lettres468. Deuxièmement, Renan ferait un transfert entre sa propre expérience avec le
catholicisme vis-à-vis du Judaïsme. Cela transparaîtrait lors de l’éloge à Spinoza, la
461 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., p. 184.462 Ibid., p. 389.463 Ibid., p. 428.464 B. Philippe, Etre Juif dans la société française, s. l., Montalba, 1979, pp. 224-225.465 E. W. Said, L’orientalisme, op. cit., p. 170.466 M.-R. Hayoun, Renan, la Bible et les juifs, Paris, Arléa, 2008, p. 97.467 Ibid, p. 99.468 Ibid., p. 99.
- 75 -
comparaison entre les deux hommes étant flagrante469. Ainsi s’« il s’identifie trop vite à ceux
qui eurent à souffrir des rigueurs de l’intolérance ecclésiastique »470, c’est parce qu’il
transpose les critiques sur « l’étroitesses d’esprit » du catholicisme aux Juifs orthodoxes qui
se basent uniquement sur les textes, pensent être les « élus » qui ne doivent pas se mélanger
aux « goyim », et qui font preuve d’autant de réserve sur la science et la recherche que les
catholiques. Troisièmement, Renan n’aurait pas été antisémite, si l’on regarde l’évolution de
sa pensée. Cette pensée aurait été récupérée justement sans tenir compte de cette évolution.
En fait, la pensée de Renan sur la question des Sémites, se diviserait en deux temps, de 1855 à
1870, puis de 1870 à sa mort, où l’on assiste à un revirement471. Dans la première phase, il
subirait l’influence des idées des penseurs allemands qu’il avait découvert à Saint Nicolas, et
qui lui avaient fait forte impression, ce qui fait qu’il aurait simplement plaqué des mots et
notions qu’il avait abordés dans ses lectures des auteurs d’outre Rhin, sans réellement
s’interroger sur leur sens profond472. Dans la seconde période, Renan subit ce qu’on pourrait
appeler « l’électrochoc prussien ». Car c’est la guerre de 1870, et l’échange avec Strauss qui
vont faire mûrir de nouvelles réflexions chez l’auteur. En effet, cette idée semble juste, car
rappelons nous cette fameuse phrase dans la Seconde lettre à Strauss, quand ce dernier fait
comprendre à Renan que les Alsaciens doivent revenir à la France parce qu’ils sont de race
germanique, et que le breton comprend toute la politique impérialiste de Bismarck : « Notre
politique, c’est la politique du droit des nations ; la vôtre, c’est la politique des races : nous
croyons que la nôtre vaut mieux »473. Cette phrase est l’expression de la nouvelle vision de
Renan, et il suffit de lire toute la lettre, pour voir que, dans les développements qui y sont
faits, préfigure la conférence de 1882 sur la nation. C’est justement cette conférence qui est la
plus importante pour Maurice-Ruben Haydoun, et qui montre que Renan, s’il avait pu être
antisémite dans le passé, ne l’était plus en 1882 : « Mais l’âge aidant, le savant sémitisant se
détourna de la notion de race pour se consacrer à l’idée de nation. D’où la fameuse conférence
de 1882, en Sorbonne, intitulée Qu’est-ce qu’une nation ? A partir de là, toute frontière
ethnique entre Juifs et Aryens est désormais abolie »474. C’est pourquoi cette conférence, bien
qu’elle n’aborde pas la question des Sémites, est fondamentale sur ce point. En effet, comme
nous l’avons démontré, Renan était bien raciste, parce qu’il appliquait le schéma de ses
contemporains, d’une Europe dominant les différents autres continents. De même, il critique
les Turcs et plus largement les Arabes et Magrébins, parce qu’ils sont musulmans et que selon
lui la religion musulmane rend ces peuples arriérés et les empêche de se constituer en nation.
Oui, mais la religion musulmane, pas judaïque. Ses exemples concernent des pays qui ont des
frontières plus ou moins établies sur les cartes, et qui sont des Sémites musulmans, pas des
469 Ibid., p. 117.470 Ibid., p. 102.471 Ibid., p. 133.472 Ibid., p. 271.473 E. Renan, « Nouvelle lettre à M. Strauss, 15 septembre 1871 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, op. cit., p. 456.474 Ibid., p. 136.
- 76 -
Sémites judaïsant, qui n’ont pas de territoire établi, et pas la même religion. Dès lors, quand
Renan récuse la race comme fondement essentiel de la nation, cela signifie que les Juifs qui
vivent en France, qu’ils soient ou non réellement une race, peuvent s’intégrer dans la nation
française. Ici apparaît le clivage entre Renan et les futurs antisémites, puisque ces derniers
considèrent que les juifs sont les maux de la France, et refusent leur intégration au corps
national. Mais nous pouvons aller plus loin que Maurice-Ruben Haydoun, qui ne s’arrête qu’à
la conférence Qu’est-ce qu’une nation ?, pour asseoir cette idée. Si l’on prend la conférence
Le judaïsme comme race et comme religion, on trouve la confirmation de cette théorie,
notamment la conclusion que voici :
« Réjouissons-nous, Messieurs, que ces questions, si intéressantes pour l’histoire et
l’ethnographie, n’aient en France aucune importance pratique. Nous avons, en effet, résolu la
difficulté politique qui s’y rattache de la bonne manière. Quand il s’agit de nationalité, nous
faisons de la question de race une question tout à fait secondaire, et nous avons raison. Le fait
ethnographique, capital aux origines de l’histoire, va toujours perdant de son importance à
mesure qu’on avance en civilisation. […] Assimilée aux différentes nations, en harmonie avec
les diverses unités nationales, elle continuera à faire dans l’avenir ce qu’elle a fait dans le
passé »475.
On constate qu’on retrouve la même idée que celle développée dans la conférence de
1882 dans cette conférence qui lui est postérieure d’un an, et que cette idée s’applique ici
explicitement aux Sémites judaïques. Dès lors, selon la définition moderne de l’antisémitisme
Renan n’aurait finalement pas été antisémite. Selon la conception de l’époque, il semblerait
cependant qu’il ait toujours eu quelques difficultés avec les musulmans.
Dès lors, nous pouvons conclure que comme souvent, Renan a un discours ambigu, et
qu’une mauvaise lecture de ses propos, ou en tout cas une lecture peu rigoureuse ne
s’intéressant pas à l’évolution de la pensée de l’auteur, ont conduit à cet amalgame476. Il s’agit
en réalité de la même conclusion que pour Renan et le racisme : en fonction de ce qu’il dit et
de la manière dont on veut s’y référer, on lui attribue ou non une réputation d’antisémite.
Mais nous pouvons affirmer avec certitude, que dans ses écrits d’après 1870, et surtout, avec
sa conférence Qu’est-ce qu’une nation ?, Renan s’était émancipé des lectures et écrits de sa
jeunesse, et qu’il n’était pas antisémite au sens contemporain que la majorité des études lui
donnent actuellement, par anachronisme et à cause du même manque de rigueur vis-à-vis de
l’évolution de pensée qui a conduit des auteurs antisémite à le revendiquer477 .
475 E. Renan, Le judaïsme comme race et comme religion, op. cit., in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., pp. 110-111.476 M.-R. Hayoun, Renan, la Bible et les juifs, op. cit., p. 97.477 Sur ce manque de rigueur voir ibid., p. 271.
- 77 -
Chapitre 2 : La nation contractuelle de Renan
Nous savons désormais, que la majorité des auteurs ne retiennent de la définition
renanienne de la nation, que la formule « la nation est un plébiscite de tous les jours ». Mais il
convient d’aller plus loin, et de comprendre ce qu’entendent les auteurs en utilisant cette
formule.
Ainsi, après avoir recensé les auteurs se référant à cette phrase dont ils tirent tous la
même conclusion, et essayé de comprendre pourquoi (section 1), nous constaterons que toutes
ces références sont sujettes à des critiques méthodologiques, et tenterons de proposer une
autre vision de la conception renanienne de la nation (section 2).
Section 1 : La quasi unanimité des auteurs sur le lien « nation renanienne » et « nation
contractualiste »
Nombre de chercheurs citent la conférence de Renan en se référant à l’idée de
plébiscite, d’adhésion volontaire de la nation, en tirant la conclusion que l’idée de nation chez
Renan est la directe héritière de la philosophie des Lumières. Il convient de recenser ces
auteurs et de voir sur quelle portion de phrase ou d’idée générale ils se basent (§1), avant
d’essayer de comprendre ce qui chez Renan, a pu engendrer une telle idée (§2).
§ 1 : Recensement et exposition de la théorie « nation renanienne égal nation contractuelle »
Ce recensement ne sera pas exhaustif, car vu le nombre conséquent d’auteurs utilisant
le « plébiscite de tous les jours », cela participe d’une tâche quasiment impossible. Nous nous
concentrerons alors sur ceux qui en font de simples mentions sans entièrement répéter ce que
nous avons déjà vu, pour aller vers les auteurs qui expriment cette idée et la travaillent.
Ainsi certains chercheurs insèrent cette expression sans réellement l’expliquer. On
trouve par exemple ceci : « Si, comme l’a dit Ernest Renan, une nation est un "plébiscite
quotidien", ce plébiscite a aussi pour enjeu le maintien ou non d’un héritage existant. Renan a
également défini les nations comme l’aboutissement d’un long passé d’effort, de sacrifice et
de dévouement. Sans un tel héritage, il ne peut y avoir de nation, et si le plébiscite le rejette, la
nation cesse d’exister »478. C’est un résumé très bref du plébiscite. Ici on trouve la fonction du
plébiscite : c’est la cohésion de la nation autour de valeurs. Cependant il n’est pas expliqué
par l’auteur comment celui-ci se manifeste, ce que recouvre l’héritage, ou encore la mise en
478 S. P. Huntington, Qui sommes-nous ? : Identité nationale et choc des cultures, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 332.
- 78 -
exergue du futur qui est tout aussi important que le passé. C’est donc un condensé succinct.
On rencontre aussi parfois des développements un peu plus complets : « On fait parfois
référence, dans la ligne de Renan, à une théorie élective de la nation, par opposition à la
théorie ethnique ou encore organique. Dans cette conception, la nation n’existe que par le
consentement de ceux qui la composent. C’est une "association séculaire", ce qui implique
non seulement l’adhésion présente et la volonté tendue vers un avenir commun, mais la
connaissance et l’adoption de l’héritage du passé »479. On trouve ici l’opposition entre les
deux conceptions classiques de la nation. Elle sera quelque peu développée dans la suite de
l’article, le triptyque « passé-présent-futur », mais sans que ne soit encore vraiment développé
ce qu’on entend par héritage, ni le fait que la subtilité de l’adhésion présente se fait en réalité
autour de l’héritage du passé, mais aussi du projet futur. Or, la phrase telle qu’elle est
formulée peut laisser entendre que ces trois stades temporels sont indépendants les uns des
autres.
Beaucoup plus laconique, mais qui exprime subtilement l’idée autour de laquelle se
fédèrent les auteurs, est ce qu’écrit Shlomo Sand à propos du plébiscite : « Renan déclara en
1882 : "L’existence d’une nation est (pardonnez moi cette métaphore) un plébiscite de tous les
jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. […]". Même si
l’on trouve des contradictions et des hésitations chez ces deux penseurs brillants [Renan et
Mill], le fait qu’ils aient identifié un noyau démocratique au cœur de la formation de la nation
indique que leur compréhension de la dimension moderne est liée à l’apparition même de ce
concept. Ce n’est pas un hasard s’ils étaient l’un et l’autre des libéraux qui redoutaient la
culture de masse tout en acceptant le principe du gouvernement par le peuple »480. Ce passage
sur le plébiscite n’explique rien à son sujet, en revanche, il relie ce concept à la démocratie et
au suffrage universel. En d’autres termes, il rattache cette idée au courant républicain, à l’idée
de démocratie telle qu’on la trouve chez les philosophes des Lumières. D’autres auteurs
renvoient implicitement à ce courant en expliquant plus ou moins le concept du plébiscite481,
plus intéressants sont ceux qui le font explicitement. Par exemple : « Contre cette acception
romantique, voire ethnique, l’historien Ernest Renan défend, dans une conférence ("Qu’est-ce
qu’une nation ?", 1882), la conception élective héritée de la Révolution. Pour lui, la nation est
un "plébiscite de tous les jours" […] »482. Encore plus directe et plus développée, c’est
l’analyse de ce plébiscite faite par la récente thèse de Hervé Beaudin. Dans les premières
pages de son ouvrage, celui-ci évoque la vision contractualiste de Renan et reproduit un
tableau dans lequel le nom de Renan figure dans la case contrat483. Il mentionne aussi
479 Y. Lequette, « Réflexion sur la nationalité française », Cahier du droit constitutionnel, n° 23, février 2008, p. 1. Cet article est accessible via http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/cahiers-du-conseil/cahier-n-23/reflexions-sur-la-nationalite-francaise.51810.html , et la page fait référence à la version pdf du document.480 S. Sand, Comment le peuple juif fut inventé, op. cit., p. 76.481 Comme par exemple M. Viroli, For love of Country, op. cit., pp. 159-160. J. P. Rioux, La France perd la mémoire, op. cit., p. 227-228.482 T. Pech, « La fabrique de l’identité nationale », Alternatives économiques, n°287, janvier 2010, p. 80.483 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., pp. 17-18.
- 79 -
plusieurs fois la nation contractualiste de Renan, notion dont la teneur serait confirmée par les
propos que Renan a tenus au Cercle Saint-Simon484. Puis il développe quelque peu l’idée en
parlant de « contrat politique » à plusieurs reprises485. On peut se demander ce qu’il entend par
« contrat politique », quelle est la nature réelle du contrat, son économie ou ses termes ?
Hervé Beaudin définit ce qu’il entend par « contrat politique » ou ce qu’on pourrait appeler le
« contrat renanien » un peu plus en aval. Pour lui, ce qu’il appelle l’« école contractualiste » à
laquelle appartient Renan, c’est « l’école » du contrat social, c’est-à-dire de tous les auteurs
du contrat social. Renan synthétiserait par son idée contractuelle, les idées de Hobbes, de
Locke et de Rousseau. En fait, le plébiscite est le contrat social passé par les citoyens, c’est-à-
dire la nation, avec l’Etat ou la société, pour vivre ensemble d’un commun accord. On
comprend alors mieux la simple mention du plébiscite, sorte de leitmotiv permanent quand on
parle de Renan, ou les mentions « conception élective de la nation », « conception
démocratique », chez les autres auteurs qui ne développent pas plus cette idée. C’est parce
qu’elle est communément admise par la majorité des auteurs, si bien qu’un réflexe pavlovien
se fait : quand on lit « plébiscite de tous les jours » la traduction est « idée du contrat social ».
C’est ce qui explique que monsieur Beaudin ait rattaché Renan aux républicains486, et ait
affirmé dans un premier temps que « Renan – ce rationaliste épris des idées de la Révolution
française – […] »487.
Mais il faut alors chercher à comprendre pourquoi cette idée a germé dans l’esprit de
nombreux auteurs, et donc chercher une explication dans l’œuvre de Renan.
§ 2 : La justification de la vision contractualiste de l’idée de nation renanienne.
Si l’idée de nation renanienne est inspirée du contrat social, c’est donc qu’il était
proche des républicains voire était républicain lui-même. C’est en tout cas ce que pensent les
auteurs qui font le lien entre Hobbes, Locke et Rousseau, et Renan.
L’œuvre qui atteste le plus certainement des idées républicaines de Renan, nous
l’avons déjà mentionnée, c’est Caliban. Les deux personnages centraux sont Caliban,
personnification de la démocratie et de la République, et Prospero, qui représente le chercheur
aristocrate et qui n’est autre que l’avatar littéraire de Renan. Dans cette pièce Caliban,
l’esclave de Prospero se révolte, dépose son maître et prend le pouvoir à sa place. Mais nous
nous intéresserons plus précisément à l’acte quatre scène V et l’acte cinq dans son ensemble.
Dans l’acte quatre scène V, le frère Augustin de Ferrare qui représente l’inquisition et plus
484 Ibid., p. 92 et pp. 229-230.485 Ibid., pp. 69-70, p. 242 et p. 246.486 Ibid., p. 241.487 Ibid., p. 162. Attention, la mention « dans un premier temps », est placée ici à raison. Cette page a été l’objet d’errata qui modifient radicalement la citation et l’idée que l’auteur de fait de Renan. Nous reviendrons sur cette modification ultérieurement.
- 80 -
largement la morale religieuse, dresse le chef d’accusation de Prospero et le somme de le
suivre afin d’être incarcéré dans l’attente de son procès. Mais alors que Prospero se sent
vaincu, un personnage lui rappelle que, bien que le peuple l’a déchu de son titre nobiliaire et
de son pouvoir aristocratique, il lui a par la même occasion donné la liberté, liberté qui est
garantie par la République. Dès lors, au nom de la République de Milan, l’individu renvoie le
moine en lui disant qu’il n’a pas de pouvoir juridique en ce lieu, car la République ne le lui
reconnaît pas cette compétence. Un autre personnage accorde au crédit de Caliban que celui-
ci est en plus anticlérical, ce qui fait dire à Prospero : « C’est vrai (après une minute
d’hésitation). Dans l’exil, je trouverais partout un moine. Ma foi, vive Caliban ! »488. Dans
l’acte cinq scène I, Caliban se rend dans une abbaye et promet à un légat du pape de
reconnaître et de protéger l’Eglise. Mais lorsque celui-ci demande à Caliban de livrer
Prospero à l’Inquisition, il refuse en disant qu’il doit défendre Prospero, même si ce dernier a
voulu nuire à la République, et qu’il faut qu’il travaille à ses recherches librement afin que lui,
Caliban (c’est-à-dire la République), puisse récolter une part des fruits de ce que Prospero
découvre. Tout à la fin de la scène, un personnage, le Prieur des chartreux, résume l’idée du
livre, et donc, l’idée de Renan : l’aristocratie a donné bonnes mœurs et éducation au peuple,
mais un jour celui-ci s’est révolté et a pris le pouvoir. Les hommes « éclairés » acceptent cet
état de fait. Car au fond, même si ce régime n’est pas attirant en apparence, il vaut peut être
mieux que l’ancien, ou pourrait valoir mieux si l’on en modifie la direction en prenant le
pouvoir dans ses institutions, puisque la démocratie laisse cette possibilité489. Dans la dernière
scène, Gonzalo dit à Caliban qu’il a bien fait d’accepter la République, car c’est finalement
faire quelques concessions pour garder l’essentiel, ce à quoi Prospero répond à un troisième
personnage par une phrase qu’on peut traduire ainsi : avec ce nouveau régime, Prospero aura
peut être enfin la liberté qu’il attendait et qu’il n’avait pas trouvé avec l’ancien régime490. On
comprend alors pourquoi des auteurs comme Maurice Gasnier le pensent démocrate, en
s’appuyant sur une ou plusieurs des citations de Caliban491.
Certains font même remonter le républicanisme de Renan à l’époque où celui-ci avait
quitté le séminaire, et rédigeait L’avenir de la Science492. On pourrait aussi se référer aux
propos qu’il fait tenir au monarchiste et au républicain dans La Réforme intellectuelle et
morale, que nous avons précédemment évoqués, et considérer qu’il se rapproche plus du point
de vue du républicain493.
Mais revenons précisément à la conférence Qu’est-ce qu’une nation ?, et les idées
républicaines qu’on peut y trouver, ainsi que dans Le judaïsme comme race et comme
religion. Dans Qu’est-ce qu’une nation ?, on trouve une sorte de « pré-formulation » du 488 E. Renan, Caliban : suite de la tempête, Paris, Calmann-Lévy, 1878, pp. 79-83.489 Ibid., pp. 84-92.490 Ibid., p. 93.491 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : […], op. cit., pp. 19-20.492 J.-P. Van Deth, Ernest Renan : simple chercheur de vérité, op. cit., p. 62.493 Supra., p. 17.
- 81 -
plébiscite qui peut renvoyer à une idée de volonté populaire, avec l’exemple de la Rome
antique : « L’Empire romain fut bien plus près d’être une patrie. En retour de l’immense
bienfait de la cessation des guerres, la domination romaine, d’abord si dure, fut bien vite
aimée. Ce fut une grande association, synonyme d’ordre, de paix et de civilisation »494. La
signification de ce que dit Renan, c’est que l’Empire romain s’approchait d’une patrie, ici
synonyme de nation, parce que tous les membres de l’Empire avaient fini par aimer Rome
dans son ensemble, c’est-à-dire son histoire, sa culture ou encore ses valeurs. « Mais un
empire douze fois grand comme la France actuelle, ne saurait former un Etat dans l’acception
moderne » 495, car l’on peut supposer que les individus ne pouvait pas avoir une certaine
proximité commune avec les valeurs de l’Empire Romain, celui-ci étant trop étendu, et c’est
pourquoi il a fallut attendre les invasions germaniques. On peut aussi interpréter les propos
que tient Renan à propos de l’évolution qui a conduit les peuples barbares à devenir les
peuples de France, d’Allemagne, d’Italie et d’autres pays encore. Pour lui la raison
fondamentale est que tous ces peuples ont fini par se métisser, adopter les us et coutumes des
uns et des autres et forger une langue commune tout en oubliant les anciennes distinctions.
Cela conduit Renan à dire que : « Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient
beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses »496. On peut
aussi interpréter cela comme une idée républicaine attachée à l’idée des Lumières et du
contrat social. Car pour former une nation selon le philosophe, les individus ne doivent se
préoccuper que de ce qui les rassemble et qu’ils oublient le reste. Finalement comme le
contrat social où dans les différents types proposés, ce qui rassemble les hommes autour de ce
contrat, c’est le commun accord qu’ils ont de défendre leurs intérêts, de se protéger, de former
une grande société ou autre, peu importe la race, la langue ou la religion497. On trouve aussi
dans cette conférence, un éloge de la Révolution dont les républicains se veulent les héritiers,
puisque selon Renan, « c’est la gloire de la France d’avoir, par la Révolution française,
proclamé qu’une nation existe par elle-même »498. D’autres phrases de la conférence ont été
retenues pour expliquer le concept de nation avec une vision contractualiste : « Une nation est
un principe spirituel, résultant des complications profondes de l’histoire, une famille
spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol », et sa répétition : « Une
nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,
constituent cette âme, ce principe spirituel »499. Cette idée entretient un lien ténu avec celle du
contrat social. Il semble que la réflexion de certains soit la suivante : la nation est donc une
chose organisée immatérielle, abstraite. Qu’est ce qui est aussi une organisation immatérielle
et abstraite ? Le contrat social. Car en effet, celui-ci, comme tout contrat, naît par la parole, la
négociation. Mais pour s’assurer de la fides du cocontractant, on le rédige sous forme d’une 494 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 52.495 Ibid., p. 52.496 Ibid., pp. 52-57.497 Bien que chez Locke, ce dernier point puisse être discuté, nous y reviendrons.498 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 58.499 Ibid., pp. 73-74.
- 82 -
constitution, afin que chaque partie connaisse de manière certaine les clauses du contrat. C’est
l’exemple de l’Assemblée Nationale Constituante de 1789, qui avant de voter la constitution,
l’a discutée, a rédigé des brouillons et finalement adopté un texte. Il en va de même avec celui
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui est censée être l’expression
formelle des droits universels des hommes qui existaient déjà en tout temps et en tout lieu, ce
qu’on peut traduire par les fondement du contrat social. Ainsi le « consentement actuel, le
désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu
indivis », cette « grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, [qui] crée
une conscience morale qui s’appelle la nation », la proposition de consulter « les populations
disputées » car « elles ont bien le droit d’avoir un avis sur la question », comme le
« plébiscite de tous les jours »500, seraient l’expression de l’attachement de Renan au contrat
social, à la démocratie, à la République et aux républicains.
Le ralliement de Renan aux idées républicaines et plus largement à la République ne
se serait pas arrêté avec cette conférence, puisqu’il l’aurait clamé directement dans des lettres501, à travers ses Drames Philosophiques dont Caliban fait partie, mais plus largement dans
tous ses autres écrits dont, la conférence La judaïsme comme race et comme religion. Cette
conférence que nous avons déjà abordée, serait une confirmation du sentiment républicain de
Renan puisqu’en effet, il parle de la République en des termes élogieux. Reprenons cette
citation pour s’en convaincre : « Quand il s’agit de nationalité, nous faisons de la question de
la race une question tout à fait secondaire, et nous avons raison. […] Quand l’Assemblée
nationale, en 1791, décréta l’émancipation des juifs, elle s’occupa extrêmement peu de la
race. Elle estima que les hommes devaient être jugés non par le sang qui coule dans leurs
veines, mais par leur valeur morale et intellectuelle. C’est la gloire de la France de prendre ces
questions par le côté humain »502.
Si l’on s’arrête à ces phrases plutôt élogieuses de la République et de la démocratie, on
en traduit effectivement que Renan était bien républicain ou du moins un sympathisant, et que
son concept de la nation se situe bien dans la droite ligne de l’héritage des Lumières, dans la
droite ligne du contrat social. Pourtant, cette conception de la nation renanienne n’est pas
exempte de critiques, principalement méthodologiques, mais aussi conceptuelles.
Section 2 : L’incohérence du lien « nation renanienne » et « nation contractualiste » par
l’évolution de la pensée de Renan
500 Ibid., pp. 74-77.501 « Je suis bien un républicain du lendemain, ce qui n’empêche pas que je crois être un ami sincère de la République » (E. Renan, Lettre à D. Rebité, 29 décembre 1878, Œuvres Complètes, Paris, Calmann-Lévy, 1947 à 1961, t. 10, p. 787).502 E. Renan, Le judaïsme comme race et comme religion, op. cit., in E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 110.
- 83 -
Considérer que la conférence de Renan est une affirmation du Contrat social ou une
vision républicaine de la nation, parce que cette dernière se situe après Caliban, et avant une
série d’autres textes affirmant un ralliement à la République semble séduisant. Mais c’est
placer l’auteur dans les seize dernières années de sa vie, et ignorer, si l’on part de sa sortie du
Séminaire et du début de sa carrière de lettré, la trentaine précédente.
Il semble alors que la conclusion que nous avons présentée précédemment souffre de
quelques critiques (§1) qui, une fois exposées, nous permettrons de proposer une autre
conception de la définition de la nation selon Ernest Renan (§2).
§ 1 : L’anachronisme du rattachement de la nation renanienne au contrat social
Hervé Beaudin, qui exprime le plus ouvertement ce lien de filiation entre les Lumières
et Renan, et le républicanisme de celui-ci, nous explique que « pour bien comprendre les idées
de Renan sur la nation, il faut se replacer dans le contexte de l’époque ou elles furent
énoncées »503. Mais cette analyse contraint l’auteur à revenir sur ce qu’il a dit. Ainsi, de
fervent républicain influencé par les idées de la Révolution, il devient un traditionaliste qui
n’aimait guère la Révolution504. Dès lors, si tous les passages mentionnant un Renan
républicain ou démocrate ne sont pas soumis à des errata, on peut cependant estimer que ce
revirement jette le doute sur la proximité supposée entre les idées de la Révolution et Renan,
voire même démontre l’erreur de l’idée d’une « nation-contrat » renanienne.
En effet, ici aussi, comme pour l’antisémitisme, il faut respecter l’évolution de la
pensée de Renan dans le temps, en adoptant la chronologie proposée par M.-R. Hayoun505.
Excepté dans L’avenir de la Science, nous savons que Renan va développer des idées
monarchistes de 1855 à environ 1870-1871. Nous savons aussi que ce sont les deux lettres
adressées à Strauss qui vont faire réfléchir l’auteur jusqu’à ce qu’il se « convertisse » à la
République avec Caliban. Car il s’agit d’une réelle conversion, non sans critique. En réalité,
le Prospero/Renan est un défenseur de la monarchie qui critique la République, et qui fini par
se rallier à celle-ci en admettant que finalement, ce régime n’est peut-être pas pire que le
précédent car il le laisse effectuer ses recherches librement. Mais cela ne l’empêche pas
d’émettre un avis critique sur celle-ci, notamment dans la dernière scène de l’avant dernier
acte, où l’on sent que même si cette République peut augurer des jours meilleurs, il n’est pas
exclu qu’elle prenne un autre chemin, et que pour la diriger dans le bon sens, il faille alors
503 H. Beaudin, L’idée de nation, op. cit., p. 218.504 Ibid., voir les errata, où il est noté « 1) Contrairement à ce qui est indiqué à tort dans le tableau de la page 272, Renan n’appartient pas à la famille philosophique "Démocratique abstraite", mais bien plutôt à la famille "Libérale traditionnaliste" » et « 2) Il n’admire guère, en effet, la Révolution française, contrairement à ce qui est affirmé à la page 162. C’est pourquoi, je souhaite supprimer, au début du 4 ème paragraphe de la page 162, l’expression " – ce rationaliste épris des idées de la Révolution française –" », ce qui constitue, me semble-t-il, un contresens ».505 Supra., p. 77-78.
- 84 -
presque « sournoisement » s’immiscer dans les postes décisionnels dont elle dispose, afin que
des aristocrates la guide506.
En effet, nombreux sont ceux qui constatent que Renan ne manque pas d’ironie dans
ce qu’on pourrait appeler ses textes de ralliement envers la République, et pas uniquement
dans Caliban. C’est ce qui fait dire à plusieurs auteurs que Renan était un « rallié », qui bien
que sincère dans sa démarche, resta longtemps méfiant vis-à-vis de ce régime, si bien que
certains vont jusqu’à estimer que Renan n’a pas fondamentalement changé d’opinion en
rejoignant les rangs des républicains. Il aurait juste constaté que la Troisième République
n’était pas une réplique de 1789 et la Terreur, et aurait alors choisi les valeurs dans lesquelles
il se retrouvait, notamment la protection des sciences507.
C’est cette position qui fait douter Françoise Lorcerie de la qualification de la nation
renanienne de « contrat social ». Pour elle le « plébiscite » est une « formule énigmatique,
pourtant, paradoxale, car pour un républicain, même rallié, le plébiscite est haïssable, il
symbolise le césarisme, l’aveuglement collectif, la confusion de la raison, l’aliénation de la
liberté (Renan s’excuse d’ailleurs, en incise, de sa métaphore). La formule ne s’éclaire que
dans le mouvement de pensée de l’auteur »508. L’auteur soulève un argument intéressant : la
confusion des notions par les auteurs postérieurs. Ainsi, non seulement le mouvement de
pensée de l’auteur ne serait pas compris ou tout simplement pas étudié, comme nous l’avons
dit précédemment, mais de surcroît, s’ajouterait l’assimilation du « plébiscite de tous les
jours », à l’expression démocratique du peuple par le droit de vote, voire par référendum. Or,
justement, le plébiscite est une forme négative de l’expression populaire selon Françoise
Lorcerie. Dès lors, il est effectivement difficile de concevoir que « plébiscite » renvoie à une
vision démocratique du peuple, surtout venant de quelqu’un qui se méfia presque toute sa vie
des suffrages qu’il n’accepta que parce que l’arrivée de ce système était inéducable. A l’appui
d’une longue démonstration, Françoise Lorcerie poursuit cette idée et finit par conclure que la
nation de Renan n’a rien de contractuel : « Une nation est une évidence de communauté, une
puissance de cohésion venant du passé et projetant vers l’avenir. Il n’y a rien de réflexif dans
un plébiscite, la nation de Renan est loin du modèle de la nation contrat, engagement mutuel
des volontés ». Et elle ajoute dans une note qui accompagne ce passage que : « C’est faire un
contresens par anachronisme de traduire "plébiscite" par "référendum" »509, ce qui renforce les
propos et la démonstration précédente.
Cette absence de lien entre le contrat social et la nation renanienne est aussi affirmé
par Patrick Canivez, pour qui « Renan le dit lui-même, il s’agit d’une métaphore. Il ne s’agit
pas du contrat social de Rousseau dont les clauses sont tacitement admises, mais
juridiquement précises. D’ailleurs, le contrat social de Rousseau institue un peuple au sens 506 E. Renan, Caliban :…, op. cit., pp. 90-92.507 Sur l’idée de ralliement voir F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., pp. 66-67. E. Richard, Ernest Renan : un penseur traditionaliste ?, op. cit., pp. 287-305. B. Pelloile, « Un modèle subjectif rationnel de la nation : Renan », Revue française de science politique, v. 37, n° 5, 1987, p. 651.508 F. Lorcerie, L’école et le défi ethnique :…, op. cit., p. 66.509 Ibid., pp. 66-67.
- 85 -
politique, c’est-à-dire un Etat Républicain. Il ne constitue pas la nation, qui est un donné
préalable. L’idée d’une nation-contrat résulte ainsi d’une confusion : chez Rousseau, le
contrat ne crée pas la nation, il la transforme en Etat »510. Pour celui-ci, le plébiscite de Renan
ne serait en fait que le désir de vivre ensemble, l’envie des individus de se regrouper autour
d’éléments tragiques et d’éléments glorieux pour avancer dans une même direction.
Pourtant, on peut supposer que le terme de « plébiscite » recouvre un sens plus
profond, une dimension plus importante qu’un simple « désir », que l’on pourrait prendre
comme un caprice que les citoyens ont assouvi et qu’ils rejetteront plus tard. Or, même si
Renan postule qu’un jour les nations seront dépassées, celles-ci apparaissent plus comme une
obligation du moment, un matériau nécessaire à la construction d’un Etat et à sa survie. Dès
lors, il faut à notre tour nous interroger sur ce que pourrait être le « plébiscite » de Renan, et
plus largement la nation renanienne.
§ 2 : La nation renanienne comme expression d’un consensus
Si nous voulions définir simplement le contrat social, nous pourrions le faire ainsi :
« la source première du droit, c’est le concours des volontés libres des individus associés dans
le Contrat social. Source seconde et dérivée, la volonté du souverain instituée par le Contrat
social, qui remplace Dieu dans le temporel. Hobbes le nommait le Dieu mortel. Il n’est plus à
tenir compte dans le droit que des lois du souverain »511. Plus largement que le domaine du
droit, le contrat social tel que défini par les trois auteurs de référence que sont Hobbes,
Rousseau et Locke dans leurs ouvrages respectifs512, est la libre association des individus
autour d’un ou de plusieurs buts communs, afin de s’organiser en société pour sortir de l’état
de nature, avec un régime politique propre à la tête duquel se trouve un souverain qui prend
les décisions en respectant et pour garantir le contrat social. En revanche, le but du contrat
change en fonction des auteurs.
Chez Hobbes, l’homme est mauvais à l’état de nature, ou du moins, parce qu’il a peur
des autres et qu’il se sent agressé, il agresse ses congénères pour se défendre. Ainsi, pour que
la violence cesse, et que l’homme puisse s’associer pour survivre, il faut qu’il conclut un
pacte avec les autres hommes, dans lesquels ses droits et devoirs sont définis et qui permette
la désignation d’un dirigeant auquel est confié le pouvoir de faire les lois et le droit d’user de
la force pour les faire respecter. Le but du contrat est donc la sécurité des individus. Chez
Locke, l’état de nature n’est ni bon ni mauvais pour l’homme contrairement à celui de
510 P. Canivez, Qu’est- ce que la nation ?, op. cit., pp. 111-112.511 M. Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2001, p. 221.512 Pour la suite des développements, nous renvoyons le lecteur directement aux ouvrages concernés, l’analyse étant la synthèse des idées qui se trouvent dans chacun de ces ouvrages et que nous ne pouvons détailler suffisamment. Voir donc J. Locke, Traité du gouvernement civil, Paris, Calixte Volland, 1802. T. Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, 2000. J-.J. Rousseau, Du contrat social, Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
- 86 -
Hobbes. L’homme amasse des possessions et des biens qu’il fait fructifier, car selon l’auteur
le travail fonde la propriété. Mais arrivé à un moment de cet état de nature, la quantité de
biens disponibles s’amenuise et certains, qui veulent posséder tentent de s’approprier les biens
d’autrui par différents moyens comme la violence, le vol ou l’argent qui, pour Locke, fausse
le jeu des possessions. Dès lors, les citoyens s’unissent par le contrat social, afin de protéger
les possessions et le bon fonctionnement du commerce. Enfin chez Rousseau, l’état de nature
semble plutôt bon, mais arrive un moment où l’homme doit s’organiser pour survivre, et où
surtout, il doit s’organiser pour ne pas se faire déposséder de ses droits fondamentaux, comme
la liberté. Dès lors, les hommes troquent leur liberté naturelle pour une liberté civile, dont les
conditions sont inscrites dans le contrat social. Ce contrat social est garanti par un souverain, à
ceci près que le souverain est le peuple. C’est donc démocratiquement que doit s’opérer la
résolution des conflits inhérents au contrat social, en respectant la règle de la majorité. Et une
fois que la majorité s’est exprimée, tous, minorités incluses, doivent appliquer aveuglément la
loi sans la contester, puisqu’elle est réputée parfaite car prise par la majorité des individus
exerçant leur libre expression pour garantir leur liberté individuelle.
Partant, Renan ne pouvait pas adhérer à cette conception, pour plusieurs raisons. La
première résulte encore une fois de l’évolution de la pensée de l’auteur. S’il s’est rallié sur le
tard, Renan a pendant longtemps prôné une monarchie constitutionnelle et soutenu qu’un
régime calqué sur le régime anglais était préférable à la démocratie. Ce qui veut dire qu’il
était, théoriquement, non pour une constitution mais, pour une charte, comme sous la
Restauration et la Monarchie de Juillet. Or, rappelons que dans une charte, le peuple
n’intervient pas dans le processus décisionnel, car c’est le roi qui accepte ou non d’octroyer
certains droits à la population. Effectivement, ce texte peut se rapprocher de la constitution
puisqu’il fixe les règles auxquelles sont soumis les sujets du roi. Mais, en tout cas pour la
pensée française, influencée par Rousseau, il ne peut s’agir d’un contrat social parce que le
peuple n’a pas participé à la décision qui concernait ses droits fondamentaux. Ce n’est donc
pas une constitution.
Mais admettons qu’il fut pour une constitution plutôt qu’une charte, car il est vrai
qu’aucun texte ne nous indique sa préférence, et que nous pouvons simplement la déduire de
son soutien aux régimes monarchistes et impériaux dont la constitution n’en a que le nom. Là
encore, sa pensée ne semble s’accorder avec aucun des types de contrats proposés. Au contrat
de Hobbes, qui assure la sécurité des citoyens une fois conclut, on peut opposer que Renan à
l’inverse, estime que pour que ce contrat soit constitué, il faut user de la violence. C’est ce
qu’il semble se dégager de cette phrase : « L’investigation historique, en effet, remet en
lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes les formations politiques,
même de celles dont les conséquences ont été le plus bienfaisantes. L’unité se fait toujours
brutalement ; la réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d’une
- 87 -
extermination et d’une terreur continuée pendant près d’un siècle »513. En d’autres termes,
contrairement à l’idée de Hobbes qui postule que la société se forme pour éviter la tyrannie et
la violence des autres individus, en donnant des pouvoirs à un chef désigné pour assurer la
protection des individus, Renan démontre que toutes les sociétés se sont fondées par la
violence d’un ou plusieurs chefs. Ces derniers ont contraint les peuples, par la guerre, à
intégrer leurs sociétés et finalement nous pourrions dire, leur « contrat social ». Pour le contrat
de Locke, la réfutation est plus directe, puisque Renan dit explicitement dans sa conférence :
« Les intérêts, cependant, suffisent-ils à faire une nation ? Je ne le crois pas. La communauté
des intérêts fait les traités de commerce. Il y a dans la nationalité un côté de sentiment ; elle
est âme et corps à la fois ; un Zollverein n’est pas une patrie »514. Dès lors, si pour Renan des
intérêts commerciaux et économiques ne peuvent fonder une nation, le plébiscite qui la forme
ne peut être un contrat social lockien, puisque la fonction première d’un tel contrat, selon lui,
est de protéger la possession et les intérêts du commerce. De plus, alors que Renan estime que
la religion n’interfère pas avec la nationalité, dans sa Lettre sur la tolérance, Locke, qui prône
la liberté religieuse à la condition que ces religions respectent et se plient à la volonté du
pouvoir temporel des institutions civiles, finit par rejeter les catholiques parce qu’ils servent
deux maîtres et donc deux lois (le pape et leurs souverains respectifs). Il en va de même pour
les Juifs et les musulmans, car pour ces deux religions, Dieu prime sur l’Etat et parce qu’elles
cherchent à obtenir des bénéfices particuliers. Dès lors on conclut que seuls les protestants
sont dignes de confiance et que les autres religions en un sens ne peuvent s’intégrer à la
société, c’est-à-dire au contrat social515. Si la nation de Renan ne s’attache pas à la religion
alors encore une fois les idées de ces deux auteurs divergent, empêchant de faire le lien avec
le contrat social selon Locke. Enfin, s’agissant du contrat social de Rousseau, il faut rappeler
que, chez Renan, le regroupement des individus en nation est unilatéral, pas multilatéral. Les
individus se sentent Français, Belges ou Espagnols parce qu’en leur for intérieur ils adhèrent à
tout ou partie des valeurs composant la nation, pas parce qu’ils ont décrété avec leurs voisins
quelles étaient ces valeurs. C’est ce qui explique que Renan ne les définisse pas, car ces
valeurs sont propres à chacun, elles ne sont pas déterminées par la majorité selon Rousseau.
De plus, rappelons que pour Renan, les rois sont les cristallisateurs de la nation, et que c’est
par leurs erreurs qu’ils ont perdu le pouvoir. Ce qui sous entend que la nation peut vivre sous
un régime monarchique comme elle peut survivre sous une démocratie, alors que le contrat
social de Rousseau lui, ne peut pas, ou difficilement, vivre sans la démocratie. Enfin, comme
nous l’avons vu avec la critique de Patrick Canivez, pour Rousseau, la nation est déjà
constituée quand les individus signent le contrat, car sinon comment expliquer cette
association ? Pour s’associer comme dans tout contrat, il faut que les signataires aient
confiance les uns en les autres, qu’ils aient des points communs, ce qui, à l’échelle d’un état,
513 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 56.514 Ibid., p. 72.515 J. Locke, Lettre sur la tolérance, Paris, Slatkine, 1995.
- 88 -
donne le legs des ancêtres qui est un des critères fondateurs de la nation renanienne. Il ne peut
donc s’agir d’un contrat social rousseauiste.
Dès lors, si la définition de la nation selon Renan n’appartient pas à la catégorie du
contrat social, que reste-t-il pour la définir ? Il reste un processus décisionnel peu usité : le
consensus. Le consensus et ses risques peuvent être définis comme suit : « le consensus ne
saurait être l’expression d’un vote majoritaire qui, comme l’expression l’indique, dégage une
majorité et une opposition. Ainsi voit-on surgir une autre définition selon laquelle le
consensus est une procédure "qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote
formel, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions" (Larousse en cinq
volumes) » dont le risque est que « la recherche systématique du consensus fait courir le
risque d’aboutir, par élimination de ce qui fâche et ajout de ce qui fait plaisir, à des
compromis manquant de cohérence »516.
La conférence de Renan semble coïncider avec cette définition. En effet, c’est ce qui
explique le sens de la phrase : « Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient
beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses »517, et
l’importance capitale de l’oubli dans la définition de la nation de Renan. C’est aussi ce qui
explique que pour lui, on ne peut baser une nation sur des critères fixes comme la langue, la
race ou la religion, et qu’il faut plutôt la baser sur l’histoire et les souffrances communes que
les individus ont vécues ensemble, car elles rassemblent plus qu’elles ne divisent, la division
étant objet d’un débat ultérieur qui ne remet pas en question l’objet principal de l’attachement.
C’est aussi ce qui explique l’utilisation de termes comme « volonté », « possession en
commun d’un riche legs » ou « consentement », et non l’utilisation directe du terme contrat.
Ainsi, le « plébiscite de tous les jours » est un consensus sans cesse renouvelé.
516 M. de Villier et A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2011, pp. 72-73.517 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 57.
- 89 -
Chapitre 3 : Renan et son idée de nation vu par le prisme politique
Après avoir constaté l’oubli plus ou moins relatif dont font l’objet Renan et sa
définition de la nation, et étudié le sujet des quelques travaux contemporains mentionnant
l’auteur, il convient de s’interroger sur le point de savoir si Renan n’est pas oublié parce qu’il
est incompris. La raison de cette incompréhension tiendrait à la politisation dont la pensée de
l’auteur et ses écrits ont été l’objet.
Ainsi, il se peut que les auteurs contemporains adoptent leur point de vue sur Renan en
fonction des écrits des auteurs passés, ayant déjà émis un avis sur Renan (Section 1). Il en va
de même lorsque la classe politique fait référence à Renan, et il faut alors envisager la
conférence de Renan non plus de manière binaire avec la division gauche/droite mais sous un
troisième angle (Section 2)
Section 1 : L’influence politique dans les travaux sur la nation selon Renan
On peut légitimement se demander pourquoi Renan peut être appréhendé
simultanément comme un antisémite alors qu’un autre le voit comme un philosémite ? De
même, pourquoi certains le voient comme un républicain et d’autres comme un monarchiste ?
En fait, on peut supposer, en se basant sur les développements précédents, que c’est en
fonction de la manière dont les auteurs classent politiquement Renan, qu’ils adoptent leurs
point de vue (§1). Associés à quelques erreurs méthodologiques, les travaux prennent alors
des chemins différents jusqu’à s’opposer complètement (§2).
§ 1 : Le constat de la politisation des travaux sur la nation renanienne
Hobsbawm écrivait la remarque suivante dans Nation et nationalisme depuis 1780 :
« Les historiens ont, de par leur profession, l’obligation de ne pas commettre d’erreurs, ou du
moins de faire leur possible pour les éviter. Etre irlandais et fièrement attaché à la France […]
n’est pas en soi incompatible avec l’étude sérieuse de l’histoire de l’Irlande. Etre fenian ou
orangiste, à mon avis, n’est pas aussi compatible, pas plus qu’être sioniste n’est compatible
avec la rédaction d’une histoire des Juifs authentique et sérieuse – à moins que l’historien ne
laisse ses convictions hors de la bibliothèque ou du bureau où il étudie. Certains historiens
nationalistes ont été incapables de le faire »518. Cette critique est en réalité un constat
fondamental. Dès lors que l’on aborde des sujets sensibles comme la nation, alors
l’impartialité du chercheur est mise à l’épreuve et il est difficile pour lui de ne pas prendre
position en fonction de ses propres opinions.
518 E. Hobsbawm, Nation et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 33.
- 90 -
Or, Renan « a abordé des problèmes qui touchent d’une manière trop brûlante le for
intérieur pour que moins d’un siècle ait suffi à faire la paix autour de son œuvre »519. C’est
pourquoi Maurice Gasnier au début de sa thèse précise que « cette réflexion témoigne avec
pertinence du renanisme que nous pourrons définir comme l’ensemble des interprétations
abusives de la pensée de Renan, mieux : la récupération d’une œuvre savante à des fins
partisanes »520. Les sujets polémiques traités par Renan, associés à son habitude de créer des
ambiguïtés, comme nous l’avons vu avec le débat entre le républicain et le monarchiste dans
La Réforme intellectuelle et morale de la France, sa manière dans Caliban d’encenser et de
critiquer la République, ou encore ne pas explicitement dire s’il rejette complètement ou non
les critères objectifs quand il définit la nation, expliquent le constat que fait Maurice Gasnier
et plus largement Hobsbawm.
En effet, c’est la récupération par les républicains et les nationalistes de droite au XIXe
et au début du XXe siècle521, que nous avons constatée, qui explique la position des auteurs.
Par exemple Hervé Beaudin, qui a d’abord vu Renan comme un républicain épris des idées
Rousseau avant de se raviser, avait adopté une vision se plaçant dans la droite ligne de celle
de la Troisième République522. En effet, rappelons que celle-ci a adopté l’idée de nation de
Renan pour la faire sienne, et s’est servie des idées de réforme de l’éducation de Renan pour
l’enseigner523. C’est en récupérant Renan et en plaçant l’auteur et sa définition de la nation au
même rang que d’autres symboles de la République, tels que Rousseau et le contrat social,
que la Troisième République a permis à la confusion de se faire entre les deux conceptions,
conduisant à l’expression « nation contrat ».
On peut aussi se demander si le champ de recherche n’influence pas les auteurs. C’est
le cas des deux Israéliens que nous avons cités. Shlomo Sand par exemple, s’est beaucoup
intéressé à Sorel524 et a abordé Renan par le biais de ses études sur l’auteur communiste, alors
que Zeev Sternhell a commencé sa carrière en soutenant une thèse sur Barrès, que l’on peut
classer plus à droite. Or, Shlomo Sand voit Renan comme un démocrate alors que Sternhell
l’associe à Maurras, Barrès, implicitement à Drumont et en fait au final, le père du
nationalisme français, terreau du fascisme. Effectivement, l’une ou l’autre de ces positions se
tiennent, puisque Barrès revendique clairement son influence renanienne et Maurras voit
Renan comme un monarchiste et s’en sert plus ou moins pour affirmer l’Action Française525.
Mais on peut se demander si ces deux chercheurs n’ont pas construit leur idée de Renan à
519 M. Gasnier, La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 :…, op. cit., p. 103.520 Ibid., p. 4.521 Voir supra., pp. 15-26.522 Voirs supra., pp. 81-84.523 Voir supra., pp. 21-26. et supra., pp. 58-67.524 Pour les références des travaux de Shlomo Sand sur Sorel, voir http://www.tau.ac.il/humanities/faculty/sand_shlomo/525 Voir Supra., pp. 18-19.
- 91 -
travers le prisme des auteurs qu’ils ont étudié en premier, ce qui expliquerait la divergence de
position entre les deux.
De cette politisation de Renan, on trace ensuite un schéma dans lequel on tente de faire
rentrer l’auteur. Par exemple s’il est républicain, alors il existe deux alternatives : soit il était
raciste, soit il ne l’était pas. La première alternative a pour conséquence que Renan était à
l’origine de la colonisation ou la soutenait. La seconde a pour conséquence que Renan était un
rousseauiste qui n’était pas raciste et voulait intégrer tout le monde dans le contrat social. On
tire alors de ces schémas les stéréotypes sur lesquels on plaque les notions déjà connues ou
nouvelles : Renan était un républicain raciste et colonialiste ou Renan, malgré ses écrits de
jeunesse n’était pas raciste et prônait le message d’intégration hérité des Lumières.
Il en va de même avec les courants de droite mais le schéma est plus simple. Renan
était monarchiste, il était donc soit toujours monarchiste, soit converti à la République. Dans
les deux cas, soit il était monarchiste nationaliste et donc raciste et antidémocrate, soit il a
influencé les républicains nationalistes qui étaient plutôt racistes et colonialistes, soit la
première alternative précédente. Les schémas se rejoignent alors d’un extrême à l’autre.
Nous ne pouvons apporter la certitude que Renan était d’un bord politique ou d’un
autre, au jour, à l’heure, à la minute précise. Nous pouvons en revanche deviner ce qu’il
n’était pas, ou ce qu’il est devenu, en rectifiant quelques critiques méthodologiques.
§ 2 : Renan : un auteur étudié hors contexte
Il convient ici de reprendre deux critiques que nous avons déjà formulées au long de
notre démonstration. La première, c’est l’époque dans laquelle s’inscrit l’auteur. Il vécut dans
deux régimes monarchiques, une très courte Seconde République qui le déçut, un Second
Empire et une Troisième République. Or, si la pensée d’un homme se forge en fonction de ce
qui l’éprouve, on ne peut pas dire que le processus de développement de la pensée se soit
inscrit dans un « monde » continu. En effet chaque changement de régime s’accompagne de
changements politiques, de changement de droits, de conception du monde ou encore de
mœurs. Tout cela fait qu’une pensée peut être plus « changeante » que dans un contexte plus
stable.
C’est pourquoi la ligne temporelle appliquée par Hayoun, que nous avons déjà
évoquée, semble la plus juste526. Celle-ci concorde aussi avec la biographie de l’auteur. En
effet, élevé chez les frères, il est alors influencé dès son plus jeune âge par les prêtres
catholiques, qui sont traditionnellement plus proche des monarchistes que des républicains.
On pourrait dire que Renan a donc commencé son émancipation du mouvement monarchiste
526 Voir supra., p. 75-78.
- 92 -
en quittant les frères, mais qu’il s’est progressivement rapproché des républicains par ses
critiques récurrentes sur le système éducatif français du Second Empire, jusqu’en 1870. A
cette date, la défaite de la France et la politique expansionniste du deuxième Reich, lui servent
de seconde émancipation, qui le fera tendre petit à petit vers le régime démocratique proposé
par la République, malgré le fait qu’il conserve toujours quelques doutes sur certaines
position prises par cette dernière.
Cela explique alors pourquoi Renan admet la République mais n’oublie pas pour
autant de faire l’éloge de l’aristocratie des régimes monarchiques. Cela ne fait pas de lui, le
Renan d’un des schémas vu précédemment, à savoir un monarchiste faussement rallié qui se
rapproche des courants nationalistes. Cela fait de Renan un individu qui s’est sincèrement
rallié à la République mais qui dans Caliban comme dans Q’est-ce qu’une nation ?, pense que
c’est par l’action politique de la monarchie que la nation s’est créée, et que c’est aussi par
l’exemple des aristocrates et l’éducation qu’ils ont donnée au peuple que celui-ci s’est révolté
et à instauré la démocratie et la République. C’est donc une pensée plutôt neutre, dont l’auteur
semble user pour rappeler que certes il a bien été monarchiste et qu’il a admiré le régime pour
les valeurs décrites, mais que n’ayant pas maintenu ces valeurs, alors le régime s’est effondré
et la République l’a remplacé. Dès lors, autant l’accepter plutôt que de lutter contre elle, parce
qu’elle est porteuse d’avenir.
C’est pourquoi il est important de se rappeler le contexte dans lequel la conférence de
1882 a été prononcée, mais il est encore plus important de connaître tout le contexte du XIXe
siècle, que Renan traverse presque intégralement, afin de comprendre réellement celle-ci,
comme le fait Martin Thom527. De surcroît, cela éviterait aux auteurs de ne se baser que sur
des écrits d’une période pour en tirer une conclusion, comme l’antisémitisme de Renan par
exemple.
Le second point sur lequel il faut revenir, qui est proche du précédent, c’est
l’anachronisme que contiennent les études qui portent sur Renan. En effet, comme nous
l’avons vu avec l’antisémitisme, cette notion n’est pas la même aujourd’hui qu’à l’époque de
l’auteur. Pour Renan les Sémites sont les musulmans et les Juifs, alors qu’aujourd’hui, nous
parlerons de magrébins et d’arabes pour les musulmans, et de sémites pour les Juifs. De plus,
cette application du terme sémite aux juifs, l’utilisation du terme antisémite, renvoie de nos
jours à Vichy et au nazisme. Cela peut expliquer pourquoi l’on tente de faire une filiation
entre Renan, les nationalistes et Vichy ou Renan et les fascistes, mais c’est encore une fois
faire des liens anachroniques. Il en va de même pour Renan et la race. Si Renan était bien
raciste, il faut rappeler que tous les auteurs de l’époque, étaient racistes dans le sens où ils
étaient, à des degrés divers, convaincus du bon sens de la classification raciale. Ainsi, ce n’est
pas parce que dans les sociétés européennes il semble528 que le racisme soit devenu marginal
527 M. Thom, « Tribes within nations », in H. K. Bhabha (dir.), Nation and narration, op. cit., pp. 23- 43.528 Semble seulement car le dernier sondage en date montre le contraire. Voir annexe 3.
- 93 -
et les racistes une minorité, que cela n’a pas été le cas de tous les pays. Les « noirs »
d’Amérique par exemple ont connu une ségrégation raciale jusque dans les années soixante-
dix et l’Afrique du Sud, l’apartheid jusqu’en 1991. Il faut alors admettre que comme dans ces
pays qui ont connu tardivement la fin des politiques de ségrégation raciale et dont les
habitants ont partagé et véhiculé des idées racistes, la France du XIXe siècle a elle aussi fait
de même. Il ne faut alors pas imputer à un auteur, un fait social généralisé.
Il s’agit aussi d’anachronisme et de confusion des notions quand il est fait référence à
une relation entre Renan et le contrat social. Car en effet ce n’est pas parce que Renan est né
après les Lumières qu’il s’en inspire forcément. De plus, il met lui-même en garde son
auditoire, et finalement, les lecteurs de sa conférence, quand il utilise le terme de plébiscite :
« L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours
[…] »529. S’il présente ses excuses avant d’avoir formulé sa phrase, c’est alors qu’il sait que
celle-ci risque d’être mal interprétée, employée à tort et finalement exprimer le contraire de ce
que l’auteur voulait dire. C’est peut être ce qui explique qu’on n’ait retenu de Renan que cette
phrase et l’idée générale dans laquelle elle s’inscrit, notamment pour défendre sa propre
conception politique de la nation.
Section 2 : Une conférence politisée en raison de son ambiguïté
On peut supposer que si la conférence de Renan est tant sujette à controverse, que si
l’auteur qui l’a prononcée apparaît inclassable, c’est peut être parce que cette conférence est à
l’image de Renan. Elle serait en réalité neutre, sans réelle expression politique (§2). Mais
certains ont tenté de voir dans cette neutralité une prise de position, ce qui explique en partie
les schémas dans lesquels les politiques actuelles placent la conférence de Renan (§ 1).
§ 1 : La perpétuation des schémas de la Troisième République
Tout d’abord, il faut brièvement rappeler comment Renan fut récupéré par les
républicains et par les nationalistes. Les premiers, ont revendiqué l’auteur anticlérical, le
défenseur des sciences et de l’éducation, et l’ont placé au même rang que les autres « pères »
de la République, comme Rousseau. Et c’est cet amalgame d’auteurs, cette filiation volontaire
ou involontaire entre le contrat social et le « plébiscite de tous les jours », qui nous est resté.
Renan a longtemps été présenté comme celui qui prônait l’intégration à la nation, quelles que
soient les origines ou les opinions, pourvu que l’individu qui souhaite s’intégrer accepte de
vivre avec les valeurs et les projets de la communauté nationale. Les seconds se sont réclamés
d’un Renan monarchiste, antidémocrate, pour qui la Révolution tenait plus de la catastrophe
529 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 75.
- 94 -
que de l’aubaine, et qui était antisémite. Ces nationalistes ont alors retenu une version
anomique de la conférence de Renan. Alors que la république s’ouvre à tous, les nationalistes
eux retiennent l’importance de la terre et de la race dans leur définition, alors que pour Renan
ces critères n’étaient pas prégnants. Ils retiennent cependant de la définition de Renan que les
individus doivent vouloir vivre entre eux en partageant des références communes. Mais ces
références sont alors liées aux critères objectifs, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas être partagés
par tous les étrangers voulant devenir français.
Aujourd’hui, on trouve encore une forme positive et une forme négative de la nation,
qui découlent des positions des républicains et des nationalistes. La distinction ne se fait plus
autour du débat entre la Monarchie et la République, puisque la République a triomphé de la
Monarchie. Il se fait sur ce qu’on entend par intégration autour des valeurs de la nation, c’est-
à-dire autour des positions défendues par les républicains.
La forme négative, c’est de dire que les étrangers ne s’intègrent plus comme avant, et
qu’il faut régénérer le processus d’intégration et sélectionner les plus intégrés. Ce courant qui
semble conservateur, est plutôt composé du personnel politique de droite. C’est par exemple
la position défendue par le député Cuq, qui appartenait au RPR puis à l’UMP, quand il disait
après avoir cité Renan : « Cette transformation [de l’immigration] entraîne des difficultés
nouvelles et particulières d’intégration »530. On voit même ressurgir cette idée selon laquelle
tous les étrangers ne peuvent intégrer les valeurs de la nation et donc s’intégrer à la nation,
puisque la raison fondamentale de cette difficulté d’intégration selon lui c’est qu’ « à une
population étrangère d’origine presque exclusivement européenne succède aujourd’hui une
population majoritairement non européenne »531.
La forme positive, quant à elle, défend une intégration à la nation plus large, plus libre.
Elle, est défendue par les partis de gauches. C’est ce qu’on constate avec le député MRC
George Sarre, pour qui le projet défendu par Cuq est « un accès traumatique à la nationalité,
mais, plus encore, frapper de suspicion ceux qui y ont accédé automatiquement avec la
réforme dont nous débattons maintenant »532. On trouve aussi cette idée d’intégration plus
libre, avec le moins de restriction possible dans les propos tenu par le député PS Bruno Le
Roux, qui après avoir lui aussi parlé de Renan, critique le projet défendu parle député Cuq en
1993 : « Un arguement développé en 1993 consistait à dire que les jeunes concernés
devenaient "Français sans le savoir". Mais la nécessité d’une démarche volontaire a souffert
d’un manque de diffusion patent, si bien que, aujourd’hui, des jeunes qui vivent en France,
après y être nés, deviennent étrangers sans le savoir. Je vous ferais grâce des chiffres, faute de
temps, mais il faut savoir que de nombreux jeunes sont exclu de fait des dispositifs que vous
avez mis en place »533.
530 Assemblée Nationale, 12 mai 1993, p. 389.531 Ibid., p. 389.532 Ibid., p. 398.533 Assemblée Nationale, 26 novembre 1997, p. 21.
- 95 -
Bien que finalement aujourd’hui le débat se résume à disputer la manière d’intégrer les
individus et autour de quelles valeurs le faire, il n’en reste pas moins que l’on a politisé la
conférence de Renan, et plus précisément, le « vouloir vivre ensemble », le « projet
commun » et le « plébiscite de tous les jours ». On a d’ailleurs retenu que cela de la
conférence, car ce sont les notions les plus aisément « malléables ». Or, si l’on prend toute la
conférence, on s’aperçoit que celle-ci n’est que l’énoncé d’une théorie qui ne se réfère
nullement à un courant politique en particulier.
§ 2 : La neutralité de la conférence de Renan
Pour comprendre la neutralité de la théorie de Renan, nous allons reprendre les points-
clés de sa conférence en suivant son déroulement.
Tout d’abord, Renan, conclut son introduction en expliquant que réfléchir sur la nation
est une chose sensible, si bien que « nous y mettrons la froideur, l’impartialité la plus
absolue »534. Certes, on peut douter, dès lors qu’on connaît le contexte, que cette conférence
soit réellement impartiale, puisque beaucoup d’auteurs y voient une réponse à la théorie
allemande. Mais mis à part cela, on peut légitimement penser que cette mention de
« l’impartialité », est aussi une mise en garde adressée à son auditoire. Cette mise en garde
consisterait à avertir qu’il ne compte pas prendre part aux idées d’un courant politique dans
son développement.
Cela est renforcé par l’idée qu’il développe et dont nous avons brièvement fait
mention, que les bases de la nation auraient été posées par les invasions germaniques qui ont
causé la chute de l’Empire. Il soutient en effet que parce que les barbares ont du cohabiter
avec les Romains et les Gallo-romains. Mais au fil du temps, une mixité s’est installée entre
les populations si bien qu’il n’y avait plus de « race » distincte, ni de langue différente
puisque pour échanger ils créèrent une langue qui leur était propre. Ils adoptèrent aussi la
même religion que les Romains, le Christianisme, ce qui leurs permit de s’associer plus
facilement entre eux. Tous ces éléments fabriquèrent « le moule qu’ils imposèrent [et qui]
devint, avec les siècles, le moule même de la nation »535, parce que toutes les différences
furent gommées. Puis les nobles instituèrent un régime aristocratique, créant la division
vilains/nobles au sein de la nation. Cette distinction se basait sur le courage et non sur les
critères précédents. Il faut ajouter à ce régime aristocratique les conquêtes et les manœuvres
politiques que mirent en place les rois pour fédérer le peuple. Mais certaines « erreurs » n’ont
pas été oubliées, c’est ce qui fait que la nation n’a pas pardonné au roi certains excès, si bien
534 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, op. cit., p. 50.535 Ibid., pp. 54-55.
- 96 -
qu’elle se détacha de lui par la Révolution et proclama la République536. Ici est donc
développée l’idée que les rois de France, ont continué le travail de cristallisation de la nation
débuté par leurs ancêtres francs, sans que ce constat soit une revendication d’appartenance au
courrant monarchiste. Si certains ont pu y voir cela, notamment parce qu’ils estiment que peu
de gens savent que les rois de France on accompli des actions positives et non pas uniquement
tyranniques, il faut noter que le constat s’arrête là. Il n’y a pas de critique de la démocratie,
juste la description de ce qui pour lui est un état de fait. La nation bien que créée par la
monarchie, est autonome et elle a choisi un autre régime sans que l’on sache, dans la
conférence, s’il est meilleur ou pire que le précédent. Cela permet aussi d’en déduire que la
nation n’est pas attachée à un régime politique, mais au régime qu’elle estime le meilleur pour
elle.
Renan rappelle aussi qu’une nation est un fait historique qui ne se crée pas de la même
manière en fonction des pays, mais que le point commun dans cette création, c’est la volonté
politique d’unir les populations pour en faire une nation : « La nation moderne est le résultat
historique amené par une série de faits convergeant dans le même sens. Tantôt l’unité a été
réalisée par une dynastie, comme c’est le cas pour la France, tantôt elle l’a été par la volonté
directe des provinces, comme c’est le cas pour la Hollande, la Suisse, la Belgique ; tantôt par
un esprit général, tardivement vainqueur des caprices de la féodalité, comme c’est le cas pour
l’Italie et l’Allemagne »537. Mais c’est après ce rappel, qu’une phrase intéressante doit retenir
notre attention :
« C’est la gloire de la France d’avoir, par la Révolution française, proclamé qu’une nation
existe par elle-même. Nous ne devons pas trouver mauvais qu’on nous imite »538
Cette phrase est intéressante, car d’un côté la nation française a été bâtie au fil des
siècles par les dynasties royales, et de l’autre, c’est la Révolution qui proclame qu’une nation
existe par elle-même, finalement qui la fait vivre sans la monarchie. Outre l’expression directe
de cette indépendance politique de la nation, la « comparaison » insiste sur cette neutralité.
Car à l’époque, un monarchiste ne peut voir la Révolution que comme un acte affreux, et les
républicains voient la monarchie de manière tout aussi négative. Accorder du crédit aux deux
régimes, c’est alors les mettre à égalité, sans que l’un prime sur l’autre. C’est même montrer
leur complémentarité : la monarchie était l’origine de la nation, et une fois qu’elle fut prête, la
Révolution en fut l’aboutissement, la maturité. C’est d’ailleurs ainsi qu’on peut comprendre la
phrase qu’il prononce plus en avant dans sa conférence : « Disons seulement que cette grande
536 « Le roi de France, qui est, si j’ose le dire, le type idéal d’un cristallisateur séculaire ; le roi de France qui a fait la plus parfaite unité nationale qu’il y ait ; le roi de France, vu de trop près, à perdu de son prestige ; la nation qu’il avait formée l’a maudit, et, aujourd’hui, il n’y a que les esprits cultivés qui sachent ce qu’il valait et ce qu’il a fait » (Ibid., p. 56).537 Ibid., pp. 57-58.538 Ibid., p. 58.
- 97 -
royauté française avait été si hautement nationale que, le lendemain de sa chute, la nation a pu
tenir sans elle »539.
De surcroît, cette idée « d’oubli », qu’il répète en disant « Or l’essence d’une nation
est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié
bien des choses »540, peut trouver à s’appliquer aux courants politiques de l’époque. Car
l’exemple qu’il prend d’oublier la race, d’oublier les grands massacres des Cathares et de la
saint Barthélemy, pourrait être transposable à son époque. Il faut oublier les origines
ethniques des immigrants et leur religion, il faut oublier les actions des monarques absolus
comme celle des révolutionnaires. Cette idée prend tout son sens quand on se souvient que
Renan était lui-même rallié à la République. Il a donc su oublier certaines choses du passé.
Quant aux critères objectifs, restant toujours neutre, sa position a conduit à interpréter
le texte en faveur ou en défaveur des républicains et des monarchistes. Or on pourrait
considérer que les propos tenus par Renan peuvent cacher autant de reproches à un courrant
qu’à l’autre, renforçant l’idée que les ambiguïtés du texte de Renan ont bien servi de prise à la
réinterprétation de ses propos à des fins politiques dont les schémas nous influencent toujours.
Premièrement, concernant le critère de la race, après avoir expliqué le sens différent
donné au mot « race » entre les anthropologues et les historiens, et avancé que les premiers
ont tort car, par l’Histoire on peut prouver que les populations se sont mélangées et qu’il n’y a
donc pas de race pure, il dénonce l’utilisation de ce critère en politique : « L’étude de la race
est capitale pour le savant qui s’occupe de l’histoire de l’humanité. Elle n’a pas d’application
en politique ». Pour prouver que la race selon lui n’a jamais eu de réelle application en
politique il ajoute « La conscience instinctive qui a présidé à la confection de la carte
d’Europe n’a tenu aucun compte de la race, et les premières nations de l’Europe sont des
nations de sang essentiellement mélangé ». Il ne nie donc pas que les races aient un jour
existé, puisque sinon il ne pourrait défendre son étude par les historiens, mais il ne leur donne
pas l’importance que d’autres lui donnent en considérant qu’une nation se fonde sur la race en
incluant ce critère dans sa politique. C’est pourquoi selon lui, « le fait de la race, capital à
l’origine, va donc toujours perdant de son importance »541. Ici, bien qu’on puisse interpréter
cette idée comme une critique des courants nationalistes, il critique en réalité aussi les
républicains. Les premiers parce qu’ils sont, en règle générale, antisémites. Les seconds pour
l’application officieuse, cachée derrières des idées humanistes, des théories raciales pour
légitimer la colonisation.
A propos de la langue, la position de Renan est plus facile à expliquer puisque pour lui
« ce que nous venons de dire de la race, il faut le dire de la langue. La langue invite à se
539 Ibid., p. 60.540 Ibid., p. 57.541 Ibid., p. 66.
- 98 -
réunir ; elle n’y force pas »542. Même si selon lui, alors qu’il est pourtant Breton, la France n’a
jamais cherché à imposer sa langue par la coercition, on peut aussi y voir une critique tant des
auteurs nationalistes que des républicains, pour qui la langue est une donnée importante.
La religion souffre de la même critique que la race. Elle aussi perd de son importance
avec le temps. En effet, « A l’origine, la religion tenait à l’existence même du groupe social.
Le groupe social était une extension de la famille. La religion les rites étaient des rites de
famille. La religion d’Athènes, c’était le culte d’Athènes même, de ses fondateurs mythiques,
de ses lois, de ses usages. […] De nos jours, la situation est parfaitement claire. Il n’y a plus
de masse de croyant uniforme. Chacun croit et pratique à sa guise, ce qu’il peut, comme il
veut »543. On peut ici aussi considérer qu’il peut s’agir d’une critique double. D’une part, il
critique les nationalistes pour leur intolérance envers la religion juive, d’autre part, il critique
les républicains qui ont fait et continuent à faire « la guerre » aux catholiques en les radiant de
l’administration ou en les fichant.
Nous passerons les deux derniers critères que sont la communauté des intérêts et la
géographie, même si l’on pourrait entrevoir une critique poindre contre les nationalistes qui
sont attachés à la terre.
Enfin, dans la dernière partie de la conférence, il insiste sur le fait que la nation se
fonde sur deux choses dont « l’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ;
l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire
valoir l’héritage qu’on a reçu indivis »544. Si nous traduisons, comme nous l’avons déjà fait, le
« legs de souvenirs », cet « héritage des ancêtres » par l’histoire, alors nous devons conclure
que Renan n’exclut pas totalement les critères objectifs.
En effet, si les critères objectifs soit vont en déclinant à travers le temps, soit sont trop
instables pour fonder une nation dessus, c’est bien reconnaître qu’ils existent. Mais c’est là où
l’histoire joue un rôle important, celui de rappeler que ces critères tendent justement à
disparaître, ou alors qu’ils sont trop incertains. Finalement, le « plébiscite de tous les jours »,
serait alors le fait qu’une nation se souvienne de son histoire et de ce qui dans cette histoire la
fédère de manière certaine, en excluant les critères objectifs ou du moins en en diminuant
l’importance. Dès lors, les individus reconnaîtraient ce qui les rassemble tous de manière
consensuelle, afin qu’ils tendent tous ensemble vers le même projet en transcendant, voir en
oubliant les critères objectifs qui était la source de leur création. Cet aboutissement, cette
finalité historique, c’est la disparition des nations, remplacées par ce que Renan appelle « la
confédération européenne ».
542 Ibid., p. 67.543 Ibid., pp. 70-71.544 Ibid., p. 74.
- 99 -
CONCLUSION
Renan, qui était une figure du XIXe siècle, a eu du mal à résister au temps. En effet,
celui dont les textes étaient diffusés en Europe et dans le monde afin d’y être abondamment
commentés, ne tient plus qu’une place réduite dans l’imaginaire collectif. On peut
comprendre cet oubli relatif, dans la mesure où Renan est un personnage atypique, qui passa
d’un courant politique à un autre, émettant une idée pour se raviser ensuite en soutenant son
contraire, écrivant des textes ambigus à la lecture et la compréhension difficiles.
A cela s’ajoute la récupération par des courants politiques divers dont ses idées firent
l’objet. Chaque extrême s’en prévalant ou le rejetant, l’auteur fut apparenté à la plupart des
courants politiques par ceux qui voulaient les légitimer. Mais à force de reprendre les mêmes
idées de l’auteur pour les opposer, ou d’en reprendre d’autres qui s’opposent, la classe
politique à fini par user l’auteur, en révélant les incohérences de ces références. Si bien que
l’auteur est tombé en désuétude, laissant la place à des auteurs plus récents, plus marqués
politiquement et plus faciles à comprendre. C’est par exemple la figure du général de Gaulle
pour la droite, celle de Mitterrand pour la gauche.
Pourtant, Renan continue de hanter notre mémoire. Lorsque la question de la nation
refait surface, que ce soit au sein des débats politiques à propos de la nation ou dans le milieu
de la recherche, on ne peut s’empêcher de citer l’auteur, même si les références ne sont le plus
souvent que la mention des mêmes phrases. Ces raccourcis de la conférence Qu’est-ce qu’une
nation ?, tiennent du fait de la difficulté de classer l’auteur, et de l’imperméabilité de ses
textes, mais aussi du fait que sa conférence commence à être marquée temporellement.
Pourtant, bien que les travaux récents sur la nation ajoutent des fondements plus adaptés à la
société mondialisée, ces références plus ou moins poussées de la conférence du philosophe,
montrent que l’on n’arrive pas à dépasser sa définition. Il est possible d’ajouter tous les
critères que l’on veut, de tenter de minimiser l’importance de cette conférence, dire qu’elle
n’est qu’une simple réponse à une annexion territoriale, dans tous les cas, il est impossible de
dire qu’une nation existe sans le consentement implicite de ses citoyens à vivre ensemble.
C’est peut être parce que l’on pense avoir dépassé la définition de Renan sans que cela
soit le cas, ou parce que l’on a travaillé dessus durant des années et que l’on croit l’avoir
percée à jour en la rattachant à une définition contractualiste, que l’on retrouve la conférence
dans des travaux sur le colonialisme et l’antisémitisme. C’est parce que ces recherches sont
plus récentes et qu’elles tentent de trouver l’origine du colonialisme et de l’antisémitisme,
qu’elles échafaudent plusieurs théories en se basant sur des auteurs influents du XIXe siècle,
dont Renan faisait partie. Sa conférence trouve alors une seconde jeunesse dans un champ
auquel personne ne s’attendait.
- 100 -
Pourtant, il semble qu’il faille reconsidérer les analyses de cette définition, en
abandonnant tous les avis des contemporains et successeurs de Renan qui ont brouillé par le
filtre politique, le message de ce discours. Car une foi rendue neutre en la replaçant dans son
contexte et en analysant l’évolution de la pensée de son auteur, l’ont peut alors s’attacher au
texte et à son exégèse. En ressort alors une définition universelle et intemporelle, qui peut
trouver à s’appliquer encore aujourd’hui. Mais l’on peut se demander pour combien de temps
encore, car l’évolution de l’Union Européenne, et plus largement la globalisation du monde,
semble donner raison à Renan quand celui-ci prophétisait la disparition des nations par leur
fusion en une entité plus importante. Car bien que les nations résistent en se tournant vers le
nationalisme ou leurs identités régionales, les institutions européennes sapent leurs
fondements, notamment le plus important de tous selon Renan : l’Histoire545.
545 C’est le cas de l’arrêt CEDH, 15 janvier 2009, Orban et autre contre France. Dans cet arrêt, la Cour Européenne des droits de l’homme, dans une affaire de liberté d’expression, rappelle que, sauf à ce que les travaux soient dangereux pour la survie de l’Etat et/ou qu’ils soient négationnistes ou violent une valeur protégée par la convention, celle-ci ne doit pas être limitée par un Etat. En l’espère, il s’agissait d’un livre sur la guerre d’Algérie témoignant de l’utilisation de la torture, qui fut autorisés à la publication par la CEDH, car un Etat ne peut empêcher ses citoyens de faire la lumière sur leur histoire. Or celle-ci peut diviser les citoyens au lieu de les réunir, car comme le soutenait Renan, il faut parfois savoir oublier le passé.
- 101 -
SOURCES
Nota : Du fait que certains articles de journaux soient sans auteur et parce que les archives en
ligne fonctionnent par ordre chronologique, tous les articles ont été classés ainsi et non
par ordre alphabétique. Il en ira de même pour les discours et les débats
parlementaires.
Enfin, parce que notre travail porte sur l’actualité d’écrits du XIXe siècle, la
dichotomie chronologique classique pour séparer les sources de la bibliographie ne
sera pas respectée. Les sources seront les documents sur lesquels nous avons basé
notre analyse. La bibliographie recensera les textes qui ont servi à illustrer ou appuyer
notre argumentation.
Ouvrages D’Ernest Renan
Renan (E.), Histoire générale et systèmes comparés des langues sémitiques, Paris, Calmann-Lévy, éd. 3e, 1863.
Renan (E.), Caliban : suite de la tempête, Paris, Calmann-Lévy, 1878.
Renan (E.), L’avenir de la Science, Paris, Calmann Lévy, 1890.
Renan (E.), « Lettre A M. Strauss, 13 septembre 1870 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, Paris, Calmann-Lévy, 1947, t. 1.
Renan (E.), « Nouvelle lettre à M. Strauss, 15 septembre 1871 », Œuvres complètes de ERNEST RENAN, , Paris, Calmann-Lévy, 1947, t. 1.
Renan (E.), « Lettre à D. Rebité », 29 décembre 1878, Œuvres Complètes, Paris, Calmann-Lévy, 1947-1961, t. 10.
Renan (E.), « Lettre de Renan à Gobineau, 26 juin 1856 », in Ernest Renan, Œuvres complètes, Paris, Calmann-Lévy, t. 9, 1961.
Renan (E.), La Réforme intellectuelle et morale et autres écrits, textes choisis et commentés par Alain de Benoist, Paris, Albatros/Valmonde Editeur, 1982.
Renan (E.), Souvenirs d’enfance et de jeunesse, 1883, in L. Rétat, Renan : Histoire et parole, Paris, Robert Laffont, 1984.
Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
Renan (E.), Le judaïsme comme race et comme religion, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
- 102 -
Dictionnaires
Maurras (C.), Dictionnaire politique et critique, Paris, A. FAYARD et Cie, 1933.
Autres ouvrages
Canivez (P.), Qu’est- ce que la nation ?, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2004.
Dieckohff (A.), La Nation dans tous ses Etats, Paris, Flammarion, 2000, réédité en 2012.
Fichte (J. G.), Reden an die deutsche Nation, Siebente Rede, dans Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke, Hrsg. Von I. H. Fichte, Berlin, Veit & Comp., 1845-1846, Band VII, traduction française de Patrice Canivez in Canivez (P.), Qu’est- ce que la nation ?, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2004.
Gellner (E.), nations et nationalisme, traduit par Bénédicte Pineau, Paris, Payot, 1999.
Hayoun (M.-R.), Renan, la Bible et les juifs, Paris, Arléa, 2008.
Hobsbawm (E.), Nation et nationalisme depuis 1780, Paris, Gallimard, 1992.
Rémond (R.), « Le XIXe siècle : 1815-1914 », Introduction à l’histoire de notre temps, Paris, Le Seuil, 1974, t. 2.
Rioux (J.-P.), La France perd la mémoire, Paris, Perrin, 2010.
Said (E. W.), L’orientalisme : l’Orient créé par l’occident, Paris, Edition du Seuil, 1980.
Sand (S.), Comment le peuple juif fut inventé : de la bible au sionisme, Paris, Flammarion, 2010.
Van Deth (J.-P.), Ernest Renan : simple chercheur de vérité, Paris, Fayard, 2012.
Winock (M.), Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, éditions du Seuil, 1982.
Sternhell (Z.), La droite révolutionnaire : 1885-1914 les origines françaises du fascisme, Paris, Seuil, 1978.
Sternhell (Z.) (dir), L’Eternel Retour, Paris, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, 1994.
Ouvrages de Science politique et de Droit constitutionnel
- 103 -
Prélot (M.), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, éd. 4e, 1970.
Ricci (J.-C.), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, éd. 2, 2011.
Touchard (J.), Histoire des idées politiques du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, PUF, t. 2, 2005.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 24e, août 2007.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 25e, août 2008.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 26e, août 2009.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 27e, août 2010.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 28e, août 2011.
Chantebout (B.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 29e, août 2012.
Cohendet (M.-A.), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 3e, 2006.
Cohendet (M.-A.), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 4e, 2008.
Cohendet (M.-A.), Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, éd. 5e, 2011.
Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 2e, 2009.
Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 3e, 2010.
Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 4e, 2011.
Fraisseix (P.), Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, éd. 5e, 2012.
Hamon (F.) et Troper (M.), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, éd. 30e, 2007.
Hamon (F.) et Troper (M.), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, éd. 32e, 2011.
Le Pourhiet (A.-M.), Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 2e, 2008.
Le Pourhiet (A.-M.), Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 3e, 2010.
Le Pourhiet (A.-M.), Droit constitutionnel, Paris, Economica, éd. 4e, 2012.
Articles
Boutry (P.), « Dieu », Sirinelli (J.-F.) (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 3 « Sensibilités ».
- 104 -
Clément (J.-P.), « Renan et Berthelot : une amitié profonde entre convergences et divergences », in Balcou (J.) (dir.), Marcelin Berthelot (1827-1907) : Sciences et politique, Rennes, PUR, 2010.
Corpet (O.), « La revue » J Sirinelli (J.-F.) (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures ».
Dumoulin (O.), « Histoire et historiens de droite », Sirinelli (J.-F.) (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures ».
Fageol (P.-E.), « Le patriotisme au lycée de Saint-Denis de la Réunion avant la Grande Guerre (1870-1914) », Histoire de l’éducation, n° 133, janvier-mars 2012.
Kouloughli (D.), « Ernest Renan : un antisémite savant », Histoire Epistémologie Langage, 29/II, 2007.
Lorcerie (F.), L’école et le défi ethnique : éducation et intégration, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2003.
Ménager (B.), « Autorité ou liberté », Les droites françaises : De la Révolution à nos jours, Sirinelli (J.-F.) (dir.), Paris, Gallimard, 1992.
Mollier (J.-Y.), « L’édition. 1815-1914 », Sirinelli (J.-F.) (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures ».
Ory (P.), « Le salon », Sirinelli (J.-F.) (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard, 1992, t. 2 « Cultures ».
Otayek (R.), « L’Afrique au prisme de l’ethnicité : perception française et actualité du débat », Revue internationale et stratégique, n° 43, 2001/3.
Thom (M.), « Tribes within nations : the ancient Germans and the history of modern France », in Bhabha (H. K.) (dir.), Nation and narration, London, Routledge, 1990.
Thom (M.), « What is a nation? », in Bhabha (H. K.) (dir.), Nation and narration, London, Routledge, 1990.
Sand (S.), « Note aux lecteurs français » in Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
Sand (S.), « Renan l’inclassable », in Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
Sand (S.), « D’Ernest Renan à Ernest Gellner », in Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
Sand (S.), « D’Ernest Renan à Raymond Aron », in Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, préface de S. Sand, Paris, Flammarion, 2011.
- 105 -
Articles de journaux
> Libération
Allouche (J.-L.), « La République, en l’aimant. Christian Jelen, "La France éclatée ou les Reculades de la République", Nil éditions, 288 pp., 120F. », Libération, 17 septembre 1996.
Bantman (B.), « Le débat sur le code de la nationalité s'est ouvert hier. Bataille à l'Assemblée sur la nouvelle façon d'être Français. La ministre de la Justice a défendu face aux ténors de la droite la possibilité pour les enfants nés en France de parents étrangers d'être naturalisés dès l'âge de 13 ans », Libération, 27 novembre 1997.
Bantman (B.), « La réforme du code de la nationalité n'excite plus le Sénat. Badinter a rappelé que tous les immigrés pouvaient être intégrés », Libération, 14 janvier 1998.
Soulé (V.), « Il ne faut pas refuser le débat sur l’identité nationale », Libération, 12 mai 2007.
Bonal (C.), « l’identité nationale, pour la droite, c’est l’immigration, l’étranger », Libération, 26 octobre 2009.
Joffrin (L.), « il y a aussi du rouge dans le drapeau tricolore », Libération, 27 octobre 2009.
Virot (P.), « Saison de grogne en sarkosie », Libération, 2 novembre 2009.
> L’Express
Barbier (C.), « Enquête sur les ennemis de la République », L’Express, 26 janvier 2004.
Makarian (C.), « La gauche est historienne, pas la droite », L’Express, 3 mai 2007.
Barbier (C.), « Ensemble, c’est tout », L’Express, 26 décembre 2008.
Andriamanana (T.), « Le débat sur l’identité nationale critiqué par une partie de la majorité », L’Express, 29 octobre 2009.
> Le Monde
Courtois (G.), « Les crispations alarmantes de la société française », Le Monde, 24 janvier 2013.
Le Bars (S.), « La religion musulmane fait l'objet d'un profond rejet », Le Monde, 24 Janvier 2013.
- 106 -
Discours et séance d’assemblée
France (A.), Discours prononcé à l’inauguration de la statue de Renan à Tréguier, le 13 septembre 1903, version illustrée par Serge de Solomko, Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud et F. Ferroud successeur, 1922.
Séance de l’Assemblée Nationale, 12 mai 1993.
Journal officiel, Assemblée nationale, 13 mai 1993, n° 15.
Séance de l’Assemblée nationale du 19 mai 1996.
Séance de l’Assemblée nationale du 26 novembre 1997.
Thèses
Beaudin (H.), L’idée de nation, Thèse, Philosophie, Paris IV, 2013.
Gasnier (M.), La destinée posthume de Renan de 1892 à 1923 : essai sur une réception idéologique, Thèse, Lettres, Brest, 1998.
Richard (E.), Ernest Renan : un penseur traditionaliste ?, Aix-Marseille, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 1996.
- 107 -
BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaires
Larousse thématique : Dictionnaire de la Philosophie, Paris, France Loisir, 1984
Le petit Larousse, Paris, Larousse, 2001.
Raynaud (P.) (dir.), Rials (S.) (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996.
Tulard (J.) (dir.), Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995.
Villiers (M. de) et Le Divellec (A.), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, éd. 6e, 2007.
Villiers (M. de) et Le Divellec (A.), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2011.
Ouvrages contemporains
Barrès (M.), Scènes et doctrines du nationalisme, Paris, Félix Juven, t. 1, 1902.
Barrès (M.), Huit jours chez M. Renan, Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. SANTOS et Cie, éd. 4e, 1904.
Barrès (M.), M. Renan au purgatoire, in Huit jours chez M. Renan, Paris, Bibliothèque Internationale d’Edition E. SANTOS et Cie, éd. 4e, 1904.
Bouscau (F.), Maurras et la pensée contre-révolutionnaire, Paris, Action Familiale et Scolaire, 2009.
Boutang (P.), MAURRAS : La destinée et l’œuvre, Paris, Plon, 1984.
Chastenet (J.), Une époque de contestation : La monarchie bourgeoise (1830-1848), Paris, Librairie Académique Perrin, 1976.
Coquerelle (S. et P.), Les débuts de l’époque contemporaine : 1789-1848, Paris, Hatier, 1960.
Crémieux (A.), La Révolution de Février : Etude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24 Février 1848, Genève, Mégariotis Reprints, réimpression de l’édition de 1912.
Cusson (M.), La criminologie, Paris, Hachette, éd. 4e, 2005.
- 108 -
Darwin (C.), De l’origine des espèces par sélection naturelle ou des lois de transformation des êtres organisés, Paris, Guillaumin et compagnie et Victor Masson et fils, traduit par Clémence Royer, 1866.
De Andrade (M.), Macounaïma, Paris, Stock/ Unesco/ ALLCA XX, traduction française de Jacques Thiériot, 1996.
Dia (H.), Poésie Africaine et engagement, Châtenay-Malabry, Acoria, 2003.
Droz (J.), De la Restauration à la révolution : 1815-1848, Paris, Armand Colin, 1970.
Drumont (E.), La France Juive, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éd. 43e, s. d., t. 1 et 2
Foillard (P.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Orléans, Paradigme, éd. 14e, 2008-2009
Font (M. A.) et Quiroz (A. W.), The Cuban Republic and José Martí, Oxford, Laxington Books, 2006.
Gellner (E.), Culture, Identity and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Hobbes (T.), Léviathan, Paris, Gallimard, 2000.
Huntington (S. P.), Qui sommes-nous ? : Identité nationale et choc des cultures, Paris, Odile Jacob, 2004.
Le Fur (L.), « Race et Nationalité », Revue catholique des Institutions et des Droits, Lyon, J. Perroud, 1921
Le Fur (L.), Races, Nationalités, Etats, Paris, Librairie Félix Alcan, 1922.
Lefranc (M.), Pourquoi nous glorifions Renan, Réponse à Jean des Buttes, Brest, Imprimerie de la Dépêche, 1903.
Lemaitre (J.), Deux Statues : un mot aux intelligents, Montréal, W. Boucher, 1903.
Locke (J.), Traité du gouvernement civil, Paris, Calixte Volland, 1802.
Locke (J.), Lettre sur la tolérance, Paris, Slatkine, 1995.
Marx (K.) et Engels (F.), Manifeste du Parti communiste, Paris, Edition Générale Française, 1973.
Millot (L.) et Blanc (F.-P.), Introduction à l’étude du droit musulman, Paris, Dalloz, 2001.
Monod (G.), Renan, Taine, Michelet : les maîtres de l’histoire, Paris, Calmann Lévy, 1894.
Mussolini (B.), La Doctrine du fascisme, Florence, Vallechi, 1937.
Philippe (B.), Etre Juif dans la société française, s. l., Montalba, 1979.
- 109 -
Ponteil (F.), Les classes bourgeoises et l’avènement de la démocratie, Paris, Albin Michel, 1989.
Rousseau (J-.J.), Du contrat social, Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
Topinard (P.), Etude sur les races indigènes de l’Australie, Paris, Typographie A. Hennuyer, 1872.
Villey (M.), Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2001.
Viroli (M.), For Love of Country: An Essay On Patriotism and Nationalism, s.l., Oxford University Press, 1997.
Articles
Aggarwal (K.), Amadou Hampâté Bâ et l’africanisme, Paris-Montréal, l’Harmattan, 1996.
Agulhon (M.), « La République a besoin de grands hommes », in L’Histoire : « 1500 ans d’histoires de France : les dates, les héros, les légendes », mars 2013.
Balcou (J.), « Renan et le Brésil », Ernest Renan et le Brésil, actes du colloque organisé par l’ERIMIT, université Rennes II octobre 2005 in Bulletin des études renaniennes, s.l, s.n, n° 111, janvier 2005
Birnbaum (P.), « Le retour d’Ernest Renan », Critique, n° 697-698, 2005/6.
Cashin Ritaine (E.), « Nationalité étatique : un état des lieux juridique », La nationalité dans le sport - enjeux et problèmes, Université de Neuchâtel, Editions du CIES, 2006.
Germinario (F.), « Fascisme et idéologie fasciste : problème historiographique et méthodologique dans le modèle de Zeev Sternhell », Revue française d’histoire des idées politiques, Paris, Picard, n°1, 1er semestre 1995.
Gnamo (A. H.), «Islam, the orthodox Church and Oromo nationalism (Ethiopia) », Cahiers d’étude africaines, n° 165, 2002.
Goudineau (C.), « Le Héros », L’Histoire, n° 282, in L’Histoire : « 1500 ans d’histoires de France : les dates, les héros, les légendes », mars 2013.
Laurens (S.), « L’immigration : une affaire d’Etat. Conversion des regards sur les migrations algériennes (1961-1973) », Culture & Conflit, n° 69, printemps 2008.
Lequette (Y.), « Réflexion sur la nationalité française », Cahier du droit constitutionnel, n° 23, février 2008.
Loubes (O.), « Les Héros », in L’Histoire : « 1500 ans d’histoires de France : les dates, les héros, les légendes », mars 2013.
- 110 -
Pech (T.), « La fabrique de l’identité nationale », Alternatives économiques, n°287, janvier 2010.
Pelloile (B.), « Un modèle subjectif rationnel de la nation : Renan », Revue française de science politique, v. 37, n° 5, 1987.
Silvestre (H.), « Ernest Renan et ses éditeurs Michel et Calmann Lévy. A propos d’un livre récent », Revue belge de philosophie et d’histoire, v. 65, n° 65-2.
Tavan (C.), « Les immigrés en France : une situation qui évolue », INSEE Première, 2005, n° 1042.
Vaillant (M.), « Carole REYNAUD-PALIGOT, la République raciale, 1860-1930. Paradigme racial et idéologie républicaine une critique de Michaël Vaillant », Raison Publique, n° 5, octobre 2006.
Vallat (X.), « Xavier Vallat 1891-1972 », Les amis de Xavier Vallat, s. l., s. n., 1977.
Wimmer (A.), « L’Etat-nation, une forme de fermeture sociale », Archives Européenne de Sociologie, t. 37.
Winock (M.), « La nouvelle guerre coloniale », in L’Histoire : « 1500 ans d’histoires de France : les dates, les héros, les légendes », mars 2013.
Articles de journaux
> L’humanité
[Anon.], L’Humanité, 3 septembre 1923.
Dunois (A.), L’Humanité, 12 mars 1923.
Rive (E.), « visite interdites au centre de rétention », l’Humanité, 12 janvier 2007.
[Anon.], « Dans l’actualité », l’Humanité, 18 juin 2007.
> L’Express
Claude-Michel (C.), « Relire Renan », L’Express, 20 juillet 1995.
[Anon.], « Privés de manuels scolaires pour des impayés de cantine », L’Express, 13 septembre 2011.
Kauffmann (G.), « Michel Winock, Flaubert et le mal du siècle », L’Express, 24 mars 2013.
- 111 -
> Libération
Devarrieux (C.) « Antoine Compagnon, la martiale éducation », Libération, 14 novembre 2012.
Noce (V.), « Orsay enfin rénové de fonds en combles », Libération, 19 octobre 2011.
> Divers
Dumas (A.), La Gazette de France, 8 octobre 1892.
[Anon.], Journal de Rennes, 12 octobre 1892.
[Anon.], Le Temps, 12 mars 1923.
Theis (L.), « Rubrique littéraire », Nouvel Observateur, décembre 1992.
Lois, décrets, arrêts et recueil Dalloz
Loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, JORF, n° 168, 23 juillet 1993.
Loi du 10 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, JORF 23 mai 2001, n°0119.
Décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement, JORF, n° 115, 19 mai 2007.
CEDH, 15 janvier 2009, Orban et autre contre France.
Recueil Dalloz, 1938 à 1945.
Discours et séances de l’Assemblée nationale ou du Sénat
Ferry (J.), discours à la chambre des députés du 28 Juillet 1885, Mopin (M.), Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, Paris, la documentation française, 1988
Discours de Marcelin Berthelot in D’Ys (R.), Ernest Renan en Bretagne, Paris, Emile-Paul, éd. 2e, 1904.
Mitterrand (F.), Ministre de l’Intérieur, Discours à l’Assemblée Nationale, 25 novembre 1954, in Mopin (M.), Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours, Paris, la documentation française, 1988
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la lutte contre la criminalité, la délinquance et l'immigration illégale, à Grenoble le 30 juillet 2010.
- 112 -
« Question orale sans débat, n° 1336S de M. Ronan Kerdraon », Journal Officiel, Sénat, 19 mai 2011.
Séance du Sénat du 22 février 2010.
Séance du Sénat du 12 juillet 2011.
Thèse :
Gasnos (X.), Etudes historiques sur la condition des juifs dans l’ancien droit français, Thèse, Rennes, 1897.
Sources numériques
Archives numériques en ligne : http://archive.org/index.php
http://gallica.bnf.fr/
Archives numérique du sénat : http://www.senat.fr/leg/archives.html
Archives numériques de l’Assemblée nationale : http://archives.assemblee-nationale.fr/
Archives en ligne de L’Humanité : http://www.humanite.fr/
Archives en ligne de L’Express : http://www.lexpress.fr/
Archives en ligne de Libération : http://www.liberation.fr/
Archives en ligne du Figaro : http://www.lefigaro.fr/
Liste des épreuves du certificat d’étude :
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2289
Enquête Ipsos intitulée « France 2013 : les nouvelles fractures » :
http://www.cevipof.com/fr/france-2013-les-nouvelles-fractures/resultats/
Liste des travaux de Shlomo Sand sur Sorel :
http://www.tau.ac.il/humanities/faculty/sand_shlomo/
- 113 -
ANNEXES
Annexe 1
Etudes consacrées à Renan de 1892 à 1923 d’après Thieme
Nbr
40
26
1711 10
410 9
3 5
12
27
11 117
4 2
104
72 1
5 61 3 1
4 59
17
72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1892
1894
1896
1898
1900
1902
1904
1906
1908
1910
1912
1914
1916
1918
1920
1922
Nbr
- 114 -
- 118 -
Annexe 3
Graphiques à propos de l’enquête Ipsos
extrait des articles du Monde de G. Courtois et S. Le Bars
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION : .................................................................................................................... 1 PARTIE 1 : LE CONSTAT DE L’OUBLI DE LA NATION RENANIENNE ....................... 15
Chapitre 1 : La liquidation de l’héritage intellectuel renanien et sa dissolution entre ses héritiers politiques ................................................................................................................. 15
Section 1 : La succession de la droite monarchiste et nationaliste ................................... 16 § 1 : La récupération des idées monarchistes de Renan ................................................ 16 § 2 Une récupération discutée et une définition de la nation partiellement assumée . . . 19
Section 2 : Le faire valoir d’une République en construction ........................................... 21 § 1 : La « glorification » du Renan de Caliban ............................................................. 21 § 2 : L’adoption de la définition de la nation renanienne comme définition républicaine .................................................................................................................. 24 de la nation. .................................................................................................................. 24
Chapitre 2 : Un oubli mâtiné de rappels ponctuels de la définition renanienne de la nation à l’époque contemporaine ........................................................................................................ 27
Section 1 : Un oubli interrompu ponctuellement dans l’espace socio-politique ............... 27 § 1 : L’oubli généralisé de Renan dans la classe politique ........................................... 27 § 2 : Une résurgence ponctuelle de l’idée de nation renanienne lors de situations particulières ................................................................................................................... 32
Section 2 : L’oubli dans le milieu intellectuel et universitaire .......................................... 36 § 1 : L’oubli de Renan dans la définition française contemporaine de la nation .......... 36 § 2 : L’importance de l’idée de nation renanienne dans les travaux étrangers ............. 40
Chapitre 3 : La raison de l’oubli : la péremption de la théorie de Renan ............................. 44 Section 1 : La caducité de la définition face aux nouveaux courants ............................... 44
§ 1 : La critique de la définition renanienne de la nation .............................................. 44 § 2 : Les nouveaux fondements de la nation : une redéfinition des bases. ................... 48
Section 2 : Les nouvelles définitions de la nation. ............................................................ 50 § 1 : L’alliance de la conception objective et subjective de la nation ........................... 51 § 2 : La nation renanienne : un fondement incontournable ? ........................................ 54
PARTIE 2 : LES ENJEUX DES ETUDES CONTEMPORAINES SUR L’IDEE DE NATION CHEZ RENAN ......................................................................................................................... 58
Chapitre 1 : Le Renan raciste et « fasciste » ......................................................................... 58 Section 1 : la définition de la nation renanienne comme base du colonialisme ................ 59
§ 1 : Le racisme renanien comme légitimation de la colonisation ................................ 59 § 2 : L’interaction entre la IIIe République colonialiste et Renan autour la nation. ..... 63
Section 2 : Renan : l’antisémite qui préfigura le fascisme. ............................................... 67 § 1 : L’antisémitisme de Renan comme source de Vichy ............................................. 68 § 2 : Le passage de l’anti-sémitisme au philosémitisme par la réflexion sur la nation . 72
Chapitre 2 : La nation contractuelle de Renan ...................................................................... 78 Section 1 : La quasi unanimité des auteurs sur le lien « nation renanienne » et « nation contractualiste » ................................................................................................................ 78
§ 1 : Recensement et exposition de la théorie « nation renanienne égal nation contractuelle » ............................................................................................................... 78 § 2 : La justification de la vision contractualiste de l’idée de nation renanienne. ........ 80
Section 2 : L’incohérence du lien « nation renanienne » et « nation contractualiste » par l’évolution de la pensée de Renan ..................................................................................... 83
§ 1 : L’anachronisme du rattachement de la nation renanienne au contrat social ......... 84 § 2 : La nation renanienne comme expression d’un consensus ................................... 86
Chapitre 3 : Renan et son idée de nation vu par le prisme politique ..................................... 90
- 121 -
Section 1 : L’influence politique dans les travaux sur la nation selon Renan ................... 90 § 1 : Le constat de la politisation des travaux sur la nation renanienne ........................ 90 § 2 : Renan : un auteur étudié hors contexte ................................................................. 92
Section 2 : Une conférence politisée en raison de son ambiguïté ..................................... 94 § 1 : La perpétuation des schémas de la Troisième République ................................... 94 § 2 : La neutralité de la conférence de Renan ............................................................... 96
CONCLUSION ....................................................................................................................... 100 SOURCES ............................................................................................................................... 102 BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 108 ANNEXES .............................................................................................................................. 114 TABLE DES MATIERES ...................................................................................................... 121
- 122 -