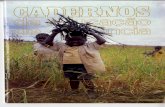Les questions disputées De potentia, ou une théologie de l'acte
-
Upload
ict-toulouse -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les questions disputées De potentia, ou une théologie de l'acte
LE S Q U E S T IO N S D IS P U T E E S DE P O T E N T IA
ou UN E T H E O L O G IE D E L ’AC T E
Ubi autem est virtus Dei, ibi est et essentia Dei : in Deo enim idem est essentia et virtus (Super Io, 13, l. 4, n. 1810 [v. 27a])
Les questions disputées De potentia sont une des œuvres les moins étudiées de saint Thomas d’Aquin. Il est vrai qu’elles sont, pour le théologien ou le philosophe contemporain d’un abord triplement redoutable : elles sont médiévales, elles sont techniques, et elles sont parmi les plus spéculatives. Il n’y a sans doute pas d’autre manière d’aplanir cette difficulté que de devenir peu à peu familier de ce texte, dont les lumières innombrables ne se révèlent qu’aux yeux accoutumés. C’est dans cette perspective qu’a été rédigée cette présentation, non pour suppléer à la lecture de l’œuvre elle-même, mais pour y introduire par le rappel de l’essentiel.
QUESTIONES DISPUTATAE…
Les questions d’un maître
Le 8 septembre 1265, le chapitre de sa province, réuni à Anagni, enjoignait à frère Thomas d’Aquin d’aller fonder un studium – c’est-à-dire un centre d’étude et de formation initiale – à Rome1. Cette mission était dans la droite ligne des décisions du chapitre général de l’Ordre des Prêcheurs célébré à Valenciennes en juin 1259, qui visaient à renforcer l’étude dans les couvents et les provinces. Le jeune Ordre fondé par saint Dominique et approuvé par Innocent III quarante ans plus tôt, le 22 décembre 1216, devait en effet faire face à deux défis : d’une part, il lui fallait accueillir de très nombreuses vocations et les préparer au ministère que leur avait confié le pape, principalement confesser et prêcher ; d’autre part, et dans le même temps, il lui fallait mettre en place les structures institutionnelles capables de répondre à une telle mission. L’organisation des études dans l’Ordre dominicain était en effet encore en phase expérimentale : la création de plusieurs grands centres – les 1 Pour les aperçus historiques sur saint Thomas, nous nous appuyons principalement sur les deux ouvrages de référence : JEAN-PIERRE TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre, « Vestigia. Pensée antique et médievale, 13 », Paris-Fribourg, Cerf-Presses universitaires de Fribourg, 20022 ; JAMES A. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, Garden City, Doubleday, 1974.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 2 -
studia generalia – en plus du couvent saint Jacques de Paris datait seulement du chapitre général de 1248. Déjà, elle avait permis la formation de nombreux frères, envoyés par leur province dans les plus prestigieuses universités de la chrétienté. Plusieurs grands maîtres – magistri2 – avaient bénéficié de ces institutions, dont Thomas d’Aquin. Ce mouvement centrifuge appelait naturellement son complément centripète : le très haut niveau intellectuel auquel s’était hissé l’Ordre en quelques années était encore trop limité aux studia generalia, et il était temps que le savoir se diffusât, si l’on peut dire, « de la tête aux pieds ». Le chapitre général de Valenciennes de 1259, évoqué plus haut, alla en ce sens, tout en confirmant le rôle moteur des studia generalia3.
Frère Thomas d’Aquin n’était pas étranger à ces décisions politiques, comme victime et comme complice. Jeune étudiant de 24 ans à l’époque du chapitre de 1248, il avait pu rapidement en percevoir les effets puisqu’il avait suivi son maître Albert le Grand à Cologne où l’Ordre avait décidé d’installer un de ses nouveaux studia generalia. Onze ans plus tard, à l’époque du chapitre de 1259, frère Thomas n’était plus étudiant mais Maître-Régent à Paris, et c’est en cette qualité que le Maître de l’Ordre, successeur de saint Dominique, le nomma expert dans la commission chargée de promouvoir les études. Il y retrouva entre autres Albert le Grand et Pierre de Tarentaise : deux futurs docteurs de l’Eglise et un futur – mais éphémère – pape ! C’est donc en application des décisions qu’il avait en partie contribué à faire adopter qu’il laissa sa charge parisienne pour retourner dans sa province romaine, où il pourrait à la fois continuer d’enseigner comme il l’avait fait à Paris, et peser sur la politique des études.
Il est donc fort probable, pour en revenir à notre point de départ, que frère Thomas n’a pas été étranger à la décision du chapitre provincial de 1265 d’ouvrir un studium local à Rome et de lui en confier la responsabilité4. Cela peut expliquer la grande liberté pédagogique dont il disposait, qui n’est pas pour rien dans la mise en chantier de cet ouvrage si personnel qu’est la Somme de théologie. Durant ses trois années à Rome (1265-1268) le Maître sera donc avant tout enseignant, y transposant ce qu’il avait appris à faire à Paris avec toutefois les aménagements que pouvait requérir le passage d’un public universitaire divers à un groupe de jeunes dominicains. En quoi le travail du Magister in sacra Pagina ou Doctor sacræ Scripturæ
2 Le titre de Magister était le plus haut titre universitaire de l’époque. Il n’était pas accordé avant 35 ans et sanctionnait au moins 12 années d’études à la faculté de théologie. 3 Sur l’organisation des études dans les premiers temps de l’Ordre, on dispose désormais de l’étude de M. MICHELE MULCHAHEY, « First the Bow is Bent in Study ». Dominican Education before 1350, « Studies and Texts, 132 », Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1998. 4 Sur le séjour romain, cf. TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre, p. 207-259. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, p. 195-230.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 3 -
consistait-il ? Pierre le Chantre l’avait défini à la fin du XIIe siècle en une formule devenue rapidement canonique : legere, disputare, prædicare5. Lire – et il faut entendre par là : commenter cursivement –, disputer, prêcher, chacun de ces verbes n’ayant qu’un unique complément d’objet principal : la Sainte Ecriture. Les titres mêmes de Magister in sacra Pagina – littéralement : Maître en Page sacrée – et de Doctor sacræ Scripturæ – Docteur de l’Ecriture sainte – sont emblématiques de ce que B. Bazàn a justement appelé « une culture en situation herméneutique »6. Toutes les activités scientifiques étaient en effet tournées vers l’assimilation d’un héritage constitué de la Bible et de la Tradition ecclésiale – conciles, coutumes et Pères de l’Eglise – mais aussi des auteurs païens, juifs ou encore musulmans dès lors que leurs écrits pouvaient aider à la connaissance de la vérité. C’est ainsi que, pendant sa période romaine, Thomas fut occupé par la rédaction de la première partie de la Somme de théologie, de la Catena Aurea sur saint Marc, saint Luc et saint Jean7, d’un commentaire du De anima d’Aristote, et de plusieurs opuscules d’expertise. Parallèlement, il enseignait à ses étudiants la théologie – peut-être en commentant à nouveau les Sentences de Pierre Lombard, plus probablement en composant la Somme de Théologie –, lisait l’Ecriture – sans doute saint Paul –, prêchait régulièrement et… disputait les questions De potentia – ainsi que quelques autres. Cette suractivité, de surcroît très diversifiée, ne doit pas être oubliée car elle transparaît bien peu dans les écrits.
Lorsqu’il met par écrit le De potentia, en 1265-1267, Thomas a 40 ans. A cette époque, il est enseignant depuis 13 ans (1252), maître en théologie depuis 9 ans (1256). Il mourra 9 ans plus tard, en 1274. Dans cette courte mais féconde carrière, le De potentia tient donc une position médiane et, à plus d’un titre, il constitue le pivot d’une évolution vers les enseignements de la maturité.
5 Cf. PIERRE LE CHANTRE, « Verbum Abbreviatum », dans PL 205, Migne, 1855, p. 21-554 [chap. I, 25 A-B] : « L’exercice en matière d’Ecriture sainte consiste en trois choses : la lecture, la dispute et la prédication. Une excessive abondance de l’une d’elles est la mère de l’oubli et la marâtre de la mémoire. La lecture est comme le fondement, la base des deux autres. C’est en effet de la lecture que les autres tiennent leur utilité. Cet exercice est une construction. La dispute en est comme le mur car rien n’est pleinement compris, ni fidèlement prêché, qui n’a pas d’abord été mâché sous les dents de la dispute. Quant à la prédication, dont les précédentes sont les servantes, elle est comme le toit abritant les fidèles de la chaleur et du tourbillon des vices. Ainsi donc, on devra prêcher l’Ecriture sainte après – et non pas avant – sa lecture avec les questions qu’elle suscite, puis sa dispute avec la recherche qu’elle implique. » 6 BERNARDO C. BAZAN, « Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie », dans Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 44-45 », Turnhout, Brepols, 1985, p. 13-149 [p. 25]. 7 La Catena Aurea, ou ‘chaîne d’or’, est une compilation de citations patristiques suivant, verset par verset, le texte de chaque Evangile. Entrepris à la requête d’Urbain IV en 1262-1263, alors que Thomas était lector à Orvieto, cet ouvrage se distingue notamment par la place réservée à la patristique grecque, dont certains auteurs bénéficiaient ici de leur première traduction latine. Cf. TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre, p. 200-206.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 4 -
Comment se disputer?
On vient de le voir, les questions disputées De potentia sont le fruit de l’enseignement ordinaire du Magister : à côté de la lectio et de la prædicatio, la disputatio est une activité prescrite à l’enseignant en faculté de théologie, très rapidement adoptée et encouragée dans l’Ordre dominicain8. Si nous ne savons pas exactement comment se sont déroulées les disputationes organisées par Thomas à Rome, nous avons cependant tout lieu de penser qu’il reprit le schéma pratiqué à Paris, non seulement parce que ses questions disputées avaient connu alors un grand succès, mais aussi parce que Thomas usait du genre sous une forme quasi-canonique, que l’on retrouve y compris dans la Somme de théologie : autour d’une question très précisément formulée, des arguments sont exposés, auxquels sont opposés d’abord des autorités (Ecriture, Conciles, Pères ou philosophes) ou des arguments de raison, puis la solution du Maître, qui achève en répondant aux arguments contraires. Nous en donnons un exemple type dans la figure 1. Comme le note le spécialiste B. Bazàn, « les Questiones disputatae de Thomas sont presque l’archétype de la disputatio telle qu’elle était pratiquée au XIIIe siècle »9.
Cette structure écrite suit d’assez près les étapes d’une disputatio orale telles que nous pouvons les reconstituer à partir des règlements universitaires et des notes de cours10 : pour les disputes à l’université, le Maître fixait deux dates rapprochées et formulait l’intitulé de la question qui serait alors débattue. Il désignait en même temps deux intervenants, appelés l’opponens et le respondens, pris normalement parmi les bacheliers11 qui lui étaient attachés. La dispute avait lieu en deux temps : la première séance, ou disputatio, était consacrée à la discussion d’arguments opposés sous la direction de l’opponens et du respondens. Les échanges permettaient ainsi de reformuler d’une manière plus rigoureuse et plus pertinente les interventions. Ils servaient aussi à préciser l’enjeu et les limites de la question. Durant cette séance, le maître pouvait intervenir soit pour apporter un nouvel argument, soit pour mettre au
8 Dès 1228, une constitution du chapitre général révèle que l’exercice était déjà couramment pratiqué. Les Statuts de 1259 concernant les études, rédigés notamment par Albert le Grand, Thomas d’Aquin et Pierre de Tarentaise, confirment l’importance pédagogique accordée aux disputes dans les studia de l’Ordre. 9 BAZAN, « Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie », p. 43. 10 Nous suivons ici B. Bazàn, Ibid., qui fait le point sur la question. Pour les détails concernant le De potentia, cf. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, p. 196-198. 11 Le baccalauréat était le premier diplôme de théologie, que l’on obtenait après 5 à 7 années de cours, et qui comportait deux degrés. Le bachelier biblique était chargé de lire aux étudiants un livre biblique par an ; lorsqu’il accédait au second degré, deux ans après, il devenait bachelier sententiaire et était chargé de lire les Sentences de Pierre Lombard.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 5 -
point un argument avancé par d’autres, soit pour apporter le soutien d’une autorité à l’appui d’un argument. Des notes – reportatio – étaient prises de cette séance sur lesquelles le maître travaillait pour la seconde séance. Durant cette dernière, appelée determinatio, le Maître apportait la solution à la question et il répondait aux différents arguments, en les réordonnant au besoin. La question disputée était par conséquent un moyen pour le Maître de mettre au point sa pensée sur un sujet précis, avec l’aide d’un auditoire qui apprenait autant qu’il stimulait son enseignant. « Les questions disputées, véritables ateliers de travail et de discussion de la scolastique, ont donné à l’université médiévale ce haut degré de dialogue qui la caractérise, car elles favorisaient l’échange vivant de points de vue, d’arguments et de doctrine »12.
12 BAZAN, « Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie », p. 147.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 6 -
C’est à partir de la reportatio des deux séances et de ses propres notes que le Maître pouvait préparer une publication : l’editio offre donc un résultat réélaboré, complété, lissé, qui est passé par le filtre de deux étapes très denses, et qui contient beaucoup plus qu’un simple procès-verbal13. Tout n’est pas du Maître dans le texte d’une question disputée puisqu’il n’a pas été le seul intervenant, mais, dans le même temps, le Maître a repris et assumé à sa manière tout le contenu de la dispute.
Un dernier point mérite d’être mentionné : le nombre total d’articles du De potentia s’élève à 83 et l’on a de bonnes raisons de penser que chacun correspond à une dispute effectivement tenue14. Si Thomas a conservé à Rome le rythme adopté à Paris, il aura disputé ces 83 questions en une année, sans doute l’année universitaire 1265-1266, ce qui représente le rythme soutenu d’une question par jour de cours. Il s’agissait bien d’un acte régulier, sans doute quotidien, d’enseignement.
Toutes ces précisions doivent donc conduire à certaines précautions de lecture : si tout est bien de saint Thomas dans le texte dont nous disposons aujourd’hui, tout n’y est pas au même titre. Le thème de chaque article est sans doute l’élément le plus stable, fixé par le Maître dès avant la dispute en fonction de ses centres d’intérêts du moment. Si le regroupement en grands ensembles (q. 1 : la puissance de Dieu, q. 2 : la puissance générative, etc.) intervenait au moment de la publication, les questions du De potentia forment cependant des ensembles si cohérents qu’ils présupposent que Thomas en avait déjà le plan en tête lorsqu’il décidait de s’attaquer à un nouveau thème. Nous en donnons un exemple dans la Figure 2 où l’on voit que la question 2 consacrée à la puissance générative en Dieu tire sa structure du Commentaire sur les Sentences – première grande œuvre de Thomas – et que Thomas conservera substantiellement cette structure dans la Somme de Théologie. Cette permanence structurelle n’empêche cependant pas que des articles aient pu être déplacés au sein d’une même question entre la dispute et l’édition : encore une fois, l’œuvre publiée reflète le dernier état de la pensée de notre Docteur, après que la dispute lui avait apporté les réponses qu’il en attendait.
13 Pour le P. Torrell, op. cit., p. 91, le fait que l’œuvre finale soit « très au-dessus de ce que pouvait donner une discussion au niveau de l’étudiant moyen » à Paris et plus encore à Rome, rend vraisemblable un « travail rédactionnel considérable » de Thomas après coup. Il suffit de lire l’article 2 de la question 4, consacré à la création de la matière, avec ses 34 arguments et ses 10 sed contra pour s’en convaincre, même s’il est difficile d’être plus précis sur la teneur de ce travail. 14 Nous suivons ici la suggestion de B. Bazàn de considérer l’article comme unité de base dans les disputes soutenues à l’intérieur du studium, comme c’est le cas des questions De potentia. Selon cet auteur, suivant ici le P. Dondaine, les disputes soutenues en public à l’université de Paris, moins fréquentes, auraient au contraire eu la question comme unité de base.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 7 -
Les arguments rassemblés en tête de chaque article correspondent à la première partie de la dispute – la disputatio – tenue sous l’égide de l’opponens et du respondens. S’il ne subsiste quasiment plus aucune trace des débats, on trouvera cependant ça et là le reliquat d’un échange. Dans l’article 1 de la question 1 par exemple : l’opponens ayant exposé sont 11e argument, le respondens élève une objection (« Mais tu dis que… ») à laquelle l’opponens répond sur-le-champ (« En sens contraire… »).
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 8 -
Dans leur état actuel, les arguments sont le résultat de plusieurs reformulations successives : primo, la couche primaire est constituée par un argument tiré explicitement d’une autorité ou s’appuyant sur une autorité, passée ou contemporaine, laquelle n’est pas nécessairement citée. Ainsi, lorsque Thomas se
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 9 -
sépare de son maître Albert ou s’oppose à Bonaventure, l’argument qui reprend leur position est le plus souvent anonyme. Secundo, au cours de la disputatio, l’argument primaire est intégré dans, ou transformé en un syllogisme, aussi précis et synthétique que possible afin de bien cerner la difficulté soulevée et de permettre une dispute fructueuse. L’importance d’un argument ne tient donc pas à sa longueur, au contraire. Tertio, le maître pouvait reformuler de manière plus rigoureuse un argument laissé dans un état trop lâche pendant la dispute. Il pouvait aussi réorienter un argument afin de développer dans sa réponse un point laissé en suspens dans le Respondeo. C’est la raison pour laquelle, si la première partie des articles est la moins personnelle du point de vue de la forme ou du style, l’ordre des arguments ou l’importance de la réponse qui leur est apportée peut être l’indice d’une réécriture thomasienne. Quarto, enfin, les citations d’autorités pouvaient être complétées ou corrigées avant publication à partir des manuscrits ou des florilèges à la disposition de Thomas – et surtout de ses secrétaires – comme elles pouvaient tout aussi bien être laissées en l’état. On se gardera donc de tirer trop de conclusions d’un matériau aussi friable.
Les sed contra, sur lesquels vient se briser le jet d’arguments comme sur une muraille, marquent l’entrée dans la determinatio et, de ce fait, dans le domaine réservé du Maître. Ce dernier les choisit donc avec attention comme devant constituer soit un coup d’arrêt bref et décisif (par exemple q. 10, a. 1), soit une première réponse (cf. le cas surdéveloppé de q. 9, a. 9), soit encore le pivot de sa propre réponse (ainsi de q. 2, a. 1). On notera que l’ordre des sed contra n’est jamais indifférent : il suit normalement un ordre décroissant d’autorité. Dans les matières révélées, c’est donc normalement l’Ecriture ou un énoncé de foi qui viendra en premier, suivi des Pères. Thomas peut ajouter en finale ce qu’il considère comme l’argument de raison le plus décisif. Un ordre différent mérite donc toujours l’attention : dans q. 2, a. 1, que nous venons de mentionner, Thomas cite Augustin après Aristote et signale ainsi qu’il s’apprête notamment à renouveler l’interprétation d’Augustin.
Le propos de Thomas dans le Respondeo est sensiblement différent par rapport à ce qu’il est dans d’autres œuvres comme la Somme de Théologie : ici le maître enseigne en allant à l’essentiel, là il résout une difficulté en éprouvant sa propre doctrine mais aussi celles de ses contemporains. On ne s’étonnera donc pas de voir notre Docteur prendre le temps de développer sa pensée et l’on se gardera d’oublier que Thomas discute – et dispute – aussi avec lui-même. Nombre d’avancées décisives se jouent dans les dédales de cette argumentation qui cherche en même temps qu’elle s’énonce. Les questions disputées sont avant tout un laboratoire théologique, une cuisine où se préparent les synthèses à venir.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 10 -
Les réponses aux objections – introduites par ad –, enfin, sont un très utile complément du Respondeo. Elles offrent en effet à Thomas l’occasion d’éprouver et de préciser la cohérence de la doctrine qu’il vient d’énoncer en la confrontant à une multiplicité d’arguments contraires.
Pourquoi se poser des questions ?
Les développements qui précèdent ont permis de mettre à jour le moteur des questions disputées : la relation à l’égard des autorités. Les questions disputées sont essentiellement une manière de réfléchir sur un sujet à partir des autorités et avec elles. Elles manifestent par là un des traits distinctifs de la théologie médiévale : la conscience d’être héritiers et le désir corrélatif de participer de l’intérieur à la vie de la Tradition. L’évolution du genre pédagogique des questions disputées, entre leur apparition comme exercice indépendant de la lectio au 12e siècle et leur dépérissement en exercice de l’étudiant au 14e, est à cet égard révélateur du tournant intellectuel pris par l’Occident au Moyen Age.
L’apparition du phénomène de la question disputée en à peine un siècle est étroitement dépendante des conditions de l’enseignement médiéval : pas de disputatio sans questio qui en fournisse la matière, et pas de questio sans, préalablement, une lectio qui la suscite. Pratiquée sur le texte biblique, cette dernière avait en effet encouragé le développement de deux types d’instruments. D’une part, des instruments logiques et dialectiques avaient été forgés pour savoir lire, décomposer les propositions et en fournir une explication littérale et spirituelle. D’autre part, la constitution de florilèges des Pères, c’est-à-dire d’extraits d’œuvres tirés de leur contexte, permettait au Maître d’enraciner dans la Tradition son enseignement oral en marquetant ce matériau sur la trame du texte biblique. L’Ecriture sacrée devenait ainsi le lieu d’un dialogue intemporel entre Augustin et Athanase, Boèce et Grégoire, Isidore et Léon, et tout auteur que sa sainteté ou sa renommée pouvait accréditer comme autorité. Cette rencontre faisait parfois apparaître une dissonance d’opinions, qui interrompait la lectio le temps d’une questio où le Maître se devait d’accorder les autorités, à moins qu’il ne choisît de privilégier une opinion. Ce faisant, le Maître intervenait lui-même comme une autorité, proposant sa propre solution et devant l’argumenter au milieu des opinions contraires. Accorder les autorités en intervenant soi-même par sa raison : deux traits principaux de la question disputés sont bien déjà présents dans la questio biblique.
C’est dans la seconde moitié du 12e siècle, avec Simon de Tournai notamment, que la questio en vint tout naturellement à se détacher de la lectio – elle perdit donc son lien direct avec l’Ecriture – pour devenir un genre à part, avec ses règles de discussion : la disputatio. B. Bazàn propose trois facteurs déterminants de cette
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 11 -
évolution : primo, le développement de la science théologique et de la raison théologique, et son corollaire institutionnel : l’affermissement de la figure du Magister. Secundo, le succès des Sentences de Pierre Lombard qui, au milieu du 12e siècle, avait recueilli les citations d’autorités et classé les questions suscitées par la lectio, suscitant par là même une multitude de sujets possibles de discussion. Tertio, l’assimilation par le monde universitaire de la logique aristotélicienne qui, en réglant la démonstration et en dévoilant les figures du sophisme, permettait une pratique mieux réglée – et dès lors plus vivante et stimulante – de la discussion.
Retenons, pour conclure ces rappels historiques, la définition de la question disputée proposée par B. Bazàn : elle est « une forme régulière d’enseignement, d’apprentissage et de recherche, présidée par le maître, caractérisée par une méthode dialectique qui consiste à apporter et à examiner des arguments de raison et d’autorité qui s’opposent autour d’un problème théorique ou pratique et qui sont fournis par les participants, et où le maître doit parvenir à une solution doctrinale par un acte de détermination qui le confirme dans sa fonction magistrale »15.
… DE POTENTIA DEI
L’apparente absence d’unité du recueil
C’est visiblement la première question consacrée à la puissance de Dieu qui a donné son titre – Quæstiones disputatæ de potentia Dei – à l’ensemble du recueil. Le même procédé avait déjà été utilisé par Thomas pour les questions De veritate. La synecdoque ne doit pas surprendre dans la mesure où l’ouvrage réunit des textes certes très élaborés, mais écrits à l’occasion d’exercices ponctuels. Dès que Thomas avait en main un ensemble cohérent de questions, il les publiait sous forme de recueil et il lui fallait bien à ce moment trouver un titre distinctif. Vue sous cet angle, la question de l’unité du De potentia semble donc être un faux problème. Certains catalogues anciens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en soulignant son caractère composite : De potentia Dei et ultra ou encore De potentia Dei cum annexis16.
Il n’est pas interdit pour autant de rechercher un certain ordre dans cette collection de 10 questions disputées. Comme on peut le voir par leur seul intitulé, cinq ensembles thématiques se dégagent :
15 BAZAN, « Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie », p. 40. 16 Cf. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, p. 198-199.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 12 -
a) Q. 1 : la puissance de Dieu prise absolument. Q. 2 : la puissance générative dans la divinité.
b) Q. 3 : La création, qui est le premier effet de la puissance divine. Q. 4 : La création de la matière dépourvue de forme.
c) Q. 5 : La conservation des choses dans l’être par Dieu. Q. 6 : les miracles.
d) Q. 7 : La simplicité de l’essence divine.
e) Q. 8 : ce que l’on dit de manière relative au sujet de Dieu dans son éternité. Q. 9 : Les personnes divines. Q. 10 : Les processions des personnes divines.
Les ensembles b) et c) peuvent sans crainte être regroupés sous le même chapeau dans la mesure où ils traitent tous les deux de l’action de Dieu dans le monde. Ils se prêtent eux-mêmes à être rattachés au groupe a) puisque Dieu crée et conserve les êtres par sa puissance. On voit mal en revanche quel pourrait être le principe d’unité avec les ensembles d) et e), traitant l’un de la simplicité divine, et l’autre de questions trinitaires. En revanche, si l’on a en tête le plan de la Prima pars de la Somme de théologie, le choix des thèmes apparaît plus clairement. Comme le montre la figure 3, toutes les questions De potentia trouvent leur équivalent dans la première partie de la Somme. Il n’est pas inutile de noter que les deux autres questions disputées datant de la même époque, la question De anima et la question De spiritualibus creaturis, abordent elles aussi des thèmes spécifiques de la Prima pars. Cela ne signifie pas nécessairement que le choix des thèmes des questions disputées ait été fait en fonction de la rédaction à venir de la Somme, mais au moins que Thomas privilégiait une certaine cohérence dans les domaines qu’il abordait. En 1926, le P. Synave n’affirmait pas autre chose : « Il ne faut pas se méprendre sur le titre général qui a été attribué à chaque grande classe de questions disputées : ce titre a été emprunté à la première question et couvre en réalité des disputes dont les groupes (questions particulières) se rapportent à des sujets parfois divers, comme dans le De Potentia »17.
17 P. SYNAVE, « Le problème chronologique des questions disputées de s. Thomas d'Aquin », Revue Thomiste, nouvelle série 9 (1926), p. 154-159 [p. 155-156].
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 13 -
Un principe unificateur ?
En 1931, le P. Maurice Bouyges se déclarait cependant insatisfait de cette explication a minima. Dès lors en effet que le Maître avait le choix des sujets qu’il disputait et qu’il lui revenait aussi d’ordonner ces questions entre elles au moment de la publication, il n’était pas déraisonnable de chercher au moins un principe unificateur à l’ensemble. Après analyse, le P. Bouyges proposait ainsi de voir dans le De potentia la réplique de Thomas à l’émanationnisme d’Avicenne. La thèse, qui est marquée par les débats entre spécialistes de la philosophie médiévale de l’époque autour de « l’avicennisme latin », met en évidence un trait commun à l’ensemble de notre ouvrage : les q. 2-6 comme les q. 7-10 traitent de l’origine de tout ce qui vient d’un autre. Contre Avicenne, qui faisait tout dériver de l’essence divine – émanationnisme univoque –, Thomas aurait donc, selon le P. Bouyges, opposé une distinction nette entre deux types de productions : d’un côté sont les productions divines ad extra – la création – et de l’autre les productions ad intra – génération du Fils et procession de
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 14 -
l’Esprit Saint. Il faudrait donc lire dans le De potentia une réaffirmation de la foi catholique concernant la création et la transcendance du mystère trinitaire par rapport au monde.
Dans deux articles de 1948, Beatrice Zedler abondait dans le sens du P. Bouyges par une étude plus approfondie des références à Avicenne dans le De potentia18. Elle relevait ainsi presque 70 passages couvrant l’ensemble des questions disputées sauf les questions 2 et 8, dans lesquels Thomas mettait en contraste l’émanationnisme et la doctrine chrétienne19. Elle identifiait aussi plusieurs articles directement liés à l’avicennisme : Dieu peut-il faire autre chose que ce qu’il fait et défaire ce qu’il a fait (q. 1, a. 5) ? Le monde a-t-il toujours existé (q. 3, a. 17) ? La puissance de créer ou l’acte de création sont-ils communicables à une créature (q. 3, a. 4) ? Les choses procèdent-elles de Dieu par une nécessité de nature ou par un décret de sa volonté (q. 3, a. 15) ? D’un premier, peut-il procéder une multitude (q. 3, a. 16) ? Enfin, elle répertoriait les citations explicites d’Avicenne, peu nombreuses, mais réparties dans les proportions suivantes : q. 2, 2 citations ; q. 3, 13 citations ; q. 5, 6 citations ; q. 6, 1 citation ; q. 7, 5 citations ; q. 9, 2 citations20.
Comme on le décèle rapidement, la faiblesse de la thèse de M. Bouyges et B. Zedler est qu’elle semble expliquer beaucoup mieux le contenu de la question 3 (sur la création) que celui du reste de l’œuvre. Si Thomas avait eu constamment Avicenne dans sa visée, nous aurions dû trouver dans les autres questions à peu près autant de citations et de références que dans la question 3, ce qui n’est pas le cas.
Si l’on fait abstraction de cet aspect anti-avicennien, qui ne convainc pas, il reste cependant une remarque fort judicieuse qu’il convient de creuser quelque peu : le De potentia aurait pour principe unificateur de s’intéresser à l’origine de tout ce qui vient d’un autre. L’idée a été reprise en passant par R. Barron21, mais il s’agit d’une exception. A titre d’exemple révélateur, le récent éditeur italien des questions, A. Campodonico, conclut son analyse de la manière suivante : « En l’état actuel des recherches, il semble que l’on doive affirmer que, autant l’unité des six premières questions est fort probable, autant l’unité des autres questions avec l’ensemble du texte apparaît moins 18 BEATRICE H. ZEDLER, « The Inner Unity of the De Potentia », The Modern Schoolman, 25 (1948), p. 91-106 ; BEATRICE H. ZEDLER, « Saint Thomas and Avicenna in the De Potentia Dei », Traditio, 6 (1948), p. 105-159. 19 ZEDLER, « Saint Thomas and Avicenna in the De Potentia Dei », p. 109, note 29. 20 Ibid. 21 ROBERT E. BARRON, A Study of the De Potentia of Thomas Aquinas in Light of the Dogmatik of Paul Tillich, San Francisco, Mellen Research University Press, 1993, spécialement p. 284 : « The dominant themes are Trinity and creation. In this disputed question, Thomas is interested, in short, in the internal and external emanations from the divine being, the acts by which God produces that which is aliud (other) ».
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 15 -
évidente. Et puisque la septième question offre des éléments utiles pour clarifier le sujet central de la relation entre Dieu et le monde, on a décidé de l’inclure dans cette édition, en laissant pour le moment de côté les dernières trois questions… »22.
Questions sur les questions
Pour quelles raisons l’hypothèse d’un recueil disparate tournant autour de deux grands thèmes – la puissance divine et la Trinité – a-t-elle été jusqu’à présent privilégiée par les spécialistes de saint Thomas ? La réponse obvie réside dans le fait que l’origine de notre ouvrage – les disputes quotidiennes animées par Thomas dans son studium romain – rend vraisemblable une dispersion des sujets ou, plus exactement, une pluralité de thèmes abordés : le Maître décidait de passer un mois sur tel sujet touchant à ses préoccupations du moment, puis le mois suivant sur un autre sujet, et ainsi de suite. Cette explication n’en est pourtant pas une : elle fait peser une présomption de disparité, mais elle ne nous fournit aucune bonne raison expliquant la structure concrète du De potentia. Pourquoi Thomas durant l’année 1265-1266 a-t-il traité de la puissance divine puis de questions trinitaires ?
Une réponse possible consisterait à lier le choix des questions à la mise en chantier concomitante de la Prima pars de la Somme de théologie. A la vérité, elle soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout. La Somme n’a pas pu donner son plan au De potentia dans la mesure où, comme le montre la figure 3, les blocs consacrés à la création et à la Trinité sont intervertis, la simplicité divine quitte sa place médiane pour apparaître au porche de la sacra doctrina, et la puissance vient se placer à la suite de la volonté, comme perfection opérative23. En second lieu, deux développements particulièrement importants d’un point de vue matériel ne connaissent, l’un quasiment pas, et l’autre pas du tout, d’équivalent dans la Somme. Il s’agit d’une part de la question 4, consacrée à la matière informe, et d’autre part des articles 5 à 10 de la question 5 traitant en détail des conséquences de la défaillance et de la fin du mouvement céleste. Il est vrai que Thomas n’était pas contraint de reprendre tout son matériau des questions disputées dans la Somme, mais cela suggère à tout le moins que le De potentia n’est pas intégralement dépendant de la rédaction de la Somme. En troisième lieu, et de manière plus significative, l’angle d’approche des questions De potentia s’avère être sensiblement différent de celui de la Somme. Essayons de préciser ce dernier point en survolant rapidement nos dix questions.
22 A. CAMPODONICO, « Introduzione », dans Tommaso d'Aquino. La Potenza di Dio. Questiones disputatae de potentia Dei, I-III, Florence, Nardini, 1991, p. 7-26, p. 14. 23 On pourrait suggérer que Thomas ait disputé les questions dans l’ordre de la Prima pars, afin de préparer la rédaction de cette dernière, puis aurait totalement refondu l’ensemble au moment de leur publication. Cette hypothèse, très improbable comme on va s’en rendre compte, rend plus évidente encore l’existence d’un principe unificateur du De potentia.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 16 -
Un angle d’approche original
A) LA PUISSANCE DE DIEU (q. 1).
La première question est sans nul doute la question la plus proche par sa structure et son contenu de la Somme de théologie. Thomas y met au point une doctrine très élaborée de la puissance divine, à la fois comme principe d’opération et principe des effets – ou termes – produits par l’opération (a. 1). Selon le premier aspect, le concept de puissance nous permet de signifier la pure actualité24 de l’essence divine au sens où elle est principe d’opération. En nous servant du terme de puissance, nous cherchons ainsi à exprimer la richesse de la perfection divine, notamment en ce qu’elle inclut l’idée d’une communication de soi. Selon le second aspect en revanche, c’est la relation qui est mise en avant : relation entre Dieu et les créatures que Dieu crée par sa puissance d’une part, mais aussi et d’abord relation entre les personnes divines (Fils et Esprit) qui procèdent par la puissance de leur Auteur. On le voit, le thème de la puissance divine plonge profondément dans le mystère de Dieu, il englobe plus que les seuls rapports entre Dieu et le monde puisqu’il permet d’esquisser comme une théologie de l’acte en reliant les actions divines – ad extra et ad intra – à leur source dans l’actualité pure de l’essence divine. Cette théologie de l’acte permet notamment de préciser ce que le christianisme confesse en affirmant la toute-puissance de Dieu (a. 7) : Dieu est dit Tout-puissant non du fait que sa puissance est infinie ou parfaite, mais parce que tout est dans sa main. Le passage d’une perspective comparative (« le plus puissant », sommet de la perfection analogique de puissance) à une perspective totalisante (« Tout-puissant ») est d’une importance capitale pour la théologie chrétienne, comme le montrent les questions suivantes. Est en jeu en effet non seulement la transcendance de Dieu mais aussi la transcendance de ses actions : l’agir divin porte en lui le mystère même de la divinité. Ceci est évidemment vrai des productions en Dieu du Fils et de l’Esprit qui, bien que recevant l’essence divine d’un autre, sont pourtant parfaitement consubstantiels à leur principe. Mais, plus encore, c’est à la lumière de cette production divine ad intra que seront, dans un second temps, envisagées les productions ad extra. D’où résulte un premier embranchement dans notre ouvrage entre la puissance comme principe des actes ad intra (q. 2) et la puissance comme principe des actes ad extra (q. 3-6).
24 Comme Thomas l’explique dans le respondeo du premier article, le terme ‘acte’ désignant au départ une perfection opérative (le soleil agit en éclairant et chauffant) en est venu à désigner aussi une perfection entitative (le soleil possède en lui-même ce qu’il dispense autour de lui, il est chaleur et lumière d’une manière actuelle avant d’agir). ‘L’actualité’ désigne donc cette perfection première d’être en acte, qui conditionne la capacité de produire un acte, appelé acte second.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 17 -
B) LA PUISSANCE GENERATIVE (q. 2) 25.
Thomas commence, on vient de comprendre pourquoi, par se pencher sur les productions en Dieu, à partir du cas de la génération du Fils. La puissance, appelée alors générative, exprime la perfection de cette opération divine ad intra : en engendrant le Fils, le Père communique totalement l’essence divine qu’Il est ; cette communication est réelle, et cependant elle se réalise dans une pure immanence, sans atteinte à l’unité numérique de l’essence divine. Autrement dit, Dieu est tel que le Père peut engendrer un Fils à la fois unique et consubstantiel. Cette réflexion sur ce que nous signifions lorsque nous confessons la foi catholique en un Fils engendré et un Esprit qui procède s’avère une étape décisive dans la maturation de la théologie trinitaire de saint Thomas, notamment en ce qui concerne sa dimension résolument personnaliste : les personnes divines sont à la fois le sommet de notre contemplation trinitaire et la source de l’économie trinitaire. Le rapport entre la procession du Fils et de l’Esprit d’une part, et la production des créatures d’autre part en ressort éclairci tant du point de vue de l’agir divin que du point de vue de ce qui est produit. (1) Du point de vue de l’agir divin, c’est bien la même puissance divine qui est à l’œuvre, ce qui signifie que l’œuvre de la création est porteuse du même mystère divin, de la même transcendance et radicale totalité. En ce sens, la puissance d’engendrer n’est autre que la toute-puissance divine – la même qui est principe des créatures – mais elle est la toute-puissance dans le Père. De même, la puissance de spirer l’Esprit Saint est la toute-puissance divine dans le Père et le Fils (a. 5). (2) Si la toute-puissance réunit les productions ad intra et ad extra, il reste que les deux types de productions sont radicalement différents si on les envisage du point de vue de ce qui est produit : entre les personnes divines du Fils et de l’Esprit et les créatures, la distance est infinie. C’est pourquoi la puissance de créer n’est pas assimilable à la puissance d’engendrer ou de spirer (a. 6).
En d’autres termes, l’étude de la puissance divine montre que le mystère transcendant de Dieu possède trois dimensions complémentaires : 1. l’actualité pure de l’essence divine dans sa dimension de perfection intensive signifiée par la puissance ; 2. la communication parfaite de l’essence en Dieu en raison de la perfection de la puissance divine ; 3. le don d’une actualité dans l’être à d’autres réalités hors de Dieu par la puissance divine. On notera que Thomas façonne explicitement la Prima pars de la Somme de théologie sur cette structure : le mystère de Dieu comprend non seulement le mystère de son Unité et de la Trinité des personnes, mais aussi celui de la production des créatures. Ce rappel n’est pas inutile : la doctrine chrétienne de la création n’est pas une réflexion métaphysique sur une
25 Sur cette question comme sur la précédente, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : EMMANUEL PERRIER, La fécondité en Dieu. La puissance notionnelle dans la Trinité selon saint Thomas d’Aquin, « Bibliothèque de la Revue Thomiste », Parole et Silence, Paris, à paraître, spécialement le chapitre II.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 18 -
production comme nous en connaissons par l’expérience26. Parce que la Révélation nous a manifesté que le Fils et l’Esprit sont produits en Dieu, l’œuvre que Dieu a produite hors de Lui-même nous apparaît comme enracinée beaucoup plus profondément que ce que nous aurions naturellement pensé. Dieu n’agit pas hors de Lui-même par une autre puissance que celle qu’Il possède en raison de la pure actualité de son essence. La création est une action de Dieu possédant la même transcendance que Dieu par rapport à notre monde. C’est pourquoi la condition de créature emporte de soi une dépendance radicale à l’égard de la puissance divine. C’est aussi la raison pour laquelle, malgré leur finitude, les êtres créés manifestent la puissance non seulement infinie mais d’abord transcendante de leur Créateur, justement parce qu’ils sont le fruit d’une action dont seul Dieu peut être l’auteur.
C) LA PUISSANCE DIVINE ET LES CREATURES (q. 3-6).
Les précisions qui viennent d’être apportées permettent de comprendre que les questions 3 à 6 ne sont pas consacrées aux créatures mais à la création et à la conservation des choses dans l’être, c’est-à-dire aux actions par lesquelles la puissance transcendante de Dieu donne à d’autres êtres de participer aux perfections divines. On pourrait s’étonner qu’il faille consacrer autant d’articles pour traiter d’actions faciles à définir. Ce serait oublier que Thomas ne cherche pas à définir mais à montrer la portée des définitions de foi : il s’agit moins d’affirmer la création que d’en prendre la mesure, de renouveler par cette affirmation le regard que nous portons sur le monde, et de manifester dans chaque cas jusqu’à quelle profondeur, jusqu’à quelle intimité des créatures vient agir la puissance divine.
a. L’acte de création (q. 3-4)27. La spécificité de la création comme acte propre de Dieu apparaît dans les 8 premiers articles de la question 3 : comme la procession des personnes divines se distingue de nos productions mondaines par sa parfaite immanence, l’acte de créer à partir de rien – ex nihilo – (a. 1) se distingue de tous les changements que nous connaissons en ce qu’il est une production radicalement nouvelle sans rien qui la précède (a. 2), instituant la relation la plus intime entre la créature et son Créateur (a. 3). C’est pourquoi créer est une action incommunicable, propre à Dieu, œuvre de sa Sagesse et de
26 Comme le résume Thomas : « Dieu n’agit pas par une action qui serait médiane, c’est-à-dire procédant de Dieu et qui s’achèverait dans la créature : car son action c’est sa substance » (De pot., q. 7, a. 10, resp.). 27 Pour une présentation plus développée, cf. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, p. 200-212. S. C. SELNER WRIGHT, The Metaphysics of Creation in Thomas Aquinas' De potentia Dei, Washington, Catholic University of America, thèse, 1992 ; G. TORRE, « Il concetto di creazione nella Quaestio tertia De potentia Dei di San Tommaso », Aquinas, 42 (1999), p. 69-111 et 241-286.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 19 -
sa Bonté (a. 4-8). Les articles 9 à 19 peuvent être répartis en trois sections : primo, Thomas étudie le cas particulier de l’âme humaine (a. 9-12). Sa transcendance par rapport à l’ordre matériel oblige à tenir sa création immédiate par Dieu. Mais ce qui retient l’attention de notre Docteur est la manière dont cette création immédiate s’opère en composant avec une matière déjà animée et transmise par les parents. Secundo, après l’action de créer en elle-même, 5 articles sont consacrés aux effets de cette action : le commencement des créatures, leur multiplicité, l’exemplarité divine (a. 13-17). Tertio, les deux derniers articles abordent le cas particulier du moment de la création des anges (a. 18-19). La question 4, en deux articles fort développés, intègre très minutieusement à ce qui a été précédemment établi le récit biblique de la création. Thomas y synthétise les deux grands courants de l’exégèse patristique, qui se distinguent par la manière dont ils envisagent la temporalité des six jours.
b. L’acte de conservation (q. 5). La puissance divine ne s’applique pas seulement, comme ponctuellement, lors de la création : l’actualité première par laquelle une chose est et subsiste dans le temps est un don au même titre que le don premier de cette actualité. Les quatre premiers articles de la question 4 sont ainsi consacrés à montrer que les créatures ont besoin de cette présence intime et incommunicable de leur Créateur pour conserver leur être (a. 1-2), sans laquelle elles retournent au néant (a. 3-4). Les six derniers articles montrent au contraire ce qu’il adviendra de l’univers à la fin des temps (a. 5-10). Si les solutions, énoncées dans les coordonnées scientifiques de l’époque, ne possèdent plus la même pertinence aujourd’hui, elles gardent toutefois un grand intérêt pour les principes qu’elles mettent en œuvre, d’autant que Thomas ne les a nulle part ailleurs autant développées.
c. Les miracles (q. 6). Du point de vue de la puissance divine, qui occupe Thomas jusqu’à présent, les miracles se présentent comme un cas particulier d’exercice de la Providence : à la différence des ‘merveilles’, lesquelles forcent l’admiration seulement parce qu’elles ont une cause cachée de nous, les ‘miracles’, entendus au sens strict, nous surprennent parce qu’ils vont contre le cours de la nature en n’empruntant pas les voies ordinaires de la causalité (a. 1-2). Etant une action nouvelle de Dieu ad extra, ils ne relèvent pas de la conservation dans l’être, étudiée à la question précédente. Pour autant, on ne saurait les placer au même niveau de profondeur que la
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 20 -
création et la conservation dans l’être car ils ne manifestent pas la puissance divine avec la même radicalité. C’est la raison pour laquelle, à la différence des autres actions divines, ils peuvent être accomplis de manière instrumentale par des créatures, non en vertu de leur puissance naturelle – une puissance naturelle ne peut aller contre le cours de la nature – mais par un don de la grâce. Les démons en sont donc exclus (a. 3-5). Les deux sections suivantes viennent préciser cette doctrine : d’une part si les anges peuvent apparaître aux hommes sous une forme corporelle, ils ne peuvent composer avec ce corps une nature nouvelle – devenir homme – car la puissance de créer est incommunicable. Entre l’ectoplasme angélique et la nature humaine assumée par le Verbe divin, la différence est donc totale (a. 6-8). D’autre part, étant une action au-dessus de la nature, le miracle ne peut être réalisé que par une créature surélevée dans l’ordre de la grâce. C’est pourquoi les miracles accomplis par les saints doivent être attribués à leur foi. A cet égard, la magie apparaît comme un mime grotesque et dangereux de cette action dans la puissance divine (a. 9-10).
D) PUISSANCE, ACTE ET SIMPLICITE DIVINE (q. 7)
Une certaine impression de dispersion pourrait résulter du large déploiement de la doctrine de la puissance divine auquel Thomas vient de se livrer, depuis la signification première de perfection intensive de l’actualité divine (q. 1) jusqu’aux miracles que les créatures peuvent accomplir (q. 6). La présente question vient utilement rappeler que malgré toute la diversité des effets dont elle est principe, la puissance divine est bien unique : multiples sont les termes des actions divines, mais c’est toujours le même Seigneur agissant par sa puissance. De ce point de vue, la question 7 clôt un cycle entamé avec la question 1. Dans le même temps elle relance aussi la réflexion puisque nous possédons maintenant une perception beaucoup plus riche de la puissance divine que dans la première question. Comme Thomas le montre en effet dans l’article 1, l’infinie diversité des créatures n’est pas seulement compatible avec la simplicité divine, elle conduit à affirmer cette simplicité divine : la multiplicité des êtres composés d’acte et de puissance oblige à poser un Être sans aucune composition, premier parce que pur Acte, et cause première de tout en raison même de cette actualité. C’est même cela qu’est la « substance » de Dieu : « il faut bien que ce qu’est l’être (esse) soit la substance ou la nature de Dieu » (a. 2)28.
28 On savourera l’usage poétique du mot « substance » puisque Dieu n’appartient à aucun genre, aucune catégorie de l’être (cf. a. 3).
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 21 -
Dans une seconde partie de cette question (a. 4-7), Thomas tire les conséquences de ce qui vient d’être dit du point de vue de notre langage sur Dieu : quand nous disons que Dieu est « bon, sage, juste », nous n’énonçons pas seulement des qualités comme nous le ferions d’une personne connue. Il n’y a pas en Dieu de qualité car Dieu est simple. La bonté, la sagesse ou la justice que nous Lui attribuons désignent par conséquent la « substance » même de Dieu, qui est Bonté, Sagesse et Justice. Ces noms et ceux du même ordre signifient la substance divine, non en la définissant car on ne comprend pas Dieu, mais en exprimant quelque chose de son mystère. Autrement dit, de même que les œuvres que Dieu accomplit par sa puissance nous conduisent à affirmer sa simplicité, de même les mots que nous tirons de notre vocabulaire pour désigner Dieu cherchent à exprimer son mystère d’infinie simplicité. Dieu n’est pas simple au sens où nous pouvons avoir une idée simple. Au contraire, parce que Dieu est pur Acte, toute perfection que nous trouvons dans notre monde vient se fondre dans la simplicité divine.
La troisième partie de notre question tire profit des deux précédentes et nous offre un dernier prolongement du thème de la simplicité (a. 8-11), le plus important pour ce qui va suivre. Les actions que Dieu accomplit par sa puissance sont le fondement de relations. Pour les créatures, cette relation s’enracine à l’origine de leur être, elle est une présence constante de Dieu à l’intime d’elles-mêmes qui les relie à leur source : Deus intimior intimo meo. Elle est donc une relation réelle par laquelle les créatures sont ordonnées à Dieu comme leur principe et leur fin. Du point de vue de Dieu en revanche, la relation à l’égard de la créature est une relation de raison et non une relation réelle dans la mesure où elle n’ajoute rien à Dieu : Dieu ne dépend pas de sa créature, Il n’a pas besoin d’elle comme si la perfection divine pouvait en retirer quelque surcroît d’actualité. Est-ce que cela signifie que Dieu est indifférent à l’égard de sa créature ? Les détracteurs de Thomas n’ont pas manqué de s’emparer de cet argument. Un peu d’attention aurait cependant suffit à les détromper quant à la signification que revêt cette relation de raison. Du point de vue de l’action, on a vu en effet que Dieu crée et conserve dans l’être par sa puissance, laquelle est parfaitement identique avec l’essence divine. Autrement dit, pour Dieu, agir hors de Lui-même, ce n’est pas agir loin de Lui-même comme il en va pour nous mais, au contraire, être au cœur des créatures. De sorte que lorsque l’on parle de relation de raison, si l’on entend certes refuser que cette relation soit réelle – Dieu ne dépend pas des créatures, c’est l’inverse qui est vrai –, l’on entend tout autant affirmer qu’il y a de notre point de vue nécessité de parler de relation. Le paragraphe précédent nous permet de le comprendre : si Dieu est parfaitement simple, nous avons cependant besoin de plusieurs mots (Il est Bonté, Sagesse, Justice, etc.) pour exprimer cette simplicité. De même, si la relation de Dieu à l’égard des créatures n’ajoute rien à ce qu’Il est parce que Dieu est simple, nous devons cependant parler de relation parce que c’est la seule
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 22 -
manière pour nous d’exprimer que Dieu, dans sa simplicité, entretient le rapport le plus profond qui soit avec les créatures.
Acte, noms et relations, tel est le tripode soutenant cette question sur la simplicité de Dieu. Un rapide coup d’œil à la Somme de théologie suffit à voir que Thomas suit ici une approche originale, polarisée par cette théologie de l’acte dont la puissance est comme le révélateur. Située au cœur de cette théologie, la simplicité divine rayonne sur deux versants : en amont, l’étude de la puissance a permis de montrer toute la richesse des productions divines, richesse qui vient intensifier la conception que nous pouvons nous faire de la simplicité. Ainsi dilatée aux dimensions du mystère de Dieu, la simplicité nous apparaît comme le premier nom de la vie divine, c’est-à-dire de la vie intra-trinitaire. Par là même, elle nous conduit vers le versant aval du De potentia, les questions 8-10, consacrées aux processions, sommet révélé de la théologie de l’acte.
E) LES PROCESSIONS DIVINES (q. 8-10)
L’ordre et les sujets des articles des trois dernières questions du De potentia ne peuvent se comprendre qu’à partir de ce qui vient d’être dit de la simplicité divine, qui est comme la clé de voûte du De potentia. S’il avait choisi d’exposer la foi trinitaire, ou de traiter des problèmes qui surgissent au cours de cet exposé, Thomas aurait en effet repris la séquence : processions, relations, personnes, où chaque étape conditionne la suivante. Ici au contraire les processions sont rejetées en dernier, et cela mérite explication.
a. Les relations (q. 8). La transition avec les quatre derniers articles de la question 7 est évidente : après avoir étudié les relations qui résultent des actions ad extra et leur rapport avec la simplicité divine, Thomas se penche sur les relations ad intra. Ce qui justifie la répartition de l’analyse des relations sur deux questions distinctes vient de leur différence de nature : de raison à l’égard des créatures, réelles entre les personnes divines. Autant en effet l’on voit bien pourquoi des relations de raisons ne remettent pas en cause la simplicité divine, autant cela est plus difficile à concevoir avec des relations réelles : Dieu est réellement Trinité, et cependant infiniment simple. La simplicité divine, que l’étude de la puissance nous a conduit à affirmer, doit-elle donc être mitigée ou contrebalancée par l’affirmation révélée de la pluralité trinitaire ? On se doute bien que c’est à la conclusion inverse que Thomas veut justement nous mener. La présente question ne prétend pas tout régler de la difficulté, mais elle nous offre le meilleur chemin d’accès pour sa résolution. Elle vise seulement à manifester « ce qui est dit de manière relative en Dieu » et
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 23 -
à montrer que les relations réelles suffisent à distinguer et constituer les personnes divines. Pour ce qui est de la simplicité, l’Aquinate va montrer que les relations réelles en Dieu vérifient la simplicité divine autant que les relations de raison à l’égard des créatures. Dans les deux cas en effet, les relations naissent d’une action de production : par la création les créatures ont une origine en Dieu ; par la génération le Fils a une origine dans le Père. Il y a donc bien relation. En revanche, ce qui distingue la génération de la création, c’est son immanence : le Père communique au Fils la nature divine de manière parfaite, de sorte que la nature de l’engendré étant numériquement une avec la nature de son principe, la relation est réelle non seulement du côté de celui qui a une origine – le Fils – mais aussi du côté de son principe, le Père. En d’autres termes, les relations réelles ne contredisent pas la simplicité de l’essence divine car elles résultent d’une action totalement immanente qui, elle-même, ne remet pas en cause la simplicité divine (a. 1). Mais pour autant, dira-t-on, elles sont bien quelque chose, elles possèdent un être. Certes, mais cet être ne saurait être accidentel : la relation n’est pas dite relativement à l’essence divine parce qu’elle ne la divise pas ni ne compose avec elle ; la relation est l’essence divine, elle s’identifie à la substance divine (a. 2). C’est selon ces deux dimensions – résultant d’une origine, s’identifiant à la substance divine – que les relations constituent et distinguent les personnes divines (a. 3-4). Rétrospectivement, la question sur les relations apparaît bien comme la meilleure introduction dans le mystère trinitaire lorsque l’on prend la simplicité comme point de départ. C’est en effet par la relation que l’on manifeste autant qu’il est possible l’absolue simplicité de la Trinité puisque, comme on l’a vu, la relation distingue les personnes et les constitue comme subsistant dans l’essence divine. Autrement dit, c’est parce qu’elles sont des relations que les trois personnes sont simples.
b. Les personnes (q. 9). La question soulevée à propos des relations se trouve donc reportée sur les personnes : la pluralité des personnes en Dieu contrevient-elle à la simplicité divine (a. 5-9) ? Répondre présuppose un travail sur la notion même de personne (a. 1-4). Thomas va ainsi montrer que le terme ‘personne’, lorsqu’il est précisément défini (a. 1-2) peut être attribué à Dieu de manière convenante : « la personne signifie une certaine nature avec un certain mode d’existence » ; or la nature divine est la plus digne des natures, et le mode d’existence par soi de la personne est aussi le plus digne (a. 3). De manière générale, la personne signifie « une substance
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 24 -
individuelle de nature rationnelle » ; en Dieu, la personne divine ne signifie pas directement et absolument la nature divine, mais elle « signifie un subsistant distinct dans la nature divine », dont la distinction vient de la relation (a. 4). C’est pourquoi « le nombre des relations est le nombre des réalités subsistantes dans la nature divine », de sorte que l’on peut vraiment parler de plusieurs personnes en Dieu (a. 5-6). Ces développements permettent à l’Aquinate de préciser le statut tout à fait particulier de notre manière de signifier ce qui est un et ce qui est multiple en Dieu. Il ne s’agit à aucun moment d’une quantité : ce que nous disons ‘un’, c’est l’Être même de Dieu en qui ne se trouve aucune division ; et lorsque nous parlons de ‘plusieurs’ (personnes, en l’occurrence) nous signifions seulement la distinction et la subsistance (a. 7). En d’autres termes, en Dieu, le multiple n’implique aucune diversité : « contre la diversité, nous confessons l’unité de l’essence ; contre la division, la simplicité ; contre la disparité, l’égalité ; contre l’étrangeté, la similitude ; contre la singularité des personnes, leur pluralité ; contre la confusion, une distinction discernable (discretio) ; contre l’isolement, l’harmonie et le lien de l’amour » (a. 8). Toute une nouvelle gamme terminologique vient ainsi enrichir le sens de la simplicité divine. Le neuvième et dernier article vient consacrer le travail jusque là accompli. Saint Thomas y cherche en effet des appuis rationnels à la révélation trinitaire du nombre des personnes divines. La question pourrait paraître saugrenue dès lors que ce nombre est révélé mais c’est l’inverse qui est vrai : si Dieu nous a révélé son mystère, il faut bien que cette révélation possède pour nous une signification, non pour démontrer le mystère, mais pour approfondir notre connaissance de Dieu. En l’occurrence, les raisons de convenance que l’on donne à l’existence de trois personnes en Dieu révèlent l’idée que l’on se fait de la simplicité divine, c’est-à-dire de l’harmonisation de la révélation trinitaire au sein de la révélation monothéiste. Arius par exemple, parce qu’il ne parvenait pas à penser une autre production divine que la création, plaçait le Fils et l’Esprit du côté des créatures. Mais à ce compte, il devenait incapable d’expliquer qu’il y a seulement le Fils et l’Esprit : la puissance divine, qui est infinie, n’a aucune raison de s’arrêter à deux productions. Autre exemple : si l’on disait que le Fils et l’Esprit procèdent par mode d’intellect et de volonté, dès lors que l’intellect et la volonté ne sont distincts en Dieu que d’une distinction de raison, on deviendrait incapable de rendre raison de la distinction réelle des deux personnes du Fils et de l’Esprit. Saint Thomas présente ainsi une liste de 5 ‘explications’ insuffisantes, puis de 6
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 25 -
‘explications’ traditionnelles avant d’exposer ce qu’il considère comme la meilleure proposition : la procession des personnes dans la nature divine ne peut se réaliser que par des opérations immanentes. Or, nous ne disposons que d’une seule analogie de telles opérations : chez les natures intellectuelles comme la nature humaine, l’intelligence conçoit un verbe et la volonté se parfait par l’amour. En Dieu, les termes des processions, le Verbe et l’Amour, sont uniques et subsistants, et procèdent selon un ordre allant de l’intellect à la volonté. Par l’analogie des productions intellectuelles, Thomas parvient donc à rendre compte de l’immanence, de la pluralité, de la trinité, de la subsistance, et de l’ordre des processions (a. 9). C’est donc à l’étude des processions en Dieu qu’il consacrera la question suivante.
c. Les processions (q. 10). Annoncé par le dernier article de la question 9, le thème de cette ultime question nous ramène à la théologie de l’acte dont nous avons vu qu’elle imprègne tout le De potentia. S’il est plus familier d’un traitement des processions préalable à celui des relations, Thomas s’explique sur le plan inhabituel qu’il suit ici dans le sed contra de l’article 3 : selon notre manière d’entrer dans une saisie du mystère, les relations distinguent et constituent les personnes et doivent donc être étudiées avant ces dernières ; en revanche, les personnes viennent antérieurement aux actions personnelles, car les processions sont en quelque sorte des actions des personnes29. En d’autres termes, ce qui guide Thomas est le souci de pouvoir envisager les actions divines pour elles-mêmes et non seulement comme prolégomènes à la découverte des personnes. L’article 1 confirme cette perspective en l’étendant à l’ensemble des productions divines : nous attribuons à Dieu deux types d’opération, les unes transitives – création, conservation, gouvernement – et les autres immanentes – génération et procession. Si les premières sont la raison
29 Thomas précise ce point dans le respondeo en rappelant la double nature de la relation, selon qu’on envisage sa raison formelle – un rapport à autrui – ou selon qu’on envisage son être – accidentel pour nous, essentiel en Dieu – : du point de vue de notre connaissance, parce qu’elles fondent les relations, les processions viennent nécessairement avant les relations en tant que les relations distinguent les personnes (raison formelle) ; mais les processions sont elles-mêmes postérieures à la constitution de la personne du Père par la relation de paternité en tant que cette dernière, étant une relation divine, s’identifie à l’essence divine (être de la relation) : le Père engendre parce qu’il est Père (la personne agente précède l’action notionnelle). A l’inverse, le Fils et l’Esprit nous sont connus après les processions : le Fils est Fils parce qu’il est engendré (la personne est le terme de la procession). La même solution s’applique pour l’Esprit. On retrouve ici des formules très proches de la patristique grecque.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 26 -
des perfections que l’on trouve chez les créatures, les secondes nous manifestent la perfection divine. Les deux actes d’intelligence et de volonté notamment, qui donnent lieu aux processions du Verbe et de l’Amour, nous conduisent à reconnaître que Dieu est vivant. Le parallélisme des deux types de procession doit être souligné autant pour le rapprochement qu’il permet que pour la différence qu’il souligne : dans l’opération transitive « nous disons que la sagesse et la bonté divine procèdent dans les créatures » ; dans l’opération immanente, « nous parlons de la procession dans la divinité du verbe et de l’amour ». Ce point établi, Thomas peut se consacrer aux productions immanentes. D’abord en rappelant que seule l’analogie du verbe et de l’amour peut rendre compte de la distinction et de l’ordre des processions (a. 2). Puis en étudiant minutieusement la question de la procession de l’Esprit (a. 4-5). Thomas y montre qu’il devient impossible de distinguer la génération de la spiration, et le Fils de l’Esprit, si ce dernier ne procède pas du premier.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 27 -
CONCLUSION
Le rapide survol auquel nous venons de nous livrer n’avait pas la prétention d’analyser le contenu du De potentia mais seulement de mettre en évidence sa structure en en soulignant les grandes articulations au fil des articles (cf. figure 4). On se gardera donc d’oublier que l’ouvrage est d’abord et avant tout une collection de questions distinctes pouvant être étudiées pour elles-mêmes. Il reste qu’on y distingue nettement une unité d’ensemble de l’œuvre, et il nous semble que l’expression « théologie de l’acte » exprime bien cette unité30 : actualité première et pure de l’essence divine, qui concentre en elle toutes les perfections que nous pouvons attribuer à Dieu, et qui place la simplicité divine au premier plan ; actes immanents de la génération du Fils et de la spiration de l’Esprit qui, au plus haut point, manifestent la puissance opérative et la vie divine, et qui sont l’exemplaire de la procession des créatures ; actes transitifs de la création et de la conservation dans l’être enfin, qui donnent aux créatures de participer à la vie divine, parce qu’elles sont les fruits de sa puissance.
Il est évident qu’une telle unité d’ensemble ne peut résulter d’une reconstruction a posteriori à partir de questions disputées sans ordre. Est-il infondé de penser que Thomas en ait formé le dessein au moment de commencer son année universitaire et non au moment de la publication ? Dès lors que les questions disputées étaient un acte quotidien ou quasi-quotidien d’enseignement et que – condition que Thomas n’avait pas connue auparavant – les participants étaient les mêmes étudiants dominicains durant toute l’année, il ne serait pas surprenant que cet exercice essentiellement ponctuel ait été pensé à partir d’une trame d’ensemble fixée dans la perspective d’une année d’enseignement. Les transitions entre les questions grâce à des articles faisant office de suture trahissent en tout cas une continuité d’intention.
Etudié sous cet angle, le De potentia acquiert une véritable consistance comme œuvre et affirme son autonomie, notamment à l’égard de la Somme. S’il est indéniable que la rédaction du premier a considérablement aidé Thomas dans l’élaboration de la seconde, il n’en demeure pas moins vrai que l’on aura avantage à lire celui-là pour lui-même.
30 Nous devons ici remercier le fr. Gilles Emery, qui nous a suggéré cette clé de lecture.
UNE THEOLOGIE DE L’ACTE
- 28 -
BIBLIOGRAPHIE
ROBERT E. BARRON, A Study of the De Potentia of Thomas Aquinas in Light of the Dogmatik of Paul Tillich, San Francisco, Mellen Research University Press, 1993
BERNARDO C. BAZAN, « Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie », dans Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, « Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 44-45 », Turnhout, Brepols, 1985, p. 13-149.
A. CAMPODONICO, « Introduzione », dans Tommaso d'Aquino. La Potenza di Dio. Questiones disputatae de potentia Dei, I-III, Florence, Nardini, 1991, p. 7-26.
M. MICHÈLE MULCHAHEY, « First the Bow is Bent in Study ». Dominican Education before 1350, « Studies and Texts, 132 », Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1998.
PIERRE LE CHANTRE, « Verbum Abbreviatum », dans PL 205, Migne, 1855, col. 21-554.
S. C. SELNER WRIGHT, The Metaphysics of Creation in Thomas Aquinas' De potentia Dei, Washington, Catholic University of America, thèse, 1992, ix + 276 p.
P. SYNAVE, « Le problème chronologique des questions disputées de s. Thomas d'Aquin », Revue Thomiste, nouvelle série 9 (1926), p. 154-159.
G. TORRE, « Il concetto di creazione nella Quaestio tertia De potentia Dei di San Tommaso », Aquinas, 42 (1999), p. 69-111 et 241-286.
JEAN-PIERRE TORRELL, Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa personne et son oeuvre, « Vestigia. Pensée antique et médievale, 13 », Paris-Fribourg, Cerf-Presses universitaires de Fribourg, 20022, xviii + 646 p.
F. VAN STEENBERGHEN, « Le problème de l'existence de Dieu dans les questions disputées De potentia Dei », Pensamiento, 25 (1969), p. 249-257.
G. VEZZOSI, « Azione e relazione secondo De potentia q. 8 a. 2 e alcuni testi », Angelicum, 83 (2006), p. 43-50.
———, « Semplice perchè relazionale alla luce del De potentia Dei di San Tommaso », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 53 (2006), p. 433-442.
JAMES A. WEISHEIPL, Friar Thomas D'Aquino : his life, thought, and work, Garden City, Doubleday, 1974, xii + 464 p.
BEATRICE H. ZEDLER, « The Inner Unity of the De Potentia », The Modern Schoolman, 25 (1948), p. 91-106.
———, « Saint Thomas and Avicenna in the De Potentia Dei », Traditio, 6 (1948), p. 105-159.