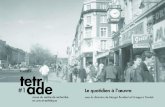Éléments pour une théorie opérationnelle de l'écriture numérique
\"Marcel Pagnol, traducteur des Bucoliques : les reconfigurations d’une image d’auteur\",...
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of \"Marcel Pagnol, traducteur des Bucoliques : les reconfigurations d’une image d’auteur\",...
Marcel Pagnol, traducteur des Bucoliques : lesreconfigurations d’une image d’auteur
Rien ne semblait moins destiné à Marcel Pagnol que le rôle de
traducteur. Toute sa carrière de cinéaste, qui a été gouvernée
par le maître-mot de l’adaptation, de son théâtre en film, a
été vilipendée au nom de son incapacité à traduire le langage
dramatique en langage cinématographique.
Pourtant, malgré ses soi-disant incompréhensions des
spécificités langagières, Marcel Pagnol se confronte à
l’exercice de la traduction à plusieurs reprises : il traduit
en 1947 Hamlet et Le Songe d’une nuit d’été, puis Les Bucoliques, en
1958. Si ces entreprises informent sur les sources de son
écriture, elles constituent pour l’auteur controversé qu’est
Marcel Pagnol un enjeu stratégique pour reconfigurer sa posture
d’écrivain. Le rôle de traducteur, qui permet de devenir un
autre tout en restant soi, influence la réception de l’auteur,
modifie son image, et le fait gagner a priori en légitimité. La
traduction virgilienne sur laquelle nous nous concentrerons
constitue un geste médiatique qui tente de déplacer, voire même
d’inverser sa réception, du marseillais galéjeur à
l’Académicien humaniste. Nous pouvons observer quatre
inversions que l’écrivain essaie de mettre en œuvre en
élaborant cette stratégie littéraire :
- D’abord, il cherche à remplacer son image d’auteur
populaire par celle du lettré conservateur, garant du
patrimoine littéraire et des humanités
- Ensuite, contre son image d’affairiste et de businessman,
il veut proposer la posture du poète désintéressé
- 3e inversion, en mettant en évidence la filiation entre le
terroir provençal et les paysages virgiliens, il cherche à
effacer la figure péjorative du régionaliste pour la
remplacer par la figure du classique
- Enfin, il veut modifier son image de moralisateur des
lettres, de Topaze de la littérature, en proposant une
causerie légère sur la traduction.
Ces quatre gestes médiatiques ne font qu’un : ils tendent tous
à être une quête de légitimité, voire une conquête du champ
littéraire et des faveurs de la critique et de l’intelligentsia
parisienne. Pourtant, nous le verrons, ce modèle de l’imitatio et
du traducteur-auteur, quelque peu obsolète, le ramène
paradoxalement à la périphérie du champ littéraire.
I) De César à Valéry
a) De l’illettrisme
« Comme j’ai fait beaucoup de cinéma, il y en a qui croient que
je n’ai pas mon certificat d’études »1. Voici ce qu’écrit
Marcel Pagnol à Pierre Brisson, le directeur du Figaro Littéraire
pour expliquer son envie de publier dans ses pages un extrait
de sa traduction des Bucoliques. Il ne peut être plus clair sur
sa stratégie auctoriale : il s’agit de contrevenir au mythe
constitué autour de sa figure de Pagnol-César ou de Pagnol-
1 Cité par Raymond Castans, Il était une fois Marcel Pagnol, France Loisir, Paris,1978.
Marius. En effet, la presse et la critique assimilent
l’écrivain à ses personnages populaires, dont le ressort
comique repose souvent sur des approximations grammaticales et
langagières. On se souvient de la scène Acte I scène XIV dans
Fanny où César fait lire la lettre de Marius à Fanny. Sans être
analphabète, le père de Marius n’arrive pas à lire le terme
« océanographique » et confond « phéniciens » et « Félicien »2.
Pagnol parsème ainsi cette scène d’émotion d’effets comiques
autour de l’illettrisme du personnage. Ce sont ces différences
intellectuelles, qui dans la théorie de Pagnol, déclenchent
« le chant de triomphe » qu’est le rire, « cette expression
d’une supériorité momentanée »3. Un interview d’Odette Lutgen
est particulièrement révélateur de cette réception de Marcel
Pagnol en illettré, ou du moins, en autodidacte :
« Que de gens prétendent que je n’ai pas faitplus d’études que Marius ». …
Envoûté que l’on est une fois de plus par lalégende de l’écrivain et de ses personnages ; despersonnages qui n’ont avec l’auteur qu’un trèsvague cousinage ; et qui, en tout cas, ne peuventpas aider à comprendre le vrai Pagnol. …
« Mais il est exact que l’on est tenté de voir envous un brillant autodidacte, qu’en fait vousn’êtes pas du tout ». …
On ne peut s’empêcher de penser au bon César,penché avec tout son sérieux habituel sur unintraduisible texte hébreu… pour faire rire. Enbref, on pense à la galéjade. 4
2 Marcel Pagnol, Fanny, dans Œuvres complètes, t. I, Éditions de Fallois,1995, p. 641.3 Marcel Pagnol, Notes sur le rire, dans Œuvres complètes, t. I, Éditions deFallois, 1995, p. 980.4 Odette Lutgen, « Rencontres avec Marcel Pagnol », Artaban, 10 janvier 1958.
Au fil de ses entretiens dans la presse, Marcel Pagnol cherche
à se libérer de cette image coincée entre les deux légendaires
personnages de Marius et de César, notamment en rappelant
qu’avant d’être auteur dramatique, il a occupé la chaire de
professeur d’anglais de Mallarmé au Lycée Condorcet. Raimu, son
acteur fétiche, lui fit peut-être ombrage, de la même façon que
ses personnages, lui, qui disait ne pas avoir besoin de jouer
ou de prétendre pour interpréter le rôle de César : « Je n’y
comprends rien, dit-il. Dans ce rôle, je dis le texte, rien de
plus, je parle comme à la maison, et tout d’un coup, c’est un
triomphe ! » 5. Si Raimu est l’interprète de sa personnalité,
Marcel Pagnol cherche à prouver par sa traduction qu’il ne
ressemble pas à ses personnages.
b) Le rival de Valéry
La posture du traducteur lui permet de renverser ce premier
cliché qui le fige en auteur populaire. Elle lui permet de se
hisser au rang d’un lettré comparable à Paul Valéry, avec
lequel Marcel Pagnol tente de rivaliser. Voici ce qu’il écrit
dans sa préface :
Et pourtant un très grand poète et qui futl’artiste le plus parfait de notre siècle, PaulValéry, a traduit les Bucoliques en vers blancs ;mais il nous a donné les raisons de ce choix. … Satraduction est, comme il fallait s’y attendre,admirable, si l’on considère chaque vers. Mais lelecteur attend sans cesse la rime, et pense àcelles dont ce grand artiste eût enrichi Virgile.
5 Marcel Pagnol, « Préface de Marius », dans Œuvres complètes, t. I, Éditionsde Fallois, 1995, p. 482.
Sa traduction en alexandrins rimés se présente ainsi comme une
réponse à la traduction valérienne. Il abandonne la contrainte
de l’auteur de La Jeune Parque de traduire un vers de Virgile par
un vers blanc français, pour y substituer la contrainte de
l’alexandrin et de la rime. Il exhibe dans cette préface
l’équivalence des contraintes métriques qu’ils se sont assignés
l’un et l’autre, soulignant une égalité de leurs deux
traductions en terme de valeur. Contre les accusations que la
critique a souvent portées contre lui, de faire une littérature
facile, Pagnol insiste sur le degré d’exigence littéraire qu’il
s’impose, pour se proposer en rival de Valéry. La presse met
sans cesse en regard les deux traductions, les compare, et les
met en concurrence. Et dans ce concours de traduction, si
proche des rivalités bucoliques, Marcel Pagnol, le
boulevardier, est souvent déclaré vainqueur. Le périodique Arts
titre par exemple son article : « En traduisant Virgile en
vers, Pagnol réussit la gageure que Valéry avait jugée
impossible »6. Et même le jeune Henri Meschonnic participe de
cette déconstruction du canon en préférant Pagnol à Valéry :
Les Bucoliques de Valéry, Les Bucoliques de M. Pagnol,- deux traductions « amébées » : je suis commePalémon et ne puis donner le prix. Une traductionest-elle faite pour accompagner l’original ou vivrede sa propre vie ? Celle de M. Pagnol se porteraitmieux que sa rivale. Elle suit le texte de moinsprès, mais elle en a mieux gardé le goût. 7
Marcel Pagnol se trouve, brutalement, intégré au monde des
lettrés, en étant comparé non seulement à Paul Valéry mais
6 D. B. « En traduisant Virgile en vers, Pagnol réussit la gageure queValéry avait jugée impossible », Arts, 7 mai 1958. 7 Henri Meschonnic, « Notes de lecture », Europe, Juillet-Août 1958.
aussi à Jean Giono8, à Anatole France9 ou à Francis Jammes10. Les
Bucoliques semblent avoir, temporairement du moins, reconfiguré,
comme l’espérait Marcel Pagnol, sa place dans le monde
intellectuel. Une lettre de Jean Paulhan en témoigne : il y
fait l’éloge de la « sagesse » et de la « liberté »11 de sa
traduction et ajoute que « l’ouvrage regorge d’informations, de
notes et de commentaires pertinents, malicieux, et d’une
parfaite érudition »12. De l’illettré, Marcel Pagnol est ainsi
propulsé au rang d’humaniste, spécialiste de langues anciennes
et érudit. Le terme « humaniste » revient sans cesse sous la
plume des journalistes qui soulèvent par le terme la question
d’actualité : l’enseignement du latin et des Humanités.
c) Les paradoxes du conservatisme
Cette posture, si elle lui permet d’acquérir temporairement une
légitimité littéraire, ne va pas sans contradiction,
puisqu’elle lui confère une figure de réactionnaire de la
littérature, à contre-temps de la modernité. La posture
humaniste du traducteur, pratiquant pour ses ouvrages l’imitatio
en bon classique, paraît, à certains égards, surannée et inapte
à conquérir véritablement le champ littéraire. Les critères de
8 B. A. Taladoire, , « traductions de Virgile », Cahiers du Sud, n°349, 1958 :« on sent chez Pagnol comme chez son modèle la nostalgie d’un citadindéraciné plus qu’à demi, peut-être aussi avec le recul, malgré la renomméeacquise, le regret de n’avoir pas choisi le chemin de Giono ».9 André Berry, « Un académicien prodige », Combat, 9 juin 1958 : « Ce n’estpas de moins qu’Anatole France qu’il faudrait le rapprocher ».10 Emile Bouvier, « Georgiques », Midi-Libre, 9 juillet 1958. 11 Lettre citée dans Raymond Castans, Il était une fois Marcel Pagnol, France Loisir,Paris, 1978.12 Lettre citée dans Jean-Jacques Jelot-Blanc, Pagnol inconnu, Flammarion2011, p. 462.
canonisation ne se définissent non plus à l’aune de la
conformité avec les Anciens mais, à l’aune de l’anti-
conformisme. Plusieurs articles à la sortie de sa traduction
souligne le caractère anachronique de l’ouvrage, qui, je cite,
« nous repose de la trépidation actuelle »13. Un journaliste
qualifie Marcel Pagnol d’ « humaniste attardé en notre âge
atomique »14. C’est cet anachronisme qui est tourné en dérision
dans une caricature signée Fousi publiée dans Le Figaro qui
présente Marcel Pagnol en pâtre à la flûte de Pan, vêtu d’une
peau de bête et de spartiates, assis sur une colonne près des
ruines d’un temple15. Ce conservatisme littéraire reste
néanmoins axiologiquement ambigu puisqu’il permet à Pagnol de
subsumer le circonstanciel et de se démarquer d’une époque.
Roger Margerit fait l’éloge du choix pagnolien :
Il semble qu’à notre époque dévorée par lavitesse et l’utilitarisme au temps de la fissionatomique et des spoutniks, rien ne puis être plusétranger à nos préoccupations que la poésie latine.Bon pour Louis XVIII de charmer ses loisirs avecHorace ! Qui donc, aujourd’hui, quand nous avons àdomicile les modernes, les faciles plaisirs de laradio, de la télévision, des romans policiers – quidonc aurait l’idée saugrenue de retourner vers cesvieilles lunes : Virgile et ses bergers ! … Foupour préférer le travail gratuit à l’ouvrage quipaye, en argent et en célébrité, fou, pour perdreson temps à traduire, quand on est soi mêmecréateur. Fou comme ne peut qu’être un latiniste.Merveilleusement fou comme le sont, heureusement,des milliers de bons esprits capables de préférerl’inutile au profit matériel, le pur plaisir aux
13 A. de Parvilez, Livres et Lectures, Juin 1958, p. 361. 14 E. P. « Virgile », Écrits de Paris, Septembre 1958.15 Anonyme, « Marcel Pagnol : “Moi aussi j’ai gardé les chèvres avecMénalque“ », Le Figaro, 21 mai 1958.
stratégies de l’arrivisme, l’effort auxdistractions passives. 16
Roger Margerit, si l’on parle en termes bourdieusiens, met en
évidence l’apport de la traduction des Bucoliques au capital
symbolique de Pagnol. L’intégration dans le champ littéraire se
fait bien au prix de l’abandon du capital économique, auquel,
Marcel Pagnol était, disait-on, asservi. Son succès dramatique
et cinématographique a une influence sur la réception négative
qui le limite à l’image d’un homme d’affaires des lettres et
des arts. Loin d’être une « folie », la publication de la
traduction est bien une stratégie auctoriale que Marcel Pagnol
a rationalisée. Une anecdote que le traducteur raconte dans
l’émission « Voyons un peu » met en évidence les motivations de
cette publication :
- Quelle est la réaction de votre fils qui a unedouzaine d’années lorsqu’ il voit son père traduireVirgile et parler latin ?
- Cela l’a un peu intrigué. Pendant que jetraduisais la dizaine églogue à la campagne, il estvenu et il m’a dit : « viens jouer avec moi ». Jelui ai dit « Je ne peux pas. Je travaille ». « Tutraduis encore ces Bucoliques ? ». Je lui aidit : « oui ». Il m’a dit « qu’est ce que ça va terapporter ? ». Je lui ai dit : « rien ». Il m’adit : « Au fond, tu fais cela pour te faireremarquer ». Et je me demande s’il n’a pas raison.17
Même s’il ne conceptualise pas précisément l’impact médiatique
qu’il entend avoir avec cette publication, Marcel Pagnol
souligne bien le caractère désintéressé de son geste, qui,
16 Roger Margerit, « Du côté de Virgile », Le Populaire du centre, 10 mai 1958. 17 André Parinaud, « Interview de Marcel Pagnol », dans Voyons un peu,Radiodiffusion télévision française, 30 avril 1958. Disponible en ligne :http://www.ina.fr/video/CPF86642784, consulté le 2 juin 2015.
précisément, lui vaut d’être « remarqué » et de se démarquer du
cliché du business-man. Dans cette émission, il est visible que
l’écrivain construit une image de stabilité : il est installé à
sa table de travail, il est entouré d’une part par une
bibliothèque de livres richement reliés et de l’autre par un
tableau ou une tapisserie figurative. Il multiplie les signes
qui le présentent en intellectuel lettré conservateur : il est
installé à un bureau de style Louis XV, il est entouré par des
livres et des œuvres d’art anciennes. Son costume et son
maintien traduisent l’honorabilité du personnage. L’interview
qui finit sur la réaction du fils renvoie Pagnol à son statut
de père, qui est un passeur pour les générations futures. Ses
propos politiques sur le maintien du latin vont de pair avec
cette incarnation qu’il propose de la tradition :
A. P. : Aujourd’hui on dit couramment qu’àl’époque atomique le latin est une triste chosebien inutile pour les études. Qu’en pensez-vous ?
M. P. : Je trouve cela tout à fait absurde. Ilserait très dangereux de supprimer que l’onappelait autrefois en somme les Humanités. Pour lesremplacer par quoi ? Par les sciences. Mais lelatin ne gêne guère pour apprendre la science. Etde mon temps, il y avait deux sections de science :il y avait la section D où l’on ne faisait que dessciences et il y avait la section C où l’on faisaitle latin-science. Et j’ai vu par la suite que tousmes camarades qui étaient en latin-science sontpassés devant ceux qui n’avaient pas fait de latin.D’ailleurs, il me semble qu’il y a dans la vie deuxsortes de gens dans ceux que je fréquente. Il y aceux qui savent le latin et ceux qui ne le saventpas.
A. P. : Qu’est-ce que vous voulez direexactement ? Croyez-vous que les études latinesdonnent une vision du monde plus large ?
M. P. : Plus large et surtout plus humaine. Ce nesont pas pour rien qu’on les appelait les
Humanités. Le latin, c’est la base de la culturegénérale, surtout pour nous autres, latins. Et jecrois que ce qui a fait la supériorité et le renomau point de vue artistique de l’Italie, de laFrance, et de l’Espagne c’est parce que ce sont despeuples latins. On connaissait le latin beaucoupmieux autrefois grâce à l’énorme influence del’Église.
A. P. : C’est-à-dire que si je vous comprendsbien, en supposant que l’on réduise les heures delatin, vous croyez que l’esprit même de notrecivilisation basculera ?
M. P. : Mais sans aucun doute. Et on ira de plusen plus alors vers la spécialisation. Et on finirapar dire, puisqu’on parle toujours du point de vueutilitaire : « À quoi bon apprendre l’optique et laphysique à un garçon qui veut faire del’électricité ? ». Il finira par connaître un seulchapitre de la Physique. Et on dira qu’il leconnaîtra à fond. Précisément, non, je ne croispas, parce qu’il le ne comprendra pas le rapport dece chapitre avec tout le reste de la science.
Ce discours conservateur, qui voit dans la modernité une fin du
monde, conforte son image de garant du patrimoine littéraire et
des fondements de la culture française. Pourfendeur de la
spécialisation et de l’utilitarisme, il renforce sa posture
d’humaniste et de lettré, qui se construit sur le rejet du
monde économique et du modèle capitaliste. Il concluait la fin
de la préface des Bucoliques, en se postant sur les ruines d’un
monde en perdition, qu’il tentait tant bien que mal de
maintenir en célébrant la poésie virgilienne :
Aujourd’hui le monde a chaviré, et nous sommes àcheval sur la quille du navire qui s’enfonce un peuplus chaque jour ; mais, au-dessus de ce naufrage,brillent toujours Sirius, Homère, Bételgeuse,Virgile, Montaigne, le Centaure, Ronsard, lesPléiades, la Voie lactée et Victor Hugo.
En faisant résonner l’image du poète-étoile qui guide les
navires du monde, à la façon de Chatterton de Vigny, Marcel
Pagnol s’assigne le rôle de survivant du naufrage qui rappelle
à la mémoire le souvenir de l’ancien monde. Pour autant, si
cette réaction est accueillie favorablement à la fin des années
cinquante, il n’en reste pas moins que la postérité de La Gloire
de mon père, que Pagnol présente comme une réécriture des
Bucoliques, démontre que cette posture reste insuffisante pour
fonder sa légitimité littéraire. Son autobiographie, quasiment
absente aujourd’hui des ouvrages retraçant l’histoire
littéraire du XXe siècle, ne survit pas au récit qui fait des
années cinquante et soixante les décennies de la déconstruction
romanesque initiée par le Nouveau Roman. Contre les pronostics
d’André Bay18 ou de Lucien Rebatet19 qui espéraient, tous deux,
l’oubli de Butor, Sarraute, Robbe-Grillet et Duras au profit de
Pagnol, ce n’est pas La Gloire de mon père ou Le Château de ma mère qui
ont fait date en 1958 dans l’histoire du roman.
II) De Mistral à Ménalque
La posture de traducteur des Bucoliques, si elle lui permet en
partie de se donner une image élitiste, l’aide à construire la
réception de son œuvre autobiographique : Les Bucoliques
paraissent quelques mois après la publication de La Gloire de mon
père et précèdent celle du Château de ma mère. La traduction
18 André Bay, « Avec La Gloire de mon père et Le Château de ma mère Marcel Pagnolfait œuvre d’écrivain », Arts, 17 septembre 1958. 19 Lucien Rebatet, « Les Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol », Rivarol, 13octobre 1960.
détourne l’accusation de régionalisme qui le menace et confère
une légitimité littéraire à ses ouvrages en les présentant
comme une réécriture virgilienne.
La traduction de Marcel Pagnol repose sur une
transposition : du paysage champêtre idéalisé de Virgile à une
représentation réaliste du paysage provençal. Jean Mistler met
en exergue ce glissement en titrant son article « des bergers
de Virgile aux chevriers de Marcel Pagnol »20. Ce déplacement
réécrit les Bucoliques, donne forme à une traduction qu’on peut
qualifier de « belle infidèle », quoique Pagnol s’en défende,
ce qui donne lieu aux principales attaques contre son ouvrage.
Ce qui est intéressant, c’est que ce glissement dresse une
comparaison systématique entre la Provence et le paysage
virgilien, ce qui donne ses lettres de noblesse au régional.
Sous l’égide de Virgile, le texte préfaciel qui parle de son
frère chevrier provençal prend une nouvelle résonnance : il
constitue moins un témoignage sur une époque et un folklore
révolus qu’une variation pastorale, qu’une modernisation des
thèmes virgiliens.
Il jouait de vieux petits airs, ceux deschevriers de l’Étoile, de la Sainte-Baume ou laGineste, et qui lui étaient venus du fond destemps.
Il avait aussi composé des fugues, qu’il jouaitavec les réponses de l’écho des Trois-Bergers.
Il fallait d’abord chercher la bonne distance :elle variait selon la longueur du thème proposé etla direction du vent : quand il l’avait trouvée, illançait la première phrase, et l’écho la reprenaitpendant qu’il attaquait la seconde. Ces petits
20 Jean Mistler, « Des bergers de Virgile aux chevriers de Marcel Pagnol »,L’Aurore, 27 mai 1958.
concerts étaient d’une beauté magnifique, surtoutles nuits d’été. Tout le paysage y participait : lesilence brillant des étoiles, l’odeur du thym, letintement d’une clochette, la lime d’argent d’ungrillon, et cet harmonica grêle et tendreenseignant enfin la musique à l’écho millénaire desroches bleues. 21
Les échos de cette musique toute virgilienne du poète-berger
sont autant de reprises et de résonnances que Marcel Pagnol
intègre à sa propre écriture. L’écho est une image
métatextuelle de la réécriture que Pagnol fait des Bucoliques.
Virgile est ramené ainsi par sa traduction à une lecture
réaliste et régionale, tandis que l’œuvre pagnolesque est tirée
vers la référence classique. Cette lecture est cohérente avec
la réflexion que propose Pagnol dans un de ses entretiens :
Au fond, toutes les grandes œuvres sontrégionales. Nos grands classiques font du folkloreparisien. En somme, qu’est-ce qu’il y a de plusparisien que Racine, qui écrivait pour le roi, pourune cour parisienne ? C’est extraordinairementlocal. … Un écrivain est forcément régionaliste. 22
Ce propos met en évidence la stratégie auctoriale de Pagnol qui
entend par sa traduction défendre la valeur de l’œuvre
régionaliste en soulignant la portée locale d’un auteur
considéré pourtant comme classique. Niant la contradiction
qu’il pourrait y avoir entre classique et régional, Marcel
Pagnol s’approprie la figure virgilienne, en fait un modèle
d’écriture comme de posture auctoriale.
21 Virgile, Les Bucoliques, traduction en vers, préface et notes de MarcelPagnol de l’Académie française, Grasset, 1958, p. 10. 22 « Marcel Pagnol par lui même », Réalités, décembre 1962, p. 159-60.
Alors que le « pagnolisme » était synonyme de galéjade, la
traduction des Bucoliques change le sens du néologisme. Proche du
« valérisme », le « pagnolisme » désigne ainsi cette
inspiration pastorale et poétique qui définirait à présent
l’esthétique de Pagnol23. Un tournant dans la réception
pagnolienne est visible : son œuvre prosaïque, autobiographique
et romanesque est investi, à la suite de 1958, de la légitimité
virgilienne. Le récit de son enfance, véritable « passé
bucolique »24, devient « une sorte de symphonie pastorale »25.
Il pare « la petite Manon de tous les charmes des nymphes »26.
Le diptyque La Gloire de mon père et Le Château de ma mère est même son
« Énéide », d’après Jean-Charles Varennes27. Transformé en
« panthéiste classique »28 dans Le Provençal, en « consul »29 dans
Le Figaro littéraire, Marcel Pagnol est panthéonisé en « demi-dieu »30
de la littérature, lui, qui a connu, je cite, « le lit d’herbe
des naïades »31.
III) De Topaze à l’Honnête Homme
23 André Berry, « Un académicien prodige », Combat, 9 juin 1958 : « Ce n’estpas de moins Valéry avait fait de sa version des Bucoliques une merveillede valérisme. Il est heureux que Pagnol ait fait de la sienne une merveillede pagnolisme : pagnolisme, qui, à vrai dire, avait attendu jusqu’ici sapleine et entière définition. »24 Lucien Guissard, « Marcel Pagnol traduit Virgile », La Croix, 27 avril1958. 25 Albert Thuman, « Pagnol, ce latin… », Le Nouveau Rhin français, 5 juin 1958.26 Jean Mistler, « Marcel Pagnol », L’Aurore, 7 mai, 1963. 27 Jean Charles Varennes, « Bonjour Marcel Pagnol ! », Centre-Matin, 13 juin1961.28 André Negis, « Lu pour vous Marcel Pagnol : Le Château de ma mère », LeProvençal, 18 mai 1958. 29 M. R., « Virgile en Provence », Le Figaro littéraire, 17 mai 1958.30 Ibid. 31 Ibid.
La stratégie médiatique de Marcel Pagnol repose, on l’a vu, sur
le souci de rappeler que loin d’être un illettré ou un
autodidacte, il a fait ses Humanités et a été un ancien
professeur. Cette figure, si elle a pu être parfois oubliée au
cours de sa carrière, est récurrente dans la représentation de
l’écrivain. Devenu célèbre à la suite de la création du
personnage de Topaze, Pagnol, s’il n’est pas rapproché de César
ou de Marius, est assimilé à cette figure de l’instituteur. Ce
souvenir est réactualisé à la sortie des Bucoliques, comme en
témoigne le portrait que donne Émile Bouvier du traducteur :
Ce Topaze si sympathique dont les vers d’unecorrection impeccable ont de temps en tempsquelques rapports avec la poésie, et dont le latin,si j’en juge par mes lointains souvenirsd’agrégations est fort honorable, existe encoresous l’habit de l’académicien et j’en suis charmé.32
La posture professorale, si elle permet de donner une
légitimité culturelle, n’en reste pas moins un terrain glissant
qui risque de se muer en moralisateur et en pédant.
a) La figure repoussoir du pédant et du philologue
Aussi, Pagnol prend-il garde dans sa préface de se positionner
en non érudit, à distance de la figure du philologue – il écrit
« je n’ai pas eu pour but d’étonner le lecteur par une
érudition que je n’ai pas, mais de parler avec lui sur un ton
familier »33. Il construit dans sa préface, ses notes, un ethos
qui l’éloigne de la figure repoussoir du pédant. La familiarité32 Emile Bouvier, « Georgiques », Midi-Libre, 9 juillet 1958. 33 Virgile, Op. cit., p. 17.
du registre de langue qu’il choisit dans ses notes, qui
abondent en anecdotes, rapproche ainsi le traducteur du lecteur
mais aussi Virgile de ses lecteurs. Yvan Audouard, qui a saisi
ce travail subtile qui le positionne à mi-chemin entre l’ami et
le professeur, parle du traducteur comme d’un « humaniste
familier et familial, c’est-à-dire qu’il considère amicalement
tous les grands auteurs comme les membres de sa famille »34.
C’est que l’on ne sait plus très bien si c’est le professeur ou
l’élève latiniste des bancs du lycée qu’il préfère convoquer
comme modèle : il traduit, écrit-il, « comme nous l’aurions
fait en classe, au temps de notre baccalauréat »35. La captatio
benevolentiae est ainsi complète auprès du lecteur, qui, lui
aussi, a traduit Virgile sur les bancs scolaires, et peut se
sentir en sympathie avec ce double de lui-même. Comme pour le
professeur, la figure de l’élève, toujours ambivalente, doit
refuser le « scolaire », se démarquer des souvenirs
d’ânonnement sur la table de travail. Les fantaisies qu’il se
permet, comme de rapprocher de la brousse marseillaise le pressi
copia lactis (vers 81, première églogue), ou de commenter
impertinemment l’homosexualité de Corydon dans la deuxième
églogue, l’éloignent définitivement de l’image du latiniste
besogneux. C’est ce qui transparaît dans les articles de
presse, qui considèrent la traduction comme « dépouillée des
oripeaux scolaires »36, « arrachée aux philologies »37. Les
34 Yvan Audouard et André Parinaud, « Marcel Pagnol a trouvé dans Virgileune deuxième jeunesse de l’ailloli », Paris-Presse L’Intransigeant, 24 avril 1958. 35 Virgile, Op. cit., p. 10. 36 Extrait d’un article de presse non référencé présent dans le dossierGrasset à l’IMEC. 37 Pierre Descargues, « Virgile arraché aux philologies », Tribune de Lausanne,13 spetembre 1959.
philologues qui s’agrippent, dirait-on, au texte virgilien, de
toutes leurs griffes, condamnent Les Bucoliques à mort. Enfoncées
jusque là dans la poussière, Les Bucoliques ont été, d’après les
critiques, « débarbouillé(es) de la poussière des siècles et de
l’enseignement officiel »38, grâce à Marcel Pagnol. Le
« brusque et poétique coup de plumeau »39 que propose Marcel
Pagnol d’après Le Figaro est une véritable renaissance : l’air et
la respiration sont sous toutes les plumes pour décrire l’effet
poétique de cette traduction. Contre la dissection morbide des
philologues, Marcel Pagnol fait respirer le vers virgilien :
Remercions plutôt Marcel Pagnol de nous rendreplus proches, par des vers qui répondent à notretempérament, les battements d’un cœur qu’on a tropsouvent disséqué sur la table du mot à mot. 40
Ainsi, galvanisant un corps poétique en décomposition, Marcel
Pagnol propose une résurrection du texte de Virgile, en
bifurquant de la ligne officielle universitaire et en proposant
une traduction buissonnière d’un homme à mi-chemin entre le
professeur et l’écolier.
b) Entre poète galant et chevrier
Parler sur un ton familier avec le lecteur, disait Pagnol
dans sa préface. Il est visible que son modèle d’écriture est
celui de la conversation, qui s’oppose à la lourdeur de
38 Anonyme, « Bucoliques », Gazette de Liège, 6 août 1959. Cette expression aété copiée et reprise par de nombreux journalistes. 39 Anonyme, « Marcel Pagnol : « Moi aussi j’ai gardé les chèvres avecMénalque », Le Figaro, 21 mai 1958. 40 G. Nelod, « Poésie : Les Bucoliques de Virgile », La Pensée et les hommes,juin 1959.
l’érudition philologique. Le célèbre critique et académicien
Robert Kemp parle des notes du traducteur comme de « causeries
pagnoliennes »41, qui lui ont procuré, « un plaisir délicat ».
La légèreté prévaut ainsi sur la rhétorique et le pédantisme,
conférant à Pagnol l’image d’un poète-traducteur qui fleure le
18e siècle :
Ses vers, si on voulait tenter de leur trouverune parenté, font plus penser, me semble-t-il àquelques poètes du XVIIIe siècle qu’à Hérédia, quoiqu’en dise l’auteur, et c’est peut-être mieux. Cepourrait être un jeu littéraire, mais ce n’est pasle cas. L’Italie de Virgile devient, par la grâcedu poète, la douce Provence d’autrefois, non pointcelle de Giono, ni celle même de Mistral, maiscelle d’avant la Révolution, que l’imageriepopulaire ou les peintures murales « àl’italienne » de quelques maisons, à Grasse ou à laColle-sur-loup peuvent aider à imaginer. … On nepouvait souhaiter professeur plus plaisant. On vapouvoir en juger d’après les extraits que nouspublions ci-dessous et qui nous ont paru présenterune juste image de sa manière. C’est celle d’unhonnête homme.
La race menace d’en disparaître ; il valait qu’oncitât son exemple. 42
S’il se donne dans la préface l’objectif d’imiter « la rime
riche, la rime parnassienne de J. M. de Hérédia »43, la
référence à la poésie du 18e siècle s’impose à lui comme une
deuxième source d’inspiration puisqu’il écrit dans les notes
sur l’Églogue III :
41 Robert Kemp, « La vie des livres : Rome vivante », Les Nouvelles Littéraires, 7mai 1958. 42 D. B. « En traduisant Virgile en vers, Pagnol réussit la gageure queValéry avait jugée impossible », Arts, 7 mai 1958. 43 Virgile, Op. cit., p. 15.
Leur concision et leur préciosité n’ont rien depastoral et font penser à chaque instant aux fameuxhaïkis japonais, que réciteraient, dans un jardin àla française, les bergers de Trianon. 44
La grâce et le raffinement de ce « siècle de la légèreté » 45
contrastent avec l’image d’un Dubout du théâtre et du cinéma,
caricaturiste de la verve marseillaise, dont la lourdeur des
blagues grivoises n’a d’équivalence que dans la corpulence du
célèbre Raimu. « Homme de goût »46, « fin poète »47, Pagnol
s’éloigne, dans le nuage d’une poésie galante, du méridional
hâbleur. La remarque d’Albert Thuman sur les illustrations de
La Gloire de mon père peut être attribuée à l’influence de cette
traduction « trop brodée »48 :
On s’étonne d’apprendre qu’une édition de luxe decet ouvrage si fin sera illustrée par Dubout dontla verve est plus faite pour charger les matronesportant culotte et les gros durs à mitraillettesque pour traduire en images cette évocationchaleureuse d’une adolescence sensible dans lagénéreuse nature provençale où le bleu du ciel etla terre dorée ne s’accommodent guère du traitbrutal du caricaturiste.49
Paradoxalement, cette familiarité, qui fait de cette traduction
une « causerie », le ramène aussi parfois à la trivialité
paysanne, à la simplicité du petit peuple. Pagnol ne se
44 Virgile, Op. cit., p. 61.45 Expression empruntée à une journée d’études d’Oxford du 15 mai 2015 :« Le siècle de la légèreté : émergences du paradigme du 18ème sièclefrançais ». 46 Le liseur, « Le Château de ma mère, Les Bucoliques de Virgile », Le Régional, 31juillet 1958. 47 Lucien Guissard, « Les Souvenirs de Marcel Pagnol », La Croix, 14 août1960. 48 Henri Meschonnic, « Notes de lecture », Europe, Juillet-Août 1958.49 Albert Thuman, « Pagnol, ce latin… », Le Nouveau Rhin français, 5 juin 1958.
départit pas, dans sa posture de traducteur, du monde paysan
qui a autorité sur les mœurs des bergers virgiliens. Janus bi-
frons, il oscille entre la sophistication précieuse et le bon
sens paysan. S’il n’en vient jamais à incarner le paysan, - il
reste le « citadin » qui n’est que le compagnon de son frère
chevrier, qui n’est que le témoin de la foire aux bestiaux en
Normandie - , Marcel Pagnol accorde un crédit à la parole
paysanne pour des questions philologiques. Par exemple, à
propos du vers 98 de l’Églogue III, il écrit :
Un chevrier de la Sainte-Baume m’enseignait, vers1913, que le froid tarissait les mamelles deschèvres, tandis que la chaleur faisait tourner leurlait. … Un savant vétérinaire nous dit aujourd’huiqu’un tel accident paraît tout à fait improbable,mais que la science des bergers était faite d’ungrand nombre de secrets précieux et de quelquestraditions absurdes.
En tout cas, il semble que Ménalque parle icicomme notre chevrier de Garlaban, car le verbepraecipere signifie bien que la chaleur a fait« prendre » le lait, comme l’ont dit d’une rivièregelée qu’elle est prise. 50
Sa quête de légitimité littéraire dépasse sa simple image
d’auteur : c’est le savoir populaire qui est aussi l’enjeu de
sa réhabilitation, c’est aussi la région provençale elle-même
qu’il essaie de rendre digne d’entrer dans le patrimoine de la
littérature française, en rappelant, qu’elle y est déjà à
l’état de classique dans le texte virgilien. Tout l’objet de sa
stratégie auctoriale est de tenter d’abolir les dichotomies :
derrière la poésie galante, la parole des bergers véritables
n’est pas loin, la réalité est idéale, le professeur est encore
50 Virgile, Op. cit., p.83-4.