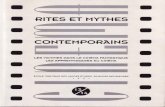L'abolition symbolique du politique, de nécessité vertu. Les réformes budgétaires dans les...
Transcript of L'abolition symbolique du politique, de nécessité vertu. Les réformes budgétaires dans les...
L'ABOLITION SYMBOLIQUE DU POLITIQUE, DE NÉCESSITÉ VERTULes réformes budgétaires dans les discours du président du Conseil italienArthur Borriello L'Harmattan | Politique européenne 2014/2 - n° 44pages 154 à 180
ISSN 1623-6297
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2014-2-page-154.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borriello Arthur, « L'abolition symbolique du politique, de nécessité vertu » Les réformes budgétaires dans les discours
du président du Conseil italien,
Politique européenne, 2014/2 n° 44, p. 154-180.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour L'Harmattan.
© L'Harmattan. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia154
L’abolition symbolique du politique, de nécessité vertu : les réformes budgétaires dans les discours du président du Conseil italien
La récente crise de la dette dans la zone euro a conduit à des plans d’austérité présentant une série de caractéristiques communes. Au-delà des débats sur l’efficacité et les conséquences politiques de ces mesures, cet article cherche à comprendre le discours spécifique qui l’accompagne. Le contexte de crise est considéré comme un moment d’exacerbation d’un discours dominant dépoli-tisé. L’article pose comme hypothèse que les stratégies discursives de dépo-litisation se déclinent suivant trois registres distincts : un registre technique et des références à la globalisation et à l’UE, présentées comme des contraintes externes justifiant les réformes. L’analyse porte sur le cas italien – considéré comme paradigmatique – étudié à travers 41 discours prononcés par Mario Monti durant son mandat. Les résultats montrent une tendance à présenter l’UE à la fois comme une contrainte (voulue) et comme le lieu approprié pour faire face aux défis de la globalisation, tandis que la dimension technique du discours s’exprime à travers une métaphore clinique des finances publiques omniprésente.
the Symbolic Abolition of Politics, the Virtue of necessity: Bud-getary reforms in the Speeches of the President of the Italian Council
The recent debt crisis in the Eurozone has led to austerity reforms that present many common features. Going beyond the debate on their efficiency and politi-cal consequences, this article aims at understanding the specific discourse that supports these measures. The context of crisis is understood as exacerbating a dominant depoliticized discourse. The article explores three depoliticization strategies: embedding the discourse in technical terms, and referring to globa-lization and the EU as external constraints that justify the reforms. The analysis focuses on the Italian case, considered as paradigmatic and analyzed through 41 speeches made by Mario Monti during his mandate. The findings show a tendency to present the EU both as a (voluntary) constraint and as the right place to deal with the challenges of globalization. The technical dimension of the discourse is expressed through a clinical metaphor of public finance.
PoLItIQUe eUroPéennen° 44 | 2014
Arthur Borriello
[p. 154-180]
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
155
L’abolition symbolique du politique, de nécessité vertuLes réformes budgétairesdans les discours du présidentdu Conseil italien
Arthur BorrielloUniversité Libre de Bruxelles
M embre fondateur de l’Union européenne, l’Italie serait-elle deve-nue la victime préférée du « monstre » qu’elle a contribué à créer ?
L’ambiguïté qui caractérisait historiquement le rapport entre les deux entités (Telò, 2013) semble en tout cas avoir trouvé son expression paroxystique durant la récente crise des finances publiques. Certes, le remplacement du gouvernement Berlusconi par un gouvernement dit « technique » n’est sans doute qu’un avatar d’un mouvement plus général de dépolitisation des questions économiques au niveau national, que la gestion de la crise a mis en évidence. De l’Irlande à la Grèce en passant par le Portugal et l’Espagne, du centre-gauche au centre-droit en passant par des gouvernements d’unité nationale, les décisions qui se sont suivies se sont ressemblées. Néanmoins, la radicalité de la transformation du cas italien le rend paradigmatique à certains égards. La pression conjuguée des marchés financiers et des parte-naires européens y a court-circuité le clivage pro/anti-berlusconien et ses corollaires (particratie, clientélisme et immobilisme) caractéristiques de la Deuxième République (Bosco et McDonnell, 2013), au profit de son quasi-contraire, un gouvernement technique a forte crédibilité internationale et soutenu par la presque totalité des acteurs politiques nationaux. Que cet épisode ait constitué une simple parenthèse ou qu’il soit voué à transformer profondément et durablement le jeu politique italien, seul l’avenir le dira. Il est toutefois difficile de le considérer comme anecdotique ; bien au contraire, il pose la question, à notre sens cruciale, du bouleversement de la légitimité politique dans un contexte de perte d’indépendance des élites nationales en matière de politique économique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia156
Jusqu’à présent, la littérature a principalement abordé les plans d’austérité sous deux angles. D’une part, à travers des débats de nature économique sur les conditions, l’efficacité et les conséquences de ces mesures (Capaldo et Izurieta, 2012 ; Lodge et Rodríguez-Vives, 2013 ; Apergis et Cooray, 2013), ainsi que sur leur impact sur des champs spécifiques de l’État social et des politiques publiques, comme ceux de la santé (Karanikolos et al., 2013 ; De Vogli, 2013) et de l’environnement (Russel et Benson, 2013). D’autre part, l’austérité a été abordée dans ses rapports à l’État-providence en général (Pierson, 2002) et à la responsabilité démocratique (Schäfer et Streeck, 2013). Cependant, les chercheurs se sont très peu intéressés à l’austérité sous l’angle du discours et de son impact dans le champ de la politique symbolique, lacune que cet article entend combler. Dans quelle mesure les discours sur les plans d’austérité accentuent, modifient ou révolutionnent les modes de légitimation de l’action publique dans un contexte national déterminé ? Comment permettent-ils de comprendre la concrétisation de grandes tendances transnationales en matière d’évolution de légitimation politique, à l’échelle d’un cadre géographique et temporel spécifique ?
L’approche adoptée rompt résolument avec toute perspective objectiviste, laissant de côté les débats qui conçoivent la globalisation (Sachs et Warner, 1995 ; Przeworski et Wallertein, 1988), l’intégration européenne (Scharpf, 1997 ; Majone, 1999 ; Moravcsik, 2002 ; Mair et Thomassen, 2010) et l’exper-tise (Bachir-Benlahsen, 1991 ; Chevallier, 1996 ; Robert, 2003) comme des contraintes objectives poussant à la convergence des politiques économiques à travers l’Europe. Concentré sur le discours dans une approche compréhen-sive, cet article s’intéresse à la façon dont ces trois éléments (globalisation, intégration européenne et expertise) sont utilisés comme ressources discur-sives pour justifier les réformes économiques et budgétaires, en partant de la littérature les ayant envisagés sous cet angle (Rosamond, 2000 ; Hay et Rosamond, 2002 ; Watson et Hay, 2004 ; Schmidt, 2010 ; Garric et Léglise, 2012). L’hypothèse principale est que ces trois arguments convergent pour produire un discours dominant dépolitisé, fondé sur la rhétorique de la contrainte extérieure et de la réduction technique des problématiques éco-nomiques. Alors que la première prolonge une tendance existante, la seconde semble profondément questionner les modes de légitimation qui dominent la scène politique italienne depuis vingt ans.
Fondée sur l’étude de 41 discours de Mario Monti, la présente analyse utilise les outils de la lexicométrie. Partant d’une étape exploratoire et interprétative (le comptage des fréquences et la classification du vocabulaire), l’analyse se
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
157
tournera ensuite, dans une approche plus déductive, vers la signification de termes clefs choisis au préalable, à travers l’étude de leur inclusion dans un registre lexical spécifique (analyse des concordances). Les résultats montrent que l’UE est plus régulièrement invoquée que la globalisation dans le discours, car cela permet au président du Conseil italien de maintenir une apparente capacité d’action et d’influence de son pays sur les décisions de politique économique. En outre, le discours s’enracine dans un registre technique où l’approche descriptive clinique de la réalité sociale est omniprésente. L’article sera divisé en trois sections. La première sera consacrée aux aspects théoriques et à l’expression de l’hypothèse centrale (II), la seconde évaluera la validité empirique de cette dernière (III) ; enfin, la conclusion reprendra les principaux résultats et ouvrira la porte à de futurs développements de nos recherches.
Le politique et la transformation de ses modes de légi-timation : la crise comme baromètre
Les démocraties européennes et leurs économies ont considérablement évolué depuis la fin du consensus keynésien qui avait marqué les Trente glorieuses. Les bouleversements économiques, politiques et sociaux ont contribué à modifier les façons de « faire » de la politique, et surtout de la « raconter ». Ces transformations sont trop nombreuses pour être énumérées ici. Néan-moins, trois éléments ressortent lorsqu’on s’intéresse aux transformations de l’action publique et de ses modes de légitimation en Europe : l’internatio-nalisation de l’économie, l’intégration européenne et la montée en puissance de l’expertise. Nous présenterons d’abord une revue de la littérature sur la globalisation (A), l’intégration européenne (B) et l’expertise (C) dans le dis-cours, avant d’aborder l’intérêt théorique du contexte de crise en général, du contexte italien en particulier, et l’hypothèse principale de l’article (D).
Globalisation et rôle de l’État
La globalisation est l’une des forces extérieures pouvant être mobilisées pour « rendre le contingent nécessaire » (Watson et Hay, 2004), pour justifier des réformes en les présentant comme le résultat de contraintes impératives. L’impact de la globalisation économique sur le rôle de l’État dans la gestion des affaires économiques et sociales est discuté depuis longtemps. Une
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia158
littérature importante défend l’idée que les transformations économiques structurelles impliquent un processus inexorable de convergence néo-libérale des politiques économiques. Matthew Watson et Colin Hay (2004) ont identifié les variantes de ce raisonnement : la « Business School Globalisation Thesis » (Sachs et Warner, 1995), la « Structural Dependence Thesis » (Przeworski et Wallertein, 1988) et la « Counter-inflationist Thesis ». Ces trois argumentaires convergent vers la même conclusion : la globalisation impose une logique politique d’absence d’alternative. Bien qu’elle ait été largement discréditée dans la littérature (Hirst and Thompson, 2002 ; Drache, 1999 ; Kleinknecht and Wengel, 1998), cette idée de la globalisation contraignante a trouvé un écho considérable dans le champ politique.
En effet, au-delà de la réalité a priori de cet argument, les dernières décennies ont vu l’apparition d’un discours politique qui le mobilise et qui, ce faisant, le fait advenir comme réalité institutionnelle (Piven, 1995, 108). Ce mythe – au sens de Roland Barthes (1972) – de la globalisation contraignante est l’un des piliers du programme de la « Troisième Voie » formulé par Anthony Giddens (Matagne, 2001, 17). Il est aussi à la base du projet du New Labour en Grande-Bretagne – en tant que stratégie discursive de « politique sans adversaire » (L’Hôte, 2010) – et du gouvernement Schröder en Allemagne (Watson et Hay, 2004, 2). Il fournit également des ressources discursives aux partisans d’un mouvement vers une gouvernance économique au niveau européen (Rosamond, 2000, 1). Il existe cependant diverses stratégies dis-cursives vis-à-vis de la globalisation en fonction des contextes nationaux. La globalisation peut être considérée comme un processus inévitable ou, au contraire, comme un projet politique contingent – la question étant alors de le soutenir ou d’y résister. Cependant, elle est parfois remplacée dans le discours par l’intégration européenne elle-même ; cela permet aux acteurs politiques de préserver leur apparente capacité d’influence sur ces processus externes qui les contraignent (Hay et Rosamond, 2002, 157). La littérature sur le cas italien (Dyson et Featherstone, 1996 ; Radaelli, 1998, 2000 ; Walsh, 1999) tend à l’assimiler au dernier cas de figure. La contrainte extérieure (vincolo esterno) y a été très largement incarnée par l’Union économique et monétaire, véritable levier pour légitimer des réformes économiques et fiscales entravées par les rigidités internes. À moyen terme, le risque de discréditer et délégitimer le processus de l’intégration européenne pourrait toutefois pousser les élites politiques italiennes à se tourner vers la rhétorique de la globalisation comme contrainte économique inévitable, comme cela a été entrevu dans le discours de l’administration Prodi (Hay et Rosamond, 2002, 162).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
159
Intégration européenne et démocratie
L’émergence d’un niveau de pouvoir européen pose elle aussi la question de la transformation des modes de légitimation de l’action publique, au moins à deux égards : la nature « peu démocratique » de la prise de décision au niveau européen, et la réduction de marge de manœuvre pour les États membres qu’elle engendre. Au-delà de la dimension institutionnelle du déficit démo-cratique (voir : Horeth, 1999 ; Scharpf, 1997, 2002 ; Majone, 1998, 1999 ; Moravcsik, 2002 ; Mair et Thomassen, 2010), certains auteurs attribuent au problème de légitimité une dimension essentiellement discursive, relevant des idées et du discours sur la démocratie (Schmidt, 2005, 761).
D’une part, la légitimité input serait déforcée par l’absence d’une communi-cation directe d’acteurs politiques européens avec un public européen, dans un langage commun et à travers un média européen (Schmidt, 2010, 18). D’autre part, la légitimité output est pratiquement éludée, puisque ni les élites européennes, ni leurs publics nationaux, n’engagent le débat, la délibération et la contestation des performances politiques de l’UE (Schmidt, 2010, 13). Un problème crucial rencontré dans ce domaine par l’UE serait le déclin des mythes légitimant l’intégration européenne (Jones, 2010), en particu-lier des « grands récits » de la paix et la prospérité, la première paraissant aussi assurée que la deuxième ne paraît compromise. Dans ce contexte, les discours sur l’UE varient d’État à État, sans discours légitimateur commun.
Par conséquent, l’UE apparaît plutôt comme l’objet d’une communication d’acteurs nationaux, exprimée dans la langue nationale, rapportée par des médias nationaux et considérée par une opinion publique nationale. L’UE devient alors une ressource discursive pour les acteurs nationaux qui la blâment pour ses politiques impopulaires et s’attribuent le mérite des politiques populaires (Schmidt, 2010). L’instrumentalisation discursive de l’intégration européenne est particulièrement prégnante dans l’Italie post-Tangentopoli, témoin d’un rapport particulièrement ambigu entre l’État italien et l’UE. Objectif majeur de la politique étrangère italienne d’après-guerre (Radaelli, 2000, 265), l’intégration européenne y perd dans les années 1990 le caractère central et consensuel que lui conférait le contexte international de la guerre froide. L’éclosion de l’euroscepticisme lors des débuts de la IIe République a pourtant progressivement cédé sa place, soit à un retour de l’idée fédéraliste, soit à un ralliement à la rhétorique de l’intégration comme mal nécessaire. La première option est liée à des raisons historiques, en particulier l’importance de la tradition de pensée fédéraliste et la faiblesse du nationalisme comme
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia160
alternative historique. La seconde est plutôt tributaire des dynamiques internes, puisque la contrainte européenne fournit une source de légitimité pour mener des réformes impopulaires, dans un contexte national marqué par la partitocratie, la corruption et la faiblesse des gouvernements (Telò, 2013, 44).
Expertise et politique
L’importance croissante de l’expertise dans la décision politique marque éga-lement une transformation fondamentale des démocraties contemporaines (Bachir-Benlahsen, 1991, 33). Le recours à l’expertise émane de l’initiative du pouvoir politique (Chevallier, 1996) qui, devant une situation délicate, cherche à désamorcer le potentiel conflictuel par un processus de dépo-litisation destiné à « consolider les ressources de légitimation politique » (Ibid.). Il ne semble néanmoins pas se limiter aux périodes de crises ou aux enjeux sensibles ; il est particulièrement présent au niveau communautaire où il est devenu un enjeu majeur dans la compétition inter-institutionnelle (Lequesne et Rivaud, 2001, 879). Certaines institutions l’utilisent comme mode de légitimation principal, en particulier la Commission qui, ne pouvant se reposer sur une légitimité électorale et se trouvant régulièrement criti-quée pour cette raison, voit en l’expertise un mode de légitimation alternatif, « non-politique » (Robert, 2003, 60).
La montée en puissance d’un discours expert dans la sphère sociale lors des deux dernières décennies, mérite d’être identifiée et déconstruite. Les carac-téristiques principales de ce discours sont les suivantes : (1) une légitimité circulaire, la légitimité des agents qui produisent ce discours étant purement statutaire, (2) une apparente neutralité politique renforcée par un vocabulaire abstrait et aseptisé, et (3) une récente homogénéisation lexicale (Cussó et Gobin, 2008, 6). Certains auteurs se sont intéressés au discours expert dans ses caractéristiques linguistiques et discursives, et dans ses relations avec les pouvoirs décisionnels, la citoyenneté et les médias (Garric et Léglise, 2012). Ils observent de nombreuses régularités formelles – faible présence des pro-noms personnels, surutilisation des verbes descriptifs, et présence de noms communs renvoyant à l’analyse, l’expérience, la validation et la preuve (Gar-ric et Léglise, 2012, 4). Ils soulignent également sa structure argumentative caractérisée par une approche descriptive presque clinique de la réalité, sur le modèle du traitement et du diagnostic (Cussó et Gobin, 2008, 7), comme cela a été brillamment relevé dans les discours de l’OMC (Siroux, 2008).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
161
Encore une fois, l’Italie semble idéale pour étudier le poids de la dimension technocratique dans les modes de légitimation des politiques publiques. Le rôle des experts et du consensus cognitif autour de la nécessité de rétablir l’équilibre des finances publiques à travers l’intégration économique euro-péenne, a joué un rôle crucial dans les dynamiques de négociation du Traité de Maastricht et dans le processus d’adhésion de l’Italie à la zone euro. En retour, ce discours dominant a contribué à transformer les rapports de force interne au système politique italien en y augmentant le poids des experts non élus (Radaelli, 1998, 2000). Cette tendance a peut-être atteint son apogée avec la nomination de Mario Monti, économiste de formation, ancien membre de Glodman Sachs et de la Commission européenne, à la tête d’un gouvernement « technique » ; nomination considérée « inévitable » par Silvio Berlusconi lui-même, chef du gouvernement démissionnaire (Bosco et McDonnell, 2012, 44), et soutenue par la quasi-totalité des partis politiques nationaux.
Des transformations convergentes dans un contexte de crise : la négation du conflit
Impératifs économiques d’un monde globalisé, contraintes d’un ordre supra-national et importance croissante de l’expertise semblent converger vers un modèle de légitimité politique éludant le conflit inhérent à la sphère sociale et présentant les solutions adoptées comme les seules possibles (Cussó et al., 2008). En d’autres termes, ces éléments jouent le même rôle fonction-nel au niveau discursif en fournissant aux acteurs politiques des arguments apparemment neutres et dépolitisés pour justifier les réformes économiques impopulaires. C’est du moins ce que cet article pose comme hypothèse. Or, si l’on considère que « la dimension antagoniste et les conflits partisans sont constitutifs du politique » (Mestrum, 2008) ces transformations posent la question de l’abolition symbolique du politique lui-même. La crise de la dette fournit un moment privilégié pour observer la synthèse de ces tendances et leur poids dans la gestion des affaires publiques. Michel Dobry soutient que, à certains égards, la crise révèle les schèmes intériorisés par les indivi-dus (Dobry, 2009, 317). Toutefois, sa conceptualisation de la crise comme « conjoncture fluide », bien qu’elle puisse être interprétée dans la continuité de l’avant-crise, constitue un moment de « configurations originales, diffé-rentes des arrangements structurels propres aux périodes de routine » (Ibid., 318). Il est possible de s’inspirer de cette conceptualisation pour l’appliquer au domaine des « échanges de coups » de nature discursive et symbolique. Le contexte de crise permettrait à la fois de saisir les récits dominants et
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia162
les récits alternatifs qui entrent en compétition avec les premiers pour la définition de la réalité sociale. Le cas italien apparaît paradigmatique à cet égard également. Chacun des éléments du récit dominant s’inscrit dans la continuité de tendances antérieures mais en rupture par rapport à d’autres. Un discours fondant la légitimité des politiques publiques sur le respect de la contrainte extérieure européenne et le recours au registre technique, renforce le récit du vincolo esterno tout autant qu’il affaiblit les dynamiques partitocratiques et clientélistes articulées autour du clivage pro/anti-Berlus-coni. Les rapports de force se recomposent alors face au discours dominant. On peut attendre d’un gouvernement « technique » qu’il se conforme et accentue la diffusion de ce discours dont il est, dans une certaine mesure, la conséquence politique. Ce faisant, il contribue à modifier le « régime de vérité », au sens foucaldien d‘un ensemble d’idées que la société adopte et produit comme la vérité (Lascoume, 1993, 42), donc le champ du légitime et du politiquement pensable auquel les concurrents politiques sont confrontés. Cet article entend vérifier l’hypothèse selon laquelle ce « régime de vérité » dominant, dans le cas italien, se décline selon la combinaison suivante des trois dimensions que constituent la globalisation, l’intégration européenne et le registre technique :
• Une faible référence à la globalisation contraignante ;
• Une référence préférentielle à l’Union européenne, intervenant dans un discours à forte dimension impérative, dans lequel l’UE et le contexte économique difficile constituent une contrainte extérieure rendant les réformes entreprises inévitables. On devrait également retrouver l’avan-tage du recours à l’argument européen, à savoir la possibilité de maintenir un discours plus volontariste sur l’action nationale italienne à l’échelle européenne ;
• Une référence répétée aux compétences techniques du gouvernement, et une dépolitisation du discours à travers des formes lexicales tendant à naturaliser les questions de politique économique.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
163
De nécessité vertu ? les stratégies de dépolitisation dans le discours de Mario Monti
Cette partie empirique devra permettre de tester cette triple hypothèse en identifiant l’apparition de ces thèmes dans le discours de Mario Monti : à quelle fréquence interviennent-ils et comment s’articulent-ils ? Le corpus sur lequel sera menée cette analyse comprend 41 discours prononcés par le président du Conseil, prononcés en italien et ayant trait à la politique économique. Ces textes couvrent une période d’un peu plus d’un an, de la déclaration programmatique devant le Sénat peu après sa prise de fonction (17 novembre 2011), à une conférence de presse effectuée à Berlin à la veille d’un Conseil européen (31 janvier 2013). Les textes sont de différents types : interventions dans les enceintes parlementaires (nationale et européenne), discours lors de conférences internationales et de forums économiques, conférences de presse et interviews. L’analyse utilise les outils fournis par la lexicographie, en l’occurrence par le logiciel d’analyse lexicographique Ira-muteq. Les quelques textes supplémentaires en anglais ou en français ont été volontairement écartés du corpus pour la simple raison qu’ils ne pouvaient être introduits simultanément dans le logiciel sans fausser l’analyse des fréquences et l’analyse classificatoire. Le faible volume qu’ils représentent nous autorise toutefois à les analyser « manuellement » et, le cas échéant, à y avoir recours pour illustrer l’un ou l’autre élément clef de notre propos.
L’analyse lexicographique ne doit pas être prise pour plus que ce qu’elle n’est : une méthode exploratoire et interprétative visant à réduire la complexité du corpus pour ensuite faire émerger le sens des termes clefs qui nous inté-ressent, à travers l’étude de leur insertion dans un registre lexical. Il ne s’agit aucunement d’une étude statistique à proprement parler ; aucune inférence n’est possible au-delà du corpus constitué, et les conclusions se limiteront à ce cadre circonscrit. Ce n’est qu’à travers des travaux ultérieurs, mobilisant un cadre comparatif et un intervalle temporel plus large, que pourra être attribuée aux conclusions une portée plus générale.
La partie empirique sera organisée de la manière suivante. En premier lieu, une analyse classificatoire générera des catégories de vocabulaires à partir de l’observation de régularités dans l’association et la proximité des termes (A). Ces classes seront ensuite labellisées à partir de l’examen des fréquences d’apparition des termes qui les composent. J’ai opté ici pour une analyse ne faisant pas émerger plus de quatre classes, considérant que l’intérêt de cette phase était essentiellement de réduire la complexité du texte, d’en écarter
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia164
éventuellement certaines parties peu utiles pour mon propos, et d’obtenir un premier angle d’approche du contenu des discours. Cette étape peut paraître relativement arbitraire. Il ne s’agit en effet que d’une démarche exploratoire, hautement interprétative ; le recensement des fréquences d’apparition des termes ne constitue, à vrai dire, qu’un prélude à l’analyse des concordances, la seule à véritablement permettre une analyse fine du sens des discours étu-diés. Celle-ci constituera la seconde et principale partie de la démonstration (B, C et D) : l’analyse du contexte d’énonciation d’une série de termes clefs en rapport avec l’hypothèse.
Économie réelle et financière, rencontres européennes et « agir ensemble » : les grands axes du discours
L’analyse classificatoire a mis au jour quatre classes. Les fréquences des unités lexicales qui les composent fournissent des indices qui permettent de les labelliser comme suit : « l’agir ensemble » (1), « l’économie financière » (2), « l’économie réelle » (3), et « les rencontres européennes » (4).
Dans un premier temps, cette première analyse superficielle permet d’écar-ter toute une partie du vocabulaire, essentiellement protocolaire et liée à la quatrième classe. Celle-ci est en effet composée de noms de personnalités politiques, de postes ou institutions, de termes évoquant la rencontre ou le dialogue, de formules de politesse et, enfin, de lieux et de repères tem-porels. En outre, à travers les autres catégories, l’analyse apporte quelques premiers indices intéressants quant aux hypothèses formulées. En premier lieu, elle confirme l’idée d’une évocation de l’Union européenne comme réalité incontournable et comme lieu de l’agir ensemble. C’est ce qu’indique la présence simultanée, dans la première classe de vocabulaire, de termes liés aux niveaux de pouvoir (Europe, Union, global, commun, ensemble), aux déterminants, modalités et objectifs de l’action (politique, moment, chemin, devoir, construction, urgence, crise, solution, leadership, futur), ainsi que de verbes d’action (croire, entendre, regarder, comprendre, savoir, vouloir, appeler, former, chercher, conduire, imaginer). La proportion de verbes parmi les termes les plus représentatifs de la classe est d’ailleurs supérieure à celle des trois autres catégories.
En second lieu, elle permet de mesurer l’importance du registre et de la contrainte dans le vocabulaire portant sur l’économie financière (classe 2). Celle-ci se manifeste à la fois positivement, par la présence de termes
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
165
renvoyant directement à ce registre (stabilité, discipline, nécessaire, contrainte, équilibre, cercle vicieux, surveillance, règle, crédibilité, déséquilibre, pare-feu, vigilance, compétitivité, nécessité) et négativement, par la sous-représentation, relativement aux autres classes, des verbes et marqueurs d’action en général (assainissement, exécution, consolidation, stabilisation, coordination, réduction, augmentation). Enfin, malgré la très nette orientation de cette classe vers l’économie financière, la « croissance » en constitue le terme le plus emblématique – terme qui pourrait faire partie des stratégies discursives de Mario Monti visant à atténuer l’impératif d’austérité. On se souvient qu’il a fait partie, avec François Hollande, des représentants d’États membres ayant poussé à l’introduction d’éléments relatifs à la croissance dans les accords européens sur les finances publiques ; il pourrait donc encore s’agir ici d’une stratégie discursive visant à récupérer l’image d’une certaine capacité d’action.
Cette étape de l’analyse permet donc de jeter les bases des étapes ultérieures. En premier lieu, elle permet d’écarter une large part du discours essentiel-lement procédurale (classe 4). Ensuite, elle fournit quelques indices sur la centralité de l’Europe comme niveau d’action. Enfin, elle souligne déjà le poids du registre de la contrainte et du registre technique dans le champ financier. Ces éléments posés, la démonstration peut maintenant s’enrichir de l’analyse des concordances.
« Recommandations » européennes, crédibilité et défis de la globalisation
L’examen approfondi des concordances du mot « Europe » dans la première classe, dont il est le terme le plus emblématique, révèle un certain nombre d’éléments qui semblent étayer l’hypothèse de départ. En premier lieu, l’Europe est à certains égards, présentée comme une contrainte extérieure sur l’action au niveau national – ou, à tout le moins, comme une entité extérieure ayant les yeux rivés sur l’action du gouvernement italien :
« C’est justement pour les conséquences que cela aurait pu avoir en Europe et dans le monde, que l’Europe et le monde avaient les yeux rivés sur l’action de l’Italie. » (Mario Monti, septembre 2012).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia166
Mario Monti, dans ses discours, se refuse toutefois à présenter l’UE comme une contrainte imposant des réformes à l’Italie ; elle ne fait à ses yeux que recommander des actions qui sont dans l’intérêt du pays :
« Je me suis promis de ne jamais faire cette mauvaise blague à l’Union européenne, et j’explique toujours à mes concitoyens, au Parlement ou ailleurs, que les sacrifices importants, les réformes difficiles, auxquels les citoyens italiens sont appelés en cette période, ne sont pas imposés par l’Europe mais sont nécessaires pour l’amélioration de la vie économique, sociale et civile italienne, et surtout dans l’intérêt de nos enfants. Ce sont des choses que l’Europe demande et recommande de faire, mais elles ne doivent pas être imputées à l’Union européenne. » (Mario Monti, 15 février 2012).
Le fait de mener ces réformes est également présenté comme une condition pour que l’Italie récupère une crédibilité, pèse sur les mécanismes de déci-sion au niveau européen et fasse ainsi valoir ses intérêts. Cet argumentaire s’inscrit dans un des thèmes majeurs de la politique étrangère italienne d’après-guerre, celle de la place de l’Italie dans le processus décisionnel européen (Radaelli, 2000).
« Ces choses – et je crois que je n’ai pas besoin de le répéter chaque fois – sont essentiellement dans notre intérêt, et puisque nous allons dans la direction de nos intérêts, mais attendue par l’Europe, c’est une bonne chose de la faire prévaloir aussi en Europe. » (Mario Monti, 26 juin 2012).
« Nous faisons partie des pays européens qui décident ensemble de la résolution du système grec, nous sommes réinsérés dans un processus de décision, nous sommes respectés. Ce n’est pas tombé du ciel ; c’est le résultat de notre prise de conscience [….] de mettre l’économie italienne sur une base plus sûre. » (Mario Monti, 7 septembre 2012).
« Naturellement l’Italie qui se consolide dans une position de sécurité – et le chemin à parcourir est encore long, mais je suis encouragé par ce qui est en train de se passer – sera une Italie qui ne se limitera pas à recevoir de façon passive les orientations politiques de l’Union européenne, ce sera une Italie qui voudra contribuer toujours plus à déterminer ces orientations, et à jouer le rôle qui est naturellement dévolu à un grand pays fondateur de l’Union européenne et à une des plus grandes économies de la zone euro. » (Mario Monti, 15 février 2012).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
167
L’Europe est enfin présentée comme le niveau adéquat pour affronter les défis posés par la globalisation :
« Je crois que nous réussirons à rendre l’Europe plus innovatrice et plus prête aux défis de la globalisation si nous affrontons cette lutte ensemble » (Mario Monti, 23 janvier 2013)
« Ces réformes qui auront été nécessaires pour conduire chacun d’eux et l’Europe dans son ensemble à être plus armés de compétitivité dans la concurrence globale. » (Mario Monti, 14 ddécembre 2012).
« Un échec ne serait pas délétère seulement pour nous Européens : il amoindrirait la perspective d’un monde plus équilibré, dans lequel l’Europe puisse transmettre au mieux ses valeurs et exercer le rôle qui lui incombe dans un monde toujours plus en besoin d’une gouvernance multilatérale efficace. » (Mario Monti, 17 novembre 2011).
Le rapport à l’Europe est donc, dans les stratégies discursives de Mario Monti, assez subtil : elle constituerait certes une contrainte extérieure à l’action nationale, non pas parce qu’elle impose des réformes, mais parce que le suivi de ses justes recommandations conditionne la crédibilité de l’Italie et sa capacité à faire valoir ses intérêts au niveau européen, et parce que leur respect par chacun conditionne la capacité de l’UE à affronter de façon commune et cohérente les défis de la globalisation. On est loin, là, de l’utilisation de l’UE comme bouc émissaire pour expliquer la mise en place de réformes impopulaires. Les discours étudiés sont plutôt conformes à l’une des possibilités entrevues par Colin Hay et Ben Rosamond (2002) et à la rhétorique spécifique du « vincolo esterno » mise en évidence par Claudio Radaelli (2000) : alors que les réformes sont présentées – comme nous le verrons en détail plus loin – sur le mode de l’impératif économique et de l’évidence, l’Union européenne est perçue comme un acteur légitime et incontournable, lieu par excellence de la promotion des intérêts et de la défense des valeurs nationales.
De nécessité vertu : l’impératif du comportement vertueux
L’examen approfondi des concordances des termes « nécessaire » et « néces-sité » offre également quelques éléments intéressants pour comprendre la façon dont les mécanismes économiques sont transformés en évidences, et
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia168
les réformes en impératifs. La globalisation, fait marquant, n’est presque jamais directement invoquée. Toutefois, même en son absence, on peut percevoir en filigrane sa dimension contraignante, matérialisée dans la men-tion « d’observateurs pas toujours bienveillants », voire, plus concrètement, d’investisseurs, pour lesquels il est nécessaire de rétablir l’image et la crédibilité de l’Italie. L’argument de la nécessité peut également être exprimé de façon inversée, la possibilité d’éviter la mise en œuvre des réformes constituant alors une illusion :
« Pour dissiper toute réserve et aider à la construction du consensus [….] je crois qu’il faudra éviter de donner des alibis aux observateurs, pas toujours bienveillants, qui observent l’action de l’Italie. Pour cela, il est nécessaire d’avoir fait tout ce parcours de réformes et de contrôle des finances publiques ; un parcours laborieux au cours duquel une très large partie de ce Parlement, pas toujours avec joie, souvent avec regret et souffrance, a soutenu le gouvernement, mais ceci était essentiel pour donner de la crédibilité à notre pays. Et pour cela il est nécessaire de donner un signal aussi à travers l’adoption de la réforme du marché du travail qui est considérée comme un des éléments centraux de l’agenda des réformes structurelles. » (Mario Monti, 26 juin 2012).
« En même temps il est nécessaire de confirmer, dans la réalité et dans les apparences, l’image d’un pays mûr qui accepte une discipline budgétaire nécessaire et raisonnable. » (Mario Monti, 12 janvier 2012).
« Le court terme malheureusement existe, que ce soit dans la politique nationale – et, j’en ai peur, également au niveau global – ou dans la poli-tique européenne. Cela signifie que l’Italie, dans la dernière décennie, n’a pas exploité l’opportunité de l’appartenance à la zone euro pour faire les réformes et atteindre un rapport dette/PIB plus bas. Nous avons continué à vivre dans l’illusion que nous pouvions arriver à un changement sans entreprendre de réformes véritables. [….] L’Italie n’a pas saisi les défis de la globalisation, du changement démographique et de l’innovation techno-logique. Elle a choisi la politique du status quo et de la procrastination. Elle a choisi l’illusion que, alors que le monde changeait, elle pouvait ne pas changer. Le coût de l’inertie, naturellement, s’est déplacé sur les épaules de nos enfants et petits-enfants jusqu’à arriver au moment de vérité. » (Mario Monti, 23 janvier 2013).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
169
Lorsqu’elle n’est pas plus ou moins explicitement rapportée aux contraintes d’un environnement globalisé, la nécessité des « réformes structurelles » est présentée sur le mode de l’évidence, l’argument de la nécessité se suffi-sant à lui-même ou étant soutenu par le constat de la situation critique de l’économie italienne appelant un « sauvetage » de la part du gouvernement1.
« Pendant longtemps, les réformes structurelles nécessaires n’ont pas été faites et tout ce qui relevait des libéralisations était tenu pour impossible ou peu réaliste à moins que ne soit modifié l’article 41 de la Constitution. » (Mario Monti, 4 avril 2012).
« Le paquet de mesures nécessaires pour sauver l’Italie que nous avons adopté hier intervient aussi bien sur l’aspect des recettes que sur celui de la réduction des dépenses, surtout dans l’objectif d’améliorer de façon stable le solde des comptes publics dans les deux cas ». (Mario Monti décembre 2011).
On le voit, ce registre de nécessité n’est que faiblement associé à des contraintes extérieures – bien loin, par exemple, de l’insistance avec laquelle le New Labour avait mobilisé l’argument de la globalisation pour justifier le changement de ses propositions programmatiques (Watson et Hay, 2004). La connotation négative de ce registre – celle d’un gouvernement dans l’incapacité de mener une politique souveraine et autonome – est largement atténuée, de la même manière que l’UE est présentée comme un lieu d’action et de défense des intérêts nationaux, plutôt que comme la source d’imposition de politiques non voulues par le gouvernement. Les réformes deviennent, non pas la consé-quence d’une perte d’autonomie de l’État en matière de politique économique dans un contexte globalisé, mais la condition du maintien de cette autonomie :
« Ces mesures prises 17 jours après l’entrée en fonction du gouverne-ment et au moment le plus aigu de la crise financière, étaient nécessaires pour sécuriser les comptes publics et renverser une dérive qui portait notre pays toujours plus près d’une situation très critique, à l’issue de
1 Ceci fait écho au titre des premières réformes introduites par le gou-vernement Monti, le décret « Salva Italia ».<http://www.repubblica.it/economia/2011/12/06/news/decreto_salva_italia_ecco_il_testo_com-pleto-26170951/>.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia170
laquelle il y aurait eu l’insolvabilité de la dette souveraine, l’incapacité de faire face aux dépenses de l’État, la perte de la souveraineté économique et la cession de fait de la responsabilité de la politique économique à des institutions supranationales, comme le Fonds monétaire, la Banque centrale et la Commission. » (Mario Monti, 24 septembre 2012).
Par ce procédé argumentatif, le président du Conseil italien fait de nécessité vertu ; l’impératif économique derrière les politiques d’austérité est transformé en condition de la capacité d’action gouvernementale. La dimension vertueuse des réformes entreprises est d’ailleurs ci et là énoncée – y compris à propos de situations extérieures au contexte italien, comme la crise grecque – que ce soit par sa mention explicite ou par la critique d’un cercle vicieux que ces mesures contribuent à rompre :
« Pour la stabilité de l’euro, il est nécessaire de briser le cercle vicieux entre la dette souveraine et la dette bancaire. » (Mario Monti, 29 octobre 2012).
« La Grèce a déjà accompli beaucoup de progrès et doit continuer le processus solide de discipline fiscale et de réformes structurelles parce que c’est dans son intérêt. Je crois que le gouvernement et le peuple grecs sont d’accord avec ça. Ils ne sont pas seuls. L’Europe aide, mais ils doivent aussi s’aider eux-mêmes en poursuivant cette voie vertueuse. » (Mario Monti, 23 septembre 2012).
« Mon gouvernement est pleinement convaincu des vertus de la discipline budgétaire, pleinement convaincu en termes opérationnels, tant et si bien que nous avons un objectif, qui a été décidé avec l’Union européenne, d’atteindre l’équilibre du budget déjà l’année prochaine, en 2013, ce qui est un peu plus tôt que la plupart des autres États membres. » (Mario Monti, 9 mai 2012)
« C’est pour cela que chaque fois que je pense aux changements dans la société et dans la politique, je suis plus convaincu encore que les compor-tements vertueux ne seront pas abandonnés ». (Mario Monti, 4 avril 2012).
« Il ne suffit pas d’attendre que la virtuosité nécessaire dérivant des réformes structurelles et de la réduction des déficits publics génère pour ainsi dire par vertu spontanée la croissance. » (Mario Monti, 19 mai 2012).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
171
Ce dernier extrait de discours fait apparaître une autre association du registre impératif. Il est également mobilisé lorsqu’il s’agit de porter l’une des revendications majeures du gouvernement Monti : l’association de ces réformes avec l’adoption d’une politique de croissance – terme-clef du discours par excellence, puisqu’il apparaît à la douzième place dans les fréquences absolues d’utilisation et constitue le concept économique le plus utilisé. L’argumentaire prend alors la forme d’un raisonnement circulaire, dans lequel austérité et croissance se conditionnent l’un l’autre : pas de politique de croissance sans des finances publiques « saines », ni d’austérité utile sans une politique de croissance.
« En particulier sur comment conjuguer maintenant cette discipline avec une plus grande attention à la croissance, que ce soit de la part des États membres ou que ce soit, chose absolument nécessaire, au niveau de la politique de l’Union européenne. » (Mario Monti, 23 février 2012).
« Naturellement il y a un lien important entre ces lignes directrices : il n’y a pas de croissance ni de bien-être sans des finances publiques saines et durables, sans équité, sens un ressenti commun et une participation à l’effort nécessaire pour sortir de la crise actuelle. La rigueur, qui impose des sacrifices au pays, représente le présupposé essentiel pour l’équité et, en même temps, le moteur pour le développement. » (Mario Monti, décembre 2011).
On voit toute la prégnance du registre de la nécessité dans la justification des réformes entreprises. Les réformes sont en effet présentées comme une nécessité, la seule voie possible par opposition à la stratégie illusoire de l’absence de réformes. Néanmoins, comme dans le rapport à l’Union européenne, on perçoit des stratégies discursives atténuant la dimension contraignante de l’impératif économique. En premier lieu, celui-ci n’est que très occasionnellement mis en rapport avec les forces externes de la globalisation. Surtout, les réformes sont présentées comme la condition du maintien de l’autonomie décisionnelle nationale ; elles représentent donc la preuve de la capacité d’action gouvernementale plutôt que l’aveu de son impuissance. Enfin, intimement liée au registre du comportement vertueux et associée aux politiques de stimulation de la croissance, l’austérité finit par prendre la forme d’une politique volontaire, d’une valeur en soi.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia172
La métaphore clinique comme naturalisation du politique
Un autre élément ressort du comptage des fréquences et de l’analyse des concordances : la métaphore médicale, hautement représentative de la naturalisation du social qu’opère le discours dit « expert » (Cussó et Gobin, 2008 ; Siroux, 2008). Cette approche « clinique » constitue un puissant outil symbolique de technicisation de la question des finances publiques : posé sur le modèle triangulaire symptôme – diagnostic – traitement, cet enjeu est ramené à un problème médical, appelant simplement à l’identification de la façon adaptée de traiter la pathologie et de retourner à l’état « naturel » du « corps sain ». Les expressions « cure d’austérité » et « assainissement des finances publiques », par exemple, sont probablement tellement rentrées dans le langage ordinaire qu’on en oublierait le « régime de vérité » dominant qu’elles incarnent, le puissant outil de dépolitisation des affaires publiques qu’elles représentent. La dette serait le symptôme d’une maladie, appelant une cure, un régime, un assainissement des finances publiques, véritable exigence vitale. La financiarisation excessive de l’économie capitaliste et ses dérives seraient le produit de la disparition de l’anticorps que constituait le modèle antagonique communiste, anticorps qu’elle doit à présent trouver en son sein, ce que l’Italie a su faire à travers les réformes. Le traitement, cela dit, comporte des souffrances sociales, il n’y a pas de solutions miracles ou indolores. Si l’élément de la souffrance – de façon compréhensible – n’est que marginalement présent dans le discours, un journaliste interrogeant Mario Monti en a fait le titre, plus qu’évocateur, de son article : « souffrir pour guérir ». Cette souffrance pourrait toutefois être atténuée par la baisse des taux d’intérêt sur la dette publique et le retour des investissements, permettant à l’économie de respirer.
« L’Italie avait la fièvre (une fièvre élevée) et ne pouvait être soignée avec une simple aspirine. Elle avait besoin d’un médicament qui ne soigne pas uniquement les effets extérieurs ou n’allège que les symptômes. Un traitement amer, pas facile à digérer. Mais absolument nécessaire, pour aller au fond et extirper la maladie. » (Mario Monti, 20 décembre 2012).
« Le parcours d’assainissement de la dette publique provient, souvenons-nous en bien, des contraintes européennes que nous avons-nous-mêmes avec conviction contribué à définir dans l’intérêt des citoyens italiens, et en particulier des générations futures [...] La réduction de notre dette publique est une exigence vitale et tout écart risquerait de faire s’effondrer notre pays dans un abysse. » (Mario Monti, 5 décembre 2011).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
173
« Je dois dire que je suis impressionné par le sens des responsabilités dont ont fait preuve les Italiens. Ils ont pourtant été soumis à un régime sévère : les augmentations d’impôts et la réduction des dépenses publiques ont entraîné une dégradation de la situation économique et une hausse du chômage. Mais ils ne sont pas les seuls : les Européens, en général, sont conscients qu’il n’y a pas de solutions miraculeuses ou indolores. » (Mario Monti, automne 2012).
« Tant qu’il existait un concurrent sérieux – qui a ensuite historiquement échoué, mais qui faisait peur et qui était le système communiste – le capitalisme a trouvé en son sein les anticorps pour se rénover, pour se modérer et pour s’orienter. » (Mario Monti, 21 août 2012).
« L’Italie est en train de reconstruire en son sein les bons anticorps, et donc devient plus saine, et deviendra plus forte. Le langage de la vérité a été dit. » (Mario Monti, 20 décembre 2012).
« Certes nous ne pouvons nous désintéresser des aspects sociaux de souf-france et pour cela nous pensons à des interventions […]. C’est pourtant vrai que la réduction des taux d’intérêt sur la dette publique donne un peu de souffle et que si les afflux de capital financier et les investissements industriels reprennent, tout cela commencera à avoir des effets [….]. » (Mario Monti, 4 avril 2012).
Outre l’initiative nationale d’assainissement des finances publiques, il est recommandé que l’Europe se dote de mécanismes d’action commune en cas de crise afin d’éviter tout risque de contagion financière. Sans oublier – enjeu toujours considéré comme absolument central – de prendre des mesures pour stimuler la croissance2.
2 La métaphore clinique, ou physiologique, est parfois présente là où on ne l’attend pas. Le stimulus, par exemple, est un terme physiologique désignant « un facteur qui agit sur une cellule, un organe, l’organisme et provoque une réponse » (Le Petit Larousse, 2009), une « action physique relative aux réac-tions d’un être vivant » (Lalande, 2002, 1029). Le terme de croissance est lui aussi relatif au monde du vivant : « Développement graduel d’êtres vivants, particulièrement dans le sens vertical » (Littré, 1886).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia174
« La question de la croissance, mais aussi l’intégration financière et le besoin d’une régulation et d’une supervision financières plus intégrées sont vitales pour de nombreux pays, dont l’Italie [….] Limiter la contagion et stimuler la croissance. » (Mario Monti, 31 mai 2012).
« Je crois que nous sommes graduellement en train de réussir à sortir notre pays de la zone d’ombre dans laquelle il s’est trouvée pendant un certain moment en tant que source potentielle de contagion, d’incendie dans la zone euro. Nous sommes en train de réaliser tous les efforts nécessaires en termes de consolidation budgétaire et en termes de réforme structurelle. » (Mario Monti, 15 février 2012).
« Il est important qu’il y ait cet élément de participation et de partage démocratique dans un moment où l’action – qui doit être conduite à l’intérieur du contexte national à travers des politiques d’assainissement financier et de stimulation de la croissance, qui demandent aussi des sacrifices pesants aux citoyens – est étroitement liée aux choix institu-tionnels et de politique publique qui s’affirment au niveau européen. » (Mario Monti, 25 janvier 2012).
La métaphore clinique, en naturalisant les enjeux de politique économique, contribue également à la même déresponsabilisation des élites nationales que provoque l’évocation de l’impératif économique et de la contrainte extérieure. Si l’économie nationale s’apparente à un corps diagnostiqué malade et conta-gieux, alors la responsabilité des élites nationales se limite à organiser sa mise sous tutelle, sa mise en conformité avec les recommandations extérieures, l’administration d’un traitement prescrit par des autorités compétentes. Un tel discours fournit simplement un équivalent fonctionnel métaphorique à la contrainte extérieure bienveillante : les recommandations de l’UE dans l’intérêt de l’Italie deviennent les prescriptions médicales dans l’intérêt du patient, auxquelles il serait décidément déraisonnable de se dérober.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
175
Conclusion
S’il est vrai que le politique est la « constitution de l’espace social » (Lefort, 1986), « une activité réfléchie et lucide, visant l’institution globale de la société » (Castoriadis, 1999), s’il est alors vrai qu’elle est liberté, les discours énoncés en rapport aux réponses apportées à la crise de la dette posent question. Son sens originel « indiquait l’ouverture de la société à sa ré-ins-titution permanente, la conscience que la vraie démocratie est invention, création libre de nouvelles formes d’organisation de la chose publique, sans qu’aucune de ces formes ne soit jamais sacralisée ou figée dans une préten-due nécessité » (Stevens, 2007). Cette « prétendue nécessité » est portée à son paroxysme dans le contexte de crise, et, dans le cas particulier qui nous intéresse, les discours de Mario Monti à propos de celle-ci. Nous avons vu que l’Europe, l’impératif économique et la métaphore médicale y étaient fortement mobilisés, et constituaient un puissant vecteur symbolique de négation du conflit, de l’existence alternative et donc – oserait-on l’avancer ? – du politique lui-même. La responsabilité des élites politiques nationales se limite à une mise en conformité avec des recommandations extérieures, formulées dans l’intérêt d’une économie nationale diagnostiquée malade et contagieuse, donc justement mise sous tutelle.
L’articulation d’un tel discours prend toutefois sa forme et son sens spéci-fique dans un contexte national déterminé. La crise a exacerbé le discours de l’impératif économique et de la contrainte extérieure tel qu’il existait déjà dans le champ politique italien, c’est-à-dire incarnés plutôt par l’Union européenne que par la globalisation (Dyson et Featherstone, 1996 ; Radaelli, 2000 ; Hay et Rosamond, 2002). La dimension impérative du discours est toutefois atténuée par des procédés lexicaux transformant la nécessité en vertu, présentant le niveau européen comme le lieu de la défense des inté-rêts nationaux et assimilant les réformes à une démarche voulue plutôt que subie, dans l’intérêt des citoyens. Une telle démarche se comprend aisément. Aucun dirigeant n’a véritablement intérêt à se présenter comme un simple agent administrant des décisions qui ne lui appartiennent pas ; à terme, cette rhétorique s’avère contre-productive en termes de légitimité. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’une élite technocratique italienne qui a moins intérêt que quiconque à discréditer ce qui constitue une de ses sources de légitimité principales. Cette atténuation de la dimension contraignante de l’Union européenne peut en outre s’appuyer sur la centralité de l’intégration européenne dans la politique étrangère italienne et sur l’absence d’alternative historique à celle-ci (Radaelli, 2000 ; Telò, 2013).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia176
La littérature spécialisée a depuis longtemps identifié isolément chacun des trois termes (globalisation, intégration européenne, discours expert) de ce type de discours. Le présent article a cependant montré que la crise offre un terrain particulièrement propice à leur utilisation conjointe, dans la mesure où ils fournissent des ressources discursives utiles à des acteurs politiques nationaux soucieux de préserver un équilibre entre la justification de réformes impopulaires et le maintien de leur apparente capacité d’action vertueuse. Le cas italien a montré que leur articulation spécifique restait tributaire du contexte national et de ses déterminants historiques propres : il existe des récits nationaux spécifiques de l’absence d’alternative. Reste à déterminer si, comme le laisse supposer la généralisation du contexte de crise, un tel type de discours a dépassé à cette occasion toute frontière nationale ou partisane ; en d’autres termes, s’il s’agit bien d’un discours dominant, d’un « régime de vérité » auquel tout discours de politique économique doit se rapporter, même pour le déconstruire. La présente analyse n’est en effet pas encore en mesure de le déterminer. Gageons toutefois qu’une comparaison de différents cas nationaux, confrontant ces discours portés par un exécutif sommé de justifier son action à ceux d’une arène parlementaire censée fournir l’espace de leur contestation, devrait nous permettre d’appréhender dans une plus juste mesure cette réalité symbolique qui nous gouverne sans l’admettre.
références bibliographiques
apergis Nicholas et cooray arusha (2013), « Forecasting Fiscal Variables: Only a Strong Growth Plan can Sustain the Greek Austerity Programs - Evidence from Simultaneous and Structural Models », CAMA Working Paper, n° 25.
Bachir-Benlahsen Myriam (1991), « Faire de sagesse vertu. La réforme du code de la nationalité », Politix, vol. 4, n° 16, p. 33-40.
Barthes roland (1972), Mythologies, Londres, Granada.
Bosco anna et Mcdonnell duncan (2013), « Introduction: The Monti Government and the Downgrade of Italian Parties », in anna Bosco et duncan
Mcdonnell (dir.), Italian Politics : From Berlusconi to Monti, Oxford, New York, Berghahn Books, p. 37-56.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
177
capaldo Jeronim et izurieta alex (2013), « The Imprudence of Labour Market Flexibilization in a Fiscally Austere World », International Labour Review, vol. 152, n° 1, p. 1-26.
castoriadis cornelius (1999), Héritage et révolution. Figures du pensable, Paris, Seuil.
chevallier Jacques (1996), « L’entrée en expertise », Politix, vol. 9, n° 36, p. 33-50.
cussó roser et Gobin corinne (2008), « Du discours politique au discours expert : le changement politique mis hors débat ? », Mots. Les langages du politique, vol. 88, p. 5-11.
de vogli roberto (2013), « Financial Crisis, Austerity, and Health in Europe », The Lancet, vol. 382, n° 9890, p. 391.
dobry Michel (2009), Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de Sciences Po.
drache daniel (1999), « Globalization: Is There Anything to Fear ? », CSGR Working Paper, n° 23/99.
dyson Kenneth et Featherstone Kevin (1996), « Italy and EMU as Vincolo Esterno: Empowering the Technocrats, Transforming the State », South European Society and Politics, vol. 1, n° 2, p. 272-299.
Garric Nathalie et léglise isabelle (dir.) (2012), Discours d’experts et d’exper-tise, Berne, Peter lang.
hay colin et rosamond Ben (2002), « Globalization, European integration and the discursive construction of economic imperatives », Journal of European Public Policy, vol. 9, n° 2, p. 147-167.
hirst Paul et Grahame thompson (2002), « The Future of Globalization », Journal of the Nordic International Studies Association, vol. 37, n° 3, p. 247-265.
horeth Marcus (1999), « No Way out for the Beast ? The Unsolved Legitimacy Problem of European Governance », Journal of European Public Policy, vol. 6, n° 2, p. 249-268.
Jones eric (2010), « The Economic Mythology of European Integration », Journal of Common Market Studies, vol. 48, n° 1, p. 89-109.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia178
Karanikolos Marina et al. (2013), « Financial Crisis, Austerity, and Health in Europe », The Lancet, vol. 381, n° 9874, p. 1323-1331.
Kleinknecht alfred et ter Wengel Jan (1998), « The Myth of Economic Globalisation », Cambridge Journal of Economics, vol. 22, n° 4, p. 637-647.
l’hôte emilie (2010), « New Labour and Globalization: Globalist Discourse with a Twist ? », Discourse et Society, vol. 21, n° 4, p. 355-376.
lalande andré (2002), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF.
lascoume Pierre (1993), « Foucault et les sciences humaines, un rapport de biais : l’exemple de la sociologie du droit », Criminologie, vol. 26, n° 1, p. 35-50.
lefort claude (1986), Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil.
lequesne christian et rivaud Philippe (2001), « Les comités d’experts indépendants : l’expertise au service d’une démocratie supranationale ? », Revue française de science politique, vol. 51, n° 6, p. 867-880.
lodge david et rodríguez-vives Marta (2013), « How Long can Austerity persist ? The Factors that Sustain Fiscal Consolidations », European Journal of Government and Economics, vol. 2, n° 1, p. 5-24.
Mair Peter et thomassen Jacques (2010), « Political Representation and Government in the European Union », Journal of European Public Policy, vol. 17, n° 1, p. 20-35.
Majone Giandomenico (1998), « Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards », European Law Journal, vol. 4, n° 1, p. 5-28.
Majone Giandomenico (1999), « The Regulatory State and its Legitimacy Problems », West European Politics, vol. 22, n° 1, p. 1-24.
Matagne Geoffroy (2001), « De l’État social actif à la politique belge de l’emploi », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1737-1738, p. 5-79.
Mestrum Francine (2008), « La “gouvernance” comme processus de dépoli-tisation par le déplacement du conflit », in roser cussó et al., Le conflit social éludé, Louvain-la-Neuve, Bruylant, p. 141-160.
Moravcsik andrew (2002), « In Defence of the “Democratic Deficit” : Reassessing the Legitimacy of the European Union », Journal of Common Market Studies, vol. 40, n° 4, p. 603-624.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
Varia •
po
lit
iqu
e e
ur
op
ée
nn
e n
°44
| 20
14
179
Pierson Paul (2002), « Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent Democracies », Revue française de sociologie, vol. 43, n° 2, p. 369-406.
Piven Frances Fox (1995), « Is It Global Economics or Neo-Laissez Faire? », New Left Review, n° 213, p. 107-114.
Przeworski adam et Wallerstein Michael (1988), « Structural Dependence of the State on Capital », The American Political Science Review, vol. 82, n° 1, p. 11-29.
radaelli claudio M. (1998), « Networks of Expertise and Policy Change in Italy », South European Society and Politics, vol. 3, n° 2, p. 1-22.
radaelli claudio M. (2000), « Logiques de pouvoir et récits dans les politiques publiques de l’Union européenne », Revue française de science politique, vol. 50, n° 2, p. 255-275.
robert cécile (2003), « L’expertise comme mode d’administration communautaire : entre logiques technocratiques et stratégies d’alliance », Politique européenne, n° 11, p. 57-78.
rosamond Ben (2000), « Europeanization and Discourses of Globalization: Narratives of External Structural Context in the European Commission », CSGR Working Paper, n° 51/00.
russel duncan et Benson david (2013), « Green Budgeting in an Age of Austerity: a Transatlantic Comparative Perspective », Environmental Politics, DOI :10.1080/09644016.2013.775727.
Sachs Jeffrey d. et Warner andrew (1995), « Economic Reform and the Process of Global Integration », Aslund, Anders ; Fischer, Stanley, Brookings Papers on Economic Activity, n° 1.
Schäfer armin et Streeck Wolfgang (dir.) (2013), Politics in the age of auste-rity, Cambridge, Polity Press.
Scharpf Fritz W. (1997), « Economic integration, democracy and the welfare state », Journal of European Public Policy, vol. 4, n° 1, p. 18-36.
Scharpf Fritz W. (2002), « The European Social Model: Coping with the Challenge of Diversity », Journal of Common Market Studies, vol. 40, n° 4, p. 645-670.
Schmidt vivien a. (2005), « Democracy in Europe: The Impact of European Integration », Perspectives on Politics, vol. 3, n° 4, p. 761-779.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan
• Varia180
Schmidt vivien a. (2010), « Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited. Input, Output and Throughput », KFG Working Paper, n° 21.
Siroux Jean-louis (2008), « La dépolitisation du discours au sein des rapports annuels de l’Organisation mondiale du commerce », Mots. Les langages du politique, n° 88, p. 13-23.
Stevens annick (2007), « Politique (le) », in Pascal durand (dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, Bruxelles, Editions Aden, p. 347-350.
telò Mario (2013), « L’interaction de l’Italie avec la construction européenne de la Iere à la IIe République : continuité et discontinuité », in Mario telò,
Giulia Sandri et luca tomini (dir.), L’état de la démocratie en Italie, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 33-50.
Walsh James i. (1999), « Political Bases of Macroeconomic Adjustment: Evidence from the Italian Experience », Journal of European Public Policy, vol. 6, n° 1, p. 66-84.
Watson Matthew et hay colin (2004), « The Discourse of Globalisation and the Logic of No Alternative: Rendering the Contingent Necessary in the Political Economy of New Labour », Policy and Politics, vol. 30, n° 4, p. 289-305.
Arthur Borriello
Doctorant, Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL), Université Libre de [email protected]
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité li
bre
de B
ruxe
lles
- -
164
.15.
69.3
1 -
09/1
0/20
14 1
6h41
. © L
'Har
mat
tan
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité libre de Bruxelles - - 164.15.69.31 - 09/10/2014 16h41. ©
L'Harm
attan