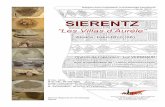Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IV e millénaire sur le site Néolithique...
Transcript of Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IV e millénaire sur le site Néolithique...
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Philippe LEFRANC, Rose-Marie ARBOGAST,
Fanny CHENAL, Erwin HILDBRAND,
Matthias MERKL, Christian STRAHM,
Samuel VAN WILLIGEN et Marie WÖRLE
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IV e millénaire sur le site Néolithique récent de Colmar « Aérodrome » (Haut-Rhin)
RésuméLe site de Colmar « Aérodrome », fouillé en 2008 par l’INRAP, a livré
soixante-quinze fosses de plan circulaire identifiées à des fosses de stockage. Aucun rejet détritique évoquant une activité domestique proche n’a été observé. Dix-neuf fosses ont livré des restes humains dont treize inhuma-tions primaires et onze dépôts secondaires. Cinq dépôts d’animaux entiers ou partiels (suinés et cervidés) ainsi que deux gigots de chevreuil ont été mis au jour, isolés ou reposant dans des creusements accueillant des sépul-tures, mais toujours séparés des corps humains par une épaisseur de sédiment. La céramique recueillie et une série de dates radiocarbones permettent de dater l’ensemble du site du Néolithique récent, et de l’attri-buer plus précisément à la culture de Munzingen.
La majorité des individus inhumés sont en position fléchie sur le côté. On note une tombe « à étage » comptant trois niveaux d’inhumations, le niveau inférieur étant occupé par une sépulture asymétrique réunissant un adulte en position fléchie et un enfant en position inorganisée. Plusieurs indices de réinterventions sur les squelettes humains – mais également animaux – ont été notés.
Cinquante-six perles en cuivre formant deux « colliers » ont été déposées auprès d’un corps reposant sur le ventre. Ces objets connaissent d’assez nombreux parallèles dans la culture de Cortaillod où ils apparaissent trois fois sous forme de dépôts. Les analyses réalisées sur huit des perles de Colmar montrent qu’elles ont été façonnées dans un cuivre arsénié connu sous le nom de cuivre du Mondsee. Ce cuivre, probablement originaire du Nord-Est des Alpes, joue un rôle majeur dans l’expansion de la première métallurgie. Au vu de leur répartition et de l’origine de la matière première utilisée, on peut supposer que les perles cylindriques caractéristiques du IV e millénaire sont mises en forme en territoire Cortaillod à partir de baguettes de cuivre impor-tées (par l’intermédiaire de la culture de Pfyn et/ou de Mondsee ?). Plutôt qu’à des parures, peut-être faut-il les identifier à des objets d’échange.
Nous proposons de reconnaitre à Colmar un ensemble fonctionnant à la fois comme une petite nécropole et comme un secteur dévolu à des pratiques rituelles impliquant des offrandes sous forme animale et, peut-être, humaine.
Mots-clésInhumations en fosses rondes, dépôts d’animaux, première métallurgie,
perles en cuivre du Mondsee, Alsace, Munzingen, Cortaillod.
690 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
AbstractExcavations carried out by INRAP at the Colmar site in 2008 revealed the
presence of 75 circular pits identified as storage pits. No layers of waste suggesting possible nearby domestic activity were found. A total of 19 of the structures contained human remains among which there were 13 primary burial sites and 11 secondary burial sites. The ceramic items collected and a series of radiocarbon dates prove that the site dates back to the Late Neolithic and can be more precisely linked to the Munzingen culture, which covered an area from the south of Upper Alsace to the Wetterau region in Germany.
Most of the bodies were in a contracted position, described as “regular” or “conventional”, that made it possible to identify a majority of real tombs. One pit shows three layers of inhumation, the lower containing an adult in the regular position and a child in a non-regular position. The two bodies were in close contact. This type of asymmetric burial, relatively common in the recent Upper Rhine Neolithic, seems to represent ritual killings of “escorts” during the burial of an important person. There is some evidence that post-decompositional manipulations occurred on human corpses as well as on animal carcasses found nearby.
Five whole or partial animal burials (suidae and cervidae) and the legs of two roe deer were discovered. They were either isolated or in the same pits as the human bodies, but always separated from these by a layer of sediment.
The practice of laying whole animals in circular pits seems to follow the same pattern as that of human burials and it is likely that both practices are a part of the same symbolic system. Studies of the Colmar pits provide several important clues to help understand the numerous aspects linked to the ritual burials in circular pits. In the present state of our knowledge, we favour the hypothesis of ritual offerings, involving animals of various kinds, from whole carcasses to isolated parts. These offerings were never clearly associated with a given individual, but may have been devoted to all the persons buried on the site or to supernatural entities.
56 copper beads making up two “necklaces” were found near a body lying on its stomach. A number of counterparts to these objects also existed in the Cortaillod culture where they have been found three times in structured deposits. Laboratory research carried out on eight of the Colmar beads shows that they are made of arsenical copper known as Mondsee copper. This copper, which probably comes from the north-eastern Alps, played a major part in the expansion of early prehistoric metallurgy. Given the locations of the discoveries and the origin of the raw material, one can assume that the cylindrical beads characteristic of the 4th millennium were produced in the Cortaillod area from copper bars imported via the Pfyn and/or the Mondsee cultures. They were perhaps a basis of exchange rather than ornaments.
The Colmar site may have been a small necropolis, but also an area devoted to ritual practices involving animal and perhaps even human offe-rings. The latter hypothesis is suggested by the association – very unlikely in a strictly funerary setting – of bodies in non-regular positions and the presence of prestige items. Individuals buried in a regular position invariably lack grave goods and no prestige items are found in conventional burials.
KeywordsBurials in circular pits, animal burials, early prehistoric metallurgy,
copper beads, Mondsee, Alsace, Munzingen, Cortaillod.
L’intérêt de ce site tient, d’une part, à sa localisation dans un secteur géographique encore très peu documenté où l’on situe la frontière entre les groupes de Michelsberg et de Munzingen et, d’autre part, au nombre élevé d’inhumations et de dépôts d’animaux en fosses de plan circulaire mis au jour. Les cinquante-six perles en cuivre déposées auprès d’un individu
INTRODUCTION
Le site de Colmar « Aérodrome » a été découvert en 2007 lors d’une opération de diagnostic archéologique motivée par l’installation d’une usine au nord-ouest de la ville puis fouillé l’année suivante par l’INRAP.
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 691
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
gisant en position non-conventionnelle constituent un ensemble aujourd’hui sans équivalent dans la vallée du Rhin.
Les découvertes de Colmar s’inscrivent dans un axe de recherches qui a récemment bénéficié de plusieurs travaux de synthèse (Jeunesse, 2010 ; Lefranc et al., 2010) : la pratique des inhumations en fosses de plan circulaire au cours du Néolithique récent (Jungneo-lithikum du système chronologique rhénan). Plusieurs dépôts de Colmar ont déjà été rapidement décrits ailleurs et ont joué un rôle non négligeable dans la définition des caractères de ce phénomène dans le Sud de la plaine du Rhin supérieur (Lefranc et al., 2010). Cependant ce site particulier offre d’autres aspects non
moins intéressants qu’il nous a semblé nécessaire de présenter dans un article de synthèse.
La pratique de l’inhumation en fosses de plan circulaire, qui touche plusieurs aires culturelles, semble apparaître dans le Néolithique moyen méditerranéen puis se diffuser vers l’est, de la vallée du Rhône à la Transdanubie en touchant successivement les cultures de Michelsberg, Munzingen, Münchshöfen, Baalberg et Lengyel tardif (Jeunesse, 2010). Dans la plupart des groupes culturels concernés, cette pratique particulière coexiste avec d’autres traditions funéraires. Ce n’est pas le cas dans le Sud de la plaine du Rhin supérieur, secteur géographique qui a fourni – avec plus d’une centaine de structures contenant des restes humains –
Fig. 1 – Localisation du site de Colmar « Aérodrome » dans le cadre du Sud de la plaine du Rhin supérieur (DAO P. Lefranc).Fig. 1 – Location of the Colmar “Aérodrome” site in the south section of the Upper Rhine plain (CAD P. Lefranc).
692 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
un corpus des plus étoffé et où l’inhumation en fosse circulaire paraît quasi-exclusive.
On distingue au sein du corpus européen, les sujets inhumés sur le côté, en position fléchie et accompagnés ou non de mobilier funéraire, et les individus gisant dans des positions aléatoires et n’ayant visiblement bénéficié d’aucun geste funéraire : les premiers entrent dans la catégorie des inhumations en position conventionnelle, les seconds dans celle des inhumations en position non conventionnelle ou désordonnée. Les dépôts simultanés où figurent un individu en position conventionnelle et un ou plusieurs sujets en position désordonnée ont été, dans plusieurs publications récentes, assimilés à des sépultures « asymétriques » (Testart, 2004) et interprétés en terme d’accompagnement (Gallay, 2006 ; Jeunesse, 2010 ; Boulestin, 2008 ; Lefranc et al., 2010).
La pratique consistant à déposer des animaux entiers dans des fosses de plan circulaire semble suivre la même trajectoire que celle des inhumations et il est
probable que les deux pratiques s’inscrivent au sein d’un même système symbolique. Sur ce dernier point en particulier, l’analyse des dépôts de Colmar, que nous abordons comme différentes parties d’un ensemble cohérent, livre selon nous plusieurs clés d’interpréta-tions importantes pour la compréhension de nombreux aspects du rituel du dépôt en fosse de plan circulaire.
PRÉSENTATION DU SITE
Étudié sur une surface d’environ 4 000 m2, le site de Colmar « Aérodrome » est implanté à 190 m NGF sur le cône de déjection des rivières de la Fecht et de la Weiss qui se déploie en éventail au sortir de la vallée de Munster et qui assure la transition entre les coteaux des collines sous-vosgiennes et la plaine du Rhin (fig. 1). Localement, ce cône alluvial, mis en place au cours du Riss, est recouvert par des lambeaux de lœss
Fig. 2 – Colmar « Aérodrome », plan du site et répartition des restes humains et animaux (DAO P. Lefranc).Fig. 2 – Colmar “Aérodrome”, site map and distribution of human and animal remains (CAD P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 693
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
sableux remaniés ainsi que par des formations limono-sableuses rougeâtres déposées par des chenaux holo-cènes. C’est sur un de ces minces placages lœssiques qu’ont été observés soixante-quinze creusements de plans circulaires attribués au Néolithique récent.
Les structures
La plus forte densité de creusements se rencontre à l’ouest du décapage où soixante-trois des soixante-quinze fosses identifiées s’inscrivent dans un cercle de 25 m de diamètre (fig. 2). Au centre de cet ensemble la concentration est telle que les structures apparaissent contiguës ou, dans cinq cas, se recoupent. En périphérie de ce noyau, qui couvre une surface d’à peine 100 m2, la trame est un peu plus lâche.
Les structures sont assez bien conservées avec des profondeurs oscillant entre 0,60 m et 1,10 m. Les diamètres à l’ouverture sont, le plus souvent, compris entre 1,20 et 1,60 m (fig. 3). Trois types de creusements ont été distingués. Le plus fréquent, avec une cinquan-taine d’occurrences, renvoie aux beutelförmige Gruben des auteurs de langue allemande, creusements aux fonds concaves et aux parois renflées constituant la plus grande part du corpus des fosses étudiées sur les sites du Néolithique récent régional (Thévenin et al., 1978 ; Jeunesse et Sainty, 1986 ; Lefranc, 2001 ; Kuhnle et al.,
1999-2000). Le second type (six occurrences) diffère assez peu du précédent si ce n’est par la présence d’un fond plat ; il trouve de bons parallèles sur le site de Rosheim « Leimen » où deux creusements morpho-logiquement proches ont été datés du Munzingen récent (Lefranc et Boës, 2006).
Le dernier type observé à Colmar (seize occurrences) présente un fond plat et des parois sub-verticales ; rare sur les habitats attribués au Michelsberg III-IV ou au Munzingen B, on le rencontre assez fréquemment à la fin du Néolithique moyen, notamment en contexte Bischheim occidental du Rhin supérieur (Jeunesse et al., 2002-2003) ainsi qu’au Munzingen Ancien (Schweitzer, 1987 ; Schweitzer et Fulleringer, 1973).
Les remplissages, d’une grande homogénéité, sont constitués par un sédiment lehmique de teinte beige à brune, plus ou moins mêlé aux lœss sableux du substrat encaissant. Quelques structures, comblées par une couche homogène de lehm, semblent avoir été rapide-ment et intentionnellement rebouchées, opération ayant par ailleurs favorisé leur conservation sous leur forme originelle. Dans la majorité des cas, les fosses présentent une alternance de couches de sédiment lehmique et de niveaux composés de lœss sableux issus de l’érosion, voire, dans certains cas, de l’effondrement des parois. Il faut en déduire que la plupart des creusements sont restés ouverts après leur abandon en tant que structures de stockage.
Fig. 3 – Colmar « Aérodrome », exemples de structures de stockage. Les structures 33 et 48 ont livré des restes de cervidés ; les structures 37 et 61 contenaient les fragments d’un même grand vase de stockage : fig. 10, no 1 (DAO P. Girard).Fig. 3 – Colmar “Aérodrome”, examples of storage structures. Structures 33 and 48 contained cervidae remains; structures 37 and 61 contained fragments of the same big storage vase: fig. 10, no. 1 (CAD P. Girard).
694 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
À Colmar, les seuls éléments pouvant évoquer le stockage sont les deux grands vases complets retrouvés dans les structures 21A, 37 et 61 (cf. 3.1). Avec soixante-quinze structures de stockage regroupées sur une aire réduite, l’ensemble de Colmar se démarque nettement des autres sites régionaux. En Alsace, les habitats de plaine les mieux documentés se présentent sous forme de petites grappes dispersées sur de vastes superficies. À Holtzheim par exemple, habitat fouillé sur une surface de près de quatre hectares (Kuhnle et al., 1999-2000 ; Lefranc, 2001), on observe quatre petits groupes composés chacun d’une dizaine de silos attribués au Munzingen récent et distants de 80 à 100 m. Le même schéma se répète à Entzheim « Aéro-parc » (Croutsch et al., 2007) et Entzheim « Les Terres de la Chapelle » (Lefranc et Chenal, 2008), donnant l’image d’un habitat dispersé caractérisé par de petites concentrations de silos diachrones, intégrés dans des cycles d’abandon/création et reliés à des unités domes-tiques distinctes (Jeunesse et Sainty, 1986). Au sein de chaque petite concentration figurent des structures de stockage désaffectées réutilisées comme fosses de rejets, indice de la proximité immédiate entre les zones dévolues au stockage et les aires d’activités.
L’ensemble de Colmar se distingue de ces habitats non seulement par la densité des creusements, mais également par l’absence de rejets détritiques : nous proposons de l’assimiler à une aire de stockage loca-lisée à distance de l’habitat et ayant été utilisée sur la longue durée. Les inhumations et les dépôts d’animaux ont été mis en place dans des creusements qui ne se distinguent en aucun point des fosses de stockage.
Chronologie de l’occupation
L’absence de mobilier détritique interdit toute tenta-tive de périodisation poussée mais, compte tenu du nombre élevé de fosses adjacentes ou se recoupant, il est possible d’envisager une première occupation du secteur antérieure au Munzingen récent, seule étape représentée par le mobilier recueilli. Les datations radiocarbones conventionnelles réalisées sur ossements humains et animaux présentent des écarts très impor-tants imputables au faible taux de collagène conservé ; elles permettent cependant d’entrevoir une occupation du site qui pourrait commencer dès le Néolithique moyen et qui se poursuit au IVe millénaire (fig. 4).
En plus des vases de stockage déjà mentionnés et d’un vase en dépôt auprès d’une inhumation (st. 41), l’occupation du site au Néolithique récent est confirmée par deux dates radiocarbones respectivement réalisées sur un individu issu d’une sépulture « à étage » (st. 49, Gd-30174 : 4500 ± 160 BP) et sur le faon déposé dans la structure 33 (Gd-19194 : 4890 ± 90 BP). Les restes d’un second faon, déposés dans une structure recoupant la fosse 49, ne peuvent être antérieurs au Munzingen B. La sépulture 23A qui a livré les objets en cuivre appar-tient, nous y reviendrons plus longuement, au même horizon. La fosse 17, contenant un individu et un suiné, est datée d’un vaste horizon recouvrant la fin du Bischheim rhénan, l’épi-roessen et le Munzingen A (Gd-30169 : 5310 ± 170 BP). S’il est impossible de trancher entre ces trois propositions, cette date permet au moins d’établir que l’occupation du site et son utilisation comme aire sépulcrale commencent très probablement avant le Munzingen B.
Enfin, la question d’une possible occupation du site dès le milieu du Ve millénaire doit être posée : la data-tion radiométrique réalisée sur les ossements de l’indi-vidu 56 a donné un résultat surprenant (Gd-30165 : 5755 ± 115 BP) qui coïncide en partie avec les dates admises pour le Bischheim rhénan (Denaire, 2009) et placerait donc la sépulture dans le Néolithique moyen. On connaît dans le pays de Bade et en Alsace, deux inhumations en silos antérieures à l’horizon Michelsberg : une inhumation éventuellement Bischheim à Weisweil « Oberendinger Weg » (Stöckl et Neubauer-Saurer, 1990 ; Jeunesse et al., 2003) et une inhumation bien datée du Bischheim occidental du Rhin supérieur à Holtzheim « Altmatt » (Lefranc, 2001). La date obtenue ne peut donc être d’emblée rejetée. Il faut cependant souligner que l’attribution de l’inhuma-tion 56 à la seconde partie du Néolithique moyen dépend uniquement du crédit que l’on veut bien accorder au résultat de l’analyse radiométrique et que ce dernier peut malheureusement être discuté 1.
INHUMATIONS ET DÉPÔTS D’ANIMAUX
Les inhumations
Dix-neuf fosses ont livré des restes humains répartis entre treize inhumations primaires (tabl. 1) et onze dépôts secondaires (tabl. 2). Les inhumations ont été
Fig. 4 – Colmar « Aérodrome », valeurs calibrées des datations radiocarbone provenant de différentes structures du site.Fig. 4 – Colmar “Aérodrome”, calibrated radiocarbon dates of different structures on the site.
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 695
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
observées dans dix structures : il s’agit de neuf inhu-mations simples et de quatre individus déposés dans un même creusement. Les données paléobiologiques sont synthétisées dans le tableau 1. Pour les dépôts primaires, on recense trois enfants et dix adultes dont quatre seulement, deux hommes et deux femmes, ont pu faire l’objet d’une diagnose sexuelle selon la méthode DSP (Murail et al., 2005), corpus nettement insuffisant pour autoriser une étude du recrutement au sein de cette aire sépulcrale.
Répartition et localisation par rapport à l’habitat
Deux inhumations (st. 20 et 56) respectivement loca-lisées dans l’angle nord-est et en limite sud de l’emprise, apparaissent isolées ; les autres (st. 17, 23A, 26, 41, 49, 51, 52, 110) s’inscrivent dans un cercle d’une vingtaine de mètres de diamètre correspondant au secteur où la densité de creusements est la plus importante (fig. 2).
On peut supposer que les creusements utilisés comme lieu de sépulture se trouvent en périphérie du secteur réservé aux activités domestiques, qui n’a cependant pas pu être localisé. Le cas n’est pas isolé en Alsace : sur le site de Reichstett « Rue Ampère », par exemple F. Blaizot
a bien montré que les inhumations Michelsberg se répar-tissaient en périphérie sud du secteur réservé aux acti-vités domestiques (Blaizot, 2001) ; sur ce site, toutes les structures riches en artefacts et en dépôts organiques se concentrent au nord d’un paléo-vallon alors que les inhumations sont localisées au sud de ce dernier, dans un secteur où les creusements, répartis selon une trame plus lâche, n’ont livré que de rares tessons erratiques. Autre exemple à Rosheim « Leimen », site où les inhu-mations datées du Michelsberg moyen sont réparties au sein d’un ensemble de silos d’où les rejets détritiques sont totalement absents ; l’unique structure riche en mobilier contemporain, localisée lors du diagnostic dans une zone n’ayant pas été prescrite à la fouille, est située à quelque 130 mètres au nord-est des inhumations (Lefranc et Boës, 2006).
Localisation dans la fosse sépulcrale,positions et orientations des individus
À une seule exception près (individu 110, fig. 5), les squelettes ne reposent pas sur le fond des creuse-ments mais au sein des comblements, élément plai-dant nettement en faveur d’une réutilisation de structures de stockage désaffectées et partiellement comblées. Les fosses 17, 41 et 56 par exemple (fig. 6 et 8), offrent des stratigraphies où se distinguent clai-rement les différents épisodes de comblement par ruissellement et/ou effondrement des parois inter-venus avant le dépôt des corps. Ces derniers peuvent occuper l’espace central du creusement (ind. 20, 26, 41, 52, 56, 49A, 49D) ou être installés le long des parois (ind. 41, 49B, 51).
La majorité des individus étudiés à Colmar a été déposée en position fléchie sur le côté : cinq sur le côté droit et quatre sur le côté gauche. La plupart des sujets sont en position fortement contractée (ind. 26, 41, 49A, 51, 56, 110), position considérée comme « conven-tionnelle » pour les inhumations du Néolithique récent régional (Jeunesse, 2010), d’autres, en flexion plus lâche (ind. 20 et 49A). Un jeune enfant a été déposé en décubitus, membres inférieurs en extension (ind. 49B). La position initiale de l’individu 17, fortement remanié, n’a pu être établie (fig. 8). Enfin, deux sujets, sur lesquels nous reviendrons, gisent dans des positions que l’on peut qualifier de « désordonnées » et n’ont manifestement pas été apprêtés : il s’agit d’un enfant déposés auprès d’un adulte qui, lui, est en position conventionnelle (ind. 49D, fig. 7) et d’un adulte en procubitus (ind. 23, fig. 12).
Les orientations les plus nombreuses s’inscrivent dans un quadrant nord-ouest (ind. 20 diag., 26, 49B, 49D et 110) ; suivent les orientations au nord-est (ind. 23, 49A, 49C, 56), puis les orientations au sud-est (ind. 17 et 51) et au sud-ouest (ind. 52 et 41). Ce large éventail se retrouve en basse Alsace où il est bien difficile d’isoler une tendance majoritaire, les orienta-tions s’inscrivant dans les quadrants sud-est, nord-ouest et nord-est apparaissant dans des proportions équiva-lentes (Lefranc et al., 2010). En haute Alsace, la situa-tion paraît différente mais il faut souligner que le
Tabl. 1 – Les inhumations primaires : données paléobiologiques.Table 1 – The primary burials: palaeobiological data.
Ind. Âge Sexe Espace de décomposition 17 > 23-30 ans ND vide 20 > 23-30 ans M colmaté 23A > 23-30 ans ND colmaté 26 entre 18 et 21 ans ND ND 41 de 5 ans 7 mois Ø ND à 6 ans 9 mois 49A > 50ans F colmaté 49B entre 18 et 36 mois Ø ND 49C > 23-30 ans ND vide 49D 9 à 10 ans Ø vide 51 Adulte > 15 - 19 ans ND ND 52 20 à 49 ans F colmatage différé ? 56 20 à 29 ans M vide ? 110 6 ans et demi à 7 ans Ø vide
Tabl. 2 – Les dépôts secondaires : données paléobiologiques.Table 2 – The secondary deposits: palaeobiological data.
St. Dépôt secondaire Âge Sexe 11 pariétal ad. ND 12 diaphyse fémorale ad. ND 14 bloc crânio-facial ad. ND 33 calotte crânienne ad. ND 45 côte/métacarpien ad. ND 48 ulna/métacarpien ad. ND 49 radius/phalange imm. ND 51 calotte crânienne ad. ND 65 tibia ad. ND 66 coxal/ulna/scapula/mandibule > 50 ans F 67 calcaneus ad. ND
696 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Fig. 5 – Relevés des inhumations primaires des fosses 52 et 110 et des dépôts secondaires des fosses 14 et 66 (DAO C. Leyenberger et P. Lefranc).Fig. 5 – Survey of primary burials in pits 52 and 110 and of the secondary deposits in pits 14 and 66 (CAD C. Leyenberger & P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 697
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Fig. 6 – Relevés des inhumations des fosses 20, 26, 41 et 51 (DAO C. Leyenberger et P. Lefranc).Fig. 6 – Surveys of burials in pits 20, 26, 41 and 51 (CAD C. Leyenberger & P. Lefranc).
698 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
corpus est beaucoup plus modeste, ce qui est suscep-tible d’introduire une importante distorsion : à Colmar « Aérodrome », les orientations les plus nombreuses se rapprochent du nord et de l’est ; on note également une orientation au sud-est et deux individus se rapprochant d’une orientation au sud.
Les espaces de décomposition
La restitution des espaces de décomposition des corps se heurte à plusieurs difficultés dont le mauvais état de conservation des restes osseux n’est pas la moindre (ind. 23, 41, 49C, 51). Par ailleurs, il est fréquent qu’un individu bien conservé présente à la fois des indices de décomposition en espace vide et de décomposition en espace colmaté (déplacement d’os en dehors du volume corporel vs maintien en déséquilibre potentiel par rapport au volume extérieur du corps ; ind. 49A, 52 et 56). Dans ce cas, il est évidemment tentant d’envisager un colmatage différé engendré par la présence d’un contenant souple en matière périssable enveloppant le corps du défunt ; or, les études menées à ce sujet sont encore peu nombreuses et les interprétations avancées parfois contradictoires. Nous resterons donc très prudents vis-à-vis de ces hypothèses, dans l’attente de validations d’arguments
plus systématiques, quelle que soit la période ou l’aire géographique concernée.
Une décomposition en espace vide peut être consi-dérée comme certaine pour les individus 17, 49D et 110 sur lesquels nous reviendrons plus longuement.
Les interventions post-décompositionelles
Deux cas de réinterventions sur des corps s’étant décomposés dans des fosses demeurées accessibles ont pu être mis en évidence par l’étude taphonomique.
Pour l’enfant mis au jour dans la fosse 110 (fig. 5) et qui repose en position contractée le long de la paroi nord, on note une « mise à plat » des ossements, en contact strict les uns avec les autres. Une côte se trouve en dehors du volume corporel et aucun os ne se trouve en déséquilibre potentiel par rapport au volume exté-rieur du corps. Ces observations vont dans le sens d’une décomposition en espace vide. Le déplacement très important du bloc crânio-facial retrouvé à 80 cm au sud du corps et à peu près au même niveau que celui-ci ne peut être, quant à lui, expliqué que dans le cadre d’une intervention postérieure au dépôt du corps. La position de la mandibule, demeurée en place en amont des vertèbres cervicales, ainsi que la présence d’une première incisive supérieure au niveau de cette
Fig. 7 – Relevés des inhumations de la « tombe à étage » de la structure 49 (DAO C. Leyenberger et P. Lefranc).Fig. 7 – Surveys of burials in structure 49, multi-levelled grave (CAD C. Leyenberger & P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 699
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
dernière, permettent d’appréhender le moment du déplacement du crâne, intervenu après la décompo-sition complète des chairs. Cette manipulation, qui n’a pas perturbé le reste du squelette demeuré en connexion peut être imputée à une intervention anthropique.
Le cas de l’individu déposé dans la fosse 17 est encore plus parlant (fig. 8) : ce dernier n’est que partiel-lement représenté par le crâne, les bras et les mains, les deux clavicules, une fibula, quelques côtes et vertèbres. La présence de nombreux os en dehors du
volume corporel indique une décomposition en espace vide, proposition par ailleurs étayée par la stratigraphie dans la mesure où une partie des ossements ont été scellés par une épaisse couche de lœss pur issue de l’effondrement des parois du silo.
Les quatre premières vertèbres cervicales, en connexion stricte, ainsi que la connexion préservée de l’atlas et du bloc crânio-facial permettent d’envisager, ici aussi, un dépôt primaire et une intervention anthro-pique intervenue sur un corps en cours de décomposition,
Fig. 8 – Relevés des inhumations et des dépôts de suinés des fosses 17 et 56 (DAO C. Leyenberger et P. Lefranc).Fig. 8 – Surveys of burials and Suidae deposits in pits 17 and 56 (CAD C. Leyenberger & P. Lefranc).
700 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
intervention se traduisant notamment par le prélève-ment d’importants segments anatomiques (le bassin et la plus grande partie des membres inférieurs notam-ment). Le positionnement particulier des clavicules, déposées côte à côte à proximité du crâne ne laisse que très peu de doutes quant au caractère anthropique de l’intervention.
Encore une fois, la datation radiométrique (Gd-30169 : 5310 ± 170 BP) correspond à une large fourchette recouvrant la fin du Bischheim, les groupes épiroesseniens et le Munzingen ancien. Un examen du corpus régional montre que les manipulations sont relativement fréquentes (Lefranc et al., 2010 et 2011a). Le caractère ancien de la plupart des découvertes ne facilite malheureusement pas la mise en évidence de tels gestes mais la plupart des sites ayant récemment bénéficié de l’intervention d’anthropologues ont livré leur lot de corps manipulés : déplacement du crâne à Geispolsheim « Forlen » (Lefranc et al., 2011b), prélè-vement du bloc crânio-facial dans la fosse 8, zone 2, de Didenheim-Morschwiller (Denaire, 2007), ainsi qu’à Kiechlinsberg – Kr. Emmendingen (Nickel, 1998) et à Bruchsal-Aue (fosse 5, ibid.). Ces réinterventions, parfois suivies de prélèvements d’ossements, sur des squelettes déposés dans les silos demeurés accessibles peuvent, en partie, expliquer la présence des ossements isolés retrouvés dans le comblement de certaines fosses. À Colmar, des os isolés ou de petits ensembles d’osse-ments, apparaissent dans onze structures.
Ossements en position secondaire
Les ossements en position secondaire constituent le seul matériel humain recueilli dans le comblement de neuf silos. Deux figurent dans les remplissages de structures ayant également livré des inhumations : dans le remplissage sommital d’un silo accueillant une inhumation (st. 51, fig. 6) et au même niveau que l’in-dividu 49A. Un fragment de calotte crânienne reposait au même niveau que le faon complet déposé dans la structure 33 et deux ossements dans le remplissage de la fosse recelant les restes d’un second faon (st. 48).
Leur répartition sur le site dessine une auréole s’étendant en périphérie de la zone où se concentrent la majorité des creusements ayant livré des inhumations primaires (fig. 2) : les structures 11, 12 et 14 sont regroupées en limite sud-est de cette zone ; les struc-tures 45, 48, 65, 66 et 67 dessinent une nette concen-tration en périphérie ouest et, enfin, la fosse 33 apparaît relativement isolée vers le nord. Cette distribution des dépôts secondaires et leur regroupement dans des secteurs restreints peuvent bien sûr être aléatoires mais pourraient également traduire une gestion particulière des restes humains au sein de cet espace.
Il est difficile de déterminer si la présence d’osse-ments isolés est accidentelle ou si elle relève de gestes intentionnels : deux dépôts seulement procèdent très probablement de la seconde proposition. Il s’agit de la dizaine d’ossements exhumés dans la structure 66 (fig. 5) et qui appartiennent probablement à un même individu adulte de sexe féminin, ainsi que du bloc crânio-facial
de la structure 14 qui était accompagné par un pendentif sur défense de suidé (fig. 5). L’assemblage crâne/parure évoque une découverte de Merxheim « Trummelmaten » (Treffort et Dumont, 2000) où un silo contenait un crâne d’enfant accompagné d’un collier de perles, dont quatre en forme de hache évoquant les exemplaires issus de tombes Chamblandes (Moinat, 2007). Il faut également mentionner, en basse Alsace, les crânes de Holtzheim « Am Schluesselberg » (Kuhnle et al., 1999-2000) et de Marlenheim « Le Clos du Marlenberg » (Lefranc et al., 2011a) qui accompagnaient des inhumations primaires et ainsi que les fosses 25 et 50 du site éponyme d’Untergrombach « Michelsberg » qui ont livré trois crânes, dont deux (fosse 25) étaient entourés de couronnes de pierres (Bonnet, 1899). Le traitement particulier des crânes dans ces quelques fosses-silos renvoie au matériel de quelques enceintes Michelsberg, dont celle de Neckarsulm-Obereisesheim « Hetzenberg » et de Heidelsheim « Altenberg » (Kreis Bruchsal), où les crânes apparaissent regroupés, en nombre variable, au niveau des têtes des segments de fossés (Nickel, 1998).
Cas particulier 1 : la structure 49,dépôts simultanés et dépôts successifs
La fosse 49 est l’unique creusement ayant livré plus d’un individu en dépôt primaire. Il s’agit d’une fosse de type Beutelförmige Grube entièrement comblée par un lehm brun foncé homogène. Trois épisodes de dépôt, séparés par des couches de sédiments de 16 à 20 cm de puissance, y ont été observés (fig. 7). La datation radiométrique réalisée sur l’individu 49A (Gd-30174 : 4500 ± 160 BP) permet d’envisager une attribution à l’horizon Munzingen récent.
Le premier dépôt, localisé à 16 cm au dessus du fond du creusement, est constitué par deux individus, un adulte (ind. 49C) et un enfant entre 9 et 10 ans (ind. 49D). L’adulte, orienté tête au nord-est repose en position contractée sur le côté droit. Divers indices comme la déconnexion du bloc crânio-facial et de la mâchoire, la localisation de plusieurs éléments des mains et des pieds en dehors du volume corporel, pourraient, bien que les arguments restent discutables, plaider en faveur d’une décomposition en espace vide. La position originelle de l’enfant est difficile à restituer ; elle résulte très proba-blement d’un affaissement du corps le long de la paroi du silo au cours de la décomposition. Il semble reposer sur le côté droit, membre inférieur gauche fléchi au niveau du genou et membre inférieur droit en extension. Le membre supérieur droit a été retrouvé au démontage, avec une flexion du coude de 90° environ, sous la cage thoracique de l’individu. Le membre supérieur gauche est en extension. Le fort degré de perturbation des restes osseux (colonne vertébrale, cage thoracique, membres supérieurs et inférieurs) ainsi que leur déplacement en dehors du volume corporel indiquent une décomposition en espace vide.
La simultanéité des dépôts des individus 49C et 49D a pu être établie lors du démontage des squelettes : le calcaneus gauche de l’individu 49C est apparu en
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 701
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
contact strict avec l’ilium droit de l’individu 49D. De la même manière, sous le calcaneus gauche de l’indi-vidu 49C, nous avons observé certains éléments du pied gauche de l’individu 49C (métatarsiens II et III) au contact d’une vertèbre thoracique de l’individu 49D. On peut donc restituer un dépôt simultané au sein d’un espace vide étendu à l’ensemble de la fosse.
À une vingtaine de centimètres au-dessus de ce premier dépôt a été inhumé un jeune enfant – partiel-lement détruit par le creusement d’une fosse adja-cente – déposé sur le dos et orienté sur un axe nord-sud, tête au nord. Enfin, le dernier épisode intervient 16 cm plus haut avec le dépôt d’une femme âgée de plus de 50 ans (Schmitt, 2005), orientée tête au nord-est et gisant en léger appui sur le côté droit, membres infé-rieurs fléchis ; ses mains sont jointes à la droite du bloc crânio-facial. Les observations taphonomiques plaident en faveur d’une décomposition en espace colmaté.
Il est bien sûr difficile de déterminer si la succession des épisodes de dépôts intervenus dans la fosse 49 résulte de gestes dissociés, ou s’il s’agit du reflet d’une réelle volonté de regroupement des défunts ; dans la seconde hypothèse, ces « tombes à étages » que l’on rencontre en contexte Michelsberg ou Munzingen sur les sites de Riedisheim « Rue des Violettes » (Schweitzer et Fulleringer, 1973), Rosheim « Sablière Maetz » (Thévenin et al., 1978), Holtzheim « Am Schluesselberg » (Kuhnle et al.,1999-2000) et Marlenheim « Le Clos du Marlenberg » (Lefranc et al., 2011a), pourraient trans-crire un mode de fonctionnement collectif (Jeunesse, 2010).
Dans un précédant article, le dépôt simultané des individus 49C et 49D a été interprété en terme d’accompa-gnement funéraire (Lefranc et al., 2010).
Cas particulier 2 : la structure 23A,un individu isolé en position non conventionnelle
L’individu a été déposé dans une fosse circulaire (diamètre : 1,30 m) à fond plat et parois légèrement évasées (profondeur : 0,68 m). Il est orienté nord-est – sud-ouest, tête au nord-est, et repose sur une couche peu épaisse de sédiment sableux qui tapisse le fond de la structure. Le reste du silo est comblé par un lehm brun sableux homogène. À une vingtaine de centimètres au-dessus du crâne, le comblement recelait un gigot de chevreuil (fig. 12). Deux colliers de perles en cuivre gisait à proximité du corps (voir ci-dessous).
Les restes osseux de l’individu en très mauvais état de conservation interdisent la détermination du sexe. Son âge peut être estimé à plus de 30 ans. Il repose en procubitus ; le bloc crânio-facial et la mandibule, en connexion lâche, apparaissent en vue postérieure. Le membre supérieur droit subit une flexion importante au niveau du coude (20° environ). Le membre supérieur gauche est également fléchi au niveau du coude (90° environ). Le bras gauche ainsi que l’extrémité proximale de l’avant-bras se trouvent sous le thorax. Les mains ne sont pas conservées, à l’exception de deux métacarpes droits, partiellement représentés à proximité de l’épaule droite. Les membres inférieurs présentent une position
particulière : le membre inférieur gauche est en exten-sion (cette dernière ayant probablement été accentuée pendant la décomposition), le droit est fléchi (100° environ) au niveau du genou. La face d’apparition des os du membre inférieur gauche ne peut pas être déter-minée du fait du trop mauvais état de conservation. Le fémur droit apparaît en vue antéro-latérale et le tibia en vue latérale stricte. Il semble que l’articulation coxo-fémorale se soit déconnectée au moment de la décompo-sition. Les quelques éléments des pieds présents indiquent que la position des membres inférieurs a bien été acquise au moment du dépôt et ne résulte pas de phénomènes taphonomiques. Les observations réalisées sur le terrain permettent de conclure, avec prudence, à une décomposition en espace colmaté.
Dépôts animaux
Des ossements d’animaux, en plus ou moins grand nombre et aux caractéristiques très diverses, sont inté-grés au comblement de plusieurs structures de ce site.
Squelettes sub-complets :- un jeune cerf (Cervus elaphus) dont les restes sont
disposés dans le remplissage inférieur de la struc-ture 33 (fig. 9). Il s’agit d’une dépouille probable-ment complète au moment du dépôt mais dont seules quelques connexions anatomiques sont préservées. Le crâne est complètement disloqué, les différentes parties (mandibules, occipital…) isolées et dispersées sur toute la surface du niveau de dépôt. Le squelette appendiculaire est complet et en connexion anato-mique à l’exception de l’extrémité du membre anté-rieur gauche (à partir du métacarpe) et des éléments supérieurs (humérus, radius) isolés et éparpillés. L’âge de l’animal peut être estimé à 4-5 mois d’après l’état d’éruption et d’usure de la dentition (d4 en début d’usure, M1 en cours de sortie ; Habermehl, 1985) ;
- un jeune suiné 2 (Sus scrofa sp.) dans la structure 17 (fig. 8), disposé sur le côté droit, les membres anté-rieurs repliés et les membres postérieurs en exten-sion. Il s’agit d’un mâle d’environ 10-12 mois (M2 en cours de sortie ; Herbin-Horard, 1997) dont la plupart des parties du squelette sont attestées à l’ex-ception des vertèbres cervicales (à partir de l’axis) et se présentent en connexion anatomique ;
- le squelette incomplet d’un deuxième suiné, de sexe mâle, dont l’âge peut être estimé à 14-16 mois (M2 en début d’usure, M3 non sortie) en position allongée sur le côté, contre la paroi de la structure 56 (fig. 8). La plupart des éléments du squelette sont attestés, mais la préservation des connexions articulaires se limite au crâne, aux membres antérieurs et à une partie du rachis ;
- les vestiges très résiduels du squelette d’un suiné de quelques semaines dans la structure 47 dont seuls les éléments les plus conséquents, comme les os longs et les mandibules, ont été collectés ; ils peuvent être rapportés à une dépouille très vraisemblablement complète d’un jeune animal dont les parties les plus fragiles n’ont pas été préservées.
702 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Parties de squelettes :- des restes du rachis et d’éléments crâniens d’un jeune
cerf dans la structure 48. Il s’agit principalement des vertèbres thoraciques et de côtes en connexion, de deux vertèbres cervicales isolées, des deux mandi-bules et du crâne très fragmenté et réduit à quelques unes de ses parties (occipital, zygomatiques…). L’âge estimé de l’animal est très proche de celui de la structure 33 (d4 en tout début d’usure et M1 en cours de sortie) ;
- un membre postérieur gauche (fémur, tibia, méta-tarse) d’un chevreuil (Capreolus capreolus) adulte dans le remplissage de la structure 23, à une ving-taine de centimètres à l’aplomb du crâne du squelette humain ;
- une extrémité d’un membre antérieur (métacarpe et phalanges) gauche de chevreuil adulte dans la struc-ture 42.
Restes isolés :- deux mandibules (gauche et droite) de hérisson
(Erinaceus europaeus) dans la structure 33 ;- une mandibule gauche complète de hérisson dans la
structure 28.Les ossements qui se rapportent aux squelettes et
aux parties de squelettes sont entiers, indemnes de toute fragmentation, de traces de désarticulation ou de prélèvement de la viande ou d’exposition au feu qui indiqueraient qu’il s’agit de restes d’animaux consommés. L’absence des marques de découpe à l’endroit des extrémités et la présence des sésamoïdes attestée dans la plupart des cas laissent penser que les animaux étaient déposés sous forme de dépouilles complètes dont la peau n’a pas été prélevée ou sous forme de quartiers de viande. Dans le cas des squelettes complets, aucun indice d’une préparation quelconque ne peut être mobilisé et il est donc tout à fait plausible qu’il s’agissait de dépouilles non apprêtées. Pour autant
ces dépouilles ne se présentent pas comme de simples cadavres dont l’évacuation dans des fosses s’inscrirait dans le cadre de la gestion de la mortalité naturelle.
La répartition des éléments squelettiques reflète des positions diverses qui s’apparentent cependant à celles d’animaux disposés avec soin plutôt qu’à des cadavres gisant en vrac. Les restes du suiné dans la structure 17 attestent le dépôt soigneux de l’animal, allongé contre la paroi sur le côté droit les membres antérieurs repliés et les membres postérieurs en extension. Les ossements du jeune faon de la structure 33, qui n’ont pas été affectés par les remaniements post dépositionnels, gardent la trace d’un animal allongé sur le flanc gauche, les membres en extension, de même que le suiné de la structure 56, reposant sur le côté gauche.
Trois squelettes montrent des indices de remanie-ments post dépositionels : les restes du squelette de faon le plus complet (structure 33) apparaissent partiellement éparpillés. Les mandibules sont séparées et dispersées, le crâne est disloqué et les diverses parties (occipital, zygomatiques, prémaxillaires) gisent en position très désordonnée. L’inventaire détaillé des parties anato-miques révèle l’absence de l’extrémité du membre antérieur droit. De même, les restes du rachis du faon de la structure 32 étaient partiellement disloqués (mandi-bules éloignées de leur position anatomique, déconnexion du crâne) et le rachis apparaît privé des vertèbres cervi-cales. Le squelette de suiné de la structure 56 est partiel-lement disloqué ; la plupart des vertèbres lombaires sont séparées de la colonne vertébrale et semblent avoir été redisposées à proximité ; les principaux os des membres postérieurs sont dissociés et reposent groupés près du squelette dans une position qui évoque une manipulation de type « rangement ». L’inventaire anatomique détaillé fait aussi apparaître des lacunes qui concernent princi-palement des éléments des extrémités (phalanges, carpes, tarses, patella gauche…) qu’il est difficile d’imputer aux techniques de fouille. Ces incohérences dans la répartition
Fig. 9 – Vue verticale du dépôt de jeune cervidé de la structure 33 (cliché P. Lefranc).Fig. 9 – Overhead view of the young Cervidae deposit found in structure 33 (photo P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 703
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
des éléments squelettiques et les lacunes dans l’inven-taire des parties ne peuvent s’expliquer par les effets de la taphonomie ni par des perturbations occasionnées par des animaux fouisseurs.
La disposition des animaux dans le remplissage des structures n’apparaît pas non plus aléatoire. Qu’il s’agisse de squelettes plus ou moins complets ou de parties de squelettes, ces ossements forment des ensembles bien individualisés, intégrés au sein du remplissage des structures, séparés d’autres ensembles de vestiges lorsque le comblement est formé de dépôts successifs. Dans la structure 56, les restes du suiné, plaqués contre la paroi, reposent à environ 20 cm en dessous du squelette humain. Cette configuration peut aussi être invoquée dans le cas de la structure 17, dans laquelle un squelette humain repose au voisinage plus direct d’une carcasse de suiné dont il n’est séparé que par quelques centimètres de sédiment. Cette faible séparation est compatible avec une succession assez rapide dans le temps des deux dépôts mais ne permet pas d’établir l’association directe entre les deux.
Les restes osseux isolés sont très peu nombreux. Il s’agit d’éléments épars se rapportant au cerf (un carpe et une phalange 3) mêlés aux restes du suidé de la struc-ture 17, trois mandibules de hérisson et un tibia de putois dispersés dans les structures 56, 28 et 33. Il paraît diffi-cile de considérer cette distribution comme résultant du hasard de l’évacuation de rejets alimentaires tant la sélection des espèces comme celle des parties anatomiques est particulière. Les mandibules de hérisson
ne présentent aucune trace de transformation ou de lustré qui indiquerait leur utilisation comme pendentifs selon une tradition bien attestée sur bon nombre de sites lacustres. Leur association aux vestiges du squelette de faon marque la signification particulière que cette partie peut revêtir. D’autres découvertes de mandibules de hérisson dans le mobilier des sépultures chasséennes de Saint-Michel-du-Touch à Toulouse, Haute-Garonne (Méroc et Simonnet, 1979) ou dans des dépôts funéraires de sépultures épipaléolithiques, comme à l’aven des Iboussières (Malataverne, Drôme) ou aux Arènes Candide (Ligurie), témoignent de leur place privilégiée comme élément du système symbolique sur une longue période (D’Errico et Vanhaeren, 2000).
Les données recueillies sur ce site s’intègrent à un ensemble de découvertes qui concernent des associa-tions d’espèces comparables et recouvrent un ensemble de pratiques assez homologues même si les méthodes de fouilles moins fines n’autorisent, dans la plupart des cas, pas une restitution aussi précise des interventions mises en évidence sur ce site. La représentation du cerf trouve son équivalent le plus étroit sur le site de Rosheim « Leimen » où le squelette complet d’un faon d’âge identique à celui de la structure 33 gisait à mi-hauteur du comblement de la structure 74 (Lefranc et al., 2007). D’autres exemples de dépôts de cervidés peuvent être mentionnés, comme à Köfering où dans une structure attribuée à la culture de Münchshöfen est signalé le squelette d’un jeune cerf (Dallmeier et Froschauer, 1996) probablement en connexion. Les
Fig. 10 – Vases de stockage issus des structures 37/61 et 21 et attribuables au Munzingen récent (dessins P. Lefranc).Fig. 10 – Storage vases from structures 37/61 and 21, probably dating from the Late Munzingen (drawings P. Lefranc).
704 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
restes dispersés d’un cerf sont également mentionnés dans une fosse du Michelsberg découverte à Zuffenhausen (Joachim, 1983). La présence de restes de chevreuil est de même attestée sous forme de squelettes complets que ce soit à Mamming, struc-ture 108 (Van den Driesch et Gerstner, 1993) ou encore à Straubing (Van den Driesch et Gerstner, 1993 ; Ott-Luy, 1988). Les suinés font partie des animaux les plus régulièrement concernés par des dépôts en fosses, le plus souvent sous forme de squelettes complets de jeunes animaux ou de parties de squelettes : bas de pattes, crânes… (Guthmann, 2010). Tant du point de vue de la composition que des pratiques de dépôt, les vestiges recueillis sur ce site s’intègrent au corpus de données disponibles pour une vaste aire géographique qui couvre les cultures de Michelsberg, Munzingen et
Münchshöfen. L’originalité des pratiques mises en évidence tient à la finesse des observations lors de la fouille et des possibilités de restitution des pratiques qu’elle autorise et qui dévoilent une dimension cultuelle méconnue et dont la variété des manifestations néces-siterait de disposer d’analyses précises plus nombreuses pour espérer une perception plus fine.
LE MOBILIER CÉRAMIQUE ET OSSEUX
La céramique
Le mobilier céramique mis au jour se résume à deux grands vases de stockage en céramique grossière et à une jatte en céramique fine. Le vase de stockage
Fig. 11 – Mobilier céramique, lithique et en matière dure animale issu des fosses 14, 17, 41 et 56 (dessins P. Lefranc).Fig. 11 – Ceramic, lithic and bone material from pits 14, 17, 41 and 56 (drawings P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 705
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
complet de la structure 21A (fig. 10, no 2) reposait écrasé sur le fond de la fosse. Il s’agit d’une forme « en tonnelet » présentant des parois curvilignes légèrement rentrantes et un diamètre maximum situé à mi-hauteur du récipient. Sans être fréquente, cette forme est attestée dans des ensembles du Munzingen B de basse Alsace, à Entzheim (Schmitt, 1987), à Rosheim « Leimen » (Lefranc et al., 2007) et Mundolsheim (Lüning, 1968).
Les fragments du second vase, lui aussi complet (fig. 10, no 1), ont été retrouvés sur le fond de deux fosses distantes de 3,50 m (st. 37 et st. 61). Il s’agit d’un grand récipient à fond plat et parois sub-rectilignes, pourvus de six éléments de préhension pleins de forme allongée, appliqués immé-diatement sous la lèvre. La partie médiane de la panse porte des traces verticales de lissage réalisées au doigt.
Fig. 12 – Relevé de l’inhumation 23A (DAO C. Leyenberger et P. Lefranc).Fig. 12 – Survey of burial 23A (CAD C. Leyenberger & P. Lefranc).
706 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Les vases de stockage tronconiques, pourvus ou non de boutons sous la lèvre, figurent parmi les formes les plus répandues dans les ensembles datés du Munzingen récent. Mentionnons simplement, au sein d’un vaste corpus, plusieurs exemplaires de Mundolsheim (Lüning, 1968,) et de Heilbronn (Seidel, 2005) strictement comparables à l’exemplaire de Colmar.
La jatte en céramique fine de teinte sombre et à dégraissant quartzeux de granulométrie hétérogène déposée auprès de l’enfant de la fosse 41 trouve de nombreux éléments de comparaison au sein du corpus céramique Munzingen (fig. 11, no 1 ; diamètre à l’ouver-ture : 16 cm ; diamètre du fond : 6,5 cm ; hauteur : 10 cm). Il s’agit d’un type de jatte carénée profonde que l’on rencontre déjà dans les ensembles Munzigen ancien de Didenheim (Schweitzer, 1987) et du site éponyme (Maier-Schmid, 1958) : sur ce dernier, les exemplaires attribués à l’étape ancienne montrent fréquemment un col évasé, une panse arrondie et une jonction col-panse marquée ; de petits éléments de p réhens ion per forés appara i s sen t quas i -systématiquement au niveau du plus grand diamètre de la panse (Maier-Schmid, 1958). Dans les ensembles attribués au Munzingen récent, les jattes carénées abondent : on retrouve les jattes à col évasé, toujours bien représentées (Kuhnle et al., 1999-2000 ; Lüning, 1968), accompagnées d’un nouveau type à col vertical ou légèrement rentrant et à carène parfois mousse, auquel nous pouvons rattacher l’exemplaire de Colmar. Cette forme apparaît en de nombreux exemplaires à Mundolsheim (Lüning, 1968) ainsi qu’à Holtzheim « Les Abattoirs » (Kuhnle et al., 1999-2000) et « Altmatt » (Lefranc, 2001). Elle est également extrê-mement bien représentée sur le site Munzingen récent de Heilbronn-Klingenberg où la plupart des exem-plaires sont strictement comparables à celui de Colmar (Seidel, 2005) que nous pouvons donc dater du Munzingen récent. Les dépôts de vases auprès des squelettes se rencontrent à quatre reprises en Alsace : à Didenheim-Morschwiller (Denaire, 2007), à Reichstett « Rue Ampère » (Blaizot, 2001), à Rosheim « Leimen » (Lefranc et al., 2007) et à Marlenheim « Le Clos du Marlenberg » (Lefranc et al., 2011a).
Ces dépôts sont toujours constitués d’un ou de deux récipients de type jatte ou gobelet, souvent préalable-ment brisés hors de la fosse. On soulignera à ce propos que la jatte de Colmar présente également quelques lacunes. Outre-Rhin, les inhumations en fosses rondes ayant livré des céramiques – plus ou moins bien documentées – sont au nombre de six. À l’exception de fragments d’une bouteille à Oberderdingen – Kr. Karlsruhe (Stauch et Banghard, 2002), les types représentés sont les mêmes qu’en Alsace et les dépôts ne sont constitués que par un unique objet : on note une jatte carénée à Bad-Kreuznach « Im Tale Links », des gobelets tulipiformes déposés chaque fois en un unique exemplaire à Bad-Kreuznach « Nauberg », Stuttgart-Münster et Wolfenweiler-Leuterberg (Nickel, 1998).
Sauf erreur de notre part, l’individu de la struc-ture 41 de Colmar est, pour l’ensemble du corpus de la plaine du Rhin supérieur, le seul enfant ayant béné-ficié d’un dépôt funéraire.
Le mobilier osseux
L’individu inhumé dans la structure 56, un homme entre 20 et 29 ans, était accompagné par un poinçon déposé face au visage. Il s’agit d’un outil obtenu par une fracture transversale de diaphyse (fig. 11, no 2 ; longueur : 8,3 cm ; diamètre max. : 1,1 cm). Ce type d’objet apparaît en Rhénanie à partir du Bischheim rhénan et est bien représenté dans le Chasséen (Sidéra, 2002). L’unique élément de comparaison fourni par le corpus régional figure sur le site de Vendenheim « Le haut du Coteau » où un poinçon en tout point identique à notre exemplaire a été découvert à proxi-mité de la dépouille complète d’un mouton. La datation radiocarbone réalisée sur l’animal permet d’attribuer ce dépôt au Michelsberg ancien du Rhin supérieur (Jeunesse et al., 2002-2003).
Le pendentif sur lame de canine de suidé perforée (fig. 11, no 3), déposé auprès du bloc crânio-facial de la structure 14 est la seule pendeloque de ce type signalée sur les sites du Néolithique récent régional. Ces objets pourvus d’une unique perforation, attestés dès le Néolithique moyen (Sidéra, 1997) se rencontrent assez fréquemment sur les habitats des bords des lacs suisses en contextes Cortaillod et Pfyn et jusqu’au Néolithique final (Voruz, 1991).
Les objets de parures datés de l’horizon Néo-lithique récent et découverts associés à des restes humains en fosses circulaires demeurent extrême-ment rares en Alsace : il s’agit de deux colliers composites découverts en position fonctionnelle à Holtzheim « Altmatt » (perles cylindriques en calcaire, un galet plat perforé, coquillages : Kuhnle et al., 1999-2000) et à Didenheim-Morschwiller (un galet perforé et deux craches de cerf : Denaire, 2007), ainsi que du collier déjà mentionné de Merxheim « Trum-melmatten ».
LES PERLES EN CUIVRE
Conditions de gisement, description et comparaisons
Conditions de gisement
Cinquante-six perles en cuivre ont été découvertes dans la structure 23A, déposées auprès de l’individu inhumé seul, en position non conventionnelle (fig. 13).
Les perles, retrouvées dans leur position originelle, enfilées sur un lien non conservé, composent deux objets de type « collier ». Le collier 1 (fig. 14, nos 1-51), composé de vingt-sept perles est apparu immédiatement sous le corps, au niveau du bassin présentant d’ailleurs des traces d’oxydation. Le collier 2 (fig. 15), rassemblant vingt-cinq perles, gisait au sud des pieds du sujet et au même niveau que ces derniers. Quatre perles isolées (collier 3) ont été retrouvées sous le corps lors du démontage du squelette (fig. 14, nos 52-55).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 707
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Description
Les perles cylindriques ont été façonnées à partir de plaquettes de cuivre de longueur variable : 4 cm pour la plus petite (perle no 1) à 7,5 cm pour la plus grande (perle no 18). La plupart des autres perles ont été obte-nues à partir de segments dont la longueur est comprise entre 5 et 6 cm. Les diamètres oscillent entre 1,2 et 2,45 cm.
La technique de fabrication est la même pour toutes les perles : les segments sont simplement enroulés sur un support cylindrique ; les extrémités sont jointes bout à bout et assemblées par martelage, opération dont les plus grandes pièces portent encore les stigmates. La plupart des exemplaires façonnés sur des plaquettes de faible épaisseur n’ont pas bénéficiés de cette dernière opération comme le montrent bien de nombreuses pièces présentant des extrémités non soudées (par exemple nos 7, 10, 31, 33, 34, 37, 45, 47). Trois pièces de facture moins soignée montrent un chevauchement des extrémités (nos 2, 5 et 26).
La largeur et l’épaisseur des segments sont très variables (tabl. 3) : les perles du collier 1 ont été obte-nues sur des plaquettes dont l’épaisseur oscille entre 0,1 et 0,2 cm et dont la largeur est comprise entre 0,5 et 1,5 cm, avec une majorité d’exemplaires n’excé-dant pas 1 cm. Les perles du collier 2 en revanche sont, pour la majorité, beaucoup plus massives (perles 11
à 25). La largeur des segments est comprise entre 1,1 et 1,55 cm et leur épaisseur excède souvent 0,3 cm (jusque 0,6 cm pour les perles 17 et 18).
Le poids des perles varie fortement en fonction de ces paramètres, de 1,4 à 33,6 g (tabl. 3).
Nous pouvons, en nous appuyant sur les mesures des objets, définir quatre types de perles :- type A : type regroupant un ensemble homogène
incluant la quasi-totalité des perles du collier 1, sept pièces du collier 2 et deux perles du collier 3. Il s’agit d’objets façonnés sur des baguettes de faible épais-seur et dont la largeur se situe en moyenne aux alentours de 1 cm. Les diamètres, compris entre 1,5 et 1,9 cm présentent également une belle homogé-néité. On doit faire une distinction entre les cinq perles de type A du collier 2 (sous-type A2) de section plus épaisse et surtout bien plus lourdes que celles du collier 1 (sous-type A1) ;
- type B : nous classons dans ce type les perles massives obtenues sur des segments dont la largeur est comprise entre 1,2 cm et 1,5 cm, et dont l’épais-seur oscille entre 0,3 et 0,6 cm. Le type offre une assez grande disparité, notamment au niveau de la taille – les diamètres s’échelonnant entre 1,6 et 2,45 cm – et du poids, mais se distingue aisément des types précédents. Il regroupe la majorité des perles du collier 2 (quinze pièces, nos 11 à 25) et deux perles du collier 3 (nos 52 et 55). On peut distinguer deux sous-types en s’appuyant sur le rapport diamètre/largeur : d/l = 1 pour la forme du sous-type B1 (nos 11, 12, 13, 22, 24, 52), et d/l > 1 pour la forme du sous-type B2 ;
- type C : perles de petite taille dont le diamètre et la largeur sont de valeurs approchantes (perles nos 1, 2, 26). Pour les perles 2 et 26, le faible diamètre n’est dû qu’au chevauchement important des extrémités. Il ne s’agit donc pas d’un véritable type mais plutôt d’objets de mauvaise facture que l’on doit probable-ment rattacher au type A ;
- type D : perle dont le diamètre est inférieur à la largeur. Ce type n’est représenté que par un seul exemplaire (no 3).Seuls les types A et B se distinguent vraiment ; les
types C et D ne sont que des épiphénomènes.
Le collier no 1 (fig. 14 et 16) est composé de vingt-sept perles appartenant toutes au même type (type A). L’une d’elles (no 56), située entre les perles 28 et 29 était réduite à l’état de petits fragments et n’a pu être reproduite graphiquement. Toutes sont réalisées sur des segments fins présentant une épaisseur constante comprise entre 0,1 et 0,2 cm. En section transversale, la majorité des pièces montre un profil bombé vers l’extérieur. Au niveau des diamètres, on peut distin-guer deux groupes : le premier rassemble les pièces dont le diamètre est inférieur à 1,7 cm ; il s’agit des perles nos 26 à 28 et 48 à 51. Ces deux petits ensembles sont placés aux deux extrémités du collier. Le second groupe de perles offre des diamètres s’échelonnant entre 1,7 et 1,9 cm. Les poids sont répartis entre 1,4 g et 3,3 g, la majorité des pièces pesant entre 2 et 3 g
Fig. 13 – Vue verticale de l’inhumation 23A avec les « colliers » in situ (cliché P. Lefranc).Fig. 13 – Overhead view of burial 23A with the “necklaces” in situ (photo P. Lefranc).
708 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Fig. 14 – Les perles en cuivre constituant le collier 1 : perles nos 26 à 51, et le collier 3 : perles nos 52 à 55 (dessins P. Lefranc).Fig. 14 – The copper beads forming necklaces 1: beads 26 to 51, and 3: beads 52 to 55 (drawings P. Lefranc).
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 709
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Fig. 15 – Les perles en cuivre constituant le collier 2 (dessins P. Lefranc).Fig. 15 – The copper beads forming necklace 2 (drawings P. Lefranc).
710 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Tabl. 3 – Types, dimen-sions et poids des perles en cuivre de Colmar « aérodrome ».Table 3 – Types, dimen-sions and weights of the copper beads from Colmar “Aérodrome”.
Perle no Collier no Type Diam. max. Largeur max. épaisseur Poids (g) (cm) (cm) max. (cm) 26 1 C 1,35 1 0,2 1,8 27 1 A1 1,65 0,9 0,2 2,7 28 1 A1 1,53 0,85 0,15 2,1 29 1 A1 1,75 1 0,15 2,8 30 1 A1 1,75 0,8 0,15 2,1 31 1 A1 1,8 0,75 0,15 2 32 1 A1 1,75 1,1 0,15 3,3 33 1 A1 1,9 1,1 0,2 3,1 34 1 A1 1,7 1 0,15 2,8 35 1 A1 1,75 1 0,1 2,5 36 1 A1 1,8 0,7 0,2 1,7 37 1 A1 1,8 0,9 0,1 2,1 38 1 A1 1,9 0,85 0,2 2,3 39 1 A1 1,9 1 0,2 2,4 40 1 A1 1,9 0,75 0,15 1,9 41 1 A1 1,9 0,95 0,2 2,9 42 1 A1 1,8 0,85 0,2 2,7 43 1 A1 1,8 1 0,15 3,1 44 1 A1 1,7 0,75 0,15 2,2 45 1 A1 1,8 1,5 0,1 2,8 46 1 A1 1,7 0,85 0,1 2,1 47 1 A1 1,8 1,1 0,1 2,2 48 1 A1 1,6 0,8 0,1 2,6 49 1 A1 1,65 1,1 0,1 2,8 50 1 A1 1,65 0,6 0,2 1,5 51 1 A1 1,6 0,5 0,15 1,4 56 1 fragments ? 1,1 0,1 ? poids minimum collier 1 : 61,9 1 2 C 1,2 1 0,2 1,8 2 2 C 1,45 1 0,3 3,2 3 2 D 1,35 1,5 0,25 4,2 4 2 A1 1,5 0,9 0,2 1,7 5 2 A1 1,9 1 0,15 2,8 6 2 A2 1,7 0,9 0,2 6,7 7 2 A2 1,6 0,9 0,3 6,3 8 2 A2 1,7 0,9 0,2 8,4 9 2 A2 1,8 0,9 0,3 7,9 10 2 A2 1,7 0,9 0,25 5,9 11 2 B1 1,8 1,2 0,4 13,9 12 2 B1 1,8 1,3 0,15 8,7 13 2 B1 1,8 1,3 0,3 12,8 14 2 B2 1,9 1,3 0,3 15,7 15 2 B2 2,05 1,3 0,55 18,8 16 2 B2 2,15 1,4 0,4 21,5 17 2 B2 2,45 1,55 0,6 33,6 18 2 B2 2,45 1,55 0,6 32 19 2 B2 2,2 1,5 0,55 27,9 20 2 B2 2 1,4 0,4 18 21 2 B2 1,9 1,3 0,3 11,1 22 2 B1 1,8 1,3 0,3 9,6 23 2 B2 1,75 1,1 0,3 10,1 24 2 B1 1,9 1,4 0,25 10,5 25 2 B2 1,9 1,2 0,4 12,2 poids total collier 2 : 305,3 52 3 D1 1,6 1,2 0,2 7,5 53 3 C2 1,7 0,9 0,2 6,3 54 3 C2 1,85 1 0,25 7,9 55 3 D2 1,9 1,2 0,4 12,3 poids total collier 3 : 34,0 poids total colliers 1-3 : 401,2
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 711
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
.Le poids total du collier est de 61,9 g. La largeur des perles est également sujette à variation : les plus larges atteignent 1,1 cm contre 0,5-0,6 cm pour les plus étroites. Leur distribution au sein du collier est aléa-toire ; on rencontre l’alternance de pièces larges et étroites (nos 43 à 49) ou encore de petits groupes de perles semblables (nos 30 à 42). La localisation des deux perles les plus étroites à une des extrémités du collier doit être soulignée (nos 50 et 51). On remarque que plusieurs pièces ont été obtenues sur des segments de cuivre de largeur décroissante. C’est particulière-ment net pour les perles nos 33 (de 1 cm à 0,75 cm), 37 (0,9 cm à 0,6 cm), 40 (0,9 à 0,7 cm), 45 (1,1 à 0,9 cm) et 47 (1,1 à 0,8 cm). Cette particularité – également observée sur des perles du collier 2 de Burgäschisee-Süd (cf. infra) – est d’une grande impor-tance pour l’interprétation : d’après E. Sangmeister et C. Strahm (1973), ces segments en forme de trapèzes allongés, constituent les extrémités de baguettes de cuivre, longues d’une trentaine de centimètres (au nombre de cinq) dont ont été tirées toutes les perles constituant les deux colliers découverts. L’hypothèse, tout à fait convaincante à Bürgaschisee-Süd, semble également se vérifier à Colmar. Les perles 50 et 51, très étroites, peuvent être interprétées comme issues des extrémités d’une même barre ; les perles irrégu-lières déjà mentionnées semblent bien indiquer que ces baguettes décroissent régulièrement en largeur
jusqu’à atteindre, à leurs extrémités, la moitié de leur largeur maximale.
Le collier 2 (fig. 15 et 16) se compose de vingt-cinq perles appartenant en majorité au type B. Les perles nos 4 et 5 obtenues sur des segments peu épais doivent être rapprochées des perles du type C appartenant au collier 1. Malgré une disparité certaine, toutes les autres perles se distinguent nettement des pièces composant ce dernier. Les exemplaires les plus massifs sont de section transversale plano-convexe. La face interne est généralement plane. L’épaisseur des baguettes de cuivre est plus importante, avec des valeurs s’échelonnant entre 0,2 et 0,6 cm (les deux tiers des perles offrent une épaisseur supérieure ou égale à 0,3 cm). Leurs largeurs, comprises entre 0,9 et 1,55 cm, sont également plus importantes. Les perles étroites du collier 2 que nous classons dans le type A (nos 6 à 10), se distinguent cependant nettement de leurs homo-logues du collier 1, notamment par leur épaisseur et leur poids (entre 5,9 et 8,4 g, contre 1,7 et 2,8 g pour les perles 4 et 5 qui s’apparentent davantage à celles du collier 1). Les quinze perles du type B présentent toutes des largeurs supérieures ou égales à 1,2 cm. Le diamètre de la majorité des pièces tourne autour de 1,8-1,9 cm. Six exemplaires qui se distinguent par leur aspect massif (nos 15 à 20) offrent des diamètres supé-rieurs à 2 cm (jusque 2,45 cm). Sur plusieurs pièces, les extrémités sont soigneusement assemblées ; on
Fig. 16 – Restitution des trois assemblages de perles tels qu’ils se présentaient in situ (cliché F. Schneikert).Fig 16 – Reconstruction of the three assemblages of beads in situ, as they were found (photo F. Schneikert).
712 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
observe, au niveau de la ligne de jonction, un net écra-sement consécutif à une opération effectuée par marte-lage (nos 13, 14, 17, 19, 21). Le poids des pièces de type B est nettement plus élevé que celui atteint par les perles du collier 1 : les valeurs s’échelonnent entre 8,7 g et 33,6 g (no 17). Le poids total du collier est de 305,3 g, soit presque exactement cinq fois le poids du collier 1, et ce, pour un nombre quasi-équivalent de perles. Les perles ne sont pas disposées de façon aléa-toire sur la cordelette : les exemplaires massifs de plus grand diamètre occupent la partie centrale, les perles nos 17 et 18, les plus grandes et les plus lourdes, sont au centre du dispositif. Ainsi, les pièces vont grosso modo en décroissant. Il est possible que les perles no 13 à no 20 proviennent d’un même support et qu’elles aient été classées selon la place qu’y occupait le segment de cuivre sur lequel elles ont été façonnées : on observe que, de part et d’autre de la perle no 18, les pièces décroissent régulièrement en largeur, en épais-seur et en poids. On pourrait avoir ici un indice assez probant en faveur de l’obtention d’au moins huit perles dans une même baguette d’une quarantaine de centi-mètres de longueur en forme de losange allongé. On pourrait y adjoindre également les nos 11, 23, 24 et 25 obtenus elles aussi sur des segments épais, et donc proposer de restituer une baguette longue d’au moins 50 cm, ce qui, d’après les données de Burgäschisee-Süd, reste tout à fait envisageable. Les perles 11, 23 et 25, de section épaisse mais relativement étroites pour-raient appartenir aux extrémités de cette éventuelle baguette. C’est également le cas de la perle 55 (collier 3) où l’on observe clairement une diminution de l’épais-seur de la section. Les pièces nos 1, 2, et 6 à 10 présentent des similarités évidentes, en termes de largeur (de 0,9 à 1 cm) et d’épaisseur (entre 0,2 et 0,3 cm), permettant peut-être de les rattacher à un second support long d’au moins 27 cm. Elles ressem-blent beaucoup aux pièces nos 53 et 54 (collier 3) qui pourraient être issu du même support. Restent les perles nos 3, 12, 22, larges et peu épaisses, que l’on hésite à attribuer à un troisième et dernier support.
Les quatre perles qui composent le collier 3 (fig. 14 et 16) ont été recueillies sous le thorax du squelette, non loin du collier 1. Aucune d’elles ne peut cependant y être rattachée comme l’indiquent leurs épaisseurs et leurs poids. Les nos 53 et 54 se rapprochent des perles de type A du collier 2 (nos 6 à 10) ; la no 5 ressemble aux perles massives du type B, qui peuvent être issues d’une même baguette, et enfin, la no 52 renvoie au groupe rassemblant les perles no 3, 12 et 22.
Comparaisons
Des perles cylindriques en tous points identiques à nos exemplaires apparaissent sur une quinzaine de sites, tous localisés en Suisse (fig. 17). Nous nous sommes appuyés sur l’inventaire établi en 1982 par Barbara Ottaway (Ottaway, 1982, appendice XI), en l’enrichis-sant de rares découvertes plus récentes. La plus grande partie des perles a été mise au jour en Suisse occidentale, sur des sites bordant les lacs de Neuchâtel et de Bienne
(onze sites). Le site de Seeberg « Burgäschisee-Süd » est localisé à une trentaine de kilomètres à l’est du lac de Bienne, sur la rive sud du petit lac de Burgäschisee (canton de Berne). Parmi les découvertes récentes nous avons recensé une perle sur le site d’Hitzkirch, près du Baldergersee (canton de Lucerne) et une perle provenant de la rive nord du Léman (nécropole de Lausanne-Vidy, canton de Vaud).
La plupart des sites ont livré des perles isolées, représentées en un ou deux exemplaires : c’est le cas à Baulmes « Abri de la Cure », Concise, Cortaillod, Estavayer, Font, Lüscherz, Mörigen, Sutz, Vinelz (Ottaway, 1982), Lausanne (Crotti et al., 1995) et Hitzkirch (Winiger, 1981). À l’exception de l’exem-plaire de Lausanne issu d’un contexte funéraire 3, toutes proviennent d’habitats. La fourchette chronologique communément admise pour les objets de ce type correspond, en Suisse occidentale, au Cortaillod tardif et, en Suisse orientale, au Pfyn récent (env. 3750-3500 av. J.-C). Ces données indirectes nous permettent d’attribuer le dépôt de Colmar à la même fourchette chronologique, fourchette correspondant dans la vallée du Rhin à l’étape récente du Munzingen, étape dont les débuts peuvent être placés après 3800 av. J.-C. si l’on se fonde sur la série de dates radiocarbones réalisée sur le site de Heilbronn (Seidel, 2005).
Trois sites ont livré de vrais colliers, Marin-Epagnier « Préfargier », Seeberg « Burgäschisee-Süd » et Gerolfingen « Öfeli ». Le collier de Marin-Epagnier, site localisé sur la rive sud du lac de Neuchâtel, non loin de La Tène, semble aujourd’hui perdu et n’est connu que par un dessin publié par Forrer (dans Antiqua, 1884) et par une description sommaire (Forrer, 1884 et 1885). Le collier est constitué de vingt-cinq perles cylindriques (pour un poids total de 160 g) disposées par taille décroissante ; les plus grandes occupent le milieu du collier et les plus petites, les extrémités. Nous ne dispo-sons d’aucune information sur les conditions de gise-ment de cet objet, mais il s’agit selon toute probabilité d’un dépôt. À Gerolfingen, sur la rive sud-est du lac de Bienne, ce sont douze perles de section épaisse qui ont été retrouvées rassemblées au même endroit (Forrer, 1885 ; Sangmeister et Strahm, 1973).
Le site de Seeberg-Burgäschisee-Süd, petit établis-sement Cortaillod (Müller-Beck, 1990), a livré deux colliers, découverts en 1957 à proximité du mur nord de la maison 2 et déposés dans une petite fosse (Sangmeiser et Strahm, 1973). Les perles sont enfilées sur deux cordelettes bien conservées. Le collier 1 rassemble dix-huit perles ; le collier 2, trente-six perles ; deux autres perles ont été retrouvées isolées (total de cinquante-six perles).
Au niveau des techniques de fabrication, ces perles correspondent en tout point aux exemplaires de Colmar. On retrouve notamment la distinction entre face interne plane et face externe plano-convexe, ainsi que la zone d’écrasement au niveau de la ligne de jonction des extrémités. Typologiquement, les perles du collier 1 de Burgäschisee-Süd peuvent être rapprochées des exem-plaires les plus massifs de type B1 et B2 de Colmar.
Les dix-huit perles du collier 1 de Burgäschisee-Süd ont été réparties entre deux groupes (Sangmeister et
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 713
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Strahm, 1973) correspondant à des ensembles d’objets façonnés sur deux baguettes de cuivre distinctes, l’une longue de 40 à 50 cm et l’autre d’une trentaine de centimètres. Les trente-six perles du collier 2 auraient été obtenues à partir de quatre baguettes de métal d’une trentaine de centimètres de longueur chacune.
Les différents types de perles définis à Burgäschisee-Süd comme à Colmar n’ont pas d’autre signification que technologique ; ils semblent uniquement dériver des dimensions des baguettes de cuivre dans lesquelles les perles ont été fabriquées et de la place qu’y occupait le segment. Tout ce que l’on peut noter, c’est que les baguettes qui ont été utilisées pour la fabrication des six colliers aujourd’hui connus semblent toutes affecter la même forme particulière et qu’elles sont de tailles et de poids divers, la plus massive étant celle servant de support aux perles de type B2 de Colmar.
On remarquera, pour conclure, que l’on retrouve à Burgäschisee-Süd tous les éléments décrits à Colmar : outre les techniques de fabrication identiques, il s’agit
de la disposition des perles sur les cordelettes par taille décroissante, de l’utilisation de plusieurs baguettes que l’on peut reconstituer, ainsi que de l’association de deux colliers respectivement composés de perles massives et de perles légères. On peut également mentionner qu’en terme de poids de métal, les deux assemblages sont, à moins de 20 g près, quasi-identiques (Burgäschisee : collier 1 = 235,06 g, collier 2 = 147 g, au total 382,06 g ; Colmar : total = 401,2 g). Enfin, on l’aura noté, le nombre de perles est identique.
Les analyses
Les perles en cuivre de la fosse 23A sont suffisam-ment inhabituelles dans le Néolithique récent du terri-toire français (Ambert et Vaquer, 2005 ; Strahm, 2007) pour que l’on leur consacre une étude poussée. Malgré le fait que leur fabrication n’ait fait appel qu’à des tech-niques simples, elles présentent certaines particularités
Fig. 17 – Carte de répartition des perles cylindriques du IVe millénaire et indication des aires de répartition des cultures de Mun-zingen, Pfyn et Cortaillod. En blanc : perles isolées dans des couches d’habitat ; en noir : dépôt de « colliers » (DAO P. Lefranc).Fig 17 – Distribution map of the 4th millennium cylindrical beads and the areas covered by the Munzingen, Pfyn and Cortaillod cultures. White: isolated beads in dwelling layers; black: “necklace» deposits (CAD P. Lefranc).
714 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
qui permettent d’en proposer une attribution culturelle précise. Comme nous l’avons signalé ci-dessus, des objets comparables sont connus dans des contextes attribuables à la culture de Cortaillod et la comparaison la plus convaincante, puisqu’elle n’est pas seulement fondée sur des aspects typologiques est, nous l’avons souligné, constituée par les deux colliers de Seeberg-Burgäschisee-Süd (Sangmeister et Strahm, 1973).
Au vu de ces similitudes, il est impératif d’appro-fondir cette comparaison en faisant appel aux données issues d’analyses chimiques. Celles-ci doivent par ailleurs permettre de mieux situer cette nouvelle découverte dans le contexte de la première métallurgie centre-européenne.
Huit des cinquante-six perles en cuivre de la struc-ture 23A ont été analysées par le laboratoire de recherche en conservation du Centre des collections des musées nationaux suisses. Les prélèvements ont été réalisés par micro-forage. La composition chimique du métal a été déterminée par la méthode de la spec-trométrie par absorption atomique (AAS ; four cylin-drique en graphite). Cette technique nécessite des prélèvements d’environ 10 mg de métal et permet d’obtenir des résultats avec des seuils de détection très bas (tabl. 4a, en bas). Les concentrations des éléments suivants ont été déterminées : Sn, Pb, As, Sb, Ag, Au, Ni, Bi, Co, Zn et Fe. Les colliers 1 et 3 étant constitués de perles réalisées sur un support de faible épaisseur, seule une perle du collier 1 a pu être analysée (no 50). Sept des vingt-cinq perles du collier 2 (nos 6, 11, 14, 16, 18, 19 et 23) ont fait l’objet d’une analyse. Une première analyse de la perle no 14 ayant mis en évidence un taux d’argent élevé par rapport aux autres résultats (0,958 %), un deuxième prélèvement a été réalisé sur la même perle. Cette deuxième analyse a cependant confirmé les résultats de la première. Au total, neuf analyses quantitatives ont donc été réalisées dont deux analyses distinctes pour la même perle.
Les résultats des analyses des huit perles de Colmar-Aérodrome sont relativement homogènes (tabl. 4a). Il s’agit d’un cuivre très pur (Reinkupfer) puisque la part cumulée des éléments en traces est comprise entre 0,4 et 1,9 %. Seuls l’arsenic, l’antimoine et l’argent présentent des concentrations supérieures à 0,01 %. Le taux des autres éléments en trace (en particulier le plomb et le nickel) est dans la majorité des cas inférieur à 0,01 %. L’unique analyse du collier 1 se distingue des perles du collier 2 par un taux d’étain relativement élevé (0,0177 %) et des concentrations d’antimoine et d’argent très basses. Les deux analyses de la perle no 14 ont donné des résultats en grande partie comparables. Toutefois, la concentration d’arsenic varie considéra-blement (0,8957 % pour la première, 0,2542 % pour la deuxième analyse) 4.
Comparaisons des analyses sur le plan régional (Plateau suisse, Franche-Comté, Alsace, Luxembourg, Neckar)
Ces résultats permettent dans un premier temps de comparer les perles de Colmar-Aérodrome à d’autres
objets en cuivre néolithiques. Les perles de Burgäschisee-Süd, qui sont sur le plan typologique très proche de celles de Colmar (cf. supra), présentent la même signature chimique : un taux d’arsenic toujours supérieur à 0,1 %, des taux d’antimoine et d’argent généralement supérieurs à 0,01 % tandis que les autres éléments traces présentent tous des concentrations extrêmement faibles (inférieures à 0,01 % ; tabl. 4b) 5. Une telle ressemblance ne s’explique que par l’utilisa-tion d’un même type de minerai et par la mise en œuvre de techniques métallurgiques similaires.
Si l’on se tourne maintenant vers les régions voisines de Colmar, c’est-à-dire la zone comprise entre le Jura, la plaine du Rhin et la Moselle, rares sont les objets en cuivre attribuables au Néolithique. Toutefois, diffé-rentes publications font état d’une quinzaine d’objets en cuivre pour lesquels nous disposons d’analyses de composition élémentaire (tabl. 4c). Quatre haches en cuivre alsaciennes ont été analysées dans le cadre du projet « Studien zu den Anfängen der Metallurgie » (SAM) : Koenigsbruck, Niederschaeffolsheim, Rouffach et Schirrhein (Forrer, 1923, fig. 72). Une alène en cuivre et un fragment de creuset du site Michelsberg de Heilbronn-Klingenberg ont été analysés par le laboratoire de Heidelberg (Allemagne) et publiés dans la monographie consacrée à ce site (Seidel, 2008, p. 312). Six haches en cuivre, découvertes ancienne-ment dans le Jura français, ont été analysées par l’ins-titut d’archéométrie de l’université de Freiberg (Allemagne) et publiées récemment (Klassen et al., 2007). Deux haches et un poignard découverts à Schwebsange et à Remerschen (« Ile » et « Moselle »), dans le Sud-Est du Luxembourg ont été analysés par le laboratoire de l’UMR 6566 de Rennes (Valloteau et al., 2003). La comparaison des taux des différents éléments traces montre que certains de ces objets présentent, à l’instar des perles de Colmar, des taux d’arsenic (et dans une moindre mesure d’antimoine et d’argent) élevés. Il existe donc dans la région quelques objets en cuivre fabriqués à partir de la même matière première et en faisant appel aux mêmes techniques métallurgiques que les perles de Colmar.
Les analyses de Colmar dans le contexte de la métallurgie néolithique d’Europe centrale
Ceci nous amène à aborder la question de la métal-lurgie susceptible d’être à l’origine du cuivre utilisé pour fabriquer les perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd 6. Pour y répondre, il est nécessaire de comparer les analyses de composition élémentaire de Colmar et de Burgäschisee-Süd avec d’autres analyses d’objets préhistoriques en cuivre.
Ce problème a été abordé en suivant une double démarche : une première approche nous a conduit à rechercher au sein des cuivres préhistoriques (du Néolithique à l’âge du Bronze) analysés, les objets dont les taux d’éléments traces se situent au sein de limites fixées sur la base de des analyses de Colmar et de Burgäschisee-Süd ; une autre approche, totalement indépendante de la première, a consisté a soumettre
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 715
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Tabl. 4 – Composition chimique élémentaire des perles de Colmar (a), de Burgäschisee-Süd (b) et de divers objets en cuivre découverts entre le Jura, la plaine du Rhin et la Moselle (c). Les objets ayant une composition chimique comparable à celle de Colmar sont en gras. Gris-clair : concentrations supérieures à 0,01 % ; gris foncé : concentrations supérieures à 0,1 %.Table 4 – Chemical composition of the beads from Colmar (a) and Burgäschisee-Süd (b), and of various copper objects found between Jura, the Rhine plain and Moselle (c). Objects with a chemical composition similar to those from Colmar are in bold. Light-grey: concentrations over 0.01%. Dark grey: concentrations over 0.1%.
716 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
l’ensemble des analyses d’objets en cuivre néolithiques du pourtour alpin à une classification ascendante hiérar-chique puis d’isoler les classes qui présentent des caractéristiques proches de celles des perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd.
Constitution d’un corpus d’analysesqui présentent les mêmes caractéristiquesque celles de Colmar et de Burgäschisee-Süd.
Grâce au projet SAM et aux travaux qui ont suivi, nous disposons actuellement d’une base de données qui rassemble plus de 40 000 analyses d’objets en cuivre attribuables à une période qui couvre l’ensemble du Néolithique et l’âge du Bronze d’Europe et d’Asie 7. Il est clair que cet ensemble est beaucoup trop large compte tenu de nos objectifs. Nous avons donc isolé au sein de cette base de données un « corpus de réfé-rence » d’objets découverts en Europe centrale, dans les régions du pourtour alpin, dans le Nord de l’Italie et dans le bassin des Carpates et attribuables à la période qui va du début de la métallurgie centre-européenne (vers 5000 avant notre ère) au début de l’âge du Bronze (vers 2000 avant notre ère). Ce corpus de référence constitué de 2 113 analyses 8 permet donc d’élargir notre cadre de réflexion à l’ensemble des premiers groupes métallurgiques européens et des régions dans lesquelles ceux-ci sont attestés.
Les analyses des perles de Colmar présentent un certain nombre de caractéristiques (taux relativement élevés d’arsenic, d’antimoine et d’argent, quasi absence de plomb, de nickel et de bismuth) que l’on retrouve à Burgäschisee-Süd. Nous avons donc dans un premier temps recherché au sein de notre corpus de référence les objets qui présentent une composition comparable en suivant le procédé préconisé par L. Klassen (2000, p. 94) et appliqué à plusieurs reprises depuis (Klassen et al., 2007 ; Klassen, 2010). Cette démarche consiste à filtrer une base de données à partir des valeurs mini-males et maximales fixées en multipliant/divisant les taux maximum/minimum d’éléments traces de l’objet (ou du groupe d’objets) pour lequel on cherche des points de comparaison. Dans notre cas, les valeurs minimales des éléments As, Sb, Ag, Ni et Bi 9 des deux séries (Colmar et Burgäschisee-Süd) ont été divisées par deux, les valeurs maximales multipliées par deux. Un intervalle a pu être ainsi défini pour chacun des éléments mentionnés ci-dessus dans le but de fonder nos comparaisons sur une base non équivoque (tabl. 5).
Ces valeurs ont ensuite servi à filtrer les 2 113 analyses de notre corpus de référence. Ce procédé permet d’obtenir une liste constituée de 264 analyses (« liste de comparaison ») qui ne renferme que des analyses dont les valeurs sont situées en deçà des limites fixées dans le tableau 4. Les objets qui y figurent sont caractérisés par des concentrations d’éléments trace comparables à celles des perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd et donc apparentées. Ils proviennent d’une vaste région comprise entre l’Alsace et la Transdanubie, le versant nord des Alpes
et l’Est de l’Allemagne et présentent deux concentra-tions géographiques : le Salzkammergut en Autriche et la Suisse orientale d’une part, la Slovaquie d’autre part. La première concentration, qui regroupe la majo-rité des objets, correspond au Néolithique récent nord alpin, c’est-à-dire aux cultures de Mondsee, d’Altheim, de Pfyn et plus ponctuellement de Cortaillod. La deuxième concentration, centrée sur la Slovaquie, correspond à une centaine d’objets du début de l’âge du Bronze (culture de Nitra). Le Néolithique récent nord-alpin et la culture de Nitra ont donc produit des objets en cuivre qui présentent la même composition. La métallurgie de la culture de Nitra étant au moins un millénaire plus récente que celle du Néolithique récent nord-alpin, elle ne joue aucun rôle dans les problématiques qui nous préoccupent ici mais pose cependant le problème de la définition d’un type de cuivre sur la seule base de sa composition chimique (cf. infra).
Cette première approche montre donc clairement que les perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd ont été fabriquées dans une variété particulière de cuivre arsénié qui trouve des comparaisons au Néolithique récent dans le Nord-Est des Alpes et au début de l’âge du Bronze en Slovaquie. Cependant, notre liste de comparaison de 264 analyses a été obtenue à partir des valeurs des perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd. Or, à ce stade de l’étude il est impossible de dire si les valeurs de Colmar-Aérodrome et de Burgäschisee-Süd, qui ont servi à sélectionner les 264 analyses de la liste de comparaison, se situent au centre ou en marge de la variabilité du type de cuivre dont elles sont susceptible de faire partie. Dans ce deuxième cas, notre liste de comparaison pourrait se trouver dans la zone de recou-vrement de plusieurs types de cuivres différents. Cette sélection permet certes de pointer des objets dont la composition est comparable à celle des perles de Colmar-Aérodrome et de Burgäschisee-Süd. Par contre, elle ne permet ni de définir un type de cuivre parti-culier, ni de juger de sa place dans la métallurgie néolithique du domaine périalpin. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’adopter une approche plus exploratoire.
Tabl. 5 – Tableau des valeurs minimales et maximales pour les éléments traces arsenic, antimoine, argent, nickel et bismuth fixées en multipliant/divisant les valeurs maximales/minimales de ces éléments dans les analyses des perles de Colmar et de Burgäschisee-Süd ; Les valeurs 0,0005 et 0,0006 % étant en deçà du seuil de détermination des analyses réalisées dans le cadre du projet SAM, 0,000 % a été considérée comme valeur minimum.Table 5 – Table showing the minimum and maximum values for traces of arsenic, antinomy, silver, nickel and bismuth found by multiplying/dividing the maximum/minimum values of these elements in the analyses of the Colmar and Burgäschisee-Süd beads. The values 0.0005% and 0.0006% being below the determination threshold of the analyses made in the scope of the SAM project, 0.000% has been considered as the minimum value.
Éléments Valeur minimale Valeur maximale Arsenic 0,055 % 2,3 % Antimoine 0,0006 % (0,000 %) 0,2 % Argent 0,0005 % (0,000 %) 1,957 % Nickel 0,0005 % (0,000 %) 0,014 % Bismuth 0,0005 % (0,000 %) 0,01 %
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 717
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Tabl. 6 – Les concentrations moyennes, minimales et maximales et les écarts standard des éléments traces correspondant aux classes 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24 et 27 (cuivres arséniés), soit 657 analyses ; en grisé les classes retenues pour définir le cuivre arsénié du Néolithique récent nord-alpin (voir tabl. 7 et 9) et les valeurs moyennes supérieures à 0,1 %.Table 6 – Mean, minimum and maximum concentrations and the standard deviations of the trace elements corresponding to grades 3,4,6,8,9,10,12,20,21,22,23,24 and 27 (arsenical copper), 657 analyses; in grey, the grades accepted as defining arsenical copper from the Late North-Alpine Neolithic (see tables 7 and 9) and mean values over 0.1%.
Classes Sn Pb As Sb Ag Ni Bi3 n 242 242 242 242 242 242 242 valeur moyenne (%) 0,013904 0,624246 1,069902 0,269004 0,233479 0,272082 0,074450 écart standard 0,0805284 1,5577119 1,2905135 0,5590957 0,3919714 0,5069440 0,1416554 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0060 0,0200 0,050 0,0080 0,0010 valeur maximum 0,9000 16,2000 16,5833 4,5740 2,7500 3,8185 1,21204 n 205 205 205 205 205 205 205 valeur moyenne (%) 0,011244 0,033731 0,780056 0,111987 0,084482 0,011347 0,009113 écart standard 0,0670267 0,1161909 0,9089163 0,2985138 0,3073760 0,0259913 0,0150175 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0016 0,0010 0,0010 0,0009 0,0004 valeur maximum 0,6600 1,4100 5,1590 3,2816 3,8280 0,3200 0,14006 n 12 12 12 12 12 12 12 valeur moyenne (%) 0,000000 0,000000 1,235833 0,664167 0,152000 0,001000 0,300000 écart standard 0,0000000 0,0000000 0,8411297 0,4169251 0,0740565 0,0000000 0,1280625 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,2800 0,0700 0,0240 0,0010 0,1600 valeur maximum 0,0000 0,0000 2,8000 1,5500 0,2900 0,0010 0,50008 n 38 38 38 38 38 38 38 valeur moyenne (%) 0,000789 0,033947 0,990947 0,000000 0,044237 0,020632 0,016000 écart standard 0,0048666 0,1451067 0,9790346 0,0000000 0,0494398 0,0449013 0,0272337 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0060 0,0000 0,0060 0,0010 0,0010 valeur maximum 0,0300 0,8600 4,4000 0,0000 0,1700 0,2700 0,10009 n 1 1 1 1 1 1 1 valeur moyenne (%) 0,00000 0,00000 0,34000 0,00000 0,01000 0,00000 0,00000 écart standard - - - - - - - valeur minimum 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 valeur maximum 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 0,0100 0,0000 0,000010 n 17 17 17 17 17 17 17 valeur moyenne (%) 0,00000 0,007412 1,119765 0,000000 0,010529 0,008294 0,00000 écart standard 0,000000 0,0202208 0,8731228 0,0000000 0,0021828 0,0144515 0,000000 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0060 0,0000 0,0100 0,0010 0,0000 valeur maximum 0,0000 0,0760 3,6000 0,0000 0,0190 0,0500 0,000012 n 89 89 89 89 89 89 89 valeur moyenne (%) 0,026462 0,005678 0,869642 0,029140 0,067691 0,008712 0,000195 écart standard 0,1168099 0,0334681 1,0497358 0,0607640 0,1695871 0,0093010 0,0018017 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0008 0,0010 0,0010 0,0010 0,0000 valeur maximum 0,7000 0,3000 4,9000 0,5115 1,2200 0,0550 0,017020 n 6 6 6 6 6 6 6 valeur moyenne (%) 0,000000 0,000000 0,418333 0,000000 0,000000 0,098333 0,000167 écart standard 0,0000000 0,0000000 0,5717138 0,0000000 0,0000000 0,1070358 0,0004082 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 valeur maximum 0,0000 0,0000 1,5500 0,0000 0,0000 0,2500 0,001021 n 6 6 6 6 6 6 6 valeur moyenne (%) 0,033333 0,065667 2,103333 0,261833 0,000000 1,671667 0,005500 écart standard 0,0816497 0,1108543 1,3166878 0,2831610 0,0000000 1,2939925 0,0030166 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,3200 0,0300 0,0000 0,1000 0,0010 valeur maximum 0,2000 0,2700 3,4000 0,7800 0,0000 3,0000 0,010022 n 27 27 27 27 27 27 27 valeur moyenne (%) 0,000000 0,000000 0,453000 0,079037 0,000000 0,001333 0,002926 écart standard 0,0000000 0,0000000 0,5063147 0,1794321 0,0000000 0,0017321 0,0077207 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0050 0,0030 0,0000 0,0010 0,0000 valeur maximum 0,0000 0,0000 1,9500 0,8200 0,0000 0,0100 0,039023 n 1 1 1 1 1 1 1 valeur moyenne 0,0000 9,3200 4,6200 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 écart standard - - - - - - - valeur minimum 0,0000 9,3200 4,6200 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 valeur maximum 0,0000 9,3200 4,6200 0,0500 0,0000 0,0000 0,000024 n 6 6 6 6 6 6 6 valeur moyenne (%) 0,000000 0,003333 1,541667 0,000000 0,000000 0,002500 0,003167 écart standard 0,0000000 0,0081650 0,7921216 0,0000000 0,0000000 0,0036742 0,0027869 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,5400 0,0000 0,0000 0,0010 0,0010 valeur maximum 0,0000 0,0200 2,4000 0,0000 0,0000 0,0100 0,008027 n 7 7 7 7 7 7 7 valeur moyenne (%) 0,000000 0,041429 1,062857 0,090714 0,000000 0,609000 0,000714 écart standard 0,0000000 0,1096097 0,7394077 0,0702631 0,0000000 0,9760261 0,0018808 valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0700 0,0350 0,0000 0,0230 0,0000 valeur maximum 0,0000 0,2900 2,3000 0,2100 0,0000 2,8000 0,0050
718 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Classification ascendante hiérarchique
Cette étude étant centrée sur la métallurgie néolithique, nous avons éliminé les analyses d’objets attribuables au début du Bronze ancien de notre corpus de référence qui se trouve donc réduit aux seuls objets néolithiques. Cette sélection (« corpus de référence/Néolithique ») est cons-tituée de 1 452 analyses 10 qui rassemblent toutes les productions néolithiques du domaine périalpin, c’est à dire celles attribuées aux cultures de Pfyn, d’Altheim, du Mondsee mais aussi les objets de la fin du Néolithique et du début du Bronze ancien local découverts dans le marais de Ljubljana en Slovénie ou encore provenant des sépultures cordées de l’Est de l’Allemagne.
Une classification ascendante hiérarchique 11 a permis d’obtenir un premier classement au sein de ce « corpus de référence/Néolithique ». Parmi les trente classes défi-nies, treize classes correspondent à des cuivres arséniés (classes 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24 et 27, soit 657 analyses), c’est-à-dire des cuivres qui présentent un taux d’arsenic relativement haut (les valeurs maximales/minimales, moyennes et l’écart standard de chacune de ces classes figurent sur le tabl. 6). Sept d’entre elles (classes 4, 8, 9, 10, 12, 22 et 24 soit 383 analyses) ont la particularité de présenter à la fois des taux moyen d’arsenic environ dix fois supérieurs à celui des autres éléments traces 12 et d’être constituées en majorité d’objets attribuables au Néolithique récent nord alpin (cultures de Mondsee, Altheim et Pfyn). Ces 383 analyses (tabl. 7) décrivent donc un cuivre caractérisé à la fois par un spectre chimique spécifique (la prédominance de l’arsenic par rapport aux autres éléments trace) et par une utilisation presque exclusive dans un contexte chrono-culturel particulier (le Néolithique récent nord alpin).
Les neuf analyses des perles de Colmar font partie des classes 4 et 12 qui regroupent la majorité des objets constitué du cuivre décrit ci-dessus (294 sur 383). Ce résultat est largement corroboré par l’appartenance de ces mêmes perles aux groupes E01 et C3 du classement réalisé par E. Sangmeister sur la base des perles de Burgäschisee-Süd (Sangmeister et Strahm, 1973 ; ici tabl. 8) et aux groupes E01A et G du classement SAM.Cuivre arsénié et cuivre du Mondsee
Le cuivre arsénié du Néolithique récent nord-alpin (tabl. 9) correspond à une partie des groupes E01A et G du projet SAM. Dès les premiers travaux consacrés aux variétés de cuivre, le groupe E01 a été mis en rapport avec la diffusion de la métallurgie vers l’Europe centrale (Sangmeister et Strahm, 1973, p. 216). Depuis, nombreux sont les chercheurs qui se sont penché sur le problème.
La première classification ascendante hiérarchique, réalisée à partir des données collectées dans le cadre du projet SAM, a permis à B. Ottaway d’établir un lien entre cette métallurgie précoce et des variétés de cuivre particulières dont l’origine est, selon elle, à chercher dans la région du lac du Mondsee en Autriche (Ottaway, 1982, p. 130). Au début des années 1990, l’analyse d’une grande partie des objets en cuivre des sites lacustres de l’Attersee et du Mondsee a permis de montrer leur appartenance presque exclusive au groupe E01 du projet SAM. Dans un article prélimi-
naire, J. Obereder, E. Ruttkay et E. Pernicka, respon-sables de ce projet, envisagent une production locale, c’est-à-dire est-alpine, sans toutefois exclure une origine sud-est européenne des aspects typologiques et techno-logiques de cette métallurgie (Obereder et al., 1993). Motivé par des indices d’ordre archéologiques, l’un d’entre nous s’exprime alors en faveur d’une origine nord-est-alpine des variétés de cuivre représentées dans la culture du Mondsee et d’une large diffusion du métal produit dans ce contexte culturel jusque sur le Plateau suisse (Strahm, 1994, p. 20). Ce métal est alors perçu comme faisant partie du courant métallurgique carpa-tique, caractérisé non seulement par des objets mais également par une technologie et des connaissances particulières. Quelques années plus tard, I. Matuschik en arrive aux mêmes conclusions et propose le terme « cuivre du Mondsee » (Matuschik, 1998, p. 240) qu’il décrit à l’aide d’un diagramme de type Waterbolk. Plus récemment, M. Bartelheim a recensé les objets en cuivre E01 du versant nord des Alpes qu’il semble assimiler au cuivre du Mondsee. Il laisse cependant ouverte la question de l’origine de la matière première qu’il propose de situer dans le Nord-Est des Alpes, en Slovaquie ou plus largement dans le Sud-Est de l’Europe (Bartelheim et al., 2002). La question du cuivre dit « du Mondsee », tel qu’il a été caractérisé par I. Matuschik, a été repris par L. Klassen (2000) puis par R. Krause (2003, p. 152) qui le décrivent sur la base des analyses réalisées dans le cadre du projet SAM. Ces deux auteurs proposent de chercher son origine dans l’arrière-pays de la culture du Mondsee.
Les résultats de notre deuxième approche vont donc dans le même sens que ces travaux et soulignent le rôle du cuivre arsénié dans l’expansion de la première métallurgie néolithique. Cependant, nous avons égale-ment évoqué au terme de notre première approche, l’existence d’un cuivre arsénié en tous points compa-rable à celui utilisé dans le cadre des cultures de Mondsee, d’Altheim et de Pfyn, mais qui fait son apparition environ un millénaire plus tard, dans des contextes attribuables au début du Bronze ancien (culture de Nitra). La définition d’un « cuivre du Mondsee » lié à l’expansion de la première métallurgie néolithique sur la seule base de la composition chimique n’est donc pas satisfaisante puisque cette dernière n’est apparemment pas spécifique d’une période précise. Il est donc indispensable de faire la distinction entre cuivre arsénié, défini par des critères chimiques et cuivre du Mondsee dont la définition doit faire appel de surcroit à des critères culturels. C’est la raison pour laquelle nous proposons de réserver l’appellation « cuivre du Mondsee » aux seuls cuivres utilisés dans les contextes du Néolithique récent nord alpin et répon-dant aux critères chimiques mentionnés ci-dessus (cuivre arsénié du Néolithique récent nord-alpin : tabl. 9). Défini de la sorte, le « cuivre du Mondsee » ne constitue qu’une partie (et non la totalité) du cuivre arsénié.
Le grand nombre d’objets en cuivre de type Mondsee tel qu’il a été défini ci-dessus, ainsi que leur répartition permettent de poser la question de la localisation des gîtes qui ont alimenté cette métallurgie. Les hypothèses
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 719
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
N° d’analyse Commune/lieu dit (district/département/Canton) Pays Type d’objet Groupe métal- Classe lurgique (SAM) 14470 Attersee (Vöcklabruck) A hache E01 814466 Attersee (Vöcklabruck) A hache E01A 1214469 Aufham (Vöcklabruck) A hache E01A 12100030 Brixlegg-Mariahilfbergl (Brixlegg) A fragment E10 425629 Finkenstein bei Villach A hache 49 123730 Leobersdorf (Wiener-Neustadt) A torque à enroulements terminaux 49 223731 Leobersdorf (Wiener-Neustadt) A torque à enroulements terminaux E01A 224638 Lichtenwörth (Wiener-Neustadt) A torque à enroulements terminaux G 44644 Lichtenwörth (Wiener-Neustadt) A torque à enroulements terminaux E10 411196 Linz-Scharlinz (Linz) A poignard C1B 411197 Linz-Scharlinz (Linz) A poignard E11B 411592 Miedlingsdorf (Oberwart) A hache E01 414465 Misling am Attersee-Misling I (Vöcklabruck) A hache E01A 1025506 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A hache FA 1225507 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A hache E01A 1225508 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A hache E11A 1225509 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A lame E01A 1225510 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A poignard FA 1225512 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A lame E01A 1225601 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A alène E01A 1225602 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A hache E01A 1225624 Misling am Attersee-Misling II (Vöcklabruck) A hache E01A 1262204 Mödling (Mödling) A hache-marteau C1A 411526 Oggau-Seestrasse (Eisenstadt-Umgebung) A poignard E01A 1025511 Scharfling am Mondsee-St. Lorenz (Vöcklabruck) A hache E01A 1225513 Scharfling am Mondsee-St. Lorenz (Vöcklabruck) A moule E01A 124470 Schlögelsbach bei Kilb (Melk) A hache E01A 84895 Seewalchen (Vöcklabruck) A couteau G 44896 Seewalchen (Vöcklabruck) A alène E01A 44897 Seewalchen (Vöcklabruck) A alène E01A 43612 Seewalchen (Vöcklabruck) A hache E01A 814463 Seewalchen (Vöcklabruck) A hache E01A 1214473 Seewalchen (Vöcklabruck) A couteau E01A 1225611 Seewalchen (Vöcklabruck) A alène E01A 1225626 Seewalchen (Vöcklabruck) A alène E01A 123613 Seewalchen (Vöcklabruck) A hache E01 2425527 Steinabrunn (Niederösterreich) A fragment E10 124351 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache G 124340 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) C3 84341 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) E01A 84342 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84343 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) E01A 84345 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84346 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84347 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84348 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84349 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84350 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 84344 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 1025503 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 1225504 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) E01A 1225505 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) E01A 1225532 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A alène E01A 1225533 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A alène E01A 1225534 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard FG 1225535 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard E01A 1225536 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard E01A 1225537 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A spirale E01A 1225538 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard FA 1225539 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A spirale E01A 1225540 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hameçon E11A 1225541 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard E01A 1225604 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A spirale E01A 1225605 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache (fragm.) E01A 1225605 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A hache E01A 1225625 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A poignard FA 12100081 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A fragment E01A 12100082 Unterach-Mondsee-Station See (Vöcklabruck) A fragment E01A 123617 Weyeregg (Vöcklabruck) A poignard E01A 425516 Weyeregg (Vöcklabruck) A hache E01A 123615 Weyeregg (Vöcklabruck) A poignard G 2214464 Weyeregg-Puschacher (Vöcklabruck) A hache G 124318 Zwerndorf a. d. March (Gänserndorf) A hache-marteau E01A 862169 Bevaix (Neuchâtel) CH poignard FG 4
Tabl. 7 (ci-dessus et pages suivantes) – Les 383 analyses qui correspondent aux classes 4, 8, 9, 10, 12, 22 et 24 (cuivre arsénié du Néolithique récent nord-alpin ou cuivre du Mondsee) ; les numéros d’analyse font références aux corpus publiés dans Krause, 2003 ; Bartelheim et al., 2002 ; Klassen et al., 2007 ; Cevey et al., 2006 et Merkl, 2011.Table 7 (above and next pages) – The 383 analyses corresponding to grades 4, 8, 9, 10, 12, 22 and 24 (arsenical copper from the Late North-Alpine Neolithic or Mondsee copper); the analysis numbers refer to the corpus published in Krause, 2003; Bartelheim et al., 2002; Klassen et al., 2007; Cevey et al., 2006; and Merkl, 2011.
720 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
N° d’analyse Commune/lieu dit (district/département/Canton) Pays Type d’objet Groupe métal- Classe lurgique (SA M) 22232 Bevaix (Neuchâtel) CH poignard C3 862168 Bevaix (Neuchâtel) CH poignard C3 822230 Bevaix (Neuchâtel) CH poignard FG 127280 Bex (Vaud) CH hache G 424403 Bottighofen-Schlössli (Thurgovie) CH hache C3 422276 Chevroux (Vaud) CH poignard FA 862102 Chevroux (Vaud) CH ciseau E11A 122953 Chevroux (Vaud) CH ciseau E01 2262164 Concise (Vaud) CH poignard C1A 862110 Concise (Vaud) CH double spirale E01A 12SNM-ZH/A-2273 Dietikon (Zurich) CH hache E01A 422356 Egolzwil (Lucerne) CH hache G 12SNM-ZH/A-23823 Estavayer (Fribourg) CH perle E11B 4SNM-ZH/A 42323 Fällanden-Rietspitz (Zurich) CH pendentif 127051 Genève-Crêts St. Laurent (Genève) CH hache E01 462128 Genève-Crêts St. Laurent (Genève) CH hache FA 42860 Greng (Fribourg) CH hache E01 227293 Hitzkirch-Seematte (Berne) CH hache E01A 2424496 Hüttwilen-Nussbaumersee-Inseli (Thurgovie) CH hache E01A 12SNM-ZH/A-52747 Küsnacht (Zurich) CH hache bipenne G 42926 Lüscherz (Berne) CH ciseau G 42929 Lüscherz (Berne) CH poignard C3 87279 Mont CH hache C5 43037 Mörigen (Berne) CH poignard E10 42925 Mörigen (Berne) CH ciseau E01 83033 Mörigen (Berne) CH alène 49 83044 Mörigen (Berne) CH ciseau E01A 1262127 Onnens (Vaud) CH poignard FG 416526 Saint Blaise (Neuchâtel) CH pendentif E11A 425721 Saint Blaise (Neuchâtel) CH perle C1B 425778 Saint Blaise (Neuchâtel) CH spirale E10 462137 Saint Blaise (Neuchâtel) CH poignard FG 4SNM-ZH/A-8995 Saint Blaise (Neuchâtel) CH poignard C3 422238 Saint Blaise (Neuchâtel) CH poignard C3 825762 Saint Blaise (Neuchâtel) CH perle E00 FC 127108 Saint Blaise (Neuchâtel) CH poignard C3 242987 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 42988 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42989 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42990 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 42991 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 42993 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 42994 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42995 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42996 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42997 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 42998 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43000 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43001 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43002 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43003 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43004 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 43005 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43007 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43008 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43009 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43010 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43013 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 43015 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43016 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43021 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 43022 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43026 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 43090 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH ciseau E01 42992 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 83023 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 83024 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01A 83011 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 103019 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 102999 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 123006 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 123012 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 123014 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 123020 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 123025 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle G 123017 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 223018 Seeberg-Burgäschisee Süd/Grabung 1957 (Berne) CH perle E01 222923 Sutz-Lattrigen (Berne) CH poignard E01 429800 Sutz-Lattrigen (Berne) CH poignard E01 1018029 Täuffelen-Gerolfingen (Berne) CH ciseau E01 22SNM-ZH/A-8999 Täuffelen-Oefeli (Berne) CH ciseau E01A 4
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 721
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
N° d’analyse Commune/lieu dit (district/département/Canton) Pays Type d’objet Groupe métal- Classe lurgique (SAM) 2862 Trachselwald (Berne) CH hache E01A 1222143 Twann-Bahnhof/Grabung 1974 (Berne) CH poignard E01A 4SNM-ZH/A-16331 Vetroz (Valais) CH ciseau E01A 42842 Vinelz-Amt Erlau (Berne) CH poignard C3 8SNM-ZH/A-469 Wetzikon-Robenhausen (Zurich) CH hache C3 422140 Yvonand-Geilinger (Vaud) CH épingle C3 822141 Yvonand-Geilinger (Vaud) CH épingle C3 862190 Yvonand-Geilinger (Vaud) CH épingle C3 82846 Zoug-Otterswil (Zoug) CH hache (fragm.) E01A 8120055 Zurich-AKAD (Zurich) CH alène E01A 4120056 Zurich-AKAD (Zurich) CH alène E01A 4120057 Zurich-AKAD (Zurich) CH ciseau E01 4SNM-ZH/A-1003 Zurich-Bauschanze (Zurich) CH hache E01A 4SNM-ZH/A 36390 Zurich-Dampfschiffsteg (Zurich) CH alène E01A 1222357 Zurich-Mozartstrasse (Zurich) CH nodule 12SNM-ZH/A-2243 Zurich-Rathaus (Zurich) CH hache G 458013 Besenová CZ hache-marteau G 43348 Brno-Lisen-Stare Zamky CZ hache G 43349 Brno-Lisen-Stare Zamky CZ ciseau C1B 47523 Dolný Chvatliny CZ hache C1A 421396 Jicín CZ hache G 123388 Koberice CZ hache G 223382 Kojátky CZ hache G 223389 Kromeriz-Kotojedy CZ hache E01 227525 Kunetice CZ hache cruciforme E11B 47527 Kunetice CZ hache FG 44922 Ludkovice CZ hache E01 2498902 Makotrasy CZ ciseau E01A 458024 Makotrasy CZ ciseau E01A 1258025 Makotrasy CZ creuset (échantillon 1) FA 1258026 Makotrasy CZ creuset (échantillon 2) E01 1258031 Makotrasy CZ ciseau E01A 1298903 Makotrasy CZ creuset E01A 1258027 Makotrasy CZ creuset (échantillon 3) E01 2211110 Mlázovice CZ hache-marteau C1B 411111 Mlázovice CZ hache-marteau C1B 47543 Mlázovice CZ hache-marteau C1B 223241 Neratovice CZ poignard E11B 43408 Plumlov CZ hache E01 43374 Prace CZ hache E01A 43375 Prace CZ hache G 43240 Praha-Bubenec-Sibirska Gasse, CZ poignard G 43343 Praha-Liben CZ épingle G 47488 Praha-Sárka CZ hache G 47495 Praha-Sárka CZ hache G 47496 Praha-Sárka CZ hache FA 819924 Predmostí CZ poignard E01 419922 Predmostí CZ poignard E01 2219923 Predmostí CZ poignard E01 243237 Roztoky-Levy Hradec CZ poignard G 43386 Senorady CZ hache G 22100018 Sobesuky CZ tube E10 1221567 Tlumacov CZ hache C6A 421568 Tlumacov CZ hache C6B 43367 Tvorihráz CZ hache C3 43380 Vevcice CZ hache G 22100013 Vikletice CZ bracelet FG 12100017 Vikletice CZ anneau spiralé E10 123401 Vitonice CZ ciseau FA 42627 Ainring-Au (Berchtesgadener Land) D hache E01 1234238 Altenburg (Altenburger Land) D hache bipenne G 48 Altheim (Landshut) D hache E01A 49 Altheim (Landshut) D fragment FA 4Halle 3 Ampfurth-Schermcke (Börde) D hache E01A 4Halle 4 Ampfurth-Schermcke (Börde) D hache E01A 4Halle 6 Auleben (Nordhausen) D hache cruciforme G 4Halle 40 Bad Bibra-Steinbach (Burgenlandkreis) D hache G 424410 Bad Waldsee-Reute (Ravensburg) D poignard E01A 424411 Bad Waldsee-Reute (Ravensburg) D rivet C3 424413 Bad Waldsee-Reute (Ravensburg) D fil E01A 424463 Bodman-Weiler (Konstanz) D tube E11A 1234431 Börnecke-Renneberg b. Blanckenburg (Harz) D perle C1A 4Halle 7 Brachwitz (Saalekreis) D hache perforée G 472 Dillingen a. d. Donau-Reitweg (Dillingen) D poignard G 434241 Drosa-Buchberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube E01A 434460 Drosa-Küsterberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube FG 434472 Drosa-Küsterberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube G 434478 Drosa-Küsterberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube G 434527 Drosa-Küsterberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube G 434587 Drosa-Küsterberg (Anhalt-Bitterfeld) D tube C3 4Halle 10 Egeln-Bleckendorf (Salzlandkreis) D alène C3 4
722 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
N° d’analyse Commune/lieu dit (district/département/Canton) Pays Type d’objet Groupe métal- Classe lurgique (SAM) Halle 9 Egeln-Bleckendorf (Salzlandkreis) D poignard E01A 424446 Gaienhofen-Hornstaad-Hörnle I/ Schicht AH1-3 (Konstanz) D disque E11A 1224448 Gaienhofen-Hornstaad-Hörnle I/ Schicht AH4 (Konstanz) D hache E01A 12105 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D hache FA 821801 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D alène E01A 8106 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D ciseau E01A 921797 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D hache (fragm.) E01 1021798 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D hache E01 1021805 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D faucille E01 1021808 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D nodule E01A 1021853 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D alène E01A 1221804 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D anneau spiralé E01A 2221802 Goldburghausen-Goldberg (Ostalbkreis) D alène E01 2432219 Gotha-Ostheim (Gotha) D tube C3 432326 Gotha-Ostheim (Gotha) D tube C1A 4Halle 14 Halle-Advokatenweg (Halle) D hache E01A 4Halle 17 Halle-Dölauer Heide (Halle) D perle G 424405 Hattingen (Tuttlingen) D hache G 41944 Kassel-Waldau (Kassel) D hache C1B 12Halle 25 Kayna-Grosskayna-Janushügel (Burgenlandkreis) D anneau spiralé C1A 4120059 Klingenberg (Heilbronn) D alène E01A 12120060 Klingenberg (Heilbronn) D alène E01A 12156 Kornwestheim (Ludwigsburg) D hache E01A 425666 Künzing (Deggendorf) D anneau spiralé E10 1215908 Langquaid (Kelheim) D hache E01A 434433 Latdorf-Pohlsberg (Salzlandkreis) D perle G 424412 Meersburg-Haltau (Bodenseekreis) D ciseau E11B 4Halle 30 Merseburg (Saalekreis) D anneau spiralé E01A 4Halle 30 Merseburg (Saalekreis) D anneau spiralé E01A 4184 Mettenheim (Mühlheim a. Inn) D alène C3 832321 Nerkewitz (Saale-Holzland) D hache C1A 434235 Nienburg (Salzlandkreis) D hache bipenne G 4Halle 34 Petersberg (Saalekreis) D perle FA 4Halle 34 Petersberg (Saalekreis) D perle FA 4Halle 34 Petersberg (Saalekreis) D perle FA 432315 Pilsting-Trieching (Dinglofing-Landau) D poignard E01A 434436 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D Pendant E01A 434437 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D Pendant E01A 434438 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D perle E01A 434439 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D tube, fragment E01A 434440 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D fragment E01A 434441 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D fil E01A 434442 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D fil C3 434443 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D tube E01A 434444 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D tube E01A 434446 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D fil C3 434447 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D perle C3 432322 Rastenberg (Sömmerda) D hache E01A 434445 Preußlitz-Ilgensteiner Mühlberg (Salzlandkreis) D perle C3 4Halle 36 Rastenberg (Sömmerda) D hache E01A 422288 Riekofen (Regensburg) D hameçon E01A 432310 Saaldorf-Abtsdorfer See (Berchtesgadener Land) D hache G 432311 Saaldorf-Abtsdorfer See (Berchtesgadener Land) D hache E01A 449901 Schernau (Bad Kitzingen) D alène G 434239 Schortewitz-Windmühlenberg (Anhalt-Bitterfeld) D perle C1A 434240 Schortewitz-Windmühlenberg (Anhalt-Bitterfeld) D perle C1A 424499 Überlingen (Bodenseekreis) D hache bipenne FB2 1224406 Überlingen-Osthafen (Bodenseekreis) D hache C3 424409 Überlingen-Osthafen (Bodenseekreis) D hache C3 424492 Unteruhldingen (Bodenseekreis) D double spirale E11A 1232312 Wallerfing-Bachling (Dingolfing-Landau) D alène C1A 4Halle 45 Zabitz (Anhalt-Bitterfeld) D hache bipenne C3 4479 Zimmern unter der Burg (Zollernalbkreis) D Axe, double axe, Type Zabitz G 4Halle 46 Zscheiplitz (Burgenlandkreis) D hache perforée G 4120065 Chassagne (Doubs) F hache C3 4SNM-ZH/Colmar1/50 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 1/50 E01A 4SNM-ZH/Colmar2/14 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/14 E11A 4SNM-ZH/Colmar2/14 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/14 E11A 4SNM-ZH/Colmar2/16 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/16 E11B 4SNM-ZH/Colmar2/18 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/18 G 4SNM-ZH/Colmar2/19 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/19 G 4SNM-ZH/Colmar2/6 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/6 E01A 4SNM-ZH/Colmar2/11 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/11 E11A 12SNM-ZH/Colmar2/23 Colmar-Aérodrome (Haut-Rhin) F perle n° 2/23 E01A 12120063 Myon (Doubs) F hache C3 43969 Niederschaeffolsheim (Bas-Rhin) F hache E01A 472147 Ouroux-sur-Saône (Saône-et-Loire) F perle E11A 4120064 Rochefort (Doubs) F hache FA 43960 Rouffach (Haut-Rhin) F hache E01 10120062 Salins (Doubs) F hache FA 43970 Soufflenheim-Königsbruck (Bas-Rhin) F hache E01 8
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 723
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
N° d’analyse Commune/lieu dit (district/département/Canton) Pays Type d’objet Groupe métal- Classe lurgique (SAM) 77054 Soyons (Ardèche) F poignard C3 8A-40273 Lutzengüetle FL alène E01A 413010 Apagy-Nagysziget dülo H hache-marteau E10 412999 Aranyosapáti H hache cruciforme E10 126485 Aszód H hache-marteau G 413115 Bácsalmás H hache perforée G 49256 Bagamér H hache E01A 126563 Balassagyarmat H hache cruciforme 49 81296 Debrecen H hache perforée C1B 412438 Dunaföldvár H poignard G 1213402 Dunakömlöd H hache perforée C1B 413409 Dunakömlöd H hache C1B 414419 Fajsz H hache perforée E01A 2212526 Hajduböszörmény H poignard C3 413049 Hajdúhadház H hache-marteau 49 226542 Kerepes H hache-marteau 49 410939 Kisbér H hache perforée G 43742 Komárom H hache cruciforme E10 414385 Nógrádkövesd H hache G 413208 Szeged H hache E01A 2213209 Szeged H hache E01A 226556 Szilágy-Somlup H hache cruciforme E01A 1214391 Szirák H hache G 2213098 Tápé-Lebö H hache perforée E11B 46530 Tiszapolgár-Basatanya H alène E01A 46569 Tiszapolgár-Basatanya H anneau spiralé E10 46529 Tiszapolgár-Basatanya H alène 49 106571 Tiszapolgár-Basatanya H anneau spiralé E01A 22120069 Remerschen-Moselle L hache G 46475 Jibert RO hache cruciforme E01 410854 Bajc Vlkanovo-Sonda III SK tôle E11B 43352 Barca SK hache FG 458011 Besenová SK hache C3 410387 Bojnice SK hache E01 458001 Bojnice SK hache E01 103736 Bratislava SK hache-marteau G 410820 Cigel SK hache G 410849 Durciná SK hache C1B 43785 Handlová SK hache-marteau G 410398 Handlová-Na Pstruhároch SK hache-marteau C2A/B 412166 Horné Lefantovce SK hache G 429787 Horné Lefantovce SK hache G 429788 Horné Lefantovce SK hache G 478168 Horné Lefantovce SK hache G 45719 Hrkovce SK hache E01 858004 Hronské Kosihy SK hache E01 1258012 Hronské Kosihy SK hache E01 1210391 Hronské Kosihy SK hache G 2258018 Jablonovce SK hache-marteau G 126498 Kežmarok SK hache-marteau G 458006 Lisov SK hache G 46483 Nitrianske Pravno SK hache-marteau G 412507 Senec SK hache perforée G 410848 Strecno SK hache-marteau G 43354 Tibava-Hrun za cintirom SK hache-marteau E01A 410732 Tibava-Hrun za cintirom SK hache-marteau E01A 478174 Tibava-Hrun za cintirom SK hache-marteau E01A 410733 Tibava-Hrun za cintirom SK hache-marteau E01A 1017689 Veselé SK anneau E01A 1210850 Vysná Pokoradz SK hache E01 226555 Veliki Gaj SRB hache cruciforme 49 126552 Veliki Gaj SRB hache perforée G 2212475 Veliki Gaj SRB hache perforée G 225684 Horodnica UA poignard E01A 105688 Horodnica UA perle en tonnelet FA 105689 Horodnica UA perle en tonnelet FA 10
qui prévalent actuellement privilégient, on l’a vu, trois pistes : l’Europe du Sud-Est en général, la Slovaquie et le Nord-Est des Alpes. La présence de nombreux gîtes de cuivre dans l’Ouest de la Slovaquie dont certains auraient été exploités durant la Préhistoire (Tocík, 1974 ; Tocík et Bublová, 1985 ; Tocík et Zebrak, 1989 ; Schalk, 2002) peut aller dans le sens d’une origine slovaque du cuivre de type Mondsee. Cependant,
le fait que l’essentiel des objets en cuivre découvert dans cette région sont attribuables à la culture de Nitra, c’est-à-dire au début du Bronze ancien, ne conforte pas cette hypothèse. La concentration d’objets en cuivre de type Mondsee dans le Pongau et le Salzkammergut (lands de Salzbourg et de Haute-Autriche) est certes partiellement liée à la présence dans cette région des riches sites lacustres du Mondsee et de l’Attersee.
724 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Toutefois, il ne faut pas oublier que ces mêmes sites ont livré de nombreux creusets, preuve irréfutable d’une production métallurgique autochtone. La présence de nombreux gîtes de cuivre dans cette même région ne fait que renforcer l’hypothèse d’une origine locale des cuivres de type Mondsee. Le lien entre ces gîtes et la métallurgie de la culture du Mondsee a certes été remis en question par E. Pernicka sur la base d’ana-lyses isotopiques (Bartelheim et al., 2002, p. 55). La découverte sur le Götschenberg d’indices métallurgi-ques associés à de la céramique de la culture de Mondsee va pourtant clairement dans ce sens (Lippert, 1992).
La métallurgie du cuivre du Mondsee est orientée sur la production d’un corpus d’objets bien délimité : haches plates de type Thayngen, Robenhausen et Altheim, poignards à rivets et spirales à crochet (Strahm, 1994). Si ces objets sont majoritairement constitués de cuivre du Mondsee, une petite partie d’entre eux fait toutefois appel à d’autres types de cuivre. L’homogénéité typologique des objets réalisés en cuivre du Mondsee ainsi que le fait qu’ils proviennent souvent de contextes stratifiés et bien calés sur le plan chronologique, facilitent leur datation. Leur répartition est centrée sur les Préalpes du Nord. Ils y apparaissent à partir du XXXIXe siècle avant notre ère et se propagent vers l’ouest, le long des Alpes et du Danube pour atteindre les cultures d’Altheim et de Pfyn où l’activité métallurgique semble être limitée à la production d’objets à partir de cuivres déjà transformés, aucun
indice ne permettant actuellement d’y supposer l’exploi-tation et la transformation de minerais de cuivre.
Plus à l’ouest, au sein de la culture de Cortaillod, qui est en contact intensif avec la culture de Pfyn, ce même type de cuivre apparaît dans une utilisation tout à fait nouvelle. Le cuivre y est importé sous forme de baguettes qui sont ensuite débitées et transformées en anneaux ou en perles. Le caractère sommaire de cette transformation, en particulier le peu de soin accordé au raccord entre les extrémités des segments que l’on peut observer sur les perles de Burgäschisee (Sangmeister et Strahm, 1973, p. 191-194) et de Colmar (voir ci-dessus), permet d’envisager qu’elles ne sont pas conçues comme des objets de parure mais plutôt comme des objets d’échange, des équivalents. Les perles de Colmar ne constituent donc pas seulement un nouveau jalon de l’expansion du cuivre de type Mondsee vers l’ouest. Elles illustrent également de manière éclatante, au même titre que les exemplaires du Cortaillod, le fait qu’une matière première nouvelle peut revêtir un rôle totalement différent en passant d’un contexte culturel à un autre.
DISCUSSION
Les inhumations mises au jour à Colmar sont, pour l’essentiel, des inhumations régulières que l’on doit assimiler à de vraies tombes. Leur concentration au sein d’un périmètre restreint, dans une zone périphé-rique de l’habitat relève d’une configuration inédite qui permet, cas aujourd’hui unique dans la vallée du Rhin, d’identifier avec quelques certitudes un véritable ensemble funéraire. La dispersion des différentes inhu-mations sur toute la hauteur des comblements des creusements montre assez bien que les fosses sépul-crales ne sont ici rien d’autre que des fosses de type silo désaffectées ; il faut également souligner l’utilisa-tion très probablement concomitante de ce petit secteur à des fins de stockage et à des fins funéraires. Les corps inhumés en position fléchie sur le côté, rarement accompagnés de mobilier, reflètent bien ce que l’on connaît par ailleurs du rituel funéraire du Michelsberg et du Munzingen dans le sud de la plaine du Rhin. Les manipulations post dépositionnelles, la sépulture « à étages » comme la pratique de l’accompagnement dans la structure 49, s’inscrivent parfaitement dans le tableau des gestes funéraires du Néolithique récent régional, gestes récemment analysés en détail dans plusieurs contributions (Jeunesse, 2010 ; Lefranc et al., 2010).
Tabl. 8 – Attribution des perles de Colmar-Aérodrome aux classes définies par l’analyse ascendante hiérarchique et aux groupes du classe-ment réalisé par E. Sangmeister sur la base des perles de Burgäschisee-Süd (Sangmeister et Strahm, 1973).Table 8 – Attribution of the Colmar “Aérodrome” beads to the grades defined by the hierarchic ascending analysis and to E. Sangmeister’s classification groups based on the Burgäschisee-Süd beads (Sangmeister & Strahm, 1973).
Perles Classe Sangmeister et Strahm, 1973Colmar, objet 1, perle no 50 4 E01Colmar, objet 2, perle no 14 4 E01Colmar, objet 2, perle no 14 4 E01Colmar, objet 2, perle no 16 4 C3Colmar, objet 2, perle no 18 4 C3Colmar, objet 2, perle no 19 4 C3Colmar, objet 2, perle no 6 4 E01Colmar, objet 2, perle no 11 12 E01Colmar, objet 2, perle no 23 12 E01
Tabl. 9 – Le cuivre arsénié du Néolithique récent nord-alpin ; valeurs moyennes, écart standard, valeurs minimales et maximale des éléments traces (sans l’analyse no A-23823).Table 9 – Late North-Alpine Neolithic arsenical copper: mean values, standard deviations, minimum and maximum values of trace elements (without analysis no. A-23823).
Sn Pb As Sb Ag Ni Bin 382 382 382 382 382 382 382valeur moyenne (%) 0,012275 0,023153 0,825973 0,063883 0,055982 0,010664 0,006778écart standard 0,0750989 0,0987397 0,9346910 0,1606080 0,1448303 0,0246036 0,0149204valeur minimum 0,0000 0,0000 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000valeur maximum 0,7000 1,4100 5,1590 1,2000 1,2200 0,3200 0,1400
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 725
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
Le site de Colmar présente un autre intérêt : c’est en effet la première fois, dans l’histoire de la recherche sur le Néolithique récent régional, qu’ont pu être reconnus des dépôts étroitement liés à un ensemble funéraire. Tous les éléments observés doivent être considérés comme interagissant au sein d’un système symbolique dont il s’agit de saisir la signification.
Les dépôts d’animaux notamment livrent, grâce à ce contexte particulier, une grille d’interprétation originale qui pourrait être appliquée à la plupart des dépôts d’animaux en fosses circulaires recensés en Europe. À Colmar, la diversité des espèces animales déposées dans les creusements est peu compatible avec l’idée qu’il s’agit de cadavres d’animaux impropres à la consommation qui reflèteraient la mortalité naturelle. La présence de faons de cerf renvoie à la capture d’ani-maux sauvages rapportés sur le site, non pour intégrer le circuit de la consommation, mais pour faire l’objet de dépôts, ce qui en souligne le caractère actif et non hasardeux comme cela serait le cas s’il s’agissait d’ani-maux morts naturellement. L’homogénéité des âges des faons de cerf est par ailleurs un indice de prélèvements opérés à des moments précis du cycle de croissance des animaux qui peuvent être situés en fin de printemps ou au tout début d’été.
Cette caractéristique permet de pousser un peu plus loin la réflexion sur l’origine des animaux associés à ces structures, car rien ne s’oppose à ce que comme ces gibiers capturés pour faire partie des dépôts, les animaux domestiques n’aient pas de la même manière fait l’objet d’une sélection délibérée. La préservation des connexions anatomiques suggère qu’il s’agit de restes en position primaire dont la décomposition a eu lieu sur place et selon toute vraisemblance en espace colmaté. Cette caractéristique est loin d’être systéma-tique et ne se vérifie pour aucun des autres squelettes évoqués ci-dessus. Les restes des faons des struc-tures 32 et 33 ainsi que le suiné de la structure 56 sont partiellement disloqués et laissent au contraire entre-voir la possibilité d’interventions postérieures à la décomposition et de manipulations qui se déroulent dans l’espace de la fosse. Ces remaniements impliquent que les carcasses animales aient, dans certains cas, pu rester accessibles et laissent entrevoir un fonctionne-ment en plusieurs étapes qui n’est pas sans rappeler celui observé sur les squelettes humains des struc-tures 17 et 110. Leur mise en place s’apparente à une mise en scène basée sur des gestes qui se répètent d’un individu à l’autre et d’une structure à l’autre laissant soupçonner une certaine régularité. Cet aspect est un indice fort en faveur d’un rituel dont la finalité reste à élucider mais pour laquelle différentes possibilités peuvent être évoquées.
L’idée qu’il pourrait s’agir d’une pratique à caractère funéraire en relation avec les sépultures et dont les destinataires seraient les inhumés s’avère difficile à démontrer en raison de l’absence d’association directe entre des dépôts de carcasses animales et de squelettes humains, qu’ils soient installés au sein d’une même structure ou dans des structures différentes même avoisinantes. L’explication sacrificielle est de même très malaisée à argumenter. Les restes des dépouilles
animales ne souscrivent pas aux principales caractéris-tiques du sacrifice animal tel qu’il est connu par l’histoire et l’ethnologie comme don aux entités surnaturelles et festin pour les participants. L’impossi-bilité d’identifier le destinataire et l’absence de toute traces de découpe et de désarticulation qui découlent du partage des corps rendent cette hypothèse peu plau-sible. À cela s’ajoute l’apparente incompatibilité entre chasse et sacrifice soulignée par les travaux de Testart qui tient au fait qu’on ne sacrifie que des êtres vivants, animaux domestiques ou capturés (Testart, 2010). La découverte, dans l’emprise du volume corporel du suiné de la structure 17 d’une armature de flèche est le seul indice qui pourrait être mobilisé en relation avec la mise à mort.
Dans l’état actuel, l’hypothèse pour laquelle les indices les plus parlants peuvent être mobilisés est celle de pratiques d’offrandes qui impliquent des animaux sous des formes diverses, allant de carcasses complètes à des quartiers isolés. Les restes d’un membre posté-rieur de chevreuil de la structure 23 peuvent ainsi être rapportés à un cuissot soit l’une des pièces de viande les plus nobles. Les restes d’extrémités d’un membre antérieur de chevreuil (métacarpe et phalanges) de la fosse 42 pourraient de même recouvrir une significa-tion d’offrande même si à priori la valeur alimentaire du quartier correspondant est plus modeste. Dans ces deux derniers cas il est intéressant de noter qu’il s’agit de dépôts non directement associés aux dépôts humains voire de dépôts isolés dans des structures qui ne recèlent aucun reste humain. La valeur économique peut aussi être mise en avant dans les cas des carcasses complètes parmi lesquelles figurent en bonne place les suinés et le cerf dont le rôle dans l’approvisionnement en ressources diverses est déterminant. Le fait que seuls sont concernés des animaux dans la force de l’âge, qui fournissent la viande la plus tendre souligne la valeur des dons consentis. Le choix d’animaux dont l’âge semble presque calibré – quelques semaines à un an pour les suinés, 4-5 mois pour les faons de cerf – soit des animaux qui occupent une place particulière pour la régénération des troupeaux, suggère une relation forte avec les cycles naturels, le renouvellement saison-nier. Les indices d’interventions et de prélèvements sur les carcasses plus ou moins complètes inscrivent par ailleurs ces dépôts ainsi que les manipulations dont ils font l’objet dans une temporalité dont la relation avec les cycles naturels ou d’autres rythmes peut être ques-tionnée.
L’inhumation d’un individu en position non conven-tionnelle accompagné de colliers de perles en cuivre pose de nombreux problèmes d’interprétations. La question de la fonction de ces colliers est, à nos yeux, insoluble : il peut bien sûr s’agir d’objets de prestige destinés à l’affichage social mais peut être également, en suivant une piste ouverte il y’a plus d’une trentaine d’années, d’une « monnaie primitive » utilisée comme moyen d’échange dans le cadre de transactions sociales (Ottaway et Strahm, 1974). Quoiqu’il en soit, ce débat est spécifique à la culture de Cortaillod et n’a que peu d’incidence sur l’étude du dépôt de Colmar. Par contre, comme nous l’avons vu, ces objets ont été réalisés dans
726 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
une matière première exogène dont les centres de production sont, selon toute probabilité, localisés dans les Alpes autrichiennes et ont été mis en forme selon des techniques bien attestées en Suisse occidentale. Il paraît donc indiscutable qu’il s’agisse là d’objets socialement valorisés. En outre, il est important de souligner que les colliers de perles en cuivre sont, dans leur région d’origine, uniquement connus sous forme de dépôts isolés. Par contre, ils n’interviennent jamais dans la composition des mobiliers funéraires.
L’improbable association entre de tels objets et un corps en position non conventionnelle (fig. 16) nous incite à considérer comme peu vraisemblable l’hypo-thèse d’un dépôt funéraire : en effet, tous les dépôts d’objets avérés recensés au sein du corpus du Néolithique récent du Sud de la plaine du Rhin supé-rieur accompagnent des individus en position standar-disée. Il s’agit en règle générale de dépôts très modestes de céramique ou, beaucoup plus rarement, de gobelet en bois de cerf ou de mobilier poli, mais jamais d’objets de prestige (Lefranc et al., 2010).
Nous l’avons rapidement évoqué à propos de l’indi-vidu 49D, les corps en position non conventionnelle se rencontrent en majorité dans le cadre d’inhumations multiples. Dans un article récent, plusieurs chercheurs ont proposé d’identifier ces accompagnants à des « dépendants » ou, formulée de manière moins contournée, à des esclaves (Testart et al., 2010).
Il existe également en Alsace et dans le pays de Bade des exemples de corps isolés en position non conven-tionnelle (Lefranc et al., 2010). L’interprétation de ces dépôts d’individus affectant la même position non standardisée que les « accompagnants » que l’on rencontre dans les inhumations multiples est délicate : deux hypothèses ont déjà été formulées. La première, qui s’inscrit dans la logique de l’accompagnement, les identifie à des inhumations « satellites » de l’inhuma-tion principale (Boulestin, 2008). La proposition ne peut être écartée mais demeure toute théorique et, à ce jour, impossible à démontrer. La seconde hypothèse reprend l’idée, développée par A. Villes pour la Proto-histoire (Villes, 1986), d’une gradation du rituel funé-raire. Nous avons proposé dans une étude récente et en reprenant cette idée, d’identifier ces inhumations isolées non conventionnelles à des sépultures de relé-gations réservées à la même catégorie de population que celle impliquée dans le rituel de l’accompagnement (Lefranc et al., 2010). Ces quelques éléments ne permettent guère de répondre aux problèmes d’inter-prétations que soulève le dépôt pour le moins « discor-dant » de Colmar. Il faut peut-être aborder la question sous un autre angle et réfléchir aux motivations pouvant avoir conduit à l’enfouissement d’objets socialement valorisés et/ou de richesses.
Parmi ces pistes, l’hypothèse de l’accompagnement périphérique se présente comme une solution sédui-sante mais qui se heurte selon nous à un obstacle de taille : comment justifier, dans l’hypothèse de l’accompa-gnement, la présence d’objets socialement valorisés auprès d’un éventuel esclave et non auprès de l’indi-vidu dont sont célébrées les funérailles ? Il est possible que notre dépôt relève encore d’un contexte funéraire
mais s’agit-il véritablement d’accompagnement ? Cette pratique induit le plus souvent une unité de lieu, l’exis-tence d’un « espace clos » réservé au mort et à ses dépendants (Testart, 2005) 13, configuration par ailleurs bien illustrée en Alsace (Denaire, 2007 ; Lefranc et al., 2010). A. Testart a également bien insisté sur la néces-saire distinction à opérer entre l’espace réservé à la sépulture et l’espace périphérique qui est la « zone où l’on peut faire des offrandes au mort transformé en ancêtre (…) la zone encore où peuvent avoir lieu des sacrifices, humains ou pas » (Testart, 2005).
On ne peut cependant totalement rejeter l’idée qu’il puisse exister une hiérarchie des accompagnants, certains étant inhumés auprès du défunt principal – le plus souvent des enfants comme le montre le corpus alsacien (Lefranc et al. 2010) – et d’autres dans des fosses périphériques. Ce « rapprochement » ou cet « éloignement » pourraient refléter, ainsi que nous l’a suggéré A. Testart, la « distance sociale » existant entre l’inhumé principal et les accompagnants. À ce jour cependant, le corpus alsacien n’a livré aucun cas convaincant d’accompagnants « périphériques » que l’on pourrait relier à une tombe principale.
Une autre piste intéressante, suivie par L. Klassen notamment (2000), met en parallèle les dépôts d’objets de prestige avec un aspect secondaire de la cérémonie du Potlatch durant laquelle la destruction somptuaire de certains biens intervient dans le cadre de la compé-tition sociale entre élites (Mauss, 1924-1925). En suivant cette idée, la destruction volontaire de biens s’exprimerait dans le cas de Colmar non seulement par le dépôt des perles en cuivre, mais également par celui d’un individu : on mentionnera à titre d’exemple les sociétés de la côte nord-ouest du continent américain où la mise à mort ostentatoire d’esclaves est une des composantes des Potlatch de destruction (Testart, 1999 et 2001) et où du reste l’accompagnement est attesté.
Aux hypothèses de « l’accompagnement périphé-rique » ou du Potlatch de destruction, nous en ajoute-rons une troisième qui nous semble plausible et, à ce stade de la recherche, nécessaire : celle du sacrifice stricto sensu. Nous sommes bien conscients du risque qu’il y a à forcer l’interprétation, mais le dépôt de Colmar rassemble des caractères pour le moins troublants qui nous amènent donc à ne pas négliger l’option sacrificielle. Un survol de la littérature montre il est vrai que, à quelques exceptions célèbres et specta-culaires près (Duverger, 1979 ; Graulich, 2005), l’écra-sante majorité des mises à mort ritualisées d’êtres humains intervient à l’occasion de funérailles et dans le cadre strict de l’accompagnement (Memel-Foté, 2007, p. 721-733 ; Roth, 1903 ; Testart, 2004 ; Testart et al., 2010 ; Albert et al., 2005 ; Albert et Midant-Reynes, 2005 ; Crubézy et Midant-Reynes, 2005 ; Forest, 2005 ; Heymann et Selva, 1980 ; Selva, 1984). Il n’en demeure pas moins vrai que l’on rencontre ça et là des mentions de mises à mort d’êtres humains qui ne relèvent ni de l’accompagnement ni du judiciaire mais davantage du sacrifice dans une acception étroite, celle d’un rituel à trois termes (sacrifiant, sacrifié et destinataire), d’un « transfert » avec une entité supé-rieure par le biais de la destruction d’une victime (ou
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 727
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
d’un objet). On pense aux exemples bien connus des royaumes Ashantis et de Bénin (Graham, 1965 ; Campion-Vincent, 1967 ; Terray, 1994 ) mais égale-ment au sacrifice du Mériah chez les Khonds (Carrin, 2005), aux mises à mort d’esclaves chez les Tlingits lors de diverses cérémonies religieuses ou lors de consécrations de nouvelles maisons (Testart, 1999), à la cérémonie de la Morning star des Pawnees (Linton, 1926 ; Mc Leod, 1931), ainsi qu’aux nombreux exemples est-asiatiques et ouest-africains rassemblés par J.-G. Frazer dans le livre V du Rameau d’or (Esprit des blés et des bois) dans le cadre de l’exposé consacré aux cérémonies agraires (Frazer, 1933). Enfin, il faut réserver une mention spéciale à l’étude très détaillée livrée par H. Memel-Foté des « immolations d’utilité publique » au dieu protecteur de la cité, aux dieux de l’agriculture et de l’eau (Memel-Foté, 2007, p. 714-719), ainsi que des « immolations contractuelles » consacrant les alliances au sein des sociétés lignagères de la forêt ivoirienne (ibid., p. 359).
La mention de sacrifices d’êtres humains dans nombre de sociétés qui pratiquent le sacrifice animal – et souvent également, l’accompagnement – et ce à toutes les époques (Graulich, 2005, p. 13-14 ; Testart, 2006, p. 31 et 78), nous permet de considérer comme plausible cette alternative pour le dépôt de Colmar, constitué d’objets exceptionnels et, peut-être, si l’on se réfère aux exemples ethnographiques, de la dépouille d’un éventuel esclave ou captif. Nous posons l’hypothèse selon laquelle ce dépôt procède de rites d’offrandes à l’instar des animaux entiers et des pièces de viande découverts isolés dans plusieurs fosses du site. Définir quelles entités sont les bénéficiaires de ces offrandes (sacrificielles ou non) est évidemment utopique ; cependant, l’étroite relation de tous ces composants avec les tombes conventionnelles permet d’évoquer l’éventuel rôle dévolu aux ancêtres du groupe dans ces transactions surnaturelles. Le site de Colmar fonctionnerait donc à la fois comme une petite nécropole et comme un lieu « sacralisé », théâtre de rituels dont le sens nous échappe mais qui pourraient aller bien au-delà de la sphère funéraire.
NOTES
(1) Une autre datation, réalisée sur l’individu de la sépulture 110, donne une date comprise entre le Mésolithique récent et le Rubané (Gd-30170 : 6770 ± 270 BP) et donc beaucoup trop ancienne pour ce type de structure, ce qui jette un doute sur l’ensemble des datations radiocarbone du site.(2) L’importante variabilité biométrique et morphologique révélée par les ossements de suinés, la présence majoritaire d’individus jeunes voire très jeunes, n’autorisent pas une attribution précise à la forme sauvage ou domestique.(3) La sépulture 71 de Lausanne « Vidy-Chavannes 11 », datée du Cortaillod tardif contenait les restes de cinq enfants et a livré, au milieu d’éléments de parure perforés dont trois métapodes de carnivore, une dent de suidé, un pendentif biforé en pierre, des craches de cerf et des perles en calcaire, une unique perle cylindrique en cuivre (Crotti et al., 1995).(4) Cette hétérogénéité peut être liée au fait que l’arsenic est susceptible de s’enrichir en surface durant le refroidissement du métal. Ce phéno-mène a été observé sur des objets réalisés dans des cuivres qui présentent un taux élevé de cet élément (McKerrell et Tylecote, 1972, p. 216). Il pourrait expliquer la variabilité du taux d’arsenic dans le cas de la perle no 2/14 même si celle-ci n’en contient que peu. Les autres éléments ne sont, quant à eux, pas affectés par ce problème puisqu’ils présentent dans les deux cas les mêmes concentrations. L’homogénéité de la répartition des éléments chimiques (à l’exception de l’arsenic) dans les cuivres préhistoriques, déjà constatée à l’occasion de différentes études (Pernicka, 1989, p. 626), permet de considérer les résultats de l’analyse d’un échan-tillon comme étant représentatif de l’ensemble de l’objet.(5) Le fait que le taux de certains éléments traces (en particulier le fer) diffère de manière notable d’une série à l’autre est lié à l’amélioration des techniques de mesure depuis les travaux réalisés dans le cadre du projet SAM. Les difficultés rencontrées à l’époque pour déterminer le taux de fer ont déjà été évoquées (Krause et Pernicka, 1999, p. 279) et nous n’y reviendrons pas ici.(6) La composition chimique du cuivre dépend non-seulement du mine-rai utilisé (de son origine géographique et géologique) mais également des techniques mises en œuvre pour transformer celui-ci.(7) Base de donnée dite « Stuttgarter Datenbank » (Junghans et al., 1960-1974) annexée sous forme de cédérom dans Krause, 2003.(8) Doubles analyses comprises, c’est-à-dire les analyses réalisées à partir d’un seul et même objet.(9) Ces éléments ont été choisis car ils ont été régulièrement mesurés et assurent ainsi la comparabilité en particulier avec les analyses du projet SAM.(10) Analyses de Colmar-Aérodrome comprises.(11) Fonctions Average Link et Between Groups du logiciel SPSS ; Les aspects méthodologiques de ce procédé sont décrits dans Christoforidis et Pernicka, 1988, Shennan, 1997 et Baxter, 2003.(12) À une seule exception près : une perle en forme de tonnelet qui provient d’Estavayer (canton de Fribourg, Suisse ; SNM-ZH/ A-23823) est caractérisée par un taux élevé d’argent (3,828 %) et d’anti-moine (3,2816 %).(13) Il existe cependant des exceptions notables en Ashanti (Ghana) et sur la côte nord-ouest de l’Amérique où des accompagnants sont aban-donnés en forêt (Testart, 2005).
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALBERT J.-P., MIDANT-REYNES B. (2005) – Sacrifices humains et autres mises à mort rituelles : une introduction, in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 10-19.
ALBERT J.-P., CRUBEZY E., MIDANT-REYNES B. (2005) – L’archéo-logie du sacrifice humain : problèmes et hypothèses, in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 20-33.
AMBERT P., VAQUER J., dir. (2005) – La première métallurgie en France et dans les pays limitrophes, Paris, Société préhistorique française (Mémoire, 37), 306 p.
BARTELHEIM M., ECKSTEIN K., HUIJSMANS S., KRAUSE R., PERNICKA E. (2002) – Kupferzeitliche Metallgewinnung in Brixlegg, Österreich, in M. Bartelheim, E. Pernicka et R. Krause (dir.), Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt, Rahden, M. Leidorf (For-schungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft, 1), p. 33-82.
BAXTER M. J. (2003) – Statistics in Archaeology, Londres, Arnold, 300 p.
BLAIZOT F. (2001) – Premières données sur le traitement des corps humains à la transition du Néolithique récent et du Néolithique final dans le Bas-Rhin, Gallia Préhistoire, 43, p. 175-235.
BONNET A. (1899) – Die steinzeitliche Ansiedlung auf dem Michels-berge bei Untergrombach, Veröffentlichungen der Grossherzoglichen Badischen Sammlungen für Altertums- und Völkerkunde in Karlsruhe, 2, p. 39.
BOULESTIN B. (2008) – Pourquoi mourir ensemble ? À propos des tombes multiples dans le Néolithique français, Bulletin de la Société préhistorique française, 105, 1, p. 103-130.
CAMPION-VINCENT V. (1967) – L’image du Dahomey dans la presse française (1890-1895) : les sacrifices humains, Cahiers d’études africaines, 7, 25, p. 27-58.
728 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
CARRIN M. (2005) – Le sacrifice humain dans les royaumes de jungle (Inde), in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 190-211.
CEVEY C., GÜNTHER D., HUBERT V., HUNGER K., HILDBRAND E., MÜLLER-SCHESSEL N., STRAHM C., VAN WILLIGEN S., WÖRLE-SOARES M. (2006) – Archäometrische Untersuchungen jungsteinzeitlicher und bronzezeitlicher Metallobjekte aus der Sammlung des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, rapport final du programme COST-Aktion G8 « Non-destructive Analysis and Testing of Museum Objects », Zürich, Schweizerisches Landes-museum, 47 p.
CHRISTOFORIDIS A., PERNICKA E. (1988) – Gruppierung von Metallanalysen mit Hilfe der Clusteranalyse, in R. Krause, Die endneolithischen und frühbronzezeitlichen Grabfunde auf der Nordstadtterrasse von Singen am Hohentwiel, Stuttgart, Konrad Theiss (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 32), p. 252-262.
CROTTI P., MOINAT P., WOLF C. (1995) – Le Néolithique, Archéolo-gie suisse, 18, 2, p. 47-57.
CROUTSCH C., LEPROVOST C., BOUQUIN D., ARBOGAST R.-M., PUTELAT O., ENGEL E., GERBASI F. (2007) – Entzheim-Geispolsheim (Alsace, Bas-Rhin) Aéroparc (Lidl-CUS), 2. Les occupations néolithiques, rapport de fouille préventive, PAIR, SRA Alsace, 2007.
CRUBEZY E., MIDANT-REYNES B. (2005) – Les sacrifices humains à l’époque prédynastique : l’apport de la nécropole d’Adaïma, in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 58-81.
DALLMEIER L.-M., FROSCHAUER W. 1996 – Neue Befunde der Münchshöfener Gruppe in Burgweinting (Stadt Regensburg, Oberpfalz), Das Archäologie Jahr in Bayern, 1995 (1996), p. 32-34.
DENAIRE A. (2007) – Les sépultures multiples du Néolithique récent de Didenheim, Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin), in F. Le Brun-Ricalens, F. Valoteau et A. Hauzeur (dir.), Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan, actes du 26e Colloque interrégional sur le Néolithique (Luxembourg, 8 et 9 novembre 2003) = Archaeologia Mosellana, 7, p. 567-583.
DENAIRE A. (2009) – Le Néolithique moyen du Sud de la plaine du Rhin supérieur et du Nord de la Franche-Comté, Strasbourg, univer-sité de Strasbourg (Rhin-Meuse-Moselle, Monographies d’archéologie du grand Est, 3), 655 p.
D’ERRICO F., VANHAEREN M. (2000) – Mes morts et les morts de mes voisins, in C. Cupillard et A. Richard (dir.), Les derniers chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale (13000-5500 av. J.-C.), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, p. 325-342.
DUVERGER C. (1979) – La fleur létale : économie du sacrifice aztèque, Paris, Seuil, 249 p.
FOREST J.-D. (2005) – La Mésopotamie et le « sacrifice humain » en contexte funéraire, in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 180-189.
FORRER R. (1884) – Neue Funde aus der Pfahlbauten der Westschweiz, Antiqua, 4, p. 59.
FORRER R. (1885) – Statistik der in der Schweiz gefundenen Kupfer-geräthe, Antiqua, 5, p. 81, 102, 129 et 175.
FORRER R. (1923) – Nouvelles découvertes et acquisitions du Musée préhistorique et gallo-romain de Strasbourg, Cahiers d’archéologie et d’histoire d’Alsace, 53-56, p. 88-134, fig. 72.
FRAZER J.-G. (1925-1933) – Le rameau d’or, Paris, Paul Geuthner, 1925-1933 [rééd. Robert Laffont, 1981-1984], 4 vol.
GALLAY A. (2006) – Les sociétés mégalithiques. Pouvoir des hommes, mémoire des morts, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (Le savoir suisse, 37), 139 p.
GRAULICH M. (2005) – Le sacrifice humain chez les Aztèques, Paris, Fayard, 415 p.
GRAHAM J.-D. (1965) – The Slave Trade, Depopulation and Human Sacrifice in Benin History, Cahiers d’études africaines, 5, 18, p. 317-334.
GUTHMANN E. (2010) – Signification des dépôts animaux dans les structures d’habitat et les fossés d’enceinte au Néolithique récent. Les cultures de Munzingen, Michelsberg et Münchshofen (4400-3500 av. J.-C.), mémoire de master 2 « Archéologie du territoire », université de Strasbourg.
HABERMEHL K. H. (1985) – Alterbestimmung bei Wild- und Pelztieren, Berlin, Paul Parey. 223 p.
HEYMANN F., SELVA R. de (1980) – Le sacrifice en Afrique noire : première partie, Journal des Africanistes, 50, 2, p. 145-248.
HORARD-HERBIN M.-P. (1997) – Le village celtique des arènes à Levroux. L’élevage et les productions animales dans l’économie de la fin du second âge du Fer, Tours, Revue archéologique du Centre de la France (Levroux, 4 ; Supplément à la Revue archéologique du Centre de la France, 12), 205 p.
JEUNESSE C. (2010) – Les sépultures en fosses circulaires de l’horizon 4500-3500 : contribution à l’étude comparée des systèmes funéraires du Néolithique européen, in L. Barray et B. Boulestin (dir.), Morts anormaux et sépultures bizarres. Les dépôts humains en fosses cir-culaires ou en silos du Néolithique à l’âge du Fer, actes de la table ronde interdisciplinaire (Sens, mars-avril 2006), Dijon, Éditions interuniversitaires de Dijon, p. 26-46.
JEUNESSE C., LEFRANC P., DENAIRE A. (2002-2003) – Groupe de Bischheim, origine du Michelsberg, genèse du groupe d’Entzheim. La transition entre le Néolithique moyen et le Néolithique ancien dans les régions rhénanes, Zimmersheim, Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace (Cahiers de l’Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, 18-19), 280 p.
JEUNESSE C., SAINTY J. (1986) – Un nouvel habitat du Michelsberg récent (groupe de Munzingen) à Geispolsheim (Bas-Rhin). Première partie : les structures, Cahiers de l’Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, 2, p. 37-71.
JOACHIM W. (1983) – Stuttgart-Zuffenhausen, Fundberichte aus Baden-Württemberg, 8, p. 157-158.
JUNGHANS S., SANGMEISTER E., SCHRÖDER M. (1960-1974) – Metallanalysen kupferzeitlicher und frühbronzezeitlicher Bodenfunde aus Europa, Berlin, G. Mann, vol. I, 1960 ; vol. II, 1968-1974.
KLASSEN L. (2000) – Frühes Kupfer im Norden, Høbjerg, Jutland Archaeological Society (Jutland Archaeological Society Publications, 36), 358 p.
KLASSEN L., PÉTREQUIN P., GRUT H. (2007) – Haches plates en cuivre dans le Jura français. Transferts à longue distance de biens socialement valorisés pendant les IVe et IIIe millénaires, Bulletin de la Société préhistorique française, 104, 1, p. 101-124.
KLASSEN L. (2010) – Karpaten oder Alpen? Zur Herkunft der Kupfer-scheibe aus Hornstaad (Lkr. Konstanz), Archäologisches Korrespon-denzblatt, 40, 1, p. 29-48.
KRAUSE R. (2003) – Studien zur kupfer- und frühbronzezeitlichen Metallurgie zwischen Karpatenbecken und Ostsee, Rahden, M. Leidorf (Vorgeschichtliche Forschungen, 24), 388 p.
KRAUSE R., PERNICKA E. (1999) – Das neue Stuttgarter Metallanaly-seprojekt « SMAP ». Archäologisches Nachrichtenblatt, 3, p. 274-291.
KUHNLE G., WIECHMANN A., ARBOGAST R.-M., BOES E., CROUTSCH C. (1999-2000) – Le site Michelsberg et Munzingen de Holtzheim (Bas-Rhin), Revue archéologique de l’Est, 50, p. 3-51.
LEFRANC P. (2001) – L’habitat Néolithique moyen et récent de Holtzheim « Altmatt », zone d’activités économiques, phase 3 (Bas-Rhin) : fouilles 2000 et 2001, Cahiers de l’Association pour la pro-motion de la recherche archéologique en Alsace, 17, p. 107-134.
LEFRANC P., BOËS E. (2006) – L’habitat Néolithique récent et proto-historique de Rosheim « Leimen » (Bas-Rhin), rapport de fouille préventive, INRAP Grand-Est, SRA Alsace, Strasbourg, 2006.
Inhumations, dépôts d’animaux et perles en cuivre du IVe millénaire… 729
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
LEFRANC P., CHENAL F. (2008) – Entzheim, Les terres de la Chapelle, Lotissement : habitat du Néolithique ancien rubané et du Néolithique récent (Michelsberg et Munzingen), inhumations du Néolithique moyen, document final de synthèse de fouilles préventive, Strasbourg, SRA Alsace, INRAP Grand-Est, 2008.
LEFRANC P., ARBOGAST R.-M., BOËS E. (2007) – L’habitat Néo-lithique récent de Rosheim « Leimen », Cahiers alsaciens d’archéo-logie, d’art et d’histoire, 50, p. 11-26.
LEFRANC P., ALIX G., ARBOGAST R.-M. (2011a) – Inhumations et dépôts du Néolithique récent à Marlenheim « In der Hofstatt » (Bas-Rhin), Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, 54, p. 29-46.
LEFRANC P., DENAIRE A., BOËS E., ARBOGAST R.-M., BILLOIN D. (2011b) – L’habitat Néolithique récent de Geispolsheim « Forlen » (Bas-Rhin). Contribution à la périodisation de la culture de Munzingen et à l’étude de ses relations avec les cultures du plateau suisse et du lac de Constance, Revue archéologique de l’Est, 60, p. 45-82.
LEFRANC P., DENAIRE A., CHENAL F., ARBOGAST R.-M. (2010) – Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosses circulaires du Néolithique récent du Sud de la plaine du Rhin supérieur, Gallia Préhistoire, 52, p. 61-116.
LINTON R. (1926) – The Origin of the Skidi-Pawnee Sacrifice to the Morning Star, American Anthropologist, 28, 3, p. 457-466.
LIPPERT A. (1992) – Der Götschenberg bei Bischofshofen, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Mittei-lungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akade-mie der Wissenschaften, 27), 191 p.
LÜNING J. (1968) – Die Michelsberger Kultur. Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung, Bericht der Römisch-germanischen Kommission, 48, p. 1-350.
MAIER-SCHMID R. A. (1958) – Neufunde aus der « Michelsberger » Höhensiedlung bei Munzingen, Ldkr. Freiburg-i.-Br., Badische Fund-berichte, 21.
MATUSCHIK I. (1998) – Kupferfunde und Metallurgie-Belege, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Kupferzeitlichen Dolche Mittel-, Ost- und Südosteuropas, in M. Mainberger (dir.), Das Moordorf von Reute. Archäologische Untersuchungen in der Jungneolithischen Siedlung von Reute-Schorrenried, Staufen, Teraqua CAP, p. 207-261.
MAUSS M. (1924-1925) – Essai sur le don, Paris, PUF, 248 p.
Mc KERELL H., TYLECOTE R. F. (1972) – The Working of Copper-Arsenic Alloys in the Early Bronze Age and the Effects on the Deter-mination of Provenance, Proceedings of the Prehistoric Society, 38, p. 209-218.
Mc LEOD W. C. (1931) – Child sacrifice in North America, Journal de la Société des américanistes, 23,1, p. 127-138.
MEMEL-FOTÉ H. (2007) – L’esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne (XVIIe-XXe siècle), Paris, CERAP, IRD, 1009 p.
MERKL M. B. (2011) – Bell Beaker Copper Use in Central Europe: a Distinctive Tradition?, Oxford, Archaeopress (BAR, International Series 2267), 229 p.
MEROC L., SIMONNET G. (1979) – Les sépultures chasséennes de Saint-Michel-du-Touch à Toulouse (Haute-Garonne), Bulletin de la Société préhistorique française, 76, p. 379-407.
MOINAT P. (2007) – Cistes en pierre et coffre en bois, inhumations simples et dépôts complexes : un bilan des pratiques funéraires à Vidy (Lausanne, Vaud) et à Chamblandes (Pully, Vaud), in P. Moinat et P. Chambon (dir.), Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental, Lausanne, Cahier d’archéologie romande (Cahiers d’archéologie romande, 110), Paris, Société préhistorique française (Mémoire, 43), p. 195-220.
MÜLLER-BECK H. (1990) – Zur Ökologie, Ökonomie und Demo-graphie des Cortaillod-Dorfes Seeberg, Burgäschisee-Süd, Kt. Bern, in J. Schibler, J. Sedlmeier et H. Spycher (dir.), Festschrift für Hans R. Stampfli, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, p. 57-88.
MURAIL P., BRUZEK J., HOUET F., CUNHA E. (2005) – DSP : Un outil de diagnose sexuelle probabiliste à partir des données métriques de l’os coxal, Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 17, p. 167-176.
NICKEL C. (1998) – Menschliche Skelettreste aus Michelsberger Fund-zusammenhängen, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 78, p. 29-233.
OBEREDER J., PERNICKA E., RUTTKAY E. (1993) – Die Metall-funde und die Metallurgie der kupferzeitlichen Mondseegruppe. Ein Vorbericht, Archäologie in Österreich, 4, p. 5-9.
OTTAWAY B. S. (1982) – Earliest Copper Artifacts of the Northalpine Region, Berne, Universität Bern (Schriften des Seminars für Urgeschichte der Universität Bern, 7), 351 p.
OTTAWAY B., STRAHM C. (1974) – Swiss Neolithic Copper Beads: Currency, Ornament or Prestige Items?, World Archaeology, 6, p. 307-321.
OTT-LUY S. (1988) – Die Tierknochenfunde aus der mittelneolithischen Station von Künzig-Untermberg, Ldkr. Deggendorf, Veterinär Medi-zinische Dissertation, Munich.
PERNICKA E. (1989) – Erzlagerstätten in der Ägäis und ihre Ausbeu-tung im Altertum. Geochemische Untersuchungen zur Herkunfts-bestimmung archäologischer Metallobjekte, Jahrbuch des Römisch Germanischen Zentralmuseums, 34, 2, p. 607-714.
ROTH H. L. (1903) – Great Benin: its customs, art and horrors, Halifax, F. King & Sons, 288 p.
SANGMEISTER E., STRAHM C. (1973) – Die Funde aus Kupfer in Seeberg, Burgäschisee-Süd, in H.-G. Bandi, E. Sangmeister, H. Spycher, C. Strahm et K. Zimmermann (dir.), Seeberg, Burgäschisee-Süd, 6. Steingeräte und Kupferfunde, Berne, Stampfil (Acta Bernensia, 2), p. 189-256.
SCHALK E. (2002) – Forschungen zu den frühen Metallzeiten im nördlichen Karpatenraum, in M. Bartelheim, E. Pernicka et R. Krause (dir.), Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt, Rahden, M. Lei-dorf (Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft, 1), p. 265-276.
SCHMITT A. (2005) – Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-pelvienne iliaque, Bul-letins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 17, 1-2, p. 89-101.
SCHMITT G. (1987) – Trouvailles inédites du Néolithique récent et final, Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, 30, p. 35-73.
SCHWEITZER J. (1987) – Le site Michelsberg de Didenheim, Cahiers de l’Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, 3, p. 50-87.
SCHWEITZER J., FULLERINGER R. (1973) – Découverte de fosses Michelsberg à Riedisheim, Bulletin du musée historique de Mulhouse, 81, p. 23-38.
SEIDEL U. (2005) – Das Michelsberger Erdwerk von Heilbronn-Klingenberg « Schlossberg », Fundberichte aus baden-Württemberg, 28, 1, p. 19-61.
SEIDEL U. (2008) – Michelsberger Erdwerke im Raum Heilbronn, 1, Stuttgart, K. Theiss, 464 p.
SELVA R. de (1984) – Le sacrifice en Afrique noire : bibliographie analytique, deuxième partie, Journal des africanistes, 54, 1, p. 129-207.
SHENNAN S. (1997) – Quantifying Archaeology, 2e éd., Édimbourg, Edinburgh University Press, 433 p.
SIDÉRA I. (1997) – Le mobilier en matières dures animales en milieu funéraire Cerny : symbolisme et socio-économie, in C. Constantin, D. Mordant et D. Simonin (dir.), La culture de Cerny. Nouvelle éco-nomie, nouvelle société au Néolithique, actes du colloque international (Nemours, 9-11mai 1994), Nemours, APRAIF (Mémoires du musée de Préhistoire d’Île-de-France, 6), p. 499-513.
730 Philippe LEFRANC et al.
Bulletin de la Société préhistorique française 2012, tome 109, no 4, p. 689-730
SIDÉRA I. (2002) – L’outillage osseux, in C. Jeunesse (dir.), Vendenheim « Le Haut du Coteau ». Une nécropole du Néolithique ancien, document final de synthèse de fouilles préventives, SRA d’Alsace, INRAP Strasbourg, vol. 1, p. 123-133.
STAUCH E., BANGHARD K. (2002) – Das ganz normale Michelsberg, neues zur Jungneolithischen Siedlungsgeschichte zwischen Rhein und Neckar, in P. Etell, R. Friedrich et W. Schier (dir.), Interdisziplinäre Beiträge zur Siedlungsarchäologie, Gedenkschrift für Walter Janssen, Rahden, M. Leidorf (Internationale Archäologie. Studia honoraria, 17), p. 369-390.
STRAHM C. (1994) – Die Anfänge der Metallurgie in Mitteleuropa, Helvetia Archaeologica, 25, p. 2-39.
STRAHM C. (2007) – L’introduction de la métallurgie en Europe, in J. Guilaine (dir.), Le Chalcolithique et la construction des inégalités, Paris, Errance, p. 49-71.
STÖCKL H., NEUBAUER-SAURER D. (1990) – Neue Funde der Strassburger und Wauviler Gruppe aus dem nördlichen Kaiserstuhl-vorland, Cahiers de l’Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, 6, p. 115-170.
TERRAY E. (1994) – Le pouvoir, le sang et la mort dans le royaume asante au XIXe siècle, Cahiers d’études africaines, 34, 136, p. 549-561.
TESTART A. (1999) – Ce que merci veut dire. Esclaves et gens de rien sur la côte nord-ouest américaine, L’Homme, 39, 152, p. 9-28.
TESTART A. (2001) – L’esclave, la dette et le pouvoir : étude de socio-logie comparative, Paris, Errance, 238 p.
TESTART A. (2004) – Les morts d’accompagnement. La servitude volontaire, vol. I et II, Paris, Errance, 262 et 137 p.
TESTART A. (2005) – Doit-on parler de « sacrifice » à propos des morts d’accompagnement ? in J.-P. Albert et B. Midant-Reynes (dir.), Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs, Paris, Soleb (Études d’égyptologie, 6), p. 34-57.
TESTART A. (2006) – Des dons et des dieux. Anthropologie religieuse et sociologie comparative, Paris, Errance, 156 p.
TESTART A. (2010) – La déesse et le grain. Trois essais sur les religions néolithiques, Paris, Errance, 165 p.
TESTART A., JEUNESSE C., BARAY L., BOULESTIN B. (2010) – Les esclaves des tombes néolithiques, Pour la Science, 396, p. 74-80.
THÉVENIN A., SAINTY J., POULAIN T. (1978) – Fosses et sépultures Michelsberg, sablière Maetz à Rosheim (Bas-Rhin), Bulletin de la Société préhistorique française, 74, 2, p. 608-621.
TOCÍK A. (1974) – Prieskum zaniknutých banských diel v Slovinkách, Archeologicke výskumy a nálezy na Slovensku, 1974, p. 105-106.
TOCÍK A., BUBLOVÁ H. (1985) – Príspevok k výskumu zaniknutej t’ažby medi na Slovensku, Študijní Zvesti Archeologického Ústavu, 21, p. 47-128.
TOCÍK A., ŽEBRAK P. (1989) – Ausgrabungen in Špania Dolina, Piesky, in A. Hauptmann et al. (dir.), Archaeometallurgie der Alten Welt, actes du colloque international « Old World Archaeometallurgy », Bochum, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums (Der Ans-chnitt, 7), p. 71-78.
TREFFORT J.-M., DUMONT A. (2000) – Merxheim « Trumelmatten » (Haut-Rhin), Néolithique, Bronze final, Hallstatt et haut Moyen Âge, document final de synthèse de fouilles préventive, AFAN Grand-Est, SRA Alsace.
VALOTTEAU F., LE BRUN-RICALENS F., BOURHIS J.-R., QUERRE G., LEGRAIN L. (2003) – Contribution à l’étude des premiers outils métalliques du territoire luxembourgeois, Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise, 25, p. 163-173.
VAN DEN DRIESCH A., GERSTNER H. (1993) – Tierreste aus der jungneolithischen Siedlung von Mamming, Ldkr. Dingolfing-Landau, Rahden, M. Leidorf (Acta Praehistorica et Archaeologica, 25), p. 48-55.
VILLES A. (1986) – Une hypothèse : les sépultures de relégation dans les fosses d’habitat protohistorique en France septentrionale, in H. Duday et C. Masset (dir.), Anthropologie physique et archéologie : méthodes d’étude des sépultures, actes du colloque (Toulouse, novem-bre 1982), Paris, CNRS, p. 167-174.
VORUZ J.-L. (1991) – Le Néolithique suisse. Bilan documentaire, Genève, université de Genève (Document du département d’anthro-pologie et d’écologie de l’université de Genève, 16), 172 p.
WINIGER J. (1981) – Das Neolithikum der Schweiz: eine Vorle-sungsreihe zum Forschungsstand, Bâle, Seminar Für Ur- und Frühges-chichte, 323 p.
Philippe LEFRANCUMR 7044 du CNRS et INRAP
Centre archéologique de Strasbourg10, rue d’Altkirch, 67100 Strasbourg
Rose-Marie ARBOGASTUMR 7044 du CNRS, MISHA
5, allée du Général-Rouvillois, 67083 [email protected]
Fanny CHENALINRAP, Centre archéologique de Strasbourg
10, rue d’Altkirch, 67100 [email protected]
Erwin HILDBRANDMusée national suisse
Museumstrasse 2, CH-8021 Zurich (Suisse)[email protected]
Matthias MERKLLandesamt für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium StuttgartBerliner Straße 12
D-73728 Esslingen-am-Neckar (Allemagne)[email protected]
Christian STRAHMInstitut für Archäologische Wissenschaften
Albert-Ludwigs-Universität FreiburgBelfortstrasse 22
D-79089 Freiburg (Allemagne)[email protected]
Samuel VAN WILLIGENMusée national suisse
Museumstrasse 2, CH-8021 Zurich (Suisse)[email protected]
Marie WÖRLEMusée national suisse
Museumstrasse 2, CH-8021 Zurich (Suisse)[email protected]