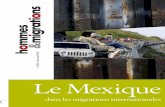Les structures de type "fente" dans le Kochersberg (Alsace)...
2013 Vergnaud L. Arbogast R.-M. et Denaire A. Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et...
-
Upload
migatosellamaguantes -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of 2013 Vergnaud L. Arbogast R.-M. et Denaire A. Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et...
Rencontre organisée parIlona BEDE, Cécile BUQUET-MARCON, Magali DETANTE, Daniel PERRIER
pour le Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
Financée parLe Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
Le Musée d’archéologie nationale
Ouvrage conçu et réalisé parLe Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
Financé parL’Inrap
Le Ministère de la Culture et de la CommunicationL’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Le Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
2
© Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraireMusée d’archéologie nationale
Château de Saint GermainPlace Charles de Gaulle
F-78105 Saint-Germain-en-Laye cedexISBN : 9782954152615
Gaaf 2014_v2.indd 2 21/03/2014 16:26:34
Rencontre autour de l’animalen contexte funéraire
Actes de la Rencontre de Saint-Germain-en-Layedes 30 et 31 mars 2012
Sous la direction deIlona BEDE et Magali DETANTE
Avec la collaboration deCécile BUQUET-MARCON
IVe Rencontre du Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
3
Gaaf 2014_v2.indd 3 21/03/2014 16:26:34
4
Comité scientifique : Armelle ALDUC-LEBAGOUSSE (CNRS, UMR 6273 CRAHAM), Rose-Marie ARBOGAST (CNRS, UMR 7044), Frédérique BLAIZOT (Inrap, UMR 5199 PACEA), Patrice BRUN (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 8215 Trajectoires), Alain DIERKENS (Université Libre de Bruxelles), Sylvie DUCHESNE (Inrap, UMR 5288 AMIS), Carole FERRET (CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale), Henri-Paul FRANCFORT (CNRS, UMR 7041 ArScAn), Sébastien LEPETZ (CNRS, MNHN, UMR 7209), † Alain TESTART (CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale).
Comité de lecture : Armelle ALDUC-LEBAGOUSSE (CNRS, UMR 6273 CRAHAM), Rose-Marie ARBOGAST (CNRS, UMR 7044), Ilona BEDE (Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; UMR 8167 Orient et Méditerranée),Frédérique BLAIZOT (Inrap, UMR 5199 PACEA), Patrice BRUN (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR 8215 Trajectoires), Cécile BUQUET-MARCON (Inrap, UMR 5199 PACEA),Louis CHAIX (Muséum d’histoire naturelle de Genève, Département d’archéozoologie),Olivier COTTÉ (Inrap, UMR 7324 CITERES-LAT),Magali DETANTE (Inrap),Alain DIERKENS (Université Libre de Bruxelles), Sylvie DUCHESNE (Inrap, UMR 5288 AMIS), Carole FERRET (CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale), Henri-Paul FRANCFORT (CNRS, UMR 7041 ArScAn), Sébastien LEPETZ (CNRS, MNHN, UMR 7209), Daniel PERRIER (Musée d’archéologie nationale, École du Louvre),Olivier PUTELAT (PAIR, UMR 7041 ArScAn Archéologies Environnementales).
Maquette et mise en pageMartine MOERMAN, Inrap
Couverture et graphismeFlorence TANE, Inrap
Secrétariat de rédactionIlona BEDE, Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; UMR 8167 Orient et Méditerranée
Magali DETANTE, Inrap
TraductionJuliette MICHEL, Chronoterre
Ilona BEDE, Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; UMR 8167 Orient et Méditerranée
Les auteurs sont responsables de l’exactitude de leurs références et citations. Ils garantissent le Gaaf contre tout recours ou action de tiers dont les droits d’auteur auraient été enfreints de façon délibérée ou non.
Gaaf 2014_v2.indd 4 21/03/2014 16:26:34
5Sommaire
Introduction
Ilona BEDE, Magali DETANTE et Cécile BUQUET-MARCONL’animal en contexte funéraire .......................................................................................................................................................... 11-14
De la Préhistoire à la fin du Néolithique
Nadia CAVANHIÉL’Ours et l’Homme préhistorique : liés jusque dans la mort ? L’exemple de la possible tombe d’ours du site de Regourdou (Dordogne). ............................................................................................................................................................... 17-23
Luc VERGNAUD, Rose-Marie ARBOGAST et Anthony DENAIRE Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace. ...................................................................................................................................................... 25-32
Les âges des Métaux en Gaule
Hélène FROQUET-UZEL et Frédéric POUPONLes vestiges fauniques issus des ensembles funéraires du Bronze final I-IIa du Gâtinais (Loiret) : nature et fonction. ........................................................................................................................................................................................... 35-44
Laurent FOURNIER et Magali DETANTEUne structure particulière associant un homme et plusieurs animaux à Chilleurs-aux-Bois (Loiret). ................................... 45-52
Grégory BAYLE, David JOSSET et Pascal JOYEUX Dépôts d’animaux entiers en contexte funéraire dans le secteur Carnute au second âge du Fer. Les découvertes de Chevilly « Pièces de Chameul » et d’Orléans « 8-10 rue Porte Madeleine » (Loiret). .......................................................... 53-62
Sébastien CHEVRIER, avec la collaboration de Carole FOSSURIER, Dominique LALAI et Julian WIETHOLDDes animaux et des hommes inhumés dans une fosse à Villemanoche (Yonne) : un cas particulier de pratiques funéraires au second âge du Fer dans le Sénonais. ......................................................................................................................... 63-84
Sylvain RENOULes offrandes animales au second âge du Fer dans la périphérie de Reims. (Marne) ............................................................... 85-93
Le monde méditerranéen antique
Stéphanie PORCIERL’animal sacré en Égypte ancienne, medium entre les vivants et les morts : un témoignage du Nouvel Empire. ............ 97-101
SOMMAIRE
Gaaf 2014_v2.indd 5 21/03/2014 16:26:35
Sommaire6
Aurélie AUBIGNAC Les dépôts d’équidés et de canidés complets dans les tombes crétoises du premier âge du Fer. ....................................... 103-110
Wolf-Rüdiger TEEGEN A dog in a human multiple burial from Roman Pergamon. Discussion of a recent discovery in the light of the osteological, archaeological and historical evidence. Un chien mis au jour dans une sépulture multiple d’époque romaine, à Pergame. Discussion sur une découverte récente au regard des données anthropologiques, archéologiques et historiques ................................................................. 111-121
La Gaule romaine
Marielle DELÉMONT et Frédéric POUPONDépôts particuliers dans une sépulture à crémation du Ier siècle après J.-C. de l’ensemble funéraire du Rio, parcelle des « Palais », à Argentomagus (Saint-Marcel, Indre). ................................................................................................ 125-131
Aurélien PIOLOT et Vincent HINCKER Dépôts carnés dans une sépulture aristocratique du IIe siècle après J-.C. cité des Viducasses : approche taphonomique et interprétation socioculturelle. ........................................................................................................................ 133-143.Anne-Sophie VIGOT, Sébastien LEPETZ, Perrine GAMBIER, May COUSSIRAT et Lucie CHRISTIN Des animaux et des hommes sur le site antique de Louvres (Val d’Oise). ............................................................................ 145-151
Du premier au second Moyen Âge
Françoise PASSARD-URLACHER, avec la contribution de Claude OLIVE Des dépôts animaliers dans les tombes : de la nourriture… pas seulement. L’exemple de la nécropole des Champs Traversains à Saint-Vit (Doubs) dans le contexte de la Burgondie franque (VIe-VIIe siècle après J.-C.). ......... 155-164
Olivier PUTELAT, Madeleine CHÂTELET, Annamaria LATRON-COLECCHIA et Hélène RÉVEILLAS Les dépôts alimentaires animaux de la nécropole mérovingienne d’Eckwersheim « Burgweg links » (Bas-Rhin). ......... 165-181
Sylvie DUCHESNE, Hélène MARTIN, Sylvie JULIEN, Sacha KACKI et Patrice GEORGESDes sépultures animales à Marsan (Gers) ? ................................................................................................................................. 183-191
À travers les steppes d’Eurasie
Élise LUNEAU Les dépôts funéraires animaliers de la civilisation de l’Oxus : diversité et singularité du rapport entre l’animal et la mort en Asie centrale méridionale à l’âge du bronze (2300-1500 avant n.è.). ............................................................... 195-209
Ilona BEDE Le cheval dans les rites funéraires de la période avare : une forme d’individuation ? (fin VIe-début IXe siècle après J.-C. ; Bassin des Carpates). ................................................................................................................................................. 211-225
Sylvie DUCHESNE, Dariya NIKOLAEVA, Patrice GÉRARD et Éric CRUBÉZY Rites funéraires et chevaux : exemple de la Iakoutie (XVe-XIXe siècles, Sibérie orientale). ................................................ 227-238
Carole FERRETDes chevaux qui accompagnent les morts en Asie intérieure. ................................................................................................. 239-250
Gaaf 2014_v2.indd 6 21/03/2014 16:26:35
7Sommaire
Représentation et Épistémologie
Pierre-Yves BALUT « Cadeau, meuble et sacrifice ». ............................................................................................................................................................ 253-255
Conclusion
François POPLINConclusion anthropozoologique, taphonomique, oryctologique. ........................................................................................... 259-262
Auteurs et intervenants .................................................................................................................................................................................................................... 265
Gaaf 2014_v2.indd 7 21/03/2014 16:26:35
25Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace
Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire, 2014, p. 25-32
La commune de Wittenheim est localisée au nord de l’agglomération mulhousienne (fig. 1). La fouille menée en 2009 sur le site du « Moulin » a permis de mettre au jour, sur les 5000 m² décapés, de nombreux vestiges s’échelonnant du Néolithique ancien (vers 5300 avant J.-C.) à l’époque Moderne (fouille S. Guillotin, Antea-Archéologie ; Guillotin 2011). Parmi ces occupations successives, celle du Néolithique récent1 a livré un petit ensemble de fosses qui se signalent par la présence d’in-humations et de dépôts d’animaux. La structure la plus spectaculaire a ainsi livré les restes d’une vache, de deux cochons et de trois squelettes humains.
Au travers de la présentation de ces découvertes, cette contribution se propose de faire le point sur les dépôts animaux et les inhumations du Néolithique récent du sud de la plaine alsacienne.
1. Le système chronologique adopté ici est celui d’Allemagne du sud-ouest. Le Néolithique récent désigne la période qui couvre l’horizon 4000-3400 avant J.-C. qui correspond à celui du Néolithique moyen II français.
1. Les inhumations et les dépôts animaux du Néolithique récent alsacien
Le Néolithique récent commence en Basse-Alsace, vers 4100-4000 avant J.-C. avec l’arrivée de la culture du Michelsberg. En Haute-Alsace, ses débuts semblent tardifs et sont marqués par l’émergence de la culture de Munzingen (fig. 2), sans doute peu avant 3900 avant J.-C. (Lefranc et al. 2011, p. 65-70).
Bien que d’origines différentes, ces deux cultures partagent un certain nombre de traits, notamment en ce qui concerne les pratiques funéraires et les dépôts animaux. Ces aspects ayant fait l’objet d’une récente synthèse (Lefranc et al. 2011), nous nous bornerons ici à en brosser les principales
Le site de Wittenheim « Le mouLin » (haut-rhin) et Les dépôts animaux
dans Les inhumations en fosses circuLaires du néoLithique récent en aLsace
Luc VERGNAUD1, Rose-Marie ARBOGAST2, Anthony DENAIRE3
1 Antea-Archéologie ; [email protected] CNRS, UMR 7044 ; Université de Strasbourg ; [email protected]
3 Antea-Archéologie ; UMR 7044 ; Université de Strasbourg ; [email protected]
20 kmN
A.Denaire, Antea-Archéologie
Ill
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
BASEL
FREIBURG
Wittenheim«Le Moulin»Wittenheim«Le Moulin»
Figure 1 : Localisation du site de Wittenheim « Le Moulin » (© Antea-Archéologie). Bischheim rhénan
Bruebach-Oberbergen
B.O.R.S
Munzingen
B.O.R.S
Michelsberg
Horgen?
Dachstein?
Haute-AlsaceBasse-Alsace3000
3500
NéolithiqueFinal
NéolithiqueRécent
NéolithiqueMoyen
4000
4500
(Av. J.-C.)
Figure 2 : Tableau chronologique simplifié du Néolithique en Alsace (© Antea-Archéologie).
Gaaf 2014_v2.indd 25 21/03/2014 16:26:43
Luc VERGNAUD, Rose-Marie ARBOGAST, Anthony DENAIRE
caractéristiques. L’une des plus remarquables est l’absence de nécropoles. Désormais, les inhumations se retrouvent dans des fosses que rien ne distingue, le plus souvent, des structures domestiques. La majorité des squelettes ont ainsi été retrouvés dans des fosses de plan circulaire ; les plus profondes sont assimilées, par analogie de forme, à des silos ; la fonction des moins profondes reste diffi cile à établir.S’il n’est pas exclu que certaines de ces fosses ont pu être creusées spécifi quement pour accueillir des inhumations, dans la majorité des cas, celles-ci interviennent après une première phase d’utilisation et d’abandon de ces structures qui se matérialisent par une épaisseur plus ou moins impor-tante de sédiment mis en place par gravité et ruissellement (Lefranc et al. 2011, p. 60-71).L’inhumation simple constitue le cas le plus fréquent, même si les inhumations plurielles sont nombreuses, en particulier dans la région de Mulhouse où plus des deux tiers des fosses accueillant des inhumations renfermaient les corps de deux individus ou plus ; le maximum est d’au moins neuf (Bergheim « Saülager », Haut-Rhin ; fouille B. Perrin, Antea-Archéologie ; inédit). Au sein d’une même fosse, les individus peuvent être inhumés en même temps, ou du moins dans un laps de temps assez court. Plusieurs exemples de dépôts successifs formés de niveaux compre-nant un ou plusieurs individus ont également été étudiés comme par exemple à Rosheim « Leimen » (Bas-Rhin ; Lefranc et al. 2011, p. 100-101) ou encore à Riedisheim « Violettes » où d’ailleurs les deux niveaux de dépôts des corps étaient séparés par près d’un mètre de sédiment (Haut-Rhin ; fi g. 3).La majorité des squelettes sont complets et en connexion. Néanmoins, plusieurs cas de remaniements, dont l’am-pleur est plus ou moins importante, sont également bien documentés. Ils peuvent alors s’accompagner du prélève-
ment d’os ou de parties de corps. Le dépôt d’os isolés ou de morceaux de cadavre reste rare, sauf dans le secteur de Colmar où il est attesté dans plus d’un tiers des dépôts de restes humains comme par exemple sur le site de Colmar « Aérodrome » (Lefranc et al. 2011, p. 102-104).Dans le cas de corps déposés complets, deux groupes de position peuvent être distingués. Le premier comprend les individus placés sur un côté, les membres inférieurs forte-ment fl échis, les avant-bras fl échis de manière à ramener les mains en avant du visage. Cette position est qualifi ée de « conventionnelle » en opposition aux corps retrouvés dans des positions les plus diverses et souvent les plus improbables. Ces deux types de position se retrouvent fréquemment au sein des mêmes fosses.Aucune orientation ne semble privilégiée, ni d’ailleurs évitée. D’après la série aujourd’hui disponible, aucun recrutement en fonction du sexe ne se dessine. En revanche, les individus immatures en général, et les jeunes enfants en particulier, sont presque systématiquement présents dans les inhuma-tions plurielles, seuls ou avec un ou des adultes.Si on ne tient pas compte des tessons erratiques et des frag-ments de torchis ou d’os animaux retrouvés dans les couches situées au-dessus ou au-dessous du dépôt des corps, le mobi-lier reste exceptionnel. La catégorie la mieux représentée est la céramique. De rares lames polies, des fragments de meule ou de molette en grès sont également signalés, ainsi que quelques objets plus « exotiques » comme les gobelets en bois de cerf importés de Franche-Comté ou du Plateau suisse (Lefranc et al. 2011, p. 77). De cette dernière région proviennent égale-ment un éclat de cristal de roche (site d’Illfurth, Haut-Rhin ; fouille M. Landolt, PAIR ; inédit) et surtout les deux magni-fi ques colliers de perles de cuivre de la fosse 23A de Colmar « Aérodrome » (Lichter 2010, p. 314).La fréquence des inhumations multiples, notamment dans la région de Mulhouse, l’existence d’une asymétrie, tant dans les positions que dans les orientations, entre les indi-vidus inhumés dans une même fosse permettent de poser la question de la pratique de l’accompagnement (Testart 2004 ; Lefranc et al 2011, p. 89-92). Celle du sacrifi ce doit également être prise en compte (Lefranc 2010 ; Lefranc et al 2011, p. 94).
Le même type de fosses, parfois d’ailleurs les mêmes struc-tures que celles ayant livré des inhumations, abritent des dépôts de corps d’animaux. Le choix des espèces est très diversifi é, incluant le chien, les petits ruminants, les cervidés (cerf et faon) ou encore les lièvres ; les suinés, surtout jeunes, sont les plus nombreux (fi g. 4). Ces dépôts peuvent concerner des squelettes complets ou des parties de squelette. Il existe aussi des exemples de réinterventions post-décompositionnelles, comme ces restes d’un suiné, provenant du site de « l’Aérodrome » de Colmar, dont une partie des os ont été rangés contre la paroi de la fosse et une autre partie prélevée.
2. Les dépôts du Néolithique récent de Wittenheim « Le Moulin »
Six des sept fosses Munzingen découvertes à Wittenheim sont groupées dans le tiers central de la fenêtre décapée,
26
niveau de dépôt des squelettes
1 et 2
niveau de dépôt du squelette 3
Figure 3 : Riedisheim « Violettes », fosse 1 (d’après Schweitzer et Fulleringer 1973).
Gaaf 2014_v2.indd 26 21/03/2014 16:26:45
la dernière apparaissant un peu plus isolé, à une quinzaine de mètres au sud-est (fi g. 5). De plan circulaire, ces fosses relèvent toutes, par leur profi l et leurs dimensions, de la catégorie des silos. Plusieurs d’entre elles ont été partiel-lement perturbées par l’aménagement de structures plus tardives, notamment un large fossé dans lequel plusieurs os humains ont été retrouvés et datés par radiocarbone du Néolithique récent. Il n’est donc pas impossible que des fosses Munzingen moins profondes aient été complè-tement détruites.Seules les fosses 136 et 299 ont livré des vases caractéristiques de la culture de Munzingen ; plusieurs dates radiocarbones ont donc été réalisées pour préciser la datation des autres fosses qui, si on se fi e aux résultats, ont été utilisées entre 3750 et 3650 avant J.-C. (fi g. 6).
Les structures 136 et 564 n’ont pas livré de restes humains ou animaux. L’une d’elles (st. 136) se signale toutefois par la présence, à une quarantaine de centimètres au-dessus du fond, d’une jatte écrasée sur place (fi g. 6). Elle est complète à l’exception de son fond, brisé volontairement.La fosse 566 a, quant à elle, livré les restes d’un adulte, probablement une femme (fi g. 7). L’état de ce squelette, très
incomplet, s’explique sans doute en grande partie par le creu-sement du grand fossé traversant le site.La fosse 33 renfermait les restes d’un adulte et d’un jeune enfant, inhumés simultanément ou dans un laps de temps de temps assez court. Tous deux ont été disposés en posi-tion fl échie, l’adulte sur le côté, l’enfant sur le ventre (fi g. 8). Cinq perles discoïdes en nacre ont été retrouvées dans le volume du corps de l’adulte.Deux individus ont également été enterrés dans la fosse 487 (fi g. 9). Il s’agit cette fois de deux adultes, tous deux retrouvés
27Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace
Figure 4 : Colmar « Aérodrome », structure 17 (d’après Lefranc et al. 2011, p. 89).
Figure 5 : Wittenheim « Le Moulin », plan du site (© Antea-Archeologie).
Figure 6 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 136 (© Antea-Archéologie).
10 cm0
Niveaudu dépôt
0 1 m
Structures autres périodesStructures Munzingen sans dépôt Structures Munzingen avec dépôt
0 20 m
487426
566
299
564
33
136
487426
566
299
564
33
136
Gaaf 2014_v2.indd 27 21/03/2014 16:26:49
Luc VERGNAUD, Rose-Marie ARBOGAST, Anthony DENAIRE
en position conventionnelle. Pour seul mobilier, un gros galet a été placé sous le coude de l’un des défunts.Le contenu de la fosse 426 est nettement plus spectaculaire (fig. 10). Malgré les dimensions peu importantes du creuse-ment – environ 1,50 m de diamètre pour une profondeur conservée dépassant de peu 1 m –, trois hommes, une vache, les restes de deux cochons et plusieurs blocs de grès et frag-ments de meule ou de molette y ont été déposés. Ces restes proviennent de deux niveaux distincts. Ainsi, le premier dépôt, localisé sur le fond de la fosse, comprenait les blocs de roche, les fragments de mobilier de mouture ainsi que les ossements animaux (fig. 11). Ceux-ci proviennent d’un squelette subcomplet de bovin et de deux squelettes de jeunes suinés, d’âge périnatal. Il s’agit d’osse-ments complets indemnes de fragmentation et de traces d’exposition au feu. Aucune marque imputable à l’exploita-tion bouchère où à la préparation culinaire n’a été observée.
Les restes du bovin attestent la présence de tous les éléments du squelette à l’exception de l’extrémité du membre antérieur droit dont manquent les éléments carpiens, le métacarpe et les phalanges. Ces lacunes ne sont pas attribuables aux condi-tions de conservation qui semblent assez favorables si l’on en juge par la représentation de parties assez fragiles comme les cartilages costaux, les vertèbres et le crâne (dont les os hyoïdes figurent parmi les éléments retrouvés). Il s’agit d’une vache adulte au crâne acère, dont l’os frontal ne porte pas de trace de développement de la cheville osseuse. Une autre particularité concerne les troisièmes molaires inférieures et supérieures, qui présentent une usure des lobes fortement asymétrique. La répartition des différents ossements ainsi que la préservation de certaines connexions anatomiques laissent entrevoir plusieurs phases dans la mise en place de cette dépouille animale dans l’espace très contraint de la structure. Le crâne avec les mandibules en connexion gisait sur le fond de la fosse,
28
Figure 7 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la fosse 566 (© Antea-Archéologie).
Niveau du dépôt
0 1 m
Niveaudu dépôt
0 3 cm
0 1 m
Figure 8 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 33 (© Antea-Archéologie)
Niveaudu dépôt
0 1 mGalet
Figure 9 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la fosse 487 (© Antea-Archéologie).
Gaaf 2014_v2.indd 28 21/03/2014 16:26:51
29Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace
Niveau de dépôtdes restes humains
Niveau de dépôtdes restes de faune
0 50 cm
Ossements humains
Ossements animaux
Céramique
Pierre
Figure 10 : Wittenheim « Le Moulin », plan et coupe de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
0 1 m
Ossements animaux
Pierre
Figure 11 : Wittenheim « Le Moulin », plan et vue de premier niveau de dépôt de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
Gaaf 2014_v2.indd 29 21/03/2014 16:26:58
Luc VERGNAUD, Rose-Marie ARBOGAST, Anthony DENAIRE
sur le côté droit, en continuité avec les vertèbres cervicales. Une rupture s’observe au niveau des premières thoraciques et peut être attribuée au fait que la colonne vertébrale apparaît fortement fléchie pour tenir dans l’espace limité de la fosse. Le sacrum est en connexion avec les os coxaux ainsi que les os des membres postérieurs, dont la position fléchie apparaît également liée à l’étroitesse de l’espace disponible. Les ossements des membres antérieurs apparaissent en connexion partielle. En effet, les relations articulaires entre les différents éléments semblent bien préservées alors que les membres sont dissociés du tronc. Les éléments du membre antérieur gauche gisent en avant du crâne, à l’écart de leur position attendue au dessus de la cage thoracique de même que ceux du membre droit dont l’extrémité est manquante. Ces caractéristiques permettent de reconstituer une mise en place en plusieurs étapes dont la première correspond à la dissociation des membres antérieurs, suivie du dépôt de la dépouille la tête en bas, réduite au rachis, à la cage thoracique et aux membres postérieurs, par-dessus. Les éléments des membres antérieurs ont probablement été disposés dans un troisième temps, dans l’espace disponible entre les parois et le volume de la dépouille. Cette séquence, ainsi que le prélèvement d’une partie d’un des membres, implique une série de gestes qui s’accorde avec l’idée d’un dépôt intentionnel d’un animal dont les caractéristiques particulières laissent penser qu’il a pu faire l’objet d’une sélection. Les ossements des deux suinés étaient mêlés à ceux du squelette de bovin. La représentation se réduit aux os longs, un métapode et un calcanéum, aux éléments crâniens dissociés, à quelques noyaux vertébraux et des fragments de côtes. Ces éléments permettent de recons-
tituer un squelette complet. Les lacunes concernent les parties les plus fragiles et les plus sensibles aux effets de la conservation différentielle. La position de ce squelette par rapport à celui du bovin n’est pas connue. Le deuxième porcelet, d’âge approximativement équivalent d’après le développement des diaphyses, n’est attesté que par un humérus et un fémur. Il n’est pas possible de préciser si ces vestiges proviennent d’une carcasse complète, auquel cas la disparition plus importante des autres éléments s’expli-querait difficilement, ou de parties de squelette. Il ne nous est pas possible de déterminer si ce premier niveau correspond à un seul dépôt ou au résultat de plusieurs événements successifs ; les blocs de roche et les animaux n’ont pas forcément été placés au même moment dans cette fosse et, même si les restes de suinés ont été découverts parmi les ossements du squelette de vache, rien ne permet de conclure qu’ils ont été déposés simultanément.
Le second niveau de dépôt correspond à celui des squelettes humains (fig. 12). Il est séparé du sommet du premier dépôt par une trentaine de centimètres de limon brun stérile. Les trois individus ont été inhumés en même temps ou dans un laps de temps assez court.Le premier corps déposé est celui d’un individu périnatal placé sur le ventre, les membres inférieurs faiblement fléchis. Directement sur lui, le corps d’un second enfant (6-10 ans) a été placé sur le côté droit, en position conven-tionnelle. Sa tête reposait sur un petit bol en céramique.Le dernier inhumé est un adulte. Bien que son squelette soit largement incomplet, il a probablement été déposé entier dans la fosse. En effet, l’absence d’une grande partie des os des jambes s’explique par le creusement de structures médiévales. Il est toutefois possible de restituer sa position
30
adulte
enfant
périnatal
0 5 cm
0 50 cm
Figure 12 : Wittenheim « Le Moulin », plan et vue du second niveau de dépôt de la fosse 426 (© Antea-Archéologie).
Gaaf 2014_v2.indd 30 21/03/2014 16:27:00
initiale, sur le dos, les membres inférieurs fortement fléchis. Précisons que son épaule droite reposait directement sur l’épaule gauche de l’enfant.Il est délicat d’apprécier le laps de temps qui sépare la constitution de ces deux niveaux de dépôts. L’absence de tout phénomène de soutirage généré par la décomposition du cadavre de la vache – le niveau de dépôt des squelettes humains est horizontal – suggère fortement qu’il s’est écoulé une durée assez importante entre les deux dépôts, plusieurs mois étant sans doute un minimum pour la décomposition d’un tel volume de chair.
Pour terminer cette description des fosses de Wittenheim, il faut évoquer la fosse 299 (fig. 13) où deux niveaux distincts de dépôts ont également été observés. Le premier comprend un grand vase, complet, mais écrasé sur place par le poids des sédiments. Il a été placé sur sa base, sur le fond de la fosse. L’étude du sédiment prélevé parmi les tessons n’a rien révélé quant à son éventuel contenu. Une cinquantaine de centimètres au-dessus, ont été retrouvés les restes d’un jeune suiné dont la conservation de tous les éléments et la préservation de l’intégralité des connexions anatomiques évoquent le dépôt d’un animal complet, disposé sur le flanc gauche, les pattes étendues, en position de repos.
Discussion
Les fosses circulaires du site de Wittenheim offrent un bon exemple de la diversité des types de dépôts que l’on peut retrouver en Alsace au Néolithique récent. La fosse 426 reste toutefois, dans ce contexte, un cas exceptionnel et spectacu-laire. Si l’inhumation simultanée de trois corps est fréquente, en particulier dans la région mulhousienne, la coexistence au sein d’une même fosse de restes humains et animaux l’est beau-coup moins. En Alsace, la majorité des autres exemples connus proviennent du site de Colmar. La structure 17 de ce site a livré les restes d’un individu adulte déposé quelques centimètres au-dessus du squelette complet d’un jeune sanglier. Toujours sur le même site, la fosse 23A contenait le corps d’un individu inhumé avec une dotation exceptionnelle constituée de deux colliers composé de 56 perles en cuivre. À une vingtaine de centimètres au-dessus, le comblement recelait des fragments osseux d’un cuissot de chevreuil. Enfin, un fragment de calotte crânienne a été découvert parmi les os d’un faon au sein de la structure 33 (Lefranc et al. 2011, p. 102-104). Par ailleurs on ne peut que souligner la difficulté qu’il peut y avoir à faire rentrer une carcasse de vache dans une fosse dont les dimensions restent, somme toute, assez modestes. Mais il se singularise aussi par la nature même de l’espèce
31Le site de Wittenheim « Le Moulin » (Haut-Rhin) et les dépôts animaux dans les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent en Alsace
Figure 13 : Wittenheim « Le Moulin », plan, coupe et mobilier de la fosse 299 (© Antea-Archéologie).
0 10 cm
Niveau dudépôt animal
Niveau dudépôt céramique
0 1 m
Gaaf 2014_v2.indd 31 21/03/2014 16:27:01
Luc VERGNAUD, Rose-Marie ARBOGAST, Anthony DENAIRE
déposée ; la découverte d’un bovin est, à ce jour, un cas unique au niveau régional.L’exemple de Wittenheim « Le Moulin » permet également de souligner le rôle particulier que semblent jouer les dépôts animaux au Néolithique récent. Sur ce site comme ailleurs, ils sont toujours retrouvés à proximité de restes humains, au sein des mêmes fosses (st. 426) ou dans des structures distinctes, mais voisines (st. 299). Dans les deux cas, il faut toutefois se garder de les assimiler trop rapidement à du « mobilier » funéraire. Le fait que la plupart de ces animaux se retrouvent seuls est bien entendu un argument allant à l’encontre de cette hypothèse. La présence de carcasses animales dans des creusements accueillant également des inhumations ne plaide pas forcément davantage pour une explication funéraire. Au contraire, comme dans la fosse 426, les ossements animaux et humains appartiennent à des ensembles séparés, relevant d’épisodes successifs et pour lesquels il est délicat d’établir un lien direct, d’autant que certains dépôts animaux interviennent parfois plusieurs mois avant celui des restes humains (Lefranc et al 2011, p. 87-92). Si elle n’est pas funéraire, la finalité de ces dépôts animaux reste à établir, l’hypothèse d’offrandes ou de dépôts symboliques peut être proposée. L’absence d’indices de valorisation bouchère, la diversité des espèces rencontrées qui concerne autant les animaux du cheptel que la faune sauvage sont des caractéristiques qui s’accordent mal avec le statut de dépôts alimentaires. Le choix d’animaux très jeunes, comme les squelettes de porcelets ou dans la force de l’âge comme le bovin et les indices d’interventions et de prélèvements sur des carcasses plus ou moins complètes inscrivent par ailleurs ces dépôts dans une temporalité dont la relation avec les cycles naturels ou d’autres rythmes peut être questionnée. Par ailleurs, ces dépôts animaux présentent indéniablement d’étroits parallèles avec ceux de corps humains. Ainsi, les deux se retrouvent quasi-exclusivement dans des fosses circulaires, le plus souvent réutilisées. De plus, les cadavres humains et les dépouilles animales sont habituellement déposés complets. Leur intégrité est souvent respectée, mais pas toujours ; certains font l’objet, une fois la décomposition du corps achevée, de manipulations, de réinterventions plus ou moins poussées qui peuvent s’accompagner du prélèvement d’os ou de segments anatomiques. Enfin, plusieurs dépôts, tant animaux
qu’humains, se limitent à des os isolés ou à des parties anatomiques. Ces convergences vont d’ailleurs assez loin puisque l’hypothèse de dépôts humains non funéraires est également avancée (Lefranc 2010).
Il est certain que ces similitudes posent de nombreuses questions quant à la place que pouvait occuper les animaux déposés près ou dans les fosses accueillant des inhumations, questions auxquelles le Groupement de recherche en cours sur les inhumations en fosses circulaires du Néolithique récent/moyen II tâchera d’apporter quelques éléments de réponses (GDR 3442 Humfosneo).
Guillotin 2011 : GUILLOTIN (S.) dir. – Wittenheim « Lotissement Le Moulin ». DFS de fouille préventive. Habsheim : Antea-Archéologie, 2011. 2 vol.
Lefranc 2010 : LEFRANC (P.). – Une découverte énig-matique en Alsace. Pour la Science, 396, 2010, p. 78.
Lefranc et al. 2011 : LEFRANC (P.), DENAIRE (A.), ARBOGAST (R.-M.), CHENAL (F.). – Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosse circulaire du Néolithique récent du sud de la plaine du Rhin supérieur. Gallia Préhistoire, 52, 2010, p. 61-116.
Lichter 2010 : LICHTER (C.). – Jungsteinzeit im Umbruch. Die « Michelsberger Kultur » und Mitteleuropa vor 6.000 Jahren : exposition au Badischen Landesmuseum Schloss Karlsruhe, 20 novembre 2010-15 mai 2011. Darmstadt : Primus Verlag, 2010. 414 p.
Schweitzer et Fulleringer 1973 : SCHWEITZER (J.), FULLERINGER (R.). – Découverte de fosses Michelsberg à Riedisheim. Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, 81, 1973, p. 23-38.
Testart 2004 : TESTART (A.). – Les morts d’accompagne-ment. La servitude volontaire I. Paris : Errance, 2004, 261 p.
32
Gaaf 2014_v2.indd 32 21/03/2014 16:27:02