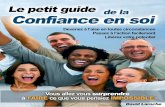Vision de l'Autre et Vision de Soi (revised)
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Vision de l'Autre et Vision de Soi (revised)
UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE. ANNEE 2013-2014.
Vision de l’Autre et Vision de Soi.
Les attitudes anglaises face à l’Etranger dans la première
moitié du XVe Siècle
Mémoire de Master 2.
Melissa Barry
Sous la direction de Messieurs Olivier MATTEONI
&
Christopher FLETCHER
1
This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise,
This fortress built by Nature for herself
Against infection and the hand of war,
This happy breed of men, this little world,
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands,
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings,
Fear'd by their breed and famous by their birth
Renowned for their deeds as far from home,
For Christian service and true chivalry,
As is the sepulchre in stubborn Jewry,
Of the world's ransom, blessed Mary's Son,
This land of such dear souls, this dear dear land,
Dear for her reputation through the world,
Is now leased out, I die pronouncing it,
Like to a tenement or pelting farm:
England, bound in with the triumphant sea
Whose rocky shore beats back the envious siege
Of watery Neptune, is now bound in with shame,
With inky blots and rotten parchment bonds:
That England, that was wont to conquer others,
Hath made a shameful conquest of itself.
Ah, would the scandal vanish with my life,
How happy then were my ensuing death!
William Shakespeare, The Tragedy of King Richard II, Acte II, scène 1.
2
Illustration en couverture : Richard Beauchamp reçu comme capitaine de Calais en 1414, The
Beauchamp Pageants, British Library, Ms Cotton Julius IV E.
3
Table des matières
Introduction……. .......................................................................................................................................5
I) Contacts et Pratiques.
A) L’Angleterre et ses voisins
1)Les relations politiques, militaires et économiques……………………………………………………………………… 14
2) Insécurité sur terre, insécurité sur mer……………………………………………………………………………………..….22
B) Présence anglaise hors d’Angleterre
1) L’expérience anglaise en Europe…………………………………………………………………………………………………..31
2) La présence « coloniale »……………………………………………………………………………………………………………..35
C) Régulation de la présence et de l’activité étrangère en Angleterre
1) Les réactions anglaises face à la présence étrangère……………………………………………………………………44
2) Régulation de l’activité marchande………………………………………………………………………………………………51
II) Images mentales de l’Etranger
A) Les thèmes liés à la figure de l’Etranger
1) Les contextes d’apparition de l’Etranger dans les textes : termes et concordances………………………55
2) L’ Etranger : une menace pour la communauté anglaise……………………………………………………………..59
3) Le « bon » et le « mauvais » Etranger : les figures opposées de l’Empereur Sigismond et de Philippe
le Bon……………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
B) Registres de la description des peuples
1) Le sentiment de l’altérité ethnique……………………………………………………………………………………………….71
2) Portraits de peuples……………………………………………………………………………………………………………………..74
3) Des cas exemplaires : le Flamand et le Français…………………………………………………………………………… 79
III) La définition de l’ « Englishness » face à l’Etranger
A) La description du caractère national : vices des étrangers et vertus anglaises
1) L’éloge du caractère national……………………………………………………………………………………………………….93
2) Grandeur et décadence ? L’évolution du discours face aux revers et à la défaite……………………….103
3) L’enjeu de l’honneur national face à l’Etranger…………………………………………………………………………. 107
B) Le développement des mythes et symboles de la nation
1) La conscience d’un passé glorieux……………………………………………………………………………………………...110
2) La nation et Dieu………………………………………………………………………………………………………………………..122
C) L’identité anglaise face à la Double Monarchie
1) Le double héritage dynastique d’Henry VI et les réactions de l’opinion publique anglaise………. .129
2) La récupération des mythes et symboles de la royauté et de la nation françaises…………………… 131
4
D) Penser et repenser la place de la nation en Europe
1)Le Libelle of Englyshe Polycye, une définition originale de l’identité anglaise………………………………137
2) Une nouvelle perception de l’insularité…………………………………………………………………………………… 139
Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
Sources et bibliographie……………………………………………………………………………………………………………… 147
5
Introduction. De nombreuses difficultés attendent le médiéviste qui s’engage dans une réflexion sur l’idée
de nation. En effet, il est alors confronté à des concepts anthropologiques dont le
maniement est en lui-même difficile, de l’aveu-même des spécialistes. C’est ainsi que, pour
Benedict Anderson, « Nation, nationalité, nationalisme sont autant de notions notoirement
difficiles à définir, a fortiori à analyser »1, à tel point qu’il semble impossible d’en concevoir
une définition scientifique. De fait, les spécialistes en Sciences Humaines tendent alors à
faire de la nation une pure construction mentale découlant du sentiment d’appartenance de
ses membres, de sorte qu’ Hugh Seton-Watson écrit qu’une nation existe « quand un
nombre significatif des membres d’une communauté considèrent qu’ils forment une nation,
ou se conduisent comme s’ils en formaient une », et que Benedict Anderson propose de
définir la nation comme une « communauté imaginaire » (« Imagined community »)2.
A cette absence de définition précise vient alors s’ajouter une difficulté plus sérieuse
encore : la question de la légitimité de l’application de ces concepts à la période médiévale.
En effet, force est de constater que les spécialistes associent intrinsèquement l’idée de
nation au concept de modernité, et ne conçoivent en aucun cas sa naissance au Moyen Age,
Benedict Anderson allant jusqu’à nier explicitement à l’esprit médiéval chrétien toute
capacité à penser la nation3. De même, ces concepts, très récents, ne trouvent pas de réel
équivalent à la période médiévale, à laquelle le terme de natio peut renvoyer à des réalités
très diverses, et traduit surtout l’appartenance à un groupe, familial, ethnique, géographique
ou institutionnel4. Enfin, si la question du sentiment national a fait l’objet d’excellents
travaux collectifs parmi les médiévistes5, le débat semble loin d’être clôt, comme le
démontre un colloque tenu en Sorbonne en 2013, pendant lequel on a pu évoquer à la fois
la tendance des historiens à « plaquer des désirs assez contemporains » sur des hommes et
des femmes d’une autre époque, et leur incapacité à « sonder les cœurs » de ces derniers6.
Face à ces difficultés, il a alors semblé nécessaire de revenir au seul élément de définition
semblant faire consensus chez les anthropologues : le principe selon lequel toute
communauté se définit avant tout par l’exclusion de ceux qui sont identifiés comme n’en
faisant pas partie. C’est ainsi que l’anthropologue norvégien Fredrik Barth, inventeur du
1 Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres et New-York, 2006 [1983] (p.3). 2 Ibid (p.6-7 ; la citation d’Hugh Seton-Watson est donnée dans la note 9, p.6). 3 Ibid (p.22). 4 Pour une discussion du terme natio au Moyen Age et de sa possible évolution vers la définition moderne à la fin de la période, voir Louise R. Loomis, « Nationality at the Council of Constance: An Anglo-French Dispute », in The American Historical Review, Vol. 44, No. 3 (Avril 1939), p. 508-527. 5 Parmi ces derniers, on peut citer les études réunies dans Concepts of National Identity in the Middle Ages, Simon Forde, Lesley Johnson et Alan V. Murray (eds.), Leeds, 1995 ; et dans Imagining a Medieval English Nation, Kathy Lavezzo (ed.), Minneapolis, 2004. 6 Voir le rapport que donnent Anne-Cécile Charritat et Pierre-Emmanuel Erard du colloque « guerres, ‘nation’, ‘sentiment national’ au Moyen Age » (1er mars 2013), téléchargé en ligne le 15/04/2013, sur http://epi.univ-paris1.fr
6
concept de Boundaries, nous amène à considérer que les groupes ethniques ne se
définissent pas au moyen de caractéristiques internes, mais par un principe d’exclusion et de
comparaison avec l’Autre7. C’est donc ce lien intrinsèque qui existe entre la conscience de
l’Autre et le sentiment d’appartenance qui sert de point de départ à notre réflexion.
Or, il semble que le cadre géographique retenu, soit l’Angleterre, illustre parfaitement ce
processus. De fait, un préjugé bien connu consiste à affirmer que « le milieu insulaire
favoriserait un repli sur soi propice à la crainte des étrangers », de même que certains
n’hésitent pas à affirmer que la « réputation de xénophobie » des Anglais et des
Britanniques en général « a allègrement passé les siècles »8. En effet, au Moyen Age, le
sentiment national anglais semble bien naître de la confrontation avec l’Etranger, dans deux
directions opposées. D’une part, dès le XIIe Siècle, des historiens anglais tels que William de
Malmesbury, Henry de Huntingdon, Geoffrey de Monmouth, ou encore Giraud le Cambrien,
articulent un discours de différenciation entre les Anglais et les peuples celtes voisins9.
D’autre part, l’identité anglaise prend son essor face au continent, et particulièrement à
l’espace français, avec qui, surtout depuis la conquête normande de 1066, les liens
politiques, religieux et culturels sont particulièrement soutenus. De plus, si ces liens ont
longtemps été considérés comme un frein à la renaissance d’une identité anglaise propre, de
telle sorte qu’on a pu présenter la perte du duché de Normandie en 1204 comme un
bienfait, il apparaît qu’ils n’ont en rien fait barrage, bien au contraire, à l’émergence d’une
identité raciale et ethnique très précoce10.
C’est ainsi que Philippe Contamine a pu opposer l’existence de cette puissante identité
anglaise de la fin du Moyen Age au flou qui subsiste alors en France à la même époque. De
fait, les Anglais établissent une distinction très nette entre les membres de leur
communauté nationale et les aliens11, catégorie qui inclut bien souvent les sujets non-
anglais du roi d’Angleterre, tels que les Gallois et les Irlandais. De plus, on assiste dès le XIIIe
Siècle à une fixation des thèmes associés à la présence étrangère, et qui traduisent souvent
des réactions hostiles. C’est ainsi qu’on voit surgir dès le règne d’Henry III une opposition à la
présence des étrangers à la Cour royale, alors que le roi se voit reprocher de favoriser ces
7 Voir Fredrik Barth, « Introduction », in Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organization of Culture Difference, Fredrik Barth (ed.), Waveland, 1998 [1969], p.9-38. Voir aussi John A. Armstrong, Nations before Nationalism, Chapel Hill, 1982 (ici, p.5). 8 Voir Frédérique Laget, « L’étranger venu de la mer : naissance et conscience de la ‘frontière de mer’ dans les îles Britanniques à la fin du Moyen Age (XIIIe-XIVe siècles) », in Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol.177-1, 2010, p.177-191 (ici, p.177). 9 Voir John Gillingham, The English in the Twelfth Century, Imperialism, National Identity and Political Values, Rochester, 1999. 10 Voir Malcolm Vale, The Ancient Enemy, England, France and Europe from the Angevins to the Tudors, Londres et New York, 2007 (ici, p. 10 et 21). 11 Voir Philippe Contamine, « Qu’est-ce qu’un ‘étranger’ pour un Français de la fin du Moyen Age », in Peuples du Moyen Age, Problèmes d’identification, Aix-en-Provence, 1996, p.27-43.
7
derniers aux dépens de la noblesse d’Angleterre. De même, c’est à la même époque que les
parlementaires se dressent contre la nomination de clercs étrangers aux bénéfices anglais12.
Notre propos, ici, consistera donc à tenter d’observer les mécanismes de la vision de l’Autre
et de la vision de Soi en Angleterre.
Pour ce faire, nous avons choisi d’adopter la première moitié du XVe Siècle comme cadre
chronologique, et de nous centrer essentiellement sur les années 1415-1453. En effet, il
paraissait indiqué de situer l’analyse dans le contexte de la reprise de la guerre de Cent Ans,
dans la mesure où le conflit favorise le renforcement du sentiment national, entraîne une
radicalisation des attitudes et nourrit le discours sur l’adversaire. De plus, la première moitié
du XVe Siècle présente des ruptures chronologiques intéressantes. En effet, il est possible de
distinguer une première période allant de 1415, date de la première campagne d’Henry V en
France, à l’année 1420, soit celle de la conclusion du Traité de Troyes, nommant le roi
d’Angleterre et ses successeurs héritiers du royaume de France. Ensuite, une deuxième
période couvre la première décennie du règne d’Henry VI, qui devient roi de France et
d’Angleterre en 1422 et est couronné à Westminster en 1429 et à Notre-Dame de Paris en
1431, et correspond donc à la promotion de la Double Monarchie. Une autre période s’ouvre
avec la rupture de l’alliance anglo-bourguignonne en 1435, qui marque le « début de la fin »
de la domination anglaise en France. Enfin, une dernière période, dans les années 1450-
1453, correspond à la perte de tous les territoires du roi d’Angleterre en France, à
l’exception de Calais.
En suivant cette chronologie, nous nous appuierons sur un corpus de sources anglaises qu’il
nous faut maintenant présenter. Premièrement, le choix a été fait de privilégier les sources
en Middle English, langue de l’Angleterre d’environ 1150 à environ 1500. De fait, il ne fait
pas de doute que ce sont ces dernières qui sont susceptibles de renfermer les plus fortes
expressions du sentiment national. En effet, le lien qui existe en Angleterre entre la langue
et l’identité nationales a fait l’objet de nombreuses études. De plus, c’est dans le cadre du
conflit franco-anglais que cette association apparaît, alors que la langue nationale fait office
d’argument affectif. C’est en effet le cas dès 1295, alors qu’Edward I, convoquant le Clergé
de son royaume afin d’obtenir la levée d’un impôt pour financer la guerre qu’il mène alors
contre le roi de France Philippe IV, prétexte que ce dernier souhaite envahir l’Angleterre
dans le but d’ « éradiquer la langue anglaise » ! Le même scénario se répète ensuite en 1344,
lorsqu’ Edward III convoque les parlementaires pour leur exposer la menace que représente
pour le royaume Philippe VI de Valois, qui est « en ferme purpos […] à destruire la lange
Engleys, et de occuper la terre Engleterre »13. De fait, ce n’est pas un hasard si c’est avec la
première phase de la guerre de Cent Ans qu’on assiste à la renaissance de la langue anglaise
12 Voir Christopher Fletcher, « La Communauté anglaise face à l’étranger » in Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 19, 2010, p.105-122 (ici, p.108). 13 Voir Christopher Fletcher, « Langue et nation en Angleterre au Moyen Age », in Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, 2012/2 - N° 36, p.233-252 (ici, p.241).
8
en tant que langue littéraire, avec l’Alliterative Revival porté par de grands noms tels que
Geoffrey Chaucer et John Gower14. Surtout, l’anglais connaît une promotion importante sous
le règne d’Henry V, alors que l’affirmation de la langue nationale correspond à une politique
délibérée de la part du roi15. C’est ainsi que ce dernier élève l’anglais au rang de langue
administrative, de même qu’on souligne généralement sa responsabilité personnelle dans la
standardisation de l’ « anglais de Chancellerie »16. Cependant, le français demeure encore
largement usité en Angleterre17.
C’est ainsi que les requêtes des Commons en Parlement contiennent encore à notre période
une très large majorité de requêtes en français, alors que l’anglais n’y fait son apparition
qu’en 1423, et n’y devient majoritaire face au français qu’en 144518.
De fait, les Parliament Rolls19, registres des sessions du Parlement anglais20 du règne
d’Edward I (1272-1307) à celui d’Henry VII (1485-1509), constituent l’une de nos sources
pour cette étude, consultés, sauf exceptions, du début du règne d’Henry V (1413) à la
déposition d’Henry VI par Edward IV (1461). C’est ainsi que 11 parlements se sont tenus de
1413 à 1422, et 22 entre 1422 et 1461. De fait, les pétitions des Commons, censées attirer
l’attention du roi sur les maux du royaume seront ici largement mises à contribution pour
tenter de percevoir les pratiques qui président aux relations avec les étrangers. Cependant, il
ne faut pas oublier qu’elles rendent surtout compte des attitudes londoniennes, de telle
sorte qu’on doit se garder de généraliser aveuglement.
Si cette source institutionnelle nous renseigne sans aucun-doute sur les attitudes réelles, sur
les réflexes communautaires et sur une certaine perception de l’étranger, il apparaît
nécessaire de se tourner vers un autre type de sources pour plonger au cœur des
14 L’œuvre de Chaucer a souvent été analysée en rapport avec le contexte de la guerre de Cent Ans et avec le discours national. Voir par exemple Ardis Butterfield, The Familiar Enemy, Chaucer, Language, and Nation in the Hundred Years War, Oxford, 2009. 15 On a pu ainsi pu suggérer l’élaboration d’une véritable « politique linguistique » entre le futur Henry V, son précepteur Henry Beaufort, Thomas Chaucer, John Lydgate et Thomas Hoccleve à Oxford. Voir John H. Fisher, « A Language Policy for Lancastrian England ? », in PMLA, vol.107, no.5 (octobre 1992), p.1168-1180. 16 Voir Malcolm Richardson, « Henry V, the English Chancery, and Chancery English », in Speculum, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1980), p. 726-750. Cependant, le modèle du triomphe de l’anglais est parfois remis en question aujourd’hui (voir Christopher Fletcher, « Langue et nation », op.cit, p.244-247). 17 Voir Helen Suggett, «The Use of French in England in the Later Middle Ages: The Alexander Prize Essay », in Transactions of the Royal Historical Society, Fourth Series, Vol. 28 (1946), p. 61-83. 18 Voir Christopher Fletcher, « Langue et nation », op.cit. (p.247-251). Cependant, ici encore, il est possible de déceler un lien entre l’emploi de l’anglais et le discours national, dans la mesure où on a pu observer que les pétitions en anglais concernent particulièrement le Bien Commun et la sécurité du royaume. 19 Edition électronique PROME, The Parliament Rolls of Medieval England, 1275-1504, Chris Given-Wilson (ed.général), Scholarly Digital Editions et The National Archives, Leicester, 2005. 20 Sur l’histoire et le fonctionnement de ce dernier, voir PROME, « Introduction », ainsi que les paragraphes introductifs sur chaque règne ; de même, voir Gerald Harriss, Shaping the Nation, England 1360-1461, Oxford, 2005 (p.66-74).
9
représentations mentales. C’est ainsi que, mis à part les Parliament Rolls, le corpus se
compose exclusivement de textes littéraires, ayant tous en commun une tonalité historique
et politique.
De fait, il a été fait usage de la chronique nationale du Brut21 tel qu’il a été édité par le
professeur Friedrich Brie en 190622. Cette dernière, originellement composée en français
avant d’être traduite en anglais à la fin du XIVe Siècle, fait en effet l’objet de continuations à
notre période. On trouve ainsi une première continuation, éditée par Brie sous l’initiale
« H », qui s’étend de 1377 à 1419 (prise de Rouen par les troupes d’Henry V)23, et qui a sans-
doute été composée avant 1430. De la même façon, une seconde continuation (« D »)
s’étend de 1418 à 1430 et s’achève avec la capture de Jeanne d’Arc devant Compiègne, et
semble ici encore ne pas être postérieure à 143124. Le récit des années 1430 à 1446 (« F »)
est alors emprunté à un manuscrit qui relève en fait des Chroniques de Londres et dont la
composition originale se situe au plus tard au début de l’année 144625. Enfin, Brie a
également donné une édition de versions particulières du Brut, soit une collection d’extraits
du Ms. Harley 53, imprimée sous l’initiale « H », et une continuation de cette dernière (« I »),
dont la composition originale a dû suivre de très peu les événements du siège de Calais
qu’elles relatent longuement26.
En sus de ces textes qui relèvent du genre de la chronique, la majeure partie du corpus se
compose de poèmes historiques et politiques, toujours strictement contemporains des
événements qu’ils relatent. De fait, ces poèmes présentent souvent une réelle valeur
historique, déjà reconnue par les compilateurs du Brut et des Chroniques de Londres, qui les
intègrent parfois à leur récit des événements. Cependant, l’intérêt majeur de la poésie
réside dans sa capacité à rendre compte de l’état de l’opinion publique à un moment donné,
ou encore à influer sur cette dernière. De fait, la réaction des poètes à une situation est
généralement spontanée et éminemment partiale, dans la mesure où elle reflète alors leurs
intérêts particuliers ou ceux du groupe auquel ils appartiennent. C’est ainsi que « quand un
auteur choisit de commenter un événement politique […] il vise presque toujours à exprimer
ses propres ressentis, ses attitudes et ses opinions, ses espoirs et ses peurs », qu’il s’efforce
21 Sur le Brut et les Chroniques de Londres, voir Charles Lethbridge Kingsford, English Historical Literature in the Fifteenth Century, Oxford, 1913 (p.113-139, et p.70-112) ; Antonia Gransden, Historical Writing in England, vol. II, Londres, 1982 (p.220-248). 22 The Brut or the Chronicles of England, Friedrich W.D. Brie (ed.), Londres, 1906. 23 Ibid, p.335-394. Voir Charles Lethbridge Kingsford, English Historical Literature, op.cit. (p.115). 24 Ibid, p.394-444. Voir Ch. L.Kingsford, Ibid (p.118-119). 25 Ibid, p.456-490. Voir Ch. L. Kingsford, Ibid (p.92). 26 Ibid, p.534-580. Voir Ch. L. Kingsford, Ibid (p.125).
10
de plus de faire partager à ses lecteurs.27 De ce fait, on a pu relever de très nombreuses
expressions du sentiment national dans les poèmes du XVe Siècle28.
Enfin, le corpus comprend également le Boke of Noblesse de William Worcester, qui
constitue l’un des rares exemples de traités politiques composés du côté anglais pendant la
guerre de Cent Ans29, et dans lequel l’auteur analyse les causes de la défaite subie par ses
compatriotes en France.
Détail des sources.
Première partie du corpus : 1415-1420.
The Battle of Agincourt (1415)30. Conservée dans le Cotton Ms.Cleop.C.iv. (relevant des
Chroniques de Londres et datant du milieu du XVe), d’abord transposée en prose, puis
recopiée dans sa forme originale.
The Agincourt Carol (1415)31. MS.Arch.Selden B.26. Carol sans-doute contemporaine,
conservée avec la partition. Décrite par Robbins comme « part of England’s heritage and
deservedly popular » (xix).
The Rose on Branch (1415)32. B.M.Addit.MS.31042 (manuscrit composite, Robert Thornton
v.1440).
The Siege of Rouen33. Figure dans 14 ms, dont 10 ms du Brut (1ère partie paraphrasée, 2nde
partie recopiée en vers ; voir MS. Galba E VIII, édité par Fr. Brie sous l’initiale « D », p.394-
439). Inclus par James Gairdner dans son édition du MS. London B.L. Egerton 1995,
manuscrit composite (« commonplace book ») du 3e quart du XVe Siècle, qui semble contenir
la version originale du poème. Source historique essentielle pour la connaissance des
événements du siège de Rouen (1418-1419), étape décisive de la conquête de la Normandie
par Henry V. La question de l’auteur: témoin oculaire, qui donne son nom : “And the better
27 Voir John Scattergood, Politics and Poetry in the Fifteenth Century, Londres, 1971 (p.11). Sur les poèmes politiques du temps, on pourra également consulter Ch.L. Kingsford, Ibid (p.228-252). 28 John Scattergood consacre en effet un chapitre entier à cette question : « Nationalism and Foreign Affairs », Ibid, p.35-106. 29 Sur la propagande de guerre française et anglaise au XVe Siècle, on pourra consulter Peter S. Lewis, « War Propaganda and Historiography in Fifteenth-Century France and England », in Peter S. Lewis, Essays in Later Medieval French History, Londres, 1985, p.193-213. 30 Historical Poems of the XIVth and XVth Centuries, Rossell Hope Robbins (ed.), New York, 1959, p.74-77. 31 Ibid, p.91-92. 32 Ibid, p.92-93. 33 The Historical Collections of a Citizen of London in the Fifteenth Century, James Gairdner (ed.), Londres, 1876, p.1-46. Sur le poème, voir Tamar S. Drukker, « 'An Eye-Witness Account or Literary Historicism?’ John Page's Siege of Rouen », in Leeds Studies in English, n.s. 36 (2005), 251-73.
11
telle I may/ For at the sege with the kyng I lay” (p.1) et “Wyth owtyn fabylle or fage/ Thys
procesce made John Page” (p.45). Peut-être prieur de Barnwell34.
Deuxième partie du corpus : 1427-1432.
The Title and Pedigree of Henry VI35 (1426-1427), John Lydgate36. MS. London B.L. Harley
7333 (ms composite, J.Shirley, 2e ou 3e quart du XVe S).Traduction d’un poème en fr. par
Laurent Calot, à la demande de Richard Beauchamp.
A Mumming at Eltham37. MS.Trin.Coll.Camb.R.3.20 (anthologie Chaucer et Lydgate, J.Shirley,
1430-1450). Pantomime jouée devant le roi, 1428 ?
A Recollection of Henry V (1429), by John Audelay38. MS.Douce.302 (poèmes de John
Audelay). Rappel des victoires d’Henry V.
Ballade to King Henry VI upon his Coronation39. 4 ms, ici : MS.Trin.Coll.Camb.R.3.20 (cf plus
haut).
Roundel for the Coronation of Henry VI40. MS. London B.L. Harley 7333 (cf plus haut).
The Sotelties at the Coronation banquet of Henry VI41. 11 ms, ici : MS.B.M, Cotton Julius B.1
(ms relevant des Chroniques de Londres, fin Xve).
A Mumming at Windsor42. 2 ms, ici : MS.Trin.Coll.Camb.R.3.20 (cf plus haut). Légende du don
de l’Ampoule et des lys à Clovis, relatée en vue du couronnement fr d’Henry VI.
King Henry VI’s triumphal entry into London (1432)43. 6 ms, ici Ms Cotton, Julius, B II
(Chroniques de Londres, v.1435).
34 Sur John Page, voir la notice de Jean-Philippe Genêt Dictionnaire des auteurs anglais, Auteurs actifs dans les champs de l'histoire et de la politique en Angleterre de 1300 à 1600 : http://lamop-intranet.univ-paris1.fr/auteurs_anglais/ ; voir aussi la notice de Joanna Bellis, in Oxford Dictionary of National Biography (DNB) : http://www.oxforddnb.com 35 The Minor Poems of John Lydgate, Vol II, Henry Noble MacCracken (ed.), Londres, 1934, p.613-622. 36 Sur John Lydgate, voir Franz Schirmer, John Lydgate : a Study in the culture of the Fifteenth Century, Berkeley, 1961 ; Larry Scanlon et James Simpson, John Lydgate, Poetry, Culture and Lancastrian England, Notre Dame, 2006. Voir aussi la notice de Jean-Philippe Genêt in Dictionnaire des auteurs anglais, et celle de Douglas Gray dans l’Oxford DNB. 37 Minor Poems of John Lydgate, p.672-674. 38 Historical Poems, op.cit., p.108-110. Sur John Audelay, voir la notice de Douglas Gray, Oxford DNB. 39 Minor Poems, op.cit., p.624-630. 40 Ibid, p.622. 41 Ibid, p.623-624. 42 Ibid, p.69-694. 43 Ibid, p.630-649.
12
Troisième partie du corpus : 1436.
Scorn of the Duke of Burgundy (1436).442 ms, ici : English Coll.Rome MS.1306 (ms composite,
poèmes, 1436-1456).
A Ballade, in Despyte of the Flemynges45. MS. Lambeth 84 (ms du Brut, fin XVe, également
édité par Fr.Brie sous l’initiale « K », p.585-604). Attribuée à Lydgate par MacCracken.
The Siege of Calais (1436)46. English Coll.Rome MS.1306 (voir plus haut).
Mockery of the Flemings (1436)47. Lambeth Palace MS.6 (ms du Brut, fin XVe, édité par Brie
sous l’initiale « I », p.581-584).
The Libelle of Englyshe Polycye48. 19 manuscrits, deux versions différentes, l’une datant sans-
doute de 1436, et la seconde, sans-doute de 1438-1441. Ms principal utilisé par Warner :
Bodleian Library, Laud MS.70449. Auteur : peut-être William Lyndwood, Keeper of the Privy
Seal50. Source importante d’histoire économique (liste des marchandises et
« mercantilisme »). Expression violente de chauvinisme et de xénophobie, et réévaluation de
la place de la Nation en Europe51.
Dernière partie du corpus : 1451-1475.
The Boke of Noblesse52. Un seul manuscrit conservé : BL MS.Royal 18 Bxxii, avec ajouts de la
main de l’auteur lui-même (1475). Date de composition : sans-doute d’abord 1451-1452,
puis révisions au milieu des années 1470 (invasion de la France par Edward IV)53. L’auteur :
44 Historical Poems, op.cit., p.86-89. 45 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.600-601. 46 Historical Poems, p.78-83. 47 Ibid, p.83-86. 48 The Libelle of Englyshe Polycye, a poem on the use of sea-power, 1436, ed. Sir George Warner, Oxford, 1926. 49 Pour un détail des ms, voir Taylor, Frank : « Some Manuscripts of the Libelle of Englyshe Polycye », in Bulletin of the John Rylands Library, 24 (1940), p.376-418. 50 Sebastian Sobecki: “Bureaucratic Verse: William Lyndwood, the Privy Seal, and the Form of the Libelle of Englyshe Polycye”in New Medieval Literatures 12, no. 1 (2011), p. 251–288. 51 Voir George Holmes, "The Libel of English Policy", in The English Historical Review, 76 (1961), p.193-216 ; Carol Meale,"The Libelle of Englyshe Polycye and Mercantile Literary Culture in Late-medieval London", in London and Europe in the Later Middle Ages, Julia Boffey et Pamela King (eds) , Londres, 1996, p. 181-228. John Scattergood,"The Libelle of Englyshe Polycye: the Nation and its Place", in Nation, Court and Culture: New Essays on Fifteenth-Century English Poetry, Helen Cooney (ed.), Dublin, 2001, p.28-49. Sur la postérité de l’oeuvre, voir Anthony S.G. Edwards, “A New Manuscript of the Libelle of English Policy”, in Notes and Queries, Dec.1999, p.444-445, et Andrew Breeze, “Sir John Paston, Lydgate and the Libelle of Englyshe Polycye”, in Notes and Queries, Sept.2001, p.230-231. 52 The Boke of Noblesse, addressed to King Edward the Fourth on his Invasion of France in 1475, John Gough Nicholas (ed.), Londres, 1860. 53 Sur le Boke of Noblesse, voir Christopher Allmand, « France-Angleterre à la fin de la guerre de Cent Ans : le Boke of Noblesse de William Worcester », in La France anglaise au Moyen Age, Poitiers, 1986,
13
William Worcester. Attribution permise par la dédicace du manuscrit de « pièces
justificatives » (Lambeth Palace Library, ms 506) faite par son fils à Richard III. Biographie de
Worcester : Secrétaire de Sir John Fastolf. Aussi connu pour son œuvre d’ « antiquaire »54.
Ce corpus a de plus été soumis à un début d’étude lexicométrique. En effet, si l’on en croit
Antoine Prost dans son article fondateur « Les Mots », « Les façons de parler ne sont pas
innocentes […] Elles trahissent les préjugés et les tabous par leurs stéréotypes ou leurs
silences », de telle sorte que « à côté des démarches ethnologiques, les démarches
linguistiques constituent l’une des voies les plus sûres d’une histoire des mentalités »55.
Cependant, la démarche lexicométrique a ici, faute de temps, été limitée à ses fonctions les
plus simples, et qui ne manquent cependant pas de porter leurs fruits, soit l’analyse des
concordances et des segments répétés, facilitée par une lemmatisation partielle du corpus.
C’est ainsi que l’étude de ces sources nous dirige vers trois pistes de recherche majeures.
Premièrement, nous essaierons de cerner les modes de contact des Anglais avec l’étranger
et les pratiques qu’ils génèrent. Dans un deuxième temps, nous nous tournerons vers le
domaine des représentations mentales, en tentant de percevoir les grandes lignes de la
vision de l’Autre dans les sources anglaises, qu’il s’agisse de l’Etranger en général ou du
portrait spécifique à chaque peuple. Enfin, dans la mesure où la vision de l’Autre et la vision
de Soi sont intimement liées, nous étudierons comment l’identité anglaise se développe et
s’articule par rapport à l’Etranger.
p.103-111 ; Anne F. Sutton et Livia Visser Fuchs, « Richard III’s Books : William Worcester’s Boke of Noblesse and his Collection of documents on the war in Normandy », in the Ricardian, vol.IX, No.115, Dec. 1991, p.154-165 ; Christopher Allmand et Maurice Keen, «« History and the Literature of War : the Boke of Noblesse of William Worcester », in War, Government and Power in late medieval France, Christopher Allmand (ed.), Liverpool, 2000, p.92-105. 54 Sur la biographie de Worcester, voir K.B McFarlane, « William Worcester, a preliminary survey », in England in the Fifteenth Century, Londres, 1981. Voir aussi la notice de Jean-Philippe Genêt, in Dictionnaire des auteurs anglais, et de Nicholas Orme dans l’Oxford DNB. 55 Antoine Prost, « Les Mots », in Pour une Histoire politique, Paris, 1988, dir. René Rémond, p. 255-286. Ici, p. 259-259 (ici, p.270-271).
14
I) Contacts et pratiques.
A) L’Angleterre et ses voisins.
1) Les relations politiques, militaires et économiques.
Pour décrire la position de l’Angleterre en Europe à partir de la conquête normande, on a pu
parler, d’une manière percutante autant que pertinente, d’une situation « à la Janus ». En
effet, selon Malcolm Vale, l’un des deux visages regarde vers le Continent, alors que l’autre
est tourné vers les voisins des Iles Britanniques56.
Les Iles Britanniques.
C’est ainsi que le royaume, qui fait partie d’un archipel dont la situation géographique à
l’extrémité nord-ouest du Globe n’échappe pas aux contemporains, est d’abord confronté
aux voisins celtes. Pour cette raison, Léonard Dauphant, dans sa thèse récemment publiée,
n’hésite pas à opposer la cohérence territoriale du royaume de France à la fin du Moyen Age
à celle de l’Angleterre, qui « doit partager la Grande-Bretagne avec d’autres nations, le pays
de Galles et l’Ecosse, soumises ou hostiles mais jamais confondues »57.
De la même façon, il est intéressant de noter que cette situation géopolitique particulière
est prise en compte dans la plupart des cartes réalisées par les contemporains, qui
expriment fortement le séparatisme du pays de Galles et de l’Ecosse, en allant jusqu’à les
couper nettement de l’Angleterre au moyen de véritables frontières aquatiques (Hereford
Mappamundi, datant de la fin du XIIIe Siècle), ou en faisant même du pays de Galles une île
séparée (Carte du Monde de Higden, fin XIVe)58.
De fait, au XVe Siècle encore, les relations de l’Angleterre avec ses voisins celtes sont
souvent marquées par l’hostilité. C’est particulièrement le cas pour l’Ecosse, qui constitue un
royaume indépendant. En effet, la politique d’affirmation de la suzeraineté du roi
d’Angleterre, poursuivie à partir du règne d’Edward I, a non seulement déclenché une guerre
d’indépendance qui se solde, à partir de la défaite des troupes d’Edward II contre celles de
Robert the Bruce à Bannockburn en 1314, par un échec total, mais aussi présidé à la
naissance d’un puissant sentiment national écossais, exprimé de manière exemplaire par la
fameuse Declaration of Arbroath (1320), ainsi qu’à celle d’une haine durable entre les deux
royaumes59. De plus, si l’Angleterre, tout au long des XIVe-XVe Siècle, répugne à reconnaître
56 Malcolm Vale, The Ancient Enemy, Londres, 2007 (p.3). 57 Léonard Dauphant, Le Royaume des Quatre Rivières, Seyssel, 2012 (p.149). 58 Voir John Scattergood, « The Libelle of Englyshe Polycye : the nation and its place », op.cit. (p.36-43). L’auteur reproduit également, entre autres, les deux cartes évoquées ici (p.38 et 39). 59 Sur les guerres d’indépendance écossaises, on pourra consulter : Michael Prestwich, « England and Scotland during the Wars of Independence », in England and her Neighbours (1066-1453), Malcom Jones et Malcolm Vale (eds.), Londres, 1989, p.181-197. Voir aussi R. Rees Davies, « The Failure of the
15
l’indépendance du royaume voisin, comme en témoigne la mention, dans les Parliament
Rolls, des « receivours » et « triours » « des petitions d'Engleterre, Irland, Gales, et Escoce »,
celle-ci n’en est pas moins effectivement réelle60.
Surtout, cet affrontement initial est à l’origine d’une situation plus dangereuse encore, dans
la mesure où les Ecossais se tournent alors vers la France, avec laquelle ils concluent la
célèbre Auld Alliance dès 1295. Cette dernière, effective tout au long du XIVe Siècle61, est de
même régulièrement renouvelée au siècle suivant, et les Ecossais jouent alors un rôle non-
négligeable dans la conduite de la guerre en France62 : une force d’environ 6000 hommes est
ainsi envoyée en France en 1419, et constitue, au cours de la décennie suivante, une part
essentielle de l’armée de Charles VII, à Baugée en 1421, mais aussi à Cravant et à Verneuil en
1423-1424, où les Ecossais figurent en nombre parmi les morts, comme William Worcester
tient à le rappeler dans son récit des gloires militaires anglaises. C’est ainsi que, à la « male-
infortuned » bataille de Baugée, il évoque les « Scottis holding withe youre adverse party of
Fraunce » « to a grete nombre there assembled […] in the feelde »63, ensuite défaits à
Cravant : « there were slayne of the ennemies to the nombre of. iiij. M., beside.ij.M.
prisonneris take, of whiche gret part of them were Scottis »64, et à Verneuil, où leurs
capitaines Archibald Douglas (« the erle Douglas made duc of Tourayne ») et John de
Buchan, d’ailleurs nommé connétable de France par Charles VII la même année (« erle
Bougham of Scotlonde, marchalle of Fraunce »)65, sont tués, et à nouveau à la « bataille des
Harengs » devant Orléans, en 142966.
On comprend mieux, dans ce contexte particulièrement tendu entre les royaumes
d’Angleterre et d’Ecosse, l’importance politique attachée par les Anglais à la capture en mer
par un pirate de Yarmouth, en 1406, de l’héritier d’Ecosse James, qui ne tarde pas à devenir
Jacques I, la captivité du roi d’Ecosse conférant à l’Angleterre une position de force. C’est
pourquoi James reste prisonnier en Angleterre jusqu’à la mort d’Henry V, qui le fait chevalier
et l’emmène avec lui en France, et n’est libéré qu’en 142467. On trouve ainsi, dans les
first British Empire ? », in England in Europe (1066-1453), Nigel Saul (ed.), Londres, 1994, p.121-132, (plus particulièrement, p.126-127 et 130). 60 Voir Jean-Philippe Genêt, « Scotland in the Later Middle Ages : A Province or a Foreign Kingdom for the English? », in Contact and Exchange in the Later Middle Ages, Hannah Skoda et Robert Shaw (eds.), Woodbridge, 2012 (p.127-143). 61 C’est ainsi que le roi de France, alors que s’ouvre la guerre de Cent Ans, soutient le jeune David II contre le renouvellement des attaques anglaises, et qu’une invasion conjointe de l’Angleterre est même projetée en 1385. 62 J.A.F. Thompson, « Scots in England in the Fifteenth Century », in The Scottish Historical Review, Volume LXXIX, 1: No. 207: April 2000, p.1-16 (ici, p.3). 63 Boke of Noblesse, p.18. (Voir aussi p.44). 64 Ibid, p.17. 65 Ibid, p.18. 66 Ibid, p.44 : « God […] suffred the seid capteyns of Scottis to be overthrow bothe at the batailes of Cravant, also at the bataile of Vernelle, and [also] at the bataile of Rouverey ». 67 Jean-Philippe Genêt, « Scotland in the Later Middle Ages », op.cit., p. 131-132, et Gerald Harriss, op.cit. (p.533).
16
Parliament Rolls, à partir de 1423, plusieurs articles relatifs aux négociations en vue de sa
libération, mentionnant son mariage avec l’aristocrate anglaise Joan Beaufort68, sa rançon,
et surtout l’échange d’otages, de même que la conclusion d’une trêve, qui n’est cependant
pas maintenue au-delà de 1435, Jacques I optant alors pour une politique francophile.
A l’ouest de l’île, les Anglais sont également confrontés à un autre voisin, le pays de Galles.
Certes, la situation est ici différente de celle qui préside aux relations anglo-écossaises,
puisque la province ne constitue plus une principauté indépendante depuis la conquête
menée à bien par Edward I aux dépens du dernier prince « natif », Llewelyn ap Gruffudd, en
1282. Cependant, le tout début du XVe Siècle est le théâtre d’une révolte galloise à grande
échelle, qui vise ni plus ni moins à rétablir l’indépendance nationale sous la direction
d’Owain Glyndwr, qui se pare en 1400 du titre de prince de Galles69. Ici encore, les révoltés
font appel au roi de France, qui envoie des troupes en 1405, en vue d’un projet d’invasion
commune de l’Angleterre70… Si la révolte finit par s’épuiser en 1412, au terme d’une
répression qui joue un rôle important dans la formation militaire du futur Henry V71, elle ne
manque pas de creuser un fossé psychologique entre les deux peuples, qui ne s’efface
ensuite que très progressivement au cours du siècle72. En témoigne en particulier l’évocation
de la révolte dans les pétitions soumises au Parlement très longtemps après les faits, par
exemple en 1431 : « Please it […] to be remembred, of the grete insurrections, rebellions and
orrible tresons, ymagined and don be Owen of Glendurdy of Walys »73, et encore en 144574…
Enfin, nous achèverons ce tableau des Iles-Britanniques par l’Irlande. Envahie par Henry II en
1171-1172, elle est progressivement conquise, le territoire sous domination anglaise
équivalant, vers le milieu du XIIIe Siècle, à environ la moitié de l’espace de l’île. Cependant,
cet espace se réduit considérablement au cours du XIVe Siècle, sous l’effet d’une
« résurgence gaélique », de telle sorte qu’il finit par se résumer principalement au « Pale »
autour de Dublin et aux quatre comtés aux mains de grands seigneurs anglo-irlandais. De
plus, en dépit de quelques interventions en Irlande, telles que celles de Richard II en 1394 et
1399, la période se caractérise par une relative indifférence du gouvernement central,
laissant les Anglo-irlandais faire face seuls aux assauts des « Irish enemies » ou « wild Irish ».
Cette situation génère par ailleurs une mise en garde de la part de l’auteur du Libelle of
Englyshe Polycye, selon lequel « wylde Yrishe so muche of grounde have gotyn / There upon
68 PROME, Parlement d’octobre 1423, items 10 et 27 (sur les otages, voir aussi avril 1425, item 18). 69 Sur les relations entre l’Angleterre et le pays de Galles à partir de la conquête d’Edward I, on pourra se référer à R. Rees Davies, « The Failure of the first British Empire ? », op.cit. (p.122-123, 125-126 et 128-129). Voir aussi Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.517-527). 70 Voir Ibid (p.30), et Gerald Harriss, op.cit. (p.522). 71 Christopher Allmand, Henry V, New Haven et Londres, 1997 (p.16-38). 72 Voir Ralph A. Griffiths, « After Glyn Dwr : An Age of Reconciliation ? », in Proceedings of the British Academy, vol.117, 2001, p.139-164. 73 PROME, parlement de janvier 1431, item 32. 74 PROME, parlement de février 1445, item 26.
17
us […] / Lyke as England to shires two or thre / Of thys oure londe is made comparable ; / So
wylde Yrishe have wonne on us unable / It to defenden and of none powere, / That oure
grounde there is a lytell cornere / To all Yrelonde in treue comparisone » (vers 721-728)75.
L’espace politique européen.
Cependant, l’horizon des rois d’Angleterre est très loin de se limiter aux Iles-Britanniques. Le
royaume est en effet parfaitement incorporé à l’espace politique européen.
En effet, depuis 1066, le roi d’Angleterre, duc de Normandie, est aussi un prince continental,
de même que l’avènement des Plantagenêt en 1154 ajoute l’Anjou, le Maine et la Guyenne,
héritage d’Aliénor d’Aquitaine, à la liste de ses possessions.
De plus, cette situation initie le conflit avec le roi de France, suzerain du roi d’Angleterre
pour ses possessions continentales, conflit qui occupe, tout au long de la période, la place
principale dans les « relations extérieures » du royaume. En effet, si une première phase de
cet affrontement s’est soldée par la perte du duché de Normandie en 1203-1204, et sa
reconnaissance par le Traité de Paris en 1259, la Guyenne a continué à constituer une
constante pomme de discorde entre les rois de France et d’Angleterre, en 1294 et en 1324,
et surtout en 1337, lorsque la confiscation du duché, mêlée aux questions dynastiques
soulevées par l’accession au trône du prince Valois, a initié le conflit communément appelé
« guerre de Cent Ans »76. A l’origine purement féodal, l’affrontement s’est alors
progressivement transformé en conflit dynastique, avec revendication du trône de France
par le roi d’Angleterre, en sa qualité de descendant de Philippe IV. Après les brillants succès
militaires anglais des années 1340-136077, la fin du XIVe Siècle est marquée par un recul des
armées anglaises sous le règne du roi de France Charles V, suivi d’une détente sous le règne
de Richard II.
Au début du XVe Siècle, la position difficile du nouveau roi lancastrien, dont la légitimité est
contestée, l’oblige à se cantonner à une position majoritairement défensive, avant
d’exploiter, à la fin de son règne, les divisions internes des princes français, en répondant, de
manière assez non-officielle, aux appels des ducs rivaux de Bourgogne et d’Orléans. Des
forces anglaises aident ainsi les Bourguignons à déloger les troupes armagnaques de Saint-
Cloud en 1411, comme le rappelle William Worcester : « the bataylle of Seynt-clow besyde
Parys, by the duc of Burgoyn with help of capteyns of England owt of England, waged by the
seyd duc », et débarquent l’année suivante pour soutenir les Armagnacs : « the duc of
75 Libelle of Englyshe Polycye, p.37. 76 On pourra se référer, parmi la très riche bibliographie existante, à l’ouvrage de Christopher Allmand, The Hundred Years War, Cambridge, 2001 [1988], et particulièrement au 1er chapitre, « The Causes and Progress of the Hundred Years War », p.6-36, qui présente les grandes lignes de la guerre. 77 victoire de Crécy en 1346, prise de Calais l’année suivante, ou bataille de Poitiers en 1356, menant à la capture de Jean II et au Traité de Brétigny-Calais, cédant la Guyenne au roi d’Angleterre en toute souveraineté.
18
Orlyance waged another armee sone aftyr owt of England to relyeve the ovyrthrow he had
at Seyntclowe »78.
Inversement, son fils, Henry V, se fixe comme but, dès son accession au trône, « le recoverer
del enheritance et droit de sa corone, esteant hors du roialme »79. Après une première
expédition en 1415, marquée par la capture stratégique d’Harfleur et surtout par la grande
victoire d’Azincourt, une seconde invasion permet au roi de mener à bien la conquête de la
Normandie, de 1417 à 1419. L’année suivante, le Traité de Troyes établit la paix entre les
deux royaumes, prévoit le mariage du roi d’Angleterre avec la princesse Catherine, fille de
Charles VI, et déshérite le Dauphin Charles au profit de leur enfant à naître, prévoyant ainsi
l’instauration future d’un régime de Double Monarchie. Après ces triomphes initiaux,
établissant la domination anglaise en France, le gouvernement du tout jeune Henry VI,
succédant dès 1422 à ses père et grand-père dans les deux royaumes, poursuit la conquête
du territoire et la lutte contre Charles VII et ses partisans, d’abord victorieusement, avançant
irrémédiablement vers la Loire, avant que le vent ne tourne à partir de la défaite au siège
d’Orléans et des « années Jeanne d’Arc ». Au cours de la décennie suivante, la recherche
d’un arrangement diplomatique se solde par une impasse, à la fois au congrès d’Arras (1435)
et à Oye (1439), alors que les Anglais perdent Paris en 1436, et se retrouvent sur la défensive
en Normandie. Malgré la conclusion de la Trêve de Tours en 1444, prévoyant le mariage
d’Henry VI et de Marguerite d’Anjou, les hostilités ne tardent pas à reprendre, et les troupes
de Charles VII reprenent le Maine en 1448, puis la Normandie en 1450, avant de se tourner
vers la Guyenne, reprise en 1451-1453, ne laissant au roi d’Angleterre que Calais et son
« Pale » sur le Continent80.
De même, le statut de prince continental de son roi, ainsi que le conflit séculaire avec la
France, confère à l’Angleterre le rôle de puissance européenne, parfaitement incorporée au
réseau d’alliances et de contre-alliances sur le continent. C’est ainsi que le constant
« intertwining »81 avec la France engendre aussi de nombreuses relations avec les autres
Etats européens, alliés ou adversaires dans le cadre du conflit qui oppose les deux
royaumes82. William Worcester rappelle ainsi le réseau d’alliances constitué par Edward III
avant d’entrer en guerre contre la France : « And therto king Edwarde allied hym withe fulle
mighty princes to socour and reliefe hym in his werres or he began to set on hem : first
78 Boke of Noblesse, p.8. De manière intéressante, on remarque que la formulation adoptée ici par William Worcester lui permet d’insister sur le caractère non-officiel de ces interventions, présentées comme des initiatives privées… Sur la politique internationale d’Henry IV, voir Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit., p.426-432. 79 PROME, parlement de novembre 1414, item 2. 80 Christopher Allmand, The Hundred Years War, op.cit, p.26-36 ; Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit., chapitre 14, « The English in France », p.540-587. 81 Malcolm Vale, The Ancient Enemy, op.cit. (p.5). 82 A ce sujet, voir Ibid (p.59-71).
19
withe Lowes emperoure of Allemayne […] ; and after allied hym to the erle of Heynew and to
the erle of Flaundres, and also withe the duke of Bretein »83.
Au XVe Siècle, l’ancienne alliance avec la Bretagne cède la place à une politique d’équilibre
des pouvoirs de la part des ducs. De plus, le statut du duché constitue une pomme de
discorde entre Charles VII et Henry VI au moment du sac de Fougères, alors-même que le
nouveau duc, François I, a fait le choix d’une politique francophile contre la politique
anglophile défendue par son frère Gilles de Bretagne… Par la suite, William Worcester inclut
fermement le duc de Bretagne au nombre des « sujets et alliés » de Charles VII : « youre
saide adversarie or his allies and subjectis, be it the duke of Breteyne… »84. Cependant,
d’autres alliances formées durant la première phase de la guerre de Cent Ans conservent
toute leur actualité à notre période. C’est ainsi que, du côté français, la flotte de la Castille,
royaume allié à la France et ennemi de l’Angleterre depuis l’accession de Trastamare, prend
part aux opérations militaires françaises contre l’Angleterre, par exemple au siège d’Harfleur
de 1416 : « the seyd towne was beseged by the Frenshe partye by lond and also by see, wyth
a grete navye of carekys, galeyes, and shyppis off Spayne »85. De la même façon, l’alliance
traditionnelle de la France et de Gênes, dont les bateaux jouent le rôle essentiel dans le
projet d’invasion de l’Angleterre par Philippe VI en 1346, comme le rappelle William
Worcester : « the said king Philip purposid to have entred into Englond and had waged a gret
noumbre of Genues shippis… »86, se poursuit au XVe Siècle, lors de la bataille de la Seine en
1416, à laquelle prennent part les « carikkys orrible, grete and stoute », mais aussi à la
bataille de Verneuil, où sont présents de nombreux archers génois87. Du côté anglais,
l’alliance avec le Portugal, née au Traité de Windsor de 1386 et encore renforcée par le
mariage de Joao I avec Philippa de Lancastre en 1401, qui institue des relations très étroites
entre les deux dynasties88, joue à plein lors du siège de Rouen, où des vaisseaux portugais
sont employés pour bloquer l’embouchure de la Seine ; John Page peut ainsi évoquer, parmi
les blasons arborés par les hérauts, « Of Portynggale castelle, and toure »89.
83 Boke of Noblesse, p.40. 84 Ibid, p.39. 85 Ibid, p.15. 86 Ibid, p.12. 87 Libelle of Englyshe Polycye, v.1021, p.51. Même si l’auteur n’évoque pas nettement la provenance de ces bateaux, on ne peut ici douter qu’il fait référence aux navires génois, dans la mesure où il semble leur réserver l’appellation de « carikkys » (Il est en effet question, p.17, des « Januays and here grette karekkys » … voir également le vers 332 et la note correspondante, p.75). Pour sa part, William Worcester n’évoque étonnamment que les navires castillans au siège d’Harfleur, et a recours à l’appellation générique de « Lombards » dans le cas de Verneuil (« Lombardis and other sowdieris holding youre adverse partie », Boke of Noblesse, p.32). Sur la présence génoise en ces deux occasions, voir Christopher Allmand, The Hundred Years War, op.cit., p.33 et 84. 88 Wendy R.Childs, « Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century », in Transactions of the Royal Historical Society, Sixth Series, vol. 2,1992, pp. 195-219 (ici, p.197). 89 Historical Collections of a Citizen of London, p.34.
20
En plus de ces alliances anciennes, la recherche d’alliés nouveaux se poursuit au XVe Siècle,
toujours dans le contexte du conflit franco-anglais. C’est ainsi qu’Henry IV se rapproche de
l’Empire en négociant le mariage de sa fille Blanche à l’héritier du comte palatin en 1401, de
même qu’il recherche l’alliance du Danemark qui, si elle ne débouche pas sur une
intervention militaire, se solde toutefois par le mariage d’Erick I avec la princesse Philippa en
140690. Surtout, le règne d’Henry V est marqué par la conclusion d’un traité défensif et
offensif avec l’Empereur Sigismond en 141691, et surtout par l’alliance bourguignonne,
officielle à partir de 1420, et pierre angulaire du maintien anglais en France jusqu’à sa
rupture en 1435.
Les relations économiques.
De plus, si l’Angleterre entretient des relations politiques avec l’ensemble des Etats
d’Europe, du Danemark à la Méditerranée, le Libelle of Englyshe Polycye témoigne
également de sa parfaite intégration à l’espace économique européen. En effet, le
commerce de la laine a très tôt fait de l’Angleterre un partenaire essentiel pour les villes
drapantes de Flandres. Au XIVe Siècle, ce commerce passe des mains des marchands italiens
à celles des marchands anglais, et la Compagnie des Marchands de l’Etape, fixée à Calais, en
reçoit le monopole. De la même façon, on assiste à la même époque au développement de
l’industrie drapière nationale, qui, ayant pour débouchés aussi bien les Pays-Bas et l’espace
germanique que la Baltique ou encore la Méditerranée, occupe, au cours de notre période,
la seconde, puis la première place dans les exportations anglaises. Enfin, l’étain figure
également parmi les principaux produits exportés vers les différents pays d’Europe, de telle
sorte que l’auteur du Libelle peut décrire « Clothe, woll and tynne » comme « oure beste
chaffare » (v.376)92.
De même, l’auteur dresse une liste détaillée des « commodytees » de chaque nation,
soulignée dans le Laud MS.704 par des notes marginales, qui, même si elle ne prétend sans-
doute pas à l’exhaustivité et est dictée dans une certaine mesure par des exigences
métriques93, semble décrire assez fidèlement la situation contemporaine, et nous renseigne
également sur les importations anglaises. Ainsi, s’il omet étrangement de mentionner la
Guyenne, dont le vin représente pourtant un élément essentiel des importations anglaises
en termes de volume, il évoque longuement la Péninsule ibérique, l’allié portugais
fournissant de l’huile, du vin, de la cire, la « graine » du kermès nécessaire à l’industrie
drapière, des fruits, du miel, du cuir et des peaux : « Here londe hathe oyle, wyne, osey, wex
and greyne, / Fygues, reysyns, hony and cordeweyne, / Dates and salt hydes and suche
marchaundy » (v. 132-134)94, et l’Espagne, en sus de produits comparables, du fer, tiré des
90 Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.427). 91 PROME, parlement d’octobre 1416, item 14. 92 Libelle of Englyshe Polycye, p.20. 93 Ibid, xix. 94 Ibid, p.7.
21
mines de Biscay et de Guipuzcoa95. De même, les Génois fournissent de la soie, du poivre, de
l’or, ainsi que des teintures et des produits bruts pour l’industrie textile : « silke and pepir
blake / They bringe wyth hem and of woad grete plente, / Woll-oyle, wood-aschen by vessell
in the see, / Coton, roche-alum and gode golde of Jene » (v.333-336)96, alors que le
commerce des produits de luxe de la Méditerranée et du Levant semble être l’apanage des
Vénitiens et des Florentins. Le sel provient de la Baie de Bourgneuf en Bretagne (« Britounse
bay »)97, les Pays-Bas fournissent des teintures : « madre and woade, that dyers take one
hande / To dyen wythe » (v.543-544), de l’ail, des oignons et du poisson98. Au nord-est,
l’auteur mentionne l’espace hanséatique (« Pruse and Hyghe Duchemenne and
Esterlynges »), pour la bière, le bacon, les métaux (« Osmonde ») et les fourrures
(« Peltreware and grey ») de la Baltique, ou encore les lingots d’argent « Oute of the londes
of Béalme and Hungrye »99. Au nord-ouest, il évoque longuement l’Irlande, pour le poisson
(« fish, samon, hake and herynge »), les textiles, et surtout les peaux et fourrures : « Hertys
hydes and other hydes of venerye, / Skynnes of oter, squerel and Irysh hare, / Of shepe,
lambe and fox […], /Felles of kydde and conyes grete plente » (v. 661-664)100, avant de
terminer son tableau de l’Europe économique par l’évocation de l’Islande et du seul produit
qu’elle offre, le poisson : « Of Yseland to wryte is lytill nede / Save of stokfische » (v.800-
801)101.
C’est ainsi que l’Angleterre est un acteur actif sur la scène européenne, aussi bien au plan
politique qu’économique. Ces deux types de relations sont par ailleurs intimement liés, de
mauvaises relations politiques pouvant entraîner des sanctions économiques, et vice versa.
La période précédant le Siège de Calais s’accompagne ainsi, de la part du duc de Bourgogne,
de la promulgation d’une ordonnance interdisant l’entrée de ses territoires aux marchands
et marchandises d’Angleterre, qui s’accompagne de tentatives répétées, mais largement
restées lettre morte, pour prohiber tout contact économique entre ses sujets de Hollande et
de Zélande et l’Angleterre. Surtout, la situation de conflit grève assurément l’économie des
deux pays, en raison de la suspension des exportations de laine vers la Flandre102.
95 Libelle of Englyshe Polycye, p.4, et Gerald Harriss, op.cit. (p.264). 96 Ibid, p.18. 97 Ibid, p. 6 et 17. 98 Ibid, p.28. 99 Ibid, p.15-17. 100 Ibid, p.34. 101 Ibid, p.41. 102 Voir Marie-Rose Thielemans, Bourgogne et Angleterre, Bruxelles, 1966 (p.111 et ibid, note 3), et G.A. Holmes, « The Libel of English Policy », op.cit. (p.194 et ibid, note 1).
22
2) Insécurité sur terre, insécurité sur mer.
Ainsi, il ne fait aucun doute que l’Angleterre entretient avec ses voisins, à la fois insulaires et
continentaux, des rapports très soutenus. En quoi ces relations influent-elles sur la vie
nationale anglaise ?
Les frontières : points de contact avec l’Etranger.
C’est ainsi que, premièrement, les frontières constituent des points de contact privilégiés
entre les Anglais et leurs voisins étrangers. Bien-entendu, la frontière avec l’Ecosse, qui
sépare deux royaumes, joue encore ici un rôle particulier. En effet, les relations tendues
entre l’Angleterre et l’Ecosse occasionnent plusieurs invasions, comme par exemple, en
1417, le « Foul Raid », pendant lequel les Ecossais, conduits par le duc d’Albany, assiègent
sans succès les villes de Berwick et de Roxburgh, épisode auquel Thomas Langley fait
référence dans son discours d’ouverture du Parlement la même année, lorsqu’il évoque la
« save garde » des «marches guerrantz » et la nécessité de résister aux Ecossais103. De
même, Jacques I vient assiéger Roxburgh en 1436, ici encore sans succès104. Plus
généralement, le cas des Marches anglo-écossaises est bien souvent considéré comme
représentatif des « sociétés de frontière »105, qui se distinguent du reste du royaume par un
mode d’organisation original, également du point-de-vue de la loi et des institutions106, et
entièrement fondé sur la guerre. Surtout, ce mode d’organisation particulier caractérise
aussi bien les deux côtés de la frontière, unis par la conscience d’un affrontement séculaire
et donc, d’un passé commun, de plus volontiers célébré, par une culture militaire identique
reposant sur le raid et le contre- raid, régulés par la conclusion de trêves, et par le respect
des mêmes valeurs guerrières. Cette conscience qu’ont les habitants des Marches de leur
particularisme permet donc également de faire naître de puissants liens transfrontaliers, qui
dépassent largement la question de l’appartenance nationale. Cependant, l’étude d’Anthony
Goodman107 a également montré que, si les contacts personnels et commerciaux sont loin
d’être inexistants au XVe Siècle, les efforts des gouvernements anglais et écossais pour
séparer plus strictement leurs sujets des Borders selon une ligne nationale commencent à
porter leurs fruits, alors que les régions frontalières s’intègrent de plus en plus à l’ensemble
du royaume, et que les élites s’identifient de plus en plus, culturellement, à l’ensemble de
leur nation. Il est donc intéressant de s’interroger sur les effets de la proximité des Ecossais
sur la vie des Anglais habitant les comtés adjacents à la frontière, et, en l’occurrence, de
103 PROME, parlement de novembre 1417, item 3 (voir aussi introduction, et n.3). 104 Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.533), et Brut, p.470. 105 Voir à ce sujet l’article d’Anthony Goodman, « The Anglo-Scottish Marches in the Fifteenth Century : A Frontier Society ? », in Scotland and England (1286-1815), Roger A. Mason (dir.), Edinbourg, 1987, p. 18-33. Sur la situation de la frontière anglo-écossaise, on pourra également consulter Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.528-539). 106 A ce sujet, voir Jean-Philippe Genêt, « Scotland in the Later Middle Ages », op.cit. (p.132-135). 107 Anthony Goodman, « The Anglo-Scottish Marches in the Fifteenth Century… », op. cit.
23
tenter de percevoir quelle est l’image de ces relations que l’on trouve dans les Parliament
Rolls.
Sans surprise, le thème principal qui se dégage des pétitions présentées en Parlement est
bien celui du sentiment d’insécurité, nourri par la fréquence des raids108. Ainsi, c’est un
portrait bien sombre de la situation à la frontière qui est dressé par les habitants des comtés
frontaliers (Northumberland, Cumberland et Westmorland) dans une pétition de 1421, qui
rappelle les dangers de leur position géographique : « les ditz counties sont adjoynantz et
adgisantz as marches d'Escoce, et par les cruels enemys du roy nostre soverain seignur en
graunde partie destruitz, arsés, et degastez sibien par terre come par mere », les raids
écossais ayant même contribué, selon eux, à la dépopulation des mêmes comtés, puisque
plusieurs habitants ont été « pisez , emprisonez, et tuez par plusours invasions des ditz
enemys », ainsi qu’à leur appauvrissement et à un mouvement de migration dû au manque
d’approvisionnement par terre et par mer, «pur dout des ditz enemys ». De même, le
sentiment d’insécurité concerne également les châteaux, forteresses et les villes, qui,
d’après la pétition, seraient incapables de faire face à une attaque écossaise, en raison de
l’état déplorable dans lequel ils se trouvent : « Et auxi plusours chastels, villes, et autres
forteresses sur les ditz frunturs esteantz, sont si feblement reparaillez et estuffez de gentz et
de vitailles, et yceux persones as queux les ditz chasteaux parteignent sont si plenerment
empoverez et destruitz, q'ils ne purront les ditz chastels \et/ forteresses garder et defendre
encountre la malice et graunde poair des ditz enemys »109… De la même façon, l’argument
de l’appauvrissement de ces régions en raison des raids écossais peut être brandi, dans une
pétition de 1425, par les habitants du Northumberland, pour demander l’abolition d’un
impôt alors injustement prélevé par les shérifs : « Sur quoy please a voz haultes discretions,
considerer les plusours causes d'enpoverismentz qu'ount regnes deinz le dit countee, sibien
par plusours envasions des ennemys d'Escoce, come par extortions des ditz officers »110. De
plus, un autre aspect des relations de part et d’autre de la frontière est documenté par une
pétition de 1414, émanant des commons du Northumberland, et qui dénonce les crimes
commis par certains habitants des « franchises » ou « liberties » de Tynedale, ancien
territoire écossais, de Redesdale et du comté d’Exham, franchises dont l’existence-même
témoigne du particularisme de ces régions, puisqu’il s’agit, au sein du royaume d’Angleterre,
de juridictions privées, qui ne sont donc pas administrées par les responsables locaux
ordinaires, les shérifs. Or, de manière très intéressante, les commons du Northumberland,
lorsqu’ils évoquent les « murdres, tresons, homicides et robberies, et autres maffaitz »,
perpétrés par « plusours gentz des fraunchises de Tyndale, Riddesdale et Exhamshire,
adjoignantz a les marches d'Escoce, a cause q'ils sont ensi enfraunchisez », font plus que
confirmer l’image des Borders comme une zone de non-droit, dans la mesure où ils
soulignent particulièrement les rapports que ces gens des franchises, « corps étranger »,
108 Sur le sentiment d’insécurité dans les Borders au XVe S., voir Ibid (p.22). 109 PROME, parlement de mai 1421, item 22. 110 PROME, parlement d’avril 1425, item 40.
24
entretiennent avec les Ecossais : « et auxi ascuns des ditz gentz herbergent et supportent
plusours gentz d'Escoce, eux conselantz et confortantz de robber et despoiller les ditz
communes, et eux prendre prisoners, et ove lour biens et chateux amesner en Escoce, la a
demurer tanqe ils ount fait raunceoun a lour volunte; et ceo par l'eide, assent et comfort des
ditz gentz ensi enfraunchisez »111.
La question des Borders et de l’insécurité qui y règne figure aussi en bonne place dans un
autre ensemble de pétitions, qui couvre la quasi-totalité de notre période, et qui vise à abolir
le Statut des Trêves (Statute of Truces) promulgué par Henry V à Leicester en 1414,
interdisant à tous ses sujets de s’en prendre aux étrangers dont les pays ont conclu une
trêve avec le roi d’Angleterre ou qui disposent de sauf-conduits royaux, ou de soutenir et
héberger les coupables, sous peine d’être accusés de haute-trahison112. En effet, ce statut
fait l’objet, dans les décennies suivantes, de nombreuses demandes d’amendement et
d’abolition, dans lesquelles la situation des Marches d’Ecosse est toujours invoquée. C’est
ainsi que, dès 1415, les comtés du nord réclament avec succès l’amendement du Statut en
ce qui concerne leur droit essentiel de répliquer face aux attaques des Ecossais113 , ou qu’un
article de 1416, faisant état de la décision d’amender le Statut des Trêves en raison du non-
respect de ces dernières par les ennemis, qui en profitent pour s’attaquer aux Anglais alors
tenus de ne pas répliquer, décrit également la situation des Marches d’Ecosse : « pur tant les
ennemys du roy nostre soverain seignur, […], come en roiaume d'Escoce, en ount pruis
grande courage de grever les foiaux liges du roy, en tuant aucuns de eux, et aucuns en
preignant prisouners, et auxi en preignant lour biens et chateux, encountre le teneur des
trieuves; […], comme en les marches d'Escoce dessusdit »114. De même, la pétition de 1421
évoquée plus haut réclame à son tour la modification du Statut, afin de pouvoir récupérer
les biens enlevés par les Ecossais : « Et enoutre, qe l'estatuit fait a Leycestre, par qy les lieges
du roi nostre soverain seignur sont restreintz, sur peyne de tresoun, q'ils ne purront faire
rescous ne reprise de lour biens et chateux prisés par les ditz enemys par terre ne par mere,
soit moderé en cest article »115. Par la suite, c’est le même discours qu’on retrouve dans des
pétitions de 1429 et 1433, qui évoquent plus nettement encore les effets néfastes du Statut
sur les Marches d’Ecosse : « Et ore est ensy, qe lez suisditz merchiez d'Escoce sount
enpoverez, destruez et degastez »116, et encore en 1435, 1442 et 1447, alors que les
Commons insistent sur le danger de destruction totale qui guette les habitants des Marches :
« par ount plusours de voz lieges, enhabitantz en marches […] suisditz, sount […] en point
d'estre finalment destruez »117. L’expérience de l’Etranger à la frontière anglo-écossaise est
111 PROME, parlement d’avril 1414, item 20. 112 PROME, parlement d’avril 1414, item 23. 113 PROME, parlement de novembre 1415, item 10. 114 PROME, parlement d’octobre 1416, item 31. 115 PROME, parlement de mai 1421, item 22. 116 PROME, parlement de septembre 1429, item 43 ; parlement de juillet 1433, item 58. 117 PROME, parlement d’octobre 1435, it.28 ; parlement de janvier 1442, item 37 ; parlement de février 1447, item 21.
25
donc essentiellement marquée par l’hostilité, même si la poursuite de relations plus
pacifiques apparaît également en creux dans une pétition de 1426, par laquelle les bourgeois
de Berwick-upon-Tweed, ville située directement sur la frontière, demandent l’extension
vers le sud du Northumberland du taux préférentiel dont ils jouissent pour l’achat de laine,
en invoquant les torts causés à leur économie par un ordre du roi d’Ecosse interdisant à ses
sujets de vendre à des Anglais, ce qui révèle indirectement que leurs contacts économiques
avec l’autre côté de la frontière étaient encore, jusque-là, considérables118.
Qu’en est-il donc à l’autre frontière, soit la frontière ouest, avec le pays de Galles119 ?
Premièrement, on trouve, à ce sujet, une pétition de 1414, qui, se situant à la suite des
évènements de la rébellion d’Owen Glyndwr, évoque les actions des rebelles en Angleterre,
soit dans les comtés frontaliers (Shropshire, Herefordshire, Gloucestershire…). Sans surprise
compte-tenu de la situation politique contemporaine, les actes évoqués sont des actes de
violence, et en particulier des enlèvements contre rançon, les victimes étant emmenées au
pays de Galles par leurs ravisseurs : « plusours des ditz rebelles, ove autres a eaux adherantz,
ove force et armes, en manere de guerre, ascun foitz par jour, et ascun foitz par noet, ount
venuz en les countees de Salop', Hereford, Gloucestr', et en autres a mesme la paiis
adjesantz, et en diverses boys et autres lieux en ycelles parties mussiez et loggez, ount
treterousement et felenousement pris plusours de voz foialx lieges, ascunz chivechant
entour lour merchandises, et lour autres busoignes faisantz, et ascunz en lour maisons, ou ils
furent demurantz faisantz lour overaigne et lour housbondrie en le peas de Dieu, et le
vostre, et mesmes voz tielx lieges ensi prisez ont amenez hors de lour dit paiis as diverses
parties de Gales, et les eient gardez et detenuz ovesqe eaux en les mountaignes d'icelles
parties de Gales par un demy an, ascun foitz pluis, et ascun foitz meyns, tanqe ils ount
raunsonez ascun de voz ditz lieges ». La pétition enchaîne alors sur le lourd sentiment
d’insécurité que ces actions font naître, qui est tel que les Anglais n’osent plus résider dans
les comtés frontaliers : « issint par celle cause, voz ditz foialx lieges n'osent pas demurer a
lour houstelle demesne, ne pres bordures de Gales, par my les countees suisditz »,
conscients qu’ils sont de la difficulté d’obtenir réparation une fois que les malfaiteurs sont
retournés au pays de Galles, où la Common Law anglaise ne s’applique pas : « issint par celle
cause, voz ditz foialx lieges n'osent pas demurer a lour houstelle demesne, ne pres bordures
de Gales, par my les countees suisditz […] a lour tresgraunde anientisment et finalle
destruccioun pur toutz jours, si due remedie ne soit purveu en ceste partie, a cause qe tielx
malfaisours maintenaunt sur lour malfait soy retrahent en Gales, ou le brief du roy ne
court »120. Un an plus tard, une pétition émanant des habitants de la frontière, et en
118 PROME, Annexe février 1426, it.9 ; Anthony Goodman, « The Anglo-Scottish Marches… », op.cit. (p. 25-26). 119 Sur les Marches de Galles et les relations à la frontière, on pourra consulter : Ralph A. Griffiths, « Wales and the Marches in the Fifteenth Century », in King and Country, England and Wales in the Fifteenth Century, Londres et Rio Grande, 1991, p.55-81 ; et, du même auteur, « After Glyn Dwr, an Age of Reconciliation ? », op.cit. 120 PROME, parlement de novembre 1414, item 41.
26
particulier du Shropshire, réclame le droit d’obtenir réparation face aux incendies, meurtres,
vols et enlèvements commis « par les gentz de Gales », au moyen de lettres adressées aux
responsables de l’autre côté de la frontière, et, si ces dernières n’aboutissent pas, par leurs
propres moyens : « et s'ils ne deliverent lez persones ensy grevez, ove lour biens, en la
fourme suisdit, q'adonqes bien lirra lez ditz gentz Engleys ensy grevez, arestier qeconqes
venauntz ove biens et chateux de ceux seignuries en Gales, ou tielx messaisours sont
recettez ou demurantz, et les resceiver tanqe plein gree a eux soit fait, ove lour mysez et
costagez, ensemblement ove lour distressez biens et chateux suisditz », et ce « a fyne q'ils
purront demurer en pees, ove lour biens et chateux, en lour measons demesnez, as ditz
marches de Gales adjoignauntz »121. Malgré les mesures prises sous le règne d’Henry V, une
pétition nettement postérieure de 1445 fait état des mêmes problèmes, encore amplifiés,
puisque les Gallois « preignent a pluis graund nombre dez gentz des ditz countés, veignauntz
en Galys et en les marches de Galys, et hors des ditz countés, et eux reteignent tanqe gree a
eux soit fait a lour volunté », et redoublent généralement d’activité contre les habitants et
leurs biens (« issint qe les ditz mauxfaisours sount pluys beaudés de prendre, chacer,
amesner et enporter les gentz des ditz countés, lour chivalx, bestes, biens et chateux, hors
des ditz countés, en Galys, et en les marches du Galis »)122, pétition qui est encore
reconduite quatre ans plus tard, alors que les Commons rappellent que, si « eny
Walsshman » se livre à ces activités, il sera coupable de haute trahison123.
De la même façon, les pétitions en Parlement attirent également notre attention sur un
point géographique particulièrement touché par l’insécurité, soit la rivière Severn, qui
marque la séparation entre l’Angleterre et le pays de Galles. En effet, plusieurs pétitions
exposent comment, alors que les sujets du roi résidant près de la Severn avaient pour
habitude de transporter des marchandises le long de cette dernière sans interruption
aucune, des Gallois et des gens des franchises (« diverses gentz mafeisours, sibien de Gales,
come d'autres viles et lieux privielegiés adjoinantz ») ont commencé à les attaquer, à les
capturer et à détruire leurs bateaux pour les forcer à louer les leurs, certains, ici encore,
« q'ils ne serrount pursuies par la commune ley, pur ascun chose ou offense fait en Gales et
les autres ditz lieux privielegiés »124. Ce même thème de la (dangereuse) navigation sur la
Severn est repris ultérieurement, dans une pétition qui expose comment « divers Galoies, et
autres persones demorantz en divers lieus adjoynauntz a dit river, ount ore tard assemblés
en graunde noumbre, arraiez en faire de geer, et pris tielx flotus, autrement appellés
draggus, et eux ount trenchez en pesés, et ove force et armes bateux lez gentz queux
fuerent ov tielx flotus »125. On retrouve donc ici l’image d’une société de frontière et d’une
121 PROME, parlement de novembre 1415, item 13. 122 PROME, parlement de janvier 1442, item 20. 123 PROME, parlement de février 1449, item 21. 124 PROME, parlement d’octobre 1427, item 42. 125 PROME, parlement de janvier 1431, item 38. Voir aussi septembre 1429, item 30, qui évoque des malfaiteurs non pas gallois, mais habitant la forêt de Dean, et Bledisloe et Westbury, régions décrites comme « large cuntrees, and wylde of peple, and negh adjoynaunt to Wales ».
27
zone de non-droit, modelées par une proximité essentiellement dangereuse avec l’Etranger.
En témoigne également une dernière pétition, qui évoque la facilité avec laquelle les
criminels gallois (« divers persones demurantz en Gales, et en le march de Gales, enditez et
utlagez de tresons et felonyes ») se rendent dans le comté d’Hereford, y commercent et y
résident plusieurs jours avant de retourner « en lour propre pays », sans rencontrer aucune
opposition des autorités ou de la population, dont une partie est d’ailleurs soupçonnée de
les favoriser (« et lez aultres personez ascuns pur faveur et amiste, et ascuns pur doubte de
male »), cette absence d’opposition les encourageant finalement à venir « tuer, arder,
robber, et aultres males faire en le dit countee, a perpetuel destruccion et enpoveresment
de lez communes du dit countee »126.
De manière très intéressante, il existe, aux yeux des contemporains, une troisième frontière,
non pas terrestre mais maritime, soit celle qui sépare l’Angleterre de ses voisins
continentaux. C’est ainsi qu’Henry V, en 1414, accorde aux habitants de Southampton
(située sur la côte sud, et donc très exposée à la menace navale française) un allègement de
leur rente foncière, sous prétexte que la ville « est assis en le pluis periolous fronture celles
parties du roialme a les enemys », et qu’il faut donc veiller à assurer ses moyens de défense
et le maintien de sa population, sans quoi « purroient avenir legierment trops hautes
meschiefs et damages importables a roy et a toute sa terre »127. Si nous réservons pour plus
tard l’étude des images mentales qui s’attachent à cette conscience d’une « frontière de
mer »128, il nous faut évoquer ici ses aspects pratiques. En effet, le danger d’invasion par la
mer est bien réel, comme l’ont démontré au siècle précédent les projets avortés de Philippe
VI et du gouvernement de Charles VI. Surtout, cette « frontière » d’un genre particulier
présente un véritable point commun avec les frontières terrestres, dans la mesure où les
villes côtières, particulièrement dans le sud du pays, sont régulièrement confrontées à une
réelle insécurité occasionnée par des contacts hostiles avec l’Etranger. De fait, les navires
français et castillans avaient déjà eu l’occasion de ravager la côte sud, de Rye à Plymouth,
dans les années 1370, et ces raids reprennent au début du siècle, sur les côtes du sud et de
l’est de l’Angleterre, l’ennemi atteignant même l’embouchure de la Tamise en 1406. En 1416
encore, une flotte française ravage l’Ile de Wight, et Sandwich est la cible d’une descente
française aussi tardivement que 1457, pendant laquelle le maire trouve la mort129… De la
même façon, les côtes anglaises sont victimes, tout au long de notre période, des raids de
pirate qui descendent à terre pour se livrer au pillage, la côte est subissant ainsi les assauts
de pirates danois, flamands et bretons, l’auteur du Libelle faisant état d’attaques de ces
derniers « in Northfolke coostes and othere places aboute » (v.170)130, et les pétitions en
126 PROME, parlement de février 1445, item 31. 127 PROME, parlement de novembre 1414, item 42. 128 Le terme est ici emprunté à Frédérique Laget, in « L’étranger venu de la mer : naissance et conscience de la ‘frontière de mer’ dans les îles Britanniques à la fin du Moyen Age », op.cit. 129 Voir Geoffrey Hindley, England in the Age of Caxton, St-Albans, 1979 (p.21-22), et Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.88-92). 130 Libelle of Englyshe Polycye, p.9. Voir aussi Introduction, xxii et ibid, n.2.
28
Parlement pointent du doigt le sort des Anglais qui habitent sur les côtes, victimes de vols et
parfois-même d’enlèvements : « voz poverez lieges demurrantz pres les costes du mier, hors
de lour propre measons ove lour chateux et enfauntz sur le terre prisez, et ove lez ditz
enemyes ou lour plest amesnez »131.
Insécurité sur mer : les activités de piraterie.
En sus des contacts que les Anglais peuvent avoir avec l’Autre dans les régions frontalières et
sur les côtes, l’expérience de l’Etranger est aussi nourrie, pour certains, par des rencontres
peu amicales sur mer. En effet, les activités de piraterie dirigées contre les bateaux de
commerce sont alors monnaie-courante, et les Anglais en sont aussi souvent coupables que
victimes. C’est ainsi que, dans les trois premières années du siècle, on assiste à une véritable
crise dans la Manche, alors que des pirates français et anglais, avec l’accord de leurs
gouvernements respectifs, s’attaquent de façon systématique aux bateaux de commerce
ennemis132. Par la suite, c’est bien ce problème essentiel qu’Henry V entend résoudre
lorsqu’il promulgue le Statut des Trêves déjà évoqué ci-dessus, qui évoque les crimes
perpétrés par ses sujets à l’encontre des étrangers, « ascuns tueez, ascuns robbez et
despoillez par les lieges et subgitz de roi, sibien sur le haut meer, come deinz les ports et
costes de meer d'Engleterre, d'Irland et de Gales », et qui prévoit d’instituer un
« conservateur » des trêves et sauf-conduits dans chaque port, chargé d’enquêter sur ces
crimes par lettres patentes et sous l’autorité du Lord High Admiral d’Angleterre133.
Cependant, la politique du Statut des Trêves s’avère, comme nous l’avons vu plus haut,
difficile d’application, et la piraterie, un temps limitée, atteint des sommets dans les années
1440, culminant en incident diplomatique en 1449, avec la capture de la « Flotte de la Baie »,
composée de navires hanséatiques, flamands et hollandais, par le célèbre corsaire Robert
Winnington134. La question de la piraterie constitue donc également un aspect essentiel des
relations avec les étrangers. De fait, elle occupe également une place certaine dans nos
sources, bien-sûr dans le cadre de l’argumentaire du Libelle of Englyshe Polycye, qui évoque
aussi les activités des pirates français, flamands et hollandais135, ainsi que, bien-entendu,
dans les Parliament Rolls. En effet, ces derniers témoignent de la fréquence des ces
rencontres hostiles, puisqu’un ensemble de pétitions, dont la première date de 1422,
accordant au roi les droits de « tunnage and poundage », réclame que les marchands soient
exonérés de l’impôt sur la laine (Wool subsidy) au cas où leurs marchandises seraient
131 PROME, janvier 1442, item 18. 132 Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.91). 133 PROME, parlement d’avril 1414 ; item 23. 134 Voir M.M Postan, « The Economic and Political Relations of England and the Hanse (1400 to 1475) », in Studies in English Trade in the Fifteenth Century, Eileen Power et M.M Postan (eds.), Londres, 1933, p.91-153 (ici, p.127 et suivantes). 135 Voir v.600-601 : « Yf men were wyse, the Frenshemen and Flemmynge / Shulde bere no state in the see by werrynge », ainsi que le passage sur « Hankyne Lyons » qui suit et la note marginale qui lui est associée.
29
«pershid or take be enemyes on the see »136. Plus concrètement, on trouve d’autres
pétitions qui racontent comment « plusours des lieges nostre soverain seignur le roi, ove
lour biens et chateux passantz sur le mere, sont sovent foitz prisés et robbés, par certeins
gentz appellez roveres sur le mere », hors-la-loi souvent bannis de leurs royaumes
d’origine137, ou qui font état d’attaques de pirates dont la nationalité est précisée, tels que
les marins écossais qui capturent des bateaux anglais138, « diverses persones du dite duché »
de Bretagne, qui, malgré les trêves, « ount prisez diverses marchaunts d'Engleterre, et lour
marchandises, et autres persones, et lour biens»139, les Danois, par qui « plusours des foialx
lieges nostre dit seignur le roy, sount enpoverez, anientez et destruitz […],par cause q'ils
preignount de jour en autre de vous ditz foialx lieges lour biens »… alors-même qu’ils sont de
l’ « amysté » du roi d’Angleterre140, et à nouveau les « Escotes et Britons », qui «ount priz
des marchantes et autrez lieges suisditz, diverses prisoners des lieges du roy, nyefs, biens,
chatelx et merchandises de mesme les lieges »141. Bien-entendu, les Anglais sont ici toujours
présentés comme les victimes, comme en témoigne cette description pour le moins
larmoyante de la situation des marchands : « voz poverez marchaunts de ycest vostre
roialme, de jour en autre sount desrobbez par vous enemyes sur le meer, et deinz divers
rivers et portz deins mesme le roialme, de lour niefs, biens et marchandisez, de graunde
richesse, et lour corps prisez emprisonez ove graunde duresse, et mys a graunde finaunces
et raunsone »142. De même, certaines pétitions reflètent des expériences individuelles, telles
que celle d’un certain John Tutbury, marchand de Hull, victime en mer d’une attaque des
« carrekes » de Gênes143, ou celle de John Hamshire et Henry May, victimes, entre la
Normandie et l’Angleterre, d’une attaque bretonne, décrite de manière percutante et
involontairement comique, puisque les vingt navires bretons ne se contentent pas de
prendre leurs biens et leurs marchandises, mais s’emparent également de tous les
équipements du bateau et des provisions qui s’y trouvent…avant de prendre également les
vêtements des passagers et de les abandonner en pleine tempête : «they […] dispoilled
youre besechers and theire saide felasship into to theire shertis, and somme moder naked,
and so abandoned theym uppon the see in horribel weder and tempest, .iij. dayes and .iij.
nyghtes, withoute help of eny erthely mannes witte, save the mercy of Oure Lord, as they
have to shewe »144 !
De même, les pétitions concernant le Statut des Trêves, déjà évoquées ci-dessus, font de la
question de la piraterie l’un de leurs arguments en faveur de la modification ou de la
136 PROME, parlement de novembre 1422, item 19. Par la suite, cette même demande est sans cesse reconduite. 137 PROME, parlement de septembre 1429, item 42. Voir aussi janvier 1431, it.29. 138 PROME, décembre 1420, item 22. 139 PROME, avril 1425, item 41. 140 PROME, mai 1432, item 34. 141 PROME, juillet 1433, item 46. 142 PROME, janvier 1442, item 18. 143 PROME, mars 1416, item 49 et octobre 1416, item 26. 144 PROME, février 1447, item 16.
30
suspension de ce dernier. En effet, leur discours concerne quasiment toujours aussi bien les
Marches d’Ecosse et les régions côtières que les crimes commis par les étrangers «sur la
haut meer », et le Statut est tenu pour responsable du découragement des marchands
anglais, qui n’osent plus s’aventurer en mer et répliquer aux attaques de l’ennemi, ce qui
entraîne un affaiblissement général de la flotte anglaise : « voz marchantz et mariners du
passer sur le meer ove lour niefs et vesselx, ove lour merchandises, ou autrement en fair de
guerre, pur le safe garde du meer, sount graundement discoragez et embeasshez, et la
naveie de vostre roialme en point d'estre destruez, et voz marchantz du faire ou renoveller
ascuns niefs ou vesselx, tout outrement discomfortez 145».
Dans la même lignée, nombreuses sont les pétitions qui revendiquent pour les marchands
anglais l’octroi de lettres de marque et de représailles contre les nations qui les ont
dépouillés en mer, les autorisant à saisir leurs biens pour se dédommager146. C’est ainsi
qu’Henry V, répondant favorablement à la pétition pour l’amendement du Statut des Trêves
en 1416, prévoit l’octroi de « lettres de requeste » pour obtenir réparation et, au cas où
celles-ci resteraient lettre morte, de « lettres de marque de soubz le grant seal en due
forme »147. Le scénario se répète en 1425, contre les pirates bretons, alors que, « nulle
satisfaction ne agrement faitz, par vertue des lettres de requeste », les Commons réclament
l’octroi « a toutz persones compleignantz des tieux injuries a eux faitz, et duement provez »,
de « lettres de mark et de reprisaill, pur avoir due amendes pur les injuries avauntditz »148,
et encore en 1433149, et en 1447, au profit de John Hamshire et Henry May150.
Les Anglais sont donc constamment mis au contact de l’Etranger, parfois sans même quitter
leur demeure, pour les habitants des frontières et des côtes, soit sur la mer, dans le cas des
hommes de mer. Dans les cas présents, ces rapports demeurent, comme nous l’avons vu,
essentiellement marqués par une forte hostilité. Sans-doute convient-il maintenant de
s’interroger sur les relations que les Anglais entretiennent avec les étrangers... précisément
lorsqu’ils se trouvent en terre étrangère.
145 PROME, parlement d’octobre 1435, item 28 ; février 1447, item 21. 146 Sur les lettres de marque et de représailles, voir Christopher Fletcher, « La communauté anglaise face à l’Etranger », op.cit. (p.111-115). 147 PROME, octobre 1416, item 31. 148 PROME, avril 1425, item 41. 149 PROME, juillet 1433, annexe. 34. 150 PROME, février 1447, item 16.
31
B) Présence anglaise hors d’Angleterre.
1) L’expérience anglaise en Europe.
Depuis la conquête normande, les Anglais fréquentent assidûment le continent. C’est ainsi
que la « peregrinatio studii » amène de nombreux étudiants anglais à fréquenter les écoles
parisiennes, à partir du XIIe Siècle, comme en témoigne l’exemple célèbre de Jean de
Salisbury, et jusqu’au milieu du XIVe, parallèlement au développement des universités
nationales d’Oxford et Cambridge, de même que les clercs et hommes d’Eglise passent
aisément d’un pays à l’autre. Si, par la suite, le conflit franco-anglais limite considérablement
la présence étudiante anglaise en France, la nation dite « anglaise » de l’Université de Paris
étant même définitivement rebaptisée « nation allemande » à la fin de la période151, il va de
soi que, au XVe Siècle encore, les occasions de visiter les Etats d’Europe de manquent pas.
C’est le cas pour les ecclésiastiques présents en cour de Rome, tels que Thomas Polton,
procureur de la délégation royale152, ou qui reçoivent des bénéfices à l’étranger, certains
prélats anglais se voyant attribuer des diocèses jusque dans la lointaine Islande153, ou
encore, qui font partie des délégations anglaises aux Conciles oecuméniques de Constance
(1414-1418) et de Bâle (1431-1449). Il en est de même pour les membres de la nation
anglaise de l’Ordre de Saint-Jean à Rhodes ou pour les moines tenant l’Hôpital de St-Thomas
à Rome pour accueillir leurs compatriotes en pèlerinage, ainsi que pour les pèlerins eux-
mêmes, qui, tels que la célèbre Margery Kempe en 1413, passent par Constance et Venise en
route pour la Terre Sainte, ou se rendent à Rome ou encore à St-Jacques de Compostelle154.
Les ambassadeurs, envoyés aux quatre coins de l’Europe, ont également l’occasion de voir
du pays, de même que les membres de la suite escortant des princesses anglaises dans leur
nouvelle patrie à l’occasion de mariages dynastiques, le Brut mentionnant ainsi les
nombreux « lordez and worthi knyztis, ladiez, and Squyers » qui escortent Blanche de
Lancastre jusqu’à Cologne155, ainsi que les « lordiz, kniztis and squyers, ladiez and gentil-
wymmen » qui accompagnent sa sœur Philippa au Danemark156. Surtout, un groupe social et
professionnel particulier est amené à voyager constamment en Europe : les marchands.
151 Voir Peter Rickard, Britain in Medieval French Literature, Cambridge, 1956 (p.28-30). 152 Cet exemple, ainsi que les suivants, sont empruntés à Geoffrey Hindley, England in the Age of Caxton, op.cit. (p.26-29). Thomas Polton est surtout connu aujourd’hui pour sa participation à la polémique franco-anglaise au Concile de Constance (voir Jean-Philippe Genêt, « English Nationalism: Thomas Polton at the Council of Constance », in Nottingham Medieval Studies, XXVIII, 1984, p.60-78. 153 Voir E.M. Carus-Wilson, « The Iceland Trade », in Studies in English Trade in the 15th Century, op.cit., p.156-182 (ici p.169-170) ; (cet article est repris dans E.M. Carus-Wilson, Medieval Merchant Venturers, Londres, 1967 [1954], sous le titre « The Iceland Venture », p.98-142). 154 Anthony Goodman, « Before the Armada : Iberia and England in the Middle Ages », in England in Europe, op.cit., p.108-120 (ici, p.108-109). Margery accomplit le pèlerinage de St-Jacques en 1417. 155 Brut, p.364-365. 156 Ibid, p.367-368.
32
Les marchands et les gens de mer.
Ainsi, les marchands anglais, du fait de leurs activités, se trouvent sans-cesse au contact de
l’Etranger. C’est ainsi qu’en Bretagne, les Anglais, qui représentent le premier groupe
étranger en termes de présence157, sont majoritairement des gens de mer. Ils fréquentent
aussi activement les grandes foires internationales d’Anvers, de Bruges et de Berg-op-Zoom,
qui, sans-aucun doute, les mettent au contact de toutes les nations de la chrétienté : « To
whyche martis, that Englissh men call feyres, / Iche nacion ofte maketh here repayeres. /
Englysshe and Frensh, Lumbardes, Januayes, / Cathalones, theder they take here wayes ; /
Scotes, Spaynardes, Iresshmen there abydes » (v. 524-529)158. On retrouve les marchands de
Bristol en Irlande, surtout dans le port de Waterford, en Guyenne, en Espagne et au
Portugal159, où l’auteur du Libelle souligne la présence anglaise : « And wee Englysshe passen
into there countrees » (v.131)160. Plus exotique, ils se rendent également chaque année dans
la légendaire Islande, décrite de manière pittoresque dans le Polychronicon de Ranulph
Higden un siècle plus tôt, et dont la voie est ouverte au début du XVe Siècle par les pêcheurs,
puis les marchands d’Angleterre : l’auteur du Libelle évoque ainsi la présence de bateaux
anglais, « Out of Bristow and costis many one », qui se frayent un chemin à travers l’océan à
l’aide du compas (« by nedle and by stone »), jusqu’aux « costes colde », leur nombre
augmentant tellement que les ressources de l’Islande ne peuvent pourvoir à tous : « And
now so fele shippes thys yere there were / That moche losse for unfraught they bare. /
Yselond myght not make hem to be fraught / Unto the hawys… » (v.806-809)161.
Qu’en est-il donc des relations que les Anglais entretiennent avec les populations locales ?
Tout d’abord, l’historiographie du sujet fait souvent apparaître des rapports hostiles, par
exemple dans le cas de l’Islande, où les Anglais se heurtent violemment aux agents du roi de
Danemark ainsi que, parfois, aux locaux, afin d’établir leur suprématie, et sont également
accusés d’enlever ou d’acheter des enfants islandais !162 De même, ces rapports difficiles
avec l’autorité danoise, qui cherche à mettre un terme aux activités anglaises en Islande,
sont documentés par des pétitions en Parlement, alors que les pêcheurs anglais supplient
Henry V en 1416 de ne pas leur interdire de se rendre en Islande malgré la demande
formulée par « certeins estraungers des parties de Northway, et Denmark »163, et que les
marchands et les pêcheurs anglais se plaignent, en 1431, de l’interdiction d’entrer en Islande
et de fréquenter tout autre endroit que « Northbarne » (Bergen, Norvège) en Scandinavie, et
157 Laurence Moal, L’Etranger en Bretagne au Moyen Age, présence, attitudes, perceptions, Rennes, 2008 (p.58). 158 Libelle of Englyshe Polycye, p.27. 159 Voir E.M. Carus-Wilson, « The overseas Trade of Bristol », in Medieval Merchant Venturers, op.cit., p.1-98. 160 Ibid, p.7. 161 Ibid, p.41. 162 E.M Carus-Wilson, « The Iceland Trade », in Studies in English Trade, op.cit. (p.163-167). 163 PROME, mars 1416, item 33.
33
protestent contre le sort réservé aux marchands se rendant à Bergen, où ils « sount pris et
detenuz saunz cause resounable, a loure tresgraunt anientisement et finall destruction »164.
Surtout, si les activités des gens de mer leur donnent l’occasion de voir du pays, cette
expérience de l’Etranger est plus forte encore pour ceux qui vivent sur place. En effet, même
si certains auteurs ont pu observer chez les Anglais, plus que chez les autres peuples, une
tendance à rester au sein de leur communauté nationale et à ne pas se mélanger aux
populations locales165, il n’en est pas moins intéressant de se demander quelles relations ces
communautés entretiennent avec l’Etranger. Ainsi, il existe des communautés marchandes
anglaises importantes établies à Lisbonne (où on peut déceler, en contradiction avec
l’observation qui précède, des cas d’intermariage)166, dans les villes de Flandres et des Pays-
Bas, ou encore à Dantzig. Dans la ville hanséatique de Dantzig réside en effet une
communauté marchande anglaise, installée à la fin du XIVe Siècle, dont les membres,
appelés « liggers », font parfois venir leurs femmes et leurs enfants d’Angleterre, et font
l’acquisition de maisons et de boutiques, dominant le commerce du drap anglais et
s’engageant dans le commerce local. Ils disposent de plus sur place d’une organisation
spécifique, sans-doute avec une maison communale, des assemblées périodiques et des
représentants167. Cependant, les relations avec les gens de Dantzig sont très loin d’être
harmonieuses, dans le contexte très difficile qui caractérise à l’époque les relations de
l’Angleterre et de la Hanse. C’est ainsi que des pétitions en Parlement font état de ce
contexte général, par exemple en 1435, alors que les Hanséates interdisent aux marchands
anglais d’entrer et de commercer dans leurs territoires, et les considèrent comme « hir
mortal enemyes », en raison d’une dette du roi d’Angleterre168, puis en 1442, lorsque les
marchands se plaignent du traitement qui leur est réservé sur place, à l’encontre des accords
commerciaux jadis conclus entre la Hanse et les rois d’Angleterre, puisque les Hanséates
« have putte your saide Englisshe merchauntz in grete subjeccion, and take away their olde
custumes, libertees and fredoms, and do thaym grete wronges, injuries and oppressions »,
en confisquant leurs biens, en les soumettant à de nouvelles impositions, en les
emprisonnant pour les soumettre à la rançon, en imposant des restrictions sur leurs activités
commerciales, et en les chassant de leurs bâtiments communaux, interdisant de plus à toute
personne de leur louer des logements décents, afin de les reléguer dans des caves
(« chargyng that no manere man lete hem none hous to hyre, but in low celers be
erthe »)169. En ce qui concerne plus spécifiquement la communauté de Dantzig, a été
conservée, dans les archives de la Hanse, la trace d’une pétition adressée en Parlement par
les marchands en 1422, et qui fait état d’un épisode particulièrement violent dont elle a été
164 PROME, janvier 1431, item 34. 165 Voir Frédérique Laget, « L’étranger venu de la mer… », op.cit. (p.177). 166 Sur la communauté anglaise de Lisbonne, voir Wendy R. Childs, « Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century », op.cit. (p.206-207). 167 M.M. Postman, « The Economic and Political Relations of England and the Hanse », op.cit. (p.108). 168 PROME, octobre 1435, item 27. 169 PROME, janvier 1442, item 39.
34
victime. Cette pétition raconte en effet comment le maire et le conseil de Dantzig,
souhaitant supprimer leur organisation, font jurer aux marchands résidants de renoncer à
former une compagnie et les forcent à loger dans des auberges, puis, lorsqu’ils osent se
plaindre, font barrer les portes des maisons anglaises avec des chaînes, afin de les forcer à
aller à l’auberge. Surtout, lorsque les marchands osent refonder leur compagnie, le maire et
le conseil passent à la menace, en leur faisant savoir que, s’ils s’obstinent, les chiens de
Dantzig pourraient lécher leur sang dans les rues de la ville (!), avant de leur imposer
diverses restrictions commerciales et de les soumettre à des impositions arbitraires en les
emprisonnant !170 Plus fort encore, les sources de la Hanse nous font connaître une
complainte présentée verbalement par les marchands anglais, et qui traduit un véritable
traumatisme, puisque les hommes de Dantzig vont jusqu’à jeter dans la boue une bannière
aux armes d’Angleterre, avant de la clouer au pilori !171
Les soldats.
Si les gens de mer acquièrent de fait une expérience de première main de l’Etranger, un
autre groupe se trouve nécessairement au contact de ce dernier, soit les soldats qui
prennent part aux guerres du roi d’Angleterre sur le continent, et donc, plus spécifiquement
en ce qui concerne notre période, en France. En effet, l’interaction avec l’Etranger ne se
limite pas ici aux affrontements avec l’ennemi, mais débute au sein-même des troupes
royales, dans lesquelles on a pu relever la présence d’un certain nombre d’hommes d’armes
étrangers172. C’est ainsi que de nombreux Gallois participent aux opérations militaires
anglaises en France tout au long de la guerre de Cent Ans173 . De même, la présence de
troupes irlandaises au siège de Rouen, emmenées par Thomas Butler, Prieur de Kilmainham,
est mentionnée par John Page : « And then the pryor of Kylmaynan / Was come with yn the
mowthe of Sayn. / At Harflete he londed evyn, / With xv. Hundryd fyughtyng men »174, repris
en prose dans les manuscrits du Brut175, et l’auteur du Siege of Calais mentionne également
la présence d’un « Irissh man »176 parmi les défenseurs de la ville. Enfin, John Page cite
également parmi les capitaines de l’armée anglaise à Rouen un écuyer gascon, Jenico
170 Editée dans PROME, novembre 1422, Annexe 25. Cette même pétition fait également état des malheurs de marchands anglais fraîchement arrivés en territoire hanséatique, qui sont capturés par des Hanséates, forcés de courir « comme des bêtes » devant leur geôliers, puis enchaînés et menacés de mort, en raison d’un acte de piraterie commis par leurs compatriotes (raison pour laquelle les Hanséates se déclarent ennemis de l’Angleterre toute-entière), avant d’être dépouillés, mis à la rançon et finalement libérés, entre autres actes violents ! 171 Aussi éditée dans PROME, novembre 1422, annexe 26. 172 Voir Anne Curry, « The Nationality of Men-at-Arms serving in Normandy and the pays de conquête, 1415-1450 », in Reading Medieval Studies, vol.18, 1992, p.135-163. 173 Andrew D. Carr, « Welshmen and the Hundred Years’ War », in Welsh History Review, vol.4-1, 1968, p.21-46. 174 Historical Collections of a Citizen of London, p.12. 175 Brut, p.389 et 397. 176 Historical Poems of the XIVth and XVth Centuries, p.82.
35
d’Artas : « And Janygo lay hym a-bove / A grete Squyer for to prove »177. Par ailleurs, un
article des Ordonnances dites « de Mantes », promulguées, sans-doute en 1419, par Henry
V, indique que les relations entre sujets du roi d’Angleterre de nationalités différentes au
sein de l’armée n’étaient pas toujours des plus courtoises, puisqu’Henry V est obligé
d’ordonner sous peine de mort que « no maner man geve no reproche to non other by cause
of the countrey that he is of, that is to saye, be he Frenche, Englisshe, Welshe, or Irisshe, or
of any other countrey whens that ever he be, that no man saye no vilony to non other,
throughe the whiche vilony saynge, may falle sodenly man slaughter, or risinye of
people »178 !
2) La présence « coloniale ».
De même, certains Anglais ont l’occasion, à notre période, d’avoir des rapports avec
l’Etranger qui vont au-delà du ponctuel ou de l’activité professionnelle. En effet, certains
d’entre eux vivent et parfois-même naissent au contact direct de l’Etranger. De fait, comme
nous l’avons vu plus haut, le roi d’Angleterre possède, au sein des Iles-Britanniques comme
sur le continent, des territoires, souvent décrits comme des « colonies », l’ensemble de ces
possessions formant le « premier empire anglais »179.
Les Iles-Britanniques.
Ainsi, il ne fait pas de doute que les territoires sous la domination du roi d’Angleterre dans
les Iles-Britanniques font bien l’objet d’une politique coloniale. C’est ainsi le cas pour
l’Ecosse pendant la courte période de domination anglaise, puisqu’Edward I accorde à ses
capitaines les terres confisquées aux ennemis écossais180. Si le settlement en Ecosse s’achève
sur un échec, alors que les Anglais, victimes du Traité de Northampton, sont forcés de
renoncer à leurs possessions écossaises et forment ensuite le groupe des « Déshérités »181,
la situation d’autres « colonies » s’avère plus durable.
C’est le cas bien-sûr du pays de Galles. En effet, à partir de la conquête d’Edward I,
nombreux sont les fermiers anglais (et aussi flamands) qui s’installent dans les lowlands
galloises, alors que les natifs sont expropriés des meilleures terres. Les lords anglais à la tête
177 Historical Collections of a Citizen of London, p.9. 178 Sur les Ordonnances de Mantes, voir Anne Curry, « The Military Ordinances of Henry V: Texts and Contexts », in War, government and aristocracy in the British Isles, c.1150-1500, Chris Given-Wilson, Ann Kettle et Len Scales (eds.), Woodbridge, 2008. L’extrait de l’Ordonnance est ici cité à partir de l’édition qu’en donne Sir Harriss Nicolas dans son History of the Battle of Agincourt, 3e édition, Londres, 1833 (Annexe VIII, p.39). 179 Pour une réflexion sur l’emploi de ces termes, voir Peter Crooks, « State of the Union : Perspectives on English Imperialism in the Late Middle Ages », Past and Present, 2011, téléchargé le 29/01/2014, sur http : // past.oxfordjournals.org 180 Voir Michael Prestwich, « Colonial Scotland : the English in Scotland under Edward I », in Scotland and England (1286-1815), op.cit., p.6-17. 181 Michael Prestwich, « England and Scotland during the Wars of Independence », op.cit. (p.187).
36
de seigneuries galloises font appel, pour gérer ces dernières, à des familles anglaises de la
petite gentry, qui résident sur place (les advenae). Surtout, il existe environ 80 « plantation
towns », des bourgades qui font office de centres administratifs et commerciaux, et dont les
habitants sont encore, à la période qui nous concerne, très largement d’extraction
anglaise182.
Quels sont, donc, les rapports que ces Anglais entretiennent avec la population locale ?
Premièrement, il est intéressant de noter que les familles anglaises installées au pays de
Galles ne perdent jamais de vue leur appartenance à la nation anglaise. De fait, les
interactions entre les deux peuples demeurent souvent réduites au minimum, dans la
mesure où les Anglais commencent alors à peine à vaincre leurs réticences à épouser des
Galloises, et où, s’il leur arrive d’utiliser un nom gallois, ils ne se convertissent jamais à la
langue et aux coutumes locales183. Cette absence d’interaction s’explique également par la
discrimination qui pèse sur les natifs depuis la conquête, puisque les Gallois ne bénéficient
pas, comme nous l’avons vu plus haut, de la Common Law anglaise, cette différence de
statut légal, qui rend certes difficiles les poursuites en cas de crimes, constituant surtout un
puissant outil d’infériorisation face aux Anglais184, et se voient aussi interdire, du moins
officiellement, l’acquisition de propriétés et le statut de bourgeoisie dans certaines villes, de
même que l’accès aux offices, toutes mesures qui sont reprises et amplifiées, même si leur
application est loin d’être systématique, par la législation anti-galloise promulguée par Henry
IV en 1401-1402, au moment de la révolte de Glyndwr185. De plus, cette législation étend
également aux Anglais mariés à des Galloises, et plus spécifiquement à celles « de l'amyste
ou aliance de Owen de Glyndourdy » l’interdiction d’occuper des offices au pays de Galles ou
dans les Marches, comme le rappelle encore une pétition de 1433186 !
C’est cette législation extrêmement répressive qui amène de très nombreux Gallois à
rechercher des Lettres de denization, qui, leur conférant la nationalité anglaise, leur permet
de jouir des droits des Anglais, non seulement en Angleterre, mais également dans leur
propre pays ! C’est ainsi le cas, en 1413, pour Rhys ap Thomas, qui, invoquant les dommages
qu’il a subi aux mains des rebelles en raison de sa loyauté au roi d’Angleterre, demande à
être exempté du statut d’Henry IV prévoyant « qe nulle homme Galois, eiant pier et mier
neez en Gales, serroit fait officer ou ministre du roy, ne de nulle autre seignur en Engleterre,
ne citezein, ne burgeois, ne riens purchaceroit des terres ou tenementz deins les villes
Englois, n'aillours en Engleterre n'en Gales, ne q'il serroit du counseil d'ascuny », et
réclamant aussi, pour lui et ses descendants, un statut égal à celui des Anglais : « et outre ce,
q'il, et ses heirs et issues, soit, et soient, tenuz, reputez, et tretez, come verrois Englois lieges
182 Voir Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.518) et Ralph A. Griffiths, « Wales and the Marches… », op.cit. (p.66). 183 Voir Gerald Harriss, ibid, et Peter Crooks, « State of the Union… », op.cit. (p.9-10). 184 Voir Christopher Fletcher, « La Communauté anglaise face à l’étranger », op.cit. (p.109). 185 PROME, parlement de janvier 1401, it.77. 186 PROME, parlement de septembre 1402, item 102 ; parlement de juillet 1433, item 30.
37
nostre dit seignur le roy, ou de ses heirs, en toutz pointz »187. Des requêtes identiques sont
accordées à de certains Lewis John, John Montgomery, et John Stiward en 1414, à Griffith
Don en 1421, puis à David ap Thomas en 1427, tous autorisés à jouir sans-contredit de leurs
acquisitions foncières en Angleterre et dans « les burghs et villes Engloises de Gales » et à
occuper des fonctions officielles, « auxi franchement et entierment come ascun de voz lieges
neez et engendrez deinz vostre roialme suisdit »188. Surtout, la « naturalisation » est
officielle dans le cas de Rhys ap Madoc qui, en 1431, en raison de ses bons services envers
Henry V et Henry VI « en lour guerres depar dela le meer », se voit reconnaître le statut de
« denizen » par lettres patentes : « qe lettres patentz soient faitz desoubz le graunde seal de
nostre dit seignur le roi, au \dit/ Rys, q'il durante sa vie soit deinszein, et q'il soit tretee, tenuz
et reputez, en toutz choses, come son verrai et foial [liege] , neez deins son roialme
d'Engleterre »189. Enfin, deux pétitions relatent le cas, particulièrement intéressant, de
William ap Gwillym ap Griffith, « Engloys de par sa mere » Joan, fille de William Stanley, et
« Galoys de par son piere », que le roi accepte de « faire […] Engloys », avec les mêmes
privilèges que « auteres foialez Engloys », en posant cependant comme conditions qu’il ne se
marie pas à une Galloise (« quod idem Willelmus mulieri Wallensi nullatenus maritetur »), et
qu’il renonce à occuper des charges au pays de Galles ! (« nec quod ipse durante vita sua,
aliquod officium infra Wall' […] habeat neque occupet quovis modo »)190, la deuxième
condition étant levée à sa demande trois ans plus tard191.
De même, les pétitions témoignent généralement d’une haine solide entre les Anglais et les
natifs au pays de Galles. De fait, de nombreuses tensions demeurent du fait de la récente
révolte galloise, alors que les Anglais (et aussi les Gallois) ayant participé à sa répression,
pendant laquelle des rebelles « furent tuez, et ascunez maihemez, batuz, naufrez, pris et
imprisonez, lour biens et chateux emportez », sont victimes d’injustes rétributions de la part
de ces derniers ou de leurs parents192. Surtout, les Anglais, qui conservent tout-au-long de la
période une très forte mentalité coloniale, se montrent particulièrement soucieux
d’empêcher l’octroi de quelconques privilèges aux natifs. En témoignent particulièrement
deux pétitions de 1445 et 1447, émanant des habitants des villes anglaises du nord du pays
de Galles, et qui demandent l’application stricte des ordonnances promulguées par Edward I
au moment de la conquête, « for the suertee of his true Englissh men, and for to kepe the
seid Walssh men and their heirs, in subjeccion unto his croun of Englond », et par Henry IV
au moment de la révolte « to holde hem in obeysaunce, for the wele of this seid noble
reaume, and suertee of his trewe lieges Englissh there ». C’est ainsi que celle de 1447,
invoquant les menaces de vengeance dont les Anglais font quotidiennement l’objet de la
part des Gallois « for the slaghter and distruccion of thair aunceters rebellez, in the tyme of
187 PROME, parlement de mai 1413, item 16. 188 PROME, parlement d’octobre 1414, items 27, 28 et 29 ; mai 1421, item 13 ; octobre 1427, item 22. 189 PROME, parlement de janvier 1431, item 20. 190 PROME, parlement de novembre 1439, item 29. 191 PROME, parlement de janvier 1442, item 16. 192 PROME, parlement d’octobre 1427, item 33.
38
rebellion by hem and by her aunceters slayn and distroyed; and for landes and tenementz,
that her aunceters rebellez forfaited in the saide tyme, and […] to the seid lieges English and
to hir aunceters graunted », réclame avec succès la confirmation de tous les statuts anti-
gallois, l’annulation des privilèges commerciaux qui leur ont été accordés, ainsi que leur
soumission aux corvées 193. Plus frappant encore, celle de 1445 s’élève contre la possibilité-
même pour les Gallois d’échapper à ces contraintes en obtenant des lettres de denization,
« to thentent that they mowe be of the same fredom and libertee as Englissh men ben
there », ce qui causerait la perte définitive de ces derniers (« the utter destruccion of all
Englissh men »), puisque des Gallois, qui n’ont que mépris pour les Anglais (« dispite, in hert,
countenaunce and word »), seraient alors autorisés à les juger en tribunal ! Pour pallier à ce
terrible danger, il convient d’ordonner, par une mesure « raciste » caractérisée, qu’aucun
Gallois « of hole blode, ne half blode on the fader side, be made denisen or Englissh »,
exceptions faites d’un certain Griffith ap Nicholas, et, étrangement, de William Bulkley, lui-
même anglais, mais marié à une femme à moitié galloise (« a woman of half blode
Walssh »)194 !
Tournons-nous à présent vers le cas de l’Irlande, autre « colonie » anglaise. Ici comme au
pays de Galles, ce sont bien deux nations distinctes qui cohabitent, soit « les Engleys nées
en Irlande », descendants des immigrants installés en Irlande à la fin du XIIe et au début du
XIIIe Siècle, et les « Irlandais » natifs, soit la population celte. Dans ce contexte, les « Anglais
d’Irlande » insistent continuellement sur leur appartenance à la nation anglaise, reflétée ici
aussi par leur statut légal195, soucieux qu’ils sont de ne pas être confondus avec les natifs,
qui, communément appelés « Irlandais sauvages », ne sont pas considérés comme les sujets
du roi d’Angleterre, mais comme ses ennemis. C’est ainsi qu’une pétition présentée en
parlement en 1416 exprime très clairement cette distinction essentielle, posant que « la dite
terre est [devisé par] deux nacions: c'est assavoir, lez ditz suppliantz Engloys et de Engloys
nacione, et les Irroys nacione, enemyes a nostre seignur le roy », qui, de plus, recherchent
sans-cesse l’anéantissement des premiers (« purposent continuelment les ditz lieges a
destruer, et la dite terre conquerer »). Pour cette raison, les Commons demandent à ce que
cette séparation soit nettement observée, en statuant « qe nulle d'Irroys nacione ne serroit
eslu par eleccione en ercevesqe, evesqe, abbé, priorie, ne en nulle manere resceu n'accepté
a nulle dignité ne benefice deins la dite terre »196.
Cependant, même si l’on observe d’indéniables similarités avec ce qu’on a dit du pays de
Galles, la situation est ici très différente. En effet, on assiste en Irlande à un phénomène
d’assimilation, alors que, assez rapidement, les membres des familles anglo-irlandaises
adoptent des éléments de la culture gaélique, et acquièrent une connaissance parfaite de la
193 PROME, parlement de février 1447, item 23. 194 PROME, parlement de février 1445, item 26. 195 Voir Robin Frame, «'Les Engleys Nées en Irlande': The English Political Identity in Medieval Ireland », in Transactions of the Royal Historical Society, Sixth Series, Vol. 3 (1993), p. 83-103. 196 PROME, parlement d’octobre 1416, item 21.
39
langue et de la littérature du pays, tendant ainsi à devenir, selon l’expression consacrée, une
nation intermédiaire (« Middle Nation »), distincte à la fois des natifs et des Anglais
d’Angleterre197. Cette spécificité des Anglo-Irlandais, reconnue aussi bien par les Celtes que
par leurs cousins anglais, et taxée par ces derniers de « dégénérescence », fait ainsi l’objet
d’une large législation, dont le parlement de 1297 et les célèbres Statuts de Kilkenny de
1366, visant à rétablir la distinction par rapport aux natifs, en leur interdisant d’adopter les
mœurs irlandaises, et en limitant les contacts entre les deux peuples, y compris les
intermariages. Parallèlement, on assiste à la mise-en-place d’une politique de discrimination
à l’encontre des natifs, qui à partir de 1447, peuvent être arrêtés et soumis à la rançon, de
manière assez comique, s’ils arborent une moustache de quinze jours198 !
De plus, une pétition présentée en Parlement en 1423 révèle que les seigneurs anglais
possessionnés en Irlande sont prompts à s’accuser les uns les autres d’intelligence avec les
ennemis Irlandais. C’est ainsi que John Talbot énumère les « divers tresons » dont James
Butler, Earl d’Ormond, s’est rendu coupable en Irlande, en achetant un « ennemi irlandais »,
Calagh O’Connor (« Calagh Oconqore Irissh enemy »), qui utilise alors sa seigneurie
d’Oghtryn dans le comté de Kildare comme base pour ses raids (« be þe wiche the said
Calagh wyth his men, […] enemys of oure lorde the kyng, oftymys roode aftire þat thourgh
the said lordship, […] robbyng, slayng, and distruyng the kynges liege peple, and bernyng þe
countre wyth in forth, wyth outen […] any resistence makyng by […] any of hame of the said
lordship, to the said Calagh in hys comyng and goyng »), mais aussi en soutenant son
serviteur William Edward, ayant assassiné le gouverneur du château de Wicklow de
connivence avec Obryn, « chef de la nation irlandaise » (« Irish enemy to oure lorde the
kyng, and chief of his nacioun »), en ayant accueilli le traître William Thomasson, et enfin, en
ayant capturé Thomas Talbot pour le livrer aux Irlandais Kernes et O’Connor, qui le traitent
avec cruauté et le soumettent à la rançon.199
Les territoires continentaux.
En quittant les Iles Britanniques pour le Continent, on observe une situation assez différente,
alors qu’on oppose souvent les territoires conquis des Iles Britanniques aux territoires
héréditaires des rois d’Angleterre en France200. De plus, cette différence se retrouve aussi
dans la question du rapport aux populations locales, qui n’apparaît pas dicté, dans les
territoires continentaux, par les préjugés racistes décrits plus haut201.
197 Voir James Lydon, « The Middle Nation », in The English in Medieval Ireland, James Lydon (ed.), Dublin, 1984, p.1-26. 198 Voir Ibid, et, du même auteur, « Nation and Race in Medieval Ireland », in Concepts of National Identity in the Middle Ages, op.cit., p.103-124. Pour le dernier exemple, voir Ralph A. Griffiths, « The English Realm and Dominions and the King’s Subjects in the Later Middle Ages », in King and Country, England and Wales in the Fifteenth Century, Londres et Rio Grande, 1991, p.33-54 (p. 42). 199 PROME, parlement d’octobre 1423, item 9. 200 Voir Peter Crooks, « State of the Union… », op.cit. (p.10). 201 Ibid, p.9.
40
Parmi ces territoires continentaux, le plus ancien encore aux mains des rois d’Angleterre
alors que s’ouvre notre période est la Guyenne. C’est ainsi que cette dernière a pu être
décrite comme étant « England’s first colony »202. De fait, on assiste en Guyenne à une
« anglicisation » progressive du personnel administratif sans exclure cependant les natifs,
alors que, « à partir de la fin du XIIIe Siècle, les lieutenants généraux, les sénéchaux, les
connétables, les maires des principales villes sont presque tous des Anglais »203. De plus, il
arrive que ces derniers, à l’instar du sénéchal John Stratton à la fin du XIVe Siècle204, se
marient dans la noblesse locale, de même que de grands seigneurs de Guyenne épousent
des Anglaises pour resserrer les liens, comme en témoigne l’exemple de Pierre de
Montferrand qui, ayant déjà une grand-mère anglaise, prend pour femme Mary, fille bâtarde
de John de Bedford205. De même, Robert Boutruche a décelé la présence en Guyenne
d’immigrés anglais permanents, « dont le domicile, la profession, les intérêts sont dans le
Sud-Ouest », et qui exercent les métiers les plus divers à Bordeaux (où ils donnent leur nom
à la « Rue aux Anglais ») et dans les bourgades voisines, de l’homme de loi au « laboureur de
vigne » en passant par le marchand et l’artisan206. Toutefois, il apparaît légitime de remettre
en question l’appellation de « colonie », dans la mesure où la Guyenne ne fait aucunement
l’objet d’une politique de peuplement207, comme c’est le cas pour Calais et la Normandie
lancastrienne, et que ce sont les rapports commerciaux qui sont surtout documentés dans
les Parliament Rolls208.
Inversement, la ville de Calais, conquise par Edward III en 1347, est très rapidement
transformée en une véritable « ville anglaise »209. C’est ainsi que, dès la fin du siège, le roi
fait expulser la quasi-totalité des habitants, afin de repeupler la ville avec de « pure
Englysshemen », en accordant aux Anglais de toutes conditions qui viennent s’installer à
Calais des dons de propriété et toutes sortes de libertés et de privilèges. De même, le traité
de Brétigny permet de fixer la zone de domination anglaise autour de Calais, plus tard
désigné sous le nom de Pale. Par la suite, Calais et le Pale sont dotés d’institutions anglaises
202 C’est en effet le titre donné par Margaret Wade Labarge à son ouvrage sur la Guyenne anglaise, Gascony, England’s first colony (1204-1453), Londres, 1980. 203 Robert Boutruche, « Anglais et Gascons en Aquitaine du XIIe au XVe Siècles : Problèmes d’histoire sociale », in Mélanges d’histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p.55-60 (ici, p.55). 204 Sur John Stratton et son mariage avec Isabelle de Saint-Symphorien, voir Ibid (p.58), et Margaret Wade Labarge, Gascony…, op.cit. (p.178). 205 Voir Malcolm Vale, « The Last Years of English Gascony (1451-1453) », in Transactions of the Royal Historical Society, Fifth Series, Vol. 19 (1969), p. 119-138 (ici, p.136-137). 206 Robert Boutruche, « Anglais et Gascons… », op.cit. (p.58). 207 Peter Crooks, « State of the Union », op.cit. (p.10 et Ibid, n.47). 208 PROME, voir par exemple la pétition de janvier 1437 (item 22), dans laquelle les marchands anglais demandent à être exemptés d’une nouvelle taxe qui leur est imposée à Bayonne, ou encore celle de février 1445 (item 46), qui concerne les fraudes des producteurs de vin en Gascogne et en Guyenne. 209 Ici encore, nous empruntons cette expression au titre de Susan Rose, Calais, an English Town in France, Woodbridge, 2008.
41
régies par un personnel anglais, les forteresses reçoivent une très importante garnison
anglaise, et surtout, la ville acquière une importance économique majeure dès 1363,
lorsqu’elle est choisie pour être le siège du Staple anglais pour l’exportation de la laine et
d’autres produits, et qu’elle accueille de même un Mint battant la monnaie d’Angleterre210.
C’est ainsi que la présence du Staple, qui a pu être décrit comme « the most important
Anglicizing force upon the town », confère aussi à la ville de Calais une place importante
dans les pétitions présentées en Parlement, tout au long de notre période. De fait, on
trouve, dans les Parliament Rolls, de très nombreuses pétitions émanant des représentants
de Calais et du Staple, qui dénoncent les fraudes des marchands qui exportent de la laine,
des peaux ou de l’étain sans passer par Calais, afin d’échapper aux impositions royales211. De
même, d’autres concernent plus spécifiquement les activités illicites des « shipmen » et
marchands étrangers212, ou encore le contrôle de ces derniers et le fonctionnement du
Mint.213
De même, si la question de l’identité anglaise n’est pas encore aussi poussée qu’après la
perte des autres territoires continentaux, alors que le Pale de Calais marque réellement la
frontière entre les possessions du roi d’Angleterre et celles du roi de France214, la question
des non-Anglais qui habitent Calais et ses alentours apparaît déjà de manière dramatique au
moment du siège de la ville par les troupes de Philippe le Bon. En effet, le Brut rapporte alors
comment les non-Anglais, visiblement perçus à Calais comme un corps étranger et
possiblement dangereux, sont sommés, en prévision du siège, de se rendre à l’hôtel de ville
pour prêter serment d’allégeance au roi d’Angleterre, ou de quitter la ville : « And there was
a cry made in the market-place of Caleis, that al maner of men beyng in Caleis, or lyvyng
vnder bill vnsworn, that they shulde come to the toune-hall, and there to be sworn the
Kynges trewe leege men ; And that that wold not be sworn, to take theire goodes and go
theire way where thay wold ». Or, si beaucoup acceptent de prêter serment, nombreux aussi
sont ceux qui préfèrent s’enfuir… en Flandre : « And so there come many, and were there
sworn ; and many went theire way into Flaundres, and wold not be sworn »215 !
210 Voir Ibid, p.1, 22-38 et 39-53 ; et David Grummitt, « ‘One of the mooste pryncipall treasours belongyng to his Realme of Englande’ : Calais and the Crown (1450-1558) », in The English experience in France, David Grummitt (ed.), Aldershot, 2002, p.46-62. 211 Voir par exemple, pour n’en citer que quelques-unes, PROME, parlement de novembre 1414, item 43 ; octobre 1423, item 39 ; octobre 1427, item 41 ; septembre 1429, items 59 et 63 ; mai 1432, item 51 ; juillet 1433, item 64 ; octobre 1435, item 22… 212 Voir PROME, parlement de septembre 1429, items 61 et 62. 213 PROME, parlement de décembre 1420, item 14 ; décembre 1421, item 19 ; septembre 1429, item 60. 214 En témoigne l’écriteau placé par Thomas Fynderne, lieutenant de Guînes, à la frontière : « no man be so hardy to take me awaye ffor this ys the right pale between Ingland anf ffraunce » (cité par D. Grummitt, « …Calais and the Crown », op.cit., p.53). Pour la politique des Tudors visant à renforcer l’identité anglaise à Calais, voir Ibid (p.57 et suivantes), et Malcolm Vale, The Ancient Enemy, op.cit. (p.115-128). 215 Brut, p.574. Voir aussi Marie-Rose Thielemans, Bourgogne et Angleterre, op.cit. (p.92).
42
De même, c’est bien le modèle de Calais qui est repris par Henry V à Harfleur en 1415, alors
que les chroniqueurs rappellent fièrement comment le roi, ayant pris la ville, ordonne
l’expulsion de l’ensemble de ses habitants, « hommes, femmes et enfants « (« put out alle
the Frensch peple, both man, womman and chylde ») afin de l’ « emplir d’Anglais » (« stuffe
the toun with Englisch men »), et particulièrement d’artisans, qui se voient offrir une maison
dans la ville, de manière perpétuelle: « And than the King sent yn to Engelonde, that what
crafti man wolde come thidir, & ynhabit hym there ynne the toune, he scholde have hous
and housholde to hym and to his heyre3 for euyrmore »). A en croire le Brut, cette politique
est alors couronnée de succès, puisque « thidir went mony dyuers Marchaunte3 & Crafti
men, & inhabited ham there »216. C’est le même scénario qu’on retrouve à l’œuvre lors de la
prise de Caen en 1417 : « And the King commaunded to put out alle the Frenschmen, bothe
man & woman […] And thanne the King lete stuffe the Toun and the Castell with Englisch
men »217. De fait, si l’expérience à Harfleur semble se solder par un échec relatif, les Anglais
demeurent nombreux, tout-au-long de la période, à Rouen, et surtout à Caen, véritable
« ville anglaise ». En effet, celle-ci abrite une importante communauté anglaise, composée
d’administrateurs civils et militaires, et des soldats de la garnison. De fait, nombreux sont
ceux qui reçoivent des propriétés dans la ville, et en viennent donc naturellement à
revendiquer leur statut de « bourgeois de Caen, natif du pays d’Angleterre »218. De même, ils
établissent alors des relations avec la population locale, comme en témoignent plusieurs cas
d’intermariage, par exemple, dès 1417, ceux de John Convers avec Estienne la Cauvette et
de Thomas Pole à Colette de Cabourg. De plus, de nombreux Anglais fréquentent alors la
toute jeune université de Caen, fondée en 1432 par Bedford219. De même, l’ensemble du
duché de Normandie fait l’objet, de la part d’Henry V puis du Régent Bedford, d’une
politique consciente de settlement. En effet, nombreux sont les membres de l’armée
anglaise qui se voient accorder d’importantes propriétés foncières dans le duché, afin d’en
assurer la défense militaire, mais aussi d’intéresser les bénéficiaires à sa conservation220. De
fait, ces dons fonciers sont transmissibles à leurs héritiers, de même qu’il leur est
rigoureusement interdit de les vendre à des non-Anglais, ce qui prouve bien que le but
d’Henry V était d’établir une colonie durable. De même, le settlement contribue à créer une
« société anglo-française » dans le nord de la France221, alors que les Anglais s’intègrent
souvent à la société normande locale, au moyen d’intermariages, particulièrement fréquents
216 Brut, p.377. 217 Ibid, p.384-385. 218 Christopher Allmand, « La Normandie devant l’opinion anglaise à la fin de la guerre de Cent Ans », in Bibliothèque de l'école des chartes, 1970, tome 128, livraison 2, p. 345-368 (ici, p.353). 219 Pour Caen, voir Christopher Allmand, Lancastrian Normandy (1415-1450) : the History of a Medieval Occupation, Oxford, 1983 (p.81-131). 220 Sur le settlement, on pourra consulter Christopher Allmand, Ibid (p.50-80), ou, du même auteur, « The Lancastrian land settlement in Normandy (1417-1450), in The Economic History Review, New Series, Vol. 21, No. 3 (Dec. 1968), p. 461-479, ou encore Robert Massey, « the Land Settlement in Lancastrian Normandy », in Property and Politics, Essays in Later Medieval English History, A.J. Pollard (ed.), Gloucester, 1984, p.77-91. 221 Robert Massey, op.cit. (p.77).
43
en Normandie, comme en témoigne entre autres le cas de Richard Merbury, qui, ayant
épousé la Française Catherine de Fontenay, choisit, au moment de la reconquête, de prêter
serment à Charles VII et de rester en France222 !
Ce dernier exemple témoigne en effet du degré d’intégration auquel les « Anglais de
Normandie » étaient alors parvenus. En effet, il ne fait pas de doute qu’à leurs yeux, « le
duché était leur ‘patrie’ » et qu’ « ils se sentaient partie intégrante du pays »223. De fait, il
n’est pas rare de voir se succéder aux offices, à Caen, deux ou même trois générations
d’Anglais, parfois issus de mariages mixtes, et pour qui « la Normandie lancastrienne était le
seul monde qu’ils connaissaient, celui dans lequel se trouvait leur avenir », alors que certains
d’entre eux n’avaient même jamais mis les pieds en Angleterre avant d’y être renvoyés par la
reconquête224 ! C’est ainsi que le moment de la reconquête constitue pour eux un véritable
drame personnel, proche de la crise identitaire225. De même, pour la grande majorité des
bénéficiaires de dons de terres, appartenant à la gentry, leurs possessions en Normandie
représentent leur unique moyen de subsistance, dont la défaite vient les priver. C’est ainsi
qu’on trouve, dans des archives familiales, un texte, imprimé en annexe au parlement de
novembre 1449, qui raconte comment, en raison de la « trahison » du duc de Suffolk, les
sujets du roi d’Angleterre ont été privés de leurs terres, de leurs biens et même de leur
famille, avant d’être obligé d’abandonner le pays (« the true subjects lost their land, their
goods and chattels, their wives, their children, and in addition were exiled and fled the
country »)226. Surtout, leur situation désespérée inspire à William Worcester une grande
pitié, alors qu’il expose comment les colons anglais ont perdus les biens qui leur avaient été
donnés en récompense de leurs bons et loyaux services : « And there youre obeisaunt
subgeitis and trew liege peple be put owt of their londis and tenementis yoven to hem by
youre predecessoures […] for service done unto hem in theire conquest, not recompensed
ayen to theire undoing »227. De même, ce sont leurs exclamations de douleur que l’auteur
met en scène : « Heh allas ! thei did crie » et plus loin, « He allas ! we dolorous parsones
suffring intorabille persecucions and miserie, aswelle in honoure lost as in our lyvelode there
unrecompensid, as in oure meveable goodes bereved… »228.
Enfin, il nous fait terminer ce tableau de la présence coloniale anglaise en évoquant le cas de
Paris. De fait, si certains capitaines anglais, tels que Richard Woodville en 1423, s’y voient
attribuer des propriétés confisqués aux Armagnacs, ces dons restent dans l’ensemble
limités, et la plupart des Anglais ne résident pas à Paris de façon régulière, de telle sorte
222 Christopher Allmand, Lancastrian Normandy, op.cit. (p.79-80, et Ibid, n.118 et 119). 223 Christopher Allmand, « La Normandie devant l’opinion anglaise », op.cit. (p.348). 224 Christopher Allmand, Lancastrian Normandy, op.cit. (p.120 et 103). 225 A ce sujet, voir Maurice Keen, « the End of the Hundred Years War : Lancastrian France and Lancastrian England », in England and her Neighbours, op.cit., p.297-311 (ici, surtout p.306-307). 226 PROME, parlement de novembre 1449, Annexe 1. 227 Boke of Noblesse, p.41. 228 Ibid, respectivement p.41 et 49.
44
qu’on n’assiste jamais à la formation d’une communauté anglaise dans la capitale229. De
même, si quelques relations personnelles peuvent parfois se former, comme en témoignent
ici encore quelques intermariages et l’histoire de Gilbert Dowel qui, fiancé à la Parisienne
Jeannette Roland, doit tragiquement quitter Paris en 1436, les rapports autres que les
altercations entre les soldats anglais et la population locale demeurent dans l’ensemble
plutôt rares, à cause de la « barrière de la langue » et de l’emplacement géographique des
propriétés accordées aux Anglais, situées dans les quartiers originellement occupés par les
Armagnacs230…
C) Régulation de la présence et de l’activité étrangère en Angleterre.
1) Les réactions anglaises face à la présence étrangère.
De même que les Anglais sont présents à l’étranger, les étrangers sont présents en
Angleterre. C’est ainsi que les Anglais, sans-même quitter le royaume, se retrouvent
nécessairement au contact de l’Etranger. De fait, les habitants des villes et villages situés sur
la route allant de Douvres à Londres, et bien-sûr les Londoniens eux-mêmes, ont souvent
l’occasion d’assister au passage des étrangers en visite et de leur suite. C’est ainsi le cas,
entre autres, lors de la visite particulièrement exotique de Manuel II, empereur de
Constantinople, en 1400-1401, accompagné de « mony grete lorde3 and kny3tes and moch
other peple of his cuntre »231, ou lors de la venue en Angleterre de Sigismond de
Luxembourg, sur laquelle nous reviendrons plus en détail par la suite. De même, les
Chroniques de Londres ne manquent jamais de signaler la présence d’ambassadeurs
étrangers dans la capitale, par exemple en 1431, alors que des ambassadeurs de France,
d’Espagne, et d’autres pays sont présents au Parlement : « And also to this parlement come
Frenssh lordes […] and ambassatours of Spayne, and other diuers lordes of dyuers landes »,
et que le roi reçoit la même année une ambassade bretonne et une ambassade
navarraise232. Même chose au parlement de 1437, où le chroniqueur relève la présence de
«many dyuers straungers, somme of Aragon in Spayne, somme of Spruce, somme of Beam,
and somme of Fraunce and Normandy »233. De plus, une anecdote rapportée de même dans
les Chroniques de Londres suggère que ces ambassadeurs ne reçoivent pas toujours bon
accueil, puisque certains Londoniens n’hésitent pas à s’en prendre à eux, malgré le sauf-
conduit royal dont ils bénéficient. C’est ainsi qu’en 1430, un aubergiste londonien, au terme
d’une dispute avec des ambassadeurs espagnols, blesse l’un d’entre eux au sang : « John
Ostillere, at the Crowne in Fanchirchestrete of London, debadet with the ambassitours of
Spayne, and rered blode of oon of theym »234 ! En sus des visites de princes étrangers et des
ambassades, les grandes joutes internationales organisées à Smithfield donnent également 229 Voir Guy Llewelyn Thompson, Paris and its People under English Rule, Oxford, 1991 (p.112-145). 230 Guy Llewellyn Thompson, op.cit. (p.206-240). 231 Brut, p.364. 232 Ibid, p. 465. 233 Ibid, p.471. 234 Ibid, p.456.
45
aux Londoniens l’occasion d’apercevoir des étrangers, par exemple en 1388, ou encore en
1403, alors que de nombreux chevaliers de Hainaut viennent se mesurer aux sujets du roi
d’Angleterre235.
Bien-entendu, les contacts avec l’étranger sont loin de se limiter à ces visites ponctuelles. En
effet, un certain nombre d’étrangers résident en Angleterre de manière permanente. De fait,
si les estimations de Sylvia Thrupp indiquaient que les étrangers ne devaient pas représenter
plus de 2 à 4 % de la population urbaine totale à Londres, ce chiffre a désormais été revu à la
hausse, pour suggérer un minimum de 6 %236. C’est ainsi qu’il existe à Londres des
communautés marchandes résidentes, parmi lesquelles figurent une communauté italienne,
et aussi une communauté de marchands hanséates, établie dans le Steelyard, Kontor de la
Hanse dans la capitale anglaise. Or, ces étrangers sont alors à Londres une présence très
familière, de telle sorte que Lydgate n’oublie pas de mentionner leur participation au
cortège londonien venu au-devant d’Henry VI lors de son Entrée, et dans lequel figurent des
Génois, des Florentins, des Vénitiens et des Hanséates : « And fforto remembre off other
alyens ; / First Ienewys, though they were straungers, / Florentynes and the Venycyens, /
And Esterlinges… » (v.43-46)237. De même, sans entrer ici dans le détail de leurs professions,
on trouve un nombre important d’artisans étrangers établis à Southwark, parmi lesquels
dominent les immigrés originaires de Flandre et des Pays-Bas. Or, il ne fait pas de doute que
leur présence est ressentie dans la capitale comme une menace économique sérieuse. En
témoigne ainsi une pétition présentée au parlement de 1414 par les Weavers de Londres,
qui se plaint que les tisserands étrangers, qui n’appartiennent pas à la guilde, « supplantent
et preignent les profitz qe les ditz suppliantz soloient avoir et prendre en la dite citee »,
avant de demander qu’ils soient soumis aux mêmes obligations que les natifs (« qe les ditz
wevers aliens soient desoutz les governances denizeins, et desouthe mesmes les
governances et correccions come les ditz wevers denizeins sont »)238.
De fait, il apparaît d’emblée que les rapports que les Anglais, et particulièrement les
Londoniens, entretiennent avec ces étrangers sont particulièrement houleux. En témoigne
une anecdote survenue en 1429, et ici encore rapportée dans les Chroniques de Londres, qui
raconte comment un « traître Breton » (« a fals Breton »), accusé d’avoir assassiné dans son
sommeil une veuve londonienne qui l’avait recueilli, afin de lui voler ses biens, et espérant
échapper au châtiment en prenant la croix et en s’engageant à quitter le royaume, est alors
235 Brut, p.343 et 369-370. 236 Voir The Alien Communities of London in the Fifteenth Century, Jim L. Bolton (ed.), Stamford, 1998 (p.8-9). De même, Sylvia L. Thrupp, dans son « Survey of the Alien Population of England in 1440 », in Speculum, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1957), p. 262-273, suggère qu’ils ne devaient pas même représenter 1% de la population totale du royaume. Sur la présence étrangère en Angleterre, on pourra aussi consulter le site England’s Immigrants (1330- 1550), animé par l’Université d’York, et disponible en ligne à cette adresse : http://www.englandsimmigrants.com/ 237 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.631-632. 238 PROME, parlement de novembre 1414, item 33.
46
intercepté par les femmes de la paroisse, qui lui jettent des excréments et des pierres, avant
de le battre à mort : « women of the same parish come oute to hym with stones & with
canell dong & there made an ende of hym in the high streit […] & on hym thei had neither
mercie nor pite ». Cet épisode apparaît alors révélateur des attitudes face à l’Etranger, de
même qu’il témoigne des réflexes communautaires des Londoniens239 ! Surtout, l’hostilité
face aux étrangers donne parfois lieu à de véritables explosions de violence collective,
comme en 1381, pendant la Peasants’ Revolt, alors que les Flamands sont victimes d’un
véritable pogrom qui coûte la vie à quarante d’entre eux240. Bien-entendu, la situation
politique de 1436 échauffe à nouveaux les esprits, et les Flamands vivant à Londres sont
alors victimes de nombreuses attaques, de telle sorte qu’ils s’empressent de renouveler leur
serment d’allégeance à Henry VI en échange de lettres de protection241. De même, les
maisons des Italiens sont pillées en 1456, à la suite de l’arrestation d’un jeune Londonien,
qui avait protesté en voyant un Italien portant une arme à sa ceinture dans les rues, et qui
lui avait alors brisé cette dernière sur la tête242 ! De plus, les étrangers sujets du roi
d’Angleterre se heurtent également à l’hostilité des Anglais, comme en témoigne une
pétition de 1411, émanant des réfugiés de Guyenne. En effet, ces derniers décrivent
comment, après avoir été forcés de quitter le duché à cause des « grauntz oppressiouns »
qu’ils ont endurées aux mains des adversaires français et pour ne pas avoir à renoncer à leur
allégeance envers leur suzerain, ils sont venus vivre dans le royaume d’Angleterre, s’y sont
mariés et y ont acquis des biens : « pluseurs a cause de ce se sount retraits en vostre roialme
d'Engleterre, et pluseurs autres y sont venuz demurer de leur bone gree, les quielx tant des
uns qe des autres se sont mariez en vostre dit roialme en pleuseurs bones villes, et autres
lieux d'icelluy; esquielx ils sont demurantz et habitantz come voz vrayes lieges et y ount
acquis par leur graund labour et travail pluseurs hostielx, terres, rendes, possessiones, et
revenues ». Or, malgré cela, ils sont victimes d’injures de la part des Anglais, qui les
considèrent comme des « intrus » et font fi de leur loyauté envers le roi : « Et soit ainsy qe
pleuseurs nés de vostre dit roialme par graund mespris lour font et dient de jour en jour
pleuseurs injures et villanies, come de les appeller alliants, et autres pleuseurs
inconvenients, les quielx injures leur sont faitz a tresgrant mespris de vostre dit paiis de
Guyene, et de la graund loialte qu'ilx ont toutditz envers vostre dite coroune », de même
qu’ils semblent remettre en question leur droit à jouir des biens qu’ils ont acquis en
Angleterre243.
239 Brut, p.442-443. Pour une analyse complète de l’épisode, voir Ralph A. Griffiths, « A Breton Spy in London, 1425-29 », in King and Country, op.cit., p.221-225. 240 Sur cet épisode, voir Erik Spindler, « Flemings in the Peasants’ Revolt, 1381 », in Contact and exchange in later medieval Europe: essays in honour of Malcolm Vale, Hannah Skoda, Patrick Lantschner, RLJ Shaw (eds.), Woodbridge, 2012, p. 59-78. 241 Voir par exemple Sylvia Thrupp, « A Survey of the Alien Population of England », op.cit. (p.265). 242 Voir Keith Dockray, « Patriotism, Pride and Paranoia : England and the English in the Fifteenth Century », in The Ricardian, vol.VIII, No.110, 1990 (septembre), p.430-442 (ici, p.436-437). 243 PROME, parlement de novembre 1411, item 22.
47
De fait, il n’est pas étonnant de constater que de nombreuses pétitions en Parlement
concernent la présence étrangère dans le royaume. En effet, les demandes d’expulsion y
sont récurrentes. Elles trouvent ainsi une formulation complète en 1404, sous le règne
d’Henry IV, alors que les parlementaires réclament que les étrangers d’obédience
avignonnaise quittent le royaume, mais aussi que les étrangers dits « Catholikes » soient
« assignez a demourer sur ascuns fronters en garnisons », et généralement, que tous les
étrangers « soient remoevez des hostielx du roy nostre seignur, et de ma treshonure dame
la roigne » ; de même, ils exigent l’expulsion des Ecossais qui refuseraient de prêter serment
d’allégeance au roi (« qe toutz autres Escotes qi ne veullent faire hommage liege au roy
nostre dit seignur soient removez »), et que le roi ne conserve aucun Gallois dans son
entourage (« Et qe nul Galoys soit demourant entour la persone du roy »)244. De même, une
pétition de 1413 se réclame des dispositions adoptées en 1404 pour demander le
« Remoevement » de tous les « aliens », auquel Henry V consent, en se réservant toutefois
le droit d’en exempter les étrangers de son choix (« sauvant a luy sa prerogatif, et q'il purra
dispenser ovesqe ceux queux luy plerra »)245. On retrouve cette même exigence plus loin, au
cours du même parlement, mais cette-fois limitée aux ennemis du roi d’Angleterre : « qe
toutz maners aliens neez d'autry ligeaunce, enemys a nostre seignur le roy et a son roiaume
d'Engleterre, de quel estat ou condicioun q'ils soient, soient nettement voidez hors du
roialme, sur peyne de vie et de membre »246.
De même, les demandes d’expulsion s’attachent parfois à des groupes particuliers. Sous le
règne d’Henry V, le premier groupe visé semble bien être celui des clercs et des religieux. En
effet, une pétition de 1413 vise à établir que les « aliene straungers shall not enjoye any
benefice wythin this realme », et aussi qu’ils seront expulsés (« deliverez et voidez ») du
royaume d’Angleterre. De plus, la pétition demande que, lorsque ces bénéfices deviennent
vacants du fait de la mort ou de la résignation de leurs titulaires, ces derniers soient
remplacés par d’ « honestes persones Englois »247… La question des bénéfices rejoint bien-
entendu celle des Alien Priories, soit des monastères qui ont leur maison-mère en France, et
sont donc ressentis en tant de guerre comme de véritables « corps étrangers ». De fait, on
trouve dans les Parliament Rolls, pour le règne d’Henry V, plusieurs pétitions concernant leur
dissolution au profit du roi d’Angleterre, ainsi que le remplacement de leurs membres par
des religieux anglais. C’est ainsi le cas en 1413, dans une pétition qui prévoit leur totale
expropriation, en excluant cependant les « priories aliens conventuelx enhabitez ovesqe
religeous Engloises », et dans laquelle Henry V prévoit le remplacement des prieurs
étrangers par des prieurs anglais : « qe apres la voidaunce des tielx priours aliens, soient faitz
priours Engloises covenables et honestes en lour lieus ».248 De même, une pétition de 1414
stipule que les biens confisqués ne seront pas rendus aux maisons-mères en France, mais
244 PROME, parlement de janvier 1404, items 26-29. 245 PROME, parlement de mai 1413, item 15. 246 Ibid, item 37. 247 PROME, parlement de mai 1413, item 32. 248 PROME, parlement de mai 1413, item 38.
48
conservés pour que les Anglais puissent célébrer le service divin mieux que les Français ne
l’ont fait avant eux : « al entent qe divines services […] purront pluis duement estre faitz par
gentz Englois en temps avenir, qe n'ont esté faitz avaunt ces heures […] par gentz
Fraunceys »249 ! Enfin, on trouve également une pétition individuelle émanant du Prieuré de
St-Neots, fille de l’Abbaye du Bec-Herlouin en Normandie, et qui réclame la confirmation des
lettres de denization qui lui ont été accordées par Henry IV (« vostre dit pier, graunta […] qe
les ditz priour et covent, et lour successours, delors soient denizeins, et come denizeins
neez, et denizeins founduz dedeinz le roialme d'Engleterre, soient reputez, tenuz, et
tretez ») à la condition que « nulle soit priour illoeqes, ne eslit priour de mesme le priorie, s'il
ne soit verroie Engleis, et nee dedeinz le roialme d'Engleterre »250.
Les Irlandais, pourtant sujets du roi d’Angleterre, sont également particulièrement visés,
dans la mesure où leur présence est perçue comme un facteur de désordre en Angleterre, de
même que leur absence d’Irlande met en danger la défense du pays251. On trouve ainsi une
première pétition en 1413, alors que les Irlandais, et particulièrement les clercs, sont
sommés de quitter le royaume « pur quieté et tranquilliée deins le roialme d'Engleterre, et
pur l'encrees et estuffement de la terre d'Irland », à l’exception toutefois de « ceux qi sount
graduates en les escoles, et sergeauntz et apprentices de ley, et ceux qi sount enheritez en
Engleterre, et relegiouses professes ». De même, tous ceux qui sont à la tête de bénéfices en
Irlande doivent y demeurer, sous peine qu’ils leur soient confisqués pour servir à la défense
du pays252. Même chose en 1422, alors que les Commons dénoncent les divers méfaits
commis par les étudiants irlandais d’Oxford, à la fois sujets du roi et « wylde Irisshmen », et
réclament alors que « toutz Irrois sont voidez hors de roialme », à l’exception de ceux
évoqués en 1413, mais aussi de ceux occupant des bénéfices en Angleterre, de ceux ayant
« piere ou miere Engloys », des habitants des villes et des bourgs anglais qui jouissent d’une
bonne réputation, ainsi que des Irlandaises et Irlandais ayant un conjoint anglais (« femmes
mariez as Englois, et auxi hommes Irrois mariez as femmes Englois, qi sont de bone
fame »)253. Cette exigence est ensuite rappelée l’année suivante, alors que les étudiants
irlandais souhaitant demeurer en Angleterre doivent faire parvenir à la chancellerie des
lettres émanant des autorités irlandaises, et « tesmoignauntz q'ils sount del obeisaunce du
roi »254. Enfin, une pétition de 1429 évoque les crimes commis par les étudiants irlandais,
mais aussi gallois et écossais à Cambridge et dans les comtés avoisinants, de telle sorte que
les parlementaires demandent que le chancelier de l’Université de Cambridge et les
responsables des différents collèges n’accueillent aucun étudiant de ces nationalités sans
obtenir au préalable des garanties de leur bonne conduite (« ne receivent mye ascun escoler
249 PROME, parlement d’avril 1414, item 21. 250 PROME, parlement de novembre 1414, item 25. 251 Voir Jim L. Bolton, « Irish migration to England in the late middle ages : the evidence of 1394 and 1440 », in Irish Historical Studies, vol.XXXII No.125, 2000 (mai), p.1-21. 252 PROME, parlement de mai 1413, item 39. 253 PROME, parlement de novembre 1422, item 43. 254 PROME, parlement d’octobre 1423, item 47.
49
d'Irelond, Escoce, ou de Gales, desore en avaunt en lour ditz collegis, hostelx ou sales,
avaunt q'ils eient trovez sufficiant suerté, devaunt le chaunceller de dit universite pur le
temps esteant, de son bone et pesible port, envers nostre seignur le roi et son poeple »)255.
De même, on trouve deux pétitions qui s’opposent à la présence de nombreux bretons dans
l’hôtel de Jeanne de Navarre, veuve du duc Jean IV, et remariée au roi d’Angleterre Henry IV
en 1403. C’est ainsi que les Commons réclament, en 1416, l’expulsion de tous les Bretons, et
en particulier de ceux « demurrantz entour la persone du roygne en soun hostiel, et ascunes
bien pres le dit hostiel ». Même chose dix ans plus tard, alors que les parlementaires
dénoncent le danger que représentent « les estraungers demurrantz en Engleterre ove la
Royne Johanne », et réclament leur expulsion rapide et définitive du royaume, de même
qu’ils ne pourront revenir sans autorisation spéciale de la part du roi (« qe les ditz
estraungers purront estre voidez hastement hors du roialme d'Engleterre, sanz retourner,
sanz coungé du roi »)256.
De même, les pétitions en Parlement visent parfois à clarifier le statut de certains étrangers.
C’est ainsi qu’une pétition de 1420 stipule que les femmes étrangères mariées à des Anglais
pourront jouir de leur douaire en Angleterre après la mort de leur époux, au même titre que
les Anglaises : « qe toutz maners femmes aliens, qe desore enavaunt serrount mariez as
hommes Engleis, par licence roiale, soient ablez a demaunder lour dowere, et estre dowez et
eient dowere apres la mort lour barons […] ; de toutz les manoirs, terres, tenementz,
seigneuries, fees, advousons et autres possessions qeconqes de lour ditz barons. En mesme
la manere come femmes Engleis, apres la mort lour barons, duissent estre endowez, par la
leye d'Engleterre »257. C’est ainsi qu’en 1421, on trouve une pétition émanant de Béatrice de
Portugal, fille illégitime de Joao I et veuve de Thomas, Earl d’Arundel, qui expose comment
les héritiers de son mari lui contestent la jouissance de son douaire, « allegeantz, qe la dite
suppliante n'est pas dowable, a cause q'ele fuist nee et engendree en la dite terre de
Portyngale », et qui demande alors au roi de bénéficier du même traitement que si « ele
eust estee nee et engendree vostre liege femme deinz vostre roialme d'Engleterre »258.
Surtout, cette clarification passe parfois par l’octroi de lettres de denization en bonne et due
forme, qui, comme nous l’avons vu plus haut, confèrent aux étrangers un statut égal à celui
des Anglais259. On trouve ainsi dans les Parliament Rolls plusieurs mentions de lettres de
denization, outre celles accordées aux Gallois que nous avons étudiées précédemment. De
fait, l’octroi de lettres de denization s’avère particulièrement nécessaire dans le cas des
« mariages mixtes », afin que le droit à l’héritage des enfants qui en sont issus ne puisse en
255 PROME, parlement de septembre 1429, item 58. 256 PROME, parlement de février 1426, item 33. 257 PROME, parlement de décembre 1420, item 26. 258 PROME, parlement de mai 1421, item 12. Sur la vie de Béatrice de Portugal et de sa suite en Angleterre, voir Anthony Goodman, « Before the Armada : England and Iberia in the Middle Ages », op.cit. (p.118). 259 Sur les lettres de denization, conservées dans les Calendar of Patent Rolls, voir le site England’s Immigrants, rubrique « Sources and Research », « Letters of Protection and Denization ».
50
aucune façon être remis en cause. C’est ainsi qu’en bénéficient les épouses étrangères des
princes de la Maison de Lancastre, soit, en 1423, Jacqueline de Bavière, épouse éphémère
d’Humphrey de Gloucester, qui réclame d’être « faite denzeisne, et que elle come denzeisne
et vostre liege femme, sibien deinz le roialme d'Engleterre, come aillours deinz voz poair et
seignurie, soit euz, tenuz, treatez et reputez »260, et Anne de Bourgogne, sœur de Philippe le
Bon mariée à John de Bedford : « Plese au roy […] graunter a vostre humble cousine Anne,
femme a vostre trescher uncle Johan duc de Bedford', qe ele soit faite denisine »261. De
même, des lettres de denization sont accordées en 1433 à la seconde épouse de Bedford,
Jacquette de Luxembourg, originaire du Hainaut, et qui devait ensuite passer le reste de ses
jours en Angleterre : « concessimus et licentiam dedimus, pro nobis et heredibus nostris,
quantum in nobis est, carissime amite nostre Jacobe de Luxembourg ducisse Bedford', in
partibus Hanonie oriunde, quod ipsa, et heredes sui, extunc sint indigene, ac tractati, tenti et
in omnibus reputati, sicut veri et fideles ligei nostri, infra regnum nostrum Anglie
oriundi »262. A un moindre échelon social, on trouve dans une pétition de la même année la
trace d’un « mariage mixte » célébré en Normandie entre un certain Thomas Gower et une
femme d’Alençon prénommée Jeanne, alors que le couple pétitionne pour obtenir la
denization de cette dernière : « […] supplie humblement Thomas Gower et Johan sa femme:
qe come la dit Johan, fuist nee en la ville de Alenceon, en le roialme de Fraunce, qe please a
voz tressagez discretions […] de grauntier par auctoritee de mesme le parliament, qe la dit
Johan, et touts ses enfaunts engendrez, et a engendrerz par le dit Thomas, purront estre
deinseinz, et estre treteez, tenuz et en toutz choses reputez, come verrais lieges de roy
nostre soverain seignur suisdit »263.
Surtout, si les lettres de denization sont une source importante pour connaître la présence
étrangère en Angleterre, la source majeure demeure bien les Subsidy Rolls264, soit le
recensement de l’ensemble de ceux qui sont soumis à « l’impôt sur les étrangers » (Alien
Subsidy) par décision du parlement de novembre 1439. En effet, ce parlement accorde au roi
la levée d’une Poll tax sur tous les étrangers résidant en Angleterre, à un taux différent selon
qu’ils sont « householders » (essentiellement des artisans et des commerçants) ou « non-
householders » (soit les serviteurs, les laboureurs et les journaliers), et exception faite des
Gallois, des étrangers ayant reçu des lettres de denization, des femmes étrangères mariées à
des Anglais ou à des Gallois (« women not Englissh borne, to eny Englissh men or Walshmen
wedded »), des membres des ordres religieux (« men of religions obediencers »), et des
enfants de moins de 12 ans (« children withynne the age of .xij. yere »)265. Cette taxe est
260 PROME, parlement d’octobre 1423, item 31. 261 PROME, Ibid, item 32. 262 PROME, parlement de juillet 1433, item 26. 263 PROME, Ibid, item 31. 264 A ce sujet, voir le site England’s Immigrants, rubrique « Sources and Research », « Alien Subsidies ». C’est également sur les Subsidy Rolls que se fondent les études de Sylvia Thrupp et de Jim L.Bolton évoquées ci-dessus. 265 PROME, parlement de novembre 1439, item 14.
51
ensuite reconduite en 1442, l’exemption étant alors étendue aux Irlandais et aux personnes
originaires des îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey (« men and wymmen borne
in Wales, in Irland, in the isles of Gersey and of Garnesey »)266, puis en 1449, alors qu’elle
inclut nouvellement les marchands étrangers (« every Venician, Italian, Januey, Florentyn,
Milener, Lucan, Cateloner, Albertyns, Lumbard, Hansers, Pruciers, beyng merchants or
factours, and all other merchants straungiers, borne oute of youre said lordshippes, duchies
and isles, and dwellyng within this youre royalme, or shall dwell duryng \þe said/ graunte ») et
leurs commis, et qu’elle exclut désormais l’ensemble des sujets du roi d’Angleterre, y
compris les personnes originaires des « duchies of Normandy, Gascoigne and Gyane », qui,
en raison de la situation militaire dramatique en France, font alors figure de réfugiés
politiques267, et encore en 1453, où les marchands étrangers sont bien davantage mis à
contribution268.
2) Régulation de l’activité marchande.
De même les activités des marchands étrangers en Angleterre font l’objet d’un contrôle
attentif, de telle sorte qu’il est courant de parler de mesures « mercantilistes » ou encore
« protectionnistes » pour la période. En effet, l’obsession du temps semble bien être le
principe selon lequel les marchands étrangers doivent être traités en Angleterre comme les
marchands anglais le sont à l’étranger. Cette idée est ainsi parfaitement exprimée dans une
pétition de 1416, qui demande « qe toutz les marchantz aliens, de quele estat ou condicion
q'ils soient, venantz, demurrantz, ou repairantz deins le roialme d'Engleterre, soient traitez
et demesnez deins mesme le roialme, en manere, forme, et condicion, come les marchantz
denizeins sont, ou serront traitez ou demesnez es parties depardela ». Or, cette pétition
expose également ce qui constitue le thème principal du contrôle de leurs activités, soit
l’obligation qui leur est faite de résider, pendant la durée de leur séjour, chez un « hôte »
anglais, chargé de contrôler leurs transactions269 (« q'en chescun citee, ville, et port du meer
d'Engleterre, ou les ditz marchantz aliens et estranges sont, ou serront repairantz, soient
assignez a mesmes les marchantz suffisantz hosties par les mairs, viscontz, ou baillifs des ditz
villes, et portz du meer ») et qui, pour sa peine, est autorisé à prélever une somme sur ces
dernières.270 La même exigence réapparaît en 1420 : « priont les ditz communes, qe toutz les
266 PROME, parlement de janvier 1442, item 7. 267 PROME, parlement de février 1449, item 14. 268 PROME, parlement de mars 1453, item 10. 269 Sur le Hosting System, on pourra consulter Montague S. Giuseppi, « Alien Merchants in England in the Fifteenth Century », in Transactions of the Royal Historical Society, New Series, Vol. 9 (1895), p. 75-98 ; Ralph Flenley, « London and Foreign Merchants in the Reign of Henry VI », in The English Historical Review, Vol. 25, No. 100 (Oct., 1910), p. 644-655 ; et Alwyn A. Ruddock, « Alien Hosting in Southampton in the Fifteenth Century », in The Economic History Review, Vol. 16, No. 1 (1946), p. 30-37. 270 PROME, parlement d’octobre 1416, item 29.
52
marchauntz estraungers repairauntz en Engleterre, soient misez a oste, accordant a
l'ordinaunce ent faite »271, et le système des hôtes est instauré la même année à Calais272.
De plus, une pétition de 1425 requière à nouveau l’application du Hosting System, alors que
les marchands étrangers débarquant en Angleterre doivent se placer sous la surveillance
d’un hôte sous quinze jours, et ne pas conclure de transaction entretemps (« That al the
merchantz straungers shalle be under hoost withynne .xv. dayes after thair commyng, and or
thay make any sale of thaire merchandise »), de même qu’elle impose à ces mêmes
marchands une limitation de leur durée de séjour dans le royaume, qui ne doit pas dépasser
les quarante jours à partir de l’installation chez l’hôte, après quoi leurs marchandises
invendues reviennent au roi d’Angleterre : « And þet alsoo that wyth inne .xl. dayes after
thay bee under hooste, the said merchantz straungers shall selle and emploie all \thaire/
merchandises. And all the said merchandises of the saide merchantz straungers that leven
unsoold, delivered and unemploied aftre þe .xl. daies forsaid, shall bee forfaited to oure said
soverayn lord the kyng »273.
Ces deux thématiques réapparaissent alors dans une pétition de 1427, qui évoque la
nécessité de l’application du Hosting System pour éviter les fraudes (« au fyn qe les ditz
estatutes serroient le mielx gardés, et nostre seignur le roi nient defraudés par icellez
merchauntes qi faire et conceler purroient qiqe voillent s'ils fuissent a lour hostage
demesné »), et qui ajoute que, si les marchands étrangers ne respectent pas les règles
imposées, ils seront soumis à l’amende et même emprisonnés : « adjoustant a icell estatut,
par l'assent et auctorite dessuisditz, q'en cas qe les ditz merchauntes aliens, \ne vendent/ lour
ditz merchaundises, deinz un quarter d'an, come devaunt est dit, ou q'ils demurgent en \ascuns/ autres lieux, qe ovec les ditz hostes eux ensi assigners, q'ils facent fyn et raunceon a
nostre seignur le roi, et eyent la prisonement d'un quarter d'an » ! De même, la pétition
cherche à imposer une autre contrainte aux marchands étrangers, qui, afin d’empêcher la
sortie du numéraire, sont forcés de dépenser l’argent de leurs transactions pour acheter des
marchandises anglaises, sous peine que cet argent ne leur soit confisqué : « qe la moneie qe
serroit deliverez pur eschaunge en Engletere, serroiet emploiez sur commoditees de mesme
le roialme, deinz icell roialme, sur peine de forfaiture d'icell moneie », de même qu’ils se
voient interdire de traiter avec un autre marchand étranger présent en Angleterre : « et qe
null merchant alien ne estraunge, vendroit null maner de merchandises a autre merchant
alien ne estraunge, sur peine de forfaiture de mesme le merchandise »274.
De même, une pétition de 1432 précise la peine d’emprisonnement encourue par les
marchands étrangers ne résidant pas chez un hôte anglais : « Et qe chescun merchant alien,
qi poet estre trouvé en ascun cite, bourgh ou ville deinz le dit roialme, qe ne soit soubz
271 PROME, parlement de décembre 1420, item 21. 272 PROME, Ibid, item 14. 273 PROME, parlement d’avril 1425, item 17. 274 PROME, parlement d’octobre 1427, item 31.
53
governaunce d'un sufficeant hoste Engloise, dedeinz quinze jours apres ceo q'il soit tielment
premunitz et garniz, ou requis de ceo fere, soit par son corps arrestuz et mys en prisone, pur
y demurrer saunz baille ou mainpris, jusqes a ceo q'il a trouve sufficeant seurte, d'estre
soubz governaunce d'un sufficeant host Engloise », et prévoit aussi des amendes pour les
maires, shérifs et baillis qui manqueraient à appliquer les sanctions qui s’imposent : « Et si
ascun maire, viscountz ou baillif, souffre ou laisse ascun merchant alien aler a large, a son
propre governaunce et volunte, saunz estre a sufficeant hoste Engloise, par manere come
dessuis, nient arrestuz ne mys en prisone, come dit est; il forfaira et paiera au roy nostre
seignur .lx.li., pur chescun merchant alien alant a large encountre le tenure d'icestes »275.
Bien-entendu, la plupart de ces thématiques sont également reprises et exploitées par
l’auteur du Libelle of Englyshe Polycye. C’est ainsi qu’il s’indigne du fait que les marchands
étrangers jouissent en Angleterre d’une liberté supérieure à celle des Anglais eux-mêmes,
alors que les Anglais sont pour leur part contraints de résider chez un hôte lorsqu’ils se
trouvent dans leurs pays : « What reason is it that wee schulde go to oste / In there cuntrees
and in this Englisshe coste / They schulde not so, but have more liberte / Than wee oure
selfe ? » (v.496-499). Il réclame alors que le Hosting System soit appliqué en Angleterre, ou
que les marchands anglais se voient accorder la même liberté à l’étranger : « Therefore lett
hem unto ooste go wyth us here, / Or be wee free wyth hem in like manere / In there
cuntres ; and if it woll not bee, / Compelle them unto ooste… » (v.506-509)276. Dans la même
optique, il évoque la fait que les marchands anglais qui participent aux grandes foires de
Brabant ne disposent que de quatorze jours pour vendre leurs marchandises, et de quatorze
jours encore pour acheter, de même que tout leur est confisqué s’ils dépassent ce délai
impératif : « Conseyve well here that Englyssh men at martes / Be discharged, for all her
craftes and artes, / In the Braban of all here marchaundy / In xiiij. dayes and ageyne hastely /
In the same dayes xiiij. Are charged efte. / And yf they byde lengere, alle is berefte : / Anone
they shulde forfet here godes all / Or marchaundy, it schulde no bettere fall » (v.512-519)277.
Or, le nombre-même des pétitions cherchant à imposer ces restrictions démontre la
difficulté de leur mise en application. C’est ainsi qu’une note marginale du Ms Laud 704 du
Libelle of Englyshe Polycye révèle que, depuis la rédaction du poème, la résidence chez un
hôte anglais a été rendue obligatoire… mais est constamment contournée par les marchands
étrangers, peut-être au moyen de la corruption: « But how this policie is subverted it is
mervelle to knowe be wyles and gyles »278. Bien-entendu, toutes ces exigences sont reprises
et amplifiées pendant le parlement de 1439, qui, avec l’instauration de l’Alien Subsidy
évoqué plus haut, semble bien correspondre à l’aboutissement du sentiment anti-étranger
en Angleterre. C’est ainsi qu’une pétition évoque alors les « graundes damages et perdes »
subies par le royaume du fait des activités des marchands étrangers, demande qu’il soit
275 PROME, parlement de mai 1432, item 32. 276 Libelle of Englyshe Polycye, p.26. 277 Ibid, p.26-27. 278 Ibid, p.26.
54
interdit aux marchands étrangers de commercer l’un avec l’autre, et qu’ils soient contraints
de se présenter sous trois jours aux autorités urbaines pour se voir assigner des hôtes, qui
doivent être « bonz et crediblez persons, natifs Englois ». De la même façon, toutes leurs
activités seront supervisées par ces hôtes, et ils devront acheter des marchandises anglaises
exclusivement avec l’argent gagné : «les merchaundises vendent pur autre merchaundises
du dit roialme, ou les vendent pur money, et ove mesme le money achatent deins le temps
suisdit autres merchaundises, cresceantz et faitz deins mesine le roialme ». Il leur est
accordé un délai de huit mois pour achever leurs transactions, après quoi ils pourront
toutefois remporter les marchandises invendues, qui leur seront cependant confisquées s’ils
essaient de les vendre au-delà des huit mois impartis. De même, la pétition rappelle la
sanction d’emprisonnement qui sera appliquée aux fraudeurs et les amendes que subiront
les autorités urbaines négligentes, mais innove également en soumettant les hôtes eux-
mêmes à un contrôle strict, signe évident de l’importance qu’on attache à leur fonction. De
fait, ils devront prêter serment devant les autorités urbaines, et seront punis en cas de
défaillance (« Et serra chescun tiel host, en sa primere admission all dit occupacion, jurrez
devaunt les mairs, viscountz et baillifs […] de bien et loialment user et excercer mesme
l'occupacion. Et s'il soit trove disloiall ou defectif a contrarie, q'il soit ousté de dit occupacion
par les ditz mairs, viscountz et baillifs […]. Et outre ceo punis soloncqe son demerite, par
discretions des mesmes les mairs, viscountz et baillifs »). De même, ils devront rendre
compte par écrit à l’Echiquier de toutes les transactions accomplies par le marchand
étranger dont ils auront eu la charge : « Et ferra chescun dez ditz hostes, register et escrier
en un livre de temps en temps, toutz lez ditz merchaundises, qe les ditz merchauntz aliens
averount et resceiverount, et toutz les vendes, achates, contractz et emploiementes, q'ils
ferront par son scieu et survieu, et le transcript portera ou ferra porter devaunt les tresorer
et barons de vestre escheker deux foitz par an ». Enfin, toute personne choisie pour être
hôte sera soumise à l’amende en cas de refus : « Et si ascun home, q'est par tiel maire,
viscount ou baillif, assigné pur estre host a ascun tiel merchaunt alien et estraunge, rufuse
d'estre tiel host, paiera a vous, chescun foitz q'il issint refuse d'estre host, .x.li. »279.
Les Anglais de la première moitié du XVe Siècle entretiennent donc avec les étrangers des
contacts multiples et soutenus, essentiellement marqués par l’hostilité de part et d’autre, et
qui viennent alors nourrir les réflexes communautaires. De même, il ne fait pas de doute que
ces contacts et pratiques « réels » viennent alimenter les représentations mentales de
l’Etranger.
279 PROME, parlement de novembre 1439, item 38.
55
II) Images mentales de l’Etranger.
A ) Les thèmes liés à la figure de l’Etranger.
1 ) Les contextes d’apparition de l’Etranger dans les textes : termes et concordances280.
Tout d’abord, il est possible d’analyser plus en détail, à l’aide de l’outil lexicométrique, ce
qu’on pourrait appeler les « mots de l’Etranger », soit les appellations servant à le désigner
dans les textes qui constituent notre corpus.
En effet, ce genre d’étude ne peut que se révéler riche d’enseignements, dans la mesure où
il permet, d’après Derek Pearsall, qui se livre à une réflexion comparable à partir des textes
de Chaucer, de mettre au jour une « architecture verbale de la xénophobie », ou « une
expression verbale du principe de la communauté », profondément « ancrées dans le
langage »281.
De fait, on remarque tout d’abord la fréquence assez élevée, dans notre corpus, du mot
« straunge », qui comptabilise en tout 23 occurrences. Or, ce dernier présente un intérêt
particulier dans le cadre d’une étude des représentations mentales. En effet, l’emploi de cet
adjectif dérivé de l’idée d’ « étrangeté » traduit d’emblée la volonté de poser l’Etranger
comme étant l’Autre, de même que l’adjectif « forein », avec seulement 2 occurrences dans
le corpus, traduit l’extériorité par rapport à la communauté. C’est ainsi que, sur les 23
occurrences totales relevées, 6 ne renvoient pas à l’Etranger lui-même, mais expriment
l’étrangeté : « straunge wise », « they make it nothing straunge », « straunge and
merveylouse », « gret merveilles and straunge aventures », « straunge and divers herbis »,
« straunge faculteez ». De plus, deux occurrences semblent témoigner d’une autre
connotation de « straunge », liant l’altérité à l’idée d’hostilité : l’adjectif sert ainsi à désigner
des dérèglements climatiques (« straunge wethirs » et « straunge menys ») à l’origine de
disettes.
L’emploi de « straunge », comme d’ailleurs celui d’ « estrange » dans les textes français
contemporains282, pour désigner l’Etranger, est ainsi lié, et ce dès son apparition, à un
certain nombre de représentations mentales. Par ailleurs, force est de constater que, ici
encore, l’adjectif ne renvoie pas toujours à l’Etranger au sens national du terme, mais peut
servir à désigner tout individu extérieur à un groupe, qu’il soit national, régional ou local, ou
280 Cette sous-partie repose essentiellement sur l’étude lexicométrique du corpus, et plus particulièrement sur l’analyse des concordances, telle que nous l’avons décrite en introduction. 281 Derek Pearsall, « Strangers in Late- Fourteenth-Century London », in The Stranger in Medieval Society, F.R.P. Akehurst et Stephanie Cain Van D’Elden (eds.), Minneapolis et Londres, 1997, p.46-62 (ici, p.46-48). 282 Pour une réflexion sur l’équivalent français, voir Laurence Moal, « Les peuples étrangers dans les chroniques bretonnes à la fin du Moyen Âge », in Revue historique, 2009/3 n° 651, p. 499-528 (ici, p.508-510).
56
même familial ou dynastique. De la même façon, lorsque Worcester évoque l’impossibilité,
pour un souverain, de transmettre ses domaines, qui sont « his propre enheritaunces », à
une « straunge parsone » sans l’assentiment de ses sujets283, l’introduction de « straunge »
ne renvoie sans-doute pas, ou du moins pas directement, à la nationalité du roi de France,
mais traduit bien littéralement l’idée d’ « aliénation » au profit d’une tierce personne.
Cependant, comme nous le verrons plus en détail par la suite, on ne saurait être aussi
catégorique au sujet de l’affirmation de Lydgate dans son Title and Pedigree of Henry VI,
selon laquelle l’accession du petit Henry VI au trône de France ne revient pas à « remettre le
couronne en des mains étrangères » (« the crowne to put in non hondis straunge »,
v.121)284, le poète semblant ici jouer subtilement sur le double sens d’aliénation dynastique
et d’aliénation nationale…
Cependant, dans la plupart des cas, le mot « straunge » est bien employé pour désigner
l’Etranger, associé à des termes géographiques (« countrees », « regions », « roiaumes »), ou
ethniques (« nacions », « tung »). Or, ces associations apparaissent riches d’enseignement au
niveau des représentations mentales. En effet, si Worcester, lorsqu’il évoque la situation des
soldats anglais mal-soldés en Normandie, dit bien qu’ils se sont retrouvés « empoverisshed
in straunge contreis »285, il semble plus haut établir à l’aide du même adjectif une distinction
entre les lointains territoires musulmans et les proches Etats d’Europe, distinction qui
semble motivée aussi bien par la distance géographique que par la distance culturelle et
religieuse, les « Sarrazyns » demeurant, tout au long de la période, l’Etranger par
excellence : « aswelle in straunge regions as among the Sarrazyns in the region of Sirie and
Turkie, as in the said neere regions of Fraunce, Spayne, Lumbardie, Spruce, and other
countrees »286. Parallèlement à l’adjectif, le nom commun « straungers » est aussi employé
pour désigner les hommes étrangers, puisque, sur un total de 5 occurrences, 4 renvoient à
l’Etranger par rapport à la communauté nationale, correspondant aux étrangers mentionnés
par Lydgate lors de l’entrée d’Henry VI287, ou, plus généralement, à l’ensemble des peuples
extérieurs au royaume et aux membres de ces peuples. C’est également dans cette mention
des « straungers » présents lors de l’entrée triomphale dans Londres que l’on trouve la seule
et unique occurrence dans le corpus du mot « alyens » (v.43), pourtant assez répandu en
Middle English, et qui, de manière très intéressante, semble traduire littéralement l’idée
d’exclusion. Enfin, ce tableau peut être complété par la seule et unique occurrence de
« foreyns », synonyme du substantif foreigners, qui ne se généralise qu’au XVe Siècle288, mais
qui, cependant, ne renvoie pas ici à l’Etranger à la communauté nationale, mais, dans le
cadre d’une allusion biblique, aux « foreyns that came frome Babylon » (Ballade to King
283 Boke of Noblesse, p.35. 284 Minor Poems of John Lydgate, vol. II, p.617. 285 Boke of Noblesse, p.72. 286 Ibid, p.43. 287 Minor Poems of John Lydgate, vol. II, p.631-632. 288 Pour les informations concernant les termes « alyens » et « foreyns », voir Derek Pearsall, op. cit. (p. 48).
57
Henry VI,v.88)289 soit à l’Etranger à la communauté religieuse, en l’occurrence
l’hérétique.
De même, si les appellations géographiques évoquées plus haut, auxquelles s’ajoute
également le mot « londes » sous ses différentes variantes, apparaissent généralement assez
neutres, les mots exprimant l’appartenance ethnique réclament sans-doute qu’on s’y
attarde plus longuement. Parmi ceux-ci, c’est sans conteste le mot « nacion » qui est utilisé
de manière préférentielle, comptabilisant pas moins de 15 occurrences au singulier et 11 au
pluriel, et couplé avec l’adjectif « straunge » à 5 reprises. De manière très intéressante, on
remarque également que, chez William Worcester, le mot « tong » (désignant bien-sûr la
langue parlée) fonctionne également comme un synonyme de « nacion » : « how that gret
chaunge of roiaumes and countreis frome one nacion to another straunge tong hathe
be »290, ce qui ne fait que confirmer le lien étroit qui existe, au Moyen Age, entre l’idiome
d’un peuple et son identité ethnique291. Enfin, cette dernière est, sans-surprise, associée à
l’idée de race, exprimée par le mot « bloode », qui, s’il renvoie parfois à l’appartenance
familiale ou dynastique, peut aussi désigner l’héritage ethnique de tout un peuple, et même
fonctionner comme un synonyme de « nacion ».
A partir de là, on peut tenter une classification des contextes d’apparition de l’Etranger dans
les textes, qui semble assez riche d’enseignements. Certes, certains de ces contextes
paraissent plutôt neutres. C’est par exemple le cas quand les auteurs posent l’Etranger en
modèle ou en contre-modèle, comme lorsque l’auteur du Libelle, dans le cadre de sa
démonstration de l’importance des marchands et de la flotte, développe l’exemple des
Danois « Whiche when they had here marchaundes destroyde, / To poverte they fell, thus
were they noyede, / And so they stonde at myscheffe at this daye », avant de conclure :
« Therefore beware […] of other mennys perylle »292. De même, William Worcester fait
figurer aux nombres des vertus du sénateur romain Fabius le fait qu’il « delited gretly to rede
actis and dedis of armes of straunge nacions, to have a parfiter remembraunce and
experience to rule a comon wele »293.
Plus encore, il arrive que les sources se fassent l’écho du souhait d’entretenir des relations
cordiales et pacifiques avec l’Etranger. C’est ainsi que, d’après Lydgate, Henry VI se voit
promettre, lors de son Entrée dans Londres, à la fois l’amour de ses sujets et la « faveur » de
tous les étrangers (« ‘Love off his peple, ffauour off alle straungers », v.447)294. Surtout,
L’Etranger revêt également à plusieurs reprises le visage positif de l’allié. C’est ainsi que
289 Minor Poems of John Lydgate, vol. II, p.628. 290 Boke of Noblesse, p.51. Cette équivalence apparaît également en latin dans les notes marginales de l’auteur, p.2 : « lingua Danorum ex nacione Grecorum ». 291 Sur le lien étroit qui existe au Moyen Age entre la langue et l’appartenance ethnique, voir Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe Siècles, Les Etats, Paris, 1998 [1971] (p.117-119). 292 Libelle of Englyshe Polycye, p.25. 293 Boke of Noblesse, p.59. 294 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.645.
58
William Worcester, qui estime à leur juste valeur les alliances étrangères conclues sous le
règne d’Edward III, et par Henry V et Bedford, n’hésite pas à faire du renouvellement de ces
alliances le remède miracle aux revers anglais en France : « For one good moyen […] may be
this, and if youre lordis wolde enforce hem to renew theire olde alliez of straunge regions
and countrees », as […] of late daies king Edwarde the thrid gafe example and sithe king
Harry the .vte. In oure daies, and also his noble brothir Johan duke of Bedford after hym ».
Pour ce faire, il fixe à ses compatriotes un programme consistant à conclure des mariages
dynastiques, à envoyer des ambassades, à « chérir » les nobles et les marchands des régions
alliées, et à honorer les princes dont on recherche l’alliance…Ce développement est alors
renforcé par une note marginale latine, qui n’aurait pas nécessairement suscité
l’enthousiasme de tous les contemporains : « Nota et concidera ad honorandum
extraneos ». Il ne fait pas de doute dans l’esprit de l’auteur que les alliés s’appliqueraient
alors « withe alle hir power and might » à redresser la situation en France295…
De fait, les sources anglaises prennent souvent soin de distinguer entre les « alien friends »,
clairement rangés du côté des « wel-wyllynge »296 et « wellewilleris »297 du roi d’Angleterre,
et les « alien enemies »298. C’est ainsi que, dans une logique très proche de celle que nous
venons de décrire pour le Boke of Noblesse, le discours d’ouverture du Parlement en mai
1413 met à l’ordre du jour, entre autres, la « bone et sufficeant ordinance […] pur cherier les
estrangiers ses amys, et outre ce de faire resistence encontre ses enemys dehors le
roialme »299.
Cependant, force est de constater que, dans nos textes, l’Etranger revêt bien plus souvent le
visage de l’adversaire que celui de l’allié. Cette identification de l’Etranger à la figure de
l’ennemi, sans-doute influencée par la tradition chrétienne, pour laquelle l’Ennemi par
excellence n’est autre que le Diable300, reçoit même une expression concrète dans le cadre
du poème de Lydgate sur l’Entrée d’Henry VI à Londres, puisque le géant qui se tient à
l’entrée de London Bridge est là, nous dit le poète, « pour éloigner du roi tous les ennemis
étrangers » (« Alle fforeyn enmyes ffrom the Kyng to enchace », v.77)301, et également dans
une pétition concernant les attaques sur la Severn, où il est dit que les gens des franchises
de Bledisloe et Westbury ont agi « with greete ryot and strengthe in maner of werre, as
enemys of a straunge lande »302. De plus, il est intéressant, dans cette optique, de comparer
les occurrences et les emplois respectifs de « frendes » (synonyme d’ « alliés ») et
« enmyes », « adversaries » et « foo » dans le corpus. Premièrement, si l’on trouve en-tout
295 Boke of Noblesse, p.49. 296 The Agincourt Carol, v.22, Historical Poems, p.92. 297 Boke of Noblesse, p.6. 298 Ralph A. Griffiths, « The English Realm and Dominions and the King’s Subjects in the Later Middle Ages », in King and Country, op.cit., p.33-54 (ici, p.39). 299 PROME, parlement de mai 1413, item 2. 300 Laurence Moal, « Les peuples étrangers… », op.cit. (p.509). 301 Minor Poems of John Lydgate, vol. II, p. 633. 302 PROME, parlement de septembre 1429, item 30.
59
18 occurrences de « frende », au singulier et au pluriel, on remarque rapidement qu’elles ne
renvoient pas toutes à des alliés effectifs. C’est ainsi que, à plusieurs reprises, l’auteur du
Libelle emploie « frendes » pour exprimer la nécessité de « transformer » les ennemis en
amis, en les soumettant, comme en témoigne ces quelques vers, particulièrement agressifs :
« Wee shulde hem stoppe and wee shulde hem destroy, / As prysoners wee shulde hem
brynge to noy. / And so wee shulde of oure cruell enmysse / Maken oure frendes for fere of
marchaundysse »303. Parmi les occurrences de « frendes », on distingue de plus une autre
thématique, particulièrement intéressante, et qui traduit le malaise profond des
contemporains face à l’Etranger : celle des « feyned frendes »304… Inversement, les 44 ( ! )
occurrences de « enmyes », sous ses différentes formes, sont généralement sans ambiguïté,
et sont de plus, à deux reprises, associées à l’adjectif « cruell », il en est de même pour le
terme « adversarie » chez Worcester, avec 23 occurrences au singulier et 30 au pluriel, et
pour les 10 occurrences de « foo », une fois décrit comme « evil-wylled » (Libelle, v.1071)305.
2 ) L’Etranger : une menace pour la communauté anglaise.
De même que l’étude des mots montre bien qu’il existe une association d’idées dominante
entre les figures de l’Etranger et de l’ennemi, on constate que l’Etranger, quel qu’il soit, est
toujours décrit comme un individu malintentionné. La première thématique qui ressort, à
cet égard, est celle de l’Etranger comme espion. En effet, c’est cette dernière qui justifie la
plupart des demandes formulées contre les étrangers en parlement évoquées plus haut.
C’est ainsi qu’en 1404, les Commons, réclamant l’expulsion des étrangers schismatiques,
invoquent également « les perils qe purroient advenir s'ils ferroient certifier par lettres ou
autrement a les enemys pardelea l'estat \du/ roialme, et le conseil et secretz d'icelle », et
enchaînent sur la nécessité « qe les Escotes prisoners soient gardez come prisoners, sanz
aler a large pur veier la governance du roialme »306. Même discours en 1413, alors que les
Français obtenant des lettres de denization pour occuper des bénéfices en Angleterre en
profitent pour informer leurs compatriotes (« le counseille du roiaume discoveront a noz ditz
enemys de Fraunce; a graund damage al roialme »)307. De même, c’est ce portrait de
l’Etranger comme espion qui est à l’œuvre dans le cas des archevêques et évêques d’origine
celte qui, du fait de leur statut, « sount peers de les parlement et counsailles » tenus en
Irlande, et amènent avec eux des serviteurs irlandais, qui s’empressent alors de faire part de
ce qu’il ont appris à leur peuple (« issint le feblenez, les privetés, et meschiefs des ditz lieges
par eux conuz, et as ditz enemys discoverez)308. Même discours pour les Bretons qui sont
accusés, en 1416, de ne résider en Angleterre que « pur oier, savoir, et entendre les secretes
du roialme, et les discoverer as Bretons, qe sount les greindres enemyes de vostre
303 Libelle of Englyshe Polycye, p.30. 304 Ibid, p.32. 305 Ibid, p.54. 306 PROME, parlement de janvier 1404, items 26 et 28. 307 PROME, parlement de mai 1413, item 32. 308 PROME, parlement d’octobre 1416, item 21.
60
roialme »309, accusation à nouveau formulée dix ans plus tard : « les quelles estraungers
discoverent le counseill du roi, a ses enemyes depar la »310.
De plus, à cet espionnage politique vient s’ajouter un espionnage de type économique,
exprimé de manière frappante dans les pétitions concernant les « Brokers » étrangers en
Angleterre, originaires de « diverses nations ». En effet, ces derniers, individus louches par
excellence puisque souvent bannis de leurs pays d’origine pour leurs actions malhonnêtes
(« of whiche many been banned in her owen lond for falshede »), non contents de nuire aux
marchands anglais par leurs activités usuraires, révèlent les besoins économiques du
royaume aux marchands étrangers, envers qui ils sont nécessairement favorablement
disposés, au détriment des Anglais : « þurgh the grete sotiltee and disceite of soche brocours
aliens, þat been nowe so prive and expert of merchandises, where of the roialme hath
haboundaunce and necessite, and þerewith so favorably and enclynyng to the profite of
merchantz aliens, þat þei discoveren to hem all the privetee of merchandises of þis roialme
and hem enducen and enfourmen all the weys and menes by the whiche þei mowe
enhaunce þe prises of her merchandises »311.
De la même façon, l’espionnage à la fois politique et économique par l’Etranger fait l’objet
d’un développement de la part de l’auteur du Libelle, particulièrement en lien avec les
activités des Italiens, lorsque, dénonçant le danger qu’ils représentent pour les Anglais
(« What harme, what hurte and what hinderaunce / Is done to us unto oure gret grevaunce /
Of suche londes and of suche nacions », v.386-388), il explique que ces étrangers, non
contents de se livrer à un espionnage économique et aussi politique en révélant les plans de
l’Angleterre dans leur correspondance (« By wretynge ar discured oure counsayles », v.390),
s’attachent aussi apparemment à induire les Anglais en erreur en ce qui concerne les plans
de leurs ennemis (« And false coloured alwey the countertayles / Of oure enmyes », v.391-
392). Sous couleur de leurs activités marchandes (« And alle this is colowred by
marchaundye », v.395), les étrangers visent donc en fait à nuire « Unto oure goodes, oure
realme and to the kynge » (v.393)312 !
Cependant, si le « péril étranger » est essentiellement associé à cette assimilation avec la
figure de l’espion, la présence et les activités de l’Etranger représentent également, plus
généralement, une menace économique. Leur présence au sein de l’hôtel royal est ainsi
considérée, en 1404, comme un facteur de dépense superflue : « et qe l'oustiel de nostre dit
seignur le roy ne feusse chargez ovesqe tielx estrangers, mais qe ycel houstelle purroit estre
mys en bone et moderate governance, dont les costages purroient estre supportez des
revenues de roialme, ovesqe autres charges necessaires »313. Surtout, les étrangers sont
tenus responsables de l’appauvrissement du pays, qu’ils poursuivent volontairement en
309 PROME, parlement de mars 1416, item 32. 310 PROME, parlement de février 1426, item 33. 311 PROME, parlement de juillet 1433, item 51. Voir aussi janvier 1442, item 27. 312 Libelle of Englyshe Polycye, p.20-21. 313 PROME, parlement de janvier 1404, item 27.
61
emportant les richesses hors du royaume. C’est en effet le cas pour les Bretons, qui sont
aussi accusés, dans la pétition de 1416 évoquée ci-dessus, de résider en Angleterre « pur
l'emportier les money et joialx hors du dite roialme, en graund prejudice du roy, et graund
damage a tout le roialme », de même que celle de 1426 affirme à nouveau qu’« ils
mandount et portount graunt tresour d'ore et d'argent hors du roialme d'Engleterre »314.
Cette thématique, ici attachée aux étrangers lorsqu’ils résident en Angleterre, constitue
aussi, comme nous l’avons vu plus haut, un élément essentiel dans le contrôle des activités
des marchands étrangers dans le royaume. Or, si cet élément apparaît avant tout fondé sur
des arguments techniques en adéquation avec la situation économique contemporaine, on
ne peut douter qu’il influe également sur les images mentales attachées à la figure de
l’Etranger. C’est le cas, en effet, dans une pétition présentée en Parlement en 1455 par les
ouvrières londoniennes travaillant la soie (« Silke wemen »), se plaignant des « divers
lombardes and other aliens estraungers », qui importent en Angleterre des articles finis dans
le but de détruire l’industrie londonienne au profit des étrangers, et qui privent du même
coup les femmes de Londres d’une occupation vertueuse ( « ymagenyng to destroye þe
same craftes, and all such vertueux occupacions for wymmen within þis lande, to thentent to
enriche them self and put such occupacions to oþer landes »), exposant ces dernières à une
menace à la fois économique et morale puisqu’elles risquent alors de tomber dans l’oisiveté
(« grete ydelnes »)315. De même, cette image mentale de l’Etranger qui draine
volontairement les ressources économiques de l’Angleterre reçoit une expression
particulièrement imagée de la part de l’auteur du Libelle qui, dans un passage consacré aux
activités frauduleuses des marchands de Venise et de Florence, emploie une métaphore
animalière particulièrement originale pour décrire les marchands étrangers, qui, prenant l’or
des mains des Anglais, sont semblables, du fait de leur attitude prédatrice, à la guêpe qui
vient butiner le miel dans la ruche de l’abeille ( ! ) : « Also they bere the golde oute of thys
londe / And souke the thryfte awey oute of oure honde ; / As the waffore soukethe honye
fro the bee, / So mynuceth oure commodite » (v.396-399)316.
De la même façon, la fausseté et les mauvaises intentions de l’Etranger se manifestent
clairement par son association à la fraude économique, même s’il est vrai que cette dernière
semble ici s’appuyer sur des pratiques effectives. En témoigne ainsi la description par
l’auteur du Libelle des pratiques particulièrement élaborées et complexes des Vénitiens et
Florentins, qui semblent avoir pour habitude d’acheter de la laine dans les Cotswolds à
crédit, avant de la vendre à Venise, et d’emmener l’argent ainsi gagné en Flandre, où ils s’en
servent pour faire des prêts usuraires aux Anglais ! (« whan they this money have, / They
wyll it profre […] / To Englysshe marchaundis to yeve it oute by eschaunge », v.410-412)317.
De même, ils font du tort à ces derniers (« made us a baleys », v.434) en usant des mêmes
pratiques en « empruntant » de la laine au Staple de Calais, qu’ils vendent ensuite pour
314 PROME, parlement de mars 1416, item 32 et parlement de février 1426, item 33. 315 PROME, parlement de juillet 1455, item 55. 316 Libelle of Englyshe Polycye, p.21. 317 Ibid, p.22.
62
argent comptant à Bruges, où ils vivent tranquillement des revenus usuraires jusqu’au jour
du paiement de la dette, renouvelant ensuite l’opération autant de fois qu’ils le souhaitent
(« Than whan thys payment of a thowsande pounde / Was welle contente, they shulde have
chaffare sounde / Yff they wolde fro the staple at the full / Reseyve ageyne ther thousande
pounde in woll, v.448-451)318. L’auteur, dans les manuscrits de la seconde version, peut alors
exprimer son sentiment face à ces pratiques frauduleuses au moyen d’une expression
décrite comme extrêmement familière, mais néanmoins vraie (« Thow this proverbe be
homly and undew, / Yet be liklynesse it is for soth trew »), selon laquelle les étrangers visent
à « essuyer le nez des Anglais avec leur propre manche » ! (« And thus they wolde, if ye will
so beleve, / Wypen our nose with our owne sleve »)319. De même, il arrive que les étrangers
se liguent contre les intérêts anglais. C’est ainsi qu’une pétition présentée en Parlement en
1435 expose comment « les aliens del amistee le roi nostre soverain seignur, frettent et
chargent les niefs, et autres vesselx des enemyes […] d'Espayne et autres », et, au cas où les
Anglais s’en emparent sur mer, réclament ces biens comme étant les leurs « par colour de
faux chartres, doubles lettres, merches countrefaites, et faux testemoignes de lour nation »,
ce qui remet en cause le droit de prise des Anglais et provoque leur découragement320.
Mêmes arguments dans le Libelle, où cette pratique, dite des « maynteners and excusers »,
fait que les succès anglais profitent finalement à leurs ennemis (« Wee have the strokes and
enmyes have the wynnynge », v.650), de telle sorte que ceux qui ont pris des risques afin de
purger la mer « Schalbe sone oute of wynnynge al for mede / And lese here costes and
brought to poverte, / That they shall nevere have luste to go to see » (v.635-637), de même
qu’elle brouille dangereusement les notions d’ « alliés » et d’ « ennemis » : « frendes shuld
frome enmyes well be knowe, / Oure enmyes taken and oure frendes spared »(v.645-
646)321.
Enfin, de manière générale, l’Etranger est souvent associé au risque de destruction générale
du peuple anglais. De fait, comme nous l’avons vu précédemment, cette thématique est
sans-cesse reprise dans les pétitions en Parlement qui traitent des rapports avec les
étrangers, que ce soit à la frontière, sur la mer ou pour les immigrés anglais au pays de
Galles et en Irlande. De même, c’est bien cette idée qui est à l’œuvre dans les
communications politiques émanant d’Edward I et d’Edward III et reprises par leurs
successeurs, que nous avons déjà évoquées en introduction, et qui lient la menace de
l’invasion française à celle de l’anéantissement de la langue anglaise. En effet, la formulation
choisie en 1295 par Edward I, selon laquelle Philippe IV souhaite « éradiquer la langue
anglaise de la terre entière » (« linguam anglicam […] omnino de terra delere »)322,
démontre très clairement qu’ici, en conformité avec les observations qui précèdent sur
l’emploi du mot « tung » dans le Boke of Noblesse, la « lingua anglica » désigne avant tout
318 Libelle of Englyshe Polycye, p.23. 319 Ibid, p.24. 320 PROME, parlement d’octobre 1435, item 24. 321 Libelle of Englyshe Polycye, p.33. 322 Voir Christopher Fletcher, « Langue et nation en Angleterre au Moyen Age », op.cit. (p.241).
63
les gens qui parlent cette langue, et donc l’ensemble du peuple anglais, sur lequel porte
précisément la menace de destruction.
De manière très intéressante, on retrouve à notre période cette même menace, formulée de
manière proche ou identique, dans deux pétitions présentées en Parlement. La première,
qui date de 1414 et fait référence à l’ Epiphany Rising de 1400, tentative de renversement
d’Henry IV menée, entre autres, par John Montagu, Earl de Salisbury, y a en effet recours
pour décrire la trahison suprême dont les rebelles se sont rendus coupables, en projetant
l’assassinat du roi et de ses lords, mais aussi en prévoyant, du fait de leur prétendue
collusion avec les étrangers, de peupler (« enhabiter ») le royaume « de gentes d'autre
lange »323. La seconde, quant à elle, renvoie à la rébellion d’Owen Glyndwr, décrite comme
visant non seulement la destruction du roi Henry IV, celle de son fils le futur Henry V et
généralement de toutes les « braunches of the stok riall » et de tous les « lordes and gentils
of this noble roialme », mais aussi, finalement, celle de toute la « langue » anglaise, et ce
pour toujours ( « distruction of all Englissh tonge for evermore »)324.
3) Le « bon » et le « mauvais » Etranger : les figures opposées de l’Empereur Sigismond et de
Philippe le Bon.
L’Empereur Sigismond.
Le cas de deux figures individuelles de princes étrangers, d’une part l’Empereur Sigismond,
et de l’autre, le duc de Bourgogne Philippe le Bon, mérite sans-doute d’être analysé ici en
détail, leurs portraits respectifs permettant de mieux cerner l’idée que les Anglais du XVe
Siècle se font du « bon » et du « mauvais » Etranger. Bien-entendu, on pourrait objecter à ce
développement que les portraits qui sont faits de ces deux personnages sont très largement
dépendants de la contingence politique du temps : Sigismond incarne ainsi la figure de l’allié,
alors que Philippe le Bon, passé de l’alliance anglaise à l’alliance de Charles VII, incarne celle
du traître. Cependant, les références constantes aux attitudes de ces deux princes face à la
communauté anglaise nous paraissent justifier la démonstration que nous nous proposons
d’entreprendre ici.
Force est de constater, en corrélation d’ailleurs avec le développement qui précède, que les
figures positives d’étrangers, dont les actions témoignent de leur bienveillance envers le
peuple anglais, sont assez rares dans les textes. On pourrait ainsi mentionner, dans le Brut, la
note rapide consacrée à la venue en Angleterre du « Prince of Portyngale », Pierre de
Coïmbre, qui reçoit la Jarretière, et qui, surtout, joue le rôle de pacificateur entre Humphrey
de Gloucester et son rival Henry Beaufort : « the Prince of Portyngale, beyng that tyme in
Englond, labourt so betwene hem, as God wold, to kepe the pees »325, ou encore, dans le
Boke of Noblesse, l’évocation de Gilles de Bretagne, « that noble and trew knight Gilis the
323 PROME, parlement d’avril 1414, item 12. 324 PROME, parlement de janvier 1431, item 32. 325 Brut, p.567-568.
64
Duke is son of Bretaine », à qui son amitié pour l’Angleterre (« his grete trouthe and love he
hadde to this youre Royaume warde ») coûte finalement la vie326. Cependant, aucun autre
allié étranger ne fait l’objet d’un éloge comparable à celui qui est consacré, dans les sources,
à Sigismond de Luxembourg. Un aspect essentiel de cet éloge se concentre sur la lutte de
Sigismond contre l’hérésie hussite, qui permet de tracer un parallèle flatteur avec celle que
mène Henry V contre les Lollards à la même époque. C’est en effet cet élément qui
prédomine lorsque Lydgate propose conjointement Henry V et Sigismond comme modèles à
Henry VI, en tant que défenseurs de la Foi, d’abord dans la Ballade qu’il adresse à son jeune
souverain à l’occasion de son couronnement de 1429 : « And that thou mayst beo
resemblable founde / Heretykes and Lollardes for to oppresse, / Lych themperour, worthy
Sygesmound, / And as thy fader, floure of hye prowesse » (v.81-84)327, et à nouveau dans les
Sotelties mises en scènes pour son banquet de couronnement : « Ageinst miscreauntes
themperour Sigismound / Hath shewid his myght which is imperial ; / Sithen Henry the Vth
so noble a knyght was founde / For Cristes cause in actis martial ; / Cherisshyng the Chirch
Lollardes had a falle » (v.9-13)328.
Cependant, c’est surtout par sa visite en Angleterre en 1416, pendant laquelle il devient
l’allié d’Henry V, que Sigismond laisse aux Anglais un souvenir durable et profondément
positif329. Il ne fait pas de doute, premièrement, que les Anglais sont sensibles à l’honneur
que constitue sa venue. De fait, si le roi d’Angleterre a pu saisir l’occasion pour réaffirmer
haut et fort l’indépendance de son royaume vis-à-vis de l’Empire, la légende voulant que
plusieurs nobles anglais, menés par Humphrey de Gloucester, soient entrés dans l’eau à
l’approche du navire de Sigismond pour exiger la garantie qu’il ne chercherait pas à remettre
en cause la souveraineté du roi d’Angleterre330, il est révélateur que la totalité des sources
anglaises s’accordent à antidater à dessein l’accession officielle de Sigismond à la tête du
Saint Empire Romain Germanique, survenue en 1433 seulement, pour faire de sa venue en
Angleterre quatorze ans auparavant une visite proprement impériale331, alors que Sigismond
était à cette époque roi de Hongrie et de Croatie, et roi des Romains. C’est ainsi que le Brut
fait état de la venue en Angleterre et à Londres de l’ « Emperour of Almayne, King of Rome &
of Hungary »332, simplement décrit, dans le manuscrit des Chroniques de Londres édité par
Brie, par son titre impérial : « Segewyn, the Emperoure of Almayn »333. Même chose dans le
Libelle of Englyshe Polycye, qui évoque « Sigesmonde the grete Emperoure, / […] whan he
326 Boke of Noblesse, p.5. 327 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.627. 328 Ibid, p.623-624. 329 Sur cette visite et la vision de Sigismond en Angleterre, on pourra surtout se référer à l’article de Norman Simms, « The Visit of King Sigismund to England, 1416 », in Hungarian Studies Review, Vol. XVII, No. 2, automne 1990, p.21-29. 330 Voir Ibid, p.22. 331 Ibid, p.23. 332 Brut, p.380. 333 Ibid, p.558.
65
was in this londe » (v.7-8)334, et aussi dans le Boke of Noblesse, où Worcester fait encore
référence, certes incidemment, à cette visite, plus de cinquante ans après les faits, en
mentionnant la présence à Londres de Thomas Beaufort, capitaine d’Harfleur, à l’occasion
de la venue de Sigismond (« the seyd erle Dorset then beyng yn England at the Emperour
comyng hedre, called Sygemondus »)335.
Cependant, l’honneur de cette visite impériale n’explique pas à elle seule le portrait
extrêmement positif que les sources dressent de Sigismond. En effet, les contemporains
semblent surtout avoir été flattés et enthousiasmés par la bienveillance témoignée par
Sigismond au peuple anglais. Tout d’abord, le récit que le Brut consacre à l’arrivée de
Sigismond en Angleterre et à sa rencontre avec Henry V fait état de relations
particulièrement cordiales entre les deux souverains, situés sur un pied d’égalité : « And
there was a worthi metyng betwene the Emperour and the King ; & there thay kussid
togadre3, & braced ech othir ; and than the King toke the Emperour be the hande »336. De
plus, les sources tendent à nous présenter un étranger qui, pendant sa visite et au-delà,
participe pleinement des modèles nationaux anglais. De fait, le Brut mentionne son
admission, avant son départ d’Angleterre, au sein de l’Ordre de la Jarretière, dont il reçoit et
porte le costume : « but ere he went he was made Kny3t of the Gartir, & resceyved and
weryd the lyuerey »337. Or, par la suite, Sigismond devait porter l’insigne de l’Ordre lors de
toutes les cérémonies officielles, comme au Concile de Constance, pour signifier aux yeux de
tous la réalité de son alliance avec l’Angleterre338. De fait, cette appartenance affichée de
Sigismond à l’Ordre national flatte sans aucun doute l’orgueil anglais, au point d’être mise en
scène lors du banquet de couronnement d’Henry VI dans le tableau évoqué plus haut, qui
montre Sigismond et Henry V, portant tous deux le costume de l’Ordre : « A sotelte,
themperour and the kyng that ded is, armed, and here mantelles of the garters »339.
Surtout, la bienveillance de Sigismond envers la nation anglaise fait l’objet d’un
développement original dans le Libelle, dont l’auteur, tirant peut-être ses informations du
témoignage de Walter Hungerford, proche d’Henry V, raconte la discussion que Sigismond
aurait eue avec ce dernier concernant la nécessité de bien garder Calais, et la relate de plus
au discours direct. C’est ainsi qu’on apprend que le roi des Romains, ayant identifié Calais,
où il avait embarqué pour l’Angleterre, comme la plus précieuse des possessions anglaises et
comme un « joyau » (« the emperoure Sigesmounde, / […] of all joyes made it one the moste
/ That Calais was soget unto Englyssh coste. / Hym thought it was a jewel moste of alle, /
334 Libelle of Englyshe Polycye, p.2. 335 Boke of Noblesse, p.16. 336 Brut, p.381. 337 Ibid. 338 Voir Norman Simms, op.cit. (p.23). Pour le soutien de Sigismond à la délégation anglaise à Constance, voir Louise R. Loomis, « Nationality at the Council of Constance: An Anglo-French Dispute », op.cit. 339 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.623.
66
And so in latyn did it calle », v. 829-833)340, s’adresse à Henry V en « frère » et en égal pour
lui donner le plus précieux des conseils, celui de s’attacher à conserver Calais et Douvres
comme la prunelle de ses yeux, à la fois pour recouvrer ses droits en France et pour s’assurer
le contrôle de la Manche : «And to the kynge thus he seyde, ‘My brothere », / Whan he
perceyved too townes, Calys and Dovere, / ‘Of alle youre townes to chese of one and other /
[…]To kepe the see and sone for to come overe, / To werre oughtwardes and youre regne to
recovere, / Kepe these too townes sure to youre mageste / As youre tweyne eyne to kepe
the narowe see’ » (v.15-21)341. Il est donc très intéressant de constater que l’auteur du
Libelle, prompt à dénoncer les mauvaises intentions de l’Etranger, fait une exception pour le
bienveillant Sigismond, dont il n’hésite pas à faire le porte-parole de la politique nationale
qu’il préconise, et qui consiste à assurer « profete […] worshype and salvacione to Englande
and to alle Englyshe menne »342 !
Enfin, les sources transmettent l’impression, de manière générale, de ce que l’on pourrait
appeler un « coup-de-foudre » réciproque entre Sigismond et le peuple anglais. En témoigne
ainsi un passage de la Chronique de John Capgrave, qui reproduit un poème distribué dans
les rues de Londres sur l’ordre de Sigismond au moment de son départ, dans lequel le roi des
Romains se livre à un éloge de l’Angleterre, fondé sur le jeu de mots classique entre
« Anglici » et « Angeli » : « Farewel, with glorious victory, / Blessid Inglong, ful of melody, /
Thou may be clepid of Angel nature ; / Thou servist God so with bysy cure./ We leve with the
this praising, / Which we schul evir sey and sing »343. De même, l’auteur du Libelle se fait
l’écho de la haute estime que Sigismond porte à l’Angleterre, dont il reconnaît la gloire et la
puissance, mesurées à l’aune des guerres en France et de la domination maritime : « Here
moche glorye, as hym thought, he founde, / A myghty londe, whyche hadde take on honde /
To werre in Fraunce and make mortalite, / And ever well kept rounde aboute the see » (v.11-
14)344. De la même façon, les Chroniques de Londres racontent comment Sigismond, au
moment de quitter l’Angleterre, prend à son service de nombreux Anglais, qu’il juge plus
dignes de confiance que son propre peuple ! : « And after, the Emperoure went home in-to
his cuntre, and many Englissh men with hym made officers, for he trustid hem better then
his oune nacion »345.
Philippe le Bon.
Inversement, si William Worcester, se souvenant de l’ancienne alliance anglo-
bourguignonne, présente étrangement Jean Sans Peur comme un ami de l’Angleterre (« a
greet frende to the land ») et rappelle la victoire conjointe des troupes de Philippe de
340 Libelle of Englyshe Polycye, p.42. 341 Ibid, p.2. 342 Ibid, p.1. 343 Cité par Norman Simms, op.cit. (p.24). 344 Libelle of Englyshe Polycye, p.2. 345 Brut, p.559.
67
Bourgogne et des « fidèles sujets anglais » à la bataille de Cravant 346, ce dernier incarne
bien, après son abandon de l’alliance anglaise à Arras et encore plus après sa tentative
contre Calais, la figure de l’Etranger sous ses aspects les plus négatifs. Ici comme ailleurs, le
discours des poètes reflète sans aucun-doute l’état de l’opinion publique anglaise en 1435-
1436, alors que, selon le témoignage de la Chronique d’Enguerrand de Monstrelet, tous les
Anglais « de bonne éducation » formulaient contre le duc les injures les plus grossières347 !
Principalement, Philippe incarne la figure du traître par excellence. C’est ainsi que les
poèmes Scorn of the Duke of Burgundy et A Ballade in Despyte of the Flemynges déploient
une étonnante richesse de vocabulaire pour rendre compte de la « fausseté » de Philippe.
De fait, on trouve dans le premier pas moins de 9 occurrences de « falsnes » sous ses
différentes formes, dont 7 figurent en fin de strophe, 3 occurrences de « falshede », 1 de
« frowardnes », 1 de « gyle », 1 de « false » et 1 de « feyned ». De même, on relève dans le
second 1 occurrence de « falsnesse » renforcée par l’adjectif « fraudulent », à laquelle
viennent s’ajouter 1 occurrence de « feyned », 1 occurrence de l’adverbe « frowardly » et 2
autres de « falsly », et surtout 4 de l’adjectif « fals », associé à deux reprises au mot
« collusioun », désignant ici une trahison, et à deux autres reprises, au substantif
« decepcioun ».
C’est ainsi que l’auteur de Scorn of the Duke of Burgundy, qui multiplie les insultes à
l’encontre du duc dans les premiers vers de son poème, n’hésite pas à désigner Philippe
comme un innovateur dans le domaine de la fausseté (« O thou Phelippe, fonder of new
falshede », v.1)348. De la même manière, l’auteur de In Despyte of the Flemynges, lorsqu’il
conseille à toute personne voulant se joindre à des traîtres de se rendre en Flandre auprès
du duc (« Off stryvys new, & fraudulent falsnesse, / Who-so lyst to seek out the cheef
occasioun, / Late hym resorte, & his weye dresse, / In-to Flaundrys », v.1-4), désigne ce
dernier par l’emblème héraldique des comtes de Flandre, le Lion Noir (« the Blak Lyoun »,
v.4), afin d’en faire le symbole-même de la fausseté : « fals collusion,-/ Lyk in his standard as
betyn is the signe,- » (v. 5-6)349.
Cette trahison de Philippe envers son suzerain le roi d’Angleterre reçoit ainsi d’amples
développements. C’est ainsi que l’auteur de Scorn of the Duke of Burgundy remonte à
l’année 1431, soit quatre ans avant Arras, pour déceler les premières preuves de la mauvaise
foi du duc qui, absent au couronnement parisien d’Henry VI (v.33-40)350, se refuse
également à le rencontrer tout au long de son séjour en France, en invoquant des excuses
spécieuses pour dissimuler ses mauvaises intentions: « Phelippe, thy falsnes was shewed
346 Boke of Noblesse, respectivement p.9 et p.17. 347 Cité par James A. Doing, « Propaganda, Public Opinion and the Siege of Calais in 1436 », in Crown, Government and People in the Fifteenth Century, Rowena E. Archer (ed.), New York, 1995, p.79-106 (ici, p.91). 348 Historical Poems, p.86. 349 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.600. 350 Historical Poems, p.87.
68
openly / In that thy lige lord thou woldest neuer see, / While he was in France continually / A
yere and an halfe […] / […] as a rightwys kyng there crovned to bee. / Thou absent thiself
with feyned contenance, / Imagenyng alway cruell soteltie » (v. 49-55)351. Surtout, le poète
insiste sur le parjure de Philippe, « false to god » (v.31), dans la mesure où il a enfreint son
serment d’allégeance à Henry V et à ses successeurs, prononcé sur les Saints Sacrements à
Amiens en 1420, de son propre mouvement : « To kyng henry the fyft by thyn ovne assent, /
Withoute his desire, thou madest a solempne vow, / Vsyng goddes body the holy sacrement,
/ To become trew ligeman with gode entent / To hym and to his heires without variance »
(v.26-29), en s’en faisant absoudre à Arras de manière illégitime par un cardinal non-investi
de l’autorité papale : « Phelippe, at Arras, thy falshede to encrece, / Bothe of thyn avow and
othes with all, / Before th’embassatours of trete of pees / Thou shewedest thyself assoilled
by a cardinal, / The which was withoute power papall » (v.57-61)352. Même chose chez
l’auteur de In Despyte of the Flemynges, qui relate comment Philippe, ayant juré à Amiens
« to be trewe, voyde of dobylnesse » (v.19), a finalement obtenu son absolution à Arras
« vndyr the courteyne of fals collusioun » (v.20), pour se défaire de sa feinte fidélité (« Thy
feyned feythe vp falsly to resygne », v.22), après avoir usé de la même hypocrisie pour
tromper la délégation anglaise à Arras, venue dans l’espoir de rétablir définitivement la paix
entre la France et l’Angleterre : « Thou shewyng there a face ful benygne / Vndyr a veyle of
fals decepcioun » (v.30-31)353.
De même, la trahison de Philippe, horrible en elle-même, l’est encore plus si l’on prend en
considération la bonté extrême que les Anglais lui ont toujours témoignée. En effet, les
sources insistent alors sur l’ingratitude (« vnkyndenesse », Scorn, v.15) du duc, taxé de
« moste vnkynde prince that euer man knew » (v.47)354. L’auteur de Scorn of the Duke of
Burgundy l’engage ainsi à se souvenir de la bonté d’Henry V, dispensée sans qu’il l’ait
méritée ( ! ) : « haue in mynde / How king henre the vte, of veray gentilnesse, / Withoute thy
desert he was to the kynde » (v.9-11), alors que le roi l’a toujours secouru dans le danger et
défendu contre « alle thy mortall enemys » (v.13-14), devenant son suzerain et son
protecteur après le meurtre de son père à Montereau (v.17-24)355. Cette « knyghtly
gentylnesse » d’Henry V envers Philippe est également rappelée par l’auteur de In Despyte of
the Flemynges, qui y ajoute de plus un élément inédit, celui de l’ordre donné par Henry V,
compatissant et charitable, d’exhumer le cadavre en décomposition de Jean Sans Peur afin
de le faire ré-enterrer dignement : « How Herry the Fyfthe […] / Had of his dethe manly
compassioun / Leete digge hym vp, stank for corrupcion, / Of a prynce a mercyable sygne »
(v.11-14)356. De même, l’insistance, dans Scorn of the Duke of Burgundy, sur les circonstances
de l’assassinat de Jean Sans Peur, perpétré avec le soutien du futur Charles VII (« thy fader
351 Historical Poems, p.88. 352 Ibid, p.87 et 88. 353 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.600 et 601. 354 Historical Poems, p.87. 355 Ibid, p.86 et 87. 356 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.600.
69
thrugh conspired treson, / By assent of Charles that calleth hymself kyng / Of the reaume of
france […] / Was at Motreux broght to his confusion », v.18-21), permet à l’auteur de
présenter la réconciliation de Philippe avec Charles VII comme un acte proprement contre-
nature, alors que Philippe abandonne Henry VI, son suzerain et ami (« thy ligelord and frend
moste special ») pour reconnaître l’assassin de son père comme « rightwis king of france »
(v.62-63)357 ! De plus, ce n’est pas seulement le roi, mais bien tous les Anglais qui ont fait
preuve de bonté et de droiture envers lui (« Remembre the, Phelippe, how peple of England,
/ Haue been to the euer gentil and trew », v.41-42), en volant à son secours alors qu’il était
assiégé par « plusieurs milliers d’Armagnacs » à Cravant, et généralement, en suivant ses
désirs et en défendant son honneur (« Perfourmyng thy desire bothe olde and new, / Euer
redy thyn honeur to mayntene and avance », v.45-46)358.
De même, les Anglais sont frappés par la malveillance que Philippe leur témoigne. C’est ainsi
que son abandon de l’alliance anglaise, ainsi que son attaque ultérieure contre Calais, lui
vaut d’être taxé de « Distourber of pees » et « Sower of discorde » (v.2-3) par l’auteur de
Scorn of the Duke of Burgundy359. De même, ce dernier démontre à quel point il a nui à son
ancien allié en permettant la reconquête de Paris, de Pontoise et de Bois-Vincent, menée à
bien par Villiers de l’Isle- Adam (« thurgh thy falshede and gyle, / Bothe Parys, Pountois, and
Boys vicent / Were unwerly wonne by the lord lyle », v.73-75), de même qu’il n’hésite pas à
dénoncer la cruauté dont il a fait preuve en faisant pendre la garnison anglaise de la
forteresse d’Oye après avoir incendié cette dernière : « And eke the Castel of Oye whan thou
haddest brent, / The peple thou henge by cruel Iugement » (v.76-77)360. L’auteur de In
Despyte, de même, reprend cette idée, alors que Philippe est accusé de pousser les
Flamands, officiellement sujets du roi de France anglais, à rechercher la ruine de
l’Angleterre, le verbe «malygne », mis à la rime à la fin de chaque strophe, recevant même la
place d’honneur dans le poème : « meved his countre of presumpcioun / Ageyn Ingelond
frowardly to malygne » (v.8), « Madest Flaundrys ageyn Ingelond to malygne » (v.16),
« Causyng Flaundrys […] / Ageyn Ingelond prowdly to malygne » (v.24)361…
Cependant, les auteurs ont la satisfaction de constater que la traîtrise, l’ingratitude, la
malveillance et l’orgueil démesuré (« grete maintenance », Scorn, v.70362, « The Duc of
Burgone, of grete pride », v.13, Siege of Calais363) de Philippe ne lui rapportent rien. C’est
ainsi que l’auteur de Scorn of the Duke of Burgundy fait toujours figurer en fin de strophe le
mot « myschance », désignant les malheurs qu’a subis Philippe en raison de sa « falsnes »,
les deux termes étant très souvent associés (« Wite thyn ovne falsnes al thy myschance ! »,
v.8, « Wherfore thyn ovne falsnesse causeth thy myschance », v.24, « Thy falsnes is
357 Historical Poems, p.87 et 88. 358 Ibid, p.87. 359 Historical Poems, p.86. 360 Ibid, p.88. 361 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.600. 362 Historical Poems, p.88. 363 Ibid, p.78.
70
begynnyng of al thy myschance », v.72…)364. Surtout, cette affirmation amène nos auteurs à
ajouter un dernier élément au portrait qu’ils consacrent à Philippe : celui de sa lâcheté. En
effet, il est décrit dans la première strophe de Scorn of the Duke of Burgundy comme un
« Capiteine of cowardise » et comme la honte de la chevalerie (« Repref of al knyghthode »),
indigne d’être duc de Bourgogne, présentée par l’auteur, ironiquement ou non, comme une
terre de grande valeur (« so grete of pryse »)365. De fait, cette accusation de lâcheté trouve
un terrain fertile dans ses actions au moment du siège de Calais, puisqu’ayant originellement
fait monter sa tente devant Calais, il a ensuite rapidement reculé de peur d’essuyer les tirs
des canons ! : « thy princehode was vtterly repreved / Whan thou tofore Calais thy tentes
had pight, / And for feer of shotte at sege thou bacward remeued ; / A gretter shame at sege
gat hym neuer knyght » (v.81-84)366. Le même jugement est bien-sûr porté sur sa fuite afin
d’éviter l’engagement militaire avec le duc de Gloucester : « Thou flygh away for drede of
bataille : / Neuer prince brak sege with gretter myschance » (v.95-96)367. Par la suite, alors-
même que le duc Humphrey envahit ses territoires « To meve thy courage the felde forto
take » (v.98), le duc n’ose pas lui faire face (« Thy land is distroied, and thou dar not awake »,
v.103), et demeure caché, de telle sorte que l’auteur du poème feint de se demander où il
peut bien être : « Where art thou, Phelippe, whan wiltow thy swerd shake ? »(v.101), « whan
wiltow rise, / And in pleyn felde doo mustre with thy launce ? », v.5-6)368, et que ses gens
répandent la rumeur de sa mort369 ! Enfin, l’affirmation de la lâcheté de Philippe trouve son
expression la plus accomplie dans In Despyte, lorsque l’auteur, évoquant sa « cowardly
flyght », le compare à un jeune homme efféminé (« cokeney of a chaumpyoun »),
malveillant, mais trop lâche pour oser combattre (« Whiche darst not fyght, and canst so wel
malygne », v.39-40)370.
364 Historical Poems, p.87-88. 365 Ibid, p.86. 366 Historical Poems, p.89. Voir aussi Siege of Calais, Ibid, p.81, où l’auteur raconte comment Philippe, d’abord installé à l’ouest de la ville, se retire ensuite à l’est pour échapper au danger : « And for the duc logged hym no nere, / At the southwest corner, / Of gonnes he had a songe ; / That anoon he left his place, / And to the est ende he made a chace, / Hym thoght he bode to longe » (v.109-114). Voir aussi le Brut pour un récit similaire, p.578. 367 Ibid. 368 Historical Poems, p.89 et 86. 369 Libelle of Englyshe Polycye, p.16 : « Thene his meyné seidene that he was dede ». 370 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.601.
71
B) Registres de la description des peuples.
1) Le sentiment de l’altérité ethnique.
Après nous être consacrés à l’étude générale des « mots de l’Etranger » et des thèmes qui lui
sont attachés, ainsi qu’à l’analyse de figures individuelles, il faut à présent nous tourner vers
une autre question, celle de l’image des peuples.
Tout d’abord, sans-doute convient-il de dire quelques mots de l’évolution des stéréotypes
nationaux au Moyen Age. De fait, ce dernier hérite d’une tradition intellectuelle remontant à
l’Antiquité. Les auteurs grecs et romains sont en effet à l’origine de la division du monde en
différents peuples (gentes)371. Surtout, les auteurs latins, tels que César, se passionnent pour
« la psychologie des peuples », considérée comme « une clé essentielle de l’histoire », et
établissent ainsi une ethnologie sommaire, qui associe à chaque peuple une caractéristique
dominante372. Les auteurs médiévaux reprennent ensuite à leur compte cette « série
d’archétypes littéraires, de topoi ethnographiques »373, en dressant des catalogues tous faits
des nations médiévales selon leurs défauts, dans une optique parodique ou scientifique. En
témoigne, entre autres, l’exemple célèbre de Boncompagno da Signa qui, au début du XIIIè
Siècle, écrit que « Teutonici per furorem, Alobroges per latrocinium, Francigenae per
arrogantiam, Yspani per mulas, Anglici per caudam et Scoti per mendacitatem a plurimis
deridentur »374. Cependant, les listes « traditionnelles et routinières » des siècles
précédents, « où l’envie des Juifs voisinait avec la perfidie des Perses, la sagesse des Grecs, la
gourmandise des Gaulois, l’orgueil des Francs, la colère des Bretons, la cruauté des Huns ou
la traîtrise des Poitevins », semblent peu à peu, à la fin du Moyen Age, s’adapter à leur
temps, pour fixer l’image des peuples de l’Europe contemporaine375. De même, les
stéréotypes nationaux évoluent en fonction de la situation contemporaine, puisqu’ils se
renforcent à l’occasion des conflits entre Etats, de même qu’ils servent alors à encourager le
sentiment d’hostilité face à l’ennemi étranger376.
Ainsi, « l’image de l’étranger ne signifie pas la connaissance. Elle évolue à travers le prisme
d’une culture, de préjugés et s’accompagne d’une démarche de différenciation et
d’infériorisation, les auteurs reprochant aux autres peuples leurs attributs identitaires, réels
ou supposés »377, et la conscience de l’altérité s’exprime alors de manière imprécise,
caricaturale et hautement stéréotypée, alors que « ce sont souvent les mêmes vices qui
371 Laurence Moal, « Les Peuples étrangers dans les chroniques bretonnes », op.cit. (p.502). 372 Laurence Moal, L’Etranger en Bretagne, op.cit. (p.313). 373 Ibid, (p.314). 374 Voir Benoît Grévin, « De la rhétorique des nations à la théorie des races : L’influence des théories scientifiques sur la pensée des stéréotypes nationaux à partir du XIIIe Siècle », disponible en ligne à cette adresse : http://gas.ehess.fr (téléchargé le 09/11/2012). 375 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe Siècles, op.cit. (p.132). 376 Laurence Moal, L’Etranger en Bretagne, op.cit. (p.313). 377 Ibid (p.311-313).
72
reviennent d’une époque à une autre, d’un peuple à un autre »378. Cependant, la conscience
de l’altérité s’appuie également sur quelques critères effectifs, soit « le physique, la langue,
les mœurs », qui caractérisent pendant toute la période l’appartenance ethnique379.
Qu’en est-il dans nos sources ? Premièrement, on peut constater que la terminologie-même
des peuples est parfois imprécise. C’est en effet le cas, comme nous l’avons entrevu plus
haut à de nombreuses reprises, pour le terme « Lumbardes », qui sert alors couramment à
désigner l’ensemble des personnes originaires du nord de l’Italie, par exemple dans les
Subsidy Rolls380, mais aussi dans le Libelle of Englyshe Polycye, où l’auteur l’utilise pour
stigmatiser l’ensemble des marchands italiens haïs, soit en particulier ceux de Venise et de
Florence, et encore dans le Boke of Noblesse, lorsque Worcester mentionne la présence
génoise à Verneuil381. De la même façon, le terme « Flemings », connoté péjorativement, est
susceptible d’être utilisé collectivement pour toutes les personnes originaires des Pays-Bas
bourguignons, et même en général d’Europe du nord-ouest382. Surtout, on trouve très
souvent, pour désigner ces derniers, le terme très imprécis de « Duchemen », dont l’emploi
se fonde sur des similarités de langue : le Brut, évoquant la menace d’une attaque du roi de
France et du duc de Bourgogne pendant le siège de Rouen, décrit ainsi l’armée de Jean Sans
Peur : « an huge compeny of Burgoynys, of Flemmyngis, and of othir Duche tungis »383, de
même que l’auteur du Libelle parle des « Highe Duchmene of Pruse » (v.279)384 et que, pour
Worcester, c’est la langue germanique qui caractérise ethniquement les Saxons (« the
Saxons of Duche ys tung »)385. Enfin, le même flou semble régner en ce qui concerne la
distinction observée plus haut entre les « Anglais d’Irlande » et les « Irlandais », alors que ce
dernier terme en vient peu à peu à désigner, en Angleterre, tous les habitants de l’Irlande de
manière indifférenciée, tous perçus comme des « étrangers » 386. C’est ainsi que l’auteur du
Siege of Calais relate la participation d’un « Irissh man » (v.121), désignant ici un sujet du roi
d’Angleterre, à la défense de Calais387, alors que l’auteur du Libelle, qui trace une nette
distinction entre les « wylde Yrishe » et les sujets du roi d’Angleterre, semble ici,
étrangement, réserver l’appellation d’ « Yrichemen » à ces derniers : « The Yrichemen have
cause lyke to oures / Oure londe and herres togedre to defende » (v.669-670)388.
De fait, l’altérité linguistique fait souvent l’objet de commentaires de la part de nos auteurs.
C’est bien entendu le cas pour les Flamands, que les auteurs se plaisent à citer « en version
378 Laurence Moal, L’Etranger en Bretagne, op.cit. (p.314). 379 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe Siècles, op.cit. (p.117). 380 The Alien Communities of London in the Fifteenth Century, op.cit. (p.26). 381 Boke of Noblesse, p.32. 382 The Alien Communities of London, op.cit. (p.1). 383 Brut, p.397. 384 Libelle of Englyshe Polycye, p.15. 385 Boke of Noblesse, p.51. 386 Voir James Lydon, « The Middle Nation », op.cit. (p.8-9). 387 Historical Poems, p.82. 388 Libelle of Englyshe Polycye, p.34-35.
73
originale » pour marquer leur différence. En effet, l’auteur du Libelle désigne les grandes
foires des Pays-Bas sous le nom néerlandais de « martes », avant de donner l’équivalent
anglais : « To whyche martis, that Englissh men call feyres » (v.524)389. Le même procédé est
utilisé dans le Brut, alors que les Flamands affirment que le Staple de Calais peut être
conquis en moins de temps qu’il ne faut pour avaler un repas : « [thai] said that the steevan
Caleis was but a male tyde, that is to say, A mele tyde »390. Surtout, c’est l’adjectif « quade »
(mauvais), compréhensible des lecteurs anglophones tout étant intimement associé aux
Flamands, qui est employé pour rendre compte de l’altérité linguistique de ces derniers.
C’est ainsi le cas dans une version du Brut, qui raconte que les Brugeois surnomment le jour
de leur défaite et de leur fuite devant Calais le « Mauvais Jeudi » : « And this was on a
Thursday ; wherfore the Flemmynges it clepit the ‘Quade Thursdagh’ »391. De même, l’auteur
de Mockery of the Flemings atteint un rare degré de virtuosité en retournant contre les
Flamands une malédiction formulée dans leur propre langue, au moyen du mot
« quadenramp » (malheur) : « God gyue you quadenramp ! » (v.66)392. De même, les auteurs
anglais peuvent parfois s’attacher à rendre compte de l’altérité linguistique des Français,
comme le fait par endroits John Page, au moyen d’un vocabulaire spécifique : c’est ainsi qu’il
fait précéder les noms des capitaines français au siège de Rouen des titres de
« Monsenyour » et « Monsenoure »393, et surtout, qu’il fait prononcer aux Rouennais les
phrases de « Graunt marcy » ou même de « Mon syr, graunt mercy »394 !
De la même façon, l’altérité physique, ou du moins vestimentaire, retient parfois l’attention
des auteurs. C’est le cas pour les soldats irlandais que Thomas Butler amène avec lui au siège
de Rouen, et dont John Page évoque, certes avec bienveillance, l’équipement particulier :
«xv. hundryd fyughtyng men, / Welle a-rayde of warre wyse, / As the cuntraye hathe the
gysse »395, idée qui est reprise dans le Brut, qui mentionne « a fayre mayne of men of arme3
of hir owne cuntre gise »396. De même, l’altérité est relevée dans le cas du soldat irlandais
présent à Calais en 1436, puisque l’auteur du Siege of Calais précise qu’il monte un hobby,
petit cheval typique de l’Irlande : « an Irissh man / On his hoby that swiftly ran » (v.121-
122)397. Dans le cas du Flamand, son altérité physique est telle que, d’après le même auteur,
elle apparaît évidente même aux yeux du chien Goby, héros de la défense de Calais, qui le
distingue très bien des Anglais : « fful wel he cowde hem kenne » (v.132)398. Enfin, la
389 Libelle of Englyshe Polycye, p.26-27. 390 Brut, p.572. 391 Ibid, p.580. 392 Historical Poems, p.85. Voir aussi l’explication qu’en donne Joanna Bellis, in « Rymes sette for a remembraunce : memorialization and mimetic language in the war poetry of the late Middle Ages », in The Review of English Studies, New Series, Vol. 64, No. 264, p.183-207 (ici, p.196-197). 393 Historical Collections of a Citizen of London, p.14. 394 Ibid, p.21 et 28. 395 Ibid, p.12. 396 Brut, p.389. 397 Historical Poems, p.82. 398 Ibid.
74
question de l’apparence de l’Etranger demeure toujours présente à l’esprit des scribes, de
telle sorte qu’une variante manuscrite du poème de Lydgate sur l’Entrée d’Henry VI
remplace l’allusion aux « joyeuses manières » des étrangers participant au cortège en une
remarque sur leur différence vestimentaire (« vêtus à leur manière ») : « gladde in her
maners / clad in her maners » (v.46)399.
Bien-entendu, dans nos sources comme ailleurs, la vision des peuples est essentiellement
tributaire de la conjoncture politique et militaire. En effet, de nombreux traits relevés chez
eux relèvent avant tout d’une vision traditionnelle de l’Adversaire, toujours orgueilleux et
vantard, comme le sont, d’après l’auteur du Libelle, à la fois les Flamands, les Espagnols, les
Ecossais et les Bretons, dont il évoque les fanfaronnades (« here bostes », v.274)400 et les
Génois présents en 1416 devant Harfleur (« To stoppe us there wyth multitude of pride »,
v.1023)401 et « malicieux », au sens de malveillant et cruel, la nécessité de « resister a la
malice de sez enemys » étant toujours invoquée par le roi d’Angleterre pour obtenir le
consentement des parlementaires à l’impôt402.
2) Portraits de peuples.
Malgré cette observation portant sur la nature hautement stéréotypée de la description des
peuples, il ne paraît pas inutile de tenter de percevoir quels sont les traits dominants que
nos auteurs attribuent à chacun d’entre eux. Ici encore, cette démarche relève de l’analyse
et s’appuie sur la lexicométrie, alors que l’image des peuples se dévoile incidemment au fil
des sources, qui n’ont jamais le discours ethnographique pour objet premier. C’est ainsi qu’il
peut être frustrant de constater que l’auteur du Libelle n’a rien de particulier à dire au sujet
des Espagnols en tant que peuple, alors-même qu’il consacre un long passage aux ressources
de leur pays et à leur rôle économique en Europe, rien non plus au sujet des « Hyghe
Duchemenne and Esterlynges », et rien encore en ce qui concerne les Islandais ! Cependant,
il est possible, en se fondant sur les sources, de reconstituer l’image de plusieurs peuples.
Les peuples celtes.
Premièrement, c’est le cas pour les peuples celtes des Iles Britanniques, soit les Irlandais, les
Gallois et les Ecossais. En effet, en conformité avec le discours anglais des siècles précédents,
qui justifie la conquête de ces peuples par la nécessité de leur apporter la civilisation, nos
auteurs s’accordent tous pour les décrire comme des barbares et des « sauvages ». De fait, il
est très révélateur de constater que, sur 9 occurrences totales de l’adjectif « wilde » dans le
corpus, 8 s’appliquent justement aux peuples celtes ! C’est ainsi que William Worcester,
lorsqu’il évoque l’hégémonie acquise par Edward I sur l’ensemble des Iles Britanniques,
n’hésite pas à ranger les Irlandais, les Gallois et les Ecossais sous la même définition : « king
399 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.632 et note 46. 400 Libelle of Englyshe Polycye, p.14. 401 Ibid, p.52. 402 Voir PROME, par exemple parlement d’octobre 1419, item 9.
75
Edwarde first kept under subjeccion bothe Irelond, Walis, and Scotlond, whiche were rebellis
and wilde peple of condicion », attirant ainsi l’attention sur leur caractère naturellement
rebelle et insoumis403.
De la même façon, c’est bien cet élément de description qui se trouve au premier plan dans
le discours de l’auteur du Libelle of Englyshe Polycye. En effet, alors qu’il se livre à une
description des « commodites of Scotelonde » et de ses liens commerciaux avec la Flandre, il
a recours à l’adjectif « rude » (grossier) pour caractériser les échanges commerciaux des
Ecossais, qui ne ramènent de Flandre que des articles de mercerie (« lytyll mercerye / And
grete plentee of haburdasshers ware », v. 265-266), des charrettes et des roues de
charrette (« And halfe here shippes wyth carte whelys bare / And wyth barowes ar laden... »,
v.267-268) : « Thus moste rude ware be in here chevesaunce » (v.269). Surtout, il ne fait pas
de doute que ce caractère « grossier » ne s’applique pas qu’à leur commerce, mais
caractérise également les Ecossais en tant que peuple, idée qui est explicitée par une
variante manuscrite, qui les décrit comme des « hommes grossiers » acquérant des produits
qui leur correspondent : « Thus have rude men rude ware in chevesaunce »404 ! A cet
élément majeur de description vient de plus s’ajouter, dans le sermon d’ouverture du
parlement de novembre 1417, la caractéristique majeure de l’adversaire qu’est la
« malice » : « l'haute malice de les Escos, queux s'afforcent toutditz a destruier le
roialme »405.
En ce qui concerne les Irlandais, si on a pu évoquer plus haut l’amalgame qui tend à se faire,
dans l’esprit des « Anglais d’Angleterre », entre les « Anglais d’Irlande » et les Irlandais
gaéliques, il ne fait aucun doute que le registre des descriptions des deux peuples est, dans
nos sources, profondément différent. En effet, si John Page et les compilateurs du Brut après
lui relèvent bien l’altérité des soldats anglo-irlandais, le portrait qu’ils en dressent demeure
éminemment positif. En effet, ces sujets du roi d’Angleterre sont salués pour les bons
services qu’ils rendent alors à leur souverain, alors qu’ils se pressent pour venir participer au
siège aux côtés du roi (« spede hem in alle haste to the Kynge, and come vnto the sege of
Rone ») et qu’ils se réjouissent de la mission qui leur est assignée, qui consiste à garder la
forêt de Lyons (« of that ordynaunce thei weren fayn and glad »). De même, ils sont très
positivement décrits comme d’excellents hommes de guerre (« good bodyes and manfulle
men to werre »), qui se distinguent par leur bravoure face à l’ennemi (« and as good
warriouris and as prowde men of armys they shewid hem at alle tymes vpon her enemyes »),
qui leur vaut de gagner l’affection d’Henry V (« wherefore the Kynge had hem in heighe
cherite for her grete manhode »)406. Il en est de même pour l’ « Irlandais » qui compte parmi
les héros de la défense de Calais en 1436407.
403 Boke of Noblesse, p.11. 404 Libelle of Englyshe Polycye, p.14. 405 PROME, parlement de novembre 1417, item 3. 406 Brut, p.397-398. 407 Historical Poems, p.82.
76
Il en va tout autrement pour les Irlandais gaéliques, le peuple celte qui inspire le plus de
commentaires à l’auteur du Libelle of Englyshe Polycye. En effet, ce dernier reprend à son
compte l’expression de « wylde Yrishe », employée pas moins de 5 fois. Or, si cette dernière
revêt bien un sens politique, elle est loin d’être neutre du point de vue des attitudes et des
représentations mentales408. De fait, comme le démontrent les concordances, le caractère
« sauvage » est bien, aux yeux de l’auteur du Libelle, le trait ethnique majeur des Irlandais
gaéliques. En effet, il exprime l’idée que l’Irlande se divise en deux types distincts de
territoires et de peuples, les uns encore « sauvages » et les autres « soumis », voire-même
« apprivoisés » : «wylde and tame » (v.749)409 ! Surtout, l’auteur insiste sur l’idée du manque
de civilisation et du sous-développement des Irlandais gaéliques, qui sont pauvres (« pore »,
v.687) et incapables de tirer avantage eux-mêmes des incroyables ressources naturelles du
pays en exploitant les mines d’or et d’argent qui s’y trouvent, précisément à cause de
leur « grossièreté » et de leur « ignorance » des techniques : « For they ar rude and can
thereone no skylle » (v.688)410. De la même façon, lorsque l’auteur engage ses compatriotes
à empêcher la conquête de l’ensemble de l’Irlande par les « wylde Yrishe », il exprime la
crainte qu’elle puisse un jour être gouvernée par un chef gaélique : « God forbede that a
wylde Yrishe wyrlynge / Shulde be chosene for to be there kinge » (v.716-717), le terme
« wyrlynge » désignant une personne rachitique et maladive, et suggérant donc encore un
état de sous-développement, cette-fois au sens physique du terme411.
Enfin, sans surprise, la vision des Gallois reste encore fortement marquée par la récente
rébellion du pays de Galles, qui pousse les auteurs anglais à relever chez eux la fausseté,
comme en témoigne l’expression de « fals Walschmen » dans le Brut412, et aussi ce trait
traditionnel de l’adversaire qu’est l’arrogance (« their pompe and pride »)413. De même,
l’auteur du Libelle, dans un passage célèbre, engage ses compatriotes à se méfier des Gallois
qui, toujours susceptibles de se rebeller « rudely » (ici au sens de « violemment »),
pourraient un jour leur faire verser bien des larmes, à eux ou à leurs descendants : « Beware
of Walys, Criste Ihesu mutt us kepe, / That it make not oure childes childe to wepe, / Ne us
also […] / […] sethen that many a day / Men have be ferde of here rebellione / By grete
tokenes and ostentacione. / Seche the menys wyth a discrete avyse, / And helpe that they
rudely not aryse / For to rebellen… » (v.784-792)414. Enfin, à la « sauvagerie » des Gallois
correspond celle des paysages du pays de Galles, alors qu’une pétition de 1437 expose
comment un certain William Pulle, habitant du Cheshire, a violenté une femme avant de
408 Voir James Lydon, « The Middle Nation », op.cit. (p.19-22). 409 Libelle of Englyshe Polycye, p.38. 410 Ibid, p.35. 411 Ibid, p.37. 412 Brut, p.363. 413 PROME, parlement de février 1445, item 26. 414 Libelle of Englyshe Polycye, p.40.
77
l’emmener avec lui « dans les endroits sauvages et désolés du pays de Galles » (« and her […]
ledde with him into the wylde and desolate places of Wales »)415 !
Les Bretons.
Un autre peuple qui retient l’attention des auteurs, les Bretons, ne reçoit pas un meilleur
traitement. En effet, pour l’auteur du Libelle, la Bretagne (appelée, de manière amusante,
« Pety Brytayne » et « Lytell Bretayne », v.151) et les Bretons sont irrémédiablement
associés aux activités de piraterie. Cette idée apparaît en effet dès le titre du chapitre qu’il
consacre au duché : « The commodytes of Pety Brytayne, wyth here revers on the see », et
est ensuite explicitée, alors que les pirates bretons sont décrits comme étant les pires :
« And of thys Bretayn […] / Are the gretteste rovers and the gretteste thevys / That have
bene in the see many a yere » (v.158-160). Ce jugement est bien-sûr motivé par le fait qu’ils
dirigent en particulier leurs opérations contre les bateaux de commerce anglais (« And that
oure marchauntes have bowght alle to dere. / For they have take notable gode of oures »,
v.161-162), et s’attaquent même aux villes côtières anglaises, ce qui pousse l’auteur à les
associer à diverses images de destruction, soit le vol, l’incendie, le meurtre et le « racket » :
« Thus they have bene in dyverse costes manye / Of oure England, mo than reherse can I,
/[…]/ And robbed and brente and slayne by many a routte ; / And they have also raunsouned
toune by toune » (v.169-172). De la même façon, ils incarnent pour l’auteur la figure du
bandit sans foi ni loi, du « traître » et du « pilleur » (« these false coloured pelours », v.163),
dans la mesure où, rebelles à l’autorité de leur duc (« Wheche to there duke none
obeysaunce woll bere », v.165), ils ne respectent aucunement les trêves conclues par ce
dernier avec l’Angleterre, mais bien plus, profitent de cette « paix feinte » pour nuire de plus
belle aux Anglais (« Wyth suche colours we have bene hindred sore, / And fayned pease is
called no werre herefore », v.166-167)416.
Toutes ces idées sont alors à nouveau mises en scène dans une anecdote historique plus ou
moins fantaisiste, que l’auteur situe sous le règne d’Edward III. En effet, il raconte comment
les Anglais, après que la paix ait été conclue entre le roi et le duc de Bretagne, se rendent
avec confiance (« boldelye », v.197) dans le duché pour y commercer, considérant désormais
les Bretons comme des « amis » (« Wenynge hem frendes », v.197), seulement pour être
traitreusement capturés et dépouillés par les pirates de St-Malo et du Mont St-Michel (« But
sone anone oure marchaundes were itake, / And wee spede nevere the better for treuse
sake ; They loste here goode, here navy and spendynge», v.198-200). De plus, le duc lui-
même n’est pas épargné par l’accusation de fausseté, alors qu’il décline toute responsabilité
pour les actions de ses sujets en affirmant qu’il est impuissant à s’en faire obéir : « Whiche
duke […] hym excused, / Rehersyng that the Mount of Seynte Michell / And Seynt Malouse
wolde nevere a dele / Be subject unto his governaunce / Ner be undere hys obëysaunce, /
And so they did withowten hym that dede » (v.205-210), et qu’il ne finit par s’engager à
415 PROME, parlement de janvier 1437, item 14. 416 Libelle of Englyshe Polycye, p.8-9.
78
observer une paix sans réserve, impliquant l’ensemble de ses sujets, que sous la menace de
la destruction totale de son duché : « The duke hymselfe for all dyd undertake, / Wyth all hys
herte a full pease dyd he make » (v.236-237)417.
De même, William Worcester, à part la courte mention qu’il consacre à Gilles de Bretagne,
ne trouve rien à dire de positif sur les Bretons. Bien au contraire, leurs ducs, au prix d’une
distorsion historique, apparaissent de tout temps ou presque comme les « complices » des
rois de France (« complisses »)418 et les ennemis de l’Angleterre, de même que les Bretons
profitent des trêves pour s’attaquer aux Anglais, comme après la bataille de l’Ecluse : « And
the Bretons making under that colour mortalle werre to this lande » et en 1363, sur l’ordre
de Philippe VI : « the seide Philip […] comaunding the Bretons to make werre ayenst youre
progenitours »419.
Les Italiens.
Autre peuple présent dans les sources, les Italiens font l’objet d’un discours bien particulier,
et ce surtout dans le Libelle. En effet, si une pétition présentée en parlement en 1414 fait
état de la fausseté et de la traîtrise des Génois (« subtilité et ymaginacion »)420, ce sont bien
les Vénitiens et les Florentins qui retiennent toute l’attention de l’auteur du Libelle. En effet,
la description de leurs « commodites » comme étant des objets de luxe (« nycetees »,
« thynges of complacence », v.345), sans aucune utilité particulière (« Nifles, trifles, that litell
have availed », v.349), parmi lesquelles figurent, entre autres bricoles (« japes », v.348) des
marmousets (« marmusettes taylede », v.348)421, attire l’attention du lecteur sur le
caractère éminemment superficiel des Italiens, mais aussi sur leur fausseté, puisqu’ils
séduisent les Anglais par la ruse (« fetely », v.350), au moyen de ces marchandises
« trompeuses » (« dyssevable », v.353)422. De même, les « Lumbardes » demeurent associés
à la fausseté dans la suite du Libelle, puisque leurs pratiques usuraires décrites ci-dessus
relèvent de la « tromperie » (« deseytte » et « disceytte »423) caractérisée, de même que ce
sont eux qui exploitent particulièrement la pratique des « maynteners and excusers » en
revendiquant traitreusement les prises des Anglais : « Than shall Lumbardes and other
feyned frendes / Make her chalenges by coloure false of fendes / And sey ther chafare in the
shippes is » (v.617-620)424. De même, on retrouve des « Lombardis » dans le Boke of
417 Libelle of Englyshe Polycye, p.10-13. 418 Boke of Noblesse, p.39. 419 Ibid, p.36. 420 PROME, parlement de novembre 1414, item 44. 421 Libelle of Englyshe Polycye, p.18. 422 Ibid, p.19. On retrouve d’ailleurs cette même idée dans la pétition des Silkwomen de Londres évoquée plus haut, attachée au mode de fabrication des produits importés par les Italiens, décrits comme « falsly and deceyvably wrought », PROME, parlement de juillet 1455, item 55. 423 Ibid, p. 21 et 23. 424 Ibid, p.32.
79
Noblesse, occupés à piller les « chariottes of […] tresoure and vesselle » de l’armée anglaise
à Verneuil, et donc encore associés à l’appât de gain et au vol425 !
Les Portugais.
Enfin, on peut terminer ce développement en évoquant les Portugais, dont le caractère
national ne fait certes pas l’objet d’un développement complet, mais qui sont, de manière
très intéressante, les seuls étrangers à être associés à la notion d’amitié : « They bene oure
frendes wyth there commoditez » (v.130), et peut-être même de confiance : « Portyngalers
wyth us have trought on hande » (v.128)426. Cependant, malgré ces rapports très cordiaux,
l’auteur du Libelle engage aussi ses compatriotes à empêcher les Portugais de passer en
Flandre pour commercer avec les ennemis de l’Angleterre, puisque les « amis » ne doivent
pas davantage être autorisés à nuire aux Anglais que les ennemis : « (Sethe oure frendys woll
not bene in causse / Of oure hyndrenge, yf reason lede thys clausse) », (v.144-
145)427.
3) Des cas exemplaires : le Flamand et le Français.
Les Flamands.
Bien-entendu, il n’est pas étonnant de constater que le Flamand, du fait de la situation
politique et militaire contemporaine, occupe une place particulière dans les textes, où il
incarne véritablement la figure de l’Etranger haï. Cependant, la haine des Flamands, loin de
naître avec l’épisode du siège de Calais en 1436, trouve déjà une expression forte au
moment d’Azincourt, alors qu’ils se voient reprocher d’avoir combattu aux côtés des
Français, en dépit de la position de neutralité alors adoptée par leur duc Jean Sans Peur.
C’est ainsi que l’auteur de la Battle of Agincourt leur consacre la dernière strophe de sa
ballade, dans laquelle il dénonce leur fausseté (« The fals flemynges », v.57) et leurs paroles
mensongères (« Here fals flateryng fare », v.59), alors que leur présence dans l’armée
française témoigne clairement de leur malveillance envers le peuple anglais : « Thei loved vs
neuer 3it, by the roode » (v.58). L’auteur peut alors se réjouir de la mort de nombre d’entre
eux dans la bataille : « Bot many of hem her hert-blode / Vnblythly bledden vpon that bent »
(v.62-63), qui prouve que, malgré leurs tentatives, ils ne parviendront jamais à nuire à la
« bonne Angleterre » : « 3it schall thai neuer wayt Inglond good » (v.63)428.
Par la suite, le moment du siège de Calais donne bien-sûr aux Anglais l’occasion de se
déchaîner contre les Flamands. C’est ainsi que les auteurs s’attachent à décrire l’orgueil des
Flamands et le mépris qu’ils portent aux Anglais, alors qu’ils se réjouissent du siège à venir et
comptent sur une victoire facile : « the Flemmynges were then so proude and hawteyn that
they sette by none Englisshe men, but hem hade in gret despite ». En témoignage de ce
425 Boke of Noblesse, p.32. 426 Libelle of Englyshe Polycye, p.7. 427 Ibid, p.8. 428 Historical Poems, p.77.
80
mépris, les Flamands commencent à maltraiter les marchands anglais présents en Flandre
(« thai hade evill chere in al plases »), les Brugeois font l’acquisition de draps peints,
représentant leur victoire à venir et des Anglais pendus par les pieds : « And they of Brigges
made payntet clothes, howe the Flemmynges were att seege att Caleis, and howe thai wann
the toune ; and hanget out Englisshe men by the helis out at lopes : and well was hym that
myght by of thes clothes ! », et mettent en scène des représentations théâtrales sur les
négociations d’Arras, « all in dispite and hoker of Englissh men ». De même, les Flamands se
réjouissent à l’idée de mettre la main sur les laines du Staple et de les répartir entre eux :
« thei were so glad and fayn that they shuld lay seege to Caleis, and wynne the wulles of the
staple of Caleis, and departe it amonges hem », et prononcent de nombreuses paroles
arrogantes (« bostet ») et méprisantes : « And mony othir scornefull wordes thai had that
tyme Amonges hem »429. De la même façon, l’auteur du Siege of Calais raconte comment les
troupes de Philippe le Bon se targuent de conquérir Calais (« made avaunt Calais to wynne »,
v.22), de tuer tous les Calaisiens, hommes, femmes et enfants : « And alle shuld dye that
were therin, / Man, woman and childe » (v.23-24), de se partager les marchandises du
Staple : « The wolles and the merchandise, / And other godes of grete emprise, / Eche
shulde have a certeine » (v.25-27), et même de raser la ville : « The walles thay wolde bete
adovn, / Tour, castell, and dongeon, / And all shuld be made pleyne » (v.28-30)430. Plus loin,
mettant en scène le premier jour du siège, l’auteur évoque encore « the ennemys proude »
(v.97)431.
Cependant, si les auteurs se plaisent à mettre en scène les vantardises des Flamands, c’est
avant tout pour tracer un fort contraste entre leur orgueil et leurs réalisations effectives. En
témoigne particulièrement la ballade Mockery of the Flemings, qui évoque comment les
Flamands se proposent de conquérir « la petite ville de Calais » (« ye wolde be conquerouris
/ Of Caleis, that litill toun, as it come on youre mynde », v.2-3), « with gret pryde & bost »
(v.21), alors qu’ils en sont en réalité incapables par nature (« But ye to conquere Caleis it
cometh you not of kynde », v.4)432, comme le prouve la suite des événements. Pour le même
auteur, les Flamands sont en effet capables de grandes paroles… mais en aucun cas de
grands actes : « Ye be nothing elles worth but gret wordes to camp » (v.65).
En effet, nos auteurs s’attachent à ridiculiser les Flamands en tant que soldats. C’est ainsi
que, premièrement, l’auteur de Mockery décrit d’une manière éminemment comique
l’engagement avec l’Earl de Mortain devant Gravelines. De fait, il utilise l’ironie pour
raconter comment les Flamands tombent « bravement » sur les soldats anglais (« as men
bold », v.7), et, surtout, il détourne la traditionnelle métaphore du lion, synonyme de
bravoure militaire, en affirmant que les Flamands se montrent alors aussi redoutables que
des « lions des Cotswolds » (« Com rennynge on hym as fersli as lyons of Cotteswold », v.8),
429 Brut, p.572. 430 Historical Poems, p.78-79. 431 Ibid, p.81. 432 Ibid, p.84.
81
région d’Angleterre associée à la laine… et au mouton ! L’auteur n’épargne pas non plus les
Flamands en ce qui concerne la description de leur équippement militaire, qui montre bien
qu’ils ne sont guère un peuple de guerriers, puisqu’il inclut des « casques rouillés » (« rusti
kettill-hattes », v.9), des piques « tout-à-fait appropriées pour embrocher des rats » (« With
long pykes- goden daghes for to stikke the rattes », v.9), et d’étranges tuniques rembourées,
semblables à des sacs ou à des matelas (« & eke with side Iakes / […] lyke to sakes, / Stoppid
al with hempen tawe, and that in straunge wise, / Stiched like a matrace al of the newe
gyse », v.11-14) ! De même, les Flamands se battent si bien contre les Anglais qu’à la fin, ce
sont eux qui gisent à terre au nombre de 300 (« Ye laid vpon th’englisshmen so myghtily with
your handes, / Til of you iij hundrid lay strechid on the sandes », v.15-16), alors que Mortain
n’a pas perdu un seul homme (« & lost neuer a man », v.19)433 !
Cependant, c’est une autre stratégie qui est adoptée pour décrire le siège de Calais, dans la
mesure où tous les auteurs s’accordent à relever les incroyables effectifs et moyens de
l’armée de Philippe le Bon, afin de mieux ridiculiser leur défaite finale. C’est ainsi que
l’auteur du Siege of Calais adopte une tonalité faussement épique pour raconter comment
Philippe assemble, à travers l’ensemble de ses Etats (« The Duc of Burgone […] / Made grete
assemble in landes wide, / in flandres and Braband, / Of all the power and Chiualrie / Of
Burgone and of Pykardie, / Of hanaude and holland, v.13-18), une armée qui ne compte pas
moins de 150 000 hommes (« An Cml lti and moo », v.19)434, et pour détailler leurs brillants
préparatifs et équipements militaires, qui incluent des tentes imposantes (« stately tentes
[…] Large, longe, and of gret hight, / It was a riall rowte », v.34-36), des canons et machines
de siège (« With gonnes grete and ordinance », / That theyme myght helpe and avance »,
v.37-38), des larges boucliers (« With many a proude pavis », v.39), et même 1000 coqs
« pour chanter la nuit » et autant de flambeaux (« So many ml cokkes to crow anyght , /And
also cressettes that brenned light », v.43-44)435. Or, il est évident que cette accumulation
porte plutôt à rire, du moins de manière rétrospective. D’ailleurs, on retrouve la même idée
dans Mockery, alors que l’auteur fait également état des 150 000 hommes (« the noumbre
of your host / Was a hundrid thousand & fifty », v.22-23), avant de signaler que, malgré
cette immense armée, les Flamands ne sont pas parvenus à effrayer les Calaisiens, qui n’ont
même pas fermé les portes : « And yette for al youre gret host, erly nothir late, / Caleis was
so ferd of you they shitte neuer a gate » (v.25-26)436 !
De même, les auteurs s’attardent sur les défaites que subissent les Flamands. C’est ainsi que,
dans le Siege of Calais, les ennemis attaquent en poussant de grands cris (« Began to
skirmyssh with shoutes lowde », v.98)… mais sont immédiatement repoussés (But countred
they were anon », v.99). De la même façon, l’auteur de Mockery humilie les Brugeois en leur
rappelant comment ils ont « gagné leurs éperons » (« wan youre shon », v.35) sur la plaine
433 Historical Poems, p.84. 434 Ibid, p.78. 435 Ibid, p.79. 436 Ibid, p.84.
82
de St-Pierre, alors que les Calaisiens les ont mis en fuite et ont amené les prisonniers dans la
ville, poings liés (« tyed fastly by the fist », v.40), avant de raconter comment les Anglais ont
abattu le fort des Gantois « for al youre pride & bost » (v.41), et tué tous ceux qui se
trouvaient à l’intérieur437.
En effet, c’est surtout pour leur lâcheté que les Flamands sont tournés en dérision. C’est
ainsi que l’auteur de Scorn of the Duke of Burgundy engage Philippe à se souvenir de la
lâcheté dont les Picards ont fait preuve devant Arde, en fuyant face aux troupes de Lord
Camoys : « Thay turned her backes as thay were coward » (v.71)438. De même, l’auteur du
Siege of Calais évoque la fuite des Gantois, en même temps que leur duc, et bientôt rejoints
par ceux de Bruges et d’Ypres, qui ne demandent pas non plus leur reste : «The next nyght
[…] / Erly the duc fled away ; / With hym, they of Gaunt ; / And after, Bruges and Ipre bothe,
/ To folow hym were they not lothe » (v.151-155), l’auteur pouvant alors conclure
ironiquement que c’est ainsi qu’ils ont mis leurs paroles à exécution : « Thus kept thay thaire
avaunt » (v.156)439. De manière plus détaillée, l’auteur de Mockery raconte comment les
Gantois se sont enfuis avec leur duc par peur d’Humphrey de Gloucester, « qui pourtant
n’était pas là » (« for dreed and for fere / Of the duyk of Gloucester-& yette was he not
ther ! », v.45-46), avec seulement leurs vêtements sur eux, et sans prendre le temps
d’emmener leurs précieux équipements : « Wel was hym might go before with pison & with
paunce, / And laft behind you for hast al your ordynaunce » (v.47-48). De même, les Picards,
« aussi effrayés que les Flamands » (« As ferd as the fflemynges », v.52), se sont
honteusement (« shamfulli », v.51) enfuis devant Guînes en entendant sonner l’alarme («ffor
ryngyng of the larum bell », v.51), et ont ici encore abandonné leurs canons sur place (« Ye
lost there your ordynaunce of gunnes that was cheff », v.53), à la grande honte de tout leur
peuple (« To you & to al pycardis, shame and gret repreff ! », v.54)440. Enfin, la lâcheté des
Flamands fait l’objet d’un développement de la part de l’auteur du Libelle, qui utilise la
métaphore animalière de la biche, prompte à la fuite : « they wente lyke as a doo, / Wel was
that Flemmynge that myght trusse and goo » (v.292-293), avant de raconter comment les
Flamands, terrorisés par le duc de Gloucester, ont couru se cacher, à l’instar de leur duc :
« For fere they turned bake and hyede faste / […] / They flede to mewe, they durste no more
appere » (v.294-299), ce qui les frappe d’un éternel opprobre : « Rebuked sore for evere so
shamefully / Unto here uttere everelastinge vylany » (v.304-305)441.
Si tout ce qui précède apparaît éminemment lié à une situation politique, voire-même à un
épisode militaire précis, le caractère national des Flamands fait aussi l’objet de quelques
développements purement originaux. C’est ainsi que l’auteur de Mockery démontre que le
caractère ignoble des Flamands remonte aux origines-mêmes de leur peuple. Pour ce faire, il
437 Historical Poems, p.85. Pour ces deux épisodes, voir aussi Brut, p.580. 438 Ibid, p.88. Pour un récit de cet épisode, voir Brut, p.576. 439 Ibid, p.83. 440 Ibid, p.85. 441 Libelle of Englyshe Polycye, p.15-16.
83
se fonde sur un type d’argument très apprécié des médiévaux, l’argument étymologique442.
De fait, il explique que le nom de « fflemynges » vient du verbe flemen, qui signifie
« bannir », de telle sorte que les Flamands sont tous les descendants de hors-la-loi, premiers
habitants de leur province : « ffor flemmynges com of flemmed men, ye shal wel vndirstand,
/ for fflemed men & banshid men enhabit first youre lande » (v.59-60). Ainsi, par extension,
l’auteur peut affirmer que les Flamands ne sont rien d’autre que des brigands, qui devraient
avoir honte de se comparer aux Anglais : « Thus proue I that fflemmynges is but a flemed
man, / And fflaunders of flemmynges the name first began ; / And therfore ye fflemmynges,
that fflemmynges ben named, / To compare with englisshmen ye aught to be ashamed. »
(v.61-64)443.
Surtout, l’auteur du Libelle leur consacre de nombreux développements. En effet, si l’idée de
la fausseté est déjà présente dans le Siege of Calais, alors que l’auteur, toujours sur le même
ton faussement héroïque, présente ironiquement le mois de juillet, celui de l’attaque des
troupes de Philippe le Bon contre Calais, comme la période de la reprise de la guerre, où les
combattants ont l’occasion de s’attirer profit et gloire, en faisant preuve de droiture et
d’honnêteté : « Than cometh tyme of labours, / To profit and worshippe wynne / In armes,
so ther be not ther-in / Vntrouthe ne false colours » (v.9-12)444, c’est l’auteur du Libelle qui
l’exploite le plus. En effet, il y fait référence dans le cas des villes de Poperinghe et Bailleul
(the townes of Poperynge and of Bell », v.251), incendiées par le duc de Gloucester « For
here falshede » (v.253)445, et surtout, il l’élève véritablement au rang de trait national des
Flamands, lorsqu’il évoque leur caractère naturellement trompeur et changeant : « oure
cruell enmyes, / That is to saye Flemmynges wyth here gyle, / For chaungeable they are in
lytel whyle » (v.137-139)446. Enfin, l’évocation de la bière par l’auteur dans son chapitre sur
l’espace hanséatique l’amène à compléter son portrait du Flamand par des considérations
scatologiques. En effet, il s’amuse à raconter comment deux Flamands peuvent boire à eux
seuls un tonneau de bière complet avant d’aller quelque part, de telle sorte qu’ils finissent
par ne plus contrôler leur vessie : « Ye have herde that twoo Flemmynges togedere / Wol
undertake, or they goo ony whethere / Or they rise onys, to drinke a barell fulle / Of gode
berkyne ; so sore they hale and pulle, / Undre the borde they pissen as they sitte » (v.284-
288) ! A cette révélation vient alors s’en ajouter une deuxième, qui se situe au moment de
leur fuite devant Calais, puisque l’auteur affirme alors qu’ils ont déféqué dans leur
nourriture afin de la rendre inutilisable par les Anglais : « Wythoute Calise in ther buttere
they cakked, / Whan they flede home and when they leysere lakked / To holde here sege… »
442 Pour la « passion de l’étymologie » au Moyen Age, voir Bernard Guenée, Histoire et Culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980 (p.184-191). 443 Historical Poems, p.85. 444 Ibid, p.78. 445 Libelle of Englyshe Polycye, p.13. 446 Ibid, p.8.
84
(v.290-292) 447! Les manuscrits de la seconde édition peuvent alors faire un rapprochement
explicite entre les Flamands et la figure animalière du porc : « Thus are they hoggishe »448.
Les Français.
De même, la vision du Français constitue, à tous égards, un véritable cas d’école. De fait, ce
dernier, en raison d’un affrontement politique et militaire pluriséculaire, incarne avant tout
la figure de l’Ennemi héréditaire, ou, selon les mots de William Worcester, de « l’ancien
ennemi » (« oure ancient adversaries »)449. C’est ainsi que, dans la première partie du
corpus, qui correspond à la période des grandes victoires nationales anglaises, les mots
« fraunce », « ffrensshe » et « ffrensshemen » renvoient invariablement à l’image de
l’adversaire. En effet, la paraphrase de la Battle of Agincourt évoque les « ffrenchmen » et le
« ryall powere of ffrensshemen »450 qui viennent couper la route de Calais à Henry V, puis,
de même, les « ffrensshe folk » (v.37) et les « ffrensshemen » (v.45) qui ont trouvé la mort
dans la bataille451. De la même façon, l’Agincourt Carol affirme hautement que la France
pleurera à jamais la victoire d’Henry V à Harfleur : « that fraunce shal rywe tyl domesday »
(v.8)452. De même, the Rose on Branch raconte comment Henry V a fait fâner « toutes les
fleurs de France » : « When the rose by-tyde a chaunce, / Than ffadide alle the floures of
fraunce / And chaungyde hewe » (v.15-17)453. Enfin, c’est le terme de « Fraynysche men »
qui est utilisé de façon préférentielle, avec pas moins de 9 occurrences, par John Page pour
désigner les Rouennais assiégés par l’armée anglaise454.
Quelles sont donc les caractéristiques majeures attribuées au principal peuple ennemi de
l’Angleterre ? Premièrement, on peut noter que, en sus du thème de l’ennemi héréditaire, la
vision du Français correspond principalement à celle du sujet rebelle. En effet, le fait que les
Français refusent de se plier aux revendications légitimes du roi d’Angleterre ne peut que
témoigner d’un goût naturel pour l’injustice et d’un orgueil démesuré. C’est ainsi qu’on
connaît bien l’exclamation du chapelain, auteur des Gesta Henrici Quinti, qui, ayant résumé
le sermon d’ouverture du parlement de mars 1416 prêché par Henry Beaufort, se demande
pourquoi le « misérable » peuple français « à la nuque raide », ne peut se résoudre à
accepter les preuves divines du bon droit du roi d’Angleterre : « O Deus ! Cur non paret haec
gens misera et durae cervicis tot terribilibus divinis sententiis […] obediri ? »455. En effet,
c’est bien cette idée de l’entêtement des Français qui est exprimée dans le sermon de 1416,
447 Libelle of Englyshe Polycye, p.15. 448
Ibid, p.17. 449 Boke of Noblesse, p.4. 450 Historical Poems, p.74. 451 Ibid, p.77. 452 Ibid, p.91. 453 Ibid, p.93. 454 On trouve également un emploi de l’expression « Fraynysche pepylle », p.42. 455 Henrici Quinti, Regis Angliae, Gesta, Benjamin Williams (ed.), Londres, 1850, p.74.
85
alors qu’ils se refusent à négocier avec Henry V : « les Franceis, pleins d'orguille, et riens
pensantz de lour dit rebuc, ou fiblesse, nullement vorront a ceo applier »456.
C’est ainsi que l’orgueil français fournit aux auteurs l’un de leurs thèmes de prédilection.
Dans le Brut, il s’incarne ainsi parfaitement dans la figure du Dauphin Louis de Guyenne qui,
en réponse aux revendications légitimes d’Henry V, envoie à ce dernier des balles de tennis
en signe de mépris : « & yn scorne & despite he sent to hym a tonne fulle of teneys-ballis,
be-cause he schulde haue sumwhat to play with-alle, for hym & for his lorde3 »457.
Exactement de la même manière, différentes versions du Brut se plaisent à rappeler les
fanfaronnades des Français à la veille d’Azincourt, alors qu’ils célèbrent à l’avance une
victoire qu’ils considèrent comme acquise d’office, et qu’ils vont jusqu’à « jouer aux dés » les
combattants anglais : « And alle ny3t before the bataile, the Frenschmen made mony grete
fires, and moche revell with hontynge, and played our King and his lorde3 at the dys, and an
archer for a blanke of hir moneye »458, « And the Frenshmen, al the nyghte before […] made
muche revell, and cryeng and shoutyng, al the nyghte, and plaiet Englisshemen at the dyce,
euery archer for a blank »459. C’est cette même accusation d’orgueil qu’on retrouve dans la
Agincourt Carol, qui rappelle comment Henry V a pu se rendre de Calais à Azincourt, malgré
les vantardises des Français : « Than went our kynge with alle his oste / Thorwe fraunce, for
alle the frenshe boste » (v.9-10)460. Même chose encore chez William Worcester, qui
dénonce l’orgueil des adversaires (« they holde theym […] so proude »461), en s’appuyant sur
des exemples historiques. En effet, en choisissant l’exemple de l’orgueilleux roi gaulois
Bituitus, qui méprise à tort la petite armée romaine qui lui fait face, en affirmant qu’elle ne
compte pas assez d’hommes pour nourrir les chiens de son armée (« he despraised hem, and
seid of gret pride that there were not inoughe of the Romains for to fede the doggis of his
oost »), et en insistant fortement sur l’identité entre la Gaule et la France (« the countre of
Gaule clepid Fraunce ») et entre les Gaulois et les « Frenshemen », il sous-entend peut-être
que l’orgueil représente chez les Français un trait ancestral462. De même, Worcester
rapporte incidemment, dans son chapitre sur l’importance du respect de l’Eglise, les
vantardises des Français avant Poitiers en 1356, alors que les capitaines se félicitent de
pouvoir bientôt utiliser la cathédrale de Salisbury comme écurie pour leurs chevaux (« suche
chieveteins […] avaunted hym silfe to stabille her hors in the cathedralle chirche of
Salisbury ») !463
Or, si les auteurs s’attachent continuellement à relever l’orgueil des Français, c’est aussi
pour avoir le plaisir de décrire son abattement final. C’est dans cette optique que John
456 PROME, parlement de mars 1416, item 3. 457 Brut, p.374. 458 Ibid, p.378. 459 Ibid, p.555. 460 Historical Poems, p.91. 461 Boke of Noblesse, p. 41. 462 Ibid, p.27. 463 Ibid, p.75.
86
Audelay rapporte comment Charles VI, ayant constaté l’absolue supériorité militaire d’Henry
V, envoie de lui-même des messagers au roi d’Angleterre pour réclamer la paix : « The kyng
of frawns then was agast, / Mesagers to him send in hast, / ffore wele he weste hit was bot
wast / Hem to witstond in hone way » (v.25-28)464. Surtout, cette thématique se trouve au
centre du poème de John Page. De fait, si l’orgueil des Rouennais se manifeste dès les
premières pages, alors qu’ils congédient les hérauts anglais venus réclamer leur soumission
(« To meke hem to oure kyngys methe ») d’un simple geste de la main («To that the cytte gaf
non answere, / But prayde oure herrowdys furthe to fare. / They made a maner skorne with
hyr honde / That they there shulde not longer stonde »465, ce qui amène Page à décrire
Rouen comme une « cytte of grete pryde »466, la démonstration de l’auteur porte surtout sur
le changement d’attitude des Rouennais face à l’adversité, alors que l’orgueil fait place au
malheur : « There as was pryde in ray be-fore, / Thenn was hyt put in sorowe fulle soore »467,
idée qui se trouve encore amplifiée dans la paraphrase qu’en donne le Brut, puisque l’orgueil
et la vantardise se changent en gestes de désespoir : « and there as was firste ioy and pryde,
and grete boste, tho was there amonge hem weylynge, sorow and care, and wepyng, and
wryngynge with hondis »468. De fait, si Page se montre sensible aux souffrances endurées par
les Rouennais assiégés, qu’il décrit de manière poignante, il n’a aucun doute sur le fait
qu’elles leur sont infligées en punition de leur injustice et de leur orgueil : « There myght
men lerne alle there lyve, / What was a-gayne ryght for to stryve »469, comme l’affirme
également la paraphrase du Brut, qui en fait un châtiment divin : « her vnrightwesnesse and
her cursyd leuynge and pryde that regnyd amongis hem in tho dayes, wherefore God sent
hem a yerd of chastisement »470. C’est ainsi que, poussés par la faim, les Français
abandonnent leur attitude orgueilleuse pour adopter la posture du suppliant face à Henry V :
« As sone as the Fraynysche men hym se / That lorde be fore they fylle on kne »471, et
surtout, finissent par s’amender en reconnaissant son bon droit (« [He] askysse no thynge
but hys ryght »)472, les habitants enjoignant à leurs représentants de renoncer à leur orgueil
et de se soumettre à leur suzerain (« Wolde ye obey unto oure lege, / Thenn wolde he sesse
of hys sege. / But for […] / Youre pompe and youre grete pryde »)473, et recevant ensuite
Henry V avec allégresse : « Alle the pepylle of that cytte, / They sayde, ‘Welcome, oure lege
so fre, /Welcome in to youre oune ryght, / As hyt ys the wylle of God Almyght’ »474.
464 Historical Poems, p.109. 465 Historical Collections of a Citizen of London, p.2. 466 Ibid, p.6. 467 Ibid, p.19. 468 Brut, p.401. 469 Historical Collections of a Citizen of London, p.36. 470 Brut, p.401. 471 Historical Collections of a Citizen of London, p.29. 472 Ibid, p.33. 473 Ibid, p.38. 474 Ibid, p.44.
87
Naturellement, le portrait traditionnel de l’adversaire ajoute la déloyauté à l’orgueil. En
effet, de tous temps, les auteurs anglais associent les Français à la fausseté, comme en
témoigne l’expression assez courante de « french fare » pour désigner la parole mensongère
et trompeuse475. De même, c’est dans un document envoyé par Henry V au concile de
Constance que se forge l’expression de « Gallicana duplicitas »476. En effet, l’idée de la
déloyauté de l’adversaire fait l’objet de nombreux développements, tout au long de la
guerre. C’est ainsi qu’Humphrey de Gloucester, dans une protestation prononcée dans le
cadre du parlement de 1439 contre la prochaine libération de Charles d’Orléans, met son
neveu en garde contre la « subtelty » et la « cautele » de l’ennemi français477, de même que
l’Earl de Somerset, alors lieutenant du roi d’Angleterre et France et en Normandie, adresse
dix ans plus tard un avertissement aux parlementaires, dans lequel il est question des
«froward dedes » des Français478. De fait, c’est bien cette déloyauté qui caractérise les
Français aux yeux de William Worcester, puisqu’ils agissent « ayenst alle honoure and
trouthe of knyghthode »479. Surtout, l’auteur n’hésite pas à affirmer que c’est cette
malhonnêteté profonde qui est la cause principale des revers anglais en France. En effet, il
affirme dès les premières pages du Boke of Noblesse que l’expulsion de Normandie s’est
faite au moyen de « ruses subtiles », sous couleur de la trêve (« tho roughe subtile wirkingis
conspired and wroughte be the Frenshe partie undre the umbre and coloure of trewis »)480.
Les Français se sont en effet appliqués à reconduire d’année en année la trêve conclue en
1444 à Tours (« trewis and abstinence of werre late hadde and sacred at the cite of Tairs »),
jusqu’à ce qu’ils aient obtenu l’avantage (« till they had conspired and wrought theire
avauntage »), au moyen de cette traitrise (« by intrusion of soche subtile dissimilacion »)481.
L’auteur consacre ensuite un paragraphe entier à démontrer « How the Frenshe partie
began first to offende and brake the Trewis », en usant de mauvais procédés (« by subtile
undew meanys of a cautel », « be right undew meanys »)482. Il reproche alors à ses
compatriotes d’avoir accordé une confiance trop grande à un adversaire qui n’en était
absolument pas digne (« over grete favoure and trust put to youre adversaries »)483. Surtout,
pour l’auteur, il ne fait pas de doute que la tendance des Français à la trahison est
multiséculaire, et constitue chez eux un véritable trait national. Ils semblent de plus avoir
développé un talent naturel pour cet art, puisqu’ils sont décrits comme « sotill and crafty in
suche deceitis conspiring »484. Ici encore, sa démonstration s’appuie sur de multiples
arguments historiques, qui remontent aux débuts du conflit franco-anglais et qui sont pour
475 Voir Deanne Williams, The French Fetish from Chaucer to Shakespeare, Cambridge, 2004 (p.11). 476 Voir Joanna Bellis, « Rhymes sette for a remembraunce », op.cit. (p.202). 477 PROME, parlement de novembre 1439, Annexe 2. 478 PROME, parlement de février 1449, item 17. 479 Boke of Noblesse, p.25. 480 Ibid, p.3. 481 Ibid, p.5. 482 Ibid, p.5. 483 Ibid, p.25. 484 Ibid, p.41.
88
lui l’occasion d’affirmer la continuelle responsabilité des Français dans la rupture des trêves
(« Nota fallacias Francorum in rupcione treugarum »). Il est ainsi question des trêves
conclues entre les rois de France et d’Angleterre sous Henry II et ses fils, à chaque fois
rompues par les rois de France dès qu’ils y trouvaient avantage (« alle waye whan the
Frenshe partie could have and fynde any avauntage or coloure to breke here trewes they did
make new werre ayenst this lande »), de même que celles conclues de Henry III à Edward
III485. Surtout, l’attaque de Worcester se concentre sur la rupture de deux traités en
particulier, dans la mesure où ils prévoyaient un règlement définitif du conflit : le traité de
Brétigny de 1360, décrit comme « a final generalle peas » qui, jurée par les deux souverains
en présence du Pape, des hauts dignitaires de l’Eglise et des grands seigneurs, a pourtant été
rompue « fraudulentlie be feyned causes and colourable quarellis of the Frenshe partie486 » ;
et bien-sûr le traité de Troyes de 1420, « finalle peas made solemnelie at Trois in
Champayne », censé mettre un terme à toutes les querelles entre les deux royaumes (« alle
divisions and debates betwene the roiaume of Englande and the roiaume of Fraunce shulde
for ever cease »), mais qui, d’après l’auteur, n’a pas tenu longtemps après la mort d’Henry
V487. Worcester peut donc conclure que les Français ont pour coutume de ne considérer que
leur avantage, en faisant fi de leurs serments : « And none of alle these trewes hathe ben
observed ne kept, notwithstanding any sacremente, othes, [or] promisses made by youre
adversarie and be […] the seide Frenshe partie », but alway brake the saide trewes whan
they coude take any avauntage ayenst us »488.
A ces accusations vient bien-sûr s’ajouter celle de la lâcheté, alors que Worcester se plaît à
montrer que les Français ont souvent fui la bataille. De fait, il évoque, dans son récit de la
bataille de Poitiers de 1356, la fuite de nombreux grands personnages, parmi lesquels
figurent le futur Charles V (« the kingis eldist sonne Charlis calling hym duc of
Normaundie »), et son frère Jean, futur duc de Berry (« the erle of Peiters that after was
clepid [Johan] the duc of Berrie »)489. De même, la fuite est considérée comme une habitude
des Français : « gret part of the said adverse partie have voided, fledd, and forsake the feeld
and theire felouship »490. Cependant, il est intéressant de noter que John Page échappe au
cliché, alors qu’il préfère décrire les défenseurs de Rouen comme de redoutables hommes
de guerre. C’est en effet le cas du capitaine Gui le Bouteiller (« Gy the goode Botlere » !), qui
devait certes se ranger aux côtés d’Henry V après la capitulation de la ville, et qui est ici
décrit comme un homme de grande réputation (« a man of grete renowne »), mais aussi de
« Monsenyour Antoyne », valeureux guerrier (« werryour wyght »), d’un certain « John
Mawtrevers », salué pour sa noblesse (« that [nobylle] man »), ou encore d’un dénommé
485 Boke of Noblesse, p.34-36. 486 Ibid, p.37. 487 Ibid, p.39. 488 Ibid. 489 Ibid, p.14. 490 Ibid, p.47.
89
« Gaunt Jaket or Jakys », homme de guerre expérimenté (« of werrys wyse »)491. Plus
généralement, les Rouennais sont de redoutables adversaires, salués par Page pour leur
bravoure (« And there-to they were fulle hardy in dede / Bothe in foote and eke in stede »),
au point qu’ils figurent parmi les meilleurs soldats qu’il ait jamais vus (« And als prowde men
as evyr I saye »), et nombre d’entre eux témoignent d’une bonne connaissance du métier
des armes (« And poyntys of warre many one dyd shewe »). A l’excellence de leur
comportement guerrier vient s’ajouter le meilleur équipement possible (« Rychely arayde at
the beste »), de telle sorte que, lorsqu’ils effectuent une sortie, il est aussi plaisant de les
regarder qu’il est difficile de les contrer : « Hyt was grete lykyng hem to hede ; / To counter
hem hyt was grete drede »492.
Enfin, une autre accusation traditionnelle est celle de la cruauté. En effet, c’est bien de
cruauté qu’il est question chez William Worcester, alors qu’il dénonce le traitement réservé
au pauvre Gilles de Bretagne, qui meurt en prison par suite des mauvais traitements qui lui
sont infligés à l’encontre de toute pitié (« ayenst all manhode ungoodely entretid »)493. De
même, elle est évoquée sans ambages par John Page, qui affirme que les Français se
montrent très cruels et ne font preuve d’aucune pitié quand ils ont l’avantage : « For when
hyt lay in there lotte / They were fulle cruelle, God hyt wote, / And marcy wolde they non
have »494. Surtout, l’auteur met en scène cette cruauté des Rouennais, qui se manifeste
parfaitement alors que les habitants commencent à mourir de faim. En effet, on assiste alors
à une diabolisation de l’assiégé, qui, réduit aux dernières extrémités, fait preuve d’un
égoïsme total. C’est ainsi que la mère garde la nourriture pour elle plutôt que de la donner à
son enfant mourant : « Yf the chylde schulde be dede, / The modyr wolde not gyf hyt
bredde, / Ne nought wolde parte hyt a scheve / Thoughe sche wyste to save hys lyve », et
que l’enfant, de même, ne la partage pas avec sa mère : « Ne the chylde the modyr gyffe »,
et doit se cacher d’elle pour manger. De fait, alors que chacun espère survivre aussi
longtemps que possible (« Every on caste hym for to leve / As longe as they myght laste »), la
fin prend le pas chez eux sur les sentiments d’amour et d’affection : « Love and kyndenys
bothe were paste. / […] / But hunger passyd kynde and love, / By that pepylle welle ye may
prove »495. Surtout, les dirigeants de la ville décident alors d’expulser les pauvres de la ville,
parmi lesquels figurent des femmes, des enfants et des vieillards. Cette décision représente
alors, aux yeux de l’auteur, un péché (« grete syn ») et un acte de cruauté caractérisé, qui,
de manière assez spectaculaire, pousse même les malheureux à renier leur nation : « meny
of them sayde they hadde levyr ben slayne / Thenn in to the cytte goo a-gayne. / They
turnyd thenne with murmuracyon, / And cursyd hyr owne nacyon »496.
491 Historical Collections of a Citizen of London, p.13-14. 492 Historical Collections of a Citizen of London, p.14-15. 493 Boke of Noblesse, p.5. 494 Historical Collections of a Citizen of London, p.36. 495 Ibid, p.19. 496 Ibid, p.20. A ce sujet, voir aussi Tamar S. Drukker, « 'An Eye-Witness Account or Literary Historicism?’ John Page's Siege of Rouen », op.cit.
90
Cependant, si les auteurs s’attachent à relever chez les Français, tout au long de la période,
les caractéristiques traditionnelles de l’adversaire, on assiste également au développement
d’un discours parallèle alors que les Français deviennent les sujets du roi anglais. En effet,
c’est bien le souci de gagner les cœurs de ces nouveaux sujets qui se trouve au centre des
ordonnances disciplinaires promulguées par Henry V puis par John de Bedford, visant
essentiellement à empêcher la maltraitrance des populations locales par les soldats en
Normandie497. C’est ainsi que John Page signale le statut des Rouennais au moment de la
reddition de la ville. En effet, les négociations prévoient que, s’ils ne sont pas secourus par le
roi de France ou le duc de Bourgogne dans les huit jours, les bourgeois de Rouen
renonceront alors à leur ancienne allégeance pour devenir les sujets d’Henry V : « Many of
us wolde them refuse, / And to you delyvery youre cytte / And many of us youre lege men
be »498, et même des sujets « anglais » : « In viij dayes, I you tolde, / If noo rescowe unto that
holde, / They shulde delyvyr that cytte / And the burgonys Englysche be »499. De même, les
conditions stipulent que tout Normand qui refusera de prêter hommage au roi d’Angleterre
sera emprisonné : « And thoo that was a Norman borne, / And Englysche men wolde not be
sworne, / Presener he shulde be us tylle, / Oure kynge hym to ponysche at hys wylle »500.
Surtout, le régime de la Double-Monarchie, qui prend soin cependant d’observer la
distinction entre les deux peuples, qui conservent leur indépendance et leurs coutumes
respectives, fait de la réconciliation entre les Anglais et les Français l’un de ses thèmes de
prédilection. En effet, il est révélateur que Bedford, dans ses Ordonnances mentionnées plus
haut, ait éprouvé le besoin de clarifier un point de vocabulaire, en interdisant aux sujets du
roi d’Angleterre de désigner l’Ennemi comme étant « les Français », alors que le terme qui
convenait était celui d’ « Armagnacs », renvoyant spécifiquement aux partisans de Charles
VII : « plusieurs de noz subgiez, tant angloys comme normans et autres de notre obeissance,
quant ilz parlent ou font mencion de noz ennemys, Rebelles, traitres et adversaires que l'en
appelle armagnacz, ilz les nomment et appellent francoy »501. De fait, alors que John
Audelay, dans un discours rétrospectif et encore fortement imprégné de militarisme,
n’hésite pas un instant à employer le mot de « frenchemen » (v.19)502, John Lydgate, dans
son Mumming at Eltham, observe bien la distinction entre les « rebelles », soit les
Armagnacs, dont Dieu étouffera la « cruelle guerre » (« And in youre rebelles, wheche beon
497 Pour le texte des Ordonnances disciplinaires d’Henry V, voir Harriss Nicolas, The History of the Battle of Agincourt, op.cit. Annexe VIII (p.31-44). On pourra aussi consulter Anne Curry, « The Military Ordinances of Henry V: Texts and Contexts », op.cit. Pour les Ordonnances promulguées par le régent Bedford (analyse et textes), voir B.J.H Rowe, « Discipline in the Norman Garrisons under Bedford, 1422-35 », in The English Historical Review, Vol. 46, No. 182 (Apr., 1931), p. 194-208. 498 Historical Collections of a Citizen of London, p.31. 499 Ibid, p.40. 500 Ibid, p.41. Si les termes « Englysche » et « Englysche men » appliqués aux Rouennais ont de quoi surprendre, il semble qu’ils traduisent ici un changement d’allégeance politique bien plus qu’un quelconque changement de nationalité… 501 B.J.H. Rowe, « Discipline in the Norman Garrisons… », op.cit. (p.205). 502 Historical Poems, p.109.
91
now reklesse, / He stint shal of Mars the cruwel werre », v.24-25), et l’ensemble des sujets
français d’Henry VI, de même qu’il exprime le souhait que Dieu « unisse les cœurs
d’Angleterre et de France » (« He ioyne the hertes of England and of Fraunce », v.33)503. De
fait, si on peut peut-être déceler une trace de la vieille accusation d’injustice et de fausseté
dans un passage ambigu de l’éloge qu’il fait de Laurent Calot à la fin du Title and Pedigree,
affirmant que, « parmi tous les Français, il y en avait un qui ne s’écartait pas de la vérité » :
« Of Frenssh-men oonly there was oon / From the trouth which wold not varie » (v.263-
264)504, le discours de Lydgate est généralement vibrant d’amour et de pacifisme. C’est ainsi
qu’il enjoint à son jeune souverain, dans la Ballade qu’il lui adresse à l’occasion de son
couronnement, d’ « aimer ses sujets des deux pays », sous-entendu, de la même manière :
« Loue thy lyeges of eyther regyoun » (v.125)505. De même, on retrouve encore la
thématique de l’union des cœurs lors de l’Entrée d’Henry VI à Londres après son
couronnement parisien, alors que Lydgate affirme que son règne finira par rétablir la paix,
de telle sorte que les habitants des deux royaumes seront ses fidèles sujets, et ce « d’un
même cœur » : « Sesyng off werre, that men mow ryde or goon / As trewe lieges, theyre
hertes made both oon » (v.97-98)506.
Plus tardivement, William Worcester établit encore la distinction essentielle entre les
partisans de Charles VII et l’ensemble du peuple français. En effet, de manière étonnante, il
semble alors faire du mot « Frenshe » un vocable partisan. De fait, sur 27 occurrences totales
de l’adjectif, pas moins de 17 sont associées au mot « partie », ou « adverse partie ». De
même, 8 d’entre elles renvoient aux rois de France, dont 2, développées en « prétendu roi
de France » (« calling hym Frenshe king »), et appliquées à Philippe VI et à Charles VII,
insistent sur leur illégitimité507. Enfin, deux autres s’appliquent à la « Frensh navye » vaincue
à la bataille de la Seine, et aux « Frenshe lordis » de Philippe VI. Inversement, l’appellation
plus « nationale » de « Frenshemen » n’apparaît en tout et pour tout que 3 fois dans le Boke
of Noblesse, désignant à deux reprises les soldats français à Verneuil, et aussi les soldats
gaulois de Bituitus évoqués plus haut. A l’inverse, il est intéressant de constater que le mot
de « Frenshe » n’est jamais appliqué aux Français en tant que sujets des rois d’Angleterre. En
effet, ces derniers ne sont désignés que par des expressions visant à affirmer leur loyauté au
roi. Ils sont ainsi appelés « youre obeissauntes subgettis »508 ou « yowre people true
subgettis of Fraunce »509. De même, leur situation fait l’objet de plusieurs développements
de la part de l’auteur. C’est ainsi qu’il démontre que la « privacion » des duchés de Guyenne
et de Normandie a contraint plusieurs milliers de sujets d’Henry VI à renoncer à leur
503 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.673. 504 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.620. 505 Ibid, p.629. 506 Ibid, p.633. 507 De même, Philippe VI et Jean II sont présentés comme les « usurpateurs » (« occupieris ») du royaume de France, Boke of Noblesse, p.40. 508 Boke of Noblesse, p.30. 509 Ibid, p.49.
92
allégeance pour prêter hommage à Charles VII, bien à contre-cœur : « many a thousand
peple of nobles and others coherted and be force ayenst theire hertis wille and entent to
become homagiers to youre saide adversarie »510. Surtout, l’auteur affirme que les Anglais
sont à blâmer pour ne pas s’être assez souciés du bien-être de ces fidèles sujets (« And as
welle as in defaute of largesse to youre obeissauntes, not rewarding ne cherisshing youre
obeissauntes subgettis yolden and sworne stedfastly abiding under your obeissaunce), qui
ont été soumis à diverses charges et impositions toujours plus lourdes (« suffring them to be
oppressid and charged unduely in divers wises, as well by over gret taskis and tailis rered
uppon them »), de même qu’ils se sont trouvés contraints de fournir gratuitement de la
nourriture aux hommes mal-soldés et à leurs chevaux (« and therto they finding bothe
horsmete and mannysmete to youre soudeours riding be the contre without contending or
agreing hem »). C’est ainsi que, faute de solde, les hommes du roi d’Angleterre ont eu besoin
de recourir au pillage et à l’extorsion contre ceux-là mêmes qui étaient leurs alliés et les
sujets de leur prince (« pillage, extorcion, and rapyn uppon the countreis of here frendis that
be yolden undre obeisaunce of here prince »)511. Plus loin, Worcester révèle également que
les malheureux paysans normands ont été victimes de mauvais traitements et de violences
physiques (« crueltees », « duresse »), puisque les soldats les ont maintes fois menacés et
battus (« manassed [and] beten »), de même qu’ils ont blessé leurs bêtes avec leurs armes
(« mischieved theire bestis withe theire wepyns »), alors-même qu’ils n’avaient rien à se
reprocher et se comportaient « comme de fidèles sujets anglais » (« lyvyng under youre
obeissaunce […] and yeldyng to youre lawes as trew Englisshe men done ») ! C’est ainsi que,
s’ils ont finalement « détourné leur cœur » des Anglais (« turned their hertis frome us »), la
faute ne saurait leur en être imputée. En effet, Worcester affirme bien que leur « rébellion »,
soit leur abandon de la cause anglaise et leur ralliement à Charles VII, est due à leur situation
désespérée (« wanhope »), ainsi qu’à un profond sentiment d’injustice, alors que ce sont
justement ceux qui étaient censés les protéger qui les ont persécutés (« seeing theym thus
ungoodelie entretid under tho whiche were comytted to kepe, defende, and maynteyn
them »)512 !
510 Ibid, p.38. 511 Boke of Noblesse, p.30-31. 512 Ibid, p.72-74.
93
III) La de finition de l’ «Englishness» face a l’Etranger.
A) La description du caractère national : vices des étrangers et vertus
anglaises.
1) L’éloge du caractère national.
La caractérisation de ces peuples, intéressante en elle-même, ne peut se comprendre tout à
fait sans être rapprochée de l’image opposée que les Anglais se font de leur propre identité.
C’est ainsi que, bien souvent, le stéréotype national est utilisé comme « pendant négatif des
valeurs positives véhiculées par les autres »513, alors que l’image de l’Etranger « devient un
prétexte à différenciation et à concurrence dans la recherche de sa propre identité »514, et
joue ainsi un rôle essentiel dans la naissance du sentiment national. En nous tournant à
présent vers la description du caractère national anglais à laquelle se livrent nos auteurs,
nous espérons mettre au jour le mécanisme décrit par Bernard Guenée, selon qui « le
sentiment national ne se contente pas de distinguer le naturel de l’étranger », mais « exalte
le premier autant qu’il abaisse le second »515.
C’est ainsi que, sans surprise, le contexte d’affrontement préside au développement du
mythe de la vaillance et de la valeur militaire des Anglais, dans le but de les distinguer
clairement de leurs adversaires. Bien-entendu, le contexte triomphal du règne d’Henry V, où
l’orgueil national anglais semble atteindre des sommets, se prête tout particulièrement à ce
type de démonstration. De fait, la première mention de cette vaillance ancestrale anglaise
correspond, dans notre corpus, au moment d’Azincourt, dans la paraphrase en prose qui
précède les vers de la Battle of Agincourt. L’idée de l’équivalence parfaite entre la nationalité
anglaise des combattants et leur nécessaire courage en bataille y est exprimée avec force,
sans ambiguïté aucune, le roi apostrophant ses troupes en ces termes : « And thenke, be
englysshemen, that neuer wold fle at no batelle »516.
De même, cette vaillance ancestrale, littéralement inscrite dans les gènes de la nation
anglaise, fournit à Worcester un de ses principaux arguments pour encourager ses
compatriotes à la reprise de la guerre en France. C’est ainsi que, dans un chapitre les
engageant à remédier au tort qui leur a été fait par les Français (« A exortacion of a
courageous disposicion for a reformation of a wrong done »), il fait hautement valoir cet
aspect essentiel de l’Englishness, définie par le courage et les capacités guerrières, qui ont
toujours permis aux Anglais de mettre en échec toutes les nations hostiles confondues,
513 L.Harf-Lancner, in « Les frontières de l’Europe et de la civilisation dans les chroniques de Froissart », cité par Laurence Moal, l’Etranger en Bretagne au Moyen Age, op.cit. (p.314). 514 Laurence Moal, Ibid (p. 347). 515 Bernard Guenée, « Etat et Nation », in L’Occident aux XIVe et XVe siècles, op.cit, p.113-132 (ici, p.132). 516 Historical Poems, p.75.
94
quelle qu’ait été leur puissance : « For were ye not sometyme tho that thoroughe youre gret
[prowesse,] corages, feersness, manlinesse517, and of strenght overleid and put in
subgeccion the gret myghte and power of the feers and puissaunt figheters of alle straunge
nacions that presumed to set ayenst this lande ? 518». Plus loin, l’auteur relève encore cette
spécificité anglaise, lorsqu’il rappelle à ses compatriotes que leur royaume a toujours
possédé, proportionnellement (!), le nombre le plus élevé de nobles chevaliers (« haveng
alway […] the habondaunce of noble men of chevalrie, passing alle othir landes after the
quantite and afferaunt of youre roiaume »), avant de les engager à suivre l’exemple de la
« prowesse » et de la « vaillauntnesse » de leurs excellents prédécesseurs, qui ont gagné
beaucoup d’honneur (« worship ») par leurs victoires (« victorious dedis »)519.
Sans surprise, pour Worcester, c’est bien dans cette spécificité anglaise que se trouve la clé
des succès militaires antérieurs en France, par exemple sous le règne d’Edward III qui, nous
dit-il, never atteyned to that souvraine honoure but by valiauntnes of Englishe men, which
have in prowes avaunced hem, and governed so nobly… »520.
Surtout, cette qualité anglaise essentielle constitue pour l’auteur un critère de
différenciation par rapport aux autres peuples, dans la mesure où ses compatriotes ont
toujours, par le passé, fait la preuve de leur courage, « in difference of other nacions »521.
Plus loin, il semble bien que cette même idée soit à l’œuvre lorsque Worcester raconte que
Henry Grosmont, premier duc de Lancastre et modèle de chevalerie, avait pour habitude
d’éduquer dans sa maison de jeunes chevaliers venant des quatre coins de l’Europe (« of
straunge regions, as out of Spayne, Aragon, Portingale, Naverre, and out of France »), pour
leur permettre « to see noblesse, curtesie and worship », ce qui leur a assuré une réputation
unique partout où ils se rendaient (« Wherthoroughe here honoure spradde and encresid in
all londis they came unto »). En effet, cet exemple lui permet sans-doute de confirmer le
caractère unique des Anglais en matière militaire et chevaleresque, et ainsi, de poser
l’Angleterre comme modèle, et même comme école de chevalerie à l’échelle de l’Europe
toute entière522. De même, cette supériorité militaire absolue s’exprime à merveille dans le
cadre du conflit franco-anglais, alors que, comme l’affirme Worcester, les Français, toujours
beaucoup plus nombreux sur le champ de bataille, ont constamment été vaincus par les
Anglais « it hathe bene alway seen that the power of Fraunce have be in nombre of peple
517
Sur la mise en scène de la « manhood » dans le Boke of Noblesse, voir Christopher Fletcher, « La force politique de la manhood. L’exemple du Boke of Noblesse de William Worcester », téléchargé le 15/01/2014 sur https://www.academia.edu 518 Boke of Noblesse, p.9. 519 Ibid, p.43. 520 Ibid, p.20. 521 Ibid, p.43. 522 Ibid, p.77.
95
assembled ayenst youre power by double so many, or by the thrid part, yet […] few peple
have descomfited the gret multitude of your adverse partie »523.
De plus, cette identification de la bravoure comme une vertu nationale anglaise nous amène
à une autre considération, non dénuée d’intérêt en ce qui concerne les modes de
représentations médiévaux. En effet, si nous avons relevé plus haut l’emploi d’épithètes
animalières servant à désigner et à ridiculiser l’ennemi étranger, nos auteurs ont également
recours à ce type de métaphores pour décrire le caractère national anglais, cette fois bien-
sûr avec une connotation positive. C’est ainsi que la métaphore du lion, emblème-même de
la valeur chevaleresque, et peut-être aussi, implicitement, de la royauté anglaise524, est
récurrente dans le Boke of Noblesse, d’abord à titre de vérité générale et comme une
incitation destinée par Worcester à ses compatriotes525, mais aussi plus directement
appliquée à la nation anglaise, et plus précisément attachée aux chevaliers de la Jarretière,
« of the condicions of lyons fighting withe gret strenght »526, parmi lesquels est
particulièrement signalé John Chandos, héros anglais de la première phase de la guerre de
Cent Ans : « the full noble knight, a felow of the Garter, ser Johan Chaundos, as a lion
fighting in the feelde », sous les ordres d’Edward de Woodstock, également « of the lion
condicion »527 ! En effet, les chevaliers de cet Ordre national par excellence semblent, dans
le discours de Worcester, incarner parfaitement les valeurs du peuple anglais tout-entier : en
effet, c’est l’engagement à ne pas fuir en bataille qui constitue la règle d’or des chevaliers
qui, comme l’affirme l’auteur, n’ont jamais pris la fuite, mais, en raison de leurs « gret
prowesse and […] manlynesse », n’ont jamais hésité à se mettre en péril pour défendre les
droits de leur souverain ainsi que ses sujets : « none suche were never sene withdrawers or
fleers frome batailes or dedis of worship […] and defendid your roiaume of Fraunce frome
your adversaries, preservyng theire prince’s right and theire subgettis »528.
C’est ainsi que la bravoure fait l’objet, chez nos auteurs, de très nombreux développements,
la valeur militaire (« manhode ») individuelle dont font preuve les personnages évoqués et
l’honneur (« worship ») qu’ils y gagnent retombant également sur l’ensemble de leur nation,
comme l’exprime très bien l’auteur du Libelle, pour qui les hauts-faits de John de Bedford à
la bataille de la Seine sont relatés « To his worship and of his Englisshe nacione » (v.1029)529.
L’auteur anonyme de la Battle of Agincourt530 consacre en effet la majeure partie de son
poème à la louange des capitaines anglais, leurs faits-d’armes étant décrits de manière
imagée et percutante : il est ainsi question, en premier, du roi qui, combattant « ryght
523 Boke of Noblesse, p.28. 524 C’est la lecture que propose John Gough Nichols dans l’introduction de son édition (Voir Boke of Noblesse, ii). 525 Ibid, p.4 et 22. 526 Ibid, p.47. 527 Ibid, p.46. 528 Ibid, p.46. 529 Libelle of Englyshe Polycye, p.52. 530 Historical Poems, p.74-77.
96
wele », « rend la santé à plus d’un malade » (« Many on seke he made that sele »)… c’est-à-
dire en le tuant ( !)531 (v.5-8) ; l’auteur passe ensuite à Humphrey « Duke of glowcestre », qui
inflige de « très larges blessures » à ses ennemis « Manfully, with his mayne, / Wondes he
wroght ther wondere wyde » (v.9-11), à Edward d’York, combattant bravement au côté de
son roi jusqu’ à la mort : « ffro his kyng no fote wold he flee, / Til his basonet to his brayn
was bent » (v. 12-16). La strophe suivante (v.17-24) est consacrée aux earls d’Huntingdon et
d’Oxford, décrits comme de redoutables guerriers (« wondere fers »), qui font littéralement
« passer l’envie de rire » aux Français : « That erste was glade thai made ful wrothe », tuant
beaucoup et « déchirant les riches hauberts de l’adversaire » («Thorow hem many on-to
deth were dyght. / […] / Rich havberke thei rofe & rente »), tout heureux (« full lyght ») de
combattre pour le roi. Enfin, après avoir consacré une strophe (v.25-32) à deux autres
capitaines anglais morts dans la bataille, « The erle of Suthfolk » et « ser Richarde kyghle »,
l’auteur mentionne un certain William Bowsere et Thomas Erpingham (v.33-36), tous deux
signalés pour leur « manhode », ayant pour sens, dans ce contexte, le courage viril. De
manière très intéressante, on retrouve dans le portrait du premier une métaphore
animalière rendant compte de ses compétences guerrières, puisque William Bowsere,
valeureux combattant anglais, est comparé à un rapace fondant sur sa proie : « « Sire
William Bowsere, as fovle in fright, / Preste he ther was vpon his pray » (v.33-34)532.
En suivant la chronologie du corpus, on passe ensuite d’Azincourt au siège de Rouen, lors
duquel John Page souligne également la vaillance de ses compatriotes. En effet, l’auteur,
passant en revue les positions des différents capitaines anglais, en profite pour faire l’éloge
de chacun d’entre eux, en des termes de plus très proches de ceux relevés ci-dessus, ces
ressemblances de formulations nous permettant également de dégager un catalogue des
termes utilisés pour décrire les vertus des combattants, et par extension, tout en tenant
compte du caractère hautement stéréotypé de cette description et de l’obligation, pour
l’auteur, de respecter la tonalité épique de son poème, de tenter de mieux cerner les mots
servant à exprimer ce qui fonde l’excellence du caractère national. C’est ainsi que l’auteur
établit un scénario qu’on retrouve tout au long du passage, où dominent les termes associés
à la vaillance et à l’honneur et à la réputation qui en découlent. De fait, Thomas de Clarence,
salué par l’auteur pour son excellent comportement lors du siège et pour les pertes
importantes qu’il cause aux Français, gagne honneur et réputation, et est reconnu comme
l’un des meilleurs princes au monde : « Clarence the Duke […] kepte the Fraynysche men yn
fulle sore, / And wan worschippe and grete honoure. / Of pryncehode he may bere a floure. /
Thoughe alle pryncys were i-mette, / Nexte the beste he myght be sette »533. Loin d’être un
cas unique, la même formulation se retrouve trait pour trait dans l’éloge de Thomas
Beaufort, duc d’Exeter et oncle du roi, pour lequel John Page emploie de plus un autre
adjectif synonyme de vaillance, « kene », et qui repousse les attaques des Français à la Porte
531 Historical Poems, note renvoyant au vers 7, p.287. 532 Ibid, p. 76. 533 Historical Collections of a Citizen of London, p.6-7.
97
St-Denis, et gagne ainsi beaucoup d’honneur… comme à son habitude : « He bet hem yn at
every brounte, / And wanne worschyppe as he was wounte », méritant ainsi d’être distingué
parmi les grands pour sa « manhode »534, ou encore pour le duc de Gloucester, qui se
comporte « manfully », ignorant le danger (« He dradde hym for noo perelle »), et gagnant
ainsi « worschyppe », ainsi que le droit de figurer parmi les princes les plus braves (« Whenn
alle othyr pryncys ben tolde / Set hym for one of the bolde »)535. Après les princes de la
Maison de Lancastre, on retrouve les mêmes qualificatifs pour John Mowbray (« Erle
Marchalle »), décrit comme « a man-fulle man », pour Sir William Porter, dont on nous dit
qu’il repousse les Rouennais « manfully with myght and mayne, / And wanne worshyppe alle
wayes », pour Edward Holland, Earl de Mortain, auquel l’auteur associe, toujours avec le
même sens, l’adjectif « bolde » et le nom de « worshyppe », pour l’Earl de Salisbury et pour
Sir John Grey (« worschippe », « war kene »), pour Sir Philip Leche (« Worschyppe and
honoure »), pour le baron de Carew (« bolde », « worschyppe »), pour John Holland de
Huntingdon (« manfulle warre », « worschyppe »)536, pour William de la Pole, Earl de Suffolk,
auquel est associé un nouvel adjectif traduisant la bravoure, « wyght », et pour Richard
Beauchamp (« worschyppe »)537. John Page déploie donc ici un véritable arsenal de noms et
adjectifs qui tous, renvoient aux vertus militaires, confirmant peut-être ainsi le rôle majeur
qu’elles jouent dans la définition du caractère national anglais.
En outre, John Page emploie également d’autres qualificatifs élogieux pour désigner ses
compatriotes, toujours associés aux valeurs traditionnellement attachées au statut de
chevalier, soit surtout l’honnêteté et la fidélité, ce qui lui permet de poser les capitaines, et
peut-être les Anglais en général, en modèles de chevalerie : « Cornewale », John Neville et
Richard Beauchamp méritent ainsi les appellations de « that comely knyght » et de « nobylle
knyght », qui signalent leur qualité nobiliaire et chevaleresque, alors que les adjectifs
appliqués à Henry Fitzhugh (« the Lorde Fe Hewe »), à Gilbert Umfraville et à Ferrers sont
plus précis encore, puisqu’ils renvoient directement à la notion de loyauté, le premier étant
présenté comme « a goode knyght and a trewe », le second étant qualifié de « lyght » (au
sens de « pur », « sans tâche »), et le troisième, comme d’ailleurs plus loin le duc d’Exeter538,
de « soo » (l’adjectif « soth » signifiant, en Middle English, « honnête », « sincère »,
« fidèle »)539.
Sans surprise, l’épisode du siège de Calais, qui suscite un tel sursaut de fierté nationale, est
également l’occasion de célébrer cette valeur anglaise, comme en témoigne surtout le
poème sur le Siege of Calais, dont l’auteur s’attarde tout particulièrement sur les hauts faits
534 Historical Collections of a Citizen of London, p.7. 535 Ibid, p.11. 536 Ibid, p.7-10. 537 Ibid, p.11-12. 538 Ibid, p.25. 539 Ibid, p.7-10, et 12. La traduction et l’interprétation des adjectifs se fondent ici sur les définitions du MED.
98
des Anglais, qui prennent même ici le pas sur la critique des Flamands540. Bien-entendu,
l’auteur accorde dans cet éloge une place proéminente aux capitaines anglais venus
défendre la ville, et premièrement à Edmund Beaufort, Earl de Mortain et futur duc de
Somerset, déjà héros de l’épisode de Gravelines évoqué ci-dessus541, qui lui avait d’ailleurs
valu de recevoir la Jarretière542. Dans la ballade sur le Siege of Calais543, ce dernier est
également présenté comme un véritable chef de guerre, qui organise un repas pour
encourager ses troupes en leur prédisant courageusement la défaite des Flamands : « The
Erle of Morteyne made a dyner, / And said, « fellowes, be of gode chere ! / And nothing
haue we doute. » (v.49-51), de même qu’une autre strophe, dans la suite du poème (v.133-
138), célébre son rôle dans la victoire contre les Brugeois lors du « Quade Thursdagh »
évoqué ci-dessus : « And so befell, and on a Thursday, / The Erle of Morteigne made afray /
At Saint Peters on the playn ; / He drove hem to her tentes nere, / And toke many a prisoner,
/ And many of hem were slayn ». Sir John Radcliffe, nommé lieutenant de Calais par
Humphrey de Gloucester, nouveau capitaine de la ville, et considéré par ses contemporains
comme « a wurshipfull kny3t », bien-aimé de la garnison et salué pour son hospitalité544,
reçoit également une mention de la part de l’auteur anonyme de notre ballade, où figure
encore la notion de « worship », opposée au déshonneur (« repref ») : « The lietanant, ser
Iohn Radclyf, / That loued worshipp and dred repref, / Kept full gode gouernance » (v.55-57),
suivi du baron de Dudley (v.58-60), de Lord Camoys (v.61-66), déjà distingué dans Scorn of
the Duke of Burgundy pour sa victoire devant Ardres (v.68-69)545, et ici salué pour sa
constance dans la défense de Calais (« At no tyme wolde he faille, / Neither late ne erly, / Yif
any wight were so hardy / At oones forto assaille »), et de Sir William Assheton et de Geffrey
Werburton546 (v.67-72), qui, accompagnés de nombreux hommes courageux (« With many
an hardy man »), sonnent les trompettes pour signifier à Philippe le Bon le début de la
garde ! (« The Trumpettes lowd did they blow, / ffor the Duc sholde wel know / The wacch
whan it began. »). Bien entendu, le rôle personnel d’Humphrey de Gloucester est loin d’être
passé sous silence, ce qui s’explique aisément si l’on considère que ce texte, ainsi que les
autres poèmes sur le siège et le récit qu’en donne le Brut547, ont pu faire partie d’un effort
de propagande initié par le duc pour asseoir sa réputation politique et militaire, en se
540 John Scattergood, Politics and Poetry in the Fifteenth Century, op.cit. (p. 88). 541 Son rôle personnel dans l’épisode de Gravelines est également signalé dans Scorn of the Duke of Burgundy (v. 65-67), Historical Poems, p.88. 542 Brut, p.575 : « And when the Kyng and the lordes had tithynges of this iournay of Gravenyng, the Kyng sent to the saide Erle of Morteyn to Calais, the Gartur ». 543 Historical Poems, p.78-83. 544 Brut, p.573. 545 Historical Poems, p.88. 546 « the Lord Camys, Sir William of Asshton, knyghte, And Sir Geffrey Werburton, knyghte » sont aussi mentionnés dans le Brut, p.574. 547 Brut, « H » (p.571-580) et « I » (p.581-584).
99
présentant comme le héros du siège548. C’est ainsi que l’auteur souligne le rôle de l’annonce
de la venue du duc dans la levée de ce dernier, « ffor thay had verray knowyng / Of the duc
of Gloucester commyng / Calais to rescowe » (v.157-159), et célèbre surtout le raid mené
par le duc en Flandre, présenté comme dévastateur : « And because they bode not there, /
In flandres he sought hem fer and nere, / That thay may euer rewe » (v.160-162). Ces actions
du duc reçoivent également une mention spéciale dans Scorn of the Duke of Burgundy, alors
qu’il provoque la fuite de Philippe le Bon (« duc humphray redy to saille / To rescow Calais
and doo his ligeance », v.93-94), et qu’il poursuit ensuite ce dernier en Flandre pour le
pousser à l’affrontement « with knyghtly desire » (v.97), détruisant et brûlant sur son
passage : « He soght the in flandres with swerd and with fyre, / Nyne daies brennyng, no
pees did he make » (v.99-100)549, raid punitif qui suscite également toute l’admiration de
l’auteur du Libelle, qui évoque l’incendie de « Poperynge and […] Bell », « Whyche my lorde
of Glowcestre wyth ire / […] dyd sett upon a fyre » (v.252-253)550, et raconte plus loin
comment « Milorde of Gloucestre », ayant mis les Flamands en fuite, « sought hem in here
londe / And brente and slowe as he hadde take on honde » (v.296-297)551.
Cependant, l’auteur, dans son récit du siège de Calais, est très loin de limiter son éloge aux
seuls capitaines anglais. En effet, l’identité anglaise affirmée des Calaisiens pousse
naturellement le poète à exprimer à travers eux « ce sentiment de patriotisme, cette
identification chauviniste avec une Englishness surtout définie par la prouesse militaire »552,
de même qu’il insiste sur l’ « union nationale »553 suscitée par l’épisode. C’est ainsi que
l’auteur prend soin de souligner le rôle de toutes les classes de la société calaisienne dans la
défense de la ville, en commençant par les portiers, qui s’acquittent de leur tâche « manly »,
en maintenant les portes ouvertes et en veillant : « The porters kept full manly / the yates
open continuelly, / To wake were they not yrke ; » (v.73-75), avant d’évoquer les soldats de
la garnison, qui, se tenant sans cesse sur les remparts, s’acquittent de leur tâche avec une
constance quasi-religieuse, puisque, selon la métaphore de l’auteur, ils font de ces derniers
« leur demeure et leur église » : « The trew soudeours, bothe day and nyght, / Lay on the
walle in armes bright - / It was thaire hous and kirk. » (v.76-78). Après cette description de la
classe militaire, pour qui la défense de la ville est son métier, l’éloge s’étend, de manière très
intéressante, au maire, Robert Clidrowe, et aux bourgeois (v.79-81), défendant
courageusement leurs biens légitimes : « The maire and burgeis were full bovn / fforto
defende thaire possession, / It longed to hem of right ; », puis, plus étonnant encore, à
l’ensemble de la classe marchande (v.82-84), « The worthy merchantes », que l’auteur
548 David Grummitt, The Calais Garrison, War and Military service in England (1436-1558), Woodbridge, 2008 (p.36). Voir aussi James A. Doing, « Propaganda, Public Opinion and the Siege of Calais », op.cit. (p.102). 549 Historical Poems, p.89. 550 Libelle of Englyshe Polcye, p.13. 551 Ibid, p.15-16. 552 Voir David Grummitt, op.cit. (p.33). 553 Voir Ibid (p.34).
100
distingue également pour leur bravoure guerrière, puisqu’ils se tiennent prêts à défendre
leur ville, constamment et à chaque alerte (« At al tyme and euery skry »), et offrent ainsi au
spectateur « a ful gode sight » ! L’auteur passe ensuite à l’ensemble des habitants, « the
gode comon » (v.85-90), dont il ne loue certes pas la valeur militaire, mais plutôt leur rôle
dans les préparatifs en vue du siège, soit pour remplir la ville de « godes and vitaille » et
accomplir « alle other werkes […] / In al that myght availle », avant de consacrer une strophe
entière au rôle des femmes (v.91-96), « bothe yonge and olde », qui, ne s’épargnant aucune
peine (« They spared no swete ne swynk »), chargent les catapultes et font bouillir les
chaudrons, pour « donner à boire » (!) à ceux qui voudraient escalader les remparts (« Yif
thay wolde haue sawted the wall, / Al hote to gif hem drynke. »). Les archers méritent
également une mention spéciale : « There myght men see Archers gode / Cast away bothe
gowne and hode, / The better forto shote » (v.115-117). Finalement, après avoir évoqué,
comme nous l’avons vu précédemment, le rôle d’un Irlandais dans la défense de la ville, le
poète complète son tableau avec Goby, le chien du garde-pêche (v.127-132)… qui participe
pleinement à l’effort national et mérite ainsi d’être mentionné parmi les braves Anglais de
Calais ! : « Also an hounde that hight goby, / That longed to the waterbailly, / fful swiftly
wolde he renne. / At euery skirmyssh to trauaille, / Man and horse he wolde assaille… »,
sans que d’ailleurs cet épisode surprenant soit spécifique au Siege of Calais, puisque l’auteur
de Mockery of the Flemings engage également les Flamands à se rappeler du héros canin :
« Remembres eke on Goby, the watir-baillifes dog, / How he scarmysshed with you twyes
vpon the day, / And among you on the sandes made many a fray » (v.32-34)554.
Ainsi, les sources tendent généralement à souligner le fait que les Anglais sont, en quelque
sorte par nature, d’excellents et valeureux combattants. Cependant, cette qualité nationale
n’est pas la seule à être relevée. En effet, il est normal que l’affirmation du bon droit du roi
d’Angleterre et de ses sujets, qui nuit gravement à l’image de l’adversaire français, confère
ipso facto le beau rôle aux Anglais dans le récit des conflits, cette opposition recevant des
formulations très nettes, par exemple dans le Boke of Noblesse : «And where is a more
holier, parfiter, or a juster thing than in youre adversary is offence and wrong-doing to make
hym werre in youre rightfull title »555. Hors, si la sévérité est parfois de mise face à la
malveillance de l’adversaire, comme en témoignent certains passages du Brut, dont les
auteurs évoquent avec fierté l’ordre d’Henry V, après Azincourt, de mettre à mort les
prisonniers pour dissuader les Français d’une nouvelle attaque556, les menaces de mort
formulées à l’encontre des villes qui refuseraient de se rendre (« & ellis he schulde leve
neyther man ne child a lyve »557), les récits de siège, dont l’entrée dans Caen du duc de
Clarence (« the Duk of Clarans […] slow3 doun ryght til that he come vnto the King, and
spared nether man ne childe »558), ou encore les récits d’expulsion que nous avons déjà
554 Historical Poems, p.83-86. 555 Boke of Noblesse, p.22. 556 Brut, p.379. 557 Ibid, p.383. 558 Ibid, p.384.
101
évoqués. Cependant, si cette sévérité apparaît pleinement justifiée aux yeux de nos auteurs,
la stratégie qu’adopte John Page dans son Siege of Rouen est bien plus complexe et
percutante, puisqu’elle lui permet de mettre en valeur une autre qualité nationale anglaise,
jusque-là inédite dans le corpus. En effet, si Page évoque la sévérité justifiée d’Henry V lors
de son entrevue avec les représentants de Rouen, alors qu’il repousse leur demande de
laisser partir les pauvres expulsés (« Have ye pytte tham uppon / And graunte them leve for
to gone »), en rappelant aux Rouennais que leur sort ne relève pas de sa responsabilité :
« ‘Felowys, hoo put them there, / To the dyche of that cytte ? / I putte them not there, and
that wote ye. / Nothyr hyt was not myn ordynaunce, / Ne non passe by my sufferaunce 559»,
et réaffirme hautement son intention d’obtenir la ville coûte que coûte et de traiter ses
habitants selon leurs mérites (« He sayde, ‘Hyt ys myn owne londe, / I wylle hyt wyn,
thoughe ye hit with stond ; / And the men that ye so draffe / Shalle be rewarde lyke as they
serve’ »), provoquant ainsi la frayeur chez ses interlocuteurs (« With that worde they were a
dradde »)560, son discours principal est tout-autre. De fait, l’auteur contraste consciemment
le comportement des Anglais et celui de leurs adversaires, d’abord en ce qui concerne
l’épisode de l’expulsion des pauvres, puisque à la cruauté de leurs compatriotes s’oppose la
réaction des Anglais. En effet, lorsque les pauvres les supplient d’avoir pitié d’eux (« And alle
they sayden at onys thenne, / « Have marcy uppon us, ye Englysche men ». »), les soldats
anglais non seulement ne leur font aucun mal, mais leur donnent également de leur pain,
malgré le fait que les Rouennais ont tué certains de leurs camarades : « Oure men gaffe
them of oure brede, / Thoughe they hadde don sum of oure men to dede, / And harme unto
them dyd they non »561. La même idée se retrouve lorsque les princes anglais, puis Henry V,
acceptent de traiter avec la ville plutôt que de la réduire par la faim. C’est ainsi que Clarence,
recevant le message transmis par Umfraville, accepte d’intercéder auprès du roi, ce qui
pousse l’auteur à saluer sa « mekenys » et à le présenter comme l’un des meilleurs parmi les
princes, puisqu’il réunit en sa personne les qualités nationales de « manhood » et de
« mercy » : « He ys manfulle whylys the warre dos laste / And marcyfulle when wer ys paste ;
/ Manhode, mekenys, bothe wyt and grace, / He has, content in lytylle space ». A leur tour,
Gloucester et Exeter font preuve des mêmes qualités, ce qui leur vaut d’être qualifiés par
Page de « pryncys of mekenys » qui font preuve de pitié malgré les attaques dont ils ont été
victimes (« Thoughe they hadde sufferde war smarte, / Yet were they marcyfulle in herte »),
et d’être salués pour leurs qualités chevaleresques, en raison de leur disposition naturelle à
faire preuve de charité (Loo ! thes grete men of chyvalrye / Soo sone were in charyte »)562.
Cependant, si cet éloge des qualités anglaises est attaché, dans l’ensemble des cas cités ci-
dessus, soit à la nation dans son ensemble, soit à des figures particulières, aucune de ces
dernières ne rend mieux compte de l’excellence du caractère national qu’Henry V lui-même.
De fait, il ne fait aucun doute que le personnage du roi se trouve irrémédiablement lié à
559 Historical Collections of a Citizen of London, p.29-30. 560 Ibid, p.30-31. 561 Ibid, p.20. 562 Ibid, p.25.
102
l’éloge de la nation toute-entière. En effet, nous avons vu plus haut que cette association du
roi avec l’Englishness, par exemple sur le plan linguistique, correspond à une politique
délibérée de sa part. De plus, de même que l’ensemble de la nation communie autour de la
personne royale563, on assiste, déjà dans les textes datant du vivant d’Henry V, à une
identification totale des vertus de ce dernier avec les vertus revendiquées pour l’ensemble
de la nation, alors que le roi est souvent présenté comme le meilleur des Anglais. En effet,
c’est bien Henry V lui-même qui se fait le porte-parole de l’excellence du caractère national
dans la paraphrase en prose qui précède la transcription de la Battle of Agincourt, lorsqu’il
rappelle à ses troupes qu’ils sont « des Anglais, qui jamais ne fuient en bataille », et qu’il
affirme hautement son intention de ne pas se laisser capturer vivant, pour que l’Angleterre
ne soit pas contrainte à payer sa rançon : « for as I am trew kynge & knyght, for me this day
schall neuer Inglond rawnsome pay. erste many a wyghte man schall leue is weddes, for
here erste to deth I wil be dyght »564, et le même texte fait état de sa vaillance personnelle
au combat, également célébrée dans la Agincourt Carol : « Than for soth that kny3t comely /
In agincourt feld he fau3t manly » (v.13-14)565. Dans le Siege of Rouen, de même, l’auteur
n’est jamais avare de compliments concernant Henry V, qui lui inspire, comme d’ailleurs à la
plupart de ses contemporains, une admiration profonde. Dès le début du poème, il est décrit
comme un « puits d’honneur », passant toute description, et comme le meilleur parmi les
princes (« Of alle worschyppe he ys a welle ; / Hys honoure noo tongue may telle. / Of all
pryncys for to a counte, / Sette hym pryncepalle in the frounte »)566. Par la suite, ce sont les
Rouennais eux-mêmes qui confirment cette supériorité absolue du roi d’Angleterre (« Of alle
othyr pryncys he ys the pryce »), également due à ses qualités personnelles : « And also for
hys owne prynce hode, / And for hys moche manhode »567, l’éloge, aussi bien moral que
physique, atteignant plus loin des proportions proprement dithyrambiques dans la bouche
des « Fraynysche men » sortant de leur entrevue avec le roi, le passage méritant ici d’être
cité extensivement pour en saisir toute la portée : « They spake of oure kynge so goode. /
They sayde, « He ys, at oure a vyse, / Of alle erthely pryncys the pryce, / Takyng rewarde of
hys chere, / And to hys countenaunce so clere ; / To hys person in propyrte ; / To hys
fetowrys and hys beute, / And to hys depe dyscrecyon, / That he hathe in possessyon, / And
to hys passyng prynce-hode, / And to hys mykylle man-hode, / And he ys marcyfulle in
myght, / And askysse no thynge but hys ryght. / Thes vertuys ys a grete thynge / To be
withyn an erdely kynge. / Howe shulde he but wyn honowre ? / Howe shulde he be but a
conquerowre ? »568. C’est ainsi que, de l’aveu-même de l’ennemi, toute tentative de
résistance ne peut qu’être vaine face aux remarquables qualités d’Henry V. Surtout, dans le
poème, le roi incarne parfaitement la vertu nationale de charité, qui oppose les assiégeants
aux assiégés. En effet, c’est sur sa personne que se concentre l’éloge de Page, qui exprime
563
A ce sujet, voir Christopher Allmand, Henry V, op.cit. (p.404-425). 564 Historical Poems, p.75. 565 Ibid, p.91. 566 Historical Collection of a Citizen of London, p.6. 567 Ibid, p.24. 568 Ibid, p.33.
103
alors pleinement, toujours par l’entremise des Rouennais, la correspondance exacte entre
les vertus de la nation et celles de son roi, puisque l’épisode du don de nourriture fait par
Henry V aux assiégés et aux pauvres à Noël, qui témoigne de sa charité déployée à l’occasion
d’une grande fête chrétienne (« by-cause of that hyghe feste »), et est salué par Page
comme « a fayre grace, / And a mekenys of oure kynge, / Of goodenys a grete tokenynge »,
est aussi l’occasion pour l’auteur de mettre en scène la reconnaissance par l’ennemi de la
bonté et de la charité comme des traits nationaux anglais, à travers une démarche qui relève
d’un regard de l’Autre fanstasmé : « « A myghty God, » they saydyn then, / Of tendyr hertys
ben Englysche men », avant qu’ils n’enchaînent sur un nouvel éloge du roi d’Angleterre qui,
malgré leurs démérites, fait preuve envers eux de plus de compassion que leur propre
nation: « Lo, here oure excellent kynge / That we have ben so long stondynge, / And nevyr
wold obbey hym to, / With oure wylle the omage hym do / Of us nowe hathe more
compassyon / Thenn hathe oure owne nacyon »569. De fait, Henry se comporte, de même
que son frère Thomas de Clarence, aussi bien « manfully » que «marcyfully », et démontre
ses vertus en renonçant à son droit de vengeance sur les Rouennais « tombés en son
pouvoir », alors-même que ceux-ci ont blessé ou tué beaucoup de ses hommes et ont refusé
de lui céder ce qui lui revenait de droit (« Thoughe they had of hys men so many maymyd, /
And so gretely hym grevyd, / […] / And of hys men so many loste, / And so withstondyng
hym of hys ryght, / And then were fallyn in to hys myght / At hys wylle them to greve, / Yf he
wolde venge hym with myscheve. / […] / Also to graunte them to trete, / There was marcy
and charyte ! »), ce qui amène l’auteur à dévoiler le fond de sa pensée en présentant le roi
comme « l’enfant de Dieu, qui rend le Bien pour le Mal » : « The chylde of God I wote he ys /
That dothe the goode for the mys »570.
2) Grandeur et décadence ? L’évolution du discours face aux revers et à la défaite.
Si la mise-en-scène de ces vertus nationales anglaises est clairement légitimée dans le
contexte triomphant du règne d’Henry V, ou encore lorsqu’elle est nourrie par un épisode
particulier tel que la défaite des troupes de Philippe le Bon devant Calais, que devient ce
discours sur la nation lorsque la situation ne se prête plus au triomphalisme ?
De fait, force est de constater que le discours des sources, et en particulier des textes à
caractère polémique, s’adapte alors et se transforme. C’est ainsi le cas dans le Libelle of
Englyshe Polycye, qui rend compte de la situation, déjà difficile, des années 1430, et en
particulier des suites désastreuses de l’effondrement de l’alliance anglo-bourguignonne, et
aussi bien-sûr dans le Boke of Noblesse, écrit au début des années 1450, au moment de la
perte définitive de la Normandie.
Or, dans ces deux textes, les auteurs se montrent parfaitement conscients du fait que leur
nation est, du moins en partie, responsable de ses propres maux, et ils ne sont en aucun cas
569 Historical Collections of a Citizen of London, p.21-22. 570 Ibid, p.26-27.
104
aveugles aux défauts de leurs compatriotes. C’est ainsi que, en contradiction totale avec le
discours précédent, l’auteur du Libelle leur reproche de favoriser l’adversaire en succombant
eux-mêmes à la lâcheté (« cowardyse », v.33 et 48)571, et à la paresse (« slought »), cause de
la perte temporaire d’Harfleur en 1435 (« Howe was Hareflewe cryed upon at Rone / That it
were likely for slought to be gone ! », v.842-843)572, et qui pourrait également causer la
perte d’autres territoires menacés, tels que la précieuse Calais (« Do not to England for
sloughte se grete offens », v.823)573 et l’Irlande, qui ne pourra être conservée qu’en excluant
« sloughe and […] recheleshede » (v.698), l’auteur priant le Christ de « yeve us grase all
sloughte to leve bysyde » (v.710)574. Surtout, les attaques de l’auteur contre ses
compatriotes se concentrent sur un autre péché capital, celui de la convoitise. C’est en effet
ce défaut qui, selon lui, empêche les Anglais de lutter efficacement contre la piraterie,
l’auteur sous-entendant que les responsables acceptent des pots-de-vin : « Why is this
powdre called of covetise / Wyth fals colours caste thus beforne oure eyes ? » (v.608-
609)575, et cette « cupidite » (v.633) met réellement en danger la « polycye » anglaise :
« Wee lyve in luste and byde in covetyse ; / This is oure reule to mayntene marchaundyse, /
And polycye that we have on the see » (v. 652-654)576, de même qu’elle s’avère périlleuse
pour la conservation de l’Irlande : « But covetyse and singularite / Of owne profite, envye,
carnalite / Hath done us harme and doo us every daye » (v.776-778)577.
De manière très intéressante, on retrouve souvent les mêmes reproches adressés au peuple
anglais dans le Boke of Noblesse, dont le discours se concentre sur la guerre entre Angleterre
et France. En effet, si, comme nous l’avons vu précédemment, la malhonnêteté de l’ennemi
français est présentée comme l’une des causes principales des déboires anglais, William
Worcester est loin d’en dédouaner complètement ses compatriotes, qui, selon lui, ne se sont
pas comportés avec assez de « Noblesse ». C’est ainsi que, dès le début de son traité, il les
engage à sortir de leur abattement en abandonnant leurs « idille lamentacions »578 pour
reprendre la situation en main, alors que, du fait de leur tristesse et de leur paresse, ils ont
littéralement laissé s’éteindre le feu sacré : « Now at erst the irnesse be brennyng hote in
the fire thoroughe goode courage, the worke is overmoche kindelid and begonne, thoroughe
oure dulnesse and sleuthe slommering many day »579. De même, il laisse entendre que ses
compatriotes, délaissant la gloire militaire, ont été corrompus par la luxure et le goût de la
volupté : « Let it no lenger be suffred to abide rote, no forto use the pouder and semblaunce
of sensualite and idille delites, for […] voluptuous delitis led be sensualite be contrarie to the
571 Libelle of Englyshe Polycye, p.3. 572 Ibid, p.43. 573 Ibid, p.42. 574 Ibid, p.36. 575 Ibid, p.31. 576 Ibid, p.34. 577 Ibid, p.39-40. 578 Boke of Noblesse, p.3. 579 Ibid, p.6.
105
exercising and haunting of armes »580, idée qui reçoit une application plus précise encore
vers la fin du traité, alors que Worcester, attribuant aux « gret cost and pomp in clothing »
l’appauvrissement, mais aussi les vices de la nation (« gret pride, envy, and wrathe »),
préconise l’adoption de lois somptuaires… sur le modèle français ! (« And the same maner
the ryte and custom of youre adverse partie of Fraunce hathe used, escheweng alle costius
arraiementis of clothing, garmentis and bobauncees, and the usaige of pellure and furres
they have expresselie put away »)581. Surtout, si Worcester met en scène un certain nombre
de causes techniques pour expliquer la défaite, son propos revêt toujours un caractère
moral, dans la mesure où il pointe du doigt, à son tour, la convoitise et la recherche du profit
personnel qui sévit à tous les niveaux de la société anglaise, au détriment bien-sûr de cette
valeur suprême qu’est pour lui le souci du « Bien Commun » (« comon profite », « comon
wele »). En effet, pour lui, c’est bien cette convoitise et cet appât du gain qui se trouvent au
centre du changement survenu dans la société anglaise, alors que les jeunes gens de famille
noble se détournent du métier des armes au profit de carrières juridiques, renonçant ainsi à
servir leur pays sur les champs de bataille et se détournant aussi de la recherche de la gloire
militaire (« worship ») et de la « manhode » qui ont si longtemps caractérisé leur nation,
seulement « to encriche hem silfe » en oppressant le « pore bestiall peple »582. De la même
façon, c’est cette convoitise, véritable plaie nationale, qui est à l’œuvre chez les capitaines et
les officiers royaux, qui se soucient davantage des biens matériels que du « worship » et de
la justice, et qui n’hésitent donc pas à frauder sur le versement de la solde des soldats, en
prélevant injustement une somme sur ces dernières par « rewarde [of curtesye of colour]
gyven, bribe, defalcacion, or abreggement, or undew assignacion ». Cette pratique, à son
tour, fait naître la « covetise of pillage and rappyne » chez les hommes d’armes privés de
moyens, au détriment de « worship of chevalrie and knighthode »583 ! Enfin, dans le même
contexte, Worcester dénonce les « gret persecucions, by way of suche oppressions and
tyrannyes, ravynes and crueltees » commises par ces derniers à l’encontre de la population
locale normande, et tolérées par les officiers, ce qui l’amène, par un étonnant renversement
des choses, à opposer cette cruauté des Anglais à la pitié dont fait preuve Charles VII en
entendant les plaintes et les imprécations de son peuple ! : « youre [grete] adversarie made
his intrusion in the saide Normandy, for pite of his peple so oppressid, hiring theire clamours
and cries and theire curses »584.
Les deux auteurs s’accordent donc à dresser un portrait sombre des défauts de leurs
compatriotes. Cependant, le ton ne semble pas être tout-à-fait le même des deux côtés. En
effet, les déclarations de l’auteur du Libelle semblent exprimer des vérités générales sur le
tempérament anglais, et versent parfois-même dans le stéréotype national pur. C’est le cas,
580 Boke of Noblesse, p.22. 581 Ibid, p.79-80. 582 Ibid, p.76-78. 583 Ibid, p. 30-31, et p. 72-73. 584 Ibid, p.71-74.
106
en particulier, d’un passage (v.579-583), parfois comparé à un extrait de la Morte Darthur585,
œuvre ultérieure de Sir Thomas Malory, qui semble faire de l’inconstance un véritable trait
national des Anglais, décrits comme « fragiles comme le verre » et incapables de persévérer:
« but wee be frayle as glasse / And also bretyll, not tough, nevere abydynge », ce qui
explique aussi leur incapacité à saisir l’occasion : « But when grace shyneth sone are wee
slydynge ; Wee woll it not reseyve in any wysse », également liée aux « defautes » de « luste,
envye and covetysse »586. Le discours de William Worcester, cependant, est tout-autre. En
effet, très loin de présenter les défauts relevés comme des traits nationaux constants, il tient
à démontrer, par l’exemple historique, qu’ils ne sont en aucun cas une fatalité, puisque, bien
au contraire, la grandeur est en quelque sorte inscrite dans les gènes des Anglais. Le récit de
la gloire passée est donc un argument de taille dans le discours de l’auteur, qui cherche à
démontrer à son roi et à l’ensemble de ses compatriotes qu’ils sont, en tant qu’Anglais,
porteurs du même potentiel… et doivent seulement s’appliquer à réveiller leur « highe
auncien couragis »587. Il s’agit ainsi, pour eux, de se « revêtir des cotes d’armes de leur
ancienne férocité » face à l’ennemi, en ayant présent à l’esprit les hauts-faits de leurs
ancêtres : « For now it is tyme to clothe you in armoure of defense ayenst youre ennemies,
withe the cotes of armes of your auncien feernesse, haveng in remembraunce the victorious
conquestis of youre noble predecessours »588, la « noble Englisshe chevalrie » étant de
même encouragée, plus loin, à ne pas laisser s’abattre son « courage » et sa « hardiesse »
naturelles, « seeing so many good examples before yow of so many victorius dedis in armes
done by youre noble progenitoures »589. De plus, on retrouve ici la métaphore du lion,
puisque, pour suivre la voie de leurs ancêtres, les Anglais doivent d’abord transformer leurs
lamentations en « vyfnes of here spiritis, of egre courages, of manlinesse and feersnesse »,
et ainsi (ré) adopter le comportement léonin qui, selon Worcester, devrait être celui de tout
homme d’armes digne de ce nom : « every god man of [worshyp yn] armes shulde in the
werre be resembled to the condicion of a lion. […] for as ire, egrenesse, and feersnesse is
holden for a vertu in the lion, so in like manere the said condicions is taken for a vertue and
renomme of worship to alle tho that haunten armes »590. Plus loin, il réitère encore cette
incitation, les Anglais devant redevenir « furious, egre, and rampanyng as liouns », pour
résister aux injustes provocations de leurs adversaires (« ayenst alle tho nacions that soo
without title of right wolde put you frome youre said rightfulle enheritaunce »), en
enchaînant sur une autre métaphore animalière plus originale, celle du sanglier, proposé par
Worcester à ses compatriotes comme modèle de force et de courage … et surtout de
réactivité face aux attaques dont il fait l’objet ! En effet, l’auteur, appuyant sa démonstration
sur une considération pseudo-zoologique, engage les Anglais à suivre l’exemple de cet
585 C’est ce que fait John Scattergood, en citant le passage de Malory, in « The Libelle of Englyshe Polycye, the Nation and its Place », op.cit. (p.34). 586 Libelle of Englyshe Polycye, p.30. 587 Boke of Noblesse, p.9. 588 Ibid, p.20. 589 Ibid, p.29. 590 Ibid, p.4.
107
animal qui ignore sa force tant qu’il n’a pas vu couler son propre sang : « Wherfor, like and
after the example of the boore whiche knowethe not his power, but foyetithe his strenghte
tille he be chafed and see his owne bloode, in like wise put forthe youre silf, avaunsing youre
corageous hertis to werre, and late youre strenght be revyved and waked ayen… »591.
C’est ainsi que Worcester, malgré le discours assez dur qu’il tient sur ses contemporains, ne
doute pas un instant que le redressement de la situation soit possible, les Anglais devant
simplement reprendre confiance en leur nation, puisque le « good corage » et la
« manhode », décidément associés au caractère national, ne leur ont jamais fait défaut
jusqu’à ce jour, et ce même dans le cadre des récents revers en France : « And it is to
suppose that is rather in defaute of exercising of armes […] that the londes were lost […]
then for defaute of good corage and manhode, whiche is to deme werre never feerser ne
corageouser to dedis of armes »592.
3) L’enjeu de l’honneur national face à l’Etranger.
Sans-doute ne peut-on pas tomber d’accord avec Geoffrey Hindley, qui affirmait, en 1974,
que « la plupart des Anglais de l’époque de Caxton n’avaient que faire de leur mauvaise
réputation à l’étranger »593. Bien au contraire, les sources placent bien cette question au
centre de leur discours sur l’excellence de la nation, et la font également figurer en bonne
place dans leurs évocations de l’étranger. En effet, même si certaines occurrences semblent
assez stéréotypées et surtout destinées à exprimer le superlatif, comme lorsque Lydgate
prédit au jeune Henry VI, dans son Mumming at Eltham que « youre renoun shal shyne in
londes ferre » (v.26)594, et encore plus lorsque le même Lydgate fait état, dans son récit de
l’entrée triomphale d’Henry VI à Londres, de la prière alors mise en scène de « kepe the Kyng
[sure] ffrom alle damage / […] / Hys hyh renoun to sprede and shyne fferre » (v.438)595,
d’autres semblent être bien plus révélatrices. Premièrement, Worcester affirme clairement
que la renommée à l’étranger est quelque chose d’enviable pour les individus. De fait, cette
dernière ajoute du lustre au personnage d’Humphrey de Gloucester, qui, en raison du bon
traitement qu’il réserve aux visiteurs étrangers, voit sa renommée s’étendre dans toute la
Chrétienté et même parmi les « païens » ! (« the renome of his noble astate and name sprad
thoroughe alle cristyn roiaumes and in hethynesse »)596. De même, le regard de l’Etranger, à
l’échelle de la Chrétienté, est sollicité par William Worcester pour asseoir la légitimité de la
cause du roi d’Angleterre en France, puisque les torts du parti adverse sont « notorily and
openly knowen thoroughe alle Cristen Royaumes »597, de même que les droits du roi
d’Angleterre au duché de Normandie : « For as youre first auncien right and title in youre
591 Boke of Noblesse, p.22. 592 Ibid, p.29. 593 Geoffrey Hindley, England in the Age of Caxton, op.cit. (p.30). 594 The Minor Poems of John Lydgate, vol. II, p.672-674. 595 Ibid, p.645, strophe 63). 596 Boke of Noblesse, p.45-46. 597 Ibid, p.8.
108
duchie of Normandie, it is knowen thoroughe alle cristen landes »598, et au comtés de Maine
et de Touraine : « And that as for youre enheritaunce […] it is notorily knowen among alle
cristen princes »599.
Surtout, ce sont des événements historiques précis qui entretiennent la réputation de la
nation d’Angleterre à l’étranger, tels que, pour Worcester, les victoires d’Edward III et la
conquête du royaume de France et du duché de Normandie par Henry V, « notorily knowen
thoroughe alle Cristen nacyons, to the gret renomme and worship of this Reaume »600, ou
encore le sacre parisien d’Henry VI : « For sethen the roiaume of Englonde first began to be
inhabite withe peple was never so worshipfulle an act of entreprise done in suche a case, the
renoume of which coronacion spradde thoroughe alle cristen kingis roiaumes »601.
De même, les auteurs font de cette réputation au niveau international l’un de leurs
arguments essentiels pour encourager leurs compatriotes à se reprendre. C’est ainsi que
Worcester dresse un portrait bien sombre de l’actuelle réputation du peuple anglais à
l’étranger, comparée à celle dont il jouissait précédemment au niveau militaire, puisque les
Anglais, autrefois rangés parmi les plus valeureux combattants (« ye alonly have ever ben
halden […] withe the most puissant and of power thoroughe alle regions cristen or
hethen »602), sont désormais associés à la guerre civile et donc confondus avec les peuples
les moins estimés : « for, thoughe that ye were in renomme accepted alleway withe the
most worthy as in dede of armes, but now at this time ye ben take and accepted in suche
marcialle causes that concernithe werre on the left hande, as withe the simplest of price and
of reputacion »603. De la même façon, c’est le déshonneur aux yeux des nations étrangères
qui guette les Anglais, s’ils ne s’emploient pas à récupérer ce qu’ils ont perdu : « suffre ye
not […] in this maner to be rebuked and put abak, to youre uttermost deshonoure and
reproche in the sighte of straunge nacions »604, d’autant plus qu’ils ont à plusieurs reprises
vaincu les Français, qui sont, par rapport à eux, de moindre réputation : « A noble Roiaume
of gret price and of noble renomme as thow hast be. […] Shall thou than suffre the to be
confunded withe simpler people of reputacion then thow art, withe the whiche ye and youre
noble progenitours have conquerid and overcom diverse tymes before this ? »605, comme le
sont d’ailleurs les Flamands d’après l’auteur de Mockery of the Flemings : « more of
reputacioun ben englisshmen then ye » (v.57)606, et aussi les Bretons, dans le Libelle (« For
Brytayne is of easy reputasyone », v.176)607.
598 Boke of Noblesse, p.22. 599 Ibid, p.23. 600 Ibid, p.4. 601 Ibid, p.20. 602 Ibid, p.43. 603 Ibid, p.29. 604 Ibid, p.9. 605 Ibid, p.82. 606 Historical Poems, p.85. 607 Libelle of Englyshe Polycye, p.10.
109
Surtout, si les auteurs s’attardent sur la question de la vision des Anglais à l’étranger, c’est
parce que l’Autre, malveillant comme à son habitude, n’hésitera pas à se moquer de la
nation anglaise si elle manque de faire valoir ses droits. Cette idée, exprimée textuellement
dans une pétition contre les Milanais, présentée en Parlement en 1415 en vue d’obtenir des
représailles pour le non-paiement de la dot de Lucia Visconti, « saunz ceo quils vorroient
tielment estre mokez come ils nous mokent en cest partie »608, reçoit également une mise
en application particulièrement forte dans le Libelle, lorsque l’auteur raconte comment les
adversaires, se moquant des prétentions des Anglais à la souveraineté maritime, les
engagent, en un fin jeu de mots, à remplacer le symbole du bateau par un mouton : « Owre
enmyes bid for the shippe sette a shepe » (v.37)609, animal inoffensif par excellence, comme
nous l’avons vu précédemment !
De même, il ne fait pas de doute que l’Etranger, dans l’esprit de nos auteurs, met réellement
en danger l’honneur et la réputation des Anglais. C’est ainsi que l’auteur du Libelle nous
rappelle que les actions des étrangers, s’il n’y est pas remédié, couvrent la nation de honte,
comme c’est le cas pour les activités de piraterie d’Hankyn Lyons : « Thane Hankyn Lyons
shulde not be so bolde / To stoppe us and oure shippes for to holde / Unto oure shame »
(v.602-604)610, des Flamands en général, qui cherchent à s’approprier les honneurs anglais
sur la mer : « Shall […] Flemmynges to oure blame / Stoppe us, take us and so make fade the
floures / Of Englysshe state and disteyne oure honnoures ? » (v.43-47)611, ou encore des
Bretons, dont les crimes sont connus de tous (« That into the regnes of bost have ronne here
soune », v.173), au détriment du royaume et de sa réputation (Whyche hathe bene ruthe
unto thys realme and shame », v.174), d’autant plus que « Brytayne is of easy
reputasyone »612 !
Enfin, à plusieurs reprises, l’Etranger représente un danger pour le caractère national lui-
même, alors que c’est le courage anglais lui-même qui risque d’être mis à mal face à
l’adversaire. C’est ainsi qu’une pétition présentée en Parlement contre le Statut des Trêves
explique que, si ce dernier a rendu les ennemis plus agressifs encore (« orgoillous, esbaudez
et encruelés »), il a aussi, parallèlement, rendu les Anglais lâches (« toutoutrement esbaiez
et encowardez »)613. A partir de là, il convient de veiller à inverser la balance, comme
l’exprime l’auteur du Libelle en évoquant la nécessité de « garder la mer », « To oure corage
and to oure enmyes drede » (v.1075)614.
608 Cité par Christopher Fletcher, « La communauté anglaise face à l’étranger », op.cit. (p.111). 609 Libelle of Englyshe Polycye, p.3. 610 Ibid, p.31. 611 Ibid, p.3. 612 Ibid, p.10. 613 PROME, parlement de mai 1421, it.22. 614 Libelle of Englyshe Polycye, p.54.
110
B) Le développement des mythes et symboles de la Nation.
1) La conscience d’un passé glorieux.
Comme l’a écrit Bernard Guenée, « il n’y a pas de nation sans histoire nationale »615. En
effet, cette dernière fournit à la nation une preuve de son existence, et aussi de son
excellence, son rôle premier étant bien de « soutenir la fierté de tout un peuple en lui
rappelant ses toujours glorieuses origines »616.
Tout d’abord, la nation se construit sur des mythes originels, qui, en Angleterre, se mettent
en place dès le XIIe Siècle, avec l’Historia Regum Britanniae du célèbre Geoffrey de
Monmouth. En quoi consiste donc ce récit des origines mythiques, et comment est-il mis en
scène par nos auteurs ? Premièrement, pour l’Angleterre comme pour plusieurs autres Etats
européens, dont la France, les origines de la nation sont troyennes. C’est ainsi que, du côté
anglais, le mythe, apparu dès le VIIIe Siècle dans l’Historia Brittonum de Nennius, est
popularisé par l’œuvre de Geoffrey, et devient, à partir de là, une véritable doxa, à tel point
que les compilations de l’histoire nationale, le Brut, reçoivent le nom du fondateur
mythique, le prince troyen Brutus. Selon les grandes lignes du récit, ce dernier, petit-fils
d’Ascagne, finit, après moult péripéties en Grèce et un séjour en Gaule, par aborder à
Albion, alors peuplée par des géants, qu’il vainc, avant de peupler l’île et de la rebaptiser
« Britannia » en son honneur617. De fait, il apparaît d’emblée que l’affirmation de l’auteur de
Mockery of the Flemings, selon laquelle les Anglais sont d’une race plus noble et plus
ancienne que les Flamands (« comen of more gentill blode of olde antiquite », v.58)618, loin
d’être une affirmation vide de sens, s’appuie sur une connaissance générale des origines de
la nation, également bien connues des lecteurs. De même, cette affirmation illustre un autre
aspect essentiel du discours sur les origines, avant tout destiné à servir de « critère de
différenciation » face aux autres peuples, et à affirmer que la nation à laquelle on appartient
est bien « la plus noble » de toutes619. Si cette citation ne s’accompagne d’aucun
développement sur le mythe lui-même, il en va tout autrement dans le Boke of Noblesse, où
son exposition tient une place essentielle dans l’argumentation de l’auteur. En effet, dès
l’entrée de son traité, Worcester nous rappelle que « [the] Englisshe nacion » tire son origine
première de la « nacion of the noble auncient bloode of Troy », dont il souligne aussi
l’ancienneté, « more than M. yere before the birthe of Crist ». De manière très intéressante,
un argument linguistique fantaisiste vient appuyer le propos de l’auteur, selon qui la langue
des Bretons (« Brutes bloode »), de plus encore parlée « bothe in the Princedome of Walys
and in the auncient provynce and Dukedom of Cornewale », n’est autre que du « grec
615 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe Siècles, op.cit. (p.123). 616 Ibid (p.124). 617 Voir Brut, p.5-12. 618 Historical Poems, p.85. 619 Voir Laurence Moal, L’Etranger en Bretagne, op.cit. (p.353-356).
111
corrompu » (« corrupt Greke »)620. Par la suite, les origines troyennes sont encore utilisées
par Worcester dans le cadre de ses exhortations à ses compatriotes, dans la mesure où elles
fondent littéralement, pour lui, l’excellence de la nation. C’est pourquoi il apostrophe les
Anglais en ces termes : « ye worshipfulle men of the Englisshe nacion, which bene descendid
of the noble Brutis bloode of Troy »621, avant de rappeler au roi d’Angleterre, aux princes et
aux nobles anglais qu’ils sont « of so auncien a stok and of so worthy a lineage, as of the
noble Trojan blode descendid »622. Enfin, les origines troyennes permettent de tracer un lien
entre la « noblesse » de la race anglaise et celle d’Hector de Troie lui-même : « folow the
steppis […] of noble courage of the mighty dedis in armes of the vaillaunt knight Hector of
Troy, whiche bene enacted in the siege of Troy for a perpetuellle remembraunce of chevalrie
[ that your noblesse ys decended of] »623 !
De la même façon, les origines troyennes participent également du discours « civique » de la
ville de Londres, saluée par Lydgate, dans son poème sur l’entrée d’Henry VI, pour ses liens
particuliers avec le roi (« The Kyngis Chambre », v.530), mais aussi pour ses glorieuses
origines, puisque Londres n’est autre que la Troja Nova fondée par Brutus624 : « Be gladde, O
London ! […] / Citee of Citees, off noblesse precellyng, / In thy bygynnynge called Newe
Troye ; » (v.510-512)625.
Or, la race bretonne fournit à l’Angleterre plusieurs grands hommes. C’est ainsi que, en
suivant le déroulement du récit national élaboré par Geoffrey, on rencontre les frères
Brennius et Belinus (« Brenne and Belyn »), qui, d’abord divisés, finissent par s’unir pour
conquérir non seulement la Gaule, mais aussi Rome, la Lombardie et la Germanie626. Or, cet
épisode de l’histoire nationale trouve un écho dans le Boke of Noblesse, Worcester
racontant la prise de Rome par Brennius, à l’exception des alentours du Capitole : « Brenus,
king Belynus’ brother, a puissaunt chosen duke, that was before the Incarnacion, wanne and
conquerid to Rome, except the capitoile of Rome »627. Surtout, on arrive ensuite à un
personnage majeur, le roi breton Arthur. Le mythe d’Arthur, sans-doute élaboré de toutes
pièces par Geoffrey de Monmouth, et enrichi par Wace, connaît dès la fin du XIIe Siècle un
succès fulgurant, et la matière de Bretagne engendre une vaste littérature des deux côtés de
la Manche jusqu’à la fin du Moyen Age628. A notre période encore, si quelques doutes
commencent à s’élever sur la réalité de son existence, le roi de la Table Ronde demeure pour
620 Boke of Noblesse, p.2. 621 Ibid, p.9. 622 Ibid, p.43. 623 Ibid, p.20. 624 Brut, p.11 : « & ther Brut be-gan a fayre Cyte for hym & for his folk, & lete calle it « the new Troye », in mynde and remembraunce of the gret Troye, for which place all her lynage was comen ». 625 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p. 648. 626 Voir Brut, p.24-27. 627 Boke of Noblesse, p.10. 628 Sur le mythe d’Arthur, voir par exemple Bernard Guenée, op.cit (p.129) ; Anne E. Sutton et Livia Visser-Fuchs, Richard III’s Books, Stroud, 1997 (p.156) ; Peter Rickard, Britain in medieval French Literature, op.cit. (p.71-120).
112
la plupart des gens une figure historique réelle, qui tient une place essentielle dans l’histoire
nationale629. C’est ainsi qu’Arthur est mentionné comme un modèle de chevalerie par
Lydgate dans la Ballade qu’il adresse au jeune Henry VI à l’occasion de son couronnement
anglais : « Arthour was knyghtly » (v.13)630. Surtout, il occupe une place non-négligeable
dans le Boke of Noblesse, alors que Worcester, rejetant Brennius et Belinus à la phrase
suivante par un effet de style (« And many othre conquestis hathe be made before the daies
of the said Arthur be many worthi kinges of this roiaume »), réserve à Arthur la première
place dans sa liste des « worthi kinges of this lande ». Particulièrement attentif, ici encore,
aux victoires des anciens rois de Bretagne contre l’Empire, synonymes d’indépendance
politique, il choisit de mentionner, parmi tous les autres éléments de la légende d’Arthur, sa
victoire contre l’Empereur de Rome en bataille, et sa conquête de la plupart des pays à
l’ouest de Rome, lui conférant en quelque sorte le statut d’empereur, sans le titre : « And for
an example and witnes of King Arthur, whiche discomfit and sleine was undre his banere the
Emperoure of Rome in bataile, and conquerid the gret part of the regions be west of
Rome»631.
Par la suite, Worcester évoque le passage de l’île de Bretagne de la domination des Bretons
à celle des « Saxons of Duche ys tung, a straunge nacion », qui, instruments du châtiment
divin pour les péchés du « olde Breton bloode », relèguent ce dernier aux périphéries632. Or,
la vision de ces envahisseurs étrangers, originaires d’une « province de Germanie »
(« otherwise called a provynce in Germayne »), est ici très loin d’être entièrement négative.
En effet, l’auteur choisit ici d’évoquer la première venue des Saxons dans l’île sous la
direction du « vaillant chef » Cerdicus, et de raconter comment Arthur, après avoir affronté
ce dernier, l’autorise à s’installer dans l’île (« the vaileaunt Duke Cerdicius arrived in this
reaume, with whom Arthur, king of the Breton bloode, made mighty werre, and suffred hym
to inhabit here »)633, plutôt que de relater l’épisode antérieur de la trahison d’Hengist sous le
règne de Vortigern634, ou celui, postérieur, de la conquête accomplie par l’Africain Gormont
au nom des Saxons, alors que l’île est définitivement rebaptisée « Engeland for the name of
Engist »635. Si Worcester, dans un souci de tracer un portrait positif de tous les ancêtres de la
race anglaise, semble choisir soigneusement l’épisode qu’il relate, il n’hésite pas non plus à
faire un éloge plus direct de la race saxonne, dont il mentionne la puissance : « the mighty
Saxons’ bloode », ainsi que les origines glorieuses, qui lui permettent de plus de rétablir un
semblant de continuité avec les Bretons, puisqu’il affirme, en s’appuyant sur Barthélémy
629 Voir Brut, p.69-91. 630 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.625. 631 Boke of Noblesse, p.9-10. 632 Ibid, p.51. Parmi les peuples ayant habité les îles britanniques, Worcester n’omet pas de mentionner les Pictes : « peple callid Picties, commyng out of ferre northe partie of the worlde » (p.52). 633 Ibid, p.2. 634 Brut, p.49-60. 635 Ibid, p.93-95.
113
l’Anglais, que les Saxons aussi descendent des Grecs ( ! ) : « And the Saxons, as it is written in
Berthilmew in his booke of Propreteis, also were decendid of the nacion of Grekis »636.
De plus, le peuple saxon fournit à l’Angleterre des figures historiques remarquables. C’est
ainsi qu’un roi anglo-saxon très populaire à la fin du Moyen Age, le roi Edgar637 (959-975),
remporte l’attention de l’auteur du Libelle. En effet, dans le « xi. chapitle », Edgar est la
première figure historique invoquée par l’auteur dans le cadre de sa démonstration638. De
fait, ce dernier, qui se base ici sur le récit de l’Anglo-Saxon Chronicle, amplifié par Florence et
John de Worcester dans leur Chronicon ex chronicis en latin (« a cronicle […] Ryght
curiouse », v.865-866), commence par un éloge dithyrambique des vertus d’Edgar, supérieur
à tous ses prédécesseurs et modèle de piété (« oo the moste merveyllouse / Prince lyvynge,
wytty, and moste chevalrouse, / So gode that none of his predecessours / Was to hym lyche
in prudens and honours. / He was fortunat and more gracious / Then other before and more
glorious ; / He was benethe no man in holinesse ; / He passed alle in vertuuse swetenesse »,
v. 868-875), avant de le présenter comme un roi justicier, qui, soucieux du bien public « the
publique thinge » (v.912), traverse toutes les régions de son royaume pour voir par lui-
même le comportement de ses sujets de toutes conditions (« Wythine his lande aboute by
all provinces / He passyd thorowghe, perceyvynge his princes, / Lordes and other of the
commontee, / Who was oppressoure, and who to poverte / Was drawe and broughte, and
who was clene in lyffe », v.890-894), pour s’assurer de la loyauté de ses officiers et de la
bonne application des lois du royaume (« He aspied […] / […] how the ryght and lawes of his
londe / Were execute, v.898-901), et particulièrement pour punir l’oppression des pauvres
par les riches et les puissants dans les villes (« Amonge othyr was his grete besines / Well to
bene ware that grete men of rycchesse / And men of myght in citee ner in toune / Shuld to
the pore doo none oppressione », v.906-909).
Cependant, ce n’est pas cet aspect du récit qui justifie le long passage consacré par notre
auteur à Edgar, mais bien le souci de ce dernier pour le « kepynge of the see ». De fait,
l’auteur du Libelle évoque la construction, sur l’ordre d’Edgar, d’une véritable flotte royale
anglaise, composée de pas moins de 3600 navires d’énormes dimensions et capables de
naviguer sur toutes les mers : « shippes made by him before, /Grete and huge, not fewe but
manye a score, /Full thre thousande and sex hundred also, Statelye inowgh on any see to
goo. /The cronicle seyth these shippes were full boisteous ; Suche thinges longen to kynges
victorious » (v.916-921). De plus, ces bateaux sont mis à bon usage par Edgar, qui a pour
coutume, à la belle saison, de s’y embarquer avec ses troupes (« Wyth multitude of men of
gode array / And instrumentis of werre of beste assay », v.924-925), afin de longer en
personne les côtes anglaises pour dissuader les étrangers d’éventuelles attaques : « To saile
and rowe environ all alonge / So regaliche aboute the Englisshe yle, / To all straungeours a
636 Boke of Noblesse, p.2. 637 C’est ainsi que le roman national Beves of Hamtoun se situe sous le règne d’Edgar (Sur sa popularité, voir Geoffrey Hindley, England in the Age of Caxton, op.cit., p.8 et 32). 638 Libelle of Englyshe Polycye, p.44-49.
114
terroure and perille » (v.933-935). Surtout, le Chronicon lui fournit une anecdote capable de
frapper l’imagination de ses compatriotes et qui se situe au moment du couronnement
d’Edgar survenu à Bath en 973, le roi s’étant ensuite rendu à Chester639. C’est ainsi que
l’auteur du Libelle rapporte comment Edgar, après avoir reçu, « at his grete festivite »
(v.956), l’hommage de nombreux rois, chefs et seigneurs de régions diverses (« Kynges and
yerles of many a contre », v.957), désire se rendre en bateau à l’église Saint-John the Baptist
de Chester (« For to visite seynte Jonys chyrche […] / Rowynge unto the gode holy Baptiste »,
v.962-963). Pour ce faire, il fait apprêter un bateau sur la rivière Dee pour lui et pour 8
autres rois ses vassaux (viij. Kynges mo / Subdite to hym », v.966-967), qui prennent chacun
une rame, alors qu’Edgar s’installe au gouvernail : « And eche of them an ore toke in honde /
At he ore holes, as I understonde, / And he hymselfe satte in the shipp behynde / As
sterisman ; it hym becam of kynde » (v.970-973).
L’œuvre navale et maritime d’Edgar, ainsi que cette expression forte de la suprématie navale
du roi d’Angleterre, qui participe encore aujourd’hui de l’imaginaire national, ne peuvent
que susciter l’admiration de notre auteur, à tel point que ces considérations l’amènent à
faire d’Edgar, ni plus ni moins, la figure majeure de l’histoire nationale anglaise, au même
titre que Cyrus pour la Perse, Charlemagne pour la France et Romulus pour Rome ! : « Of
Englysshe kynges was none so commendable / To Englysshe men, ne lasse memoriable /
Than Cirus was to Perse by puissaunce ; And as grete Charlis was to them of Fraunce, / And
to the Romains was grete Romulus, / So was to England this worthy Edgarus » (v.876-881).
Cependant, c’est un autre roi anglo-saxon que William Worcester, poursuivant
chronologiquement sa liste des « victorious kinges and princes » d’Angleterre, choisit de
mettre en avant : le personnage d’Edmund Ironside, brièvement roi d’Angleterre en 1016 à
la mort de son père Aethelred, pour sa lutte contre l’envahisseur danois, qui l’élève au rang
de héros national : « Edmonde Ironsede had many gret batailes [and] desconfited the Danes
to safe Englond »640.
De même, William Worcester, poursuivant son énumération des ancêtres du peuple anglais,
évoque ensuite les Danois, dont il souligne alors le caractère redoutable et la puissance
guerrière : « the feers manly Danysh nacion », et qui sont à nouveau présentés, toujours
dans le même souci de continuité, comme des descendants des Grecs (« also of Grekis bene
descendid ») ! Ici, le personnage historique retenu est, sans surprise, le roi Cnut, conquérant
639 Sur les sources et la signification de cet épisode, voir Sebastian Sobecki, « Introduction : Edgar’s Archipelago », in The Sea and Englishness in the Middle Ages, Sebastian Sobecki (ed.), Cambridge, 2011, p.1-30. 640 Libelle of Englyshe Polycye, p.10. Voir aussi Brut, p.119, qui rapporte la lutte que se livrent Edmund et Cnut, avant de conclure un accord divisant le royaume entre eux : « this Edmunde Irenside & Knou3t werrede strongliche to-geder ; but at the laste thai were accorded in this maner, that thai shulde departe the reaume bituenes ham ».
115
de l’Angleterre et vainqueur des Saxons, mais aussi roi législateur : « the gret justicer king
Knowt this land subdued and the Saxons’ bloode »641.
Ensuite, Worcester, passant sous silence le retour au pouvoir d’un roi anglo-saxon en la
personne d’Edward le Confesseur, frère d’Edmund Ironside, mentionne la conquête de
l’Angleterre par les Normands : « the noble Normannes », également de sang danois (« also
of the Danys nacion descendid »), menés par Guillaume le Conquérant (« William
Conquerour »), ancêtre de la dynastie royale642. Bien-entendu, Guillaume mérite également
de figurer dans la liste des grandes figures de la nation établie par Worcester, et c’est avec
ses victoires que l’auteur ouvre l’historique du conflit franco-anglais : « And what victorious
dedis William Conqueroure did gret actis in bataile uppon the Frenshe partie [many
conquestis] », de même que son fils Henry I, défendant et fortifiant son duché de Normandie
contre les attaques du roi de France : « And also his son [kyng] Harry after hym defendid
Normandie, bilded and fortified many a strong castelle in his londe, to defende his dukedom
ayenst the Frenshe party »643.
Enfin, Worcester évoque la « race victorieuse » des Angevins (« the victorius bloode of
Angevyns »), qui accède au trône d’Angleterre par le mariage de Mathilde l’Emperesse
(« Dame Maude, Emperes »), fille d’Henry I, « kinge of grete renoune », avec Geoffroy
Plantagenêt (« Erle Geffry Plantagenet »), fils de « Fouke king of Jherusalem », dont est issue
la dynastie royale, « in most prowes »644. Bien-sûr, la dynastie Plantagenêt, qui est alors
encore la dynastie régnante, fournit à nos auteurs nombre de grands personnages. Parmi
ceux-ci, on trouve sans surprise Richard Cœur-de-Lion (« king Richarde the first, clepid Cuer
de lion »), pour sa défense acharnée de son héritage contre Philippe Auguste : « the said
king Richard kept and defendid frome his adversarie Philip Dieu-donné king of Fraunce, be
mighty werre made to hym, the duchees of Normandie, Gascoigne, Guyen, the counteez of
Anjou and Mayne… ». De même, l’auteur mentionne Edward I, conquérant des peuples
celtes et aussi protecteur et défenseur des duchés de Gascogne et de Guyenne645.
A partir de là, Worcester consacre des passages beaucoup plus longs à deux grands héros
nationaux empruntés à l’histoire récente, Edward III et Henry V. C’est ainsi qu’Edward III et
son règne glorieux646, comme nous l’avons déjà constaté, occupent une place importante
dans le Boke of Noblesse. Premièrement, l’auteur mentionne la victoire d’Edward III, « most
641 Boke of Noblesse, p.2. 642 Boke of Noblesse. De même, les origines normandes de la noblesse anglaise sont mises en scène par John Page en la personne de Gilbert d’Umfraville, en qui les Rouennais sont tout heureux de retrouver un compatriote : « And they hym askyd what he hyght. / He sayde ‘My name ys Umfrevyle’. / They thonkyd God and sayde that whyle, / ‘Of Normandy the olde blode / Shalle helpe that we may have a ende goode / By-twyxte us and thys worthy kynge’ », Historical Collections of a Citizen of London, p.23. 643 Ibid, p.10. 644 Ibid, p.2. 645 Ibid, p.10-11. 646 Ibid, p.12-15.
116
noble famous knighte of renomme », à la bataille de l’Ecluse en 1340, au tout-début de la
guerre de Cent Ans : « the gret bataile uppon the see at Scluse ayenst Philip de Valoys […]
and alle his gret navye of shippis destroied ». Vient ensuite la campagne de 1346, alors
qu’Edward III contre le projet de Philippe VI d’envahir l’Angleterre, en décidant de venir
l’affronter sur son territoire : « And the said king Edward thrid thought rather to werre withe
hym in that countre rather ». Cette campagne est alors marquée par une tentative avortée
contre Caen, mais aussi par la brillante victoire de Crécy : « And after that […] descomfit the
said king Philip and wanne the feelde uppon hym at the dolorous and gret bataile of Cressy
in Picardie », où non seulement Jean de Luxembourg (« the king of Beame »), mais aussi « la
majeure partie de la noblesse française » (« the gret part of the noble bloode of Fraunce »)
trouvent la mort. La même année, les troupes anglaises remportent la victoire à la bataille
de Neville’s Cross contre le roi d’Ecosse David the Bruce (« David king of Scottis was take
prisoner […] at the bataile beside Deram upon the marchis of Scotlond »). De même, l’année
suivante est marquée par la victoire contre les troupes de Charles de Blois à la bataille de la
Roche-Derrien (« And also the said king kept Bretaigne in gret subjeccion, had the victorie
uppon Charles de Bloys duke of Breteine, and leid a siege […] to a strong forteresse clepid
Roche daryon), mais surtout par la prise de Calais : « And he also wanne Calix after, by a long
and puissaunt sieges keping by see and be londe », suivie de la conquête d’une grande partie
de la Normandie. Ensuite, l’auteur, introduisant ainsi une autre grande figure nationale, celle
du prince de Galles Edward de Woodstock (« his eldist sonne Edward prince of Walis »),
évoque la victoire de ce dernier à Poitiers, en 1356 (« a gret discomfiture afore the cite of
Peyters uppon John calling hym King of France ») où Jean II est fait prisonnier (« where the
said king was taken prisoner »), puis emmené en Angleterre (« the said prince Edward with
king Johan tooke the see at Burdeux to Englond, […] and came to London »), où il est
honorablement reçu par Edward III (« the said king Edwarde his father meeting withe king
Johan in the feelde, doing hym gret honoure and reverence »), avant d’être soumis à la
rançon (« the said king Johan was put to finaunce and raunson »). Enfin, Worcester clôt son
récit du règne victorieux d’Edward III par la bataille de Najera (« bataile of Nazar in Spaine »),
remportée en 1367 par le prince de Galles et Henry de Lancastre pour le compte de leur allié
Pierre le Cruel et contre le « bastarde » Henri de Trastamare, et où est capturé Bertrand du
Guesclin. De plus, à ce récit des victoires du règne vient s’ajouter, plus loin, un autre épisode
glorieux attaché à la personne d’Edward III : la fondation de l’Ordre de la Jarretière à
Windsor, en 1348. En effet, Worcester, pour qui les chevaliers de l’Ordre incarnent
parfaitement, comme nous l’avons vu plus haut, les valeurs militaires de la nation, fournit
également une explication de l’insigne de l’Ordre, qui, loin d’avoir pour origine un épisode
courtois, signifie l’engagement d’Edward III à ne jamais fuir en bataille : « the noble and
worshipfulle ordre of the Garter, founded by the right noble prince king Edward thrid, and to
bere about his legge a tokyn of the Garter […] in token of worship that he being in bataile
what fortune fillle shuld not voide the feeld, but abide the fortune that God lust sende »647.
647 Boke of Noblesse, p.46.
117
Edward III apparaît également comme un personnage historique majeur dans le Libelle of
Englyshe Polycye. En effet, ce n’est pas un hasard si c’est sous le règne d’Edward III que
l’auteur choisit de situer son récit de l’expédition menée contre les pirates bretons et leur
duché648. En effet, il dit comment, ayant reçu cette histoire de John Hampton, il consulte des
personnes de tous rangs (« bothe […] hygh and lowe », v.181), qui sont toutes d’avis que cet
événement doit s’être produit sous le règne d’Edward III (« all mene accordene into one /
That hit was done […] / […] whene that noble kyng Edwarde the thride / Regned in grace… »,
v.182-184), dans la mesure où ce dernier a toujours témoigné de son amour pour les
marchands d’Angleterre (« For he hadde a manere gelozye / To hys marchauntes and
lowede hem hartelye », v.186-187). L’auteur raconte donc ensuite comment Edward III,
après en avoir appelé sans succès au duc de Bretagne, prend sur lui, sans convoquer de
Parlement (« Wythoute callynge of ony parlemente », v.213), de faire fortifier les trois ports
anglais de Dartmouth, Plymouth et Fowey (« To fortefye […] / Of Englysshe townes iij., that is
to seye / Dertmouth, Plymmouth, the thyrde it is Foweye », v.215-217), et de les encourager
à faire la guerre à la Bretagne (« Upon the Pety Bretayn for to werre », v.220), ce que les
« gode seemenne » (v.221) font alors sans se faire prier, en soumettant leurs ennemis
(« Tooke prysoners and lernyd hem for to loutte », v.223), avant de porter la guerre dans le
duché de Bretagne, détruisant tout sur leur passage (« werred forth into the dukes londe /
And had neygh destrued free and bonde », v.228-229).De même, l’auteur du Libelle,
particulièrement hostile, comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, aux
« Lumbardes », ne peut s’empêcher de louer Edward III pour son statut limitant leur durée
de séjour dans le royaume à quarante jours : « He made a statute for Lumbardes in thys
londe, / That they shulde in no wysse take on honde / Here to enhabite, to charge and to
dyscharge, / But xl. Dayes… » (v.240-243)649.
Surtout, Edward III est la deuxième figure évoquée par l’auteur dans son onzième chapitre
consacré à l’argumentation historique. En effet, il n’hésite pas à lui attribuer le titre de
« lorde of the see ». De même, selon lui, nul n’est besoin de démontrer la bravoure et
l’excellence des actions du roi, aussi bien sur terre que sur mer, puisqu’elles sont bien
connues de ses compatriotes : « Of kynge Edwarde I passe and his prowesse ; / On londe, on
see ye knowe his worthynesse » (v.980-981). De fait, l’auteur, en rappelant les grandes
victoires du règne, tend toujours à signaler que celles-ci appartiennent à un passé récent, et
sont encore très présentes à l’esprit des contemporains. Il en est ainsi pour la Bataille de
l’Ecluse (« The bataylle of Sluce ye may rede every day ; / […] / Hit was so late done that ye it
knowe », v.1004-1006), qu’il évoque en passant pour faire l’éloge de l’absolue supériorité
navale d’Edward III (« In whose tyme was no navey in the see / That myght wythstonde the
power of hys mageste », v.1003-1002). Il en est de même, bien-entendu, pour le siège de
Calais, survenu « After the bataille of Crecy was idoo » (v.985), et événement si récent qu’il
affirme (avec sans-doute une certaine exagération!), que certains vieillards encore en vie ont
648 Libelle of Englyshe Polycye, p.10-13. 649 Ibid, p.13.
118
pu y être présents (« Olde men sawe it whiche lyven, this is no doute », v.987). Surtout, le
siège de Calais par Edward III, « Rounde aboute by londe and by the water » (v.983), est
comparé au siège de la même ville par Philippe de Bourgogne un siècle plus tard, afin bien-
sûr de décridibiliser ce dernier, qui, n’ayant pas encerclé Calais par la mer, ne mérite même
pas le nom de siège (« It was no thynge beseged by the see ; / Thus calle they it no seage for
honeste », v.992-993)650.
Enfin, le portrait des grands hommes de la nation se clôt unanimement par la figure d’Henry
V. En effet, les éclatantes victoires de ce dernier sont déjà célébrées de son vivant comme
des événements historiques majeurs. En témoigne particulièrement The Agincourt Carol, qui
évoque avec une immense fierté la prise d’Harfleur (« He sette a sege, the sothe for to say, /
To harflu tovne with ryal a-ray ; / that tovne he wan… », v.5-7), et surtout la victoire
d’Azincourt (« In agincourt feld […] / he had bothe the felde & the victory », v.14-16),
marquée, comme l’auteur se plaît à le rappeler, par la mort et la capture des « dukys & erlys,
lorde and barone » (v.17) du royaume de France, de même qu’il mentionne l’arrivée des
prisonniers à Londres, qui constitue à ses yeux un épisode particulièrement réjouissant et
glorieux : « And summe were ladde in-to lundone, / With ioye and merthe & grete renone »
(v.19-20)651 ! Au-delà de la poésie, cette fierté contemporaine trouve un écho identique dans
le sermon d’ouverture du Parlement en 1416, qui relate comment Henry V, « [soi]
transportant a les parties de France […] y gaina la ville de Hareflu […], et puis combatist a
Echyncourt […] ove tout la poair de France », où « [fuit] tuee la grande partie de la chivalrie
del partie Franceis », le roi ayant également « plusours ducs, conts, et autres grandes
seignurs, et chiveuteins de France […]en sa garde ses prisoners »652, dans celui de 1417, qui
rappelle « la gracious esploit et merveillous victorie […] a Hareflete, et Echyncourt »,
méritées par Henry V en raison de ses « grandes merits et famouses vertues »653, et encore
en 1419 : « la gloriouse victorie des gents Franceys a Echyncourt »654, ces deux derniers
sermons faisant aussi état de la progression de la conquête de la Normandie.
De même que la légende s’empare des hauts-faits d’Henry V de son vivant-même, le roi
accède immédiatement au panthéon des grands personnages de l’histoire d’Angleterre655.
De fait, on trouve dèjà, dans les versions du Brut datant de la première moitié du siècle, le
tissu des mythes et légendes retravaillés par Shakespeare un siècle et demi plus tard pour
écrire son Henry V. C’est ainsi que, si le thème de sa jeunesse dissolue n’apparaît que très
tardivement656, les auteurs s’emparent immédiatement de celui de sa bravoure personnelle
650 Libelle of Englyshe Polycye, p.50-51. 651 Historical Poems, p.91-92. 652 PROME, parlement d’octobre 1416, item 3. 653 PROME, parlement de novembre 1417, item 2. 654 PROME, parlement c’octobre 1419, item 1. 655 Sur la figure d’Henry V, qui suscite une vaste littérature, voir Charles Lethbridge Kingsford, English Historical Literature, op.cit. (p.45-69) et Antonia Gransden, Historical Writing in England, vol.II, op.cit. (p.194-219). 656 Brut, p.494.
119
à Azincourt, où il combat si courageusement qu’un morceau de sa couronne se brise (« the
King that day full manfully faughte […], his oune handys, so that 1 pece of his croune was
broken, which afterward was founden and broughte to hym »)657, et surtout de la légende
de l’envoi des balles de tennis par le dauphin, que nous avons évoquée plus haut, et à
laquelle il est encore fait allusion lors du bombardement d’Harfleur par Henry V : « & there
he played at tenys with his harde gune-stone3 […].Whanne thai shulde plai, thai songyn
« welawaye and allas that eny suche tenye3-ballis were made »658. De manière très
intéressante, on trouve également cette légende, décrite de manière très proche, dans la
Recollection of Henry V adressée par John Audelay à Henry V, preuve qu’elle participait déjà
pleinement de l’imaginaire national en 1429. C’est ainsi que le poète raconte comment le
dauphin « send him ballis, him with to play » (v.12), et comment Henry, à Harfleur,
« apprend aux Français à jouer à la balle » (« ta3t franchemen to plai at the ball », v.14) avec
ses boulets de canon. Sans surprise, on retrouve également dans la Recollection la mention
d’Azincourt (« At agyncowrt, at that patayle, / The floure of frawnce he fel that day », v.23-
24)659.
Ce sont bien-sûr les mêmes épisodes qu’on retrouve dans le Boke of Noblesse, dans lequel
Worcester s’attarde longuement sur Harfleur (« Harflete »), puis raconte comment Henry
« wanne bothe the saide Duchie of Normandie first and after the Roiaume of Fraunce »
grâce à sa « gret manhode », en vainquant « the myghtie roialle power of Fraunce » au
moyen de sièges (d’abord à Harfleur en 1415, puis à Caen, Rouen et autres villes de
Normandie et de la région parisienne entre 1417 et 1420), et aussi par sa victoire à
Azincourt : « And had a gret discomfiture at the bataile of Agincourt […] where many dukes,
erlis, lordis and knightis were slaine and take prisoneris » et son union avec « the Frenshe
king Charlis .vj.te is doughter »660. Plus loin, Worcester revient sur cet éloge d’Henry V,
étendu à l’ensemble de sa fratrie : « Where was he of late daies descendid of noble bloode
that was so corageous in dedis of armes as was that mightifull prince of renommee […]
Henry .vte. and his said thre full mighty and noble princes his brethern », alors qu’il évoque
Thomas de Clarence pour sa gestion en Irlande et en Guyenne, et surtout pour son rôle dans
la conquête de la Normandie et du royaume de France (« [the seyd duc,] in company of the
victorioux prince Henry the .v.te, labourid in armes upon the noble conquest in Fraunce and
the duchie of Normandie »), qui se solde par sa mort à Beaugé, John de Bedford pour sa
défense des Marches d’Ecosse (« werrid ayenst the Scottis, keping them in subgeccion,
havyng gret journeis and batailes ayenst them »), mais aussi pour son œuvre en tant
qu’ « admirall and kepar of the see » et pour sa victoire à la Bataille de la Seine (« a gret
mortal bataile and victorie ayenst the carrakes, galeis, and othir gret shippis »), ainsi que
pour son rôle en tant que régent du royaume de France et sa conquête du Maine, et
Humphrey de Gloucester, pour sa blessure à Azincourt (« at the bataile of Agyncourt was
657 Brut, p.555. 658 Ibid, p.376. 659 Historical Poems, p.109. 660 Boke of Noblesse, p.15-17.
120
sore woundid »), pour sa participation à la conquête de la Normandie, pour son œuvre en
tant que Lord Protector, et enfin, pour avoir secouru Calais en 1436 : « whan youre nobille
castelle and towne of Calix was beseigid […], without long respit or tarieng, he puissauntly
rescued it »661.
De même, l’auteur du Libelle choisit Henry V comme sa troisième et dernière grande
référence historique. En effet, l’auteur dresse une liste dithyrambique des qualités du roi,
« merveillouse werroure and victorius prince », et digne héritier d’Edgar et d’Edward III :
« What had this kinge of high magnificens, / Of grete corage, of wysdome and prudence, /
Provision, forewitte, audacite, / Of fortitude, justice, agilite, / Discrecion, subtile
avisifenesse, / Atemperaunce, noblesse and worthynesse, / Science, proesce, devocion,
equyte, / Of moste estately magnanimite, / Liche to Edgare and the seyd Edwarde, / A
braunche of bothe, lyche hem as in regarde ! » (v.1034-1043), de telle sorte qu’il n’hésite pas
à le décrire comme l’homme le plus victorieux de tous les temps, et le meilleur des rois en
un règne aussi court (« Where was on lyve man more victoriouse, / And in so shorte tyme
prince so mervelouse ? » (v.1044-1045). Bien-sûr, son éloge se concentre ici sur les
réalisations navales du roi, et surtout sur les « grete shippes » qu’il a fait construire entre
1415 et 1420, soit « The Trinite, the Grace Dieu, the Holy Goste » (v.1014)662, dans le but
d’affirmer sa supériorité sur la mer : « What hope ye was the kynges grette entente / Of tho
shippes and what in mynde he mente ?/ It was not ellis but that he caste to be / Lorde
rounde aboute the see » (v.1016-1019), but qu’il aurait atteint s’il n’était pas mort
prématurément : « For doute it nat but that he wolde have be / Lorde and master aboute
the rounde see, / And kepte it sure, to stoppe oure enmyes hens » (v.1058-1060). Afin
d’illustrer son propos, l’auteur choisit ici d’insister sur un épisode en particulier, celui du
siège d’Harfleur par les Français en 1416, « after the kynge Hareflew had wonne » (v.1026),
et de la Bataille de la Seine, qui consacrent la supériorité d’Henry V dans la Manche et
couvrent Bedford de gloire : « And whan Harflew had his sege aboute, / There came carikkys
orrible, grete and stoute, / In the narowe see wyllynge to abyde, / To stoppe us there wyth
multitude of pride. / My lorde of Bedeforde came one and had the cure ; / Destroyde they
were by that discomfiture » (v.1020-1025)663.
C’est ainsi qu’on observe chez tous nos auteurs, pourtant dans des œuvres de types et de
contenus assez différents, un véritable consensus en ce qui concerne les grands personnages
et les grands épisodes de l’histoire nationale, tous également liés à la défense de
l’Angleterre et à la lutte contre l’Ennemi étranger.
Enfin, l’histoire, si son but premier est bien de fournir ses répères à la nation anglaise, sert
aussi, dans le Boke of Noblesse, à établir juridiquement le droit du roi d’Angleterre à ses
661 Boke of Noblesse, p.43-45. 662 Sur la politique navale d’Henry V, voir Christopher Allmand, Henry V, op.cit. (p.220-232, et particulièrement 226-227 pour les navires mentionnés). 663 Libelle of Englyshe Polycye, p.51-53.
121
possessions continentales et à la couronne de France. De fait, Worcester démontre d’abord
« the first title of Normandie, and how frely it holdithe », en s’appuyant sur « many credible
bookis of olde cronicles and histories »664. L’argument repose alors sur la figure de Rollon,
ancêtre du Conquérant, et sur celle de Richard I de Normandie. En effet, Worcester rappelle
l’attribution par Charles le Simple de la future Normandie au chef scandinave Rollon en 911,
ce dernier recevant alors le baptême et épousant la fille du roi carolingien : « duc Rollo, after
cristned and called Roberd, that came out of Dennemarke […] was righte duke of Normandie
by yeft of Charlys the symple, king of Fraunce, [who] maried his doughter to Rollo and gave
hym the saide ducdome », et cette même donation est bien présentée, plus loin, comme
une conquête : « duke Rollo […] conquerid it upon Charlis le Simple »665. Surtout, la défaite
de Louis IV d’Outre-Mer face à Richard I de Normandie, petit- fils de Rollon, est l’occasion
pour Worcester d’invoquer la cession du duché en toute souveraineté par les rois de France :
« the said Lowes relesid the seide dukedom to the said Richarde and to alle his successours
to holde frely in souvereinte and resort of none creature but of God ». De la même façon, en
ce qui concerne l’Anjou et le Maine, Worcester rappelle les origines de la dynastie
Plantagenêt, soit le mariage de Mathilde l’Emperesse, fille et héritière de Henry I, à Geoffroy
Plantagenêt, leur fils Henry II (« that most famous king in renome Henry the seconde »)
concentrant sur sa personne le double héritage de ses parents : « be right of his moder
Maude […] right king and enheritoure of Englonde, also duke of Normandie seisid. And be
right of his foresaide father Geffrey Plantagenet […] right enheritour ans seisid of the said
countee of Anjou, Mayne, Toreyne »666. Enfin, la démonstration du titre anglais en Gascogne
et Guyenne repose sur le rappel de l’union de l’héritière Aliénor d’Aquitaine au futur Henry II
en 1152, après l’annulation de son mariage avec Louis VII : « Harry the seconde of Englande
[…] wedded the said Alienor […] by whome he was duke of Gascoigne and Guien, and his
heires after hym, of whom ye bene descended and come right downe », ce qui permet à
Worcester de récapituler de manière pédagogique la titulature d’Henry II : « So in conclusion
he was, be right of his moder […], king of Englonde and duke of Normandie, and, be right of
his father […] erle of Anjou and of Mayne and Torayne ; be right of his wiff, duke of
Guien »667. De même, les titres du roi d’Angleterre en Normandie et en Guyenne s’inscrivent,
de manière très intéressante, dans la représentation héraldique, et donc dans l’imagerie
nationale, puisque ce sont eux que symbolisent les trois léopards qui figurent sur les armes
d’Angleterre. En effet, Worcester raconte ainsi comment Guillaume le Conquérant « beere in
armes by the saide duchie of Normandie in a feelde of gulis .ij. libardis of golde », auxquels
Henry II ajoute un troisième pour la Guyenne, après son mariage avec Aliénor : « king Henry
the seconde bare in armes frome that day forthe the saide libarde of golde withe the other
two libardis of the same that is borne for Duke of Normandie »668 ! Enfin, l’auteur évoque
664 Boke of Noblesse, p.22-23. 665 Boke of Noblesse, p.39. 666 Ibid, p.23. 667 Ibid, p.24-25. 668 Ibid, p.23 et 24.
122
très rapidement le titre du roi d’Angleterre au royaume de France (« Nota pro titulo regis »)
lorsqu’il rappelle le mariage conclu en 1308 entre Edward II et Isabelle de France, « unique
héritière » du royaume après la mort de Charles IV : « the saide king Edwarde weddid dam
Isabel king Charles of Fraunce daughter669, [soule] enheriter of Fraunce »670.
2) La Nation et Dieu.
Le Sacré, et l’affirmation de l’existence d’un lien spécial avec Dieu, sont aussi un élément
essentiel du discours sur l’excellence de la nation. C’est ainsi que les auteurs anglais, certes
de manière moins aboutie qu’en France, revendiquent pour leurs rois et leur nation une
place particulière dans les desseins d’En-Haut.
Premièrement, ils n’hésitent pas à faire des Anglais un nouveau « Peuple Elu », comme en
témoigne le rapprochement très fréquemment repris et mis en scène, des mots Anglici et
angeli, attribué au pape Grégoire le Grand, et que nous avons évoqué précédemment dans
le cadre de la visite de Sigismond en Angleterre. De fait, le très célèbre Diptyque de Wilton,
réalisé sous le règne de Richard II, reprend cette idée, ainsi que celle qui affirme que
l’Angleterre n’est autre que le douaire de la Vierge Marie, qui étend sa protection sur le
royaume671. De plus, William Worcester affirme encore que la protection divine particulière
dont jouit l’Angleterre ne saurait être remise en question, puisque c’est Dieu lui-même,
« protectoure, kepar » et « defendour » du royaume, qui empêche les débordements de la
Tamise : « Som say that the floode of Temmys rennythe beting hier than the londe in
stormye seasons. Yet for alle that, withe Goddis mighte and grace, thow art not in the
extremitee of tho stormes, ne never mote it come there in suche indigence and
necessite »672 ! De plus, les auteurs, tels que Thomas Polton à Constance en 1417, n’hésitent
pas à aller chercher dans le passé les preuves d’une élection divine, soit l’ancienneté de la
conversion à la Foi chrétienne, attribuée à Joseph d’Arimathie, l’organisation du premier
concile général destiné à éradiquer l’hérésie, et la naissance à York du premier empereur
chrétien, Constantin, fils de la princesse anglaise st Hélène673. De même, l’histoire fournit
aux Anglais de grands saints nationaux, Thomas Becket bien-sûr, mais aussi des figures
royales, st Edmund the Martyr, mais surtout st Edward le Confesseur, qui figurent aussi sur
le Diptyche de Wilton, flanqués de st Jean-Baptiste. C’est ainsi que st Edward occupe une
place essentielle dans le discours et les cérémonies de la Double Monarchie en tant
qu’ancêtre de la dynastie anglaise. De fait, il est évoqué pas moins de 6 fois dans les textes
de Lydgate, dans sa Ballade to King Henry VI (v.10)674, dans son Roundel (v.3)675, parmi les
669 Worcester commet ici une confusion, en faisant d’Isabelle la fille, et non pas la sœur de Charles IV. 670 Ibid, p.36. 671 Voir Jean-Philippe Genêt, « Le Roi anglais et la Nation française », in Beihefte der Francia, Bd. 39, 1997, p.39-58 (Pour la description du Dyptique, voir p.46-47). 672 Boke of Noblesse, p.82. 673 Jean-Philippe Genêt, « English nationalism : Thomas Polton at the Council of Constance », op.cit. (p.67). 674 Minor Poems of John Lydgate, vol.II p.625.
123
Sotelties du banquet de couronnement (v.2)676, et enfin dans le contexte de l’Entrée
Triomphale d’Henry dans Londres, dans la mise-en-scène de l’arbre généalogique du roi
(v.399)677, mais surtout lorsque ce dernier, se rendant à Westminster, se voit présenter par
l’abbé la relique du sceptre de st Edward, qu’il porte fièrement jusqu’à l’autel, malgré son
poids et ses dimensions, au son des cloches : « The Abbot affter moste solempnely /
Amonges the relikes the septre oute souht / Off Seint Edward, and to the Kyng it brouht ; /
Thou hit were longe, large and off grete weyht, / Yitt on his shuldres the Kyng bare it on
heyht, / Into the mynstre, while alle the belles ronge, / Tyl he kome to the hyh awtere »
(v.477-483)678.
De la même façon, nos textes témoignent du souci des rois d’Angleterre de se présenter en
défenseurs de la Foi. Ici encore, les auteurs, tels que William Worcester, ont recours à
l’histoire, qui leur fournit les noms des rois et des princes d’Angleterre qui ont participé aux
Croisades (« How many worthi kinges of this lande have made gret conquestis in ferre
contrees in the Holy Lande »), ce qui vient confirmer et compléter la liste des grands
hommes de la nation. C’est ainsi qu’il est question, dans le Boke of Noblesse, de Robert
Courteheuse, frère de Henry I, et de ses victoires en Terre Sainte lors de la première
croisade, qui lui ont valu, selon Worcester, d’être choisi comme roi de Jérusalem : « And how
victoriouslie his brother Roberd did armes uppon the conquest of the holy londe, that for his
gret prowesse there was elect to be king of Jherusalem », titre qu’il refuse pour rentrer en
Normandie. De même, Worcester va jusqu’à revendiquer pour la dynastie et la nation
anglaises la figure du comte d’Anjou Foulques V, grand-père de Henry II Plantagenêt, et élu
roi de Jérusalem : « And to bring to mynde how the noble werriour Fouke erle of Angew,
father to Geffrey Plantagenet youre noble auncestour, left hys erledom to his sonne, and
made werre upon the Sarasynes in the holy land, and for his noble dedis was made king of
Jherusalem ». Bien-sûr, Richard Cœur-de-Lion occupe la place d’honneur dans cette
énumération, en raison de ses hauts faits au cours de la troisième croisade : « in a croiserie
went in to the holy londe […] and werreied uppon the hethen paynemys […], whiche king
Richard conquerid and wanne by roiall power uppon the Sarrasyns », soit la conquête de
Chypre (« the isle of Cipres ») et la soumission de la Syrie (« the londe of Surie ») avec la
prise de Damas (« the gret cite of Damask wanne be assault » ?)679. Worcester mentionne
ensuite le rôle du futur Edward I en Afrique lors de la neuvième croisade en 1270 (« king
Edward first […], being Prince, […] put hym in gret laboure and aventure amonges the
Sarrasins in the countye of Aufrik »), d’abord à Tunis (« at the conquest of the gret cite of the
roiaume of Thunes »), mais surtout à Acre, menacée par les Musulmans (« the defence and
saufegarde of the gret cite of Acres in the londe of Sirie »), et où le prince et son armée
tiennent une année entière (« an hole yere ») en pleine épidémie meurtrière (« in tyme of
675 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.622. 676 Ibid, p.623. 677 Ibid, p.644. 678 Ibid, p.646. 679 Sans-doute une confusion de l’auteur pour Acre, conquise par les Croisés en 1191.
124
gret pestilence and mortalite […] by whiche his peple were gretly wastid »). De plus,
Worcester relate également la tentative d’assassinat dont le prince est alors victime de la
part d’un messager musulman (« a untrew messaunger Sarrasin ») à la solde du « sultan de
Babylone », qui le blesse gravement d’un coup de poignard (« wounded hym in his chambre
almost to dethe »), preuve absolue de la terreur que le prince anglais inspire alors à ses
adversaires (« becaus of sharpe and cruelle werre the seide Edwarde made uppon the
Sarrasines, of gret fere and he had of the said prince Edward and of his power »). Surtout,
l’auteur insiste sur le fait que c’est bien l’intervention d’Edward qui a évité l’échec total de la
croisade après la mort de Louis IX : « [Yn whiche cuntree that tyme and yeere seynt Lowys
kyng of Fraunce dyed, and the croyserye grete revaled by hys trespasseinte, had not the
seyd prince Edward ys armee be redye there to performe that holy voyage to
Jerusalem »…] ». Enfin, Worcester remonte de trente ans pour évoquer les « gret actis of
armes in the holy londe uppon the Sarasynes » accomplis en 1240 par Richard de
Cornouailles, frère de Henry III, plus tard élu « emperoure of Almaine »680.
De même, ce souci trouve également un écho contemporain, alors que la dynastie
lancastrienne s’associe aux projets de croisade et aux tentatives de résolution du Schisme et
affirme sa place au sein de la Chrétienté. De plus, il convient, à la même époque, de redorer
le blason de l’Angleterre après l’hérésie de John Wyclyff et de ses disciples, les Lollards. C’est
ainsi que la lutte d’Henry V contre ces hérétiques occupe une place non négligeable dans
l’éloge de son règne, et lui vaut de figurer aux côtés de l’empereur Sigismond, comme nous
l’avons vu plus haut. C’est ainsi que, lorsque Martin V, en 1427, élève Henry Beaufort au
cardinalat et lui confie la responsabilité d’une croisade contre les Hussites, son choix est
certes dicté par sa confiance en l’habilité militaire des Anglais, mais aussi par une volonté de
leur faire expier l’hérésie de Wyclyff681. De même, cet héritage est revendiqué par les
auteurs pour Henry VI, par Lydgate, mais aussi par John Audelay, qui affirme qu’il accomplira
la prophétie jadis faite à son père, selon laquelle il pourra, avant sa mort, conquérir la Croix
du Christ : « On him schal fal the prophece / That hath ben sayd of kyng herre : / The hole
cros wyn or he dye, / That crist halud on goodfryday » (v.45-48), et convertir tous les
« païens » au christianisme (« & turne to cristyndam al hethynes », v.51)682.
De même, les auteurs anglais sont prompts à opposer leur comportement religieux à celui
de leurs adversaires étrangers. En témoigne en effet la pétition de 1404 par laquelle les
Commons réclament l’expulsion des étrangers schismatiques (soit, ici, d’obédience
avignonnaise), en invoquant le danger de « contamination » qu’ils représentent pour les
Anglais : « pur eschuir, primerement, le peril qe purra avenir a les almes des lieges de nostre
dit seignur le roy par la comunicacioun ovesqe tielx qi tiegnent la partie adverse »683. Le
thème du Schisme réapparaît, bien-sûr, dans le texte de l’alliance conclue par Henry V et
680 Boke of Noblesse, p.10-11. 681 Voir Gerald Harriss, Shaping the Nation, op.cit. (p.555). 682 Historical Poems, p.110. 683 PROME, parlement de janvier 1404, item 26.
125
Sigismond, où Charles VI est accusé de repousser les ouvertures de paix qui lui sont faites
pour entretenir le Schisme, qu’il a lui-même initié et continuellement encouragé :
« tanquam […]scismatis antiqui alumpnus, detractavit pacem acceptare […], ut machinacione
pestifera pacificum statum et coadunacionem ecclesiasticam disturbaret, sicut recolitur
fuisse per ipsum adversarium nostrum, retroactis temporibus, scisma in ecclesia Dei factum
et nutritum »684. De même, les Commons, dans une pétition de 1444, se saisissent de
l’occasion d’une attaque gênoise contre Rhodes, siège de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem, en
compagnie de nombreux musulmans (« havyng in their felaship grete nombre of
Sarazynes »), pour réclamer la stigmatisation des Génois en Angleterre, en tant qu’ennemis
du peuple chrétien : « that all the Janueyes beyng in this lond, be had in suche reputacion
and conceite, as thei that bee enemyes unto the Cristien poeple, socorours and helpers to
the enemyes of the Cristien feith and mescreantz »685.
Surtout, toutes ces idées sont reprises et amplifiées dans le contexte du conflit franco-
anglais. De fait, le Sacré y joue un rôle essentiel. C’est ainsi que, tout-d’abord, Worcester est
amené à poser la question de la légitimité d’une guerre entre chrétiens : « A question of
grete charge and wighte […], whethir for to make werre uppon Cristen bloode is laufulle »,
afin de démontrer la validité de la cause anglaise. En effet, l’auteur, fondant son propos sur
l’Arbre des Batailles, démontre que le roi d’Angleterre, qui ne fait que revendiquer son droit
et répondre aux provocations de son adversaire, mène une guerre juste, et donc tolérée de
Dieu : « entrepruises and werris taken and founded uppon a just cause and a trew title is
suffred of God »686. De même, en conformité avec le processus décrit par Ernst
Kantorowicz687, le Sacré investit le discours national, alors que les Anglais tombés à la guerre
sont décrits par Worcester comme des « martyrs » de la nation. C’est ainsi qu’il engage ses
compatriotes à se souvenir de tous ceux qui ont sacrifié leur vie ou leur liberté pour servir la
cause du roi d’Angleterre en France, « comme de véritables martyrs et âmes
bienheureuses » : « And doo not away the recordacion of actis and dedis in armes of so
many famous and victorious Kingis, Princes, Dukis, Erles, Barounes, and noble Knightis, as of
fulle many other worshipfulle men haunting armes, whiche as verray trew martirs and
blessid souls have taken theire last ende by werre ; some woundid and taken prisonneres in
so just a title and conquest »688, le thème du « martyr » étant de nouveau explicitement
appliqué aux courageux chevaliers de la Jarretière (« O ye right noble martirs ! »)689. De la
même façon,Worcester, citant Job, fait appel à la charité de ses compatriotes, qui ne doivent
pas faire fi du sang répandu par tant de bons chrétiens : « the sheding of the bloode of good
684 PROME, parlement d’octobre 1416, item 14. 685 PROME, parlement de janvier 1442, item 32. 686 Boke of Noblesse, p.6. 687 Ernst Kantorowicz, « Mourir pour la patrie (Pro Patria Mori) dans la pensée politique médiévale », in Ernst H. Kantorowicz, Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, 2004. Voir aussi Colette Beaune, Naissance de la Nation France, Paris, 1985 (p.329-335). 688 Boke of Noblesse, p.4. 689 Ibid, p.48.
126
cristen people as hathe be done in youre predecessours conquest that now is lost : is said be
the wordis of Job : Criethe and bewailethe in the feelde, frendis and kyn, take heede pitously
to your bloode»690.
De même, les Anglais, combattant pour une cause juste, se présentent alors comme les
soldats de Dieu. C’est ainsi que Lydgate affirme que les guerres d’Henry V ont servi la cause
du Christ : « Sithen Henry the Vth so noble a knyght was founde / For Cristes cause in actis
martial » (Sotelties, v.11-12)691. C’est cette même idée qu’on retrouve dans le Brut, alors
qu’Henry V, apercevant les forces françaises avant Azincourt, place toute sa confiance en
Dieu et le prie de « sauver ses véritables serviteurs » : « thanne the King, with a meke hert
and a gode spiryt, lyfte vp his hande3 to Almy3ti God, besechyng hym of help & socour, and
that dai to saue his trew seruaunte3 »692. De même, les chroniqueurs anglais sont prompts à
attirer l’attention sur le comportement pieux de leurs compatriotes, qui contraste très
fortement avec l’attitude orgueilleuse de leurs adversaires. C’est ainsi que, toujours avant
Azincourt, alors que les Français ont bruyamment fêté toute la nuit leur victoire à venir, les
Anglais, qui se préparent à combattre « in the name of Almyghty God », s’agenouillent en
silence, tracent la Croix du Christ sur le sol et l’embrassent, et s’en remettent à Dieu : « Then
oure men knelit doune al attones, and made a cros on the grounde, and kissit it, and put
hem in the mercy of God »693. Il ne fait pas de doute alors que la victoire remportée à
Azincourt contre toute attente relève de l’intervention divine. De fait, c’est bien cette idée
qui se trouve au centre des communications politiques d’Henry V lorsqu’il refuse de se voir
attribuer le mérite de la victoire, de même qu’elle se trouve au centre de l’Agincourt Carol,
qui, dans son célèbre refrain, engage l’Angleterre à rendre grâce à Dieu pour la victoire :
«Deo gracias anglia, / redde pro victoria »694. Enfin, l’attitude chrétienne d’Henry ainsi que le
soutien divin manifeste dont il bénéficie font l’objet de plusieurs développements dans le
Siege of Rouen. En effet, l’auteur décrit les adversaires comme des impies, qui n’ont pas
hésité à commettre « un acte maudit » (« I wylle you telle a cursyde deede, / How evylle
they wrought there »), témoin de leur « malicia », en ravageant les faubourgs de Rouen en
prévision de l’attaque anglaise, sans-même épargner les églises : « A parysche chyrche
downe ther rente. / Of Synt Hyllary was that same / […] / At Porte Causses a downe they
drowe / A chyrche of Synt Androwe, / And an abbay of Synt Gervays... »695. A l’inverse de
l’adversaire, Henry V fait toujours preuve de la plus grande piété. De fait, les représentants
de Rouen doivent attendre, avant leur entrevue avec le roi, que ce dernier ait fini d’assister à
la messe : « When they com unto Chartryte / The kyng hyryng masse was he. / With yn
Chartyr howse with yn dyd lyende, / Tylle the masse was at ende ». Plus encore, Henry V,
ayant mené à bien la conquête de la ville, y fait son entrée sur le mode de la procession, au
690 Boke of Noblesse, p.6. 691 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.623. 692 Brut, p.377. 693 Ibid, p.555. 694 Historical Poems, p.91. 695 Historical Collections of a Citizen of London, p.3-4.
127
milieu des prêtres et des moines (« Alle they went in processyon »), embrasse avec humilité
toutes les croix qui lui sont présentées (« He kyste them alle with meke mode »), alors que
l’archevêque de Canterbury, primat d’Angleterre asperge la foule d’eau bénite (« And haly
watyr with hys hande / Gaffe the prymate of oure lande ») ! Enfin, ici encore, le roi attribue
la victoire à Dieu, alors qu’il entre dans Rouen sans aucun orgueil, sans tambours ni
trompettes, et en remerciant Dieu en son cœur : « He passyd yn with owte any pryde, / With
owtyn pype or claryons blaste, / Prynce devoutely yn he paste / As j. conqueroure in hys
ryght, / Thankyng in hys herte God Almyght »696.
De même, un rôle très important est dévolu aux saints. En effet, ce n’est pas un hasard si
John Page prend soin de souligner que le jour de la reddition de Rouen correspond à la fête
de st Wulfstan, saint « national » anglais : « On the ffeste of Synt Wolstone hyt felle »697.
Cependant, c’est un autre saint qui est choisi pour représenter la nation anglaise : st George.
En effet, si ce dernier, à la base originaire de Cappadoce et saint patron des croisés, fait
l’objet d’une célébration nationale dès le Concile d’Oxford de 1222, il faut attendre le règne
d’Edward III pour assister à l’affirmation de son statut de saint protecteur du royaume, alors
qu’il est choisi, en 1348, pour être le saint patron de l’Ordre national de la Jarretière. De
même, cette association est rendue plus explicite encore par William Worcester, qui évoque
« l’Ordre de st George » (« the order and felouship of saint George »)698. Surtout, de manière
très intéressante, le culte de st George fait un bond en avant après Azincourt. Le Brut
raconte en effet comment Henry V, avant la bataille, réclame l’aide du saint : « and Saynt
George, this day thyn help ! » et le chroniqueur n’hésite pas à lui attribuer la victoire,
conjointement avec Dieu: « And thus Almy3ti God and Saint George brou3t our enymys to
grounde, and 3af vs that day the victori »699. Surtout, une autre version fait état d’une sorte
d’hallucination collective, alors que, pendant la bataille, les soldats aperçoivent st George
lui-même flottant au-dessus de leur tête : « Saint George […] halpe hym to fighte, and was
seyn abouen in the eyre, that day they fau3t » ! C’est alors en raison de ce soutien particulier
qu’Henry V demande à Henry Chichele, alors archevêque de Canterbury, d’ordonner que le
23 avril, jour de la fête du saint, soit observé dans toute l’Angleterre aussi solennellement
que la fête de Noël : « [he] ordeynt be holy Chirch that Saint George day shuld be kept hye
and holy : and so was it neuer before that day »700. C’est ainsi que, par la suite, la figure de st
George apparaît assez fréquemment dans les sources. C’est en effet le cas dans le Siege of
Rouen, au moment de l’entrée dans la ville, alors que le nom du saint sert de cri de guerre
aux armées anglaises victorieuses : « As they enteryd they gave a schoute / With a voyce,
696 Historical Collections of a Citizen of London, p.44. 697 Ibid, p.41. 698 Boke of Noblesse, p.46. 699 Brut, p.378-379. 700 Ibid, p.557-558. L’épisode de l’apparition de st George à Azincourt, de même que l’affirmation de son statut de saint protecteur du royaume, reçoivent de même un développement dans une version ultérieure du Brut : « And that day the Frenche men syhe Seint George in the eyre ouer the hoste of the Englisshe men, fyghtyng ayenst the Frenche men ; and therfor they worship & holde of Seint George, in Engelond, more than in any other londe », Brut, p.596.
128
and that a stoute / « Syn Jorge ! Syn Jorge ! » they cryde on hyght »701, et que le duc d’Exeter
fait placer aux trois portes de la ville une bannière à l’effigie de la Trinité, une autre à l’image
de la Vierge Marie (« A baner of the Quene of Hevyn »), et une dernière à l’effigie de st
George : « At Martynvyle up he pyghte / Of Syn Jorge a baner bryght ». De même, st George
figure parmi les Sotelties du banquet de couronnement d’Henry VI, associé à l’image de la
Vierge à l’Enfant : « A sotelte of Our Lady sittyng and hir Childe in hir lappe […] and Seint
George knelyng », auprès de laquelle il occupe une position privilégiée : « O blessid Lady,
Cristes moder dere, / And thou Seint George, that callid art hir knight » (v.17-18)702. Enfin, le
statut particulier de st George est confirmé par Worcester, lorsqu’il affirme que la
reconquête des duchés de Guyenne et de Normandie pourra se faire avec l’aide de Dieu et
de st George, « principal défenseur et protecteur » de l’Angleterre : (« withe the helpe of
almightie God and saint George, chief denfendoure and protectoure of these youre
londis »)703.
Cependant, si le temps des victoires se prête particulièrement bien à ce type de
démonstration, les auteurs se trouvent ensuite contraints d’expliquer la défaite subie par les
Anglais, en contradiction avec le soutien divin dont ils sont censés bénéficier. C’est ainsi que
William Worcester est amené à considérer que ces revers sont envoyés par Dieu aux Anglais
pour les mettre à l’épreuve, et qu’ils ne sauraient donc remettre en cause ni la justice de la
cause anglaise ni le statut des Anglais en tant que Peuple Elu : « at som tymes God suffrethe
the partie that hathe right and a trew title, and that liveth after his lawes, to be gretly
parsecuted […] thoughe the peple be never so goode, ne the quarelle, title and right never
so trew »704. Si cet argument consiste à affirmer que les voies de Dieu sont impénétrables,
l’auteur se montre, par la suite, beaucoup plus critique, puisqu’il attribue la perte des
territoires en France aux péchés de ses compatriotes. C’est ainsi qu’il admet que les Anglais
sont frappés par un châtiment divin (« the ire of God and his rod of vengeaunce fallen now
upon us by his dyvyne punishment »705) qu’ils ont plus que mérité : « O mightifulle God, […]
have not we deserved cause this to be punished, seeyng so many wrecchid synnes as among
us dailie uncorrectid hathe reigned, for whiche we ought know we be worthy of moche more
chastising and grettir punishement of God, he being just and not chaungeable ». De plus, les
Français sont alors présentés comme de simples instruments de la vengence divine (« God
wulle suffre oure adversaries punisshe us with his rodde »), ce qui leur vaut de plus d’être
indirectement assimilés aux ignobles Philistins vainqueurs du Peuple Elu d’Israël, puni par
Dieu pour avoir négligé sa Loi (en l’occurrence, les Anglais) : « for the gret synnes used be
theym of Israelle, God of his rightwisnesse suffred the Phillistyns that were they never so
eville ne in so eville a quarelle to be persecutours and destroiers of the lande of Judee and of
Goddis peple, and the rathir that the saide Israelites had a law gyven hem by Moises and
701 Historical Collections of a Citizen of London, p.42. 702 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.624. 703 Boke of Noblesse, p.39. 704 Ibid, p.41-42. 705 Ibid, p.74.
129
kept it not »706 ! De fait, les Anglais demeurent bien le « peuple de Dieu », et il ne fait aucun
doute dans l’esprit de l’auteur qu’ils récupéreront Son soutien sitôt qu’ils se seront
amendés. Il peut ainsi finir sur une note décidemment positive, en affirmant que, si Dieu
prend à nouveau leur parti, personne ne sera alors en mesure de leur nuire : « Whan God
lust to shew thy power, and to be victorious, who may noy the ? »707.
C’est ainsi que l’Angleterre bénéficie au XVe Siècle d’une mythologie nationale bien établie.
Cependant, il nous faut à présent nous demander comment cette dernière s’articule avec le
nouveau discours instauré par la Double-Monarchie.
C) L’identité anglaise face à la Double Monarchie708.
1) Le double héritage dynastique d’Henry VI et les réactions de l’opinion publique anglaise.
De fait, pour que le système de la Double-Monarchie, dont l’instauration est prévue par le
Traité de Troyes de 1420, soit valide, il faut qu’Henry VI revendique de la même façon son
appartenance à la dynastie française qu’à la dynastie anglaise, et même qu’il apparaisse, aux
yeux de ses sujets continentaux, « plus français que ses ennemis »709. C’est ainsi que les
textes mettent en valeur le double héritage dynastique du roi d’Angleterre et de France.
Cette démonstration s’appuie, bien-sûr, sur le mariage de ses parents, alors que le sermon
d’ouverture du parlement de 1422 célèbre l’accession d’Henry VI en ces termes : « neez est
un tresbeaux et tresgloriouse fitz, engendrez de le pluis honurable sanc de France, ja roi
d'Engleterre et de France »710. De même, John Audelay célèbre tout particulièrement l’union
d’Henry V et de Catherine de Valois, présentée sur le ton du roman courtois : « His fader, for
loue of mayd kateryn, / In fraunce he wro3t turment & tene » (v.9-10), de même qu’il
évoque leur mariage et le couronnement de la nouvelle reine : « Of frawnce hem ad him
anon regent / & wedid kateren in his present ; / In-to Englond anon he went / & cround our
quene in ryal aray » (v.33-36), avant de conclure que, grâce à cette union, leur fils se
retrouve à la tête des deux royaumes : « Thus was his fader a conqueroure / & wan his
moder with gret onoure ; / Now may the kyng bere the floure / Of kyngis & kyngdams in
vche cuntre » (v.41-44)711. John Lydgate, dans son Title and Pedigree, évoque de même le
Traité de Troyes et s’attarde longuement sur le mariage d’Henry V et de Catherine, accompli
dans les régles et dans le respect de l’Eglise712. De même, les généalogies, telles que celle qui
706 Boke of Noblesse, p.56. 707 Ibid, p.82. 708 Sur le discours de la Double Monarchie, on pourra consulter J. W. McKenna, « Henry VI of England and the Dual Monarchy: Aspects of Royal Political Propaganda, 1422-1432 », in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 28 (1965), p. 145-162 ; et aussi Jean-Philippe Genêt, « Le Roi de France anglais et la Nation française », op.cit. 709 J’emprunte cette expression à Joanna Bellis, « Rhymes sette for a Remembraunce », op.cit. (p.191). 710 PROME, parlement de novembre 1422, item 3. 711 Historical Poems, p.110. 712 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.618-619.
130
accompagnait sans aucun-doute le poème de Laurent Calot713, s’attachent à montrer cette
double ascendance, et influent grandement sur le discours des auteurs. C’est ainsi que le
Title and Pedigree s’appuie sur les généalogies (« The pee-degre doth hit specifie, / The
figure, lo, of the genelagye », v.125-125), pour démontrer la légitimité d’Henry VI : « That
this Herry stonding in the lyne, / […] / Is iustly borne […] / For to be kyng of Englond & of
Fraunce », v.144-147714. De même, William Worcester, s’adressant à Henry VI puis à Edward
IV, peut encore les engager à suivre l’exemple de leurs « nobles prédécesseurs, tant rois de
France que rois d’Angleterre » (« And this was the custom in the daies of youre noble
auncestries, bothe of kingis of Fraunce as of Englande »)715.
Qu’en est-il cependant des réactions des sujets anglais du roi de France et d’Angleterre ?
Premièrement, il est important de noter que le Traité de Troyes a bien plus suscité la crainte
que l’enthousiasme en Angleterre. En effet, on trouve dans les Parliament Rolls une pétition
qui témoigne de cette crainte, et par laquelle les Commons demandent la confirmation des
dispositions prises sous le règne d’Edward III, stipulant que les deux royaumes resteraient
nettement séparés et que les Anglais ne seraient jamais ses sujets en tant que roi de France :
« Qe please […] de ordeigner et establier par auctoritee de ceste present parlement, qe lez
ditz graunt et establissement de dit nadgairs roy Edward come desuis est dit, soit affermé et
gardez en toutz pointz. Et outre ceo, de ordener par l'auctorite suisdit, qe par cause qe
nostre dit seigneur le roy est heir et regent del roialme de Fraunce, et q'il et sez heirs apres
la mort de dit Charles roy de Fraunce, serrount roys de Fraunce […], qe le dit royalme
d'Engleterre, ne lez gentz d'icelle, de quelle estat ou condicione q'ils soient, ne soient \en/
nulle temps a venir mys en subjeccioun n'en obeisaunce de luy, sez heirs, et successours,
come heir, regent ou roy de Fraunce, ne a luy, sez heirs et successours, come heir, regent ou
roy de Fraunce, soient subgitz ne obeisauntz; einz q'ils soient fraunches et quites de toutz
maners subjeccions et obeisaunces suisditz, a toutz jours »716. De plus, le fait-même que
Richard Beauchamp ait demandé à Lydgate de réaliser une traduction du poème de Calot
suggère qu’il était autant nécessaire de défendre la Double-Monarchie auprès des sujets
anglais qu’auprès des sujets français… De fait, Lydgate lui-même, dans son prologue du Title
and Pedigree, mentionne les doutes qui assaillent certains de ses compatriotes, auxquels sa
traduction est censée remédier : « Trouble hertis to sette in quyete, / And make folkys their
language for to lette, / Which disputen in their opynyons / […] / To put awey all maner [of]
variaunce, / Holy the doute and the ambyguyte, / To sette the ligne where hit shuld[e] be, /
[…] / Wrongfull claymes for to set aside » (v.1-10)717.
713 A ce sujet, voir B.J.H. Rowe, « King Henry VI’s Claim to France in Picture and Poem », in The Library, Fourth Series, vol. XIII, 1933, p.77-88. 714 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.617. 715 Boke of Noblesse, p.77. 716 PROME, parlement de décembre 1420, item 25. 717 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.613-614.
131
Enfin, on a pu suggérer que le poème de Lydgate n’était pas aussi engagé qu’il y paraît et
que l’auteur avait adapté le texte original de Calot à un public anglais en revêtant une
posture de neutralité718, il nous semble pouvoir déceler dans le texte les marques d’une
adaptation plus active. En effet, en comparant le poème de Lydgate à celui de Calot719, on
remarque des différences assez importantes. De fait, on remarque que Lydgate, afin sans-
doute de susciter l’enthousiasme de ses compatriotes, introduit au sein-même de sa
traduction un long éloge du héros national Henry V, salué pour ses qualités habituelles de
« manhode » et de prouesse, et surtout présenté comme le « conquérant » du royaume de
France , digne pour cela de figurer parmi les Neuf Preux (!) : « The which Herry if I shal
discryve, / I dare wele sey there was neuer on lyve / No manlier to speke of worthinesse, /
Of gouernaunce, nor of hy prowesse, / Whiche thurgh his manhode & grete labour, / Lyche a
notable worthi conquerour / Cesid not, thurgh his besy peyne, / Iustly to bring worthi
reames twayn / Vndir oo crowne by desceynt of lyne ; / For which he may among the
Worthie Nyne / Truly be set & reconed for oon » (v.208-218). De la même façon, l’auteur,
évoquant le double héritage d’Henry VI, semble toutefois préciser incidemment qu’il
demeure anglais, puisque né en Angleterre : « Henry the Sext, borne in Eng[e]lond, / For to
possede by enheritaunce / Crownes two of Englond & of Fraunce » (v.227-229)720.
2) La récupération des mythes et symboles de la royauté et de la nation françaises.
Les propagandistes ne se contentent pas de signaler cette double-identité du roi, mais se
livrent également à une reprise et exploitation systématiques des mythes et symboles de la
royauté française, de telle sorte que certains ont pu considérer que l’instauration de la
Double Monarchie avait marqué un point d’arrêt dans l’affirmation du discours national
anglais721.
C’est le cas, bien-sûr de la Fleur-de-Lys722. En effet, si l’adoption des armes royales françaises
arborant la Fleur-de-Lys, écartelées avec les léopards d’Angleterre, remonte au règne
d’Edward III, signifiant ainsi sa revendication du trône de France, la Fleur-de-Lys demeure
bien souvent associée, avant l’instauration de la Double Monarchie, à l’image de
l’adversaire. C’est ainsi que, de manière assez spectaculaire, l’auteur de The Rose on Branch
affirme que la Fleur-de-Lys devrait se soumettre à la Rose anglaise, et même être son
esclave : « Therfore me thynke the flour-de-lyse / Scholde wirchipe the rose of ryse, / And
718 Voir Scott-Morgan Straker, « Propaganda, Intentionality, and the Lancastrian Lydgate », in John Lydgate, Poetry, Culture and Lancastrian England, op.cit., p.98-128 (ici, p.117-119). 719 Pour le texte du poème de Calot, voir Mary Floran, « Document relatif à l’entrée du roi d’Angleterre Henri VI à Paris en 1431 », in Revue des Etudes Historiques, 1909, p.411-415 (ici, p.414-415). 720 Minor Poems of John Lydgate, p.619. 721 Voir par exemple Derek Pearsall, « The Idea of Englishness in the fifteenth century », in Nation, Court and Culture, Helen Cooney (ed.), Scarborough, 2001, p.14-27. 722 Sur le symbolisme de la Fleur-de-Lys en France, voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. (p.237-263).
132
ben his thralle-/ And so scholde other flours alle ! » (v.6-12)723 ! De même, John Page
évoque, pendant les négociations entre Henry V et les Français de Rouen, les deux types
d’armes arborées par les hérauts, soit d’un côté « la bête anglaise » (!), désignant le léopard,
et de l’autre, « la fleur française », soit la Fleur-de-Lys : « Kyngys, herrowdys, and
pursefauntys, / In cotys of armys suauntys, / The Englysche beste, the Fraynysche floure »724.
Cependant, l’auteur raconte également comment le duc d’Exeter, une fois la ville prise,
symbolise la prise de possession du château de Rouen par Henry V en y faisant placer une
bannière aux armes de France et d’Angleterre : « In the castelle he set to stonde / The armys
of Fraunce and of Ingelond »725, « signe d’une ambition non encore réalisée »726. Surtout,
c’est à partir de l’instauration de la Double-Monarchie qu’on observe un total changement
de discours, alors que le symbolisme de la Fleur-de-Lys est revendiqué pour le jeune roi de
France et d’Angleterre. C’est ainsi que Lydgate l’utilise, dans son Roundel for the Coronation
of Henry VI, pour symboliser la généalogie d’Henry VI, qui n’est autre qu’une « branche »
issue de la Fleur-de-Lys : « A braunche that sprang oute of the floure-de-lys » (v.2)727. De
même, elle figure en bonne place dans les mets du banquet de couronnement, aux côtés des
léopards. En effet, il y est question d’une « friture » en forme de soleil, avec une Fleur-de-Lys
à l’intérieur (« Fritour like a sonne with a flour de lice therynne »), ainsi que d’une « tourte
royale » contenant un léopard assis (« Custade Rooial with a leparde of golde sittyng
theryn »), puis d’une « Flampayne poudred with lepardis and floure de lices of golde » et
d’une « friture » en forme de tête de léopard (« Fritour, a lepardis hedde »). De même, dans
le texte qui les accompagne, Lydgate salue Henry VI comme étant « l’héritier de la Fleur-de-
Lys » (« Enheretour of the floure de lice », v.5)728. De même, lorsque l’arbre généalogique du
roi est mis en scène lors de son Entrée dans Londres, les rois d’Angleterre d’un côté et les
rois de France de l’autre sont identifiés par leurs armes « nationales », soit respectivement
les léopards et les Fleurs-de-Lys : « Twoo green treen ther grewe vp-[a]riht, / […] / conveyed
by lynes be kyngis off grete prys ; / Some bare leopardes, and some bare fflouredelys / In
nouther armes ffounde was there no lak » (v.398-303)729. De la même façon, l’auteur de
Scorn of the Duke of Burgundy, évoquant l’hommage fait par Bedford au nom de Philippe le
Bon lors du couronnement parisien d’Henry VI, identifie le jeune roi à la Fleur-de-Lys pour
mettre en avant sa légitimité : « He did thyn omage as to the floure-de-lice / Next by
condescent and true inheritance » (v.37-38)730. Enfin, Worcester, apparemment très au fait
de la nouvelle interprétation du symbolisme des Lys proposée par Guillaume de Diguleville
dans son Roman de 1338, invoque ces derniers pour appeler à l’union de l’ensemble de la
nation en vue de la reconquête des territoires perdus : « so that alle worshipfulle men,
723 Historical Poems, p.92. 724 Historical Collections of a Citizen of London, p.34. 725 Ibid, p.44. 726 Christopher Allmand, Henry V, op.cit. (p.127). 727 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.622. 728 Ibid, p.623. 729 Ibid, p.644. 730 Historical Poems, p.87.
133
whiche oughte to be stedfast and holde togider, may be of one intencion, wille and comon
assent to vapour, sprede out, according to the flour delice »731.
Cependant, le thème principal associé à la Fleur-de-Lys demeure bien celui de l’élection
divine des rois de France. En effet, c’est précisément en tant qu’héritier de la Fleur-de-Lys
qu’Henry VI se voit assigner par Lydgate, lors de son banquet de couronnement, la première
place parmi les chrétiens (« Live, among Cristen moost souereigne of price, / Enheretour of
the floure de lice ! », v.4-5). En effet, cette affirmation passe principalement par l’exposition
du miracle de Joyenval, associé à la figure de Clovis732. C’est ainsi que Lydgate, dans sa
Ballade to King Henry VI, raconte comment l’emblème des trois Fleurs-de-Lys d’or sur fond
d’azur a été envoyé à Clovis par Dieu (Dovne frome the heven thre floure delys of golde, /
The feelde of asure, were sent til Clodove », v.25-26). En effet, Lydgate reprend ici les
afirmations des auteurs français, en associant la Fleur-de-Lys à l’image de la Trinité (« To
signefye, in story it is tolde, / Parfyte byleeve and soothefast vnytee / Of three persones in
the Trynyte », v.27-29), et en en faisant la marque de l’Election divine de la dynastie : « For
to declaare that the lyne of Fraunce / Shoulde in theyre trouth parfyte and stable be, /
Grounded on feyth, with-outen varyaunce » (v.30-32)733.
Surtout, les miracles de Joyenval et de Reims font l’objet d’une exposition complète de la
part de Lydgate dans son Mumming at Windsor. C’est ainsi que le poète rapporte la légende
de l’origine des Fleurs-de-Lys et de la Sainte-Ampoule : «howe thampull and the floure delys
came first to the kynges of Fraunce by myrakle at Reynes ». Il reprend alors le thème de
l’élection divine de la France, royaume très-chrétien. De fait, la conversion du royaume à la
Foi chrétienne témoigne bien de la Grâce divine : « Howe that whylom oure worthy reavme
of Fraunce / Conuerted was frome theyre mescreaunce, / Whane the Lord of Lordes caste a
sight / Vpon youre lande and made His grace alight » (v.4-7). De même, si Dieu a daigné
accorder Sa faveur à Clovis (« The Lord […] / His eyeghe of mercy caste on Cloudovee », v.11-
12), en le tirant de l’erreur et de la vénération des idoles pour lui faire embrasser la Vraie
Foi, c’est grâce à l’entremise de ste Clotilde (« Saint Cloote », v.21), à qui Lydgate, attribue le
rôle majeur. En effet, c’est elle qui, par ses prières, ses veilles, ses jeûnes et son
comportement exemplaire, a obtenu la destruction de la « Mawmetrye » (v.26) en France, et
a ainsi permis d’étendre la Foi du Christ (« Hir meryte caused and hir parfit entent, / That
Crystes feyth aboute ther did sprede », v.29-30). C’est grâce à elle également que Dieu a
décidé d’envoyer un signe à Clovis, signe qui est à l’origine de l’écu aux Lys d’or sur champ
d’azur, apporté à l’hermite de « Ioye en Vale » (v.36) par un ange descendu du Ciel : « an
aungel was frome heven sent / Vn to an hermyte, of parfyt lyf in deed, / Presented it, whoo-
so can take heed ; / A shelde of azure, moost souerein by devys, / And in the feelde of golde
three floure delys » (v.31-35). Ainsi, ste Clotilde (« the hooly qweene », v.45), plus encore
que Clovis, retient l’attention de l’auteur, puisque c’est sa sainteté qui a permis d’illuminer le
731 Boke of Noblesse, p.4. 732 Sur « st Clovis », voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. (p.55-74). 733 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.625-626.
134
royaume de France (« Hir hoolynesse Fraunce did enlumyne », v.50), en convainquant son
époux d’adopter la Foi du Christ. De fait, le miracle survenu à Joyenval emporte la conviction
de Clovis, déjà décrit comme « preux et juste » (« manly and rightwys », v.65), et le pousse à
remplacer les trois crapauds qu’il arborait précédemment sur son blason par les Fleurs-de-
Lys, présents des Cieux : « The three crepaudes this noble kyng forsooke, / And in his
sheelde he bare thre floure delys, / Sent frome heven, a tresore of gret prys » (v.66-68).
Bien-entendu, Lydgate passe alors à l’épisode fondateur du baptême de Clovis par st Rémi à
Reims : « Affter at Reynes, the story tellethe thus, / Baptysed lowly of Saint Remigius » (v.69-
70), qui est le cadre d’un autre miracle, alors que Dieu envoie la Sainte Ampoule à Clovis par
l’entremise d’une colombe : « Thampolle of golde a colver brought adovne » (v.71).
L’onction du baptême permet alors à l’ancien païen de devenir « le champion du Christ » :
« For where as he stoode, in gret desioynt, / First a paynyme, by baptyme anoon right / Was
so conuerted, and bekame Crystes knight » (v.75-77). Lydgate peut alors dévoiler la raison de
la mise-en-scène de cet épisode, alors que le Chrême est encore conservé à Reims, et qu’on
a pour coutume d’en oindre tous les rois de France lors de leur couronnement : « At Reynes
yit that hooly vnccyoun / Conserued is for a remebraunce, / And of coustume […] / […]
Tannoynte of coustume kynges wheeche in Fraunce / Ioustely succeede… » (v.78-83), et que
cette onction viendra bientôt asseoir la légitimité d’Henry VI en tant que roi de France,
puisqu’il se prépare à être couronné comme tel et à recevoir l’onction : « Of which Sixst
Henry […] / Right soone shal, with Goddes hooly grace, / […] / Be weel resceyued in the same
place / And by vertu of that vnccyoun / Atteyne in knighthoode vn-to ful hye renoun » (v.84-
89)734 … alors que la cérémonie se tiendra finalement à Notre-Dame de Paris, et selon toute
probabilité, sans la Sainte Ampoule !
Cependant, il est intéressant de relever ici l’absence d’un regalium souvent associé à la
figure de Clovis au XVe Siècle, après avoir été lié au personnage de Charlemagne :
l’oriflamme. Peut-être sa revendication pose t’elle alors des difficultés trop importantes,
dans la mesure où ce sont précisément les défaites face à l’Angleterre à Crécy et à Poitiers
qui ont frappé la bannière de discrédit en France735… De fait, William Worcester peut
fièrement évoquer, dans son énumération des gloires militaires anglaises, la mort à Poitiers
de Geoffroi de Charny, qui portait l’oriflamme : « ser Geffrey Channy that bare the baner of
the oriflamble », ce qui suggère que les Anglais se sont alors emparés de la bannière736…
De même que la figure de Clovis, les propagandistes de la Double Monarchie utilisent celle
de Charlemagne, qui incarne le héros chevaleresque par excellence. C’est ainsi que ce statut
lui vaut, dans la Ballade to King Henry VI de Lydgate, de figurer aux côtés de son équivalent
anglais, Arthur, alors que l’auteur les pose conjointement en modèles de prouesse militaire
734 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.691-694. 735 Sur l’oriflamme, voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. (p.112-113). 736 Boke of Noblesse, p.13.
135
censés inspirer le jeune roi : « Arthour was knyghtly, and Charlles of gret prys, / And of alle
theos thy grene tendre aage / […] / Of manly prowesse shal taaken a terrage » (v.13-16)737.
Cependant, aucun personnage ne fait l’objet d’autant de développements que st Louis. En
effet, ce dernier, canonisé dès 1397, est sans-conteste la référence dynastique et spirituelle
absolue pour la monarchie française738. Tout-d’abord, s’il est grandement mis en scène dans
le discours de la Double Monarchie, c’est avant-tout dans une optique de légitimation, en
tant qu’ancêtre le plus glorieux de la dynastie française. C’est ainsi que les généalogies
d’Henry VI, mettant en scène son double-héritage dynastique, remontent toujours à st Louis.
De même, le discours des auteurs s’appuyant sur cette représentation graphique, lydgate
peut affirmer dans son Title and Pedigree que le roi est, selon l’expression consacrée, « de la
race de st Louis » (« Of the stok and blode of Seint Lowys », v.133), dont il est l’héritier
direct (« byhold & ye may se / How this Herry in the eight degre / Is to Seint Lowys sone &
very heir », v.138-140). De la même façon, la généalogie démontre que le jeune roi descend
de st Louis à la fois par sa mère, mais aussi par son père : « And of this Henry […] / From
Seint Lowys in the right[e] lyne, / I sey, of him and of Kateryne / […] / Descendid is from the
stok riall / Of Seint Lowis […] / Henry the Sext » (v.220-227)739. De même, les auteurs
s’attardent sur la gloire de cet héritage. De fait, Lydgate, dans la suite du Title and Pedigree,
rappelle l’excellence de Louis IX et introduit le thème de sa sainteté : « Seint Lowys, most
famous of renoun, / And renommed of parfite holynesse » (v.259-260)740. De la même façon,
l’héritage de st Louis est toujours mis en avant par l’auteur afin de glorifier ses interlocuteurs
royaux, par exemple dans le Mumming at Eltham, où il s’adresse à Catherine de Valois en
ces termes : « yowe, Pryncesse, borne of Saint Lowys blood » (v.52)741, ou encore dans son
Mumming at Windsor, où, après avoir exposé la légende de l’origine des Fleurs-de-Lys,
lorsqu’il salue Henry VI ainsi : « Royal Braunche, O Blood of Saint Lowys » (v.92)742. De plus,
le discours de la Double Monarchie introduit aussi une figure originale, en mentionnant côte
à côte les deux grands saints dynastiques d’Angleterre et de France, soit st Edward et st
Louis, pour symboliser le double héritage national d’Henry VI. C’est ce que fait Lydgate dans
sa Ballade to King Henry VI, où il évoque ces deux saints, qui ont tous deux été canonisés, et
qui, de leur vivant ont toujours fait preuve de sagesse : « Saynt Edward and Saynt Lowys, /
Hooly sayntes translated in theyre shrynes, / In theyre tyme manly, prudent, and wys »
(v.10-12)743, dans le Roundel, où Lydgate salue Henry VI comme étant « Blode of Seint
Edward and Seint Lowys » (v.3)744, et lors de l’Entrée d’Henry VI à Londres, où la généalogie
mise en scène au moyen de deux arbres remonte d’un côté à st Edward et de l’autre à st
737 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.625. 738 Sur la place qu’occupe st Louis dans l’historiographie française, voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. (p.126-164). 739 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.619. 740 Ibid, p.620. 741 Ibid, p.673. 742 Ibid, p.694. 743 Ibid, p.625. 744 Ibid, p.622.
136
Louis : « Twoo green treen ther grewe vp-[a]riht, / Fro Seint Edward and ffro Seint Lowys »
(v.398-399)745. Surtout, les deux saints dynastiques sont figurés parmi les Sotelties du
banquet de couronnement de 1429. En effet, le jeune roi peut alors voir une représentation
de st Edward et de st Louis portant leurs tuniques héraldiques, et lui-même figurant entre
eux deux : « A sotelte, Seint Edward and Seint Lowes armed in cote armours, bryngyng yn
bitwene hem the Kyng in his cote armours ». Ici encore, le texte qui accompagne cette
soteltie attire l’attention des spectateurs sur l’excellence du double héritage d’Henry VI, qui
descend de deux rois saints : « Loo here twoo kynges righte perfit and right good / Holy Seint
Edwarde and Seint Lowes : / And see the braunch borne of here blessid blode » (v.1-3), et
exprime le souhait que le jeune roi hérite de leur sagesse, de leur comportement
chevaleresque et de leur vertu : « God graunte he may thurgh help of Crist Ihesu / This sixt
Henry to reigne and be as wise / And hem resemble in knyghthod & vertue » (v. 6-8)746.
Enfin, William Worcester fait une large utilisation de la figure de st Louis, d’une manière
assez différente. C’est ainsi que, toujours très au fait du discours français, il pose st Louis en
modèle de roi juste. De fait, de manière assez étonnante, c’est au testament de Louis IX qu’il
fait appel pour justifier les guerres des rois d’Angleterre en France ! En effet, il expose
comment « the blissid king of Fraunce seint Lowes » a engagé le futur Philippe III à ne pas
faire la guerre à un autre chrétien, à moins qu’il ne lui ait causé des torts (« that he shulde
kepe hym welle, to meove no werre ayenst no christen man, but if he had grevously done
ayenst him »), et aussi à accepter les ouvertures de paix de l’ennemi (« And if he seke waies
of peace, of grace and mercie, thou oughtest pardon hym, and take soche amendis of hym
as God may be pleasid »). L’auteur peut alors conclure à la justice de la guerre en France,
puisque le parti adverse a continuellement cherché à nuire à l’Angleterre « bethout any
justice [or] title », et n’a jamais réclamé la paix (« bethout waies of pease shewed »)747 ! De
même, Worcester fait appel au testament de Louis IX pour engager le roi d’Angleterre à
assurer à ses sujets la paix et la justice, surtout dans les villes, et à secourir les indigents :
« And, therefore, favoure and forbere the pore peple and namelie the nedie »748. Enfin, on
voit apparaître dans le Boke of Noblesse une autre des thématiques essentielles liées à la
figure de st Louis : celle des croisades. C’est ainsi que Worcester, comme nous l’avons vu
plus haut, évoque sa mort devant Tunis. De même, afin d’encourager ses compatriotes à ne
pas renoncer face à l’adversité, l’auteur a recours à l’histoire édifiante de st Louis à la
Septième Croisade. Il rappelle ainsi comment le saint roi a mené la croisade en Egypte,
« pour augmenter la Foi chrétienne » (« in encresing the cristyn feithe »), et a alors enduré
de nombreuses souffrances (« gret adversiteis »), alors que nombre de ses hommes sont
morts d’épidémies à la Mansourah, et que lui-même et ses chevaliers ont été fait prisonniers
745 Ibid, p.644. 746 Minor Poems of John Lydgate, p.623. 747 Boke of Noblesse, p.8. 748 Ibid, p.81-82.
137
et soumis à la rançon, avant de rentrer en France couvert de gloire (« withe gret
worship »)749 !
A cette correspondance entre st Edward et st Louis vient de plus s’ajouter une
correspondance entre st George et st Denis. En effet, c’est l’utilisation de la figure de st
Denis par la Double-Monarchie qui, entre autres considérations, devait pousser les partisans
de Charles VII à remplacer le saint patron traditionnel du royaume de France, par un autre,
soit st Michel750. De fait, le « très noble martyr » st Denis (« Holy Seint Denyse, O martir
moost entier », v.19) figure aux côtés de st George dans les Sotelties du banquet de
couronnement d’Henry VI, où les deux saints présentent le jeune roi à la Vierge : « Seint
George knelyng on that oo side and Seint Denyse on that other side » et sont ainsi présentés
comme les deux protecteurs du roi de France et d’Angleterre751.
D) Penser et repenser la place de la Nation en Europe752.
1) Le Libelle of Englyshe Polycye, une définition originale de l’identité anglaise.
Nous avons analysé plus haut les différents critères qui sont invoqués pour affirmer
l’excellence de la nation. C’est ainsi que Worcester peut présenter l’Angleterre comme une
« terre de chevaliers », alors que les «noble men of chevalrie » y sont proportionnellement
plus nombreux que dans n’importe quel autre pays. De même, l’excellence du royaume peut
reposer sur l’affirmation de sa totale indépendance face à l’Empire, invoquée aussi bien par
John Page, qui fait dire aux Rouennais qu’Henry V est « empereur en son royaume » et ne
dépend que de Dieu : « And he ys kyng excellent, / And unto non othyr obedyent, / That
levythe here in erthe be ryght, / But only unto God almyght, / With-yn hys owne
Emperoure »753, que par William Worcester, qui se plaît à exposer les victoires des rois de
Bretagne contre l’Empire romain. Cependant, l’auteur du Libelle of Englyshe Polycye opte
pour une présentation radicalement différente, puisque l’excellence de la nation est fondée,
à ses yeux, sur un autre type d’indépendance : l’indépendance économique.
En effet, il ne fait pas de doute qu’à ses yeux, la valeur d’un pays se mesure à l’aune de ses
ressources, qui lui confèrent ou non un statut d’autosuffisance.C’est ainsi qu’il exprime tout
son mépris à l’égard de la Flandre, « petite terre » qui serait incapable de nourrir ses
habitants plus d’un mois sans le concours des autres pays : « For the lytell londe of Flaundres
is / But a staple to other londes iwys, / And all that groweth in Flaundres, greyn and sede, /
May not a moneth fynde hem mete of brede » (v.116-119)754. C’est alors que l’auteur nous
749 Ibid, p.42. 750 Sur st Denis et st Michel, voir Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. (p.83-125, et p.188-206). 751 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.624. 752 C’est le thème choisi par John Scattergood pour son article : « The Libelle of Englyshe Polycye : the nation and its place », in Nation, Court and Culture, op.cit., p.28-49. 753 Historical Collections of a Citizen of London, p.24. 754 Libelle of Englyshe Polycye, p.7.
138
offre une définition « marchande » de l’identité anglaise, fondée sur l’éloge des ressources
dont dispose l’Angleterre. C’est bien-sûr principalement le cas de la laine. En effet, cet éloge
de la laine anglaise, considérée par toutes les peuples comme étant la meilleure au monde,
est également présent dans un poème contemporain de John Lydgate intitulé The Debate of
the Horse, Goose and Sheep, et qui comprend la strophe suivante : « Off Brutis Albion his
wolle is cheeff richesse, / In prys surmontyng euery othir thyng / Sauff greyn &corn :
marchauntis al expresse, / Wolle is cheeff tresour in this lond growyng : / To riche & poore
this beeste fynt clothyng : / Alle naciouns afferme vp to the fulle, / In al the world ther is no
bettir wolle » (v.351-357)755. De la même façon, l’auteur du Libelle fait de constantes
références à l’excellente qualité de la laine anglaise, qui est nécessaire à toutes les nations
d’Europe, et qui les rend ainsi totalement dépendantes de l’Angleterre. C’est ainsi que les
draps produits en Flandre sont composés en majeure partie de laine anglaise : « But ye
Flemmyngis, yf ye be not wrothe, / The grete substaunce of youre cloothe at the fulle / Ye
wot ye make hit of oure Englissh wolle » (v.77-70), et que la laine de leur partenaire
économique, les Espagnols, ne vaut rien si elle n’est pas mélangée à de la laine anglaise :
« The wolle of Spayne hit cometh not to preffe / But if it be tosed and menged well /
Amonges Englysshe wolle the gretter delle » (v.99-101). De ce fait, la Flandre ne peut
absolument pas se passer des produits anglais, l’étain, mais surtout la laine, dans la mesure
où c’est véritablement cette dernière qui fait vivre les artisans flamands : « They may not
lyven to mayntene there degrees / Wythoughten oure Englysshe commodytees, / Wolle and
tynne, for the wolle of Englonde / Susteyneth the comons Flemmynges I understonde »
(v.88-91), de telle sorte qu’un embargo de la part de l’Angleterre les contraindrait bien vite à
réclamer la paix afin d’éviter la destruction totale de leur économie : «Thane, yf Englonde
wolde hys wolle restreyne / Frome Flaundres, thys foloweth in certayne, / Flaundres of nede
muste wyth us have pease / Or ellis he is distroyde wythowghten lees » (v.92-95) 756. Plus
loin, l’auteur évoque encore « notre excellente laine », nécessaire aux villes drapières
flamandes de Poperinghe et de Bailleul, mais aussi à l’Europe entière, des Espagnols aux
Ecossais : « And yett they of Bell and Poperynge / Cowde never darper her woll for any
thynge / But if they hadde Englysshe woll wythall, / Oure godely woll that is so generall, /
Nedeful to hem in Spayne and Scotlande als / And othere costis ; this sentence is not fals »
(v.254-259)757. De la même façon, l’auteur démontre que, en échange de leurs produits de
luxe (« lykynge ware », v.374), les Italiens remmènent dans leurs galées des draps, de l’étain
et de la laine d’Angleterre, qui sont des produits de grande valeur sur lesquels repose
l’économie anglaise, dans la mesure où tous les pays ont nécessairement besoin de l’un
d’entre eux : « Thus these galeise […] / […] bere hens oure beste chaffare, / Clothe, woll and
tynne, which, as I seyde beforne, / Oute of this londe werste myght be forborne ; / For eche
755 Minor Poems of John Lydgate, vol.II, p.554. 756 Libelle of Englyshe Polycye, p.5-6. Cependant, l’auteur est prêt à reconnaître l’excellente qualité des draps manufacturés à Ypres : « Fyne cloothe of Ipre, that named is better than oures » (v.74, Ibid, p.5). 757 Ibid, p.14.
139
other londe of necessite / Have grete nede to by some of the thre » (v.374-379)758. D’autre
part, la présence des marchands anglais est vitale pour les foires de Brabant et de Hainaut,
de telle sorte que, s’ils venaient à s’en retirer, il leur feraient plus de mal qu’en envoyant
10 000 soldats en France : « Yf Englysshe men be wythdrawene awey, / Is grete rebuke and
losse to here affraye, / As thoughe wee sent into the londe of Fraunce / Tenne thousande
peple, men of gode puissaunce, / To werre unto her hynderynge multiphary ; / So bene oure
Englysshe marchauntes necessary » (v.556-561)759.
Inversement, il ne fait pas de doute que l’Angleterre, elle, est auto-suffisante. C’est ainsi que
l’auteur, absolument confiant dans les ressources de son pays, préconise l’usage de plantes
médicinales anglaises plutôt que de celles que les Italiens rapportent de l’autre côté de
l’océan. De fait, s’il reconnaît l’efficacité de ces dernières (« and yet they bene to
nedefulle », v.362), il ne fait pas de doute que les Anglais n’en ont pas besoin, puisque « leur
Angleterre » leur fournit tout ce qu’il leur faut pour se soigner, sans l’aide d’aucun autre
pays : « And that I wene as for infirmitees / In oure Englonde are suche comoditees /
Wythowten helpe of any other londe / […] / That all ill humors myght be voyded sure, /
Whych that we gadre wyth oure Englysh cure » (v.364-359)760.
De la même façon, il ne fait pas de doute pour lui que les marchands anglais sont la clé de la
réussite de l’ensemble de la nation : « For yef marchaundes were cherysshed to here spede,
/ We were not lykelye to fayle in ony nede ; / Yff they bee riche, thane in prosperite /
Schalbe oure londe, lordes and comonte » (v.482-485). C’est ainsi qu’il consacre à l’ancien
maire de Londres Richard Whittington, « sonne / Of marchaundy » (v.486-487), un éloge
dithyrambique, alors qu’il le salue comme « That loodes sterre and chefe chosen floure »
(v.488), de même qu’il l’élève ni plus ni moins au rang de héros national, au-dessus de toute
définition : « Whate hathe by hym oure England of honoure, / And whate profite hathe bene
of his richesse, / And yet lasteth dayly in worthinesse, / That penne and papere may not me
suffice / Him to describe, so high he was of prise, / Above marchaundis to sett him one the
beste ! » (v.489-494)761.
2) Une nouvelle perception de l’insularité.
La réestimation de la place de l’Angleterre en Europe prend également en compte un
nouveau sentiment d’insularité. En effet, la politique défendue par l’auteur du Libelle ne se
fonde pas sur des expéditions militaires à l’étranger, mais sur un recentrage sur les Iles-
Britanniques et sur Calais. C’est ainsi que la conservation de l’Irlande et du pays de Galles
sont au centre de ses préoccupations, dans la mesure où ces territoires font office d’avant-
postes du royaume d’Angleterre, et sont ainsi nécessaires à la sécurité nationale : « Ye
remembere and wyth all youre myghte take hede / To kepen Yrelond that it be not loste, /
758 Libelle of Englyshe Polycye, p.20. 759 Ibid, p.29. 760 Ibid, p.19. 761 Ibid, p.25.
140
For it is a boterasse and a poste / Undre England, and Wales is another » (v.699-702)762. De
même, on peut déceler une certaine lassitude de l’auteur face à la guerre en France, lorsque,
citant James Butler, Earl of Ormond, il affirme que les dépenses occasionnées par cette
dernière en l’espace d’un an pourraient suffire à conquérir l’Irlande de manière définitive :
« That expenses of one yere don in Fraunce, / Werred on men well wylled of puissaunce /
Thys seyde grounde of Yrelonde to conquere / […] / Myght wynne Yrelonde to a fynall
conquest » (v.764-770)763. De la même façon, l’auteur ne peut assez exhorter ses
compatriotes à conserver Calais. De fait, la défense de Calais fait l’objet de toutes les
attentions de la communauté marchande en Angleterre à partir de la crise de 1436, de
même qu’elle apparaît de plus en plus comme « a real alternative to Normandy as an outlet
for English energies and finance », et qu’elle revêt le statut de « symbole émotionnel »764.
C’est ainsi que l’auteur du Siege of Calais conclue son poème en priant Dieu de conserver
Calais, en sorte qu’elle demeure sujette de la couronne d’Angleterre jusqu’à la fin des temps,
et qu’aucun ennemi ne puisse lui nuire : « O oonly god, in whom is all, / Save Calais the tovn
riall, / That euer it mot wel cheve / Vnto the crovn of England, / As longe as the world shal
stonde, / That noon enemyes it greve ! » (v.163-168)765. De même, une variante manuscrite
ajoute quatre autres vers, qui attirent l’attention du lecteur sur le drame que représenterait
la perte de Calais pour l’Angleterre : « Lytelle wote the fool / Who mt3th ches / What harm
yt wer / Good caleys to lese »766 … déclaration qu’on retrouve, quasiment à l’identique, dans
le Libelle : « For lytell wenythe the fole, who so myght chese, / What harme it were gode
Caleise for to lese, / What woo it were for all this Englysshe grounde » (v.826-828), ce qui
prouve qu’elle devait alors être un refrain bien connu de tous. De même, si le discours de
Sigismond concernant Calais ne figure que dans le Libelle, on trouve dans de nombreux
textes un même argument affectif tiré de l’histoire nationale et poussant à la conservation
de Calais. En effet, une pétition de 1429 engage déjà les parlementaires à considérer le sang
anglais qui a été versé, et l’argent qui a été dépensé pour permettre la conquête de la ville
par Edward III : «þe effusion of alle þe roial bloode, and þe greete goode þat hath ben spent
upon þe conquest of þe saide toune, which every trwe Englysshman ought to have in full
grete chierte and tendernesse »767, argument qu’on retrouve dans le Libelle : « Loke well
how harde it was at the firste to gete » (v.838)768, et encore dans une déclaration d’Henry VI
devant le Parlement, qui reprend aussi les termes de « joyau » et d’ « avant-poste » pour
désigner Calais : « what a preciouse jewell the said towne of Calais is to this reame, what
762 Libelle of Englyshe Polycye, p.36. 763 Ibid, p.39. Dans le cas de l’Irlande, il s’agit aussi de faire correspondre la réalité à la titulature du roi d’Angleterre, « Because the kynge clepid is rex Anglie / And is dominus also Hibernie » (v.666-667, Ibid, p.34), 764 Christopher Allmand, Lancastrian Normandy, op.cit. (p.254). Voir aussi James A.Doing, « Propaganda, Public Opinion and the Siege of Calais », op.cit. 765 Historical Poems, p.83. 766 Ibid, Notes, p.290. 767 PROME, parlement de septembre 1429, item 63. 768 Libelle of Englyshe Polycye, p.43.
141
profite and refresshing groweth ther by the Kinges subgittes the which resorte thidre for
marcaundise and other causes, what a bolewarke and defense it is to this lande and
inhabitauntes thereof, with what payne and labor it was subdued and brought to the Kinges
obeisaunce aswell in shedying of many a mannes blode and lesing of theire liffes, as
outeragiouse costes and charges to this lande »769.
Surtout, on trouve dans le Libelle les marques d’un nouveau rapport à la mer. En effet,
l’obsession du « kepinge of the see » traverse l’ensemble du poème. De fait, la frontière de
mer représente, aux yeux de l’auteur, à la fois un danger et un atout potentiels. C’est ainsi
qu’il se montre particulièrement conscient du danger de l’invasion par la mer : « Whan many
a foo us at oure dorre assaylethe » (v.471)770, qui tourne même au complexe obsidional
lorsqu’il évoque la danger de l’encerclement de l’Angleterre par des nations hostiles, à la fois
par terre et par mer, dans l’éventualité de la perte des « avant-postes » : « than Englond
cometh to drede / For alliaunce of Scotelonde and of Spayne / And other moo, as the Pety
Bretayne, / And so to have enmyes environ aboute » (v.731-734)771. Cependant, ce danger
peut se changer en atout si la mer est bien gardée, puisque la position géographique de
l’Angleterre lui permet également en temps de guerre de nuire au commerce des autres
pays, dont les bateaux sont tous obligés de passer par ses côtes : « For if this see be kepte in
tyme of werre, / Who cane here passe withought daunger and woo ? / Who may eschape,
who may myschef dyfferre ? / What marchaundy may forby be agoo ? » (v.22-25)772. C’est
ainsi le cas pour les Espagnols se rendant en Flandre : « hit most, this marchaundy of Spayne,
/ Both oute and inne by oure coostes passe » (v.81-82)773, pour les alliés portugais qui
voudraient faire de même774, pour les Flamands, les Espagnols, les Ecossais et les Bretons :
« Therefor if we wolde manly take on honde / To kepe thys see fro Flaundres and fro Spayne
/ And fro Scotelonde lych as fro Pety Bretayne, / Wee schulde ryght sone have pease… »
(v.271-274)775, pour les Hanséates qui s’aventurent dans la Baie de Bourgneuf : « Thus, if
they wolde not oure frendys bee, / Wee myght lyghtlye stope hem in the see » (v.326-
327)776, pour les Génois : « And if they wold be oure full ennemyse, / They shulde not passe
oure stremez with marchaundyse » (v.342-343)777 , et pour l’approvisonnement des foires de
Brabant : « Yff well the see were kepte in governaunce, / They shulde by see have no
delyveraunce » (v.572-573)778. Toutes ces nations ennemies pourraient alors être
contraintes à faire la paix avec l’Angleterre : « many landes wolde seche her peace for nede ;
/ The see well kepte, it must be do for drede. / Thus muste Flaundres for nede have unite /
769 Citée par Sebastian Sobecki, in « Bureaucratic Verse… », op.cit. (p.278). 770 Libelle of Englyshe Polycye, p.24. 771 Ibid, p.37. 772 Ibid, p.2. 773 Ibid, p.5. 774 Ibid, p.8. 775 Ibid, p.14. 776 Ibid, p.17. 777 Ibid, p.18. 778 Ibid, p.29.
142
And pease wyth us […] / Wythine shorte while, and ambassiatours / Wolde bene here sone
for to trete for ther socours » (v.1082-1087). C’est ainsi que l’auteur, dans une conclusion
« pacifiste » qui détonne par rapport au ton général de l’ouvrage, assigne à l’Angleterre le
rôle de pacificateur universel (!) : « And thus shuld everi lande, one with another, /
Entrecomon as brother wyth his brother, / And live togedre werreles in unite / Wythoute
rancoure in verry charite, / In reste and pese to Cristis grete plesaunce, / Wythouten striffe,
debate and variaunce » (v.1100-1105)779.
De même, le thème de la « sauf garde de mere » est également très présent dans les
Parliament Rolls, puisqu’elle est, entre autres, toujours invoquée parmi les raisons du
consentement à l’impôt780. Surtout, on y trouve en 1420 une pétition, certes non adoptée,
qui propose que le roi instaure un impôt sur les étrangers naviguant dans la Manche, en
fondant son titre de « seigneur de la mer » sur ses victoires, mais également sur un
argument ad longam consuetudinem : « Item, priount les ditz communes, qe par l'ou nostre
tressoverain seigneur le roy, et ses nobles progenitours de tout temps, ount este seigneurs
del meer, et ore par la grace de Dieu est venuz qe nostre dit seigneur le roy est seigneur des
costes d'ambeparties del meer, d'ordeigner, qe sur toutz estraungers passantz parmye le dit
meer tiel imposicione al oeps nostre dit seigneur le roy apprendre, qe a luy semblera
resonable, pur la salve garde del dit meer »781, comme le fait l’auteur du Libelle lorsqu’il
évoque les précédents d’Edgar, Edward III et Henry V782.
De même, plutôt que d’insister sur les emblèmes traditionnels de la royauté et de la nation
d’Angleterre, l’auteur choisit ici de s’attarder sur le Noble, monnaie anglaise dont
l’iconographie, qui met en scène le roi d’Angleterre à bord d’un navire et brandissant une
épée, exprime à merveille la revendication anglaise de la souveraineté maritime. C’est ainsi
que l’auteur y fait référence dès le début de son poème à l’appui de sa démonstration : « For
iiij. thynges oure noble sheueth to me, / Kyng, shype and swerde and pouer of the see » »
(v.34-35)783. Plus loin, il engage ses compatriotes à faire correspondre la réalité au
programme iconographique du Noble : « Than shulde worship unto oure noble be, / In feet
and forme to lorde and mageste […] By the noble that swerde schulde have powere / And
the shippes one the see aboute us here » (v.586-587 et v.596-597), afin qu’il ne demeure pas
une représentation vide de sens784. Surtout, l’iconographie du Noble fait l’objet d’une
description complète au début du chapitre consacré aux exemples historiques, en lien avec
la défense nationale et avec le titre de « lorde of the see » qui revient de droit aux rois
d’Angleterre : « Within the shypp is shewyd there the sayle / And our kynge of royall
apparaylle, / Wyth swerde drawen, bryght, sharp and extente, / For to chastisen enmyes
779 Libelle of Englyshe Polycye, p.55. 780 PROME, voir par exemple parlement de mai 1413, item 16. 781 PROME, parlement de décembre 1420, item 17. 782 Sur la revendication de la souveraineté sur la Manche par les rois d’Angleterre et leur royaume, voir Sebastian Sobecki, The Sea and medieval English Literature, Cambridge, 2008 (p.145-160). 783 Libelle of Englyshe Polycye, p.3. 784 Ibid, p.30-31.
143
vyolente ; / So chulde he be lorde of the see aboute, / To kepe enmyes fro wythine and
wythoute, / And to be holde thorowgh Cristianyte / Master and lorde environ of the see »
(v.854-861)785.
Surtout, si l’Angleterre est couramment décrite par sa position insulaire tout au long du
Moyen Age, par exemple dans les écrits de Bède dès le VIIIe Siècle ou dans ceux de Robert
de Gloucester au XIIIe786, il semble bien que ce soit à l’auteur du Libelle, repris vingt ans plus
tard par John Capgrave dans son Liber de Illustribus Henricis, que l’on doive la première
définition géo-politique de l’Englishness en fonction de l’insularité787. De fait, c’est l’auteur
du Libelle qui, le premier, se livre à une description métaphorique de l’Angleterre comme
étant une ville fortifiée dont le rempart n’est autre que la mer : « Kepe than the see abought
in speciall, / Whiche of England is the rounde wall, / As thoughe England were lykened to a
cite / And the wall environ were the see. / Kepe than the see, that is the wall of Englond, /
And than is Englond kepte by Goddes sonde » (v.1092-1097)788, de telle sorte que ce passage
est très souvent considéré comme étant précurseur de la très célèbre tirade de Jean de
Gand dans le Richard II de Shakespeare placée en exergue de ce mémoire.
785 Libelle of Englyshe Polycye, p.44. 786 Voir Malcolm Vale, The Ancient Enemy, op.cit. (p.15). 787 Voir Sebastian Sobecki, The Sea and Medieval English Literature, op.cit. (p.3-4). Pour sa part, John Capgrave écrit que « Dictum est ab antiquis, quod murus Angliae mare sit ; et, cum inimici nostri supra murum sint, quid putas facient accolis improvisis ? » (Pour cet extrait, voir Ibid, p.159). 788 Libelle of Englyshe Polycye, p.55.
144
Conclusion
Il apparaît ainsi que la naissance de l’identité nationale en Angleterre est liée, sous tous ses
aspects, à une conscience aigüe de l’Etranger. De fait, les contacts très soutenus des Anglais
avec ce dernier renforcent indubitablement leur sentiment d’appartenance à une
communauté, qui se double d’une réaction de rejet qui peut parfois s’exprimer de manière
violente, et ce surtout dans la capitale, où la présence des étrangers est ressentie comme
une profonde menace sociale et économique. En effet, l’étude des Parliament Rolls confirme
à coup-sûr que « les Anglais et spécifiquement les Londoniens constituaient alors le peuple
le plus xénophobe d’Occident »789. De même, ces attitudes réelles trouvent un écho fidèle
dans le domaine des représentations mentales, alors que l’Etranger rêvait constamment les
traits de l’Ennemi déclaré ou non, et que le portrait des peuples, loin d’être objectif, sert
avant tout à nourrir la haine de l’adversaire et à susciter des réactions de fierté nationale.
Enfin, l’Etranger joue également un rôle indéniable dans la constitution de la vision de Soi,
puisque les vertus nationales anglaises font généralement pendent aux vices qui leur sont
attribuée, de même que les mythes servent à asseoir la supériorité de la nation, et se
développent à la faveur du conflit avec l’Etranger, réel ou mythique.
Cependant, il faudrait nous garder d’imaginer que ce type de développement de l’identité
nationale est particulier à l’Angleterre. En effet, la plupart des Etats européens établissent
alors une construction similaire, dont les Anglais font souvent les frais lorsqu’il s’agit de
royaumes ennemis. C’est ainsi que le sentiment national écossais naît de manière précoce,
précisément dans le cadre de l’affrontement avec l’Angleterre. De fait, les Ecossais, dans la
célèbre Declaration of Arbroath790 de 1320 évoquée précédemment, fondent leur droit à
l’indépendance sur un mythe des origines, alors qu’ils prétendent descendre des Scythes
d’Egypte ayant rejoint les Iles Britanniques après un long séjour en Espagne. Ils exposent
alors comment ils ont chassé à la fois les Pictes et les Bretons, et résisté aux nombreux
assauts des Norvégiens, des Danois et des Anglais, de telle sorte que, sur les 113 rois qui ont
régné en Ecosse depuis les origines, pas un seul n’a été un « étranger » (« nullo alienigena
interueniente »). De même, leurs mérites sont rendus manifestes par leur élection divine,
puisque le Christ a fait en sorte qu’ils soient l’une des premières nations converties à la Foi
chrétienne en leur envoyant l’apôtre st André, frère de st Pierre, et qui demeure à ce jour
leur Saint Patron (« Nec eos per quemlibet in dicta fide confirmari voluit set per suum
primum apostolum […] sanctum Andream mitissimum beati Petri germanum, quem semper
ipsis preesse voluit vt patronum »). De la même façon, les Ecossais, évoquant l’invasion
d’Edward I, dressent un portrait à charge de l’adversaire anglais, qui n’a pas hésité à abuser
de leur innocence, et qui a commis de nombreux actes de cruauté, en s’en prenant aux
religieux et religieuses, en brûlant les monastères, et en n’épargnant personne : « Cuius
789
Philippe Contamine, in « Qu’est-ce qu’un ‘étranger’ pour un Français de la fin du Moyen Age », op.cit. (p.30). 790
Le texte de la Declaration est téléchargeable en ligne sur le site des Archives Nationales écossaises : http://www.nas.gov.uk
145
iniurias, cedes, violencias, predaciones, incendia, prelatorum incarceraciones,
monasteriorum combustiones, religiosorum spoliaciones et occisiones alia quoque enormia
et innumera que in dicto populo exercuit, nulli parcens etati aut sexui, religioni aut ordini,
nullus scriberet nec ad plenum intelligeret nisi quem experiencia informaret », et affirment
que, contrairement à leur agresseur, ils ne combattent que pour récupérer ce qui leur
revient de droit (« nisi nostrum cupientes »).
De la même façon, on connaît bien, grâce à l’ouvrage de Colette Beaune791, les mythes qui
ont présidé à la « naissance de la nation France », mythe des origines troyennes792 ou de
l’élection divine du royaume. Or, ceux-ci font l’objet d’une exploitation systématique dans le
cadre du conflit franco-anglais, afin d’affirmer la supériorité de la nation française face à
l’adversaire, de même que les auteurs n’hésitent pas à nier le discours anglais décrit plus
haut. C’est ainsi que l’auteur anonyme du Débat des Hérauts d’armes de France et
d’Angleterre, composé entre 1453 et 1461, conteste aux Anglais le droit de se revendiquer
des Troyens, dans la mesure où ils ne sont pas de la race des Bretons, descendants de
Brutus, mais de celle des Saxons ! Plus loin, l’auteur se livre également à une comparaison
systématique des mérites religieux du royaume de France qui s’opposent aux nombreux
démérites des Anglais, symbolisée par l’obligation qui a été faite à leurs prêtres de porter le
« manipulum », signe d’infamie, « a differance des autres crestians »793. De la même façon,
les auteurs des traités et ouvrages polémiques se livrent généralement à une diabolisation
du caractère national des Anglais, qui sont couramment décrits comme un peuple assoiffé
de sang, et coupable de tous les vices, ayant de plus une tendance naturelle à commettre
des hérésies et à assassiner leurs rois… Enfin, les ballades françaises des XIVe et XVe Siècles
n’hésitent pas à exploiter le mythe de l’ « Anglais coué », soit pourvu d’un appendice caudal,
afin de ridiculiser l’adversaire en le rapprochant de l’animalité.794
Enfin, ce sont exactement les mêmes thématiques qu’on retrouve à l’œuvre dans la
propagande de guerre castillane à l’encontre de l’Angleterre. En effet, le roi Jean I, fils et
successeur d’Henri de Trastamare, dans le cadre d’un discours prononcé devant les Cortes
en 1386, affirme que Dieu a pris soin de marquer les Anglais physiquement en signe
d’infamie, de même que les papes leur ont imposé le versement d’un tribut, le denier st
Pierre, afin que leurs péchés restent à jamais marqués dans l’esprit des hommes. De la
même façon, il rappelle que les Anglais se sont souvent rebellés contre l’Eglise, en
assassinant Thomas Becket, entre autres martyrs. Enfin, ils ont toujours mené des guerres
791
Colette Beaune, Naissance de la nation France, op.cit. 792
Ibid, p.19-54. 793
Voir Le Débat des Hérauts d’armes de France et d’Angleterre, Léopold Pannier et Paul Meyer (eds.), Paris, 1877, respectivement p.10-11 et p.14. 794
Sur les stéréotypes nationaux appliqués aux Anglais en France, on pourra consulter Charles-Victor Langlois, «Les Anglais du Moyen Age d’après les sources françaises », in Revue Historique, T. 52, Fasc. 2, 1893, p. 298-315 ; Georges Ascoli, La Grande-Bretagne devant l’opinion française, Paris, 1927 (p.23-37 et p.37-48) ; Peter Rickard, Britain in medieval French Literature (p.163-189 et p.190-205). Sur le mythe des Anglais tueurs de rois, voir Peter Lewis, « Two pieces of Fifteenth-Century Political Iconography : Clovis touches for the King’s Evil and the English kill their Kings », in Essays in Later Medieval French History, op.cit., p.189-192.
146
injustes, en ne se souciant que du profit et en se comportant de manière orgueilleuse et
hautaine. De même, il est révélateur que le noble castillan Gutierre Diaz de Gamez, dans son
Vitorial composé dans les années 1430, s’appuie sur une déformation du mythe des origines
troyennes pour expliquer ce qu’il estime être l’agressivité naturelle des Anglais, alors que,
selon lui, les compagnons de Brutus, après avoir vaincu les géants qui habitaient la future île
de Bretagne, se seraient unis à leurs filles, qui auraient alors transmis à leurs descendants la
perversité inhérente à la race des géants795.
795
Pour ces deux exemples, voir Anthony Goodman, « Iberia and England in the Middle Ages », op.cit. (p.116-117).
147
Sources et bibliographie.
I) Sources et éditions utilisées.
The Boke of Noblesse, addressed to King Edward the Fourth on his Invasion of France in 1475,
John Gough Nicholas (ed.), Londres, 1860.
The Historical Collections of a Citizen of London in the Fifteenth Century, James Gairdner
(ed.), Londres, 1876.
The Brut or the Chronicles of England, Friedrich W.D. Brie (ed.), Londres, 1906.
The Libelle of Englyshe Polycye, a poem on the use of sea-power, 1436, Sir George Warner
(ed.), Oxford, 1926.
The Minor Poems of John Lydgate, Vol II, Henry Noble MacCracken (ed.), Londres, 1934.
Historical Poems of the XIVth and XVth Centuries, Rossell Hope Robbins (ed.), New York,
1959.
PROME, The Parliament Rolls of Medieval England, 1275-1504, Chris Given-Wilson
(ed.général), Scholarly Digital Editions et The National Archives, Leicester, 2005.
Autres sources et éditions consultées.
History of the Battle of Agincourt, 3e édition, Londres, 1833, Annexe VIII, p. 31-44.
Henrici Quinti, Regis Angliae, Gesta, Benjamin Williams (ed.), Londres, 1850.
Le Débat des Hérauts d’armes de France et d’Angleterre, Léopold Pannier et Paul Meyer
(eds.), Paris, 1877.
Floran, Mary, « Document relatif à l’entrée du roi d’Angleterre Henri VI à Paris en 1431 », in
Revue des Etudes Historiques, 1909, p.411-415 (ici, p.414-415).
Declaration of Arbroath, téléchargeable en ligne sur le site des Archives Nationales
écossaises : http://www.nas.gov.uk
148
II) Bibliographie.
1) Ressources électroniques et outils de travail en ligne.
Middle English Dictionary (MED) : http://quod.lib.umich.edu/m/med/
Plateforme d’Analyse Linguistique Médiévale (PALM) : http://palm.tge-adonis.fr/PALM/
Dictionnaire des auteurs anglais, Auteurs actifs dans les champs de l'histoire et de la
politique en Angleterre de 1300 à 1600, Jean-Philippe Genêt : http://lamop-intranet.univ-
paris1.fr/auteurs_anglais/
Oxford Dictionary of National Biography (DNB) : http://www.oxforddnb.com
The Soldier in later Medieval England, Adrian Bell et Anne Curry :
http://www.medievalsoldier.org
England’s Immigrants (1330- 1550): http://www.englandsimmigrants.com/
2) Articles et monographies sur les sources et leurs auteurs.
Allmand, Christopher, « France-Angleterre à la fin de la guerre de Cent Ans : le Boke of
Noblesse de William Worcester », in La France anglaise au Moyen Age, Poitiers, 1986, p.
103-111 ; et, avec Maurice Keen, « History and the Literature of War : the Boke of Noblesse
of William Worcester », in War, Government and Power in late medieval France, Christopher
Allmand (ed.), Liverpool, 2000, p. 92-105.
Breeze, Andrew, « Sir John Paston, Lydgate and the Libelle of Englyshe Polycye, in Notes and
Queries, Sept. 2001, p. 230-231.
Drukker, Tamar S., « 'An Eye-Witness Account or Literary Historicism?’ John Page's Siege of
Rouen », in Leeds Studies in English, n.s. 36 (2005), p. 251-73.
Edwards, Anthony S.G., « A New Manuscript of the Libelle of English Policy », in Notes and
Queries, Dec. 1999, p. 444-445.
Gransden, Antonia, Historical Writing in England, vol. II, Londres, 1982.
Holmes, J.A, « The Libel of English Policy », in The English Historical Review, vol. 76, No. 299
(Avril 1961), pp. 193-216.
Kingsford, Charles Lethbridge, English Historical Literature in the Fifteenth Century, Oxford,
1913.
McFarlane, K.B : « William Worcester, a preliminary survey », in England in the Fifteenth
Century, Londres, 1981, p.199-224.
149
Meale, Carol, "The Libelle of Englyshe Polycye and Mercantile Literary Culture in Late-
medieval London", in London and Europe in the Later Middle Ages, Julia Boffey et Pamela
King (eds.) , Londres, 1996, p. 181-228.
Nall, Catherine, “Reading and War in the Aftermath of Defeat”, in Reading and War in
Fifteenth-Century England, from Lydgate to Malory, Cambridge, 2012, p. 48-74.
Scanlon, Larry et Simpson, James, John Lydgate, Poetry, Culture and Lancastrian England,
Notre Dame, 2006.
Scattergood, John, Politics and Poetry in the Fifteenth Century, Londres, 1971 ; « The Libelle
of Englyshe Polycye : the nation and its place », in Nation, Court and Culture, New Essays on
Fifteenth-century English Poetry, Helen Cooney (ed.), Scarborough, 2001, p.28-49.
Schirmer, Franz, John Lydgate : a Study in the culture of the Fifteenth Century, Berkeley,
1961.
Sobecki, Sebastian: “Bureaucratic Verse: William Lyndwood, the Privy Seal, and the Form of
the Libelle of Englyshe Polycye”in New Medieval Literatures 12, no. 1 (2011), p. 251–288.
Sutton, Anne F et Visser-Fuchs, Livia : « Richard III’s Books : William Worcester’s Boke of
Noblesse and his Collection of documents on the war in Normandy », in the Ricardian, vol.IX,
No.115, Dec. 1991, p.154-165.
Taylor, Frank : « Some Manuscripts of the Libelle of Englyshe Polycye », in Bulletin of the John
Rylands Library, 24 (1940), p.376-418.
3) Articles et ouvrages mentionnés.
Allmand, Christopher, « The Lancastrian land settlement in Normandy (1417-1450), in The
Economic History Review, New Series, Vol. 21, No. 3 (Dec. 1968), p. 461-479 ; « La
Normandie devant l’opinion anglaise à la fin de la guerre de Cent Ans », in Bibliothèque de
l'école des chartes, tome 128, livraison 2, 1970, p. 345-368 ; Lancastrian Normandy (1415-
1450) : the History of a Medieval Occupation, Oxford, 1983 ; The Hundred Years War,
Cambridge, 2001 [1988] ; Henry V, New Haven et Londres, 1997.
Anderson, Benedict, Imagined Communities, Londres et New-York, 2006 [1983].
Armstrong, John A., Nations before Nationalism, Chapel Hill, 1982.
Ascoli, Georges, La Grande-Bretagne devant l’opinion française, Paris, 1927.
Barth, Fredrik, « Introduction », in Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organization of
Culture Difference, Fredrik Barth (ed.), Waveland, 1998 [1969], p.9-38.
Beaune, Colette, Naissance de la Nation France, Paris, 1985.
150
Bellis, Joanna, « Rymes sette for a remembraunce : memorialization and mimetic language in
the war poetry of the late Middle Ages », in The Review of English Studies, New Series, Vol.
64, No. 264, p.183-207.
Bolton, Jim L., The Alien Communities of London in the Fifteenth Century (ed.), Stamford,
1998 ; « Irish migration to England in the late middle ages : the evidence of 1394 and 1440 »,
in Irish Historical Studies, vol.XXXII No.125, 2000 (mai), p.1-21.
Boutruche, Robert, « Anglais et Gascons en Aquitaine du XIIe au XVe Siècles : Problèmes
d’histoire sociale », in Mélanges d’histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis
Halphen, Paris, 1951, p.55-60.
Butterfield, Ardis, The Familiar Enemy, Chaucer, Language, and Nation in the Hundred Years
War, Oxford, 2009.
Carr, Andrew D., « Welshmen and the Hundred Years’ War », in Welsh History Review, vol.4-
1, 1968, p.21-46.
Carus-Wilson, Eleonora M., « The Iceland Trade », in Studies in English Trade in the 15th
Century, Eileen Power et M.M. Postan (eds.), Londres, 1933, p.156-182 ; Medieval Merchant
Venturers, Londres, 1967 [1954].
Charritat, Anne-Cécile et Erard, Pierre-Emmanuel, rapport du colloque « guerres, ‘nation’,
‘sentiment national’ au Moyen Age » (1er mars 2013), téléchargé en ligne le 15/04/2013, sur
http://epi.univ-paris1.fr
Childs, Wendy R., « Anglo-Portuguese Trade in the Fifteenth Century », in Transactions of the
Royal Historical Society, Sixth Series, vol. 2,1992, pp. 195-219.
Contamine, Philippe, « Qu’est-ce qu’un ‘étranger’ pour un Français de la fin du Moyen Age »,
in Peuples du Moyen Age, Problèmes d’identification, Aix-en-Provence, 1996, p.27-43.
Crooks, Peter, « State of the Union : Perspectives on English Imperialism in the Late Middle
Ages », Past and Present, 2011, téléchargé le 29/01/2014, sur http : //
past.oxfordjournals.org
Curry, Anne, « The Nationality of Men-at-Arms serving in Normandy and the pays de
conquête, 1415-1450 », in Reading Medieval Studies, vol.18, 1992, p.135-163 ; « The Military
Ordinances of Henry V: Texts and Contexts », in War, government and aristocracy in the
British Isles, c.1150-1500, Chris Given-Wilson, Ann Kettle et Len Scales (eds.), Woodbridge,
2008.
Dauphant, Léonard, Le Royaume des Quatre Rivières, Seyssel, 2012.
Davies, R. Rees, « The Failure of the first British Empire ? », in England in Europe (1066-
1453), Nigel Saul (ed.), Londres, 1994.
151
Dockray, Keith, « Patriotism, Pride and Paranoia : England and the English in the Fifteenth
Century », in The Ricardian, vol.VIII, No.110, 1990 (septembre), p.430-442.
Doing, James A., « Propaganda, Public Opinion and the Siege of Calais in 1436 », in Crown,
Government and People in the Fifteenth Century, Rowena E. Archer (ed.), New York, 1995,
p.79-106.
Fisher, John H.,« A Language Policy for Lancastrian England ? », in PMLA, vol.107, no.5
(octobre 1992), p.1168-1180.
Flenley, Ralph, « London and Foreign Merchants in the Reign of Henry VI », in The English
Historical Review, Vol. 25, No. 100 (Oct., 1910), p. 644-655.
Fletcher, Christopher, « La force politique de la manhood. L’exemple du Boke of Noblesse de
William Worcester », téléchargé le 15/01/2014 sur https://www.academia.edu ; « La
Communauté anglaise face à l’étranger » in Cahiers de Recherches Médiévales et
Humanistes, 19, 2010, p.105-122 ; « Langue et nation en Angleterre au Moyen Age », in
Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, 2012/2 - N° 36, p.233-252.
Forde, Simon, Johnson, Lesley et Murray, Alan V. (eds), Concepts of National Identity in the
Middle Ages, Leeds, 1985.
Frame, Robin, «'Les Engleys Nées en Irlande': The English Political Identity in Medieval
Ireland », in Transactions of the Royal Historical Society, Sixth Series, Vol. 3 (1993), p. 83-103.
Genêt, Jean-Philippe, « English Nationalism: Thomas Polton at the Council of Constance », in
Nottingham Medieval Studies, XXVIII, 1984, p.60-78 ; « Le Roi anglais et la Nation française »,
in Beihefte der Francia, Bd. 39, 1997, p.39-58 ; « Scotland in the Later Middle Ages : A
Province or a Foreign Kingdom for the English? », in Contact and Exchange in the Later
Middle Ages, Hannah Skoda et Robert Shaw (eds.), Woodbridge, 2012, p.127-143.
Gillingham, John, The English in the Twelfth Century, Imperialism, National Identity and
Political Values, Rochester, 1999.
Giuseppi, Montague S., « Alien Merchants in England in the Fifteenth Century », in
Transactions of the Royal Historical Society, New Series, Vol. 9 (1895), p. 75-98.
Goodman, Anthony, « The Anglo-Scottish Marches in the Fifteenth Century : A Frontier
Society ? », in Scotland and England (1286-1815), Roger A. Mason (ed.), Edinbourg, 1987, p.
18-33 ; « Before the Armada : Iberia and England in the Middle Ages », in England in Europe
(1066-1453), Nigel Saul (ed.), Londres, 1994.
Grévin, Benoît, « De la rhétorique des nations à la théorie des races : L’influence des théories
scientifiques sur la pensée des stéréotypes nationaux à partir du XIIIe Siècle », disponible en
ligne à cette adresse : http://gas.ehess.fr (téléchargé le 09/11/2012).
152
Griffiths, Ralph A., « The English Realm and Dominions and the King’s Subjects in the Later
Middle Ages », in King and Country, England and Wales in the Fifteenth Century, Londres et
Rio Grande, 1991, p.33-54 ; Ibid, « Wales and the Marches in the Fifteenth Century », p.55-
81 ; Ibid, « A Breton Spy in London, 1425-29 », p.221-225 ; « After Glyn Dwr : An Age of
Reconciliation ? », in Proceedings of the British Academy, vol.117, 2001, p.139-164.
Grummitt, David, « ‘One of the mooste pryncipall treasours belongyng to his Realme of
Englande’ : Calais and the Crown (1450-1558) », in The English experience in France, David
Grummitt (ed.), Aldershot, 2002, p.46-62 ; The Calais Garrison, War and Military service in
England (1436-1558), Woodbridge, 2008.
Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe Siècles, Les Etats, Paris, 1998 [1971] ; Histoire et Culture
historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980.
Harriss, Gerald, Shaping the Nation, England 1360-1461, Oxford, 2005.
Hindley, Geoffrey, England in the Age of Caxton, St-Albans, 1979.
Kantorowicz, Ernst, « Mourir pour la patrie (Pro Patria Mori) dans la pensée politique
médiévale », in Ernst H. Kantorowicz, Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, 2004.
Keen, Maurice, « the End of the Hundred Years War : Lancastrian France and Lancastrian
England », in England and her Neighbours(1066-1453), Malcom Jones et Malcolm Vale (eds.),
Londres, 1989, p.297-311.
Labarge, Margaret Wade, Gascony, England’s first colony (1204-1453), Londres, 1980.
Laget, Frédérique, « L’étranger venu de la mer : naissance et conscience de la ‘frontière de
mer’ dans les îles Britanniques à la fin du Moyen Age (XIIIe-XIVe siècles) », in Annales de
Bretagne et des Pays de l’Ouest, vol.177-1, 2010, p.177-191.
Langlois, Charles-Victor, «Les Anglais du Moyen Age d’après les sources françaises », in
Revue Historique, T. 52, Fasc. 2, 1893, p. 298-315.
Lavezzo, Kathy (ed.), Imagining a Medieval English Nation, Minneapolis, 2004.
Lewis, Peter S., « Two pieces of Fifteenth-Century Political Iconography : Clovis touches for
the King’s Evil and the English kill their Kings », in Peter S. Lewis, Essays in Later Medieval
French History, Londres, 1985, p. 189-192 ; et, Ibid, « War Propaganda and Historiography in
Fifteenth-Century France and England », p.193-213.
Loomis, Louise R., « Nationality at the Council of Constance: An Anglo-French Dispute », in
The American Historical Review, Vol. 44, No. 3 (Avril 1939), p. 508-527.
Lydon, James, « The Middle Nation », in The English in Medieval Ireland, James Lydon (ed.),
Dublin, 1984, p.1-26 ; « Nation and Race in Medieval Ireland », in Concepts of National
153
Identity in the Middle Ages, Simon Forde, Lesley Johnson et Alan V.Murray (eds.), Leeds,
1995, p.103-124.
Massey, Robert, « the Land Settlement in Lancastrian Normandy », in Property and Politics,
Essays in Later Medieval English History, A.J. Pollard (ed.), Gloucester, 1984, p.77-91.
McKenna, J.W, « Henry VI of England and the Dual Monarchy: Aspects of Royal Political
Propaganda, 1422-1432 », in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 28 (1965),
p. 145-162.
Moal, Laurence, L’Etranger en Bretagne au Moyen Age, présence, attitudes, perceptions,
Rennes, 2008 ; « Les peuples étrangers dans les chroniques bretonnes à la fin du Moyen
Âge», in Revue historique, 2009/3 n° 651, p. 499-528.
Pearsall, Derek, « Strangers in Late- Fourteenth-Century London », in The Stranger in
Medieval Society, F.R.P. Akehurst et Stephanie Cain Van D’Elden (eds.), Minneapolis et
Londres, 1997, p.46-62 ; « The Idea of Englishness in the fifteenth century », in Nation, Court
and Culture, Helen Cooney (ed.), Scarborough, 2001, p.14-27.
Postan, M.M, « The Economic and Political Relations of England and the Hanse (1400 to
1475) », in Studies in English Trade in the Fifteenth Century, Eileen Power et M.M Postan
(eds.), Londres, 1933, p.91-153
Prestwich, Michael, « Colonial Scotland : the English in Scotland under Edward I », in
Scotland and England (1286-1815), Roger A. Mason (ed.), Edinbourg, 1987, p.6-17 ;
« England and Scotland during the Wars of Independence », in England and her Neighbours
(1066-1453), Malcom Jones et Malcolm Vale (eds.), Londres, 1989, p.181-197.
Prost, Antoine, « Les Mots », in Pour une Histoire politique, Paris, 1988, dir. René Rémond, p.
255-286. Ici, p. 259-259.
Richardson, Malcolm, « Henry V, the English Chancery, and Chancery English », in Speculum,
Vol. 55, No. 4 (Oct., 1980), p. 726-750.
Rickard, Peter, Britain in Medieval French Literature, Cambridge, 1956.
Rose, Susan, Calais, an English Town in France, Woodbridge, 2008.
Rowe, B.J.H., « Discipline in the Norman Garrisons under Bedford, 1422-35 », in The English
Historical Review, Vol. 46, No. 182 (Apr., 1931), p. 194-208 ; « King Henry VI’s Claim to
France in Picture and Poem », in The Library, Fourth Series, vol. XIII, 1933, p.77-88.
Ruddock, Alwyn A., « Alien Hosting in Southampton in the Fifteenth Century », in The
Economic History Review, Vol. 16, No. 1 (1946), p. 30-37.
Scattergood, John, Politics and Poetry in the Fifteenth Century, Londres, 1971.
154
Simms, Norman, « The Visit of King Sigismund to England, 1416 », in Hungarian Studies
Review, Vol. XVII, No. 2, automne 1990, p.21-29.
Sobecki, Sebastian, The Sea and medieval English Literature, Cambridge, 2008 ;
« Introduction : Edgar’s Archipelago », in The Sea and Englishness in the Middle Ages,
Sebastian Sobecki (ed.), Cambridge, 2011, p.1-30.
Spindler, Erik, « Flemings in the Peasants’ Revolt, 1381 », in Contact and exchange in later
medieval Europe: essays in honour of Malcolm Vale, Hannah Skoda, Patrick Lantschner, RLJ
Shaw (eds.), Woodbridge, 2012, p. 59-78.
Suggett, Helen, «The Use of French in England in the Later Middle Ages: The Alexander Prize
Essay », in Transactions of the Royal Historical Society, Fourth Series, Vol. 28 (1946), p. 61-
83.
Sutton, Anne E. et Visser-Fuchs, Livia, Richard III’s Books, Stroud, 1997.
Thielemans, Marie-Rose, Bourgogne et Angleterre, Bruxelles, 1966.
Thompson, Guy Llewellyn, Paris and its People under English Rule, Oxford, 1991.
Thompson, J.A.F., « Scots in England in the Fifteenth Century », in The Scottish Historical
Review, Volume LXXIX, 1: No. 207: April 2000, p.1-16.
Thrupp, Sylvia L., « Survey of the Alien Population of England in 1440 », in Speculum, Vol. 32,
No. 2 (Apr., 1957), p. 262-273.
Vale, Malcolm, « The Last Years of English Gascony (1451-1453) », in Transactions of the
Royal Historical Society, Fifth Series, Vol. 19 (1969), p. 119-138 ; The Ancient Enemy, England,
France and Europe from the Angevins to the Tudors Londres et New-York, 2007.
Williams, Deanne, The French Fetish from Chaucer to Shakespeare, Cambridge, 2004.