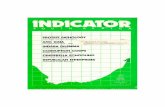FR Hortoneda - Temporalite et construction de soi
Transcript of FR Hortoneda - Temporalite et construction de soi
TEMPORALITÉ ET CONSTRUCTION DE SOI Patrice Hortonéda ERES | Empan 2005/2 - no 58pages 120 à 128
ISSN 1152-3336
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-empan-2005-2-page-120.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hortonéda Patrice, « Temporalité et construction de soi »,
Empan, 2005/2 no 58, p. 120-128. DOI : 10.3917/empa.058.0120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.
© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
Temporalité et construction de soi
Patrice Hortonéda
Act
ualit
és d
u se
cteu
r
« II y a une dialectiqueévénementielle humaine
qui dans les formulations anthropologiques,relie les formulations mythiques,
les actions, le savoir-faire, et le savoir. » F. Tosquelles, 1992.
La temporalité s’oppose à l’éternité etse confronte à la finitude. Elle supposeque la conscience 1 de nous-même« déploie ou constitue le temps », selonl’expression de Merleau-Ponty, qu’ellene fait qu’un avec l’expérience internedu temps, qu’il n’y a pas de présentfermé sur lui-même.Husserl 2 fait de la conscience intention-nelle une perception actuelle mais aussiune rétention (maintien du passé, remé-moration, rétrospection) et encore uneprétention (anticipation, prospection,visée du futur).Heidegger en parlant d’un « avenir-qui-va-au-passé-en-venant-au-présent »indique que chaque instant est hors desoi, en fuite devant lui-même. La tem-
poralité est donc l’essence de notreêtre : être voué à la finitude ; la penséedominante est alors pour lui souci decette finitude.Sartre : « Nous ne sommes pas, nousexistons », ce que Henri Maldiney 3 tra-duit : « La présence que chacun est, ouqu’il échoue à être, consiste à être àl’avant de soi. Exister, nous l’avonsrépété, c’est avoir sa tenue, c’est tenirl’être en avant de soi et en soi plus avant(selon une expression d’André duBouchet). » Si Sartre parle du projetcomme lieu d’épanouissement de saliberté, j’y ajouterai cette autre phrasede Maldiney : « Le projet n’est pas thé-matisable : le soi qui s’ouvre à soi-même n’est ni donné ni visé, il est en jetdans le projet. »
Je ne souhaite aucunement étaler unsavoir philosophique qu’il est bien diffi-cile de porter, mais nous ne pouvons, sinous souhaitons rester au plus près denotre tâche de clinicien, réduire trop vite
120
Patrice Hortonéda, psychologue, centre de guidance infantile, 27, rue Ingres, 31000 Toulouse.1. « Le péril est que l’identification de l’homme à la conscience (appelée à devenir conscience de soi, puis esprit)et de celle-ci au discours, mène à licencier tout “en dehors” de ce discours et conduit fatalement à la promulga-tion du Savoir absolu », A. De Waelhens, La psychose – essai d'interprétation analytique et existentiale, Louvain– Paris, Nauwelaerts, coll. « Pathei Mathos », 1972, p. 160.2. Consultation des ouvrages : Pratique de la philosophie, Paris, Hatier, 1994 et L.M. Morfaux, Vocabulaire de laphilosophie et des sciences humaines, Paris, A. Colin, 1980.3. H. Maldiney, Existence, crise et création, Encre Marine, 2001, p. 76.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 120
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
121
Te m p o r a l i t é e t c o n s t r u c t i o n d e s o i
la portée de ce titre d’atelier, Temporalité etconstruction de soi 4.
Pierre se précipite vers mon bureau pour sespremières séances de thérapie ; bien sûr denombreux préalables ont eu lieu, mais là ilvient seul jusqu’à ma porte entrouverte, il laferme et la bloque sans même la franchir ;de l’autre côté enfermé en un « chezmoi ? », je l’accueille paisiblement de lavoix. Ce mode de heurter se retrouve,quelques minutes après, lorsqu’il va se pré-cipiter soudain à l’intérieur et heurter de sonpropre corps les murs puis tenter de lanceret, dit-il, d’exploser sur eux, tout ce que jevais devoir protéger et « présenter ».Un autre enfant, dès sa première séance,avisera la boîte de pâte à modeler, en esquis-sera la projection vers les vitres, peut-êtremême vers mon visage, mes yeux.Ces deux enfants mettront plusieurs séancesavant de reconnaître un cadre sécurisant etengager divers jeux et échanges. J’ai sou-vent pensé que dans ces cas, il n’y avait audépart ni objet maniable ni rencontre desujets mais une angoisse effractive qui metces enfants en quasi- « pur jet » (!) d’eux-mêmes. L’offre d’une présence, ici d’uneprésence duelle, nécessite un souci accru depréparation, d’enveloppes.
Nous avons sûrement à l’esprit de multiplesscènes du quotidien : en groupe éducatif oubien en « récréation » où des précipita-tions de cet ordre ont lieu. Notre activité desoignants nous amène régulièrement à lescontenir, les « gérer », éviter bien sûr deles provoquer mais, avant tout, sans cher-cher à les passer sous silence et à ne pas lesvoir, à les penser et les transformer, leuroffrant tout d’abord lieu, espace et des ren-contres avec des techniques et des média-tions plus à même de les contenir.
Interrogeons nos outils et en premier lapsychanalyse ; si cela était possible, je vousinviterais bien à partager ensemble cemagnifique film d’Hitchcock, Le docteurEdwards, docteur qui vient de prendre sonposte de médecin dans une clinique psy-chiatrique et qui va dérouler auprès de sacollègue (Ingrid Bergman) les affres d’uneamnésie totale : il ne sait plus d’où il vient,où il va, qui il est... Vous l’avez sûrementvu et même si vous l’avez oublié pour par-tie, vous vous souvenez toutefois de cestraces, obnubilantes et énigmatiques, d’unefourchette maniée distraitement, laissées aucours d’un repas sur le blanc d’une nappede restaurant ou encore du visage angoissédu docteur Edwards lorsqu’un verre de laitlui est tendu.Cet homme sans passé, sans projets nous estmême présenté, agrippé à un couteau dansle noir de la nuit. Dans ce film, les jeux dela mémoire, de l’oubli des souvenirs figu-rables (mais magistralement cauchemardés,grâce au soin des décors de Dali) commedes traces plus subtiles... insistantes, répéti-tives, inquiétantes et mystérieuses, sont làcomme preuves patentes d’un travail diffi-cile de réouverture du passé.
La psychanalyse nous serait ainsi présentéecomme ce possible travail de reconstruc-tion du passé, de l’histoire passée du sujet,du comblement des lacunes de lamémoire...Pourtant le génie du cinéaste va souligner lanécessaire présence du transfert (sur IngridBergman, mais aussi sur son vieux maître,le docteur à la barbiche et aux lunettesrondes, à la Freud, consulté en renfort),transfert moteur du long travail de reprisesdes résistances avec leur cortège de défor-mations, déplacements, condensations (cf.le magnifique jeu de cache-cache et de glis-
Actualités du secteur
4. Ce texte a servi de support aux échanges en atelier aux VIIe Journées d'étude de recherche et de formation de l'AIRE,Paris les 4, 5, 6 décembre 2002
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 121
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
sade d’une roue de vélo que Dali brosse enun mode surréaliste sur la pente d’untoit...).Tout à trac, l’histoire passée cède le pas àl’histoire actuelle, le drame personnel dudocteur Edwards rebondit en révélant undrame actuel : une banale histoire policière,autour d’un crime, crime de la jalousie,entre deux collègues, deux semblables. Biensûr, Éros est lui aussi au rendez-vous : à unmort du passé lointain, encore non dévoiléet au crime traumatisant « après coup »,presque actuel, en tout cas d’un passéproche, succède une liaison amoureuse.Tout finira bien.
Les leçons freudiennes nous ont apportéces diverses lectures de réminiscences del’infantile : impact, après-coup, refoule-ment, travail de levée du refoulement etremémoration, répétitions mais aussi pistesplus précaires que le souvenir, traces mné-siques et scénarios non seulement origi-naux mais originaires. Fenêtres quin’ouvrent pas seulement sur le passé, maisà partir de traces infimes, fenêtres du fan-tasme qui dégagent le sujet d’un réel irre-présentable, indicible, absent et qui,pourtant, insiste. Le film s’achève, lui, surun mort, un mort enfant, frère du docteurEdwards, frère de celui qui, amnésique enpanne d’identité, s’est identifié unedeuxième fois, une nouvelle fois, et mêmeune troisième fois : avec l’amnésie à unmort ... (le vrai docteur Edwards a été, enréalité, assassiné ; Gregory Peck n’a été quele témoin traumatisé de ce meurtre).Au départ, mort tragique d’un frère ; culpa-bilité démesurée ; absence insupportable ;
deuil impossible. « L’oubli » porte ainsiessentiellement sur un vide, un point noir,un vide sans enclos, sans bords, inabor-dable, un vide que le génie du cinéaste vaentourer des signifiants du blanc, de l’éclataveuglant de la lumière, de la glissade, de ladégringolade, de la chute et, au contact duprojectile, la mort physique certes du vraidocteur Edwards assassiné mais corrélati-vement la disparition subjective radicale duhéros principal G. Peck : amnésie !
Pourtant le sujet s’accroche encore ; c’esttragiquement qu’il va tenter de mimer cettefinitude, cette mort qui ne peut parvenir àrappeler une autre absence, car elle n’ajamais eu lieu. Elle n’est au mieux que tragi-quement là, dans la perte d’identité, maisjusque-là elle n’avait pas eu de lieu, l’enfantpuis l’homme avaient grandi avec en leursein cette béance non abordable – potentiel-lement effractive et tout à coup révélée... Il ya donc des souvenirs, des traces mnésiques,mais aussi des archives, classées selondivers feuilletages et, pour finir, nous devonsreconnaître la primeur des connexions sur lesouvenir, la trace, l’événement passé. J.-B. Pontalis5 dans son dernier ouvrage rap-pelle, pour lui redonner valeur, le vieuxmodèle du « projet de psychologie scienti-fique » où Freud parle de frayage et de voies(neuroniques) aptes à freiner ou à faciliter ladécharge de l’excitation. Il conviendraitd’ajouter à ces évocations freudiennes lesdéveloppements de deux autres courantsmoins fréquentés de la psychopathologie.Je pense à la Daseinanalyse de LudwigBinswanger, traduite par « analyse existen-tielle 6 », évoquée aussi comme analyse de
122
EMPAN N°58
5. J.-B. Pontalis, Ce temps qui ne passe pas, Paris, Gallimard, 2000.6. L. Binswanger, Introduction à l'analyse existentielle, p. 30 : « J'ai deux raisons spéciales d'éviter ce terme “d'exis-tentiel”. D'abord parce qu'il évoque l'idée de l'existentialisme [...] de M. Sartre [...] qui reproche à Heidegger deprendre son point de départ dans le Dasein et non dans la “conscience”, or c'est justement l'idée de Dasein qui estimportante en psychiatrie et non celle de “conscience”. La deuxième raison est que Dasein comprend l'âme et lecorps, le conscient et l'inconscient, le volontaire et l'involontaire, la pensée et l'action, l'émotivité, l'affectivité et l'ins-tinct [...]. Toutefois je n'emploie pas « être » comme un substantif, tel que l'homme : l'être humain par exemple, maiscomme un verbe tel que “TRE, TO BE, ESSE”. »
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 122
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
123
Te m p o r a l i t é e t c o n s t r u c t i o n d e s o i
la présence, de l’être-là de l’être-au-monde,qui accorde au vécu corporel et à la motri-cité une place d’importance et engage cor-rélativement une réflexion sur les entours,l’accueil : sa tonalité, son style, sonambiance... (notion d’espace thymique).L. Binswanger 7 a ouvert de nombreusesréflexions sur la temporalité, que ce soit àpartir de « l’abandon » du mélancolique(thème de la perte, de l’autoreproche) ouque ce soit du côté extrême « improbléma-tique » de toute expérience chez lemaniaque. Des maniaques, il dit : « Il leurmanque l’habituel, leur mode de temporali-sation est l’actuel (comme nous l’avonsdéveloppé dans les études sur la fuite desidées) la momentanéité au sens du simpleinstant (ce que Heidegger nomme l’ab-sence-de-demeure-auprès-de...) 8. » À l’op-posé du maniaque qui vit seulement pourl’instant, dans la perte de la demeure, lemélancolique ne tisse plus, lui, les réten-tions et les protensions et, parce qu’il vitdans un passé ou dans un avenir altéré,n’atteint aucun présent. À ce sujet,H. Maldiney parle d’un cercle de laplainte : « Ah si j’avais... ou si je n’avaispas ... fait cela ! »Nous n’avons pas affaire, dans nos institutsde rééducation, à ces structures patholo-giques avérées et installées mais plutôt,bien sûr, à des modes défensifs, à des« positions » moins fixées. Mais quoi qu’ilen soit, ces approches de la daseinanalyse,approches phénoménologiques du tempsvécu comme celles voisines de l’espacevécu, peuvent interroger et éclairer nombrede pratiques tant éducatives que thérapeu-tiques utilisant des techniques de médiationet d’expression (travaux de G. Pankow surle modelage, d’A. Stern et de Prinzhorn surla peinture, d’E. Minkowski sur le temps
vécu, d’E. Straus sur le sentir et le se mou-voir, etc.).
L’autre courant, lui aussi proche de la psy-chanalyse, s’intitule la Schiksalsanalyse –dont le fondateur est le psychiatre et ana-lyste hongrois réfugié à Zurich, LéopoldSzondi (1893-1986). Nous pouvons tra-duire ce terme par « analyse du destin ».L. Szondi a initié un prodigieux travail quiva se condenser dans un tableau stimulant :le « diagnostic expérimental des pul-sions ».Il n’y est pas uniquement question (commedans ces reprises par un groupe d’universi-taires et d’analystes de Louvain) d’unsimple assujettissement à un destin des pul-sions – au fatum – ni à la « compulsion dedestin » ou à la névrose de destinée où « lesujet n’a pas accès à un désir inconscientqui lui revient de l’extérieur », d’où l’as-pect démoniaque souligné par Freud.D’entrée, Szondi a opposé au destincontrainte le destin liberté et a construit unschéma dialectique et dynamique où le dua-lisme pulsionnel prend encore plus d’am-pleur et ne se limite plus au jeud’intrication, de désintrication et d’ambiva-lence des motions pulsionnelles – (sontableau enrichit la représentation psychopa-thologique avec un jeu complexe des pul-sions se combinant en quatre vecteurs, enhuit facteurs et seize tendances, tous inter-actifs).En bref, le diagnostic expérimental des pul-sions offre la possibilité d’effectuer une lec-ture fine et évolutive des mouvementspulsionnels d’un sujet. Il met à la questiontant notre réflexion psychopathologiqueque notre propre disposition à accueillirdynamiquement une « pathologie » mou-vante, parce que aussi relationnelle,
Actualités du secteur
7. L. Binswanger, Introduction à l'analyse existentielle, Paris, Éditions de Minuit, 1977, préface H. Maldiney, R. Kuhn.8. L. Binswanger, Mélancolie et manie, Paris, PUF, 1997.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 123
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
humaine ou en quête d’horizons humains ;avant même le rétablissement d’un modeobjectal, le vecteur contact du psychodia-gnostic nous renseigne sur les préalables denotre « agrippement » ou de notre dérélic-tion (être-jeté) au monde. À l’oppositionnormal/pathologique viendrait ainsi se sub-stituer une articulation entre pathique etpathologique nous ramenant aux préa-lables qui font que l’être puisse être là apteou non à résister aux angoisses présentéescomme archaïques, néantisantes, pouvantsusciter un vécu d’agonie psychique(breakdown de Winnicott, 1974, qui n’est« déposé » nulle part, agonie primitive etterreur agonistique de Roussillon, asphyxiepsychique d’André Green dans la folie pri-vée, 1990, trou noir de la psyché deF. Tustin, 1985...)
Nombre de nos jeunes patients accueillis enIR, parfois partagés avec un secteur depédopsychiatrie, oscillent entre desmoments de toute-puissance où ils s’identi-fient à l’agresseur et ces moments d’agonieoù ils passent de l’excitation et de la des-tructivité à une angoisse insupportableconvoyeuse d’inexistence.Au mieux, nous avons affaire, si une rela-tion se noue, à une « palpitation »(J. Kinable 9) entre angoisse-fusion prochede l’intrusion et angoisse d’abandon.L’essentiel consiste avant tout à ne pasajouter à ce désespoir de soi un désespoirde l’autre : il convient de pouvoir rétablir lecontact pour survivre, de trouver à aména-ger un cadre et des « objets » adéquats.Si nous revenons à Pierre, celui-ci m’a indi-qué comment des « carapaces » pouvaientnous protéger de ses explosions et ses mor-sures ; il a pu mettre alors à l’épreuve unecarapace de coussins, couvertures, d’abordpour me protéger puis pour s’exposer lui-même à l’oralité d’ogre hyperagressif et
terrifiant dont je devais tenir le rôle, afinqu’il puisse en contrôler le bon fonctionne-ment. La violence se transforme ainsi enjeu, même si le thérapeute y paraît quelquepeu « tortionnaire ».Ces tours et détours avaient pour but derappeler que l’inconscient n’est pas le seulrefoulé. Bien sûr l’inconscient et ses pro-cessus dits primaires se moquent du temps,mais il n’en convient pas moins d’êtreattentifs – surtout face aux graves patholo-gies narcissiques, aux cas dits « limites » etaux psychoses – tant au recueil d’élémentsbiographiques concrets (des biographies dela daseinanalyse aux monographies de lapédagogie active...) qu’à l’accueil d’éclatspulsionnels en manque même d’objets, pro-duits du négatif.Si je joue avec Pierre, je ne suis pas abso-lument sûr que pour lui ce soit à ce jour unjeu, en tout cas, cette aire potentielle de jeudoit se disposer sur une scène avec desenveloppes institutionnelles multiples quigarantissent des écarts d’espace et de tempsbien différenciés.
Je m’avance ainsi vers la question de l’es-pace, vers la question d’un site, d’un pay-sage, d’un ouvert pour être là.Nous ne pouvons pas commencer avec cesenfants et ces adolescents par l’invitationsimple à conter leur histoire. Nous savonstous combien la parole – dois-je dire laparole tenue ? la parole prise ? – est unedenrée sinon rare du moins qui coûte endisposition de lieux et en patience. Il nousfaut entendre plus radicalement ce leitmo-tiv « ce n’est pas moi ! » proféré à tout boutde champ dans nos établissements.Non seulement l’espace et le temps sontarticulés, mais particulièrement dans lescas évoqués, c’est par l’espace que nouspouvons avoir accès à la temporalité.Disons, pourquoi pas, par l’espace poten-
124
EMPAN N°58
9. Kinablej, « Qu'est-ce que la psychopathie ? », Informations psychiatriques, n° 6, vol. 75, juin 1999, p. 617-624.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 124
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
125
Te m p o r a l i t é e t c o n s t r u c t i o n d e s o i
tiel. Cela a peut-être le mérite de nous rame-ner à un homme connu et reconnu :Winnicott. Il parlait aussi d’une aire inter-médiaire d’expérience, apte à ouvrir uneillusion, une création, un « il y a » qui sou-lage et délivre un temps de la question d’uneorigine et d’une appartenance, interne ouexterne.La création singulière, en attente d’adapta-tion adéquate ou plutôt juste suffisammentbonne, va initier « la vie imaginaire, lesarts, la religion, le travail scientifique créa-tif » ; en fin de son énumération, il ajoutait :les intérêts culturels – le déraillement de ceprocessus était en 1960 associé au « faux-self ».Dans notre pratique, l’espace potentiel,l’illusion créatrice sont bien souvent decourte durée : avez-vous remarqué, une foisencore, la précipitation, le manque de rete-nue, lorsqu’un enfant produit une œuvre,un dessin, un modelage, une peinture, unbricolage, qui le pousse à l’exhiber ou àvouloir le coller – comme une dotationnécessaire – à un adulte, parfois au mur deson bureau comme horizon d’un regardquotidien, quelque fois, bien plus rares, aucreux d’un espace concave !Quand l’enfant découvre ainsi – mais sansle piétiner – l’intérêt et l’investissement decet en-creux toléré, Winnicott en parlecomme du sein ou de « l’élément féminindistillé » : « Quand l’élément fille chez lebébé (garçon ou fille) ou chez le patientdécouvre le sein, c’est le soi qui a été trouvé,alors cela conduit à l’Être » ; c’est là la seulebase de la découverte de soi et du sentimentd’exister. À partir de là se constitue la capa-cité de développer un intérieur. La construc-tion de soi est engagée.Je noterai juste que c’est aussi à partir de làet de 1’excitation qui gagne l’enfant, car il
devient désirable – parfois, nous avons vuavec Pierre : oralement désirable – queWinnicott va aborder la capacité de l’enfantà faire, même plus précisément à faire faire(à faire appel à l’élément masculin ; seconstruit ainsi une bisexualité dont onretrouve les ratés en des scénarios sado-masochistes...). Mais mon propos ne va pasde ce côté-là, mais plutôt du côté du jeu : àl’espace potentiel sont liées création et airede jeu.
Depuis un fragment d’Héraclite le jeu estassocié au temps... Pourquoi ? Et quel inté-rêt plus précis pouvons-nous y trouver ?Déjà sous prétexte de revisiter l’évolutionde la pensée analytique, j’ai insisté sur l’in-suffisance de la reconstruction du passé. Enparaphrasant Marthe Robert, il convien-drait de passer du roman des origines àl’origine d’un roman, d’une narration, etc.Nous avons commencé ainsi à voir égrati-gnée une histoire trop chronologique, à sai-sir des nœuds et des connexions plussignificatifs, à reconnaître au présent trans-férentiel une part essentielle et à donnertoute son importance à l’accueil qui cadre,qui ouvre ce présent.Deux aspects du temps sont là en tension :le mieux connu, chrônos, le temps de ladurée, et ce présent, qui nous coûte beau-coup de digressions. Je souhaiterais, avanttoute chose, les protéger du mal actuelqu’Hélène Chaigneau épinglait, il y a peu,comme chronolâtre : accumulation decontrôles, de temps soi-disant de présence,emploi du temps bien pleins et autres stupi-dités qui ne font rien fonctionner du tout.Je crois que nos classiques grecs dispo-saient, pour la temporalité, de diversesnominations : aiôn, chrônos, nun, kaïros 10...Pour couper court, ce qui m’intéresse d’ap-
Actualités du secteur
10. Aiôn : durée et éternité ; plus antérieurement la racine ai_w, force vitale perçue, essence temporalisante du vivant.Chrônos : durée objective, quantité de temps mesurable et continue.Nun : l'instant.Kaïros : le moment opportun.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 125
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
procher c’est le « là, où il y a une sorte decommencement... non pas d’origine... dutemps 11 », ce que nous pouvons nommerévénement (étymologiquement : « ce quise passe »), événement où se joue enmême temps l’avènement du sujet commele note H. Maldiney.Événement : pas trop pris dans la trame(vers un destin tracé), pas trop instantané,pas trop non plus surgissant-surprenant, pastrop coupé de ses arrières et suffisammentopportun. Un véritable point cosmogéné-tique, naissance du monde (dont parleKlee) car il s’agit là de l’avènement de laforme (Gestaltung), du rythme qui est lemouvement même d’apparaître de laforme.En contrepoint de ceci, je vous prie de son-ger un instant à ce que serait un événe-ment... dans la précipitation... sansarrière-plans... : une étrangeté ? un cauche-mar ? un cri ? une hallucination ? une« chose », objet bizarre et angoissant...Souvenons-nous des jets évoqués au débutde ce travail.J. Oury nous parle, à propos de la hâte, durisque alors encouru d’une rencontre... avecun point d’horreur ou un point d’arrêt radi-cal de catalepsie ! Il faut donc pouvoir loca-liser le jaillissement du temps, autre façonde reprendre l’espace potentiel, le trans-fert... J. Oury parfois glisse jusqu’à baptisercela : l’espace du dire...Le temps bouclé sur lui-même et infinimentrépété, c’est le temps du mythe et des rites :si nous nous intéressons à la civilisation desDogons, par exemple, nous comprenonsque même le labour du champ ou la formede l’habitat sont pris dans un temps immé-morial et donc sans fin, du mythe.
L’histoire est là, pure synchronie. Lévi-Strauss écrit : « Les rites marquent lesétapes du calendrier comme les lieux-ditscelles d’un itinéraire. Ceux-ci meublentl’extension, ceux-là, la durée 12. »Continuité, durée et stabilité du calendrier :de ce côté-là, nous voyons bien que l’évé-nement est anticipé dans une structure,prise dans la synchronie du mythe ; l’his-toire y est stationnaire. Le rite, d’emblée,résout toute contradiction entre l’histoirepassée, énoncée dans le mythe, et tout pré-sent ; il garantit la structure en y ramenanttout événement.
Face à lui, le jeu, la transformation en jeu,c’est-à-dire un « in-ludere », un retour àl’illusion, encore ! Jeu qui a pour effet detransformer à l’inverse la structure en évé-nements, de « dissoudre la structure et dela faire voler en éclats événementiels 13 ».Le jeu donc a la capacité de rompre lesliens entre passé et présent, il est une« machine à transformer la synchronie endiachronie ». Le jeu peut subvertir le tempssacré où règne l’étroite conjonction dumythe qui énonce l’histoire et du rite qui lareproduit : il brise cette conjonction, mytheparole, rite acte, et « l’homme ainsi sedélivre du temps sacré pour l’oublier dansle temps humain ».
Depuis Sophocle et son Œdipe, nousconnaissons et nous retrouvons parfoisdans notre travail la puissance des « parolesoraculaires » ; le jeu – même le jeu drama-tique – est peut-être une façon d’y échap-per. Le retour au temps humain est alors àpenser (et à soutenir) dans la reconnais-sance de ce système binaire qui fonctionne
126
EMPAN N°58
11. J. Oury, « La temporalité dans la psychose », dans La folie dans la psychanalyse, p. 67-78. Article repris dans Lapsychose et le temps. Onze heures du soir à La Borde, Paris, Galilée, 1995.12. C. Lévi-Strauss, Mythe et oubli, p. 299, cité par G. Agamben.13. G. Agamben, « Le pays des jouets : réflexions sur l'Histoire et sur le jeu », dans Enfance et histoire, Paris, Payot,1989, p. 83-109.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 126
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
127
Te m p o r a l i t é e t c o n s t r u c t i o n d e s o i
par la corrélation et la différence de cesdeux catégories indissociables que sont lasynchronie et la diachronie. La sphère durite et la sphère du jeu se développent l’uneaux dépens de l’autre : et l’histoire naît deleur écart différentiel.
Dans nos établissements, serait-il possible,après tout cela, de penser l’historisation àla croisée de la qualité de la vie quoti-dienne et de la qualité des espaces poten-tiels ?
Je voudrais vous présenter, pour finir, unesituation de travail issue du dispositif« temps de jour » où trois adultes de for-mation différente accueillent sur un lieu etdes plages de temps fixées, de 1 h 30, desgroupes de 3 à 5 enfants, adressés par lesdifférents pavillons du centre. Les « tempsde jours » sont ainsi ouverts sept fois parsemaine, pendant le temps de fonctionne-ment de l’école. Les enfants qui y viennentsont considérés comme en grande difficultédans un ou plusieurs domaines : nous pou-vons qualifier ces temps de thérapie grou-pale médiatisée...J’ai choisi de vous présenter brièvement icile déroulement d’une plage de travailqu’animent trois collègues, un psychologueet deux éducateurs.Après le temps rituel de l’accueil, les troispuis quatre enfants ont fait émerger dans laplage atelier « zinzin », « bricolage »,des constructions de maisons. Chacun avaitla sienne, un des garçons était très« explosé » et il y avait alors un vécu per-sécutoire terrible des uns aux autres, cha-cun avait son objet et il n’y avait plus demise en commun. En définitive, chacun destrois enfants avaient mis le grappin sur l’undes trois adultes.Les maisons ont finalement été installéessur une grande surface de bois, rangée etsortie à chaque séance de travail. L’idée duvillage est alors apparue. L’un des enfants achoisi de faire du psychologue le major-
dome de sa maison ; cela va lui donnerl’idée de se faire appeler monsieurDufresne ! Le psychologue et les autresadultes restent attentifs à répartir leurs ser-vices.Il n’y a toujours pas d’espace qui fasse liensocial. Lorsque apparaît le besoin de sefabriquer des téléphones, la communicationbien sûr s’amplifie ; des échanges sont alorsinitiés, mais il faut des contreparties : unevaleur reconnue, une mesure des échanges,des chéquiers... Très vite, la fonction d’unmaire et sa nécessité comme représentant lacommunauté apparaissent ; il n’y a pas demairie, de bâtiment personnel, mais il esttrès souvent appelé pour régir les difficultés(un éducateur adulte est désigné). La policene viendra que plus tard, ce sera un enfant.Tout cela, me dit-on, leur permet de parlerde leur problématique, discrètement. Il va yavoir des accidents, des gens blessés et lanécessité d’un lieu de soin, d’un hôpital. Lamort vient même taper à la porte, elle ren-contre beaucoup d’oppositions, personnene souhaite ni ne peut accepter cette tragé-die. Mes collègues parlent en régulation,après l’atelier, de leurs résistances. Bienplus tard, un enterrement va avoir lieu...Le va-et-vient devient incessant entre l’es-pace communautaire et les espaces intimes,il faut, par exemple, fabriquer une ambu-lance et un hélicoptère pour l’hôpital ouencore transformer le majordome en direc-teur d’hôpital et monsieur Dufresne, quil’accompagne, en chirurgien. Les relationsentre les espaces privés se nouent.L’éducatrice qui a une maison la voit setransformer en magasin de construction etmatériaux divers, elle aide beaucoup le vil-lage ! Il y a aussi dans les maisons une viefamiliale : trois sont mariés, deux ont desenfants ; le dernier vit avec son major-dome !Parfois, au-dedans d’une maison, la vie sedéroule dans un vrai « foutoir » : mon-sieur Dufresne a rempli sa maison, il en
Actualités du secteur
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 127
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S
voulait toujours plus et il n’arrivait pas à sedébarrasser de quoi que ce soit, ni à vendreni en définitive se séparer car, aussitôt, ilremplissait de nouveau… Il y a finalementeu toute une période d’abandon de cetespace intérieur, puis il a pu revenir chezlui, à l’intérieur, et y mettre de l’ordre. Unjour, il a dit : « Aujourd’hui, je vais m’oc-cuper de ma maison. » Le garagiste, lui,n’a pas vraiment fait une maison, quand ilest arrivé il a trouvé assez vite qu’il pouvaitappeler son bâtiment « le garage ». Il a, endéfinitive, très peu de vie privée, il bricolebeaucoup les voitures, il entasse beaucoupde pièces, il répare et vend. C’est lui quireprésente aussi la police ; au départ il yavait beaucoup de transgressions, il provo-quait et même attaquait, mais maintenant ilse tient !Ces derniers temps, il a décidé, lui aussi,d’arranger son extérieur, il a posé une bar-rière mais pas du tout en fermeture, c’est unparking où il a mis ses voitures, puis il a euenvie de planter des arbres et il a dégagé unpetit intérieur à côté de son commerce.J., avec ses achats, n’arrivait pas à se satis-faire de son salaire : dès qu’il déduisait une
somme, il se vivait délesté. Il avait pourtantrécupéré un objet, mais il ne supportait pasune soustraction sur son carnet de compte –ça le mettait dans une angoisse insuppor-table – alors, vite, il réclamait que sonsalaire soit versé à chaque séance ! Çan’était plus une paie au mois, mais deuxfois la semaine ! C’est fini maintenant, ça amis du temps ; le cheminement nouséchappe, mais il n’y a plus cette accéléra-tion.L’espace public s’est développé à partir dela construction de la piscine ; au-delà desbiens individuels, ça a été une des pre-mières choses partageables. Plus tard, il y aeu le jardin public puis des arbres.Il y a là un extraordinaire plaisir à jouer etpourtant à l’heure, le village est rangé, dansle calme, jusqu’à la semaine suivante.Dans un échange d’équipe, le constat estfait que F., qui a mis à mal de nombreuxlieux et personnes, a fabriqué là une limiteà ses débordements et à ses explosionsincessantes. Il ne fait plus peur et il ne sefait plus peur, malgré ses lourdes difficul-tés, il est assuré d’être intimement reconnuet aussi d’être créatif au sein d’un collectif.
128
EMPAN N°58
Bibliographie
BINSWANGER, L. 1998. Le problème de l’espace en psychopathologie, Toulouse, Presses universi-taires du Mirail.
DEMANGEAT, M. 1992. « Historisation et psychose », dans Histoire et histoires en psychiatrie,Toulouse, érès, p. 181-196.
FONTAINE, A. 2001. « Club thérapeutique et perception du temps », Institutions, n° 28, p. 33-43.HORTONÉDA, P. 1987. « Un corps qui s’anime : du jeu à Gestaltung », Nouvelles du CREAI : le corps
mots pour maux, n° 4, p. 34-44.HORTONÉDA, P. 1991. « Médiations et psychothérapie : le temps à retrouver », Empan, Les média-
tions, n° 4, p. 50-58.PONTALIS, J.-B. « Trouver, accueillir, reconnaître l’absent », dans D.W. Winnicott, Jeu et réalité,
p. VII-XV.TOSQUELLES, F. 1992. « De l’histoire et des histoires dans les pratiques psychiatriques », dans
Histoire et histoires en psychiatrie, Toulouse, érès, p. 47-65.
00 EMPAN N° 58 10/01/06 13:32 Page 128
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 19
3.87
.209
.16
- 08
/07/
2013
10h
23. ©
ER
ES
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 193.87.209.16 - 08/07/2013 10h23. © E
RE
S