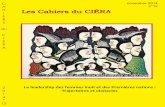Approche pluridisciplinaire de l'enfant porteur d'un Spina Bifida
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez...
Développements / septembre 2010 5
RésuméL’objectif de cet article est de proposer une modélisation des interactions complexes entre développement et psychopathologie afin de conceptualiser l’impact des troubles cognitifs sur le développement psychologique et affectif de l’enfant et de l’adolescent. Dans cette optique, l’article se propose de présenter le paradigme théorique de la psychopathologie du développement,de montrer, par des exemples spécifiques, l’impactdes troubles cognitifs sur l’identité d’apprentissageet enfin, de proposer quelques considérations sur la façon dont ces notions nous aident à revisiter notre clinique avec les enfants qui présentent des troubles du développement cognitif.
Mots-clés• Psychopathologie• Développement• Troubles des apprentissages• Estime de soi
SummaryThe aim of this paper is to offer a model of the complex interaction beween development and psychopathology and to conceptualize the impact of cognitive disorders on the psychological and emotional development of the child. From this perspective, the article first introduces the theoretical paradigm of developmental psychopathology, then show, by specific examples,how cognitive disorders can impact the learning identity and finally offers some considerations on how these notions help us revise our clincal practice with children who suffers from disturbancesof the cognitive development.
Keywords• Psychopathology• Development,• Learning disorders• Self-esteem
Trajectoiresdéveloppementalesen psychopathologie :apprentissages et construction de soichez l’enfant et l’adolescent
Mario SPERANZAPédopsychiatre, PhD, HDR Service de Psychiatriede l’Enfant et de l’Adolescent. Centre Hospitalierde Versailles, Le Chesnay, France INSERM U669,Paris V - Paris XI
Giovanni VALERINeuropsychiatre d’enfants et d’adolescentsServizio di Neuropsichiatria Infantile.Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia
Introduction
La clinique des enfants qui présentent des troublesdes apprentissages nous confronte quotidienne-ment à la question de l’impact des troubles cogni-tifs sur la construction de la personnalité du sujet.Elle nous confronte également aux aléas des tra-jectoires psychopathologiques sur lesquelles s’en-gagent parfois ces enfants dans le temps. Ladifficulté de préciser ces trajectoires est la consé-quence directe de l’intrication complexe qui semet en place entre les facteurs impliqués dans ledéveloppement (facteurs cognitifs, affectifs etsociaux) et les interventions thérapeutiques pro-posées. Malgré la difficulté de cette démarche, ilapparaît essentiel d’essayer de modéliser cettecomplexité pour guider nos interventions théra-peutiques avec les enfants qui présentent des trou-bles des apprentissages. Cet article se propose deréfléchir sur la manière de modéliser la complexitédu développement et de la psychopathologie et deconceptualiser l’impact des troubles cognitifs surle développement psychologique et affectif del’enfant et de l’adolescent. Dans cette optique,l’article se propose plusieurs objectifs : d’abordde présenter le paradigme théorique de la psy-chopathologie du développement, paradigme quinous permet de modéliser les trajectoires dévelop-pementales de la psychopathologie ; secondaire-ment de décrire les facteurs en jeu dans ledéveloppement de la personnalité et montrer pardes exemples spécifiques, l’impact des troublescognitifs sur l’identité d’apprentissage; enfin, cetteréflexion se terminera avec quelques considéra-tions sur la façon dont ces notions nous aident àrevisiter notre clinique avec les enfants qui présen-tent des troubles du développement cognitif.
Psychopathologieet développement : un paradigme
théorique de la complexité
Par le terme de psychopathologie du développe-ment, nous faisons référence au paradigme théo-rique développé par Sir Michael Rutter et sescollègues (Sroufe & Rutter, 1984; Cicchetti, 1984;Perret et al., 2006) pour donner un cadre épisté-mologique aux études sur la psychopathologiede l’enfant et de l’adolescent. Il s’agit d’un para-digme qui se propose d’étudier les influencesréciproques entre développement et psychopa-thologie afin de définir, secondairement, descibles spécifiques des interventions préventiveset curatives. Selon ce paradigme, d’un côté, ledéveloppement influence l’expression clinique
de la psychopathologie (par la maturation biologi-que, le niveau cognitif ou les compétences sociales).De l’autre côté, les manifestations psychopatholo-giques interfèrent avec le développement par desmécanismes en cascade, fonction des phases dudéveloppement (par exemple, un trouble du déve-loppement du langage oral qui interfère avec l’ac-quisition des compétences sociales ou avecl’acquisition du langage écrit). Selon ce modèle,le développement procède par des allers-retourspermanents entre facteurs biologiques, psycholo-giques et environnementaux qui s’intègrent, àpartir des relations précoces, dans des systèmesinteractifs de régulation des cognitions, des émo-tions et des comportements. Le modèle de l’atta-chement est un exemple de ce type de systèmes derégulation qui organisent, par des schémas cogni-tifs et affectifs, la façon dont l’enfant appréhendeson environnement et construit de manière activeson développement le long des deux axes fonda-mentaux de la personnalité, l’axe de l’identité(avec l’accomplissement d’une identité différen-ciée et fondamentalement positive) et l’axe desrelations aux autres (avec le développement de lacapacité à établir des rapports interpersonnels sta-bles et caractérisés par la réciprocité). Ces systèmesde régulation développementaux fixent égalementles limites d’expression de la psychopathologie etcontribuent à dessiner les trajectoires développe-mentales de l’individu car ils influencent les moda-lités adaptatives ou maladaptatives adoptées par lesujet au cours du temps et, par conséquent, le pré-disposent ou le protègent de la psychopathologie(Speranza, 1993 ; Rutter & Sroufe, 2000). L’enjeuest de mettre en relation des manifestations clini-ques avec des évolutions psychopathologiquesparticulières pour aborder d’une manière intégréeet pluridimensionnelle la question du devenir cli-nique de la psychopathologie.
Les principesde la psychopathologie
du développement
Selon cette perspective épistémologique, il existeune série de principes qui règlent le développementet la psychopathologie et qui sous-tendent notrevision actuelle de la santé mentale de l’enfant(Sroufe & Rutter, 1984).
1) D’abord, la psychopathologie chez l’enfantémerge de l’interaction complexe, sur plusieursniveaux, entre les caractéristiques spécifiquesde l’enfant (qui incluent les facteurs biologiques,psychologiques et génétiques), celles de son
6 Développements / septembre 2010
M. SPERANZA, G. VALERI
environnement (qui inclut les parents, la fratrie,les relations familiales, les pairs, les facteurs d’en-vironnement, l’école et le contexte socioculturelélargi) et la manière spécifique avec laquelle cesfacteurs interagissent et se façonnent l’un l’autredurant le développement. Donc, la compréhensionde l’histoire et les expériences particulières d’unenfant (qui incluent les évènements biologiquesqui affectent le cerveau en développement) estessentielle pour arriver à comprendre les raisonsd’un comportement particulier d’un enfant, qu’ils’agisse d’un comportement normal ou déviant.
2) Si ce principe assume des continuités dévelop-pementales, dans la mesure où les expériencesprécoces s’inscrivent dans le comportement pré-sent, il est également important de considérer lesdiscontinuités développementales, là où des chan-gements qualitatifs se produisent dans les capaci-tés biologiques, psychologiques et sociales del’enfant. Ces discontinuités ne sont pas facile-ment identifiables à l’avance car elles peuvent êtrele reflet de l’émergence de nouvelles capacités (ouincapacités) au fur et à mesure que le soi, le cer-veau et l’environnement social de l’enfant sontsoumis à des réorganisations significatives.
3) Par ailleurs, l’enfant possède une tendanceinnée à s’adapter à son environnement. Il s’agitd’un principe d’adaptation qui intègre et reconnaîtles tendances à l’auto-ajustement et à l’auto-orga-nisation de l’enfant ; en particulier, un enfant àl’intérieur d’un contexte donné s’adapte de manièrenaturelle (dans la mesure du possible) à une nicheécologique particulière ou, si nécessaire, modi-fie cette niche pour faire en sorte de satisfaire sesbesoins. Dans des environnements très perturbésou pathologiques, les adaptations de l’enfant peu-vent aussi être pathologiques, en particulier quandon les compare aux comportements des enfants àl’intérieur de situations plus saines. Ce principesouligne que certains syndromes comportemen-taux pathologiques peuvent être mieux caractéri-sés comme des réponses adaptatives de l’enfant oude l’adolescent face à des circonstances difficilesou adverses. Il est à noter, que cette capacité às’adapter se reflète à des niveaux multiples, quiincluent le cerveau et les structures du système ner-veux (selon le principe de la neuroplasticité).
4) Ces considérations doivent tenir compte del’âge et des facteurs temporels. Par exemple, uncomportement normal à un âge (par exemple, lestress d’un petit enfant au moment de la séparationavec sa figure d’attachement) peut devenir un symp-tôme ou un indicateur important d’un trouble psy-chopathologique à un autre âge. De la mêmemanière, les stress ou les facteurs de risque peuvent
ne pas avoir d’impact, avoir un impact limité ouun impact majeur, en fonction de l’âge auquelils sont vécus et selon qu’ils apparaissent demanière isolée ou cumulés avec d’autres facteursde risque.
5) Bien évidemment, le contexte de l’enfant joueun rôle majeur et notamment, du fait de son impor-tance pour le développement de l’enfant, l’envi-ronnement d’attachement. Les recherches dans ledomaine humain comme chez les animaux ontdémontré que des ruptures majeures dans ce para-mètre critique ont des conséquences immédiateset à long terme, non seulement sur le développe-ment socio-émotionnel ultérieur du petit enfant,mais également sur le plan de la santé physique, dela morbidité et de la mortalité à long terme, sur lesmodalités ultérieures de la parentalité et mêmesur le plan du devenir comportemental des géné-rations suivantes. De plus, le contexte peut jouerun rôle dans la définition de ce qui constitue à unmoment donné la santé ou la psychopathologie. Lemême comportement dans un contexte ou dansune culture donnés peut être acceptable ou même« normal », alors qu’il peut être considéré comepathologique dans un autre contexte.
6) Enfin, il est essentiel de rappeler que les pro-cessus développementaux normaux ou déviantsse différencient souvent seulement en terme d’in-tensité et non de qualité. Donc, des différencesentre comportements normaux et pathologiquespeuvent être mieux comprises en tenant comptedes différences dans la sévérité d’un comporte-ment donné, ou dans l’intensité de l’exposition àun facteur de risque particulier. Souvent il estarbitraire d’établir des distinctions nettes entreles phénomènes observés.
L’application de ces principes développementauximplique plusieurs conséquences :– Ils offrent une recherche plus informée sur les
facteurs associés à l’apparition, au maintien età la disparition de formes déviantes de com-portement chez l’enfant.
– Ils nous aident à conceptualiser des tableauxdiagnostiques non statiques qui intègrent lacomplexité des comportements et des émo-tions d’un enfant en développement.
– Ils proposent une nouvelle perspective pourdévelopper des cibles potentielles d’intervention,centrées sur l’enfant, sur l’environnement ou surdes facteurs contextuels.
– Ils soulignent la question de la temporalité desinterventions: il existe des fenêtres d’opportunitéau cours du développement durant lesquellesdes interventions préventives ou curatives peu-vent avoir une efficacité particulière.
Développements / septembre 2010 7
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent
En termes cliniques, cette perspective se traduitpar l’identification de trajectoires développemen-tales qui permettent de modéliser la complexité.Comme évoqué récemment dans un article deRichard Tremblay sur les origines développemen-tales de l’agressivité chez l’enfant, la notion detrajectoires développementales a un long par-cours dans l’histoire des idées (Tremblay, 2010).Dans son essai Sur l’éducation Erasme (1529) écri-vait : « on ne pourra jamais mettre suffisammentl’accent sur l’importance des premières annéessur le parcours qu’un enfant suivra durant toutesa vie ». Ces trajectoires mettent en exergue lescontraintes qui s’installent au fur et à mesure dudéveloppement en fonction des événements devie de l’individu. Depuis quelques années, les psy-chopathologues du développement ont essayé dedécrire ces trajectoires développementales et d’étu-dier les différents facteurs qui interviennent dansleur modulation.
Un modèle du développementdu SoiCe type d’approche de la psychopathologie impli-que une modélisation du développement et des fac-teurs qui le construisent. Il s’agit d’intégrer, dansun modèle dynamique, les paramètres du dévelop-pement normal et pathologique et leur évolutiondans le temps en fonction de l’effet modulateur del’environnement. Cette intégration complexe descontinuités et des changements durant le dévelop-pement en un ensemble cohérent correspond, auniveau subjectif, à la construction de l’identité del’enfant, à ce qu’on appelle dans une terminologieactuelle le Self, le Soi, l’image que l’individu sefait de lui-même, de sa valeur, de ses capacités.La construction de l’identité est un processuscomplexe qui se met en place dès les premières éta-pes de la vie biologique et relationnelle, quandl’enfant prend peu à peu conscience de son exis-tence au travers de ses perceptions et de ses actionsdans l’interaction et le regard des autres, et avanttout dans la relation aux figures d’attachement. Dela même manière que l’enfant émerge et s’engagedans l’environnement social, il élargit aussi sarecherche et son expérimentation au monde phy-sique. Dans le monde matériel, l’enfant fait l’expé-rience de l’action, il observe, catalogue les effets.Le développement du fonctionnement cognitif, lamotricité, le langage, les capacités attentionnel-les et exécutives, offrent à l’enfant un laboratoireoù faire l’expérience des relations causales entre sesactions et les effets qu’elles produisent. A traversces expériences, l’enfant commence à acquérir unsentiment de maîtrise ou de compétence sur les
possibilités de son corps et sur les effets qu’il peutavoir sur les autres, sur les objets et sur les évène-ments. Avec ce sentiment émergeant de maîtrisesur l’environnement physique et dans l’intersub-jectivité, maintenu à travers la communication,l’enfant apprend comment avoir une influencesur le monde dans lequel il vit. C’est à la confluenceentre ces différents sentiments d’efficacité, avec lemonde extérieur des objets et avec le monde socialdes autres, qu’émerge le Soi de l’enfant. Un Soidont la cohérence est donnée par l’harmonie quis’établit entre les capacités à réguler les expérien-ces émotionnelles, la constitution d’un mondeinterne et externe de relations sociales stables etune organisation cognitive adéquate s’appuyant surdes outils de plus en plus performants : l’atten-tion, le langage, la mémoire, la motricité. Un Soiconstitué de plusieurs composantes (la dimen-sion de l’action, du corps, des affects, de la com-munication, de l’expérience subjective etintersubjective) dont l’enfant fait initialementl’expérience de manière directe à l’occasion del’action ou de l’utilisation des processus mentaux,sans en avoir une connaissance consciente quiviendra bien plus tard à travers la verbalisationexplicite et la capacité réflexive. Différentes com-posantes du Soi dont la perturbation spécifiquepeut produire des effets majeurs sur le fonction-nement du sujet dans la pathologie (Stern, 1985).L’image de soi que l’enfant se construit assure unefonction essentielle dans la dynamique qui sedéploie entre monde interne et monde extérieurde l’enfant. Mais comment cette construction s’or-ganise quand des troubles cognitifs viennent per-turber ce processus ?
Le modèle de l’estime de soi de HarterLe modèle de Harter (1999) est parmi les plusintéressants pour étudier les répercussions destroubles cognitifs sur le développement psycho-logique et affectif des enfants et des adolescents.Selon Harter, un élément essentiel dans le pro-cessus d’apprentissage est le sentiment de compé-tence. La perception de leur compétence de lapart des enfants affecte profondément leur intérêtpour une activité et les tentatives ultérieures demaîtrise qu’ils déploient. L’engagement ou l’évite-ment des activités d’apprentissage dépendentbeaucoup de cette perception. Comme l’évoqueMme Siaud-Facchin (2005), la jubilation cogni-tive éprouvée lorsqu’on réussit une action et larécompense narcissique obtenue sont des élé-ments essentiels dans la motivation à l’apprentis-sage. Les enfants qui présentent un trouble cognitif
8 Développements / septembre 2010
M. SPERANZA, G. VALERI
ou un trouble des apprentissages ont une appré-ciation négative de leur compétences dans ledomaine impliqué comme conséquence de l’échecrépété de leurs tentatives de maîtrise. Si ces enfantsévitent les activités en question, par peur de l’échecet de la critique des autres, alors les possibilitésd’améliorer leur compétence par l’entraînement etla participation sociale en seront par conséquentlimitées. Il est prévisible que cela aura de vastesrépercussions sur le développement de la percep-tion de soi de l’enfant bien au-delà du domaine spé-cifique impliqué (White, 1959). Harter a construitson modèle à partir des conceptions théoriques surle rôle des valeurs et des idéaux de l’individu surl’estime de soi de William James et sur les origi-nes prioritairement sociales de l’image de soi deCooley. Selon ce modèle, la valeur de soi, l’imagede soi de l’enfant se construit à l’intersection entrela perception de l’écart qui existe entre la com-pétence du sujet et ses idéaux et la perceptionque le sujet a du regard que les autres portent surses propres compétences. L’image de soi que l’en-fant construit ainsi conditionne profondément levécu émotionnel et la motivation à l’apprentis-sage et à l’interaction sociale de l’enfant.
L’impact psychologique des troubles des apprentissagessur le développement de l’enfantet de l’adolescent
Dyslexie et estime de soi
Parmi les différents troubles des apprentissages, ladyslexie est sans doute le domaine qui a fait l’ob-jet du plus grand nombre de travaux pour explo-rer l’impact psychologique des troubles desapprentissages sur le développement de l’enfant etde l’adolescent. La dyslexie, ou plus précisément,les troubles d’apprentissage de la langue écrite,se caractérisent par une automatisation inefficacede la lecture qui oblige l’enfant à une vigilanceconstante qui a des coûts élevés en termes de fati-gabilité et de pénibilité (Expertise collectif INSERMsur les troubles des apprentissages, 2007).L’association avec des difficultés attentionnellespeut dégrader ultérieurement les performancesavec une perception négative de l’activité de lec-ture et, de manière beaucoup plus générale, unrejet possible du savoir. Cependant, il existe dif-férentes modalités de réponse face aux difficultésposées par la dyslexie. On peut évoquer deuxmodalités principales de réponse: ceux qui restentdans le contrat scolaire et ceux qui le refusent.Dans le premier cas, la souffrance subjective est très
intense. Ces enfants, en effet, s’inscrivent dansl’objectif de la réussite scolaire, dans la compéti-tion, dans la culture et ils se rendent compte de leurhandicap malgré leur motivation. Le sentimentde responsabilité par rapport à l’échec domine.Une logique interne emprisonne l’enfant qui s’iden-tifie à son échec, le régularise, l’anticipe selon lemodèle de l’impuissance acquise. La dévalorisationet la démoralisation aboutissent souvent à unesouffrance anxieuse et dépressive et à une démo-bilisation ou à une incapacité à s’engager dansl’activité d’apprentissage qui prend la forme del’inhibition ou de la passivité.Pour les enfants qui refusent le contrat scolaire, lasouffrance est moins évidente et portée plutôt parl’environnement. Ces enfants peuvent adopterdes stratégies d’opposition passive, dont la len-teur est l’une des manifestations les plus crian-tes, mais ne sont pas forcément dans la rupture,plutôt dans la provocation comme réaction ausentiment d’incompréhension et de rejet ressentiet amplifié par les conflits autour du scolaire.Dans d’autres cas, c’est l’opposition active qui estau premier plan, le refus du système et des règlesavec l’apparition de troubles des conduites socia-les. Ces considérations psychopathologiques s’ap-puient sur deux modèles : le premier envisage queles troubles émotionnels et les troubles du com-portement associés aux difficultés d’apprentissa-ges seraient liés à l’échec scolaire progressif et labaisse de l’estime de soi (Chapman, 1988) ; ledeuxième avance l’hypothèse que les comporte-ments perturbateurs, en association avec les dif-ficultés d’attention, interfèrent avec l’acquisitionultérieure de compétences d’apprentissage(Trzesniewski et al., 1994).Mais quelle est la réalité scientifique de ces modè-les psychopathologiques intuitifs ? Si la littéra-ture rapporte que les sujets dyslexiques présententsignificativement plus de troubles émotionnelset comportementaux par rapport aux sujets contrô-les (Beitchman & Young, 1997), ces modèles sem-blent cependant simplistes car ils ne tiennent pascompte de facteurs médiateurs comme le sexe, lestade de développement ou la présence d’autresdiagnostics comme le trouble de déficit de l’at-tention avec/sans hyperactivité.
Conséquences émotionnelleset comportementales de la dyslexie :approche de recherche
L’étude de Willcutt et ses collègues (2000) illus-tre comment une approche développementalepeut complexifier des données psychologiquesintuitives. Dans l’étude qu’ils ont réalisée pour
Développements / septembre 2010 9
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent
explorer la fréquence de troubles émotionnels etdu comportement perturbateur dans une popula-tion d’enfants et adolescents dyslexiques, ils ontconstaté que si l’association était effectivementplus fréquente que prévue par le hasard, elle étaitconditionnée par la présence de l’hyperactivité etpar le sexe. La présence de troubles externalisésou de diagnostics de troubles oppositionnels etde troubles des conduites n’était pas réellementplus importante chez les dyslexiques par rapportaux sujets contrôles si on tenait compte de la pré-sence d’un trouble attentionnel associé (Willcuttet al., 2000). En revanche, les troubles émotion-nels (anxiété et dépression) étaient significative-ment associés à la dyslexie, mais exclusivementpour les filles, même en tenant compte des trou-bles attentionnels associés. D’autres études utili-sant une méthodologie longitudinale ont mis enévidence que la chronologie d’apparition des trou-bles émotionnels suit de 2-3 ans le diagnostic detroubles d’apprentissage de la langue écrite, cequi permet de faire l’hypothèse d’un lien de cau-salité possible entre dyslexie et troubles émotion-nels, qui pourrait être médiatisé par l’image desoi développée par l’enfant. Des revues récentes dela littérature sur l’image de soi des enfants dyslexi-ques (Mugnaini et al., 2009, Leonova et al., 2009)donnent cependant un tableau très composite dece lien. En résumé, ces études rapportent que sil’estime de soi est globalement plus faible chezles enfants dyslexiques par rapport aux sujetscontrôles, il existe plusieurs facteurs intermédiai-res dont il faut tenir compte. D’abord, les différen-ces en fonction des phases du développement. Ilexiste des périodes clés durant lesquelles lesenfants dyslexiques sont particulièrement à risquepour le développement de leur identité d’appren-tissage. Par identité d’apprentissage on fait réfé-rence à la manière qu’a l’enfant de se percevoircomme acteur du processus d’apprentissage dessavoirs académiques. L’estime de soi est particu-lièrement faible en primaire et en secondaire maiss’améliore globalement à l’adolescence en lienavec l’acceptation du trouble, l’adoption de stra-tégies de fonctionnement plus efficaces (commela compartimentation du handicap) et les orien-tations scolaires et professionnelles mieux adap-tées (Ingesson et al., 2007). Durant les premièresannées de scolarité, les enfants dyslexiques (sou-vent avant le diagnostic) ont tendance à ques-tionner leurs capacités intellectuelles et à sedémotiver en réaction à des difficultés inexpli-quées et à un sentiment d’impuissance (Palombo,2001, McNulty, 2003). En effet, les stratégiesd’adaptation jouent un rôle central. Les enfantsdyslexiques qui ont un locus de contrôle interne(qui considèrent que leurs performances dépendent
d’eux-mêmes) ont une meilleure perception deleurs compétences scolaires (Frederickson &Jacobs, 2001) et sont parmi ceux qui progressentle plus (Kistner et al., 1988). Le développement destratégies efficaces, qui implique l’acceptation etl’utilisation de compensations et d’aménagementsau niveau des apprentissages (Davenport, 1991),est d’ailleurs lié à la chronologie du diagnosticavec l’effet de soulagement et de compréhensionque celui-ci permet (Ingesson, 2007), d’autantplus que l’enfant profite d’un environnement fami-lial soutenant et informé (Al-Yagon, 2004). Les étu-des sur les dispositifs scolaires spécialisés ontd’ailleurs montré que les enfants dyslexiques n’ontpas une image de soi différente de celle des enfantscontrôles (Leonova et al., 2009). Probablementla présence d’effectifs réduits et d’enseignants spé-cialisés permet une approche plus individualiséeavec des soutiens appropriés aux besoins spécifi-ques et un ajustement des exigences en fonctionde la sévérité des troubles. La comparaison avecdes élèves qui présentent des problèmes similai-res réduit, par ailleurs, la perception négative descompétences et le risque de rejet social fréquentschez les enfants dyslexiques intégrés à l’école sansdispositifs spécifiques (Humphrey, 2002). Cesrésultats sont autant de pistes d’intervention pos-sibles pour réduire l’impact de la dyslexie sur ledéveloppement psychologique des enfants et desadolescents : la précocité du diagnostic, le travailsur l’identité d’apprentissage, l’accompagnementfamilial, les dispositifs d’aide spécifiques. Il fautcependant signaler que l’intérêt, par exemple, desdispositifs spécialisés n’est pas accepté par tous lesauteurs. Certains d’entre eux, au contraire, insis-tent sur la nécessité d’intégrer les mesures réédu-catives à l’intérieur du cursus normal (Zormanet al., 2004). Ces positions contradictoires sont pro-bablement liées à la différence des perspectivesadoptées par les auteurs en ce qui concerne lesparamètres d’évolution, plus centrés sur les aspectsd’apprentissages ou sur les dimensions psychopa-thologiques.
Troubles d’acquisition des coordinations, estime de soi et difficultés sociales chez l’enfant et l’adolescent
Le modèle de Harter (1999) fournit un cadre utileaussi pour étudier l’impact d’un trouble d’acqui-sition de la coordination sur le développementpsychosocial d’un enfant. Comme nous l’avonsdéjà évoqué, l’un des principaux mécanismes del’apprentissage est le sentiment de compétencequi conditionne l’engagement ultérieur dans les
10 Développements / septembre 2010
M. SPERANZA, G. VALERI
activités. Les enfants qui présentent une mau-vaise coordination sont susceptibles de se perce-voir comme faiblement compétents du fait de leuréchec répété à utiliser leurs habiletés motrices.Si ces enfants évitent les activités motrices, parpeur de l’échec et de la critique des pairs (d’autantplus qu’ils considèrent ces activités comme impor-tantes et valorisantes), alors les possibilités depratiquer leurs compétences et de participer socia-lement seront limitées. Il est prévisible que celaaura de vastes répercussions sur le développe-ment de la perception de soi de l’enfant bien au-delà du domaine du sport et affectera l’étatémotionnel et la motivation de l’enfant.Le modèle théorique de Harter a été utilisé, parexemple, comme référence pour explorer l’impactpsycho-social des troubles d’acquisition de la coor-dination par l’équipe de Skinner (Skinner & Piek,2001). Cette équipe a essayé d’explorer le rôle de laperception de compétence et le rôle du soutiensocial (les deux axes du modèle de Harter) sur l’es-time de soi et sur le vécu émotionnel d’enfants etd’adolescents avec un trouble d’acquisition de lacoordination. Ils ont réalisé une étude transversalesur un double échantillon d’enfants entre 8 et 10 anset d’adolescents entre 12 et 14 ans, pour étudierl’effet de l’âge sur l’estime de soi. Les sujets avec unTAC (diagnostiqués à l’aide de l’échelle M-ABC)ont rempli des questionnaires concernant la per-ception de leur compétences motrices et socialeset la perception de leur image de soi (Self-perceptionprofile, Harter, 1985), un questionnaire sur le sou-tien social (Social support scale, Harter & Robinson,1988) et des questionnaires concernant l’anxiété(State-trait anxiety inventory, STAI ; Spielberger,1983). Les résultats de cette étude montrent queles enfants avec un TAC ont globalement une mau-vaise perception de leurs compétences scolaires,sportives et sociales et une moins bonne estime desoi par rapport aux sujets de contrôle. Par ailleursil existe un effet d’âge, les adolescents avec un TACayant une moins bonne estime de soi que les enfantsavec un TAC. Cette perception négative de leurscompétences est corrélée à une image négative desoi, mais elle est également associée à une percep-tion négative du soutien social qu’ils pensent rece-voir de l’environnement avec une faible approbationde la part des autres et un faible soutien émotionnelainsi qu’instrumental. Ce sentiment de ne pas pou-voir compter sur l’environnement est plus marquéà l’adolescence que durant l’enfance. Les enfantsavec un TAC apparaissent également plus anxieuxque les sujets de contrôle avec une anxiété signifi-cativement plus marquée chez les adolescents(Skinner & Piek, 2001).Sur la base de ces résultats, il semble possible d’iden-tifier chez les enfants avec un TAC un cercle vicieux
qui s’auto-entretient mais qui peut égalements’amplifier avec le temps. Pour ne pas se confron-ter à une perception d’incapacité, les enfants avecun TAC ont tendance à éviter les situations quiimpliquent l’utilisation des compétences motri-ces, mais de cette manière ils limitent les expérien-ces qui pourraient leur permettre de développerultérieurement leurs capacités (Schoemaker et al.,1994). Ce cercle vicieux peut s’amplifier dans lamesure où la non-participation, si elle est associéeà des réactions négatives de la part des pairs, réduitégalement l’expérience sociale associée à ces activi-tés physiques et sportives avec les risques d’isolementsocial, d’évitement anxieux, de démoralisation oude repli dans l’imaginaire (si fréquent chez les enfantsavec un TAC, d’autant plus que le tableau s’associeà un trouble attentionnel), toutes stratégies de naturecompensatoire qui permettent à l’enfant de trou-ver une adaptation mais au prix d’une souffranceélevée. D’autre part, la faible implication dans desactivités d’échange avec les autres, réduit les com-pétences sociales des enfants avec un TAC et pro-duit un isolement qui est souvent entretenu par lerecours à l’imaginaire et à l’écart grandissant quise creuse entre les projets et les réalisations concrè-tes. Cette dimension de maladresse sociale, voirede vrai déficit dans les compétences sociales, com-mence à être mieux connue et documentée chezles enfants avec un TAC bien qu’elle fasse l’objetde questionnements théoriques complexes et setraduise par des errances diagnostiques prolongées.Plusieurs études ont confirmé ces dernières annéesles difficultés dans les compétences sociales consta-tées au niveau clinique chez les enfants avec unTAC. Il s’agit de difficultés qui concernent la pré-sentation et l’affirmation de soi, le monitoragesocial de l’action, la gestion des codes sociaux,les compétences conversationnelles et commu-nicationnelles, l’expression et la modulation desémotions (Chen & Chen, 2003). Bien que la sévé-rité de ces difficultés soit souvent moindre quedans le cas des troubles envahissants du dévelop-pement, la question d’une possible superpositionentre ces tableaux cliniques a été évoquée par cer-tains auteurs. C’est le cas, par exemple, deChristopher Gillberg, qui a fait l’hypothèse que cer-taines formes sévères de TAC s’intégreraient dansun cadre diagnostic plus élargi, les DAMP (Deficitin Attention, Motor control and Perception, DAMP,Gillberg et al., 1992) qui se situerait à l’intersec-tion entre Troubles des acquisitions des coordina-tions, Troubles de déficit de l’attention et Troublesenvahissants du développement et qui impliqueraitdans tous les cas des troubles de l’empathie. Leconcept de DAMP a depuis fait l’objet de nombreu-ses critiques méthodologiques en ce qui concernesa cohérence interne et sa validité discriminante
Développements / septembre 2010 11
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent
(Rydelius, 2000). Il garde cependant l’intérêt depointer des tableaux complexes associant plu-sieurs éléments cliniques, et dans lesquels la ques-tion des compétences sociales occupe une placeimportante dans l’évaluation des difficultés adap-tatives de l’enfant.Dans le cas spécifique des TAC, il est possible,par exemple, de questionner les liens qui pour-raient exister entre capacités empathiques et capa-cités à percevoir des indices visuels à l’intérieur descontextes interpersonnels. Les faibles capacitésvisuo-spatiales des enfants avec un TAC pour-raient, peut-être, interférer avec la construction descapacités empathiques de ces enfants. Dans uneétude comparative, par exemple, Cummins et sescollègues (2005), ont évalué les aspects verbauxet perceptifs des capacités empathiques d’un échan-tillon d’enfants avec un TAC et d’enfants contrô-les appariés en utilisant des échelles dereconnaissance et de compréhension des émo-tions. Ils ont observé de moins bonnes perfor-mances sur le plan des capacités empathiqueschez les enfants avec un TAC uniquement sur leséchelles qui mesurent les capacités de reconnais-sance des expressions faciales statiques et en chan-gement. Les résultats sur le plan des capacitésempathiques étaient par ailleurs inversement cor-rélés aux scores obtenus au niveau de l’organisa-tion visuo-spatiale. La nature transversale de cetteétude ne permet pas d’établir en lien de causa-lité, mais permet de faire l’hypothèse d’un lienentre compétences visuo-spatiales, compétencesempathiques et déficit du fonctionnement socialdes enfants avec un TAC qui va dans le sens du cer-cle vicieux évoqué plus haut entre faible percep-tion de compétence, évitement de l’engagement etlimitation des expériences développementalesnécessaires pour l’acquisition des compétences.Ce type de modèle permet également de voir com-ment un déficit dans un mécanisme cognitif plusou moins élémentaire peut avoir des répercus-sions en cascade sur un ensemble d’aspects dudéveloppement.
L’impact psychologique des troublesattentionnels avec hyperactivité chez l’enfant et l’adolescent
Pour terminer sur les exemples de l’impact psycho-logique possible des troubles cognitifs sur le dévelop-pement de l’enfant et de l’adolescent, il est intéressantde citer la question du déficit attentionnel et de l’hy-peractivité. Le TDAH est un trouble neurodévelop-pemental avec une étiologie mutifactorielle quiillustre bien la complexité et l’intrication entredéveloppement et psychopathologie. La littérature
actuelle sur le TDAH et sur ses conséquences àmoyen/long terme est très abondante et il est dif-ficile de la résumer en quelques éléments. La plu-part des études met cependant en évidence undevenir défavorable des enfants TDAH à l’adoles-cence ou à l’âge adulte, que ce soit sur le plan psy-chologique (faible estime de soi), psychiatrique(comorbidité élevée), relationnel (augmentationdes ruptures et des séparations), social (mauvaiseinsertion sociale), professionnel (moins bon niveau,changements répétés) ou légal (AVP, problèmesavec la justice) (Biederman et al., 1993 ; Barkley etal., 2006). Le devenir de ces enfants est probable-ment lié aux spécificités cliniques initiales du trou-ble. Mais il existe, dans la plupart de cas, desphénomènes importants de renforcement négatif quiconditionnent l’évolution du trouble dans le tempset des séquences longitudinales privilégiées. Burkeet ses collègues (2005), par exemple, ont suiviannuellement de manière longitudinale une cohortede 200 enfants TDAH de l’âge de 8 ans jusqu’à l’âgede 18 ans pour étudier, avec des modèles structu-raux, la chronologie d’apparition des troubles etles liens de causalité entre les différents troubles. Lesrésultats de cette étude ont montré deux élémentsimportants : le premier élément est qu’il existe uneforte continuité homotypique, c’est-à-dire que cha-que trouble a tendance à persister dans le temps.Mais dans le même temps, le deuxième élémentest qu’il existe également une continuité qu’onpeut définir comme hétérotypique, c’est-à-dire unecontinuité associée à un changement dans les moda-lités d’expression du trouble qui suit des séquencesdéveloppementales spécifiques selon une chrono-logie d’apparition particulière: les TDAH apparais-sent plus précocement que les autres troubles, quece soit les autres troubles perturbateurs ou les trou-bles émotionnels, et il prédisent spécifiquementl’apparition d’un trouble oppositionnel, qui lui, à sontour, prédit l’apparition d’un trouble des conduitesainsi qu’une symptomatologie anxieuse ou dépres-sive. Il existe également d’autres trajectoires déve-loppementales qui aboutissent, par des phénomènescumulatifs, à l’apparition d’une symptomatologieanxieuse et dépressive. C’est le cas, par exemple, del’association d’un TDAH avec un trouble des appren-tissages, sans nécessairement que cela implique laprésence d’un trouble oppositionnel. On retrouveici ce que nous avons déjà évoqué par rapport àl’évolution de la dyslexie. Mais ce qu’il est intéres-sant de souligner, c’est que dans ce type de modèlelongitudinal, il existe également d’autres trajectoi-res qui ne sont pas forcément possibles et qui néces-sitent la présence de facteurs de médiation (voirede protection) pour aboutir à un effet significatifcomme c’est le cas, par exemple, de la trajectoireentre troubles des conduites et dépression qui ne se
12 Développements / septembre 2010
M. SPERANZA, G. VALERI
réalise qu’en association avec un dysfonctionne-ment social et scolaire important (Burke et al.,2005).Bien que ces études soient passionnantes, la pers-pective d’observation est probablement encorebien trop macroscopique. Si ce type de modèlenous permet de visualiser des trajectoires, il nenous permet pas cependant d’analyser les mécanis-mes impliqués dans la transmission des effets. Il estnécessaire, pour ce faire, d’imaginer des modèlesplus élémentaires et de les inscrire dans des trajec-toires développementales qui tiennent compte desmodérateurs environnementaux autant que desadaptations personnelles. Par ailleurs, ces modè-les, bien qu’intéressants, restent statiques et nepermettent pas d’introduire la perspective dévelop-pementale. Si à partir de ces modèles nous essayonsd’introduire les modérateurs environnementauxet les adaptations personnelles, on peut commen-cer à avoir un aperçu plus pertinent des possiblestrajectoires développementales de ces enfants. Sion se focalise, par exemple, simplement sur ladimension exécutive du TDAH, dimension qui aété largement investiguée (Willcutt et al., 2005),nous pouvons constater qu’il existe en effet unedégradation des performances exécutives chez lesenfants TDAH (difficulté à soutenir son attention,à suivre les règles, à s’organiser). Ces performan-ces sont sollicitées de manière spécifique dans lecadre scolaire qui a tendance à réagir de manièrenégative face à l’échec. L’échec produit à son tourchez l’enfant une aversion et un évitement actifde ce type de tâches qui rappelle l’évitement dessituations d’incompétence du modèle de Harterévoqué pour les TAC. Cet évitement induit à sontour un cercle vicieux : chez certains enfants avecdes fragilités particulières, la réduction des occa-sions d’entraînement des compétences nécessairesau développement des performances exécutivesaboutit à une dégradation ultérieure des perfor-mances qui affecte profondément la motivationintrinsèque à s’y engager (Sonuga-Barke, 2005).Avec ce type de modèle plus complexe, on peutmieux visualiser comment, en fonction des profilsindividuels et des médiateurs environnementaux,l’adoption de comportements d’opposition ou l’ap-parition d’une anxiété de performance devant dessituations qui impliquent les compétences exécu-tives, peuvent aboutir avec le temps à une comor-bidité plus externalisée ou plus internalisée.
Le rôle du clinicien face à un trouble des apprentissages
Cette réflexion sur la complexité de la psycho-pathologie et sur les efforts pour la modéliser
peut paraître trop distante des préoccupationsquotidiennes des cliniciens qui sont confrontésaux enfants qui présentent des troubles desapprentissages. Mais il est essentiel de voir com-ment ces modèles théoriques peuvent enrichirl’approche clinique. En consultation, nous som-mes souvent confrontés à des familles frustrées,préoccupées, confuses, à un enfant démoralisé,opposant. Les différents interlocuteurs nouslivrent souvent de manière abrupte un ensemblede difficultés accompagnées de sentiments contra-dictoires. Ils nous montrent les blessures et lesconflits que ces difficultés ont produits dans letemps. Une tâche essentielle du clinicien estd’accueillir cette souffrance et d’offrir une formu-lation suffisamment claire de la situation demanière à ce que tous les interlocuteurs puis-sent prendre conscience des principaux élémentsen jeu. Il s’agit de présenter la perspective duclinicien sur la situation actuelle de l’enfant etfocaliser la consultation avec la famille sur lafaçon de comprendre, hiérarchiser et répondreaux principales questions qu’ils se posent parrapport aux troubles de l’enfant. Cette perspec-tive s’appuie autant sur les connaissances scien-tifiques (dont les trajectoires de lapsychopathologie qui informent sur les évolutionspossibles) que sur la manière dont ces connais-sances virtuelles se traduisent dans les situationscliniques spécifiques. L’expérience clinique mon-tre cependant que l’intensité émotionnelle de lasituation réduit la capacité de compréhensiondes personnes impliquées et suggère l’impor-tance d’accompagner attentivement les explica-tions diagnostiques et thérapeutiques. Certainsauteurs ont d’ailleurs proposé d’organiser lesformulations diagnostiques et les propositionsthérapeutiques par le biais de représentationsgraphiques qui offrent l‘avantage d’une compré-hension immédiate (Brown, 2005). Il s’agit devisualiser par des systèmes graphiques simplifiés(comme des diagrammes de Venn), les relationsentre les diagnostiques possibles, les hypothèsessur les mécanismes en jeu, les stratégies thérapeu-tiques envisagées en fonction des cibles identi-fiées et leur temporalité et les élémentsindividuels et environnementaux qui peuventreprésenter des leviers positifs ou des facteursd’inefficacité des thérapeutiques. L’objectif finalest avant tout de donner une représentation cohé-rente de l’enfant en développement à l’intérieurd’un contexte environnemental élargi. Il s’agitde construire un récit le plus proche possible del’expérience qui permette de donner un sens àl’expérience subjective de l’enfant. De ce point devue, l’approche clinique scientifique ne peutqu’être enrichie d’une perspective narrative qui
Développements / septembre 2010 13
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent
permet de construire le sens de l’histoire indivi-duelle. L’expérience montre que la discussionsur ces représentations graphiques permet demieux évaluer la compréhension des enjeuxdéveloppementaux, de renforcer l’alliance théra-peutique et de développer des plans thérapeuti-ques qui tiennent compte des réalités et desperspectives différentes des interlocuteurs. Enfonction de chaque situation les axes thérapeu-tiques pourront ainsi être définis autour d’uncertain nombre de principes tels que : le prin-cipe de spécificité (agir, si possible, sur les méca-nismes pathogéniques identifiés), le principe deparcimonie (intervenir sur le facteur qui a leplus de chance d’introduire en cascade des chan-gements positifs à plusieurs niveaux) ou le prin-cipe de sévérité (modifier le facteur qui produitle plus fort impact négatif sur le fonctionnementde l’enfant, bien qu’il puisse être éloigné desmécanismes pathogéniques supposés). Il est bienévident que la référence à ces différents princi-pes ne pourra qu’être dynamique et réévaluée
régulièrement en fonction de l’évolution de notrecompréhension de la situation dans le temps.
ConclusionsLa clinique des troubles cognitifs de l’enfant et del’adolescent nous oblige à conceptualiser la com-plexité et à intégrer des dimensions multiplesdans une perspective développementale qui s’ap-puie sur des trajectoires prévisibles et visualisa-bles. Dans l’optique de la psychopathologie dudéveloppement le pronostic est en effet le seulbanc d’essai du diagnostic. Il en découle que lechoix de nos actions thérapeutiques doit être,dans la mesure du possible, fonction des mécanis-mes pathogéniques identifiés, selon un timinginformé par les trajectoires du développement, enintégrant les facteurs d’environnement et la dimen-sion subjective. Sans oublier que l’intégrationd’un sentiment cohérent et cohésif de Soi est le butultime de toute intervention thérapeutique.
14 Développements / septembre 2010
M. SPERANZA, G. VALERI
RéférencesAl-Yagon, M. (2007). Socioemotional and Behavioral Adjustment Among School-Age Children With Learning
Disabilities. The Moderating Role of Maternal Personal Resources. J Spec Educ February, 40(4), 205-217.
Barkley, R.A., Fischer, M., Smallish, L., Fletcher, K. (2006). Young adult outcome of hyperactive children : adap-tive functioning in major life activities. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45, 192-202.
Beitchman, JH, Young, AR. (1997). Learning disorders with a special emphasis on reading disorders : a review ofthe past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(8),1020-1032.
Biederman, J., Faraone, S. V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, K. A., Mick, E., Lehman, B. K. & Doyle,A. (1993). Patterns of psychiatric comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with atten-tion deficit hyperactivity disorder. American Journal of Psychiatry, 150, 1792-1798.
Brown, TE. (2005). Circles inside squares : a graphic organizer to focus diagnostic formulations. J Am Acad ChildAdolesc Psychiatry, 44(12), 1309-1312.
Burke, JD, Loeber, R, Lahey, BB, Rathouz, PJ. (2005). Developmental transitions among affective and behavio-ral disorders in adolescent boys. J Child Psychol Psychiatry, 46(11), 1200-1210.
Chapman, J. W. (1988). Learning disabled children’s self-concepts. Review of Educational Research, 58(3), 347-371.
Chen, HF, Cohn, ES. (2003). Social participation for children with developmental coordination disorder : concep-tual, evaluation and intervention considerations. Phys Occup Ther Pediatr, 23(4), 61-78.
Cicchetti, D. (1984). The emergence of developmental psychopathology. Child Development, 55, 1-7.
Cummins A, Piek JP, Dyck MJ. (2005). Motor coordination, empathy, and social behaviour in school-aged chil-dren. Dev Med Child Neurol, 47(7), 437-442.
Davenport, L. (1991). Adaptation to dyslexia : acceptance of the diagnosis in relation to coping efforts and educatio-nal plans. Dissertation Abstracts International 52(3-B), ISSN 0419-4217.
Expertise collective (2007). Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie bilan des données scientifiques. Paris: Les éditions Inserm.
Frederickson, N., & Jacobs, S. (2001). Controllability attributions for academic performance and the perceivedscholastic competence, global self-worth and achievement of children with dyslexia. School PsychologyInternational, 22, 401-416.
Gillberg C., Gillberg IC., Steffenburg S. (1992). Siblings and parents of children with autism : a controlled popu-lation-based study. Dev Med Child Neurol, 34(5), 389-98.
Harter S. (1999). The construction of the self : A developmental perspective. New York : The Guilford publications.
Harter, S. (1985). Manual for the self-perception profile for children : revision of the perceived competence scale for chil-dren. Denver, CO : University of Denver.
Harter, S., Robinson, N. (1985). The social support scale for older children and adolescents (Revised). Approval, emo-tional and instrumental support. Denver, CO : University of Denver.
Humphrey, N. (2002). Teacher and pupil ratings of self-esteem in developmental dyslexia. British Journal ofSpecial Education, 29, 29-36.
Ingesson, S.G. (2007). Growing up with dyslexia. School Psychology International, 28(5), 574–591.
Kistner, J., Osbourne, M., & Le Verrier, L. (1988). Causal attributions of learning disabled progress. Journal ofEducational Psychology 1988, 80, 82-89.
Leonova, T., Grilo, G. (2009). La faible estime de soi des élèves dyslexiques : mythe ou réalité ? L’année psycho-logique, 109, 431-462.
McNulty, M.A. (2003). Dyslexia and the life course. J Learn Disabil, 36(4), 363-381.
Mugnaini, D, Lassi, S, La Malfa, G, Albertini, G. (2009). Internalizing correlates of dyslexia. World J Pediatr,5(4), 255-264.
Palombo, J. (2001). Learning disorders and disorders of the self in children and adolescents. New York : Norton.
Perret, P., Faure, S. (2006). Les fondements de la psychopathologie développementale. Enfance, 58(4), 317-333.
Rutter, M., Sroufe, L.A. (2000). Developmental psychopathology : Concepts and challenges. Development andPsychopathology, 12, 265-296.
Rydelius, P.A. (2000). DAMP and MBD versus AD/HD and hyperkinetic disorders. Acta Paediatr, 89(3), 266-268.
Schoemaker, M.M., Hijlkema, M.G.J. & Kalverboer, A.F. (1994). Physiotherapy for clumsy children : An evalua-tion study. Developmental Medicine and Child Neurology, 36, 143-155.
Siaud-Facchin, J. (2005). Trouble des apprentissages scolaires? Enfants surdoués? Quels liens? A.N.A.E., 81, 7-15.
Skinner, R.A., Piek, J.-P. (2001). Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adoles-cents. Hum Mov Sci, 20(1-2), 73-94.
Sonuga-Barke, E.J. (2003). The dual pathway model of AD/HD : an elaboration of neuro-developmental charac-teristics. Neurosci Biobehav Rev, 27(7), 593-604.
Speranza, M. (1993). Considerazioni teoriche sulla psicopatologia dello sviluppo : un nuovo paradigma in psi-chiatria infantile. Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 60, 209-226.
Spielberger, C.D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y). Palo Alto, CA : ConsultingPsychologists Press.
Sroufe, L.A., Rutter, M. (1984). The domain of developmental psychopathology. Child Development, 55, 17-29.
Stern D. (1989). Le monde interpersonnel du nourrisson, Paris : PUF.
Tremblay, R.E. (2010). Developmental origins of disruptive behaviour problems : the « original sin » hypothesis,epigenetics and their consequences for prevention. J Child Psychol Psychiatry, 51(4), 341-367.
Trzesniewski, K.H., Moffitt, T.E., Caspi, A., Taylor, A., Maughan, B. (2006). Revisiting the association betweenreading achievement and antisocial behavior : new evidence of an environmental explanation from a twin study.Child Dev, 77(1), 72-88.
White, W. (1959). Motivation reconsidered : the concept of competence. Psychol Review, 66, 297-333.
Willcutt, E.G., Doyle A.E., Nigg J.T., Faraone S.V., Pennington B.F. (2005). Validity of the executive functiontheory of attention-deficit/hyperactivity disorder : a meta-analytic review. Biol Psychiatry, 57(11), 1336-1346.
Willcutt, E.G., Pennington B.F. (2000). Comorbidity of reading disability and attention-deficit/hyperactivitydisorder : differences by gender and subtype. J Learn Disabil, 33(2), 179-191.
Zorman, M., Lequette, C. & Pouget, G. (2004). Dyslexies : intérêt d’un dépistage et d’une prise en charge précoceà l’école. Évaluation du BSEDS 5-6. In: M.N. Metz-Lutz, E. Demont, C. Seegmuller, M. De Agostini, & N. Bruneau(Eds.), Développement cognitif et troubles des apprentissages (pp. 245-270). Marseille : Solal.
Développements / septembre 2010 15
Trajectoires développementales en psychopathologie : apprentissages et construction de soi chez l’enfant et l’adolescent