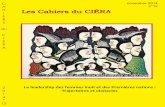Sailing through Suez from the South: The Emergence of an Indies-Dutch Migration Circuit, 1815?1940
Les trajectoires mémorielles du maréchal Michel Ney, 1815 ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Les trajectoires mémorielles du maréchal Michel Ney, 1815 ...
© Julien Renaud-Belleville, 2020
Traître, martyr, héros: Les trajectoires mémorielles du maréchal Michel Ney, 1815-1848
Mémoire
Julien Renaud-Belleville
Maîtrise en histoire - avec mémoire
Maître ès arts (M.A.)
Québec, Canada
Traître, martyr, héros : Les trajectoires mémorielles du maréchal Michel Ney, 1815-1848
Mémoire de maîtrise
Julien Renaud-Belleville
Sous la direction de :
Pierre Yves Saunier
ii
Résumé
Après la chute de Napoléon à Waterloo en 1815, le roi Louis XVIII reprend les rênes d’une
France affligée de profondes divisions sociales et politiques. La volonté du nouveau roi de réconcilier
la France se heurte aux velléités des ultraroyalistes qui rêvent d’un retour à l’Ancien Régime, et d’un
royaume épuré de ses éléments républicains et bonapartistes. Dans ce contexte, le maréchal Ney
devient une cible pour les ultraroyalistes : ayant montré des signes de loyauté au roi en 1814, Ney
trahit sa parole et rejoint Napoléon lors des Cent-Jours. Accusé de haute trahison, ce maréchal célébré
sous l’Empire est exécuté publiquement le 7 décembre 1815 à Paris, Place de l’Observatoire. Ce
mémoire est une enquête parisienne sur la commémoration du maréchal Ney sous les monarchies
censitaires (1815-1848). D’une part, la notion de « commémoration » inclut tant des actions politiques
dans l’espace public, que la littérature ou les arts. D’autre part, la trajectoire mémorielle est un moyen
d’analyser de quelle(s) manière(s) les Parisiens s’appropriaient la figure du maréchal Ney. La
trajectoire mémorielle de Ney se manifeste sous trois figures qui sont étudiées dans les différents
chapitres du mémoire : le traître, la victime/martyr, le héros. Chacune répond aux inquiétudes, espoirs
et projets de différents groupes, et se développe selon une temporalité particulière. En fin de compte,
c’est la figure du héros qui s’impose par-dessus les autres, et qui aujourd’hui encore est présente sur
la scène publique en France.
iii
Abstract
After the fall of Napoleon in Waterloo in 1815, King Louis XVIII takes up the reins of a France
plagued by a deep social and political divide. The new king’s eagerness to reconcile France faces the
inclinations of the Ultra-Royalists who dream of a return to the Ancien Régime on the one hand, and a
Kingdom cleared of its Republican and Bonapartist components on the other. In this setting, Marshal
Ney becomes a target for the Ultra-Royalists: having shown signs of loyalty to the King in 1814, Ney
breaks his word and joins Napoleon during the Cent-Jours. Accused of high treason, the Marshal, once
celebrated under the Empire, is publicly executed on 7 December 1815 at Place de l’Observatoire, in
Paris. This memoir is a Parisian enquiry on commemoration of Marshal Ney under census suffrage
monarchies (1815-48). On the one hand, the notion of commemoration includes political action in the
public space as well as in literature or the arts. On the other, analyzing the commemorative patterns is
a means of assessing the way(s) in which Parisians appropriated the figure of Marshal Ney. These
patterns reveal three main figures, which will be studied in the different chapters of this memoir: the
traitor, the victim/martyr, the hero. Each echoes the concerns, hopes and projects of various groups,
and evolves according to particular temporalities. In the end, it is the figure of the hero that prevails
over the former, and that is still the case today in the public sphere in France.
iv
Table des matières
Résumé ............................................................................................................................................... ii
Abstract ............................................................................................................................................. iii
Table des matières ............................................................................................................................ iv
Liste des figures ............................................................................................................................... vi
Remerciements ............................................................................................................................... viii
Introduction ........................................................................................................................................ 1
Notions ............................................................................................................................................. 4
Sources ............................................................................................................................................ 9
Méthode et analyse des sources ................................................................................................... 13
Chapitre 1 : Le traître ....................................................................................................................... 17
1814 et 1815 : réconciliation et radicalisation ................................................................................ 19
Commémoration et symboles : des signes de division............................................................... 22
Après les Cent-Jours ................................................................................................................. 24
Ney en procès : du brave au traître ................................................................................................ 28
Un militaire sans honneur .......................................................................................................... 30
Ney et le complot bonapartiste ................................................................................................... 33
Surveiller un condamné ................................................................................................................. 36
L’impossible dissimulation d’un cadavre .................................................................................... 40
Chapitre 2 : La victime et le martyr ................................................................................................ 47
Ney dans l’espace public parisien .................................................................................................. 51
Autour du procès et de l’exécution ............................................................................................. 51
Ney au café ................................................................................................................................ 54
Représentations de la victime, représentations pour la victime ..................................................... 60
Le spectre de Michel Ney........................................................................................................... 61
L’honneur d’un maréchal ........................................................................................................... 69
L’affaire des Nouveautés: Ney au théâtre ...................................................................................... 72
Le théâtre et la censure ............................................................................................................. 75
Chronique d’une interdiction théâtrale ....................................................................................... 76
Des planches à la rue ................................................................................................................ 79
Chapitre 3 : Le héros ....................................................................................................................... 84
v
Les derniers souffles du maréchal, en trois actes .......................................................................... 87
« Jusqu’ici ma défense me parut libre […] » .............................................................................. 88
L’attente ..................................................................................................................................... 91
« Voici une vilaine journée! » ..................................................................................................... 93
De l’infatigable au Brave des braves .............................................................................................. 96
Nommer le héros ....................................................................................................................... 98
L’effet Waterloo ........................................................................................................................ 101
Le héros en action ....................................................................................................................... 104
Ney et les Bulletins de la Grande Armée ................................................................................. 106
L’épreuve russe ....................................................................................................................... 109
« Venez-voir comment meurt un maréchal de France! » ......................................................... 114
Conclusion ..................................................................................................................................... 120
Bibliographie .................................................................................................................................. 125
vi
Liste des figures
Figure 1: Le tombeau du maréchal Ney en 1815 .............................................................................................. 42
Figure 2: Caveau du maréchal Ney en 1816 .................................................................................................... 44
Figure 3: Localisation de la tombe du maréchal Ney au cimetière du Père-Lachaise ...................................... 45
Figure 4: Le 7 décembre 1815 .......................................................................................................................... 61
Figure 5: Le Maréchal Ney étendu sur un brancard, ayant à ses côtés une sœur de charité en prières .......... 62
Figure 6: Assassinat juridique du Maréchal Ney ............................................................................................... 62
Figure 7: The execution of the sentence on Marshal Ney, in the garden of the Luxemburg at Paris ................ 63
Figure 8: Double-pièce circulaire ...................................................................................................................... 64
Figure 9: Médaille représentant le maréchal Ney ............................................................................................. 65
Figure 10: Statue d'Armand Carrel ................................................................................................................... 68
Figure 11: Le Fantôme...................................................................................................................................... 69
Figure 12: Le maréchal Ney s’emparant du pont sur le Danube lors de la bataille d’Elchingen ..................... 108
Figure 13: Le maréchal à la redoute de Kovno [Kowno] ................................................................................. 112
viii
Remerciements
Je veux remercier en premier lieu mon directeur de maîtrise, M. Pierre Yves Saunier, d’avoir
accepté la direction de ce projet de maîtrise, et d’avoir cru en moi au cours de ces 4 dernières années.
Sans son aide, ses conseils, ainsi que sa patience, jamais ce travail n’aurait pu prendre forme. Je
souhaite aussi remercier les Archives Nationales de France pour leur accueil et leur serviabilité au
cours de mes recherches en archives.
Je souhaite aussi remercier mes collègues du département des sciences historiques de
l’Université Laval pour leur écoute et leurs conseils. J’aimerai nommer particulièrement ceux qui sont
le plus proches de moi, et qui m’ont quotidiennement encouragé : Vincent Larose Picher, Antoine
Pageau-Saint-Hilaire et Gabriel Côté. De plus, mon attention se porte vers Lulie Igonène Hénault qui
m’a soutenu chaque jour depuis près de 4 ans. Je remercie mon père et ma mère d’avoir toujours cru
en mes capacités d’accomplir un mémoire de maîtrise.
1
Introduction
L’exécution du maréchal Ney, le 7 décembre 1815, offre l’opportunité de (re)visiter un XIXe
siècle aux multiples facettes. Dans leur ouvrage La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe
siècle français, Emmanuel Fureix et François Jarrige nomment certaines de ces facettes qui ont
caractérisé ce siècle : « Siècle des révolutions » ou « siècle de la bourgeoisie », « siècle du progrès »
ou « stupide XIXe siècle »1. Selon les deux auteurs, la difficulté de définir le XIXe siècle s’explique par
la présence « […] de bouleversements profonds, discontinus, inégalement perçus et vécus […] »2.
Dominique Kalifa, dans un court article, a proposé trois points de convergence pour l’histoire de ce
siècle touffu : « 1) La confusion comme point de départ; 2) La politique comme espérance; 3) La
marchandise comme horizon »3.
À l’intérieur de ce XIXe siècle « multiple », nous nous concentrerons sur le deuxième point de
Dominique Kalifa, soit un siècle éminemment politique. Nos balises chronologiques traversent trois
règnes (Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe), et deux régimes, la monarchie bourbonienne
restaurée (1815-1830) et la monarchie de Juillet (1830-1848), communément appelés monarchies
censitaires. Parallèlement à la construction et la chute de ces régimes monarchiques, la Révolution et
l’Empire sont présents en arrière-plan, comme un objet de désir, de nostalgie ou de haine. Dans la
période qui nous intéresse, l’invocation de l’empire napoléonien permet autant aux monarchies
censitaires qu’aux individus de s’appuyer sur celui-ci pour se projeter politiquement et socialement. Le
souvenir de Napoléon et de son Empire est bien présent dans les choix et les débats politiques pendant
les monarchies censitaires.
Dans ces souvenirs napoléoniens, Michel Ney (1769-1815) se démarque. Né à Sarrelouis en
Lorraine, il rejoint en 1787 le 4e régiment de hussards, à l’âge de 18 ans. Sous-officier aux débuts de
la Révolution, le jeune Ney grimpe rapidement les échelons militaires et est promu général de division
en 1799. Bien qu’il serve sous les ordres du général Moreau quelque temps en Allemagne, Ney se
rallie à Napoléon Bonaparte lors de son coup d’État du 18 Brumaire. À la proclamation de l’Empire en
1804, le général Ney occupe la 12e place dans la liste de promotion au grade de maréchal d’Empire.
Devenu maréchal Ney, il participe à toutes les campagnes militaires de la Grande Armée. Au cours de
1 Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchanté¸ Paris, Éditions de la Découverte, 2015, p. 7. 2 Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchanté, 2015, p. 7. 3 Dominique Kalifa, « Que reste-t-il du XIXe siècle? », Revue d’histoire du XIXe siècle, No. 47, 2013, pp. 13-14.
2
celles-ci, il reçoit les titres de duc d’Elchingen après la campagne d’Allemagne de 1805 et de prince
de la Moskowa après la campagne de Russie de 1812. Bien que déjà reconnu comme un militaire
d’exception au moment des guerres révolutionnaires, les guerres impériales assoient son prestige
militaire.
La prise de Paris par les armées prussiennes et russes, le 31 mars 1814, force Napoléon à
abdiquer. Ses maréchaux, et Ney au premier plan, jouent un rôle important dans cette abdication
puisqu’ils ne se déclarent pas en faveur d’une continuation du combat contre les coalisés européens.
Suivant le départ de Napoléon vers l’île d’Elbe, Ney et plusieurs autres maréchaux prêtent allégeance
au roi Louis XVIII qui fait son entrée à Paris le 24 avril 1814. Pour asseoir son pouvoir et pour s’assurer
de la loyauté des maréchaux de l’Empire, le nouveau souverain les récompense: en juin, Ney est
nommé commandant en chef de la cavalerie et Pair de France. Ennuyé par la vie de cour, Ney se retire
dans ses terres de Coudreaux, dans le département d’Eure-et-Loir. Lorsque Napoléon débarque en
France le 1e mars 1815, Ney va revenir sur la scène. Appelé à prendre un commandement, il se rend
d’abord à Paris et obtient une audience avec Louis XVIII le 7 mars 1815. Le roi le charge de freiner
l’avancée de « l’Usurpateur » et de protéger son trône. En réponse, Ney répond au roi qu’il
voulait : « […] ramener Buonaparte dans une cage de fer […] »4. Ney aurait plutôt dit qu’il souhaitait
voir Napoléon ramené dans une cage de fer à Paris5. Néanmoins, cet élan de loyauté est la preuve de
sa duplicité pour les accusateurs. Le 14 mars, à Lons-le-Saulnier, Ney fait la lecture d’une
proclamation dans laquelle il appelle les troupes placées sous son commandement à rallier Napoléon :
« La cause des Bourbons est à jamais perdue. […] C’est à l’empereur Napoléon, notre souverain, qu’il
appartient de régner sur notre beau pays »6. Ce revirement ne sera pas oublié par l’autorité royale.
Après la déroute de Waterloo du 15 août, à l’issue d’une campagne où Ney a rallié l’armée de
l’Empereur le 15 juin pour prendre la tête d’un corps d’armée trois jours avant la bataille, il est arrêté
le 3 août 1815 au château de Bessonis dans le Lot et traduit devant un conseil de guerre qui doit
décider son sort. Composé d’anciens compagnons d’armes, ce conseil se déclare incompétent, et c’est
la Chambre des pairs qui est chargée de mener un procès. Ce procès a lieu du 13 novembre au 6
décembre 1815, et se termine par un jugement de culpabilité pour haute trahison. Le 7 décembre au
4 Procès du maréchal Ney, Tome 4, Paris, L. G. Michaud, 1815, p. 44. 5 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1815, Paris E. Plon, Nourrit et Cie, 1893, p. 138. 6 Procès du maréchal Ney, Tome 1, Paris, L. G. Michaud, 1815, p. 29.
3
matin, le maréchal Ney est fusillé par un peloton de 12 soldats à l’Observatoire, à proximité du Palais
du Luxembourg où il avait été jugé et emprisonné.
La capitale française est l’endroit privilégié pour notre enquête. C’est là que le procès et
l’exécution ont lieu, c’est là aussi après sa mort que nous voulons continuer de tracer l’existence d’un
Ney posthume dans les gestes, les propos, les écrits. Dans la première moitié du XIXe siècle, Paris
joue un rôle majeur sur la vie politique et sociale française7. La cité est le cœur politique et économique
de la France. Selon un ingénieur en chef du cadastre, Victor de Moléon, Paris devient après l’Empire
le véritable entrepôt de la France. Il ajoute que : « […] cette ville de luxe, de calme et de plaisirs est
devenue laborieuse et agitée »8. Cette crainte est largement répandue à l’intérieur de cercles bourgeois
et aristocrates. Maurizio Gribaudi décrit bien le discours d’hygiénistes, de techniciens sanitaires et des
administrations locales qui stigmatisent les couches populaires parisiennes. Selon l’auteur, cette vision
occulte la réalité du Paris populaire et ouvrier qui, dans cette première moitié du XIXe siècle, vit une
réelle « montée du politique »9. Comme nous allons l’observer tout au long de ce mémoire, cette
montée du politique ne touche pas uniquement les classes populaires parisiennes, mais bien un large
éventail de groupes sociaux. Des ultraroyalistes, aux républicains, en passant par les bonapartistes,
l’action politique s’inscrit dans l’espace public parisien.
Pour notre mémoire, cette politisation parisienne est la porte d’entrée pour étudier la place et
la trajectoire de l’évocation du maréchal Ney entre 1815 et 1848. Dans le contexte de cette « montée
du politique », nous cherchons à savoir si et comment cette évocation a été utilisée à des fins de
mobilisation politique ou sociale, et par qui, et de souligner les conditions, objectifs et limites de cette
utilisation. Pour cela, nous nous appuyons sur quelques notions et propositions mises en place par les
travaux historiens concernant la première moitié du XIXe siècle.
7 Francis Démier, La France de la Restauration (1814-1830), Paris, Éditions Gallimard, Coll. Folio histoire inédit, 2012, p. 352. 8 Victor de Moléon, Rapports généraux du conseil de salubrité de la ville de Paris et du département de la Seine, Tome 1, Paris, Au bureau du recueil industriel, 1828, p. 100. 9 Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée, 1789-1848, Paris, Éditions La Découverte, 2014, p. 243.
4
Notions
Politisation et commémoration
La politisation de l’espace public et des individus est un point de départ pour notre recherche.
Cette notion permet de saisir le développement et le fonctionnement de la vie politique sous les
monarchies censitaires. Deux éléments peuvent être distingués : la politisation « formelle » et celle
« informelle ». Le premier élément capture les voies institutionnelles de la politisation. Les auteurs de
La modernité désenchantée définissent le côté formel de la politisation comme : « […] l’acquisition par
le citoyen de compétences lui permettant de se forger une opinion politique, par le vote et l’intégration
des grands partages partisans et idéologiques »10. Toujours selon les mêmes auteurs, l’autre pan de
la politisation, le pan informel, se caractérise par : « […] l’apprentissage pratique du politique, par le
bas, notamment par la revendication de justice et de dignité et par toute une gamme de pratiques
protestataires […] »11. Si la pratique dite formelle de la politique est la relation des individus avec les
institutions légitimes du pouvoir, les pratiques informelles jouent à l’extérieur de cette légitimité. Fureix
et Jarrige présentent ces gestes comme le fait de s’insérer dans le jeu politique « […] sans y avoir été
invité »12. Dans l’introduction de 1830. Le peuple de Paris. Révolution et représentations sociales,
Nathalie Jakobowicz décrit elle aussi ce processus comme : « Des exhibitions ou des mises en scène
de soi (ou de l’autre), par lesquelles les individus et les groupes se signifient socialement,
politiquement, symboliquement […] »13.
Si l’on resserre le concept de politisation autour du moment des monarchies censitaires et de
l’espace public parisien, les gestes qualifiés de formels ou d’informels se précisent. Dans son ouvrage,
Maurizio Gribaudi cible le développement d’une sociabilité ouvrière comme une pierre angulaire de la
« montée du politique » au cours de notre période historique. Cette sociabilité, informelle, s’appuie
notamment sur l’oral et « […] mille échanges qui se jouent dans l’espace […] articulé entre les garnis
et les chambres meublées, les ateliers et les fabriques, les passages et les cours, les rues et les places
des quartiers populaires »14. Ces gestes et paroles aident ceux qui les pratiquent à « […] nommer des
10 Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchanté¸ 2015, p. 234. 11 Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchanté¸ 2015, p. 233-234. 12 Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchanté¸ 2015, p. 232. 13 Nathalie Jakobowicz, 1830. Le peuple de Paris. Révolution et représentations sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 13. 14 Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière, 2014, p. 245.
5
sentiments peut-être à peine ébauchés, mais bien présents et souvent traduits dans les nombreuses
tensions qui traversent […] l’espace public »15.
Notre préoccupation de suivre les formes de politisation qui se développent autour de
l’invocation du maréchal Ney nous a amenés à placer au centre de notre réflexion certaines des formes
spécifiques de la politisation informelle. En premier lieu, la politisation du deuil qui se développe de
façon inédite à partir de la Première restauration. Emmanuel Fureix dans La France des larmes. Deuils
politiques à l’âge romantique (1814-1840) précise bien que les deuils d’un certain nombre de
personnages de l’opposition politique ne sont plus simplement ancrés dans la sphère privée des
défunts et deviennent progressivement « […] l’indice parmi d’autres d’un nouveau répertoire d’action
en gestation, et de formes de politisation inédites dans la capitale »16. Ces funérailles qui commémorent
de célèbres figures d’oppositions politiques dites « libérales » fusionnent en quelque sorte plusieurs
rituels funéraires : « défilés en corps, deuil ostentatoire, éloges mués en discours politiques, slogans
au seuil du cri séditieux, souscription nationale pour ériger un tombeau au défunt »17. Il va de soi que
l’ampleur de ces cortèges varie sensiblement selon la notoriété du personnage célébré et de son
importance sociale et politique. Ce nouveau répertoire permet aux élites politiques d’occuper l’espace
public parisien, alors que pour les classes populaires, ces deuils deviennent un moyen de s’exprimer
en dehors des modalités de la politique formelle18. Le phénomène commence sous la Restauration, et
pendant la monarchie de Juillet, ces cortèges funéraires d’oppositions continuent à prendre la rue et à
s’exprimer politiquement. Cependant, ils épousent alors davantage les nouvelles logiques politiques
qui incluent beaucoup plus d’acteurs comme les étudiants, les ouvriers ou les républicains. La
spécificité de cette période est la plus grande politisation des enterrements d’oppositions : lors des
funérailles du général Lamarque on parle même de « manifestation politique »19.
Ces funérailles d’oppositions politiques, rappelons-le, constituent également une extension de
la vie parlementaire des monarchies censitaires. Emmanuel Fureix cible une autre forme de
commémoration qui se développe de façon souterraine, à l’abri des grands cortèges funèbres qui
15 Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière, 2014, p. 248. 16 Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Paris, Champ Vallon, 2009, p. 323. 17 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 323. 18 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 323. 19 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 379.
6
sillonnent Paris : le « culte des vaincus »20. Ce culte est voué aux victimes de la répression
monarchique vis-à-vis des individus accusés de trahison, d’attentat ou d’insurrection. Puisque le
maréchal Ney est exécuté par jugement royal, notre attention est retenue par les logiques et les
modalités de ce « culte des vaincus ». La principale caractéristique des cultes souterrains est de
combattre l’effacement de la mémoire d’un condamné politique. Plutôt que de se manifester dans de
grands cortèges dans l’espace public, les individus utilisent des gestes plus modestes, plus
discrets : « pèlerinages clandestins sur la tombe, dépôts de couronnes, commémorations
interdites »21.
La notion de « culte des vaincus » nous permet par ailleurs d’introduire le rôle des autorités
des monarchies censitaires. Le développement de ce culte est indissociable du rituel de l’État autour
des exécutions politiques. Que ce soit lors de la Restauration ou de la monarchie de Juillet, l’objectif
de l’État envers la mémoire d’un condamné politique est le même : effacer ses traces de l’espace
public22. Nous avons appliqué cette grille présentée par Emmanuel Fureix à la situation du maréchal
Ney. Nous avons donc cherché les possibles actions commémoratives perpétrées en rappel à la
condamnation du maréchal Ney, dans les lieux de sociabilité politique, dans les formes discursives,
dans les images, dans les gestes posés à travers l’espace public parisien. Et comme l’un ne va pas
sans l’autre, nous avons analysé les moyens éventuellement mis en œuvre par l’État pour freiner,
contrôler ces possibles gestes subversifs, ou plus radicalement pour les empêcher en effaçant les
traces de Ney dans l’espace public afin d’éviter la mise en place d’un culte des vaincus. Évidemment,
les efforts de l’État d’éliminer toutes traces mémorielles rencontrent leurs limites : ici et là, des gestes
subversifs viennent contrecarrer les tentatives répressives de l’État.
Légende napoléonienne
Pour mener cette étude des trajectoires de l’invocation du maréchal Ney entre 1815 et 1848,
ce sont les travaux menés autour de la légende napoléonienne qu’il nous faut convoquer. Les
monarchies censitaires évoluent dans un contexte dans lequel, bien malgré elles, pour la Restauration,
ou d’une façon qu’elles tentent de canaliser pour la monarchie de Juillet, Napoléon reste présent dans
l’esprit collectif des Parisiens. Dans Mythes et légendes de Napoléon. Un destin d’exception, entre
20 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 436. 21 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 436. 22 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 439.
7
rêve et réalité, Annie Jourdan place la naissance progressive d’une légende associée au culte de
l’Empereur au lendemain de la défaite de Waterloo. Ce récit se construit d’abord en opposition à
l’arrivée des Bourbons sur le trône de France; loin d’être une nostalgie idyllique d’un Empire romancé,
la figure de Napoléon fédère avant tout les Français contre le nouveau roi23. Toujours selon Annie
Jourdan, cette légende : « […] s’est donc élaborée progressivement, au rythme de la misère et de
l’oppression, des craintes suscitées par des lois désuètes et de tracasseries infligées aux anciens
partisans de la Révolution »24. La légende napoléonienne se solidifie en 1823 lors de la publication du
Mémorial de Sainte-Hélène, une conversation entre l’auteur, Emmanuel de Las Cases, et Napoléon.
Cet ouvrage figure comme : « […] la première narration complète de la légende impériale, et en dépit
de sa longueur et de sa complexité (et de son caractère souvent répétitif), il fut sans conteste l’un des
instruments littéraires essentiels de la création du mythe napoléonien »25. Cependant, Sudhir
Hazareesingh nous rappelle dans son livre La légende de Napoléon que dès les premières années de
la Restauration : « […] tous les thèmes centraux du Mémorial étaient présents dans l’opinion
populaire : la glorification de l’Empire, la célébration des victoires militaires de Napoléon, et les
expressions de regret concernant son exil »26. De surcroît, le Mémorial donne l’opportunité à Napoléon
de s’élever au-dessus des débats qui font rage en France à propos de son héritage laissé après sa
défaite27.
Nous savons que cette légende influence les idées politiques du moment : libéraux,
républicains et bonapartistes se réfèrent de manière hétéroclite à cette légende. En d’autres mots, la
figure de l’Empereur pouvait moduler les aspirations politiques des opposants aux Bourbons. Dans
notre mémoire, nous cherchons à voir si le développement de cette légende napoléonienne implique,
déclenche ou opère des actions, gestes, propos, textes, en référence au maréchal Ney. Ce dernier, on
l’a vu brièvement plus haut, a été un protagoniste du moment auquel la légende napoléonienne se
réfère, cette période qui va de la fin des années 1790 à 1815. D’autre part, contrairement, aux
maréchaux Jourdan ou Moncey qui sont décédés de manière naturelle, Ney meurt de façon tragique,
exécuté pour cause de trahison envers le roi Louis XVIII. Nous nous demandons dès lors si et comment
23 Annie Jourdan, Mythes et légendes de Napoléon. Un destin d’exception, entre rêve et réalité, Toulouse, Éditions Privat, 2004, p. 48. 24 Annie Jourdan, Mythes et légendes, 2004, p. 49. 25 Sudhir Hazareesingh, La légende de Napoléon, Paris, Tallandier, 2005, p. 209. 26 Sudhir Hazareesingh, La légende, 2005, p. 209. 27 Sudhir Hazareesingh, La légende, 2005, p. 210.
8
la mort par exécution d’un maréchal de prestige tel que Ney peut être repris par les défenseurs de la
légende napoléonienne. Nous voulons utiliser la légende napoléonienne, omniprésente et imposante,
pour évaluer si et comment elle interagit avec une éventuelle « petite légende », celle du maréchal
Ney.
La légende de Napoléon a deux facettes, et la légende noire est son versant négatif. Natalie
Petiteau dans son ouvrage réédité en 2004, Napoléon, de la mythologie à l’Histoire, démontre que
cette légende noire débute en Angleterre durant l’Empire. L’auteure recense durant la seule année
1804 plus de 70 pamphlets publiés qui font de Napoléon un « ogre » et ils soulignent : « […] la cruauté
et la fourberie de Bonaparte, par ailleurs doté de goûts dépravés semblables à ceux de son
compatriote, le marquis de Sade »28. Entre 1814 et 1821, c’est plus de 500 brochures qui se retrouvent
sur le territoire français29. Tout comme la légende dorée, la légende noire fait de Napoléon le centre
de l’attention. Il est décrit comme un dictateur ayant : « […] un esprit violent, sombre et aventurier, […]
un étranger à la nation française et était animé que par cupidité et une ambition effrénée »30. Comme
nous allons le voir dans le premier chapitre, cette légende négative est un moteur de politisation
formelle pendant la Restauration. L’évocation de Napoléon (et de la Révolution) devient alors un
moteur de socialisation politique pour les royalistes qui y voient l’auteur de tous leurs maux. Ayant fait
le choix de la « réconciliation nationale », le roi Louis XVIII se fait alors dépasser à sa droite par des
forces politiques nostalgiques de l’Ancien Régime qui utilisent la figure de Napoléon pour affirmer leur
force, leur présence, leur influence, et cibler les ennemis de la monarchie. Dans cette perspective, le
maréchal Ney devient un exemple de la corruption impériale et de ses conséquences, et sa punition
est une priorité pour les ultraroyalistes.
Les études sur la légende napoléonienne nous incitent à revenir sur un de ses carburants
principaux : la gloire de l’Empire. Les Bulletins de la Grande Armée ont été le réceptacle et le vecteur
de la mise en valeur des succès des armées françaises sous le commandement de Napoléon. Comme
le dit Jean-Paul Bertaud dans son article « Napoléon journaliste : les bulletins de la gloire », les
Bulletins construisent au fur et à mesure la légende napoléonienne31. Bien que publiés tout au long
des campagnes de l’Empire, les Bulletins : « […] s’adressent à leur tour tout autant à la postérité qu’aux
28 Natalie Petiteau, Napoléon, de la mythologie à l’Histoire, Paris, Éd. Seuil, 2004, p. 27. 29 Natalie Petiteau, Napoléon, 2004, p. 27. 30 Natalie Petiteau, Napoléon, 2004, p. 29-30. 31 Jean-Paul Bertaud, « Napoléon journaliste : les bulletins de la gloire », Le temps des médias, No.4 2005, p. 1.
9
contemporains, militaires ou civils, français ou étrangers »32. Ces écrits nous intéressent directement,
car ils nous permettent d’entrer dans la fabrication de la gloire de l’Empire : chaque bataille, chaque
campagne y est décrite de façon à accroître le prestige de l’Empereur, de l’armée française, et par
voie de conséquence de ceux qui en font partie. Les Bulletins ont participé activement à la
reconnaissance du maréchal Ney comme un chef militaire de premier plan et la façon dont il est traité
avant, pendant et après son exécution demande à être lue en relation avec sa place dans la légende
napoléonienne.
Des Bulletins au Mémorial, la légende napoléonienne s’érige peu à peu et pose les frontières
de la gloire de l’Empire et de son empereur. Comme nous disions plus haut, cette légende est l’un des
moyens pour nous de placer le maréchal Ney face à la légende de Napoléon. Il s’agit d’abord de savoir
dans quelle mesure Ney y participe activement comme militaire, et comment sa participation est
importante dans l’écriture de cette légende. Ensuite, nous voulons savoir comment le rapport à
Napoléon établit les conditions de perception de Ney au moment de son procès, et si le maréchal Ney
s’insère dans la légende napoléonienne après son exécution.
Sources
Les sources policières des Archives Nationales
Pour mettre au travail les notions et ressources que nous venons de développer, les sources
policières conservées aux Archives Nationales de France ont été l’objet d’une attention particulière.
Nos principales sources se trouvent sous les cotes F7 et F1cl. La première, nommée « police générale »,
contient des documents datés de 1789 à 1913. Cependant, la majorité des documents sont antérieurs
à 1830 : seules les périodes du Consulat, de l’Empire et de la Restauration ont une consistance
continue33. Pour notre période (1815-1848), les archives présentes sous la cote F7 ont été produites
par deux institutions. De 1815 à 1818, les informations sont recueillies par le Ministère de la Police, et
de 1818 à 1848, la collecte d’information tombe sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur après
que Louis XVIII a ordonné la dissolution du Ministère de la Police. Pour ce qui est de F1cl, les rapports
regroupés ici sont ceux qui se préoccupent de suivre les manifestions de l’esprit public parisien.
32 Jean-Paul Bertaud, « Napoléon journaliste », p. 1. 33 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/ESV_F7.pdf.
10
La première sous-cote qui nous intéresse est F7 3028 qui est inclus dans la série dite des
« Documents généraux sur la police ». Ces cartons contiennent les rapports d’arrestations et de
surveillances de l’an IV à 1818. L’avantage de ces rapports est qu’ils indiquent clairement le lieu de
l’arrestation ou de la surveillance, ainsi que l’étiquette politique de l’individu arrêté ou de l’établissement
surveillé. De plus, cette sous-cote permet de comprendre les forces politiques en présence lors des
premières années de la Restauration, et d’y chercher la façon dont le nom, la vie, le procès, la mort de
Ney peuvent être invoqués dans des gestes, des paroles, des textes. Autres ressources importantes
dans ces dossiers de police, les sous-cotes F7 6683 et F7 6772 de la série dite « Affaires politiques ».
Le carton de F7 6683 fait partie de la sous-série dite « P. P. (Police politique). Objets généraux (1814-
1838) » et est désigné en tant que « Dossier Ney ». Cet ensemble de documents inclut des rapports
de surveillance sur « l’Esprit public » parisien lors du procès du maréchal Ney, des échanges entre
différents paliers policiers quant à l’organisation de la surveillance de l’accusé. Le « Dossier Ney »
permet de prendre conscience de l’importance qu’avait le procès de Ney pour les autorités tant
policières que politiques, et sur la manière d’organiser sa mort. La dernière sous-cote de « Police
générale », F7 6772, contient des cartons nommés « Situation politique des départements. Rapports
des préfets. Classement départemental. 1815-1830 ». Nous avons évidemment sélectionné le dossier
portant sur Paris, mais il contient finalement très peu de sources sur la période qui précède 1822. Elles
nous ont permis d’avoir un pouls politique lors de la fin du règne de Louis XVIII, ainsi que durant le
règne de Charles X.
La dernière source policière, la cote F1cl, nous permet de pallier en quelque sorte les lacunes
archivistiques de la cote F7 après 1830. En effet, avec la sous-cote F1cl 33 nous avons accès aux
archives produites par la Police politique entre 1831 et 1836, c’est-à-dire lors des débuts de la
monarchie de Juillet. Ces rapports rapportent presque quotidiennement l’esprit public à Paris, et
décrivent les actions des ouvriers, et de groupes politiques dans l’espace public parisien. Avec le climat
de tensions politiques qui caractérisait les débuts du règne de Louis-Philippe, ces cartons nous
apportent la vision policière sur les acteurs politiques, tout en nous informant sur les différentes actions
que font ceux-ci dans l’espace public parisien.
11
Sources imprimées
Pour chercher les traces du maréchal Ney, nous avons utilisé principalement les ressources
numériques de la Bibliothèque Nationale de France. Grâce aux interfaces de recherche de Gallica et
de Retronews, nous avons pu chercher les références à Ney à travers toute une gamme de sources
imprimées publiées entre 1815 et 1848, voire un peu plus en amont et en aval de cette période qui
nous a le plus préoccupés. Dictionnaires biographiques, biographies, récits autobiographiques de
contemporains, mémoires juridiques, pièces de théâtre, pamphlets, revues, journaux, autant de genres
de récits et de discours qui pouvaient nous fournir les traces et indices de la façon dont le maréchal
Ney avait été évoqué. Nous avons utilisé à cette fin toute une gamme de mots clés tels que « maréchal
Ney », « Ney », « prince de la Moskowa », « duc d’Elchingen », « Brave des braves ».
Nous reviendrons souvent, notamment dans le premier chapitre, vers les volumes qui
documentent le procès du maréchal Ney . L’ouvrage le plus utilisé sur le procès est publié par Louis-
Gabriel Michaud, un imprimeur-libraire qui fonde en 1797 une imprimerie spécialisée en ouvrages
religieux et monarchistes34. De plus, ce dernier est l’imprimeur du roi de 1814 à 181635. Sa publication
sous 4 tomes, Procès du maréchal Ney, ou recueil complet des interrogatoires, déclarations,
dépositions, procès-verbaux, plaidoyers et autres pièces rapportées textuellement, présente toutes les
étapes qui vont mener à la condamnation et l’exécution du maréchal Ney. Les minutes du procès
donnent aussi l’aperçu des acteurs en place lors du procès qui se déroule à la Chambre des pairs : les
avocats de Ney, les commissaires du roi qui assurent la mise en accusation et la condamnation et les
principaux témoins appelés à la barre. La lecture de ce procès nous permet un accès à son atmosphère
belliqueuse : tant du côté des accusateurs que de la défense, les mots utilisés nous fournissent des
éléments de compréhension des logiques politiques qui s’activent lors de la deuxième Restauration
(1815). Un autre ouvrage, plus court, est publié par Didot l’Aîné, l’imprimeur du roi et de la Chambre
des pairs en 181536. Ce livre publié sous le nom de Chambre des pairs de France. Procès-verbal des
séances relatives au jugement du Mal Ney (novembre et décembre 1815) recoupe uniquement les
séances de la Chambre des pairs contrairement au recueil de Louis-Gabriel Michaud qui inclut le
Conseil de guerre. Nous avons également mis à contribution des sections portant sur le procès
présentes dans certaines biographies du maréchal Ney pour rendre compte du procès. Celles-ci se
34 https://data.bnf.fr/fr/12440281/louis-gabriel_michaud/. 35 https://data.bnf.fr/fr/12440281/louis-gabriel_michaud/. 36 https://data.bnf.fr/fr/12229426/pierre_didot/.
12
présentent comme des résumés du procès, et offrent à l’occasion une vision différente que celle
proposée par la publication de Didot l’Aîné ou de Louis-Gabriel Michaud.
Les biographies du maréchal Ney publiées entre 1815-1848 sont une source importante. Nous
avons repéré 8 biographies, dont 5 qui ont été publiées entre 1815 et 1816. Nous les avons repérées
grâce aux mots clés cités plus hauts. Selon nos recherches exhaustives sur les plateformes
numériques, il s’agit selon nous de l’ensemble des biographies de Ney qui ont été publiées durant
notre période historique. Ces biographies permettent d’analyser la façon dont le maréchal Ney était
perçu par ces auteurs, le plus souvent contemporains à sa mort. En croisant les biographies, il a été
possible de trouver des lignes conductrices communes, notamment sur la façon dont les biographes
ont rendu compte de l’attitude de Ney lors de son procès et de son exécution ou sur sa carrière militaire.
Puisqu’elles sont toutes publiées après la mort de Ney, les auteurs de ces biographies sont les
premiers à construire une image posthume cohérente, à l’échelle d’une vie, pour ce maréchal exécuté.
L’orientation politique des auteurs, repérables à des allusions parfois très explicites, teinte aussi la
façon de raconter le fil des évènements de la vie de Ney ce qui permet de comparer les versions
biographiques selon la couleur politique. Tous ces éléments sont donc essentiels pour bâtir la
trajectoire mémorielle du maréchal Ney.
Nous avons aussi eu recours à des Souvenirs, des Mémoires, et des journaux d’anciens
soldats de l’Empire dont les auteurs ont vécu à la même époque que Ney ou l’ont côtoyé militairement.
Contrairement aux biographies, ces textes sont construits autour de l’expérience personnelle des
auteurs d’un évènement particulier lié de la vie de Ney comme son exécution ou une campagne
militaire. Par exemple, les Souvenirs du comte de Rochechouart nous ont permis de connaître
l’organisation entourant l’exécution de Ney puisqu’elle tombait sous les ordres de l’auteur. Dans son
récit, le comte de Rochechouart décrit ses impressions de l’exécution, et des gestes et paroles des
individus qui y participaient.
Journaux
Nous avons eu recours à un large éventail de journaux pour nous aider à retrouver la place
éventuelle du maréchal Ney dans l’espace public parisien, et les circonstances dans lesquelles son
nom était évoqué dans la presse. Les quotidiens les plus utilisés dans ce présent mémoire ont été Le
Constitutionnel, Le journal des débats politiques et littéraires, ainsi que Le Moniteur Universel. Souvent
13
brefs et concis, les articles des quotidiens parisiens sont précieux pour prendre connaissance d’un
élément ou d’un évènement, et préciser les acteurs présents.
Images
Il faut d’emblée dire que les résultats de notre recherche sur les plateformes numériques ne
nous ont permis de réunir qu’un corpus limité d’images : deux peintures représentent Ney sur le champ
de bataille, trois lithographies en lien avec sa sépulture, deux autres lithographies et une médaille
concernant son exécution, deux lithographies qui le présentent sur son lit de mort suivant son
exécution, une médaille commémorative, une caricature, et une statue. Néanmoins, ces treize images
sont précieuses, car elles concernent des moments différents de l’existence du maréchal Ney, y
compris après sa mort puisque la caricature de Daumier le dessine sous les traits d’un fantôme venant
hanter la Chambre des pairs. Elles viennent donc à propos pour nourrir notre analyse de la façon dont
les contemporains des monarchies censitaires se représentaient la mémoire du maréchal Ney, à
différentes étapes de la construction de sa ou de ses figures.
Méthode et analyse des sources
Pour rendre compte de la trajectoire mémorielle du maréchal Ney pendant les monarchies
censitaires, nous allons en effet utiliser 3 figures, soit celles du traître, de la victime/martyr et du héros.
L’utilisation de cette grille de lecture nous a guidé pour ordonner les différentes formes et significations
prises par le maréchal Ney entre 1815 et 1848. Dans l’introduction de son article La figure, entre histoire
et mémoire. Parcours croisés du marquis de Pontcallec et de Marion du Faouët, Brice Evain définit ce
qu’il appelle la figuration comme un processus : « […] de concrétion mémorielle qui embrasse certains
personnages du passé pour les transformer en figures de mémoire »37. Selon lui, les figures ne sont
pas un bloc monolithique, et peuvent se transformer : « […] les figures mémorielles sont elles-mêmes
labiles et changeantes »38. C’est ce que nous avons observé avec le maréchal Ney dont la « concrétion
mémorielle » nous semble avoir pris trois figures entre 1815 et 1848.
37 Brice Evain, La figure, entre histoire et mémoire. Parcours croisés du marquis de Pontcallec et de Marion du Faouët, Ad Hoc, No.4, 2015, [En ligne]. 38 Brice Evain, La figure, entre histoire et mémoire, 2015, [En ligne].
14
Ces trois figures mémorielles ne se succèdent pas dans le temps, comme dans une suite
logique de causes et de conséquences, ou comme échos aux conjonctures politiques : elles se
côtoient, se nourrissent, s’opposent. Cependant, chaque figure contient une logique interne propre qui
prend corps dans des paroles, des gestes, des discours ou des images. Notre étude cherche justement
à définir ces figures qui sont tout autant des échos au passé qu’à la réalité politique et sociale de la
première moitié du XIXe siècle.
Analyse des sources
Pour parvenir à clairement définir les trois figures, nous avons dans un premier temps cherché
des gestes et des paroles posées à propos de Ney dans l’espace public parisien aussi bien que dans
l’espace discursif des sources publiées à Paris. Il s’agissait ici de tester notre terrain d’enquête dans
le but de confirmer la faisabilité de notre entreprise. Notre recherche de « moments Ney »,
principalement parisiens, concluante, nous a permis par la suite de nous concentrer sur des moments-
clés. À partir de là, nos trois figures se sont alors progressivement dessinées.
À la lecture des sources mentionnées plus haut, plusieurs recherches lexicales ont été
entreprises pour cerner différentes notions et affiner notre recherche. D’abord, des termes associés
aux acteurs politiques ont été incontournables pour chasser les protagonistes de nos « moments
Ney ». Les termes comme « bonapartistes », « républicains », « ultraroyalistes », « royalistes » nous
ont aidés à définir les acteurs politiques des monarchies censitaires, leur rôle dans le contexte politique
du moment. Ensuite, les mots utilisés pour qualifier Ney ont été recensés pour construire nos trois
figures et les associer à des « moments Ney ». La répétition de plusieurs qualificatifs a solidifié la
définition des figures et a facilité leur liaison à des acteurs politiques. Le champ lexical du « traître »,
négatif envers Ney, provient des mouvements royalistes, alors que ceux du « victime/martyr » et du
« héros », positifs, émanent surtout des groupes politiques comme les bonapartistes ou les
républicains, même si la figure de la victime/martyr est ambivalente, comme on le verra. C’est-à-dire
que chacune de ces socialisations politiques développe un langage pour qualifier la mémoire de Ney.
Ce mémoire se divise en trois chapitres qui vont décliner les trois figures énoncées plus haut.
Le premier chapitre du mémoire se penche sur la construction de la figure du traître associée au
maréchal Ney. Nous analyserons comment un militaire de renom a été « assigné » à l’étiquette de
15
traître. Pour bien comprendre ce processus, ce chapitre commence avec une contextualisation de la
mise en place des première et deuxième Restauration. Avec le retour de Louis XVIII sur le trône, le
discours politique s’inspire de l’Ancien Régime, et appelle en partie à l’action contre l’héritage
révolutionnaire et napoléonien. Le déroulement du procès du maréchal Ney nous apparaît à ce moment
comme un « microcosme » de la situation politique française des deux Restaurations. Parallèlement à
ce procès, nous entrerons dans les rues parisiennes à la recherche des premiers signes d’opposition
au procès du maréchal Ney. Bien que le retour du roi modifie les logiques politiques en étouffant les
paroles républicaines ou bonapartistes, le procès captive Paris, et pousse certains à exprimer
publiquement leur opposition. Pour bien qualifier les gestes de répression faits par le gouvernement,
nous nous pencherons sur l’exécution et l’enterrement de Ney.
Notre deuxième chapitre s’affaire à présenter l’éventail des possibilités pour présenter
l’exécution de Ney dans le prisme de la victime et du martyr. Dans un premier temps, nous retournerons
dans l’espace public parisien à la recherche d’expressions politiques motivées par une opposition puis
une réprobation de l’exécution de Ney entre 1815 et 1848. Grâce aux rapports policiers, nous avons
été en mesure de repérer les arrondissements et les lieux de socialisation politique les plus
susceptibles d’accueillir des gestes et des paroles pouvant associer le sort du maréchal à la figure de
la victime ou du martyr. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur certaines représentations
picturales du maréchal Ney au cours de la période étudiée. Ces représentations capturent l’intention
de leur auteur : mettre en scène un condamné victime ou martyrisé du pouvoir royal et de la justice.
Les demandes de révision du procès, et celles qui réclament la réhabilitation du maréchal Ney seront
mises au travail pour voir comment cette littérature de nature juridique continue à établir la figure d’un
Ney victime. La présentation de la pièce de théâtre Le procès d’un maréchal Ney en 1831 au théâtre
des Nouveautés termine ce chapitre comme un exemple singulier de l’utilisation de la figure de la
victime et du martyr dans l’espace public parisien, et des limites de cette utilisation. Sur scène, les
auteurs font usage de cette figure, et nous observerons aussi la rue s’activer politiquement autour de
cette représentation qui n’a pas lieu.
Pour la dernière figure, celle du héros, les « derniers moments » du maréchal Ney lors de son
procès et de son exécution nous amèneront à voir comment le récit de la fin de vie de Ney contribue
à mettre en place les traits du héros. Nous verrons comment les gestes et les paroles de Ney sont
racontés à cette fin. Nous constaterons également que, comme en un miroir inversé du premier
16
chapitre qui le voit recevoir les attributs du traître, le maréchal Ney tente à son procès de laisser un
« testament héroïque » pour la postérité. Au-delà de son procès, nous analyserons également les
ensembles discursifs qui ont déployé, à travers l’évocation de la carrière du maréchal Ney, de ses
débuts jusqu’aux grandes campagnes militaires de l’Empire, la figure du « Brave des braves » sous
laquelle il est encore, et le plus fréquemment, désigné de nos jours.
17
Chapitre 1 : Le traître
Le 6 décembre 1815, le maréchal Ney est déclaré coupable de haute trahison et d’attentat à
la sûreté de l’État, suite à son procès devant la Chambre des pairs ouvert depuis près d’un mois. Ce
procès fut riche en déclarations et formules destinées à affirmer, clamer ou démontrer le manque de
loyauté de l’accusé. Avant de se pencher sur ces argumentaires, il faut revenir sur le concept de
trahison, et sur la façon dont la notion a été utilisée pour qualifier le maréchal Ney au moment de son
procès. Le Petit dictionnaire de l’Académie française de 1821 définit l’action de trahir comme : « faire
une perfidie à quelqu’un, lui manquer de foi »39. Le préambule du procès du maréchal Ney précise en
contexte ce qu’est un traître aux yeux de la monarchie restaurée. La trahison du maréchal Ney est
pour les accusateurs un exemple des « […] funestes effets de notre révolution »40. Elle est l’expression
du « […] triomphe du génie du mal »41. Le maréchal Ney : « […] est un maréchal de France qui est
accusé d’avoir trahi l’honneur, le Roi et la patrie »42.
Le champ sémantique de la trahison est lié aux passions humaines : le traître divise, anime
les émotions d’un groupe, pousse à l’action43. Au cours du procès qui se déroule dans une atmosphère
de vengeance, le lexique employé démontre l’esprit du gouvernement. Le maréchal Ney est décrit
comme un rebelle contre l’État; l’architecte « […] d’un grand acte d’infidélité »44 et l’une des
sources: « […] des malheurs qu’une fatale usurpation attira sur la France »45. Le traître et son acte de
trahison sont perçus comme une menace sérieuse à un ordre social et politique en place. Par sa
trahison, Ney « contribue » à faire tomber Louis XVIII en 1815. De plus, trahir est une dynamique qui
implique une rupture au profit d’une fidélité nouvelle46. Le maréchal (A) trahit Louis XVIII et la
monarchie (B) au profit de Napoléon Bonaparte (C). Durant le procès cette rupture est présentée
comme un complot qualifié comme: « […] infâme de livrer le trône et la patrie à cet aventurier
[Napoléon] […] »47.
39 Joseph-René Masson, Petit dictionnaire de l’académie françoise, Tome 2, Paris, Chez Masson et fils, 1821, p. 407. 40 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 1. 41 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 4. 42 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 4. 43 Sébastien Schehr, Traîtres et trahisons : de l’antiquité à nos jours, Paris, Éditions Berg, 2008, p. 12. 44 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50. 45 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50. 46 Sébastien Schehr, Traîtres et trahison, 2008, p. 12. 47 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 5.
18
Il y a deux grandes familles de trahison : les actes liés à une révélation ou une transmission
d’une information ou d’un secret (comme l’espionnage) et tout ce qui est relatif à une désertion,
défection ou un changement de loyauté48. Ces deux familles ont la même définition, c’est-à-dire un :
« […] franchissement et un dépassement avec les frontières physiques et symboliques du groupe
considéré »49. S’excluant lui-même du territoire du « Nous », le traître se détache du groupe qu’il a
trahi, ce qui facilite sa stigmatisation. Les accusateurs du maréchal Ney soulignent les aspects
« glorieux » de sa carrière militaire pour mieux l’exclure du « Nous ». Tous ses grands faits militaires :
« […] eussent brillé de l’éclat le plus pur, si ce sang n’eût malheureusement servi à cimenter le trône
de l’usurpateur »50.
Avec la trahison vient une punition. Car pour le pouvoir, l’affaire n’est pas anodine : le traître
représente une faille, une fragilité qui menace l’existence d’un système. La sanction doit être
prononcée au nom du « Nous », car il s’agit d’avoir le dernier mot sur celui qui a commis l’inadmissible,
la trahison. Pour avoir une quelconque exemplarité, le châtiment doit aussi être public, sans quoi la
sanction n’atteint pas l’objectif escompté, soit la prévention par l’exemple visant tous ceux qui
pourraient emprunter ou approcher le dangereux chemin de la trahison. Une fois le châtiment infligé,
tout peut s’apaiser. Le lendemain de l’exécution, le 8 décembre 1815, le duc de Richelieu, président
du Conseil exécutif de Louis XVIII, s’adresse à la Chambre des députés pour tourner la page de
l’exécution de Ney. Son message appelle à une réconciliation nationale, la fin de la haine et des intérêts
personnels pour faire place à : « […] un amour sincère de l’ordre et des lois! »51.
Comment peut-on expliquer une telle déclaration? Pour porter les accusations de haute
trahison, les accusateurs utilisent les faits et gestes du maréchal Ney lors des Cent-Jours. Le procureur
du roi, Nicolas-François Bellart, tient d’abord à reprendre cette chaîne événementielle lors de la séance
du 6 décembre 1815, avant de faire la lecture du verdict. Reprenons ce fil avec lui.
Ney arrive dans la capitale le 7 mars pour y prendre ses habits militaires et reçoit l’ordre de se
rendre à Besançon où ses instructions l’attendent. Il rencontre d’abord son notaire qui lui apprend le
débarquement de l’Aigle. Le roi lui accorde par la suite un entretien dans lequel Ney démontre une
48 Sébastien Schehr, Traîtres et trahison, 2008, p. 45. 49 Sébastien Schehr, Traîtres et trahison, 2008, p. 46. 50 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 5. 51 Le Constitutionnel, 9 décembre 1815, p. 1.
19
grande loyauté allant jusqu’à dire que Napoléon lui serait ramené dans une cage de fer, avant de baiser
la main de Louis XVIII. Selon Bellart, les signes de la trahison sont déjà là : comment un maréchal
d’Empire peut-il ignorer le débarquement de son ancien chef et l’apprendre par l’entremise de son
notaire? Les grandes démonstrations de loyauté au roi sont-elles sincères ou Ney fait-il preuve de
duplicité? Néanmoins, c’est à Lons-le-Saulnier, au sud-ouest de Besançon, que la « trahison » de Ney
est la plus claire selon Bellart. C’est là que Ney a rejoint les troupes qu’il doit commander pour arrêter
l’avancée de Napoléon. Durant la nuit du 13 mars, le maréchal rencontre secrètement le général
Bertrand qui lui remet une lettre signée par Napoléon. L’Empereur appelle le maréchal à le rejoindre.
Le lendemain, le 14 mars, Ney fait la lecture d’une proclamation devant ses troupes et leur propose de
les conduire vers les troupes de l’Empereur pour se joindre à elles dans la remontée vers Paris.
C’est sur cette base événementielle que Ney est identifié, qualifié, jugé et puni en tant que
traître. C’est ce processus de mise en évidence du traître que nous allons étudier au cours ce chapitre.
Dans un premier temps, nous allons suivre la progression du discours de la monarchie restaurée en
1814 et en 1815, afin de voir comment le phénomène de trahison en général lui permet de se légitimer
politiquement. Par la suite, l’ambiance du procès va nous permettre de suivre l’opération rhétorique
menée par les accusateurs pour mettre en mots la traîtrise de Ney. Finalement, nous allons analyser
les différentes méthodes du gouvernement pour d’abord publiciser le procès et l’exécution du traître,
puis tenter de l’effacer ce dernier de l’espace public.
1814 et 1815 : réconciliation et radicalisation
Le 30 avril 1814, le libéral anglais William Cobbett écrit à Louis XVIII une lettre qui représente
bien l’état d’esprit désiré par le roi durant la Première Restauration :
Le peuple français a goûté de la liberté ; il a contracté l’habitude de la discussion; il a vu ce qu’il pouvait faire, il s’est pénétré de mépris pour les prétentions aristocratiques; il sait par expériences qu’il peut se défendre contre toute l’Europe, sans le secours des talens [sic] et de la valeur héréditaire. Le seul moyen efficace pour régner paisiblement sur un tel peuple, c’est de reconquérir son affection; de le convaincre, par des mesures sages, qu’il a gagné quelque chose au renversement de Napoléon, c’est de lui prouver, par des actes plutôt que par des promesses, qu’il ne doit plus retourner à l’état d’où il est sorti en 1789 […]. 52
52 William Cobbett, Adresse à Sa Majesté Louis XVIII, 30 avril 1814, pp. 3-4.
20
Le 15 avril 1814, le Journal des débats claironne l’entrée triomphale du roi à Paris : « […]
bientôt Louis XVIII reprendra la couronne d’Henry IV. Tout annonce une longue paix, tout nous promet
des jours heureux […] »53. D’ailleurs, le cortège du roi prend la peine de passer sur le Pont-Neuf où
une statue représente Henri IV54. En octroyant une charte constitutionnelle à ses sujets le 4 juin 1814,
le roi se félicite d’être : « […] devenu le dispensateur des bienfaits que la divine providence daigne
d’accorder à mon peuple »55. Pour les constitutionnalistes, le roi joue bien ses cartes. Benjamin
Constant en rend compte dans une lettre écrite au rédacteur du Journal des débats: « […] Les Français
[…] sont mille fois plus heureux qu’ils ne l’étoient [sic] il y a six mois, mille fois plus heureux qu’ils ne
l’ont été depuis vingt années »56. À demi-mot, Benjamin Constant avance l’idée que l’aventure
impériale fût une expérience négative pour les Français. Cependant, pour certaines classes sociales,
cette expérience fut positive en leur permettant de grimper les échelons sociaux. Pour garantir la
stabilité de son pouvoir, Louis XVIII doit pratiquer un réalisme politique pour faire cohabiter, d’une part,
les élites révolutionnaires et impériales qui veulent protéger ses privilèges, et d’autre part, les royalistes
et émigrés dont certains réclament le retour de l’Ancien Régime.
Le discours du roi insiste sur le retour de la « paix intérieure », la stabilité économique du
royaume, et utilise des termes négatifs pour caractériser les épisodes révolutionnaires et impériaux.
Ce choix lexical veut satisfaire les partisans les plus dévoués de la monarchie, d’autant plus volontiers
que la Charte conserve une grande partie des acquis de la société issue de 1789. Le document
constitutionnel : « […] admet l’égalité civile, les carrières restent ouvertes aux talents, la liberté
individuelle, celle du culte […], la liberté de la presse, mais dans le cadre des lois »57. Ces concessions
politiques rassurent la nouvelle élite et garanti aux puissances européennes que le nouveau
gouvernement n’organise pas une « contre-révolution », laquelle évoque le spectre de la guerre civile.
En fait, Louis XVIII ne peut radicalement renverser un héritage apprécié et célébré sans compromettre
les balbutiements de son pouvoir.
53 Journal des débats politiques et littéraires, 15 avril 1814, p. 1. 54 Description des cérémonies, fêtes, entrées solennelles et honneurs rendus à Louis XVIII en Angleterre et en France, Paris, F. Scheoll, 1814, p. 92. 55 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série. 2 (1800-1860), Tome 12, 1868, Paris, Paul Dupont, p. 32. 56 Le Journal des débats politiques et littéraires, 4 août 1814, p. 4. 57 Francis Démier, La France de la Restauration (1814-1830). L’impossible retour du passé, Paris, Folio histoire, 2012, p. 64.
21
En revanche, le roi ne doit pas oublier sur quelle base s’édifie son pouvoir. Les couleurs
royalistes apparaissent notamment lors de la présentation de la Charte constitutionnelle par Charles-
Henri Dambray, le Chancelier du roi:
Il s’est écoulé bien des années depuis que la Providence divine appela notre monarque au trône de ses pères. À l’époque de son avènement, la France égarée par de fausses théories, divisées par l’esprit d’intrigue, aveuglée par de vaines apparences de liberté, était devenue la proie de toutes les factions, comme le théâtre de tous les excès et se trouvait livrée aux plus horribles convulsions de l’anarchie. 58
La Charte constitutionnelle est octroyée par le roi, au nom de son peuple en tant que chef
suprême. Louis XVIII est la fondation de l’édifice social et politique français et : « […] c’est autour de
lui que tous les Français doivent se rallier »59. Bien que les deux chambres législatives aient un droit
de regard sur le processus législatif60, le pouvoir du roi reste entier. La lecture de la Charte par Antoine
Ferrand, ministre d’État et proche conseiller de Louis XVIII qui participe à la rédaction du texte61, donne
l’aperçu de la mainmise du monarque sur l’État. L’article 13 de la Charte stipule que : « La personne
du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance
exécutive »62. À cette puissance, le roi s’accorde le droit de proposer les lois (art. 16) et de les
sanctionner et de les promulguer (art. 22). Les chambres législatives peuvent toutefois « […] supplier
le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d’indiquer ce qu’il leur paraît convenable
que la loi contienne »63.
Acclamé par des vive le roi! les discours, ainsi que le contenu de la Charte, sont porteurs
d’espoir pour les royalistes les plus nostalgiques de l’Ancien Régime. Par contre, l’un d’eux, le comte
de Corbière, se questionne dans ses Mémoires sur cet exercice politique qu’il croit influencé par les
libéraux. Il s’inquiète de la construction de cet édifice politique : « […] les gens de lettres se sont
emparés de l’opinion et par elle de la société, et qu’ils s’imaginent qu’on fait des systèmes politiques,
comme des systèmes scientifiques, qui se succèdent sans danger, dans leurs livres »64. Si cette Charte
politique vise une France réconciliée autour de son nouveau roi, certains, comme le comte de Corbière,
58 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S.12, T.12, 1868, p. 33. 59 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S.12, T.12, 1868, p. 33. 60 Article 15 de la Charte : « La puissance législative s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements ». 61 Hervé de Broc, Mémoire du comte Ferrand, ministre d’État sous Louis XVIII, Paris, Alphonse Picard et fils, 1897, p. xiv. 62 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S.12, T.12, 1868, p. 34. 63 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S.12, T.12, 1868, p. 34. 64 Jacques-Joseph Corbière, Souvenir de la Restaution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Coll. Mémoire commune, 2012, p. 33.
22
se méfient de ce texte politique. Cette ouverture à l’héritage révolutionnaire nourrit les premières
divisions politiques au sein du clan des ultraroyalistes et de l’Église65.
Commémoration et symboles : des signes de division
Déterminé à réconcilier politiquement la France, Louis XVIII joue ses cartes différemment sur
les tableaux symboliques et commémoratifs. L’avènement des Bourbons sur le trône permet la
réapparition d’une mémoire royaliste longtemps refoulée et pratiquée de façon souterraine pendant la
Révolution66. En 1814, cette mémoire s’érige dorénavant en deuil public sélectif67, et vise à
commémorer principalement Louis XVI et Marie-Antoinette. Lors de la Révolution, le frère de Louis
XVIII et sa belle-sœur ont été privés de tout honneur funèbre. Comme sur le plan politique, le roi veut
prendre l’initiative et dicter les règles. Ayant peu d’emprise sur le territoire « réel », le pouvoir royal
investit donc le champ symbolique pour tenter de reconquérir un pays loin d’être pacifié. La mise en
scène publique de ce deuil royal rappelle le lien qui unit Louis XVIII au roi martyrisé lors de la
Révolution. La monarchie restaurée renoue avec l’expérience monarchique française.
Le premier acte de ce rituel royal se déroule le 14 mai 1814 à Notre-Dame et est suivi par des
messes dans toutes les églises de France. À l’intérieur du 7e numéro de L’Ami de la Religion et du
Roi : journal ecclésiastique, politique et littéraire datant de 1814, cette célébration comporte deux
objectifs : « Le temps est venu de rendre à la mémoire d’un prince malheureux le tribut d’hommages
et de regrets que sa cendre attendoit [sic] depuis vingt ans. Le temps est venu d’expier un crime, qui
sera un opprobre éternel pour ses auteurs, et de montrer que ce crime ne fut pas celui de la nation,
mais de quelques factieux »68. Rendant un « douloureux » hommage à son frère, Louis XVI, le roi :
« […] a voulu […] commencer par-là l’exercice de son pouvoir, comme pour apaiser la colère céleste
par ce grand acte de religion, comme pour réconcilier, par une expiation solennelle, la nation avec elle-
même et avec toute l’Europe […] »69. Ce geste est d’une importance capitale pour le gouvernement de
Louis XVIII que l’on voit ce jour-là : « […] dans une tribune spéciale, en uniforme de la garde nationale,
65 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 85. 66 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 48. 67 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 151. 68 L’Ami de la religion et du roi : journal ecclésiastique, politique et littéraire, Tome 1 (no. 1 à 25), Paris, De Soye et Bouchet, 1814, p. 114. 69 L’Ami de la religion et du roi, 1814, p. 115.
23
[qui] manifeste l’attachement du souverain à cette commémoration »70. Il lui faut concentrer ses efforts
sur cet évènement hautement symbolique afin de réunir les royalistes autour de sa monarchie. Le
21 janvier 1815 (jour d’anniversaire de la mort de Louis XVI), la translation des cendres de Louis XVI
et Marie-Antoinette est célébrée en grande pompe à Paris, « […] première véritable fête funèbre de la
Restauration » qui veut « […] recommencer la succession des Rois dans le domaine de la mort »71.
Du cimetière de la Madeleine jusqu’à la basilique de Saint-Denis, ce défilé militaire donne l’impression
d’une unification de la nation contre l’héritage révolutionnaire72.
Si Louis XVIII recentre le deuil national autour de la mort de Louis XVI, le clan ultraroyaliste
désire étendre ce deuil à toutes les victimes royales tombées sous les « crimes » révolutionnaires et
impériaux. La translation des cendres du dernier couple royal depuis Louis XVIII représente pour eux
le commencement du deuil royal bourbonien, et non sa fin. Dans cette optique, les députés ultras
supplient73 le roi de mettre le 21 janvier « […] un deuil général à perpétuité, et prévoit l’érection de
monuments dits expiatoires à la mémoire des victimes royales de la Révolution »74. Cette loi devait
perpétuellement transmettre le crime du régicide à toutes les futures générations : « le deuil devient
ainsi un legs pour l’éternité, imposé par le caractère infini du crime »75.
Les ultras entrent sur la scène politique véritablement après les Cent-Jours qui vont fédérer
les royalistes les plus déçus des politiques de Louis XVIII. Les Cent-Jours ont donné naissance à une
forme de vengeance politique propulsée par une radicalisation « nostalgique » de l’Ancien Régime et
une vision très restreinte de la politique française. Tout individus sortant de ce cadre de pensée
ultraroyaliste est un potentiel traître au roi. La deuxième aventure bonapartiste est perçue comme une
« […] trahison assimilée à un nouveau régicide ou ‘‘parricide’’ »76. Les ultraroyalistes ont vécu d’abord
un choc militaire : l’avance des armées de Napoléon sans trop d’entraves annihile l’image d’un roi en
contrôle de son territoire et de son armée. Bien plus graves, les ralliements aux troupes de Napoléon
par le peuple et par certains hauts gradés de l’armée (dont le maréchal Ney) font croire aux ultras qu’il
existe toujours d’une part, une nostalgie importante pour l’épopée de Bonaparte, et d’autre part, évoque
70 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 153. 71 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 156. 72 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 157. 73 Selon l’article 19 de la Charte. 74 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 160. 75 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 163. 76 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 160.
24
la possibilité d’un complot. En fait, pour ces derniers, le retour de l’Aigle équivaut à revivre une
deuxième Révolution française.
Après les Cent-Jours
La force politique de l’ultracisme émerge véritablement après la défaite de Napoléon à
Waterloo, le 18 juin 1815. L’occupation militaire de la France par les puissances européennes leur
donne l’impression que les héritages révolutionnaires et impériaux seront finalement détruits, espoir
qu’ils n’ont pas en 1814 lors de la première Restauration77. Lors des élections de la Chambre des
députés qui se déroulent entre le 14 et 22 août 1815, le parti des ultras dirigés par François-Régis de
la Bourdonnaye remporte l’écrasante majorité des sièges avec 350 sièges sur les 400 disponibles. Les
ultras ont réussi à exploiter une peur sociale d’un retour des violences78. Toutefois, dès le 25 août
1815, un climat de suspicion s’installe dans les rangs de la réaction : les têtes dirigeantes ont le
sentiment de ne pas être écoutées par l’exécutif dirigé par le duc de Richelieu. Les dirigeants ultras
pensent avoir été invités à l’intérieur d’un piège politique dans lequel les ministres et la haute
administration entretiennent un regard condescendant vis-à-vis de ces députés ultras le plus souvent
issus des régions rurales. Les problèmes les plus pressants à régler – la paix avec l’Europe, la question
de l’occupation, les indemnités de guerre – échappent aux députés ultras et sont monopolisés par le
gouvernement. Sous la plume de Villèle, un des dirigeants de la réaction, les premiers désaccords
politiques se dessinent lorsqu’il décrit le travail du président de l’exécutif, le duc de Richelieu :
« Le malheur voulut que le duc de Richelieu, partageant les fausses idées de l’Empereur Alexandre,
se persuadât que l’ordre et la paix ne pouvaient être rétablis en France que par des concessions aux
principes révolutionnaires et que le plus sûr moyen pour le roi de conserver sa couronne était
d’accorder sa confiance aux hommes de la Révolution »79. Une double trahison s’active aux yeux de
Villèle : cette « concession » à des principes révolutionnaires de la part d’un gouvernement qui se veut
royaliste, et l’acceptation de la présence d’hommes qui ont contribué aux idéaux révolutionnaires.
La socialisation politique des ultras se développe autour des salons aristocratiques de St-
Germain, ainsi que ceux du faubourg St-Honoré; le premier étant l’état-major parlementaire. L'objectif
77 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 152. 78 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 153. 79 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 165.
25
de la majorité ultraroyaliste est d’instaurer : « […] un dispositif répressif nouveau contre les tenants de
l’Empire […] de démanteler l’appareil d’État construit au fil de l’épisode révolutionnaire, de remettre en
question la centralisation napoléonienne et de redonner le pouvoir aux communautés municipales et
régionales »80. Leur plan parlementaire est de s’opposer à plusieurs lois, tout en accumulant les
amendements pour bloquer ou ralentir le calendrier parlementaire de l’exécutif. Leur argumentaire est
paradoxalement révolutionnaire pour une majorité qui se veut plus royaliste que le roi. Comme le
précise Francis Démier, le peuple français devient, selon eux, la source de leur engagement : ils
affirment que leurs propositions politiques sont issues des demandes des différents collèges électoraux
et corps électoraux. La crainte d’un retour révolutionnaire radicalise un discours politique teinté de
vengeance et de rancœur.
L’entrée de Louis XVIII à Paris le 8 juillet 1815 ne s’accompagne d’aucune cérémonie
officielle81, contrairement au long itinéraire dans les rues de la capitale que le roi a effectué en 1814.
L’heure est grave, et ses premières proclamations après les Cent-Jours le laissent paraître. Les mots
envers Napoléon et ceux qui l’ont suivi dans sa dernière aventure sont durs. Dans une proclamation
faite le 25 juin, le roi qualifie leur aventure comme « […] la plus criminelle des entreprises »82. Trois
jours plus tard, une autre proclamation est publiée, et celle-ci vise directement ceux qui ont brisé leur
serment de loyauté:
Cependant le sang de mes sujets a coulé par une trahison dont les annales du monde n’offrent pas d’exemple. Cette trahison a appelé l’étranger dans le cœur de la France. Chaque jour me révèle un désastre nouveau. Je dois donc, pour la dignité de mon trône, pour l’intérêt de mes peuples, pour le repos de l’Europe, excepter du pardon les instigateurs et les auteurs de cette trame terrible. Ils seront désignés à la vengeance des lois par les deux Chambres que je me propose d’assembler incessamment. 83
Un mois plus tard, les ordonnances dites du 24 juillet tombent et affligent trois principales
exigences aux individus visés par cette proclamation. D’abord, 29 personnes se voient expulsées de
leur siège de la Chambre des pairs puisqu’ils ont accepté de siéger « […] dans une soi-disant Chambre
des pairs nommée et assemblée par l’homme qui avait usurpé le pouvoir dans nos États […] »84. Le
duc d’Elchingen fait partie de cette liste. Ensuite, 38 doivent quitter Paris pour se rendre dans un endroit
80 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 171. 81 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série 2 (1800-1860), Tome 15, Paris, Paul Dupont, 1869 p. 2. 82 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 2. 83 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 2. 84 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 25.
26
indiqué par le ministère de la Police afin que les Chambres décident de leur sort85. Finalement, une
liste de 18 militaires, sur laquelle Ney figure en premier, représente ceux : « […] qui ont trahi le Roi
avant le 23 mars ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui par
violence se sont emparés du pouvoir […] »86. Ces individus sont traduits devant les conseils de guerre
compétents, selon leur grade militaire.
Le 3 août 1815, un arrêté préfectoral du Cantal fait l’annonce que l’ex-maréchal Ney a été
arrêté dans le département d’Aurillac. Dans une lettre envoyée au ministre de la police générale Joseph
Fouché le 21 août 1815, le baron François Locard, préfet du Cantal et sous-préfet de la ville d’Aurillac,
décrit l’arrestation de l’ex-maréchal Ney avec zèle royaliste87. Le préfet souligne que toutes les
informations recueillies viennent d’individus dévoués à la monarchie88. Resté plusieurs jours à Aurillac,
Ney arrive à Paris le 19 août 1815 dans un climat tendu. Pour le ministère de la police, l’heure est à la
recherche de complots bonapartistes89. Pour le gouvernement du duc de Richelieu, l’objectif est de
satisfaire autant les occupants européens que la frange de l’ultracisme90. Avant la comparution du
maréchal Ney devant le Conseil de guerre le 9 novembre 1815, la Chambre des députés,
majoritairement ultraroyaliste, s’arme d’une législation répressive, toujours dans l’objectif de trouver le
plus de coupables des Cent-Jours.
Le 29 octobre 1815 est votée la loi dite de « sûreté générale » qui permet à l’État de détenir
provisoirement, sans le traduire devant les tribunaux : « […] tout individu prévenu de crimes ou délits
contre la personne et l’autorité du roi, contre les personnes de la famille royale et contre la sûreté de
l’État »91. Tout fonctionnaire ayant l’autorité peut lancer un mandat d’arrestation92. Le 9 novembre la
même Chambre vote la loi dite des « cris et écrits séditieux » qui menace de lourde condamnation tous
ceux qui parlent et écrivent contre le roi et sa famille ou portent des objets représentant la Révolution
85 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 25. 86 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 25. 87 Selon Paul Louilliot (1929), ce préfet est très enthousiaste pour le roi ultra Charles X. De plus, si l’on en croit la Gazette de France du 29 août 1829, l’arrestation de Ney est peut-être un titre de gloire pour ce préfet ultra. 88 « Lettre du préfet Locard au ministre de la police général Joseph Fouché du 21 août 1815 », F7 6683 Archives Nationales, « Dossier Ney ». 89 Jacques-Joseph Corbière, Souvenir de la Restauration, 2012, p. 38. 90 Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la Restauration (1814-1830), Paris, Perrin, Coll. Tempus, 2002, p. 173. 91 Armand Dalloz et Désiré Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence général, 1853, p. 18. 92 Armand Dalloz et Désiré Dalloz, Répertoire méthodique, 1853, p. 18.
27
ou l’Empire93. Ces deux lois sont sanctionnées par le roi pour éviter de plus longs débats au sein des
chambres législatives94. Ces concessions du roi démontrent bien à quel point l’exécutif veut ménager
les assauts politiques des ultraroyalistes en leur concédant certaines victoires législatives.
Le 20 août 1815, alors emprisonné à la Conciergerie (le Palais de Justice), le maréchal Ney
reçoit un interrogatoire préliminaire du préfet de Paris, Élie Decazes. Le préfet s’applique à cerner la
trahison du maréchal Ney grâce à des questions précises qui concernent ses actions lors des Cent-
Jours. Decazes veut d’abord savoir si Ney a véritablement proposé ses services au roi, démontré sa
fidélité et baisé sa main avant de partir pour Lons-le-Saulnier95. Ces premières questions veulent
évidemment compromettre Ney afin de prouver qu’il a prêté un serment de fidélité à Louis XVIII avant
de le rompre au profit de Napoléon. Toute la question de la trahison réside dans le changement
brusque de la fidélité du maréchal Ney. Mais Decazes cherche un aveu du maréchal Ney, cherche la
préméditation dans les actions de Ney. Il ne l’obtient pas et Ney ne lui cède pas de terrain: « J’ai eu
bien des fois envie de me brûler la cervelle. Je ne l’ai pas fait, parce que je désirais me justifier. Je sais
que les honnêtes gens me blâmeront. Je me blâme moi-même. J’ai eu tort, je me le reproche, mais je
ne suis pas un traître. J’ai été entraîné et trompé… »96.
Avant de se présenter devant le conseil de guerre, le maréchal Ney est également interrogé
par Louis Sébastien Grundler, rapporteur au conseil de guerre, sur des questions purement militaires.
Il questionne Ney sur sa déclaration à Lons-le-Saulnier en date du 14 mars 1815, le loyalisme des
soldats, ainsi que l’organisation des régiments présents ce jour-là97. Les questions posées aux témoins
lors du procès convergent avec les questions à Ney: « Quels ordres le maréchal Ney avait-il reçus
avant le 14 mars? / Que savez-vous de la proclamation du 14 mars? / L’exemple du maréchal a-t-il
entraîné les officiers et les troupes? / Quelle était la situation politique des pays où le maréchal était
gouverneur? / Le maréchal était-il en mesure de s’opposer efficacement aux progrès de l’invasion de
Napoléon Bonaparte ? »98. Si Élie Decazes concentre son interrogatoire sur l’attitude de Ney vis-à-vis
93 Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la Restauration, 2002, p. 171-172. 94 Emmanuel de Waresquiel et Benoît Yvert, Histoire de la Restauration, 2002, p. 172. 95 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 138. 96 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 140. 97 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 150-151. 98 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 148.
28
de Louis XVIII, le comte de Grundler questionne plutôt ses intentions militaires. Nous avons ici les deux
piliers de la définition de la trahison du maréchal Ney qui seront utilisés lors de son procès.
Le passage du maréchal Ney devant le Conseil de guerre les 9 et 10 novembre 1815 évite
cependant la question de la trahison. Ses avocats, Pierre-Antoine Berryer et André Dupin, concentrent
leur défense sur la compétence du Conseil de guerre à juger un Pair de France99. Selon André Dupin,
puisque Ney fut nommé Pair par Louis XVIII en 1814, il ne peut qu’être jugé par les Pairs. Selon l’article
34 de la Charte « Aucun pair ne peut être arrêté que de l’autorité de la Chambre [des pairs] et jugé par
elle en matière criminelle »100. De son côté, Berryer avance qu’un Conseil de guerre ne peut juger un
crime d’État. Les contre-arguments du commissaire du roi devant le Conseil de guerre ne font pas
l’effet escompté, et 5 juges sur les 7 se déclarent incompétents.
Cette décision résonne tant dans les cercles bonapartistes que royalistes. Les premiers
célèbrent une première victoire, alors que les deuxièmes dénoncent une trahison consommée par le
Conseil de guerre101. Pour le gouvernement, le processus judiciaire traîne depuis trop longtemps.
Depuis l’arrestation de Ney du 3 août 1815, la radicalisation politique des ultras, et leurs victoires
législatives poussent les autorités à accélérer le pas, et surtout à accentuer l’importance de ce procès.
L’échec du Conseil de guerre démontre en fait la difficulté des militaires à statuer sur le sort d’un ancien
compagnon d’armes : le maréchal Moncey refuse la présidence du conseil de conseil et se voit
emprisonné pour une durée de trois mois, et pour éviter de juger un de ses anciens collègues, le
maréchal Mortier se déclare incompétent. Pour ces militaires, juger Ney de haute trahison les place
dans une situation délicate : refuser, et prendre des risques pour sa personne, ou accepter, et salir son
honneur militaire.
Ney en procès : du brave au traître
Le gouvernement ne perd pas de temps à transférer le procès à la Chambre des pairs. Le
lendemain de la déclaration de l’incompétence du Conseil de guerre, le duc de Richelieu s’exprime
sévèrement devant les Pairs : « Ce n’est pas seulement, messieurs au nom du Roi que nous
remplissons cet office, c’est au nom de la France depuis longtemps indignée et maintenant stupéfaite.
99 Journal des débats politiques et littéraires, 4 novembre 1815, p. 2. 100 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 12, T. 12, 1868, p. 34. 101 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 174.
29
C’est au même au nom de l’Europe que nous venons vous conjurer et vous requérir à la fois de juger
le maréchal Ney ! »102. Les mots acerbes du président du Conseil exécutif mettent en évidence l’état
d’esprit du gouvernement. Pour celui-ci et les commissaires du roi, la trahison de Ney réside dans le
serment au roi brisé et la lecture de la proclamation à Lons-le-Saulnier.
En revanche, il est difficile de bien connaître l’état d’esprit des Parisiens durant le procès.
Comme nous allons le voir, les journaux parisiens relaient uniquement les procès-verbaux des
différentes séances du procès, et les forces de l’ordre surveillent les « factieux ». Nous avons
cependant une lettre qu’un informateur envoie, le 17 novembre 1815, au ministre de police pour lui
donner ses impressions de Paris : « […] l’indifférence presque générale que j’aie remarquée pour la
personne de l’accusé, […] j’observe que les factieux font tout ce qu’ils peuvent pour ne point laisser
échapper l’occasion de troubler l’ordre, et de verser l’odieux sur la fermeté du roi »103.
Pour accuser le maréchal Ney de haute trahison et d’attentat contre la sûreté de l’État, l’acte
d’accusation, lu dans la séance du 21 novembre 1815, utilise des articles du Code pénal de 1810104 et
de la loi du 21 brumaire de l’An V (11 novembre 1796)105. Suivant la définition de la trahison que nous
avons atirée des interrogatoires de Decazes et du comte de Grundler, la sélection des articles dans le
Code pénal de 1810 définit bien les deux piliers de la trahison détaillés plus haut. En effet, nous
trouvons à la fois des articles touchant la conspiration contre la famille royale (art. 87) que l’entretien
d’intelligences avec les ennemis de l’État (art. 77), que d’avoir pris le commandement de soldats contre
l’avis du gouvernement (art. 93). Tous ces articles sont passibles de la peine de mort.
Le point central de l’accusation contre le maréchal Ney est la proclamation du 14 mars 1815
devant ses soldats à Lons-le-Saulnier. Pour ses accusateurs, cette date est le moment décisif dans la
loyauté de Ney, la preuve hors de tout doute que Ney est un traître. Pour mieux l’imager, le
commissaire du roi Bellart utilise le terme « la trahison si publique »106. Pour ce dernier, point besoin
de témoins puisque : « La vérité se soulève toute entière pour l’accuser. […] C’est lui, général en chef,
qui excite son armée à passer dans les rangs de l’Usurpateur qu’il avait promis au Roi »107. Suivant la
102 Jules Mavidal et Émile Laurent, Archives parlementaires, S. 2, T. 15, 1869, p. 214. 103 « De l’opinion sur le procès du maréchal Ney, lettre d’un informateur au ministre de la police Élie Decazes du 17 novembre 1815 », F7 6683 Archives Nationales, « Dossier Ney ». 104 Les articles 77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 102. 105 Titre I–De la désertion à l’ennemi, articles 1 et 5; Titre III–De la trahison, article 1. 106 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 39. 107 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 45.
30
conceptualisation de la trahison de Sébastien Schehr, les gestes de Ney sont : « […] une rupture des
attentes et des conventions quant au lien [entre le trahi et le traître] »108. De surcroît, la royauté
entretient de grandes attentes envers Ney puisqu’il est perçu : « comme le principal appui au trône […]
un rempart inexpugnable contre l’Usurpateur »109. Bellart souligne les deux signes de loyauté posés
par Ney auprès du roi : le baiser sur la main du roi et la promesse de ramener Napoléon dans une
cage de fer. Le maréchal Ney fait alors preuve d’une grande loyauté envers Louis XVIII, alors que la
royauté reconnaît la qualité militaire de Ney, et sa force galvanisante auprès des soldats. Les politiques
de compromis entre l’Empire et la monarchie mises en place lors de la Première restauration peuvent
nous éclairer sur la confiance donnée au maréchal Ney. Ce dernier connaît bien Napoléon : frères
d’armes, ils ont bâti un empire. Louis XVIII ne peut diriger un État fragilisé en congédiant tous les
militaires associés à l’aventure napoléonienne.
La prise de connaissance par le roi de la proclamation provoque alors une « rupture de
réalité »110, un sentiment de stupéfaction devant celui qu’on croit faire confiance. La rupture opérée
par le maréchal Ney : « implique aussi une révélation douloureuse, car la trahison apprend ou rappelle
la fragilité de tout ensemble social »111. En effet, on peut lire dans le procès le sentiment ressenti par
ce roi trahi : « le roi crut et dut croire qu’il s’était concilié tous les cœurs qui n’étaient pas entièrement
fermés au sentiment de la reconnaissance, de l’honneur et de l’amour de la patrie. Pouvait-il en douter?
Il avait reçu des serments, et il n’appartient qu’au parjure de se méfier de la foi du serment »112. La
douleur du roi est la preuve de la promesse faite par Ney.
Un militaire sans honneur
La rupture du serment de Ney vient ruiner l’honneur associé à sa gloire militaire: « Il devait
périr s’il le fallait ; il eût emporté dans sa tombe toute la gloire qu’il avait acquise ; et il ne serait pas
réduit, puisqu’il faut que je prononce le mot, à l’ignobilité de dire que le péril l’a empêché de faire son
devoir »113. Le mot de Bellart résonne fort : ignobilité découle du mot ignoble. Selon le Larousse, on
108 Sébastien Schehr, Traître et trahison, 2008, p. 71. 109 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 45. 110 Sébastien, Schehr, Traîtres et trahison, 2008, p. 72. 111 Sébastien, Schehr, Traîtres et trahison, 2008, p. 74. 112 Procès du maréchal Ney, Tome 1, 1815, p. 4. 113 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50.
31
définit l’ignoble comme quelque chose qui « inspire du dégoût, de la répulsion, qui est très laid, très
mauvais ou très sale. Qui est capable des actions les plus viles, les plus dégradantes ». Jadis associé
à sa bravoure, le maréchal Ney est maintenant dépeint comme quelqu’un qui inspire le dégoût. Face
à un immense défi, soit celui d’empêcher Napoléon de prendre le trône de son roi, Ney a plutôt choisi
de le trahir. L’objectif est de « prouver » que la bravoure du maréchal Ney est finalement une fausseté
avouée, puisque la peur de mourir lui a empêché de défendre son roi devant tous les dangers. Dans
les cas de trahison, la punition s’accompagne le plus souvent d’une stigmatisation du traître en face
du corps social (le « Nous »). Pour stigmatiser Ney, ses accusateurs vont tenter de l’exclure du corps
social français en affirmant que sa trahison est assez grave pour « […] soulever l’indignation
universelle »114.
Les commissaires du roi utilisent allégrement la stature héroïque de Ney contre lui-même. On
peut même se demander s’ils n’ont pas exagéré la « légende » pour mieux le rabaisser et démontrer
son « ignobilité ». La posture adoptée par les accusateurs est probablement motivée par l’hypocrisie.
Il est difficile de croire que des royalistes ont de l’estime pour un maréchal d’Empire ayant hypothéqué
leur monarchie. En tout cas, Bellart déploie son talent oratoire pour expliquer comment la bravoure
légendaire de Ney atteste de sa trahison : « il est un de ces hommes dont l’honneur est la vie, dont la
valeur est l’essence, qui ne connaissent pas même le sens de ces mots, peur et danger »115. Dans un
élan moraliste qui le caractérise bien lors du procès, Bellart utilise une puissante métaphore pour
comparer le maréchal « brave » et celui qui est dorénavant « ignoble » :
Lorsqu’au fond des déserts, autrefois couverts de cités populeuses, le voyageur philosophe qu’y conduit cette insatiable curiosité caractéristique de notre espèce, aperçoit les tristes restes de ces monuments célèbres construits à des âges reculés, dans le fol espoir de braver le faux du temps, et qui ne sont plus aujourd’hui que des débris informes, et, pour ainsi dire, une fugitive poussière, il ne peut s’empêcher d’éprouver une mélancolie profonde, en songeant à ce que deviennent l’orgueil humain et ses ouvrages. 116
Les monuments construits à des âges reculés représentent pour le maréchal Ney son passé
militaire glorieux, et les débris informes, sa trahison envers le roi. Finalement, on associe sa trahison
à une désertion militaire : « le maréchal Ney a trahi sa gloire passée non moins que son roi, sa patrie
et l’Europe que par la désertion la plus criminelle, si l’on songe au gouffre de maux dans lequel elle a
plongé la France. Il consommait sa propre gloire »117. Mais ce n’est pas tout, selon Bellart : la gloire de
114 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50. 115 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50. 116 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 21. 117 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50.
32
Ney et l’ascendant qu’elle lui donne sur ses soldats ajoutent à sa trahison. En plus de ternir sa gloire
et son honneur, Ney trahit son armée, ce qui n’est pas anodin pour un militaire. Une armée, selon les
accusateurs, qui serait restée entièrement fidèle au roi si Ney n’eut pas lu sa proclamation118 : « […] le
gros des soldats savait résister encore aux brouillons et aux mauvais esprits »119. Toutefois, grâce à
sa réputation d’illustre guerrier, Ney a influencé ses soldats sur la « route de la parjure »120. Dans son
plaidoyer, Bellart penche dans le même sens, pointant Ney comme l’artisan de la désertion des soldats
du roi : « les troupes auraient été si faciles à maintenir dans un devoir qu’en effet, le cœur des Français
n’est pas fait pour trahir quand la perfidie ne cherche pas à les égarer »121. Dans les mots de Bellart,
la gloire de Ney s’efface : sa trahison montre à la France entière sa vraie nature; sa mémoire posthume
doit donc représenter cette vraie nature, et non son passé bonapartiste. Sa faute est entière, et il doit
répondre des problèmes qu’il a causés à la France.
Le commissaire du roi en rajoute sur la « fausse » gloire du maréchal Ney. Bellart attaque
directement le prestige militaire de Ney en l’accusant de ne pas avoir eu le courage d’affronter
Napoléon : « […] comme il convient aux braves, en plein jour, et au champ d’honneur, pour le
combattre et le détruire »122. Selon lui, le maréchal Ney choisit plutôt de sombrer dans : « une alliance
honteuse […] pour lui livrer [à Napoléon] son Roi, sa patrie, et jusqu’à son honneur »123. Ce
comportement « propre des traîtres »124 place Ney dans le camp des mauvais militaires, ceux pour
qui le mensonge est un moyen d’arriver à leur fin. Pire encore, Ney transpose ses égarements auprès
de ses soldats.
Selon les accusateurs, cette ruse du maréchal Ney peut aussi prouver que depuis le départ, il
trempe dans un vaste complot bonapartiste. Avec des témoins soigneusement sélectionnés, la
couronne va essayer de prouver que Ney fut l’un des artisans du retour en France de Napoléon.
118 Notons que cette partie est dans l’acte d’accusation lu le 21 novembre 1815. 119 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 25. 120 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 26. 121 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 50. 122 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 26. 123 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 26. 124 Procès du maréchal Ney, Tome 2, 1815, p. 26.
33
Ney et le complot bonapartiste
Comme nous l’avons observé plus haut, le « brusque » changement de loyauté de la part de
Ney est curieux pour ses accusateurs. C’est avec l’aide de 38 témoins présents lors de l’audition avec
le roi à Paris ou à Lons-le-Saulnier que les commissaires du roi tentent de convaincre les juges du
bien-fondé de leurs soupçons. L’essentiel des questions posées aux témoins se penche sur les gestes
et surtout les paroles du maréchal Ney avant et après la lecture de sa proclamation.
Les témoins ne faisant pas partie de la garde rapprochée de Ney ne peuvent prouver si Ney
aurait participé à un complot bonapartiste. Ils le décrivent plutôt comme loyal envers le roi tant dans
ses paroles que dans ses gestes posés sur le terrain. Ces témoins fondent leurs dépositions sur les
décisions militaires que Ney prend à son arrivée à Lons-le-Saulnier: mouvements de troupes, envoi
d’espion dans les villes sous l’emprise de Napoléon, examen des forces et inventaires du matériel
militaire dans le département. Par exemple, dans sa déposition du 16 octobre 1815, Étienne-Anastase-
Gédéon Jarry, commandant du département du Jura, répond à la question :
Que vous dit-il du débarquement de Buonaparte, de sa marche en France et de ses progrès? Il me dit que Buonaparte avait réellement débarqué, que ses dernières campagnes étaient marquées au coin de l’extravagance, qu’il avait fait beaucoup de mal à l’armée et à la France, et qu’il fallait l’empêcher qu’il ne vînt recommencer: qu’il fallait bien s’entendre pour servir le Roi et la patrie que la chose serait bientôt finie, que ce n’était qu’un trac à faire, et qu’il fallait courir droit à la bête […]. 125
D’autres témoins, plus proches du commandement à Lons-le-Saulnier mettent directement en
cause les paroles et les gestes du maréchal Ney avant même la lecture de la proclamation du 14 mars
1815. Plusieurs témoignages attaquent la crédibilité du maréchal en lui prêtant un rôle dans
l’hypothétique complot qui impliquerait l’Autriche, Napoléon et des maréchaux d’Empire. Des
témoignages recueillis, ceux du lieutenant-général de Bourmont et du général Lecourbe sont les plus
importants. Ce sont les deux seuls militaires présents aux côtés du maréchal Ney lorsqu’il leur présente
la proclamation reçue durant la nuit du 13 mars 1815 par l’entremise de l’émissaire et compagnon de
route de Napoléon, le général Bertrand. À noter que seul Bourmont témoigne lors du procès puisque
le général Lecourbe est décédé le 22 octobre 1815.
Avant de faire comparaître le général de Bourmont, les accusateurs appellent à la barre le
comte de Saverney qui organise la Garde nationale et les volontaires durant les 10, 11, 12 mars à
125 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 50.
34
Lons-le-Saulnier. Nous présumons qu’il s’agit d’une stratégie pour compromettre Ney dès le premier
témoin, pour mettre la pression et le fardeau sur l’accusé. Après la défection de Ney, ce témoin se
rend à Paris avec Lecourbe qui lui aurait dit que le débarquement de Napoléon « […] était arrangé
d’avance »126. Bien qu’il rejoigne Napoléon quelques jours plus tard, Lecourbe aurait aussi déclaré au
comte de Saverney : « […] je n’ai éprouvé que mécontentement de Buonaparte, et j’ai éprouvé que
des actions de grâce à rendre au Roi »127. En oubliant de mentionner que Lecourbe rejoint Napoléon,
il est possible que ce témoignage veuille donner plus de crédibilité à la déposition du général Lecourbe
comme nous le verrons après avoir examiné l’interrogatoire de Bourmont.
Le témoignage suivant, celui du général de Bourmont, précise les paroles que le maréchal Ney
aurait prononcées avant de lire la proclamation devant ses soldats. La biographie de Bourmont permet
de comprendre l’animosité présente entre lui et Ney lors du procès128. Après la Révolution, de
Bourmont joint l’armée de Condé, qui rassemble des émigrés, et participe aux campagnes de 1792 et
1794. Durant la guerre de Vendée, il a été le chef des armées du Maine et du Perche. Bien
qu’emprisonné pendant quatre années après avoir refusé de servir l’Empire, il s’engage néanmoins à
la campagne de Russie et reçoit la Légion d’honneur129. Au moment du procès, il est commandant de
la 2e division de la garde royale. Ce témoignage est le plus accablant pour Ney. Selon le récit du témoin
Bourmont, il demande au maréchal Ney de ne pas présenter cette proclamation aux troupes puisqu’elle
aurait pu les compromettre au profit de Napoléon. Ney répond, alors que le général Lecourbe entre
dans la même pièce : « Eh, mon ami, l’effet est produit; dans toute la France, c’est de même: tout est
fini […] Je suis bien aise de vous voir, mon cher Lecourbe, je disais à Bourmont que tout est fini: il y a
trois mois que nous sommes tous d’accord. Si vous aviez été à Paris, vous l’auriez su comme moi »130.
Ces mots attribués à Ney prouvent deux choses pour les commissaires du roi: Ney a bel et bien
participé à un complot, et les gestes de loyauté exprimés au roi s’avèrent donc faux. La trahison est
consommée bien avant la lecture de la proclamation. Cependant, Ney, lors du procès, répond à
Bourmont : « je regrette bien vivement que Lecourbe soit mort, mais je l’interpellerai dans un autre lieu
126 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 7. 127 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 7. 128 Répondant aux accusations du lieutenant-général de Bourmont, Ney s’exprime ainsi à son procès: « Il parait que M. le général de Bourmont a fait son thème à loisir; il ne croyait pas que jamais nous dussions nous revoir. Il espérait que je serais traité à la chaude comme Labédoyère » (procès, T. 3, p. 9). 129 André Borel d’Hauterive, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, Paris, Henri Plon, 1862, p. 139-140. 130 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 8.
35
qu’ici, plus haut, et là vous répondrez, M. de Bourmont »131. Ney tente de faire comprendre que les
émissaires de Napoléon lui ont dit que tout était prévu et qu’il n’a pas participé à ce complot.
Continuant, Ney confronte Bourmont : « M. de Bourmont peut dire ce qu’il veut. Il n’y a pas d’autre
témoin que lui et moi : mais je dis la vérité. Il me charge pour faire valoir sa conduite »132.
Le maréchal Ney s’oppose donc catégoriquement aux accusations du général de Bourmont.
Ce dernier semble avoir modifié la version du général Lecourbe, l’impliquant dans sa version des faits
sans qu’il puisse la corroborer. Nous ressentons d’abord une sincère amitié entre le général Claude-
Jacques Lecourbe et Ney. Les deux ont combattu dans l’armée du Rhin, notamment sous le général
Moreau133. L’attachement de Lecourbe pour ce général ennemi de Napoléon lui vaut l’exil et d’être
surveillé par la haute police sous l’Empire. Il rejoint Louis XVIII en 1814, et Napoléon lors des Cent-
Jours134. En effet, dans une lettre datée du 16 mars 1815 et adressée à son beau-frère, le général
Gauthier, Lecourbe exprime sa pensée: « Si les étrangers veulent entrer en France, et que Napoléon
soit sur son trône, mon cœur et mon bras sont à lui […] »135. Dans sa déposition, Lecourbe a été
beaucoup moins acerbe que Bourmont, et défend partiellement Ney. En effet, avant le 14 mars, Ney
apparaît pour lui : « […] dans les meilleures intentions pour le roi »136. Ce n’est que lorsqu’ils sont les
deux, Bourmont et Lecourbe, dans la chambre de Ney que ce dernier : « […] chercha à nous persuader
que c’était une affaire arrangée, que rien n’empêcherait Buonaparte d’aller à Paris »137.
Pour ses accusateurs, la conduite de Ney baigne dès le départ dans la trahison. Bien que sa
participation dans le complot de Napoléon ne soit pas véritablement prouvée, les éléments avancés
par ces témoins se retrouvent dans les accusations. Bellart, lors de sa lecture de celles-ci, met
l’emphase d’abord sur le fait d’avoir entretenu des « intelligences » avec Napoléon pour faciliter son
avancée territoriale. L’utilité de ces témoignages est de faire le lien entre le serment au roi brisé, et la
lecture de la proclamation : la présence d’un « complot » prouve donc que les deux évènements sont
liés. Plus largement, un climat vengeur se dégage de ce procès. On tente de démontrer que Ney n’est
131 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 9. 132 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p.10. 133 Notons que Lecourbe témoigne au procès de Moreau, alors que Ney y est absent. 134 Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire: 1792-1814, Tome 2, Paris, Georges Saffroy, 1934, p. 86-87. 135 Famille Lecourbe, Le général Lecourbe, d’après ses archives, sa correspondance et d’autres documents, Paris, Henri-Charles Lavauzelle, 1895, p. 488. 136 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 25. 137 Procès du maréchal Ney, Tome 3, 1815, p. 25.
36
pas ce brave tant célébré, mais bien un traître, un ignoble militaire qui s’est détourné de ses devoirs
envers son roi. Ney a évidemment fait défaut à Louis XVIII, mais ce procès veut surtout détruire la
réputation du maréchal Ney, le sortir du corps social français tout en publicisant sa descente aux enfers
et la donner en exemple pour ceux qui voudrait trahir le roi et la monarchie.
Le 8 décembre 1815, le duc de Richelieu prend la parole à la Chambre des députés pour
présenter une loi d’amnistie datée et signée par Louis XVIII le 7 décembre 1815, le jour de l’exécution
de Ney. Le premier article de cette loi stipule qu’une : « Amnistie pleine et entière est accordée à ceux
qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rébellion et à l’usurpation de Napoléon
Buonaparte […] »138. Le gouvernement utilise la condamnation du maréchal Ney pour resserrer
l’agenda politique autour de la réconciliation en imposant cette amnistie. Ce n’est d’ailleurs pas pour
rien que le duc de Richelieu rappelle la mémoire d’Henri IV dans son discours devant les députés:
« Messieurs, la mesure qu’on vous propose n’est pas nouvelle dans nos annales. Henri IV, dont nous
nous plaisons à rappeler la mémoire publia en 1594 une loi d’amnistie semblable, et la France fût
sauvée… »139. Le traître est donc condamné, et le pardon et l’oubli peuvent désormais prévaloir au
sein de la société française.
Surveiller un condamné
Au cours du procès du maréchal Ney, les autorités s’efforcent de diffuser la figure du traître de
Ney dans l’espace public tout en réprimant et surveillant toutes actions sortant de ce cadre : Ney doit
être et rester un traître. Seul le message du gouvernement doit se rendre aux citoyens par l’entremise
des journaux royalistes qui relaient chaque séance du procès. Le Journal des débats politiques et
littéraires, et la Gazette de France sont les deux principaux canaux utilisés par les autorités pour
diffuser le procès. Leur rôle n’est pas de le « commenter », mais bien d’uniquement diffuser les procès-
verbaux. Ce mode opératoire veut donc présenter aux Parisiens la déconstruction du maréchal Ney
décrite plus haut, pour mieux imposer auprès de l’opinion publique la figure du traître de ce militaire
dorénavant sans honneur.
138 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archive parlementaire, S.2, T.15. 1869, p. 429. 139 Jules Mavidat et Émile Laurent, Archive parlementaire, S.2, T.15. 1869, p. 423.
37
La surveillance policière joue un rôle complémentaire en assurant la répression d’actions
publiques qui contestent cette version. Le Palais de justice et la prison du Luxembourg sont les deux
premiers lieux qui attirent l’attention policière. Dès le 13 novembre 1815, le préfet de police Anglès
ordonne d’augmenter la surveillance du Palais de justice puisque: « l’ordonnance du roi qui renvoya à
la chambre des Pairs le jugement du maréchal Ney, et le discours de S. Ex. le duc de Richelieu
prononcé à cette occasion agite les ennemis du gouvernement »140. Précisant qu’il faut redoubler de
prudence et de sûreté, il ordonne au commandant de la Garde nationale parisienne, le maréchal de
Reggio : « […] que quelques hommes de la Garde nationale à cheval très sûrs et très dévoués passent
la nuit pendant toute la durée du procès du maréchal Ney, dans la cour de garde de la prison de justice,
et quelques autres couchent dans la grille qui est à côté de la porte d’entrée de cette prison »141. Élie
Decazes, ministre de la Police générale s’inquiète de l’influence de Ney et demande l’envoi de militaires
départementaux parce qu’il: « […] serait possible que des hommes audacieux voulussent se porter à
quelques coups d’éclat en sa faveur »142.
D’autres lieux sont touchés par une surveillance active compte tenu du procès du maréchal
Ney. Tous les endroits publics peuvent finalement être suspectés par les autorités, jusqu’au cœur de
l’organisation policière. Le ministre de la Police craint que la Préfecture de police de Paris ne soit la
cible d’attaques. Il donne l’ordre le 18 novembre 1815 de placer douze hommes à cheval et douze
hommes à pied devant la porte de la Préfecture et que ces hommes devront faire : « […] de fréquentes
patrouilles sur les quais, autour du palais de justice et de la préfecture »143. Cette surveillance s’étend
également sur les boulevards, les ponts, les faubourgs et les quartiers désignés comme dangereux
par les autorités144. De plus, dans cette même lettre, le ministre demande au maréchal de Reggio de
faire le même exercice de patrouille avec la Garde nationale parisienne. Dans une autre
correspondance entre le ministre de la Police et le préfet de Pairs, le rôle de ces patrouilles se précise.
Elles doivent parcourir les rues, et entrer dans des lieux de socialisation comme les cabarets et les
cafés pour y observer les interactions. L’usage de la force est encouragé : « […] ils feront dissiper, en
140 « Lettre du préfet du Paris Jules Anglès au maréchal de Reggio du 13 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 141 « Lettre du préfet du Paris Jules Anglès au maréchal de Reggio du 13 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 142 « Lettre du ministre de la police Élie Decazes au commandant de la 1e division Despinoy du 14 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 143 « Lettre du commandant de la 1e division Despinoy répondant aux ordres du ministre de la police Élie Decazes du 18 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 144 Saint-Denis; du Temple; Saint-Antoine; Saint-Marceau.
38
requérant la force armée, ceux qui deviendraient trop nombreux ou se formeraient trop près du Palais
et du Jardin »145. Les différentes relations entre ces deux paliers de pouvoir, le ministre de la Police et
du préfet de Paris, expriment bien l’importance pour les autorités de garder la mainmise sur le message
véhiculé dans l’espace public. Les policiers ont l’ordre d’entrer à l’intérieur de lieux et d’arrêter les
citoyens « suspects » pour arriver à leur fin, c’est-à-dire de limiter le commentaire public du procès aux
journaux acquis au gouvernement.
D’ailleurs, le 8 décembre 1815, au lendemain de l’exécution du maréchal Ney à la place de
l’Observatoire, la presse brise partiellement la « réserve » gardée au cours du procès. Le Journal des
débats politiques et littéraires célèbre un procès dont le processus fut impartial: « […] jamais
l’expression de la justice n’a paru sortir d’une conviction plus vraie et plus profonde »146. Plus loin, le
journal en rajoute : « […] un guerrier justement célèbre par sa valeur, mais qui a déshonoré une vie
héroïque par une trahison sans égale dans l’histoire […] »147. Ces propos font nécessairement écho à
ceux du commissaire du roi Bellart. Comme le procès se veut exemplaire, il est important de souligner
pour la sphère publique que dans un processus dit impartial, Ney est véritablement ce traître dépeint
par Bellart lors du procès. La Gazette de France nomme l’exécution du maréchal Ney « […] un grand
acte de justice […] »148. La Quotidienne du 18 décembre 1815 relaie et traduit même une nouvelle
parut le 13 décembre 1815 dans le Times de Londres:
L’exécution du maréchal Ney a démontré que la puissance de la loi est supérieure en France à toutes les influences particulières. L’existence d’un traître aussi criminel offrait une sorte de problème. Tant il vivait, on ne savait pas si l’autorité légitime était assez forte pour punir ceux qui la braveraient. La chambre des pairs a fait triompher la justice, et la prompte exécution de sa sentence a dû produire un excellent effet sur les esprits. 149
Parallèlement aux commentaires de la presse, le gouvernement utilise l’exécution publique de
Ney pour publiciser l’exemplarité de la sentence. Habituellement, les exécutions se déroulent à la
plaine de Grenelle comme le précise un dictionnaire topographique de Paris publié en 1816:
La plaine de Grenelle est célèbre parmi la populace de Paris, parce que, depuis longtemps, elle sert de théâtre aux exécutions des jugements de la première division militaire. Quand le bruit d’une de ces
145 « Lettre du préfet de Paris Jules Anglès au ministre de la police Élie Decazes du 21 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 146 Journal des débats politiques et littéraires, 8 décembre 1815, p. 2. 147 Journal des débats politiques et littéraires, 8 décembre 1815, p. 2. 148 Gazette de France, 9 décembre 1815, p. 1. 149 La Quotidienne, 18 décembre 1815, p. 1.
39
exécutions se répand à Paris, on voit, le jour indiqué, accourir en foule le peuple de la capitale, pour venir, dans cette plaine de la mort, savourer le plaisir atroce de voir fusiller un homme. 150
Ce geste politique qu’est l’exécution demeure l’ultime punition appliquée aux traîtres. Elle
théâtralise la domination de la monarchie sur le puni. Pour le pouvoir, la métaphore est puissante: le
condamné représente les dissidents, la foule, la nation, et les militaires, la hiérarchie, sans oublier les
représentants du gouvernement. Finalement, l’exécution publique doit mener : « le nom et la mémoire
du condamné à l’exécution de la postérité »151. Cependant, il faut dire que pour un gouvernement,
l’organisation d’une exécution publique est un jeu dangereux, notamment lorsque le condamné est un
important militaire qui peut attirer les curieux : « […] le rituel de domination risque d’être inversé: par le
refus du repentir de la part du condamné, par l’émotion et les grondements d’une foule hostile »152.
L’exécution du maréchal Ney n’échappe pas à ce risque, et c’est d’ailleurs pourquoi que les autorités
choisissent l’Observatoire plutôt que la plaine de Grenelle pour pratiquer l’exécution : pour faire
diversion des habituelles exécutions, et réduire le temps de déplacement entre la prison pour minimiser
l’attroupement de citoyens.
Ce stratagème joue avec la figure du traître du maréchal Ney sur deux tableaux. Le
gouvernement veut attirer assez d’individus pour rendre l’exécution publique, tout en voulant réduire
la possibilité d’émeutes ou la présence d’un trop grand nombre de citoyens. Selon un rapport de police
sur déroulement de l’exécution, l’exécution rassemble « […] deux cents spectateurs »153. Le même
rapport recense la présence de volontaires, de grenadiers royaux, de vétérans, ainsi que de gendarme.
Ces spectateurs, à l’exception des gendarmes, ont crié Vive le roi! à la mort de Ney, alors que : « […]
le peuple ouvrier, qui composait la plus grande partie des curieux, est resté dans un silence
morne […] »154. L’auteur du rapport, en parcourant les rues de Paris après l’exécution, rapporte une
version qui scelle la figure du traître dans la sphère publique. Le travail des autorités semble avoir
réussi : « j’y ai entendu peu de plaintes, j’ai vu quelques personnes, surtout les militaires, avoir l’air
affectées; mais en général l’on disait : c’est un grand acte de justice sévère; mais nécessaire »155.
150 Pierre Piétresson de Saint-Aubin, Dictionnaire historique, topographique et militaire de tous les environs de Paris, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1816, p. 373. 151 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 439. 152 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 440. 153 « Rapport de police au ministre de la Police du 8 décembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 154 « Rapport de police au ministre de la Police du 8 décembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 155 « Rapport de police au ministre de la Police du 8 décembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ».
40
De la publicisation de l’exécution du maréchal Ney, sa figure doit maintenant disparaître de
l’espace public. Les autorités vont alors prendre certaines mesures pour subtiliser le condamné aux
yeux des curieux qui voudraient le célébrer et le commémorer après sa mort.
L’impossible dissimulation d’un cadavre
Si pendant le procès les autorités compilent, écoutent et encadrent les gestes et opinions des
Parisiens à propos du procès du maréchal Ney, le pouvoir doit, après l’exécution, composer avec le
corps du fusillé de façon discrète dans un endroit tenu secret. Selon l’analyse d’Emmanuel Fureix,
l’inhumation des condamnés politiques, sous les monarchies censitaires, est normalement
accompagnée d’un devoir de silence, en plus d’être soumise à l’article 14 du Code pénal156. En d’autres
mots, ces condamnés n’ont pas le droit à des funérailles publiques. De plus, le lieu précis de la tombe
doit rester secret pour : « […] marquer l’infamie du cadavre et de sa mémoire, et à prévenir tout culte
futur »157. Grâce aux Souvenirs du comte de Rochechouart, commandant de la place de Paris qui a
surveillé l’exécution du maréchal Ney, nous avons accès aux ordres qu’il a reçus quant à la gestion du
corps du fusillé. Selon les ordres du lieutenant général commandant de la 1re division militaire,
François-Joseph Despinois : « Le cadavre sera exposé quelque temps, et gardé par des piquets
d’infanterie et de cavalerie […] S’il n’est point réclamé, il sera relevé à la diligence de la police civile et
déposé à l’hôpital de la Maternité […] »158. Le récit de Rochechouart confirme que le corps de Ney
n’est pas réclamé par la famille159, et que la dépouille est conduite à l’hospice de la Maternité, située
au sud du palais du Luxembourg160. Dans sa biographie Précis historique de la vie et du procès du
maréchal Ney (1816), François-Frédéric Cotterel précise que Ney « […] fut déposé dans un cercueil
de plomb, et transporté le lendemain à six heures du matin au cimetière du père Lachaise »161. Les
sources consultées ne précisent pas les modalités du transfert de Ney entre l’hospice de la Maternité
et le cimetière du Père-Lachaise, mais nous savons que cet itinéraire inquiète le ministre de la police
156 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 441 157 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 441-442 158 Louis-Victor Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1892, p. 436. 159 Le comte de Rochechouart prétend que celle-ci n’avait pas été prévenu à temps (p. 422). 160 Girault de Saint-Fargeau, Les quarante-huit quartiers de Paris, biographie historique et anecdotique des rues, des palais, des hôtels et des maisons de Paris, Paris, Firmin Didot frères, 1846, p. 188. 161 François-Frédéric Cotterel, Précis historique de la vie et du procès du maréchal Ney, Paris, J.-G. Dentu, 1816, p. 72.
41
Élie Decazes : « [...] parce qu’on pourrait abuser d’un transport éloigné pour préparer un
rassemblement qui troublerait l’ordre public »162.
Du reste, l’inhumation de la dépouille de Ney est chargée à la famille, bien qu’elle doive
respecter les règles de silence dictées par les autorités. Par contre, des « itinéraires » de tombes
célèbres du cimetière du Père-Lachaise semblent contourner les efforts du gouvernement de vouloir
étouffer tout culte posthume en faveur du maréchal Ney que ce soit pour la première tombe de 1815,
ou la deuxième de 1816. D’abord, pour la première tombe, ces ouvrages indiquent assez précisément
le lieu de la tombe. Dans le Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris avec leurs épitaphes
et inscription (1825), nous apprenons que la première tombe : « […] était situé près du mur de la
clôture, entre le quinconce et la superbe allée de charmilles que l’on a détruite »163. Dans Promenade
aux cimetières de Paris (1825), l’ouvrage précise que le premier tombeau est situé : « […] au sommet
nord-ouest du plateau qui s’élève de derrière la chapelle. Un monument simple en pierre de liais lui fut
élevé »164. Bien que ces ouvrages soient publiés 10 ans après l’érection de la tombe de 1815, la
localisation de celle-ci est connue et décrite par ces itinéraires, ce qui peut démontrer les limites de la
répression des autorités.
Ces itinéraires révèlent aussi des activités commémoratives autour de la première tombe de
Ney. Encore une fois, ces informations contredisent les efforts du pouvoir de garder dans l’ombre la
mémoire de Ney. Bien que publié en 1820, l’ouvrage Promenade aux cimetières de Paris, aux
sépultures royales de Saint-Denis, et aux Catacombes recense sa dernière visite de la tombe de Ney
au 28 avril 1816. Cette date nous confirme qu’il s’agit bien de la première tombe puisque la deuxième
tombe date de novembre 1816. L’auteur fait une description des différents objets et gestes
commémoratifs: « […] cette tombe était jonchée de bouquets, et de couronnes de fleurs entrelacées
d’immortelles. Sur la pierre, de nombreuses inscriptions avaient été mises au crayon, et sans doute
elles étaient un peu trop en harmonie avec les causes qui ont conduit le maréchal à la mort, car une
main plus prudente avait pris soin de les effacer »165. L’assertion de Pierre Piétressons confirme en
162 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 344. 163 C.-P. Arnaud, Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris avec leurs épitaphes et inscriptions, Tome 2, Paris, Arnaud, 1825, p. 9. 164 Pierre Piétressons de Saint-Aubin, Promenade aux cimetières de Paris avec quarante-huit dessins, Paris, C.-L.-F Panckoucke, 1825, pp. 95-96. 165 Pierre Piétressons de Saint-Aubin, Promenades aux cimetières de Paris, aux sépultures royales de Saint-Denis et aux catacombes, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1825, p. 61.
42
quelque sorte qu’il y a bel et bien une activité commémorative autour de la première tombe de Ney
tout en affirmant que les autorités s’efforcent à effacer les mots en faveur de Ney. Dans la même veine,
C. P. Arnaud décrit des gestes commémoratifs sur la première tombe : « le tombeau du maréchal était,
chaque jour, orné de plusieurs couronnes. La terre, enfermée dans une balustrade, était incessamment
jonchée de fleurs […] »166. On parle même dans l’ouvrage de Théodore de Jolimont, Les mausolées
français (1821) du développement « […] d’un culte fanatique, jonché chaque jour de fleurs et de
couronnes, et couvert d’inscriptions inconvenantes […] »167. Ces exemples d’actions commémoratives
signalent la difficulté du pouvoir à garder la première tombe de Ney dans le secret. C. P. Arnaud insère
même dans son ouvrage une gravure de la tombe de 1815 (Fig. 1) sur laquelle le nom du maréchal
est clairement inscrit ce qui déroge encore une fois à cette volonté du pouvoir de garder les sépultures
des condamnés politiques anonymes.
Figure 1: Le tombeau du maréchal Ney en 1815
C.-P. Arnaud. 1825. Lithographie. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475910x/f21.item.texteImage.zoom
Au mois de novembre 1816, le beau-frère du maréchal Ney, Charles-Guillaume Gamot fait une
demande au ministre de la Police, Élie Decazes, pour que les restes du maréchal soient transférés
dans un caveau familial du cimetière du Père-Lachaise. À la lumière des informations recueillies à
166 C.-P. Arnaud, Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris, Tome 2, 1825, p. 9. 167 Théodore de Jolimont, Les mausolées français, Paris, Firmin Didot, 1821, p. 169.
43
propos des actions commémoratives sur la première tombe de Ney, il est possible que les autorités
aient accepté ce transfert pour brouiller les pistes. Dans un rapport au ministre daté du 27 novembre
1816, le préfet de Paris, Jules Anglès, fait une description précise de cette délicate opération. Ce
rapport nous confirme d’emblée que le maréchal repose bien au cimetière du Père-Lachaise en 1815,
et que son nouveau caveau doit être anonyme, c’est-à-dire : « […] sur lequel il ne devait être élevé
aucun monument, ni gravé aucune inscription »168. Un an après son exécution, le transfert du
condamné est toujours une opération minutieuse pour le préfet de Paris:
Cette opération a été concertée avec tout le soin et exécutée avec tout le secret que son Excellence [Decazes] avait recommandé; au moyen des précautions qui avaient été prises d’avance, tous les travaux préparatoires ont été faits la nuit par le nombre d’ouvriers strictement nécessaires, et sur la discrétion desquels on pouvait le plus compter. Le déplacement du corps et son dépôt dans le nouveau caveau sur lequel il n’y avait ni monument ni inscription ont été faits ensuite de six à sept heures du matin par les mêmes ouvriers, en présence des seules personnes nécessaires, et à huit heures l’opération était terminée, et toutes les traces de l’ancien monument avaient entièrement disparu […]. 169
Selon les ouvrages consultés, cette deuxième tombe semble faire l’objet d’une surveillance
plus serrée. Contrairement à la première tombe, le caveau préparé par M. Gamot, selon les illustrations
disponibles, n’a pas de stèle et est entouré par un grillage de métal (Fig. 2). Bien que ce caveau soit
beaucoup plus anonyme, Ney repose étrangement aux côtés de ses anciens compagnons de
guerre: « C’est non loin des pyramides en marbre, des sarcophages pompeux de ses anciens
compagnons […] que sont déposés, sous un humble gazon, sans aucun signe extérieur, les restes
oubliés du maréchal Ney »170. La présence de Ney à proximité d’anciens maréchaux d’Empire entre
encore en contradiction avec la volonté de réduire sa mémoire au silence. D’abord, C. P. Arnaud
corrobore que Ney repose avec d’autres maréchaux : « […] où s’élève le monument du maréchal
Masséna […] ainsi que le maréchal Lefèvre et d’autres braves de l’armée »171. Selon un plan
topographique publié en 1824, Ney repose effectivement près d’anciens maréchaux d’Empire :
Masséna, Lefebvre et Davoust (Fig. 3). Par contre, lorsque Ney est enterré à cet endroit en 1816,
aucun de ces trois maréchaux n’est encore décédé. Successivement, Masséna (1817), Lefebvre
(1820) et Davoust (1823) vont être enterrés dans le même secteur que Ney. Et contrairement à Ney,
chacun de ces maréchaux a eu le droit à des funérailles publiques, suivi de cortèges dans lesquels
168 « Lettre du préfet de Paris Jules Anglès au ministre de la police Élie Decazes, 27 novembre 1816 », F7 6683, « Dossier Ney ». 169 « Lettre du préfet de Paris Jules Anglès au ministre de la police Élie Decazes, 27 novembre 1816 », F7 6683, « Dossier Ney ». 170 Théodore de Jolimont, Les mausolées français, 1821, p. 169. 171 C. P. Arnaud, Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris, 1817, p. 10.
44
des personnalités politiques et militaires sont présentes172. Maréchaux d’Empire de la première heure,
le pouvoir monarchique ne marque pas ceux-ci de l’opprobre public et commémoratif, bien que comme
Ney, ils font partie de la légende napoléonienne. Cependant, cet emplacement de choix de pour le
maréchal Ney n’égale pas nécessairement à une augmentation des activités commémoratives. À tout
le moins, selon Théodore de Jolimont, les seuls gestes visibles sur le caveau de Ney sont des
inscriptions de son nom : « […] le nom du maréchal, mille fois inscrit par les curieux sur la grille qui
entoure le nouveau lieu de sa sépulture, est le seul hommage tacite qu’on se soit permis de rendre
depuis à sa mémoire »173.
Figure 2: Caveau du maréchal Ney en 1816
Charles Motte. 1821. Lithographie. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15203496/f13.image
172 Pour Masséna, Journal Général de France, 11 avril 1817; Lefebvre : Moniteur Universel, 17 septembre 1820; Davoust : La Quotidienne, 5 juin 1823. 173 Théodore de Jolimont, Les mausolées français, 1821, p. 169.
45
Figure 3: Localisation de la tombe du maréchal Ney au cimetière du Père-Lachaise
Giraldon Bonivet. 1824. Carte. 640 x 480 cm. BnF, Dép. Cartes et Plan, GE D-14531
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8492636v/f1.item.zoom
Les étapes de ce transfert nous éclairent sur la codification des rites funéraires des condamnés
politiques. Elles prouvent que les autorités doivent garder le contrôle sur la trajectoire du cadavre du
maréchal Ney pour prévenir le plus possible l’émergence d’un contre-culte. Il faut dire que Ney, par sa
réputation de traître, n’a pas le même statut que certains autres personnages militaires et politiques.
Des hommes comme Manuel ou le général Foy ont mobilisé des milliers de citoyens dans les rues de
Paris lors de leur cortège funéraire respectif. L’enterrement de ces deux hommes est diamétralement
opposé à celui de Ney. Dans la France des larmes d’Emmanuel Fureix, l’auteur démontre que la mise
en terre de Foy (1825) a duré 10 heures, et celle de Manuel (1827), 8 heures174. Bien que ces deuils
soient qualifiés de « protestataires », ils jouissent d’une plus grande tolérance de la part du pouvoir
royal. Ce dernier réussit jusqu’en 1830 à réduire au silence toutes actions commémoratives d’une telle
ampleur liées au maréchal Ney.
La trahison, son procès, ainsi que l’exécution Ney ont permis de comprendre la fonction du
traître dans un univers politique dans lequel le gouvernement est à la recherche de légitimité. Si la
mise à mort du maréchal a pu permettre à l’ultracisme de se démarquer dans l’arène parlementaire et
d’influencer le lexique politique, celle-ci démontre plutôt à quel point le cadavre d’un traître, et sa
trajectoire posthume doivent rester sous l’emprise du pouvoir pour bloquer toutes sympathies ou
174 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 338.
46
d’honneurs publics. Avant de cacher le traître de l’espace public, de lui interdire tout honneur funèbre
et commémoratif, il faut publiciser son long châtiment, le sortir du cadre social français. Passant d’un
illustre guerrier à un traître de nature universelle, la punition appliquée à Ney est finalement un exemple
pour ceux qui voudraient emprunter la même voie, en plus d’être un vecteur d’unité pour une France
meurtrie par les divisions politiques.
47
Chapitre 2 : La victime et le martyr
Le 15 décembre 1830 s’ouvre à Paris, devant la Chambre des pairs, le procès dit des « ex-
ministres » de Charles X. Ces ministres ont été arrêtés en août 1830 pour leur tentative de modifier,
via des ordonnances royales, la Charte constitutionnelle. Polignac, Chantelauze, Guernon-Ranville et
Peyronnet tentaient de contrecarrer l’agenda politique dominé par l’opposition libérale. Ces
ordonnances avaient été présentées au public français dans Le Moniteur du 26 juillet 1830: suspension
de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, modification de la loi électorale, et
organisation de nouvelles élections175. Cette annonce ébranla le régime qu’elle cherchait à consolider.
Le 26 juillet 1830, Le Constitutionnel s’inquiétait d’un « complot contre-révolutionnaire »176; le 27 juillet,
« Les députés de la France » annonçaient la formation d’un gouvernement provisoire sous l’égide du
général Lafayette, du duc de Choiseul et du général Gérard177.
Les journées du 27, 28 et 29 juillet 1830 vont accoucher de la monarchie de Juillet, gouvernée
par Louis-Philippe, le 9 août 1830. Les premiers mois de cette nouvelle monarchie sont politiquement
difficiles: les ténors républicains tentent d’accaparer le symbole de la victoire des « Trois Glorieuses »,
soit par la presse ou grâce aux agissements des sociétés républicaines. Cette revendication de la
« victoire » éloigne et oppose les républicains à ceux que l’on nomme Orléanistes pour quoi
l’installation de Louis-Philippe sur le trône : « […] l’accomplissement définitif de la Révolution
française »178. De son côté, les bonapartistes tentent de rallier la classe ouvrière à leur projet politique.
En effet, plusieurs de nos sources évoquent un recrutement ouvrier. Par exemple, dans un rapport de
police datant du 18 novembre 1831 : « Un commissaire dit que la cause Napoléoniste recrute chaque
jour des partisans, surtout parmi la classe ouvrière »179.
Durant cet automne 1830 politiquement mouvementé, les auteurs de la pièce de théâtre Le
procès d’un maréchal de France s’apprêtent à la présenter au théâtre de la Porte Saint-Martin dans le
Xe arrondissement de Paris. Cette œuvre traite du procès du maréchal Ney. Camille Bachasson, comte
de Montalivet, alors ministre de l’Intérieur dans le ministère du banquier Jacques Laffite, explique dans
ses Fragments et Souvenirs (1810-1832) que le procès des ex-ministres était au cœur de ses
175 Le Moniteur Universel, 26 juillet 1830, p. 2. 176 Le Constitutionnel, 26 juillet 1830, p. 1. 177 Le Constitutionnel, 27 juillet 1830 (bis). 178 Arnaud Teyssier, Louis-Philippe. Le dernier roi des français, Paris, Perrin, 2010, p. 179. 179 « Rapport préliminaire du 18 novembre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
48
préoccupations : « je ne perdis pas un moment pour prendre les mesures qui me semblaient les plus
propres à livrer, le plus pacifiquement possible, la bataille d’ordre public dont la responsabilité pesait
surtout sur moi »180. C’est dans ce contexte que Montalivet invite les deux auteurs à se rendre chez lui
pour discuter de leur pièce et sa représentation au théâtre de la Porte-Saint-Martin, durant le mois de
décembre 1830 (la date exacte n’est pas connue).
Fontan et Dupeuty, les auteurs de la pièce, rapportent leur discussion avec le ministre de
l’Intérieur dans une « Lettre au rédacteur de La Tribune ». Selon leur récit, le ministre n’use pas de
menaces ou d’intimidation : « […] nous déclarant même que, quelle que fût notre résolution, [il] n’aurait
jamais recours à des mesures arbitraires, nous demanda instamment de renoncer, quant à présent, à
la représentation de notre drame »181. Les auteurs acceptent de retirer leur pièce, au nom de la « bonne
foi » de Montalivet. Il n’y a donc pas de censure ou d’interdiction en décembre 1830. Toutefois, cette
conversation fait nettement ressortir le raisonnement de Montalivet: le rapprochement entre le procès
de Ney et celui des « ex-ministres » est trop évident pour autoriser une pièce de théâtre qui puisse
galvaniser les oppositions politiques. Garant de l’ordre public parisien, le ministre semble partir de
l’idée que l’évocation du maréchal Ney en tant que victime d’un procès injuste contient une force
mobilisatrice qui peut être activée à l’occasion du procès des ex-ministres.
Dans son Dictionnaire de la langue française, Émile Littré définit victime comme : « Celui qui
est sacrifié aux intérêts, aux passions d’autrui. Il fut la victime de la calomnie »182. Cette définition
représente bien la vision de ceux qui bâtissent la figure de victime et de martyr du maréchal Ney. Pour
eux, ce dernier a été jugé par un État bourbonien à la recherche de légitimité, et son procès a été
décidé et dirigé sous l’effet des passions ultraroyalistes. En conséquence, il a été condamné suite à
de fausses accusations et victime d’une injustice. La déclinaison la plus intense de la figure de la
victime est celle du martyr. Dans son essai Sens et enjeux du martyr : de la religion à la politique, Jean-
Pierre Albert pose l’hypothèse suivante : « la référence à des saints ou des martyrs active plusieurs
schèmes anthropologiques, différents et complémentaires, qui concourent à la fois à la production du
religieux et à celle de valeurs et de représentations qui intéressent au plus haut point le politique »183.
180 Camille Bachasson, comte de Montalivet, Fragments et Souvenirs (1810-1832), Paris, Calmann Lévy, 1899, p. 162. 181 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal de France (1815), Paris, Ambroise Dupont, 1831, p. 54. 182 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Tome 4, Paris, Éditions. Hachette, 1874, p. 2478. 183 Jean-Pierre Albert, « Sens et enjeux du martyre : de la religion à la politique », p. 19, in Pierre Centlivres (dir.), Saints, sainteté et martyre. La fabrication et l’exemplarité, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2001, 200 p.
49
Ces « schèmes anthropologiques » s’appuient sur trois mécanismes : la construction d’une
transcendance, le sacrifice et l’effet d’ancestralité.
La construction d’une transcendance est mise de l’avant par l’ascétisme184 du martyr. Ce
mécanisme permet au martyr de se poser comme un être qui transcende la vie ordinaire des hommes.
Les valeurs défendues par le martyr sont dotées de cette valeur de transcendance et d’absolu parce
que le martyr a accepté la mort en leur nom. Ceux qui vont « combattre » en invoquant ces valeurs, et
sous l’égide du martyr, pourront bénéficier d’un « surcroît de légitimité »185. Pour ce qui est du sacrifice,
ce mécanisme concerne surtout les martyrs chrétiens. Si l’on dépouille la notion de sacrifice de son
origine chrétienne, le sacrifice d’un martyr politique peut souder une communauté donnée autour des
valeurs du martyr sacrifié. Le dernier mécanisme, l’effet d’ancestralité, est probablement le plus
important en ce qui nous concerne, puisqu’il permet de faire le lien entre les morts et les vivants, de
perpétuer le culte des morts. Selon Jean-Pierre Albert : « le martyr est un mort qui est ‘‘nôtre’’, dont la
mémoire est entretenue par ceux qui se reconnaissent dans la cause ou s’identifient au groupe pour
lequel il a donné sa vie »186. Si les valeurs portées par le martyr sont toujours d’actualité, l’utilité du
martyr est : « [de] marquer la distance qui nous sépare de ceux qui furent ses bourreaux, ennemis dont
il est toujours possible, si le besoin s’en fait sentir, d’identifier les descendants »187.
Dans sa réflexion sur le martyr, Jean-Pierre Albert insiste sur un autre point essentiel, celui de
l’exemplarité. Cette exemplarité est fabriquée, et elle résulte d’un travail de remodelage des
caractéristiques du martyr pour lui donner un meilleur potentiel de mobilisation. Car l’utilisation d’un
martyr est loin d’être « naïve », et elle : « […] suppose à la fois d’accentuer les traits qui valorisent la
situation du martyr et d’estomper les traits qui le rendraient tout simplement répulsif »188.
Cette théorisation de la figure de victime et du martyr permet d’éclairer notre terrain d’enquête,
et de percevoir les formes et les acteurs qui président à la présentation et l’utilisation de Ney en ces
termes. La pièce de théâtre Le procès d’un maréchal de France confirme cette opportunité puisqu’elle
bâtit une figure d’exemplarité du maréchal Ney. L’objectif de la trame narrative est de mettre en scène
le maréchal Ney comme une victime d’un processus judiciaire corrompu et d’un complot au sommet
184 Il s’agit d’une discipline volontaire du corps et de l’esprit cherchant à tendre vers une perfection. 185 Jean-Pierre Albert, « Sens et enjeux du martyre », 2001, p. 19. 186 Jean-Pierre Albert, « Sens et enjeux du martyre », 2001, p. 20. 187 Jean-Pierre Albert, « Sens et enjeux du martyre », 2001, p. 20. 188 Jean-Pierre Albert, « Sens et enjeux du martyre », 2001, p. 21.
50
de l’État. Dès la scène II, les auteurs présentent le procureur du roi, M. Nicolas-François Bellart, comme
l’architecte de ce processus judiciaire tronqué : « Heureusement, j’ai tout prévu, et le projet que nous
allons présenter au roi ne laissera aucun moyen de subterfuge au coupable »189. Les répliques prêtées
à Ney lors de son procès et de son exécution dessinent quant à eux un caractère fort et indépendant
qui s’oppose aux desseins du pouvoir. Seul dans sa chambre, courageux et lucide en attendant son
exécution, Ney dépasse les destins ordinaires et fait face à des forces qui le surpassent quand il
s’exclame : « Où s’arrêtera donc cette rage de tuer qui les anime? »190. L’effet d’exemplarité s’active
avec la dichotomie entre un pouvoir qui fomente l’injustice, et le maréchal Ney qui la combat
ardemment sans toutefois réussir.
Le curriculum vitæ des auteurs aide à comprendre le ton politique de la pièce. Louis-Marie
Fontan est connu à l’époque de la Restauration pour « […] son opposition très vive au gouvernement
des Bourbons »191. De son côté, Charles-Désiré Dupeuty a fondé un journal d’opposition, La
Nouveauté, qui est traîné devant les tribunaux sous le ministre de l’Intérieur Jacques-Joseph Corbière
(1822-1828)192. La programmation de la pièce en décembre 1830, au moment du procès des ex-
ministres, semble bien constituer un pari sur un possible « effet de mobilisation » autour de la figure
de Ney. L’attitude du ministre de l’Intérieur, M. Montalivet, pointe vers cette hypothèse. De nouveau
appelée à jouer le rôle d’un tribunal, la Chambre des pairs est critiquée pour sa clémence envers les
ex-ministres. Ici, l’effet d’ancestralité s’active encore, puisque comme lors du procès de Ney, la
Chambre des pairs semble corrompue et conciliante avec les éléments royalistes.
Dans ce deuxième chapitre, nous tenterons de mettre en lumière les commémorations et les
actions politiques associées à la figure de victime et de martyr du maréchal Ney. À l’intérieur de
l’espace public de Paris, témoin d’une « montée vers la politique »193, nous avons été particulièrement
attentifs aux forces d’oppositions politiques contre les monarchies censitaires. Les républicains et
surtout les bonapartistes nous semblent les plus susceptibles de s’emparer de Ney et d’en faire une
victime ou un martyr. Nous partirons donc à la trace de la présence éventuelle d’un Ney victime et
martyr dans les activités de ces groupes. D’une part, on sait que c’est au sein de ces groupes politiques
189 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 4. 190 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 33. 191 Félix Bourquelot et Charles Louandre, La littérature française contemporaine, 1827-1844, Paris, Félix Daguin, 1848, p. 524. 192 Félix Bourquelot et Charles Louandre, La littérature française, 1848, p. 360. 193 Maurizio Gribaudi, Paris, ville ouvrière, 2014, p. 241.
51
que plusieurs « contre-cultes » se forment autour de figures plus ou moins interdites par les
monarchies censitaires. Républicains et bonapartistes se construisent un imaginaire politique
auxquelles ces figures, qu’elles soient militaires ou politiques, poussent à l’action. Nous examinerons
plus précisément la place du maréchal Ney dans la hiérarchie mémorielle de la légende napoléonienne,
et nous chercherons à savoir s’il a été le support d’un de ces « contre-cultes ». Pour travailler sur ces
deux terrains (oppositions politiques et « contre-cultes ») ainsi que la présence, en leur sein, de l’idée
d’un Ney victime et martyr, nous allons rechercher la façon dont le nom et la mémoire de Ney auraient
pu se manifester dans l’espace public, les textes et les images. Dans un premier temps, nous partirons
à la recherche de mentions explicites de Ney comme victime et martyr à Paris à l’intérieur d’un cadre
chronologique assez large, du procès du maréchal Ney à la monarchie de Juillet. Dans un deuxième
temps, comme nous l’avons mentionné plus haut, nous tournerons notre attention vers l’espace public
parisien, où certains lieux peuvent devenir propices aux réunions ou actions politiques. Les lieux de
socialisation comme les cafés ou les cabarets seront étudiés sachant qu’ils sont épiés par la police
puisqu’ils favorisent la proximité des opinions politiques.
Ney dans l’espace public parisien
Dans cette présente partie, nous chercherons à savoir si le maréchal Ney participe à
l’imaginaire napoléonien, et surtout quelle place prendrait la figure de victime et de martyr de Ney à
l’intérieur d’un univers bonapartiste dominé par la figure de l’Empereur. Le maréchal Ney est
inévitablement associé à Napoléon Bonaparte par sa participation aux multiples campagnes militaires,
mais c’est aussi Ney qui a « abandonné » son Empereur en 1814 au profit de Louis XVIII. Rappelons-
nous qu’en 1815, Ney retourne dans le giron bonapartiste pendant les Cent-Jours. À l’aide de ces
éléments, nous chercherons ce qui invoque la mémoire de Ney ou de son exécution : d’éventuels
phénomènes récurrents, des gestes et des paroles isolées à l’intérieur de l’espace public parisien.
Pour ce faire, nous allons d’abord nous concentrer notre attention sur les actions politiques qui se
déroulent pendant le procès de Ney.
Autour du procès et de l’exécution
Les actions contestataires qui mettent de l’avant la figure du maréchal Ney sont nombreuses
dans les semaines qui précèdent son exécution. Son procès attire l’attention de la population, et celle
52
des forces de l’ordre. Dans une longue lettre au ministre de la Police Élie Decazes, le préfet de police
de la ville de Paris, Jules Anglès, avertit que : « Les rapports des officiers de Police me donnent lieu
de remarquer qu’on expose en vente avec profusion sur les quais, boulevards et dans les boutiques
de librairies ou marchands de nouveautés une brochure ayant pour titre : Vie du maréchal Ney. Les
colporteurs la vendent également partout »194. La source ne spécifie pas l’éditeur de cette brochure,
mais nous savons qu’un ouvrage publié en 1816 en deuxième tirage a été publié sous le même titre195.
Pourtant, l’auteur de cette brochure ne cherche pas nécessairement à atténuer les « fautes » du
maréchal Ney : « Dans le cours de la narration […] nous lui laisserons toute la gloire de ses faits
d’armes; nous n’ajouterons rien à l’énormité de sa faute »196.
Les actions dans l’espace public prennent de l’ampleur au cours du procès du maréchal Ney
à la Chambre des pairs. Le 9 novembre 1815, quelques personnes rôdent autour du Palais de justice
où Ney est emprisonné : « […] à 10 heures et demie, il y a une affluence considérable à l’extérieur [du
Palais de justice] ; mais le commandant de la Garde nationale a fait faire des patrouilles très fréquentes,
qui sont parvenues à disposer des attroupements »197. Le 14 novembre 1815, deux officiers habillés
en bourgeois auraient affirmé à un estaminet polonais qu’une exécution du maréchal Ney viendrait
ternir la gloire de l’armée, et que l’on ne peut pas s’attaquer à l’honneur de Ney198. Le 18 novembre
1815, on ordonne d’augmenter la surveillance : « […] sur les boulevards, dans les faubourgs Saint-
Denis, du Temple, de Saint-Antoine et de Saint-Marceau ; au quartier Saint-Jacques près du
Luxembourg, au Gros Caillou [marchand d’eau-de-vie], sur tous les ponts, et en général dans tous les
endroits qui avoisinent ces quartiers »199. Les autorités doivent inspecter les lieux où des individus
peuvent potentiellement se rassembler et conspirer durant le procès du maréchal Ney : « [les officiers
de paix] entreront dans les cafés et dans les cabarets, se mêlant aux groupes. Ils feront dissiper, en
requérant la force armée, ceux qui deviendraient trop nombreux ou se formeraient trop près du palais
et du jardin [du Luxembourg] »200. Le 22 novembre 1815, une rumeur d’enlèvement du maréchal Ney
vient aux oreilles de la police. Le rapport prévient : « qu’on dit hautement partout que les partisans du
194 « Rapport de police du 30 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 195 Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, Paris, Pillet, 1816, 419 p. 196 Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, 1816, p. xv. 197 « Rapport de police du 9 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683, « Dossier Ney ». 198 « Rapport de police du 14 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 199 « Rapport de police du 18 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 200 « Rapport de police du 21 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ».
53
maréchal Ney, désespérant de le voir absoudre, ont formé le projet de l’enlever ce soir et que la police,
complice de ces évènements, doit le favoriser […] »201.
Au cours du procès du maréchal Ney, les autorités augmentent aussi la surveillance des forces
de l’ordre elles-mêmes. Dans une lettre datée du 15 novembre 1815 adressée au ministre de la Guerre,
le commandant de la 1ère division militaire, le général Joseph Despinois, se questionne sur l’utilité de
faire venir un détachement départemental pour épauler la Garde nationale lors de l’affaire du maréchal
Ney. Despinois pense que ces troupes sont des : « […] résidus de l’armée, se trouvent composées,
en grande partie, d’hommes malingres, aussi douteux au moral qu’au physique […] »202. En fait,
Despinois s’inquiète de voir ce détachement appuyer le maréchal Ney. Dans un rapport daté du
27 septembre 1815, un mouchard épingle trois officiers avec des opinions dangereuses aux yeux du
gouvernement. En effet, le mouchard veut connaître l’opinion de ces officiers en disant que le maréchal
Ney est : « […] une autre victime que l’on va sacrifier »203. L’un de ces officiers acquiesce et dit aux
deux autres : « […] en voilà encore un de notre opinion »204. Cette surveillance, effectuée autant sur
les « citoyens », que sur les forces de l’ordre, illustre la lucidité du gouvernement devant la force
mobilisatrice potentielle de la figure du maréchal Ney: avant l’exécution, tous les individus doivent être
soupçonnés.
Lors de l’exécution, certains gestes contestataires sont également enregistrés par les
autorités. Selon un rapport de police du 8 décembre 1815, un des témoins de l’exécution s’avance
auprès de la victime pour imbiber un mouchoir blanc de son sang205. Le témoignage d’un officier du
5e hussard (Ney a fait partie de ce régiment de 1791 à 1793) publié dans la revue Rétrospective en
1891, raconte une visite sur les lieux de l’exécution le 11 décembre 1815. Il rapporte la présence d’un
graffiti effacé, autour des traces de balles. Il le déchiffre : « Ici est mort l’Achille français! »206. Notons
au passage que nous n’avons trouvé aucune mention de cette inscription dans les rapports du
« Dossier Ney ». Le même officier affirme également dans son témoignage qu’au moins 30 personnes
201 « Rapport de police du 22 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 202 « Rapport de police du 15 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 203 « Rapport de police du 27 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 204 « Rapport de police du 27 novembre 1815 », Archives Nationales, F7 6683. « Dossier Ney ». 205 « Rapport de police du 8 décembre 1815 », Archives Nationales, F7 6883. « Dossier Ney ». 206 « Note d’un officier du 5e hussards », Rétrospective, Deuxième semestre (Juillet-Décembre 1890), 1891, p. 369.
54
étaient venues à l’Observatoire pour chercher des balles de fusil dans le mur où Ney avait été exécuté,
et que tous ces gens « […] avaient l’air fort tristes »207.
Après l’exécution, les rapports réunis dans le « Dossier Ney » se font rapidement plus rares,
jusqu’à disparaître totalement à partir de 1816. La seule mention est celle de deux femmes qui viennent
porter des couronnes de fleurs sur la tombe de Ney : les rapports ne contiennent aucune trace de
geste d’hommage à la victime, pas plus d’ailleurs que la presse que nous avons dépouillée avec une
attention particulière pour les dates d’anniversaire de l’exécution de Ney. Nous avons cherché en 1816,
1817, 1818, 1819 et 1820 en raison de la proximité avec l’exécution de Ney. Par la suite, nous avons
cherché à chaque 5 ans pour terminer en 1848. Les efforts du pouvoir d’effacer toutes traces du
maréchal Ney dans l’espace public semblent être efficaces.
Ney au café
Pour continuer à traquer la figure de victime et martyr du maréchal Ney à l’intérieur de l’espace
public parisien, nous nous tournons vers des espaces où les citoyens se rassemblent pour socialiser.
Le café (ce qui inclut aussi les cabarets, les marchands de vin, les goguettes, etc.) est un des lieux où
se manifeste cette montée du politique. Comme l’explique W. Scott Haine dans son ouvrage The World
of the Paris Café. Sociability amoung the French Working Class, 1789-1914: « Café owners who
catered to the working class realized, often from personal experience, that working-class customers
came as often for space and sociability as for drink or food »208. La population et les ouvriers se trouvent
donc dans les cafés, les débits de boisson ou les cabarets pour socialiser. Il faut noter que la presse
quotidienne de Paris commençait à être de plus en plus accessible à l’intérieur de certains
établissements, ce qui peut accentuer la politisation de leurs clients209. Avec près de 4500 cafés à
Paris en 1840210, les forces de l’ordre s’activent dans la surveillance de ces établissements de plus en
plus imbriqués dans la vie quotidienne des Parisiens. La police entame la construction de réseaux
d’espionnage informels qui sont moins présents dans les sources officielles211. De cette régulation
207 « Note d’un officier du 5e hussards », Rétrospective, 1891, p. 369. 208 W. Scott Haine, The World of the Paris Café. Sociability amoung the French Working Class, 1789-1914, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1996, p. 2. 209 W. Scott Haine, The World of the Paris Café, 1996, p. 4. 210 W. Scott Haine, The World of the Paris Café, 1996, p. 28. 211 W. Scott Haine, The World of the Paris Café, 1996, p. 6.
55
informelle, Scott affirme: « [it] focused on gaining information rather than exacting repression […] »212.
C’est dans ce contexte politique que s’inscrivent les sources policières recueillies.
Ces lieux de socialisation sont pour nous un moyen d’atteindre les oppositions politiques
présentes à Paris, cerner leurs activités du quotidien, « écouter » leur parole politique, et voir si Ney
est inclus dans leurs éventuelles pratiques et paroles d’opposition au régime. À cette fin, nous avons
épluché les sources policières ainsi que la presse parisienne pour les années 1816-1848. Grâce aux
rapports d’arrestations disponibles sous la cote F7 3028, il est possible de connaître deux variables
essentielles pour saisir les actions des opposants politiques. En effet, en plus de connaître le métier
des personnes arrêtées, les sources nous informent de la nature de l’acte commis et du lieu précis.
Par exemple, l’on apprend que le 19 juillet 1815, un apprenti-tonnelier dénommé Gendrault a été arrêté
pour avoir crié Vive l’empereur ! sur le boulevard du Temple. Sa punition fut d’être « envoyé comme
vagabond à St-Denis »213. Dans nos recherches sur les possibles prises de parole ou de manifestations
envers la figure de victime ou de martyr du maréchal Ney, les sources disponibles nous démontrent
que les IIe, IVe, Ve et VIe arrondissements sont les lieux les plus susceptibles d’entretenir ces
manifestations. Nous avons sélectionné ces cinq arrondissements après la lecture exhaustive de
plusieurs rapports de police réunis sous les cotes F7 3028 et F 1cl 33. Ceux-ci démontrent une
concentration plus importante de paroles réprimées à l’intérieur du périmètre des arrondissements
cités. De ces rapports d’arrestations ou de surveillance, nous avons isolé ceux ayant d’abord un lieu
bien précis (comme un café ou cabaret), ainsi qu’une couleur bonapartiste ou républicaine, pour les
raisons initialement évoquées. Il faut toutefois noter que les rapports de police sont inégaux quant à
l’intensité de leur observation de ces gestes et propos oppositionnels. Les archives conservées nous
montrent néanmoins que l’année 1816 et les débuts de la monarchie de Juillet sont des moments dans
lesquels l’attention policière est particulièrement active autour des groupes politiques d’opposition.
Pendant le règne de Charles X et les années 1835-1848, cette attention policière semble s’être tournée
vers d’autres problèmes que les actions des oppositions.
Les sources signalent généralement trois groupes d’oppositions politiques passibles
d’effectuer des troubles dans Paris. De ces groupes surveillés, les carlistes sont ceux qui tiennent
encore aux legs de Charles X. Ce groupe est négligeable pour nous parce qu’ils sont fidèles à un
212 W. Scott Haine, The World of the Paris Café, 1996, p. 23. 213 « Rapport d’arrestation, semaine du 19 juillet 1815 », Archives Nationales, F7 3028.
56
régime qui a condamné Ney: peu de chances qu’ils en fassent une victime ou un martyr. En 1816, les
bonapartistes sont le principal groupe à apparaître dans les rapports policiers. Au début de la
monarchie de Juillet, les républicains deviennent une force politique incontournable, et conjointement
avec les bonapartistes, leur force et leur impact apparaissent dans plusieurs rapports de police qui
s’inquiètent de leur influence sur la misère ouvrière et du mécontentement des classes laborieuses qui
fréquentent ces lieux de socialisation.
Avant d’analyser les sources datant de la monarchie de Juillet, il est intéressant de se pencher
sur celles de 1816, l’année qui suit l’exécution du maréchal Ney. Les gestes identifiés par la police au
bonapartisme n’y sont pas rares. Le 23 janvier 1816, les policiers surveillent un certain marchand de
vin dénommé Mamouris qui : « […] reçoit chez lui des ouvriers bonapartistes à qui il débite de fausses
nouvelles »214. Le même jour, sur la rue des Vieilles-Étuves dans le IVe arrondissement : « on annonce
que dernièrement, 8 à 9 personnes y ont chanté des couplets séditieux, et ont occasionné, par ce fait,
un grand rassemblement »215. Tout comme le 19 mars 1816, la police recherche un maçon ayant
distribué dans un café des chansons séditieuses216. La nature du rassemblement ni celle des couplets
distribués outre le fait qu’ils soient séditieux ne sont malheureusement pas spécifiées. Cependant, il
est intéressant de savoir que « les sociétés chantantes, les goguettes ont fait l’objet de descentes de
la police qui entend traquer ceux qui reprennent les chansons de Béranger et évoquent les souvenirs
de l’Empereur »217.
Pour les cafés au cours de 1816, certaines sources nous montrent l’importance de la
surveillance des bonapartistes et leur fréquentation de ces lieux. Le 22 mars 1816, les policiers
surveillent le « Café des Gaules » qui était un lieu pour des rassemblements de bonapartistes 218; le
7 mai 1816, la police tient une surveillance dans un café de la rue Saint-Jacques dans le Ve
arrondissement où un certain Duchamp « tient un café qui sert de rendez-vous aux bonapartistes » 219;
le 7 juin 1816, la police surveille un café situé sur la rue du faubourg Saint-Honoré au coin de la rue
Pépinière qui est signalé « comme un lieu de réunion de bonapartistes »220. Le 11 mars 1816, soit
214 « Rapport d’arrestation, semaine du 23 janvier 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 215 « Rapport d’arrestation, semaine du 23 janvier 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 216 « Rapport d’arrestation, semaine du 19 mars 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 217 Francis Démier, La France de la Restauration, 2012, p. 896. 218 « Rapport d’arrestation, semaine du 22 mars 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 219 « Rapport d’arrestation, semaine du 7 mai 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 220 « Rapport d’arrestation, semaine du 7 juin 1816 », Archives Nationales, F7 3028.
57
presque un an jour pour jour après le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan qui mènera aux Cent-
Jours, un certain menuisier nommé Morel a été appréhendé « comme prévenu de s’être proposé pour
travailler à la confection d’un buste de Napoléon »221. La police rapporte une multitude de mots et de
gestes associés au bonapartisme, mais aucun ne mentionne Ney bien que sa mort soit récente. La
figure de victime et de martyr du maréchal Ney n’est pas utilisée comme moyen de contester l’autorité
de Louis XVIII.
Les évènements de Juillet 1830 vont permettre au maréchal Ney de prendre une petite place
dans l’espace public parisien. Son ombre apparaît au Panthéon :
Quelques semaines après les Trois Glorieuses, des étudiants promènent des bustes dans la capitale, et franchissent les portes du Panthéon pour les y faire défiler. Ces bustes rendent hommage aux héros libéraux de la Restauration et à ses martyrs. Le 17 août, c’est le buste du maréchal Ney, fusillé en décembre 1815, que des étudiants et des gardes nationaux intronisent au Panthéon, après avoir pour ainsi dire forcé les portes d’accès. Suivis par une foule compacte, ils placent le buste au milieu de la nef sur un piédestal. Des brochures relatant les hauts faits du maréchal circulent dans les rangs. 222
L’évènement est aussi rapporté dans le journal Le Constitutionnel du 17 août 1830. On y
apprend que ce sont 12 gardes nationaux qui ont transporté le buste de Ney, aux côtés des bustes de
Manuel et de Foy, et qu’un avocat de la cour royale, M. Lebas, a prononcé un discours lors de cette
« intronisation ». Le journal cite une phrase marquante de ce discours : « Viens reposer en paix dans
ce temple du génie et de la vertu, viens-en ouvrir les portes à ces généreux martyrs de la liberté, qui,
comme toi, lui ont donné leur vie, et qui, poussant plus loin leur héroïque dévouement, lui ont sacrifié
jusqu’à cette renommée à laquelle ils avaient de si justes titres »223. Dans l’ouvrage de Jean-Baptiste
Capefigue, L’Europe depuis l’avènement du roi Louis-Philippe (1845), l’auteur présente une version
plus longue de ce discours:
Et toi aussi tu appartiens à cette noble famille, fils de la liberté et de la victoire, toi qui sortis des rangs de ce peuple si longtemps méconnu, toujours si grand et si magnanime! Tu as vu mettre le comble à la gloire en mourant victime d’un pouvoir odieux. Viens reposer en paix dans ce temple du génie et de la vertu ; viens en ouvrir les portes à ces généraux martyrs de la liberté qui, comme toi, lui ont donné leur vie. Viens, et qu’en s’arrêtant devant le monument que la patrie reconnaissante va consacrer à ta mémoire, chacun de nous se dise en s’inclinant avec respect : il avait combattu trente ans pour la patrie, trente ans il avait été respecté par la mort, les tyrans l’ont assassiné! 224
221 « Rapport d’arrestation, semaine du 11 mars 1816 », Archives Nationales, F7 3028. 222 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 120. 223 Le Constitutionnel, 17 août 1830, p. 2. 224 Jean-Baptiste Capefigue, L’Europe depuis l’avènement du roi Louis-Philippe, T. 3, Paris, Comon et Cie, 1845, pp. 174-175.
58
Ce « moment-Ney » est aussi explicite qu’exceptionnel. En effet, si l’on se penche davantage
sur les deux versions du discours de M. Lebas, le maréchal Ney est présenté comme un martyr de la
liberté et une victime des tyrans. Tout comme le général Foy ou le député Manuel, la mémoire du
maréchal Ney occupe l’espace public. Le 30 novembre 1825, les funérailles de Foy auraient attiré
plusieurs milliers de personnes. Deux ans plus tard, les funérailles du député Manuel de 1827
rassemblent aussi des milliers et font l’objet d’affrontements entre ouvriers et policiers lorsque le
cortège passe dans un quartier populaire225. Tout comme Foy ou Manuel, Ney transcende les clivages
politiques tout en les incarnant. Sans que l’on puisse dire s’il y a un lien entre les deux évènements, la
manifestation du 17 août est peut-être liée à une pétition présentée le 12 novembre 1831 devant la
Chambre des députés par les habitants de la Moselle, pétition qui demande la « panthéonisation » de
Ney. Son nom résonne dans cette Chambre, et allume les passions de certains députés. Le député de
l’Yvonne Marie-Denis Larabit, un des compagnons de Napoléon à l’île d’Elbe, parle de la profonde
indignation que le jugement de Ney lui procure, et appui le transfert des cendres de « l’illustre maréchal
Ney » au Panthéon226. Dans la même veine que l’avocat Lebas, le général Lamarque, tout en
approuvant le transfert des cendres, rend un vibrant hommage au maréchal Ney : « Qu’un décret
solennel lui ouvre les portes du Panthéon, et absolve la France d’un jugement unique! Qu’il y repose
au milieu des amis de la liberté, à côté des martyrs qui la cimentèrent de leur sang […] »227.
Outre sa brève réapparition lors du retour des cendres de Napoléon en 1840, il retombe dans
l’ombre. Lors des funérailles de l’Empereur aux Invalides, Ney fait partie des 13 statues qui
représentent des soldats de la Révolution et de l’Empire228. Cependant, les bonapartistes et les
républicains demeurent actifs dans les sources policières. En effet, dans un rapport particulier datant
du 13 novembre 1831, on y apprend que le parti napoléoniste s’activent auprès des classes
laborieuses : « Il cherche à rallier à lui les classes inférieures de la population auprès desquelles il
exploite le prisme attaché au nom de l’ex-Empereur. […] on s’aperçoit qu’ils accueillent [les classes
laborieuses] avec faveur tout ce qui se rattache au fils de Napoléon qui est souvent l’objet de leur
entretien »229. Plus loin, ce même rapport nous apprend que les membres des Commissions de
salubrité ont découvert des portraits de Napoléon, et de son fils dans « […] presque tous les logements
225 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 331. 226 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires, 1787 à 1860, Tome 71, Paris, Paul Dupont, 1889, p. 532. 227 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires, T. 71, 1889, p. 531. 228 Emmanuel Fureix, La France des larmes, 2009, p. 309. 229 « Rapport particulier du 13 novembre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
59
d’ouvriers et jusque dans les plus petites mansardes »230. Un jour avant, un autre rapport particulier
prétend que « le parti Napoléoniste paraît croître sinon en force, du moins en audace. Beaucoup de
républicains ou prétendus tels se sont réunis à ce parti »231.
Certains journaux rapportent aussi des rassemblements bonapartistes lors de la « Saint-
Napoléon », fête nationale de l’Empire. Selon l’auteur Sudhir Hazareesingh, la Saint-Napoléon fait
partie d’une concurrence symbolique à l’intérieur de l’espace public, d’une stratégie cherchant à
séduire l’imaginaire collectif. Pour l’auteur : « La création de la fête du 15 août fut l’expression
bonapartiste de cette stratégie, qui imposait non seulement de cultiver la tradition napoléonienne, mais
d’oblitérer toutes les versions concurrentes de l’épopée nationale française »232. Dans une note de La
Gazette de France du 21 août 1838, le journal rapporte un grand rassemblement à Bruxelles : « La
Saint-Napoléon a été célébrée à Bruxelles par les frères d’armes de l’empire. Plus de trois cents
vétérans s’y sont présentés, portant à la main un bouquet d’immortelles et de pensées qu’ils ont déposé
au pied de la statue de l’empereur »233. Dans le Journal de la ville de Saint-Quentin, on parle
ouvertement d’une fête pour célébrer Napoléon, et on y décrit le déroulement des festivités du
15 août234. Contrairement à l’absence d’une commémoration récurrente à la mémoire de Ney, les
bonapartistes profitent du 15 août pour célébrer l’Empereur.
Les bonapartistes sont donc toujours présents dans l’espace public, faisant même preuve
d’audace. La plupart des rapports particuliers du début des années 1830 vont dans le même sens,
surveillant les mouvements de cette opposition politique. En 1838, dans Le Figaro, un chroniqueur
parle même d’une obsession de la figure de Napoléon qui s’étend dans tous les aspects de la vie des
Parisiens: « On a mis Napoléon en drame, en vaudeville, en mémoires, en bouteilles. Son image a
figuré sur les flacons d’eau de Cologne et d’anisette double »235. La figure du maréchal Ney, elle, ne
fait pas partie de ce bonapartisme hégémonique. De cet espace public plutôt silencieux quant à la
figure de victime et de martyr de Ney, nous allons maintenant investir le champ des représentations
de Ney, ainsi que des tentatives de réhabilitation du maréchal et de révision de son procès.
230 « Rapport particulier du 13 novembre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 231 « Rapport particulier du 12 novembre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 232 Suhdir Hazareesingh, La Saint-Napoléon. Quand le 14 juillet se fêtait le 15 août, Paris, Tallandier, 2007, p. 149. 233 La Gazette de France, 21 août 1838, p. 4. 234 Journal de la ville de Saint-Quentin, 8 août 1841, p. 1. 235 Le Figaro, 16 mai 1838, p. 3.
60
Représentations de la victime, représentations pour la victime
Au Salon des Beaux-Arts de 1868, un épisode attire l’attention médiatique : le peintre Jean-
Léon Gérôme y présente Le 7 décembre 1815 (Fig. 4), un tableau qui met en scène l’exécution du
maréchal Ney. Dans ses correspondances, le peintre écrit que ce tableau lui vaut plusieurs ennuis,
notamment avec Edgar Ney (le 4e fils du maréchal Ney) et le surintendant des Beaux-Arts, Émilien de
Nieuwerkerke236. Le tableau met en premier plan le maréchal Ney habillé tout de noir, gisant seul sur
le sol face première, alors que les soldats du peloton d’exécution sont représentés dans l’arrière du
tableau. Sur le mur, on peut voir des lettres effacées. La symbolique de la peinture présente Ney
comme une victime : l’impression est qu’il a été « assassiné » et laissé à l’abandon. Gérôme affirme
dans sa correspondance que le surintendant lui demande de ne pas présenter le tableau, sans préciser
la raison. Nous savons toutefois que sous le Second Empire, la figure associée au maréchal Ney est
celle du héros comme nous allons le voir plus loin.
La représentation de Ney sous une figure de victime froisse les autorités du Second Empire.
Bien que le tableau fût finalement autorisé et présenté subtilement « dans un coin »237, l’opinion
publique reste divisée sur le sujet du tableau. Dans Le Figaro du 20 mai 1868, Henri Rochefort dévoile
sa profonde aversion pour le maréchal Ney : « Le maréchal Ney n’est ni plus ni moins coupable en
1868 qu’il l’était en 1815, et il le fut beaucoup »238. À l’inverse, Edmond About de la Revue des Deux
Mondes, apprécie la peinture : « […] l’œuvre de M. Gérôme est d’une vérité poignante […] tout répond
exactement à l’idée que nous nous faisions de ce drame »239. De ces discussions publiques, la
correspondance de Gérôme fait ressortir l’opinion des courants légitimistes et bonapartistes. Les
premiers le traitent de « […] flagorneur du gouvernement »240, alors que les bonapartistes en font un
ingrat : « Que lui a-t-on fait? Il n’est donc pas encore content et pourtant on l’a nommé naguère officier
de la Légion d’Honneur! »241. La réception de l’œuvre de Gérôme en 1868 nous démontre que la figure
de victime et de martyr du maréchal Ney est toujours un objet de discussion. Contrairement à la
situation du Second Empire, la représentation de cette figure sous les monarchies censitaires évoque
236 Charles Moreau-Vauthier, Gérôme, peintre et sculpteur : l’homme et l’artiste, d’après sa correspondance, ses notes, les souvenirs de ses élèves et de ses amis, Paris, Hachette, 1906, p. 254. 237 Charles Moreau-Vauthier, Gérôme, peintre et sculpteur, 1906, p. 254. 238 Le Figaro, 20 mai 1868, p. 1. 239 Edmond About, « Le salon de 1868 », Revue des Deux Mondes, Tome 75, 1868, p. 729. 240 Charles Moreau-Vauthier, Gérôme, peintre et sculpteur, 1906, p. 254. 241 Charles Moreau-Vauthier, Gérôme, peintre et sculpteur, 1906, p. 254.
61
un sentiment de justice, et fait partie d’un mouvement qui participe à dépeindre les autorités comme
les responsables de l’injuste exécution de Ney.
Figure 4: Le 7 décembre 1815
Jean-Léon Gérôme. 1867. Huile sur toile. 65,2 x 104,2 cm Sheffield, City Art Gallery. Museums Sheffield/ Bridgeman Giraudon
https://www.senat.fr/evenement/archives/D26/execution_et_rehabilitations/lexecution_le_jeudi_7_decembre_1815.html
Le spectre de Michel Ney
Si la figure de la victime et du martyr associée au maréchal Ney choque les bonapartistes sous
le Second Empire, elle est utilisée sous les monarchies censitaires (1815-1848). Comme spécifié dans
l’introduction générale, bien que le répertoire pictural représentant le maréchal Ney à l’intérieur de
notre période historique soit plutôt mince, plusieurs de ces images le présentent comme victime ou
martyr. Deux d’entre-elles sont des gravures qui représentent un maréchal Ney étendu, percé de
balles, avec une religieuse à ses côtés. L’une de ces gravures est nommée Le Maréchal Ney étendu
sur un brancard, ayant à ses côtés une sœur de charité en prières (Fig. 5) et n’est pas datée. Toutefois,
une variante de cette gravure242, nommée Assassinat Juridique du maréchal Ney, 7 décembre
1815 (Fig. 6) est publiée dans L’Utile, journal populaire de la Moselle, un mensuel publié entre 1833
et 1836243. La date de publication suggère que les deux gravures ont pu être produites à l’intérieur de
notre période historique. Les deux gravures ont pour objectif de présenter le maréchal Ney dans une
posture de victime des Bourbons, notamment celle publiée dans l’Utile dont le titre ne parle pas d’une
242 La publication dans L’Utile est une reproduction, puisque le trait de l’image est plus simple, et que l’image est inversée due à un effet de miroir lié à l’impression. 243 http://presselocaleancienne.bnf.fr/ark:/12148/cb32886537v
62
exécution, mais bien d’un assassinat. Le terme « exécution » renvoie à une punition appliquée par les
Bourbons qui ont été victimes de la « trahison » de Ney, alors que le terme « assassinat » renverse
l’équation et place le maréchal Ney dans la posture de victime des Bourbons.
Figure 5: Le Maréchal Ney étendu sur un brancard, ayant à ses côtés une sœur de charité en prières
Anonyme. 1815. Lithographie. BnF, Estampes et photographie, Rés. QB-201-(158)- Fol. Collection Michel Hennin
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414106d.item
Figure 6: Assassinat juridique du Maréchal Ney
Anonyme. Lithographie. 15,6 x 25, 6 cm BnF, Dép. Estampes et photographie, Rés. Qb-370 (74)-FT 4. Coll. De Vinck
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69548237.item
63
Une autre image (Fig. 7), faite en 1816 par Innocent-Louis Goubaud sous le titre anglais The
execution of the sentence on Marshal Ney, in the garden of the Luxemburg at Paris présente l’exécution
à la place de l’Observatoire. Actif à Paris, Bruxelles ou à Londres, Goubaud est un bonapartiste
convaincu, et le peintre du roi de Rome, le fils de Napoléon Bonaparte244. Le titre anglophone de cette
œuvre s’explique par sa production : la gravure fut publiée à Londres par Edward Orme, propriétaire
d’une boutique de gravure. L’œuvre capte le moment où les soldats font feu sur Ney qui porte sa main
sur son cœur. Contrairement aux soldats qui fixent directement le condamné, tous les autres
personnages de l’image détournent le regard de celui-ci, comme s’ils n’acceptaient pas cette
condamnation. Le prêtre à la gauche de l’image semble atterré par la situation, comme les soldats qui
l’entourent et qui fixent le sol. L’officier aux côtés des soldats qui font feu semble démontrer son
désaccord avec un geste de la main.
Figure 7: The execution of the sentence on Marshal Ney, in the garden of the Luxemburg at Paris
Louis-Innoncent Goubaud. 1816. Gravure à l’eau forte. 25,8 x 36,5 cm Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S. K. Brown Military collection
https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:226410/
Cette tristesse devant la condamnation du maréchal Ney, nous la retrouvons aussi dans une
double-pièce circulaire publiée en 1835 (Fig. 8). Sur la première face, le terme « assassinat politique »
est écrit sur un drapeau tricolore, et deux militaires expriment leur tristesse. L’un des deux pleure sur
244 http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/artistes/0/1148-GOUBAUD-Innocent-Louis
64
ce qui apparaît comme la tombe du maréchal Ney, alors que l’autre tient le drapeau avec l’inscription
qui place Ney dans une posture de victime du régime des Bourbons. La deuxième face de la pièce
circulaire présente les accusateurs de Ney, et le nom des Pairs toujours siégeant à la Chambre des
pairs ayant voté la mort de Ney. Elle est en quelque sorte une réponse à la première face: l’assassinat
politique perpétré contre Ney est le résultat de ceux qui sont nommés sur cette pièce circulaire. De
plus, la deuxième face intègre des paroles de Ney lors de son procès, et une allusion à la demande de
réhabilitation de l’avocat de la famille Ney. Cette pièce joue donc un double rôle: elle présente l’émotion
vécue le 7 décembre 1815 suite à « l’assassinat politique » et pointe les Pairs qui ont joué un rôle dans
cet assassinat et qui sont encore vivants en 1835.
Figure 8: Double-pièce circulaire
Anonyme. 1835. Estampe. 8 cm. BnF, Dép. Estampes et photographies, Rés. QB-370 (74)-FT 4. Coll. De Vinck
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954824n.item
En 1846, le sculpteur et médailliste David d’Angers envoie à l’écrivain Victor Pavie un paquet
de gravures qu’il nomme Almanach populaire et qui regroupe des représentations de plusieurs
personnalités politiques ou militaires qui ont été des victimes politiques. À l’intérieur de ce lot de
gravures se trouve le trait d’une médaille publiée en 1846 et portant : « […] sur la mort du maréchal
Ney, et un épisode de ce déplorable assassinat politique »245. Nous savons par ailleurs que D’Angers
245 Henri Jouin, David d’Angers et ses relations littéraires, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1890, p. 265.
65
entretient un intérêt particulier envers la mort du maréchal Ney. Déjà en 1827, le médailliste écrivait au
même écrivain Victor Pavie: « Un soir, je me promenais du côté de l’Observatoire. Je m’arrêtai, retenu
par le souvenir d’une illustre victime. Je m’étais assis à l’endroit où Ney a été fusillé. À force d’y penser,
je crus le voir en réalité. Ma tête s’était exaltée »246. Le lexique utilisé par D’Angers, « illustre victime »,
« drame politique » et « assassinat politique », place clairement le maréchal Ney dans une posture de
victime politique des Bourbons. La médaille est la synthèse de ce lexique (Fig. 9). D’un côté de la
médaille, le maréchal Ney arbore une couronne de laurier, symbolisant la gloire de celui qui la porte.
De l’autre côté de la médaille, D’Angers présente 4 éléments associés à l’exécution: les fusils du
peloton, le mur de l’Observatoire, le brancard sur lequel Ney est transporté après sa mort et la Cour
des Pairs. La couronne de laurier traduit le terme d’illustre victime, alors que les représentations des
fusils et de la Cour des pairs symbolisent l’assassinat et le drame politiques.
Figure 9: Médaille représentant le maréchal Ney
Pierre-Jean David d’Angers. 1839. Médaille. Bronze, Fonte. 9,4 x 0.9 cm Galerie David d’Angers
https://ow-mba.angers.fr/ow4/mba18022013/images/mba-203-7137.JPG
Ce travail s’inscrit par ailleurs dans une trajectoire artistique particulière que David d’Angers
s’applique à accomplir. Pour lui : « […] la véritable mission de l’artiste est de plaider de grandes et
nobles causes, utiles à l’humanité, et non de l’amuser en faisant de l’art pour de l’art »247. La médaille
du maréchal Ney côtoie donc celle d’autres figures ou évènements historiques dans une série de
médailles consacrée à des drames politiques et des injustices historiques. Ainsi, sont présents aux
246 Henri Jouin, David d’Angers et ses relations littéraires, 1890, p. 25. 247 Henri Jouin, David d’Angers et ses relations littéraires, 1890, p. 267.
66
côtés du maréchal Ney : les sergents de La Rochelle accusés d’avoir voulu renverser la monarchie
bourbonienne et guillotinés en 1822; Labédoyère exécuté en 1815 pour avoir participé à un complot
contre Louis XVIII; Robespierre, guillotiné en 1794; les frères Faucher exécutés en 1815 pour avoir
formé un dépôt d’armes; les Frères Bandiera, fusillés en 1844 par Ferdinand II, un membre de la
maison Bourbon-Sicile. Toutefois, après une recherche sur le site du Musée D’Angers248, où plusieurs
médailles de David D’Angers sont numérisées, la médaille du maréchal Ney nous apparaît comme la
plus travaillée. Toutes les autres médailles citées ci-haut sont essentiellement des portraits de profil
des condamnés. Signe de son attachement à ses médailles politiques : « […] David a voulu qu’[elles]
soient connues, au point d’en autoriser l’édition, d’en publier certains dans la presse et d’en laisser
vendre des gravures »249.
Le nom du maréchal Ney refait surface dans l’enceinte du Luxembourg lors du procès dit des
« insurgés d’avril » en 1835. Lors de l’audience du 30 juin 1835, le républicain lyonnais Marc-Étienne
Reverchon conteste l’ambiance du procès et la difficulté de se défendre convenablement contre les
accusations, comme Ney l’avait fait lors de son procès de 1815. C’est d’ailleurs lorsque Reverchon
s’attaque au déroulement de son procès que le nom du maréchal Ney est utilisé pour critiquer les Pairs:
« […] alors aussi je me suis bien rappelé comment l’histoire contemporaine appelle certains arrêts de
la cour des pairs. L’avez-vous oublié, Messieurs, écoutez-là!... (l’accusé montrant l’allée de
l’Observatoire) Voyez l’ombre du héros! Entendez la voix de Ney: C’est ici que je fus assassiné »250.
La mobilisation de la figure de martyr du maréchal Ney par Reverchon renvoie au concept de l’effet
d’ancestralité de Jean-Pierre Albert. Le républicain lyonnais fait le lien entre l’injustice vécue par Ney
en 1815, et la situation des insurgés d’avril en 1835 pour démontrer son opposition à la Chambre des
pairs. Un autre accusé, le républicain Charles Lagrange, utilise le même processus lors du procès,
avec une véhémence qui le conduit à se faire expulser de l’enceinte par 15 soldats. Exprimant la même
colère devant le comportement des Pairs tout en étant entouré des soldats, Lagrange réussit à
mobiliser la figure de martyr du maréchal Ney:
À votre aise, Messieurs les pairs; condamnez-nous sans nous entendre; demeurez fidèle à vos magnifiques antécédents: envoyez à la mort, sans aucune défense, les seuls soutiens de cent cinquante familles d’hommes du peuple, et quand vous aurez accompli cette œuvre sublime, imposée par le 9 août à vos consciences faciles, couvrez vos têtes de vos manteaux, vertueux sénateurs, mais moi, qui vous condamne à vivre, je vous condamne à les porter à l’envers pour dissimuler les taches de souillure et d’ignominie qui
248 http://musees.angers.fr/accueil/index.html 249 Jacques de Caso, David D’Angers : l’avenir de la mémoire, Paris, Flammarion, 1988, p. 189. 250 Procès des accusés d’avril devant la cour des Pairs, Tome 2, Paris, Pagnerre, 1835, p. 176.
67
sont imprimées à tout jamais sur vos fronts comme sur celui de la royauté par le noble sang du brave des braves. 251
En 1839, David D’Angers produit une statue d’Armand Carrel (Fig. 10), journaliste dirigeant du
journal républicain Le National de 1830 à 1836. L’œuvre représente Carrel lorsqu’il s’exprime devant
la Chambre des pairs, à l’occasion d’un procès contre son article paru le 10 décembre 1834 dans Le
National. L’article en question, « De la compétence de la cour des pairs », critique violemment le
fonctionnement de la Chambre haute. Carrel y disait que, la révolution de Juillet : « […] fait trembler [la
Chambre des pairs] tous les jours encore en lui redemandant le maréchal Ney, juridiquement assassiné
par ses émigrés, ses hommes de Gand, et ses renégats de la révolution, parvenus de l’ordre
militaire »252. David D’Angers décide de confectionner la statue à un moment précis de ce procès,
lorsque le journaliste accuse les pairs d’être des assassins du maréchal Ney et de rejeter la demande
de révision du procès faite par la famille Ney253. Et lorsque le président de la Chambre lui rappelle que
certains juges du maréchal Ney sont encore présents à la Chambre, Carrel lui répond : « S’il y a
quelqu’un, dans cette chambre, qui veuille faire une proposition contre moi, je serai heureux d’avoir le
premier à flétrir dans cette enceinte l’horrible assassinat du maréchal Ney »254. Pour Armand Carrel,
le maréchal Ney a été une victime de la Chambre des pairs. Cependant, David D’Angers mobilise la
figure de Ney d’une autre façon en choisissant le moment où Ney devient un « argument », un symbole
de l’injustice et de l’iniquité que la Chambre des pairs représente. À ce moment, le maréchal devient
aussi un martyr puisque sa mention dans l’enceinte du Luxembourg appelle à la mobilisation contre la
Chambre des pairs.
251 Procès des accusés d’avril devant la cour des Pairs, Tome 1, Paris, Pagnerre, 1835, p. 37. 252 Procès du National de 1834 devant la Chambre des pairs, Paris, 1854, Imprimerie de Grégoire, p. 1. 253 Henri Jouin, David d’Angers et ses relations littéraires, 1890, p. 265. 254 Gazette du Languedoc, 21 décembre 1834, p.3.
68
Figure 10: Statue d'Armand Carrel
Pierre-Jean David d’Angers. 1839. Plâtre, Moulage. 215 x 66 x 62 cm Galerie David d’Angers
http://musees.angers.fr/collections/collections-en-ligne/index.html
La caricaturiste Honoré Daumier réalise une lithographie qui peut être liée avec les procès des
Insurgés d’avril et d’Armand Carrel. Parue dans l’hebdomadaire La Caricature du 5 mai 1835, cette
gravure intitulée « Le Fantôme » (Fig. 11) représente le maréchal Ney couvert d’un drap blanc, orné
d’une couronne de laurier, et qui écrit sur le palais du Luxembourg Palais des Assassins. Ce journal
satirique est connu à l’époque pour ses moqueries et sa vive opposition au gouvernement de Louis-
Philippe 255. Ce dessin rappelle que la Chambre des pairs est marquée par « l’assassinat » de Ney, et
qu’en tant que martyr des pairs, sa figure peut être mobilisée pour discréditer ou s’opposer aux
jugements de ceux-ci. Le maréchal Ney apparaît ici comme l’étendard de ceux qui se considèrent
comme les victimes de la justice de la Chambre des pairs.
255 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, Tome 3, Paris, Administration du grand dictionnaire universel, 1867, p. 397.
69
Figure 11: Le Fantôme
Honoré Daumier. 1835. Épreuve sur blanc, 27 x 22 cm BnF, Estampes et Photographie, Rés. Dc-180b (3)-Fol.
http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/024.htm
Cette enquête iconographique nous démontre comment la figure de victime et de martyr du
maréchal Ney peut être utilisée dans un éventail de représentations par lesquelles les auteurs
rappellent « l’assassinat » de Ney, plutôt que son exécution. En évoquant sa figure lors de procès à la
Chambre des pairs, Daumier et David D’Angers canalisent bien le concept d’effet d’ancestralité : la
mort du maréchal Ney pousse d’autres individus à l’utiliser pour démontrer qu’ils sont eux aussi des
victimes des autorités royales. Par ailleurs, la plupart des images produites lors de la monarchie de
Juillet abordent l’aspect « juridique » et placent Ney comme la victime d’un processus judiciaire
corrompu par le pouvoir monarchique bourbonien. Des images, nous allons voir que la figure de victime
et de martyr du maréchal Ney est présente dans des textes juridiques qui recoupent des demandes de
réhabilitation et de révisions du procès de 1815.
L’honneur d’un maréchal
À partir de la monarchie de Juillet, une tendance se développe autour d’écrits et de requêtes
écrites qui prônent la réhabilitation du maréchal Ney, ainsi que la révision de son procès. On définit la
70
réhabilitation comme une volonté de « rétablir, remettre en état, dans le premier état »256, alors que la
révision est une « action par laquelle on revoit, on examine de nouveau »257. Ces deux pôles écrits ont
pour objectif de présenter le maréchal Ney comme une victime du processus judiciaire de la Chambre
des pairs. Ney est une victime parce que son procès fut inéquitable et sa défense brisée. Un autre
genre littéraire, celui des biographies, s’est avéré pauvre en notations « victime-martyr » et est plutôt
lié à une figure, celle du héros.
Deux éléments permettent de situer la gamme des formes et des protagonistes de ces deux
processus tels qu’ils se développent pour l’essentiel à partir de 1831. Le 12 novembre 1831, une
pétition des habitants du département de la Moselle est déposée à la Chambre des députés et
demande : « […] que les cendres du maréchal Ney soient transférées au Panthéon et qu’il lui soit élevé
un monument aux frais de L’État »258. Selon cette pétition, cette proposition est une réparation à une
grande injustice, et une façon de remettre Ney à la place d’honneur qui devait être la sienne. Quelques
jours plus tard, le 23 novembre 1831, la famille du maréchal Ney, sa femme et ses quatre fils déposent
une requête en révision auprès du roi Louis-Philippe et son conseil des ministres. Dans ce texte rédigé
par l’un des avocats de Ney lors de son procès de 1815, André Dupin, la famille se réjouit du
changement de gouvernement, prétextant que « […] la justice semble enfin être arrivée! »259. En effet,
la famille supplie « […] Votre Majesté [Louis-Philippe], dont l’intérêt s’est manifesté pour eux dans ces
jours de deuil, d’ordonner, à présent qu’elle est placée sur le trône des Français, la solennelle révision
d’un arrêt ainsi rendu contre la foi des traités, et sans que la défense ait été libre »260. Ces deux
demandes seront rejetées, et constituent les deux seules demandes auprès de l’État.
Les écrits que nous qualifions de « juridiques » puisque rédigés par des juristes et avocats,
développent d’abord un argumentaire autour de l’interdiction d’utiliser de la Convention militaire du
3 juillet261 comme moyen de défense par Ney. Pour les auteurs de ces textes, cette interdiction de la
part des commissaires du roi rend la défense de Ney impossible, et elle rend ce dernier la victime de
ce processus judiciaire. L’un des avocats du maréchal Ney, André Dupin, définit les termes de cette
256 J. R. Masson, Petit dictionnaire de l’Académie française, Paris, Masson et fils, 1821, Dictionnaire, p. 302. 257 J. R. Masson, Petit dictionnaire de l’Académie française, Paris, 1821, p. 322. 258 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires, 1787 à 1860, Tome 71, Paris, Paul Dupont, 1889, p. 529. 259 M. Laumond, De la Chambre des pairs et de la révision du procès du maréchal Ney, Paris, Moutardier, 1831, p. 99. 260 M. Laumond, De la Chambre des pairs et de la révision, 1831, p. 99. 261 Cette convention stipule que : « Les habitants, et en général tous les individus qui se trouvent dans la Capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu’ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques ».
71
Convention pour prouver qu’elle pouvait défendre, selon lui, son ancien client : « La convention
protégeait à la fois les personnes, les propriétés et les monuments. En effet, par qui avait-elle été
conclue? Par une commission militaire et par M. le préfet de la Seine au nom des habitants de
Paris […] »262. Un texte cosigné par des avocats et juristes en 1832 prend à son tour la défense de
Ney : « Une convention militaire, signée de toutes les puissances, obligatoire pour le gouvernement
français lui-même, protégeait sa [Ney] tête; cette convention a été écartée »263. Pour l’avocat à la cour
royale, Germain Delmas, par l’omission de la Convention militaire, le gouvernement viole la liberté de
défense de Ney : « […] dans le procès, on ne permit pas d’invoquer un acte public qui offrait un moyen
péremptoire et dont le maréchal rappelait sans cesse les termes protecteurs »264. L’interdiction
d’utiliser la Convention militaire rend la défense du maréchal Ney impossible à l’intérieur de la Chambre
des pairs hostile au maréchal Ney. En imposant le silence aux défenseurs du maréchal Ney, la
Chambre des pairs réduit Ney à une victime d’un processus judiciaire tronqué par les « passions
politiques »265. Pour Germain Delmas, « […] revendiquer l’application des termes protecteurs de la
convention du 3 juillet […] »266 est un moyen d’aider la famille de Ney dans leur démarche de révision
du procès.
Ces textes appuient aussi les démarches judiciaires de la famille qui sont motivées par le « cri
testamentaire » du maréchal Ney, ainsi que la « piété filiale » qui unit le maréchal Ney et sa famille.
Lorsqu’en 1815, Ney s’exprime vigoureusement contre son jugement à l’intérieur de la Chambre des
pairs, il en appelle à l’Europe et à la postérité. Dans le texte cosigné par plusieurs juristes et avocats,
les auteurs comparent les paroles de Ney à un « héritage sacré »267 pour la famille Ney, une preuve
pour celle-ci du statut de victime de Ney. Dans son mémoire, Germain Delmas abonde dans le même
sens: « Pour madame la maréchale Ney et ses enfants, la requête au Roi était dictée par un motif
particulier et bien légitime; le cri testamentaire du maréchal, son appel à la postérité leur faisait un
devoir de le relever »268. Dans un autre texte publié anonymement le 28 décembre 1831, nous
retrouvons la valeur « sacrée » des actions de la famille: « […] elle accomplit un devoir sacré; elle obéit
au sentiment de la piété filiale; elle prouve qu’elle a entendu et compris le cri testamentaire consigné
262 M. Laumond, De la Chambre des pairs et de la révision, 1831, p. 75. 263 Consultation pour la veuve et les fils du maréchal Ney, Paris, Hippolyte Tilliard, 1832, p. 10. 264 Germain Delmas, Mémoire sur la révision du procès du maréchal Ney, 1832, p. 14. 265 Consultation pour la veuve et les fils du maréchal Ney, 1832, p. 10. 266 Germain Delmas, Mémoire sur la révision du procès du maréchal Ney, 1832, p. 85-86. 267 Consultation pour la veuve et les fils du maréchal Ney, 1832, p. 11. 268 Germain Delmas, Mémoire sur la révision du procès du maréchal Ney, Paris, Louis Janet, 1832, p. 6.
72
dans l’énergique protestation qui a précédé l’arrêt et qui l’a flétri »269. Le rapporteur de la pétition des
habitants de la Moselle, le député Mosellan Nicolas Charpentier, utilise lui aussi l’appel à la postérité
du maréchal Ney lorsqu’il présente la pétition à la Chambre des députés, sans toutefois faire allusion
à la famille de Ney. Pour ce député, la postérité parle d’elle-même, et consacre Ney comme l’un des
plus grands guerriers de la France. L’État pourrait éliminer le statut de victime en répondant à cet
appel, et transférer les cendres de Ney au Panthéon « […] monument destiné à consacrer la
reconnaissance de la France, pour la mémoire des hommes qui l’ont illustrée! »270.
Ce mouvement de défense envers le maréchal Ney par une partie du monde judiciaire est
aussi porté par l’effet d’ancestralité théorisé par Jean-Pierre Albert. Les coauteurs du texte
Consultation pour la veuve et les fils du maréchal Ney sont motivés par la volonté de préserver,
d’améliorer la figure du maréchal Ney. Pour ceux-ci, cette révision du procès peut « venger » la
mémoire de Ney: « Pendant seize ans, les larmes ont été stériles; la piété filiale s’est trouvée sans
force et sans action; le sentiment du devoir, si actif et si sacré, s’est irrité de sa propre impuissance
[…] la mémoire du Maréchal n’a été défendue que par une protestation solennelle qui la protégeait par
le doute, mais ne la vengeait point »271. C’est-à-dire que ces avocats s’identifient pleinement dans la
cause que Ney représente pour eux et ont le même objectif de révision et de réhabilitation que la famille
Ney.
En 1831, une autre forme d’art, le théâtre, porte la figure de victime et de martyr du maréchal
Ney sur les planches parisiennes au Théâtre des Nouveautés. Contrairement aux œuvres analysées,
la pièce Le Procès d’un maréchal de France, nous permet mieux comprendre l’impact de la figure de
martyr du maréchal Ney directement dans l’espace public parisien.
L’affaire des Nouveautés: Ney au théâtre
Nous avons vu dans l’introduction à ce présent chapitre qu’en décembre 1830, le ministre de
l’Intérieur de l’époque avait demandé aux deux auteurs de la pièce de théâtre Le procès d’un maréchal
de France de bien vouloir ne pas la présenter pendant le procès des ex-ministres de Charles X.
Presque un an plus tard, les deux auteurs récidivent en présentant la même pièce au théâtre des
269 Anonyme. Révision du procès du maréchal Ney, 28 décembre 1831, p. 1. 270 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires, 1787 à 1860, T. 71, 1889, p. 529. 271 Germain Delmas, Mémoire sur la révision du procès du maréchal Ney, 1832, p. 11.
73
Nouveautés, les 22 et 23 octobre 1831. Le 20 octobre 1831, cette nouvelle attire déjà l’attention de la
presse parisienne. Dans Le Constitutionnel, on peut y lire que « Le théâtre des Nouveautés […] promet
pour samedi prochain la première représentation d’un drame en quatre tableaux de M. Fontan, intitulé
Le Procès d’un Maréchal de France (1815). Ce sujet est, à ce qu’on nous assure, traité avec une
grande impartialité »272. Techniquement, la pièce n’est pas soumise à la censure gouvernementale
puisque la monarchie de Juillet avait mis fin à celle-ci. Cette liberté théorique contraste avec le régime
de Charles X sous lequel le théâtre était soumis à une stricte surveillance par les autorités. Si durant
la Restauration, les spectateurs peuvent rire ensemble, tout en restant « à leur place »273, le théâtre
connaît alors des transformations sociales et politiques. À partir de 1830, les théâtres deviennent :
« […] un des moyens les plus forts de contestation sociale, un élément de diffusion d’idées d’autant
plus éloquent qu’il resta le spectacle populaire-type, la seule occasion pour l’artisan et l’ouvrier de
côtoyer le bourgeois »274. Cette transformation sociale du théâtre fait l’objet d’une attention particulière
par le gouvernement de Louis-Philippe, notamment sous le regard du ministre de l’Intérieur, Camille
de Montalivet. Lors d’un discours à la chambre des députés le 19 janvier 1831, le ministre exprime une
vision pessimiste du théâtre et de son rôle dans la société:
Là, ce ne sont plus des individualités auxquelles on s’adresse, ce sont des masses dont on s’empare. La liberté ne prend plus la peine de raisonner avec vous, elle passe outre l’esprit et va droit à l’imagination. Ce n’est plus un docteur, c’est une magicienne; elle vous fascine, elle vous entraîne, elle vous passionne. Tout favorise l’exagération de sa puissance au milieu d’un parterre; on s’est animé pour entrer, on arrive dans une autre atmosphère, on respire à peine entre les flots qui vous poussent, les clartés qui vous inondent et la pompe qui vous enivre. Le jeune homme, surtout, ne s’appartient plus; il appartient à la puissance extérieure qui le domine à l’action et à l’auteur qui l’entraînent. 275
Ouvert le 1e mars 1827 près de la Bourse de Paris dans le IIe arrondissement, le Théâtre des
Nouveautés est dans une situation précaire en 1831. Dans son Histoire par le théâtre, 1789-1851,
Théodore Muret décrit une entreprise théâtrale qui n’est pas rentable et n’a pas su trouver son « style »
de théâtre. Le théâtre présente autant des vaudevilles, des pièces à musique et à spectacle ou des
pièces déjà jouées dans d’autres théâtres276. Dans une « Chronique parisienne » de la Revue
britannique parut en avril 1839, le Théâtre des Nouveautés est aussi présenté comme un échec
272 Le Constitutionnel, 20 octobre 1831, p. 2. 273 Odile Krakovitch, Les pièces de théâtre soumises à la censure (1800-1830), Inventaire, Paris, Archives Nationales, 1992, p. 31. 274 Odile Krakovitch, Les pièces de théâtre soumises à la censure, 1992, p. 35. 275 Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session de 1830, Tome 4 (Janvier-Février), Paris, A. Henry, 1831, p. 199. 276 Théodore Muret, L’Histoire par le théâtre 1789-1851. Le gouvernement de 1830, la seconde république, Tome 3, Paris, Amyot, 1865, p. 169.
74
commercial, un emplacement « […] qui manquait d’originalité et d’à-propos »277. À ce moment-là, pour
tenter de garder le théâtre ouvert, l’administration présente à son public des traductions de pièces de
théâtre étrangères comme celles de Shakespeare, mais sans réel succès278. En 1831, quelques mois
avant la représentation de la pièce, le ministre de l’Intérieur Camille de Montalivet, donne l’exemple du
théâtre des Nouveautés comme un théâtre bonapartiste: « Aux Nouveautés, c’est Napoléon II, c’est le
duc de Reichstadt, qui, proclamation vivante, s’adresse lui-même à la France! »279.
Ainsi, avec la représentation du drame historique Le Procès d’un Maréchal de France, il est
vraisemblable que le directeur des Nouveautés, M. Langlois, soit en train de miser sur une pièce
politique pour trouver le succès. Bien que Le Constitutionnel du 20 octobre 1831 parle d’une pièce de
théâtre « impartiale », le schéma narratif proposé par les auteurs présente le maréchal Ney comme la
victime et le martyr des Bourbons, comme on l’a dit au début de ce chapitre. Surtout, certaines
répliques sont hautement politiques et appellent presque à l’action. Par exemple, alors que Ney
s’apprête à être exécuté, un général s’avance vers lui : « J’ai des armes !... dites un mot, et je tente un
effort désespéré »280. La pièce présente même le peuple parisien au bord de l’émeute, puisqu’un
officier insiste auprès de ce supérieur lui-même au bord de la rébellion: « On m’annonce que le peuple
est détrompé, et qu’il accourt en masse par les boulevards (les cris du dehors se rapprochent.)
Entendez-vous ? Il faut en finir »281. Après l’exécution, le général réprimande le peloton d’exécution,
des vétérans qui ont tué le plus intrépide des militaires français, et termine la pièce par une tirade qui
place Ney au rang des martyrs d’une cause non dénommée, mais implicitement bonapartiste, le rôle
des assassins étant explicitement donné aux institutions de la monarchie : « Adieu, au héros de la
Moskowa ; Brune et Labédoyère attendent là-haut ta grande ombre, et la postérité te réserve une place
au panthéon à côté de Montebello ! Et maintenant, laissez passer la justice de la chambre des
pairs !... »282. Prononcées en 1831, ces dernières phrases peuvent-elles remettre en cause le nouveau
principe de liberté théâtrale?
277 « Les petits théâtres », Revue britannique, Avril 1839, p. 68. 278 « Les petits théâtres », Revue britannique, Avril 1839, p. 68. 279 Victor Hallays-Dabot, Histoire de la censure théâtrale en France, 1862, p. 291. 280 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 10. 281 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 11. 282 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 11.
75
Le théâtre et la censure
Après une révolution de Juillet mouvementée et animée par des idées républicaines et
bonapartistes, la préfecture de police de Paris va décider de ne pas autoriser la représentation d’une
pièce portant sur l’exécution controversée d’un maréchal d’Empire dont le souvenir s’attache à la
légende napoléonienne qui se développe sur les planches des théâtres parisiens. Dans l’ouvrage
publié en 1862, Histoire de la censure théâtrale en France, Victor Hallays-Dabot indique une
omniprésence de Napoléon de l’Empire à partir de la monarchie de Juillet en 1830283. Strictement
interdite lors de la Restauration, la figure de Napoléon ressurgit dans l’espace public, non sans
inquiétudes de la part du nouveau gouvernement. En effet, le ministre de l’Intérieur en 1830, François
Guizot, tente de rétablir la censure théâtrale lorsqu’il entre en poste. Dans ses Mémoires pour servir
l’histoire de mon temps, Guizot défend une censure dramatique « […] sérieuse, décidée à défendre
hautement l’honnêteté publique contre le cynisme et l’avidité des entrepreneurs de corruption »284.
Pour lui, la « politique » s’est infiltrée dans toutes les sphères de la société, et notamment dans les
arts, et les « […] passions populaires voulaient faire la loi, et l’esprit démocratique cherchait ses
satisfactions »285. Si le projet de Guizot n’aboutit pas, et ne vise pas un courant politique en particulier,
son successeur au ministère de l’Intérieur, Camille de Montalivet, s’inquiète particulièrement de
l’influence des pièces « napoléoniennes »286. À la lecture des interventions du ministre de l’Intérieur
Montalivet le 19 janvier 1831 à la chambre des députés, le contrôle de la littérature et du théâtre est
un sujet incontournable pour le gouvernement. En effet, selon Montalivet: « Interrogée par la liberté, la
littérature dramatique, il faut bien le dire, a répondu trop souvent par le scandale; elle est tombée en
une sorte de biographie vivante et de diffamation contemporaine »287.
Pourtant, l’interdiction totale d’une pièce de théâtre est assez rare dans les cinq premières
années de la monarchie de Juillet. Selon la spécialiste de la censure théâtre Odile Krakovitch: « Les
dernières années de la Restauration et les débuts de la monarchie de Juillet, avec sa courte liberté de
1830 à 1835, furent témoins d’une véritable révolution de théâtre, dans tous les genres […] »288. Bien
que le projet de Montalivet ne fut pas voté, il informe sur la vision de la censure théâtrale de ce
283 Victor Hallays-Dabot, Histoire de la censure théâtrale en France, 1862, p. 290-291. 284 François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, Michel Lévy Frères, 1859, p. 68-69. 285 François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, 1859, p. 68-69. 286 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome 3, Paris, Librairie classique Larousse et Boyer, 1867, p. 70. 287 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires de 1787-1860, Tome 66, Paris Paul Dupont, 1887, p. 212-213. 288 Odile Krakovitch, Les pièces de théâtre soumises à la censure, 1992, p. 19.
76
gouvernement. Que la pièce de théâtre soit une nouvelle ou une ancienne, l’administration d’un théâtre
devait déposer le texte entier 15 jours avant la première représentation289. De plus, le projet de loi
comportait des pénalités, des amendes ou des peines d’emprisonnement si une entreprise théâtrale
contrevenait à la loi. La législation en vigueur en 1831, du fait de l’abolition de la censure et de la non-
adoption de la proposition de loi, donne la responsabilité de la police des théâtres à l’autorité
municipale. Pour celle-ci, les théâtres représentent de potentiels lieux de : « […] réunions
considérables […] de vives émotions y sont produites par les représentations, une foule d’intérêts s’y
souvent agités, et sous tous ces rapports la surveillance de l’autorité y est nécessaire »290. Pour Paris,
la police des théâtres tombe sous la responsabilité du préfet de police, qui répond devant le ministre
de l’Intérieur.
Bien que techniquement, la censure ne soit pas en vigueur les 22 et 23 octobre 1831, les
autorités ont la volonté et la possibilité de surveiller les pièces de théâtre à saveur politique. Comme
le stipule Odile Krakovitch, les autorités de la monarchie de Juillet craignent davantage les rappels du
passé politique que des écarts de mœurs : « […] interdiction de toucher au régime de la royauté,
interdiction d’évoquer les années de la Révolution […] l’évocation de certains noms propres comme
Voltaire ou Napoléon […] »291. C’est ce pouvoir et cette volonté de surveillance qui vont s’exercer à
propos de la pièce Le procès d’un maréchal de France.
Chronique d’une interdiction théâtrale
Dans La Tribune du 23 octobre 1831, on peut lire la « Protestation du directeur du théâtre des
Nouveautés ». La représentation du Procès d’un maréchal de France a en effet été interdite le
22 octobre. Deux sources principales permettent de revenir sur cette interdiction, et sur la façon dont
les parties prenantes se sont mobilisées autour de la présentation de Ney en victime de l’injustice des
institutions de la monarchie des Bourbons. La première source utilisée est une publication des auteurs
de la pièce parue quelques jours après l’interdiction de leur pièce. L’objectif de cette publication est
décrit dans Le Constitutionnel du 28 octobre 1831 : « Les auteurs du Procès d’un maréchal de France,
ne pouvant représenter leur drame, veulent rendre le public juge de leur démêlé avec l’autorité: ils ont
livré à l’impression la pièce avec les procès-verbaux et les protestations faites par les auteurs et le
289 M. J. Mavidal (dir.), Archives parlementaires de 1787-1860, T. 66, 1887, p. 214. 290 Edmond Blanc et M. Vivien, Traité de la législation des théâtres, 1830, p. 53. 291 Odile Krakovitch, Les pièces de théâtre soumises à la censure, 1992, p. 30.
77
directeur »292. Si cette publication nous présente la vision des auteurs de ces évènements du 22 et
23 octobre 1831, les « rapports particuliers » conservés dans la série F1 des Archives nationales de
France, nous donnent accès au suivi policier de ce que le langage du maintien de l’ordre appelle
« l’Affaire des Nouveautés ». Ces rapports de police démontrent l’importance de l’affaire pour la police
et montrent comment les préoccupations policières concernent aussi bien la représentation de la pièce
que les troubles qui pourraient survenir du fait de son interdiction.
À première vue, cette Affaire des Nouveautés apparaît comme un bras de fer entre le directeur
du Théâtre des Nouveautés, M. Langlois, et la préfecture de police de Paris, sous la direction de M.
Henri Gisquet. Cette saga policière qui déborde finalement dans la rue débute alors que l’un des
commissaires du 2e arrondissement écrit le 22 octobre 1831 au directeur Langlois : « […] qu’en
exécution de l’article 14 du décret du 8 juin 1806, qui défend qu’aucune pièce ne puisse être jouée
sans l’autorisation du ministère de la Police, et encore en vertu d’ordres supérieurs, nous devons à
l’instant notifier à M. Langlois […] que l’autorité s’oppose formellement à ce que la pièce intitulée Le
Procès d’un Maréchal de France (1815), soit jouée ce soir, vingt-deux courant, et les jours suivants,
sur le théâtre qu’il dirige »293. L’avertissement est lancé : le directeur du théâtre n’a pas l’autorisation
formelle du ministère pour jouer une pièce hautement politisée. Cette mise en garde n’est pas non plus
qu’un simple message de courtoisie. En effet, le même commissaire lui déclare toujours par écrit :
« […] qu’en exécution des ordres à nous transmis, nous prendrons toutes les mesures nécessaires
pour en assurer l’exécution, et que, dans le cas où les affiches placées à la porte du théâtre
n’indiqueraient pas un changement de spectacle, nous nous opposerons à l’ouverture des portes, et à
l’introduction du public dans la salle »294.
Si les autorités s’appuient sur le décret du 8 juin de 1806295 pour s’opposer à la représentation
de la pièce, le directeur du théâtre des Nouveautés réplique en invoquant, dans sa publication des
éléments du dossier, deux articles des chartes de 1814 et de 1830. En effet, ces deux articles stipulent
que l’État abolissait la censure des théâtres :
[…] le décret en vertu duquel l’autorité prétend agir [décret du 8 juin 1806], est tombé en désuétude depuis de longues années, non seulement par le fait de la Charte de 1814, mais encore par celle de 1830, qui a, par son article 7, aboli toute censure, et accordé le droit à tous Français de publier et de faire imprimer leurs
292 Le Constitutionnel, 28 octobre 1831, p. 3. 293 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 53. 294 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 57. 295 Ce décret stipule notamment que : « aucune pièce ne pourra être jouée sans l’autorisation du ministre de la Police ».
78
opinions, en se conformant à la loi. […] depuis la promulgation de la Charte de 1830, aucuns de MM. Les directeurs de théâtre n’ont eu besoin d’autorisation préalable pour représenter sur leurs théâtres les divers sujets dramatiques qui n’ont cessé d’y être joués. 296
Ce bras de fer oppose donc liberté théâtrale, défendue par M. Langlois, contre la
« quiétude » publique, défendue par les autorités policières. Parce qu’elle met en avant la figure de
Ney comme martyr, l’œuvre de théâtre a potentiellement les effets de mobilisation et d’ancestralité,
dont parle Jean-Pierre Albert. Remettre en scène l’exécution du maréchal Ney permet aux auteurs de
la pièce, cachés derrière leur liberté théâtrale, de faire le lien entre les morts (Ney), et les vivants
(oppositions politiques à la monarchie), de fabriquer les derniers moments du maréchal martyrisé pour
s’identifier à lui et de définir plus précisément ses bourreaux.
Voyant que M. Langlois campe sur ses positions en « allumant les lumières de son théâtre »297
et en plaçant des affiches qui annoncent la représentation de la pièce sur le maréchal Ney, les autorités
prennent des actions concrètes pour faire valoir leur interdiction. Le 22 octobre, ils placardent « […]
près des portes du foyer et près de celles des acteurs, des bandes portant notre cachet et ces mots :
Par ordre de l’autorité, défenses ont été faites de jouer la pièce ayant pour titre Le Procès du maréchal
Ney (1815) »298. De plus, ils postent des sergents de ville pour empêcher le vandalisme sur ces affiches
et font évacuer les spectateurs déjà entrés dans le bâtiment.
Le lendemain, le 23 octobre, le même manège se déroule devant le théâtre des Nouveautés.
Le directeur ouvre de nouveau son théâtre et annonce la représentation de la pièce. De leur côté, les
autorités réitèrent leur avertissement de la veille et constatent :
[…] qu’au mépris des défenses que nous lui avons faites hier, M. Langlois, directeur du théâtre, n’en a pas moins fait apposer dans Paris et près de ses bureaux des affiches annonçant pour ce soir la représentation de la pièce sus-énoncée : que déjà il fait les dispositions pour recevoir le public dans la salle ; qu’il vient de faire éclairer l’extérieur du théâtre ; que dès lors tout indique qu’il persiste dans sa résistance aux ordres qui lui ont été notifiés, et contre lesquels il a protesté. 299
Face au même refus de M. Langlois, les autorités mettent en place le même mécanisme que
la veille : affiches et sergents de ville annonçant l’interdiction de la pièce. Toutefois, ils renforcent leur
dispositif en rajoutant un détachement de 45 hommes de la garde municipale « […] disposés et placés
devant la façade du théâtre pour empêcher le public d’y entrer de vive force »300. L’importance de cette
296 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 57 297 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 59. 298 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 60. 299 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 65. 300 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 64.
79
opération préventive démontre les intentions des autorités, et surtout l’importance qu’elles accordaient
à l’interdiction de la pièce. Le 23 octobre, M. Langlois annule encore une fois la représentation de la
pièce Le Procès d’un maréchal de France.
Des planches à la rue
Si les procès-verbaux cités plus haut renseignent sur les actions prises par les deux camps,
policiers et théâtre, avec un langage assez « neutre », c’est-à-dire dans le domaine du descriptif, les
rapports de police entourant l’affaire des Nouveautés utilisent un lexique beaucoup plus hostile et
partisan pour décrire l’événement. À la lecture de ceux-ci, deux éléments ressortent : les policiers
veulent rassurer leurs supérieurs quant au contrôle total de l’évènement et ils cherchent à rabaisser,
ridiculiser et amoindrir l’importance des rassemblements qui ont suivi les annulations du 22 et
23 octobre 1831.
Le rapport particulier du 25 octobre 1831 associe d’abord l’organisation de L’Affaire des
Nouveautés à la Société des Amis du Peuple, une organisation républicaine et « ennemie de
l’ordre »301 selon le gouvernement. Déjà en 1830, le ministre de l’Intérieur Guizot avait accusé cette
société républicaine d’être responsable des désordres et des difficultés économiques à Paris302. Ayant
participé activement à la Révolution de Juillet, l’objectif de cette société est de structurer et d’affirmer
politiquement le mouvement républicain. La diversité politique de la société est assez variée, et
regroupe essentiellement des hommes de lettres303. Les Amis du peuple s’intéressent à plusieurs
aspects de la vie politique, économique et sociale, notamment pour les classes inférieures, et visent
« […] l’amélioration de leur condition physique et morale »304. Par exemple, selon un rapport particulier
datant du 14 octobre 1831, les Amis du peuple distribuent des pamphlets (dont le contenu n’est pas
spécifié dans la source) gratuitement aux ouvriers sans emploi de Paris305.
Dans un rapport particulier du 25 octobre 1831, le ton est presque militaire:
« Les renseignements qui étaient parvenus à la Police dans la matinée d’hier [24 octobre 1831] sur les
projets des ennemis de l’ordre l’avaient forcée à concentrer presque exclusivement sa surveillance sur
301 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 302 Jean-Claude Caron, « La Société des Amis du Peuple », Romantisme, 1980, No. 28-29, p. 173. 303 Jean-Claude Caron, « La Société des Amis du Peuple », p. 173. 304 Jean-Claude Caron, « La Société des Amis du Peuple », p. 175. 305 « Rapport particulier du 14 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
80
la place de la Bourse et tous les quartiers adjacents. Toutes les mesures nécessaires pour la
répression d’une attaque violente avaient été prises »306. Les autorités s’attendent vraisemblablement
à une confrontation avec ceux qui sont présents devant le théâtre des Nouveautés. Selon les comptes
du rapport du 25 octobre 1831: « Les Amis du peuple et tous les meneurs du club n’ont pu réunir que
500 personnes environ, et tout s’est borné à quelques cris séditieux, et beaucoup de menaces vagues
et ridicules. Les groupes ont été dispersés, et les plus turbulents parmi les individus qui les
composaient, arrêtés et conduits à la préfecture »307.
Parmi ces personnes arrêtées, les policiers insistent sur un individu qu’ils nomment Saint-
Damse, une figure connue qui a participé à un rassemblement de « conjurés » le 14 juillet 1831. Cette
manifestation a attiré l’attention des forces de l’ordre puisqu’elle a réuni au moins 200 personnes à la
place du Châtelet308. Ceux-ci sont par la suite dispersés dans cafés et marchands de vin, vers la Porte
Saint-Denis et la Bastille309. Lors de ce rassemblement, Le Moniteur Universel du 15 juillet 1831
recense un individu qui : « […] pérorait et excitait le peuple à la révolte, aux cris de Vive la
République! »310. C’est ce même Saint-Damse, disent les rapports de police qui est un meneur des
rassemblements lors de l’Affaire des Nouveautés, qui souhaite : « […] faire des barricades en
renversant des omnibus qui passaient. Il va être mis à la disposition de M. le procureur du Roi »311. De
plus, en lien avec ce même rassemblement, le conservateur de la Bourse (bâtiment adjacent au théâtre
des Nouveautés) a rendu un poignard trouvé dans le corps de garde de la Bourse, signalant selon les
autorités, la présence d’hommes armés lors du rassemblement devant le théâtre312.
Toujours dans le rapport particulier 25 octobre 1831, les policiers affirment que les Amis du
peuple tentent de faire participer des ouvriers à ce rassemblement. En effet, trois membres influents
de l’association républicaine (Mades, Montaix et Delaunay) essaient d’attirer les ouvriers vers la Place
de la Bourse, quartier où est situé le théâtre des Nouveautés. Commandité par les auteurs de la pièce,
Delaunay aurait ainsi eu pour mission de distribuer 300 billets aux ouvriers qui se trouvent à la Barrière
du Maine313. Toutefois son projet échoue puisque : « […] s’étant mis à boire avec les ouvriers, il est
306 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 307 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 308 « Rapport du commissaire de Police de la ville de Paris du le 14 juillet 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 309 « Rapport du commissaire de Police de la ville de Paris du le 14 juillet 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 310 Le Moniteur Universel, 15 juillet 1831, p. 1. 311 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 312 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 313 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
81
tombé dans un état d’ivresse tel qu’il a oublié les billets d’entrée, et s’est endormi »314. Ce petit épisode
à première vue anecdotique illustre que les Amis du peuple cherchent à attirer le plus de personnes
possible à la pièce de théâtre.
La surveillance policière continue les jours suivant l’annulation de la pièce, et les rapports sont
toujours aussi attentifs aux possibilités d’escamotage et aux rassemblements. D’après une source
théâtrale, les autorités pensent « […] que M. Langlois eût le projet d’escamoter une première
représentation, comme cela s’est pratiqué à ce théâtre et à d’autres pour des ouvrages contre lesquels
on redoutait une cabale ou la censure de l’autorité […] »315. Ainsi, l’idée est d’annoncer l’indisposition
d’un des acteurs de la pièce ce qui empêcherait de jouer la pièce promise sur les affiches du théâtre,
pour ensuite la remplacer par Le procès d’un maréchal de France. Sur un ton ironique le rapport indique
que cette proposition « [...] qui, comme on le pense bien, serait accueillie par les bravos des amis qui
auraient garni la salle »316. Toutefois, le rapport particulier du 26 octobre 1831 note qu’il n’y a plus de
rassemblements devant le théâtre : « Des renseignements pris avec soin, portent à croire que le projet
de représenter à l’improviste la pièce de MM. Fontan et Dupeuty, dont il a été parlé dans le rapport
d’hier, avait été mis en avant dans un moment d’effervescence, mais qu’on n’a jamais songé
sérieusement à l’exécuter […] »317.
L’Affaire des Nouveautés terminée, les policiers moussent leur « réussite » dans le rapport
particulier du 26 octobre 1831 aux échelons supérieurs de la police: « La fermeté que l’autorité a
montrée dans toute cette affaire des Nouveautés a produit un excellent effet sur l’opinion publique »318.
Les policiers se félicitent d’avoir maté les ennemis de l’ordre et du gouvernement avant même qu’ils
aient pu commencer une émeute « à l’aide d’un prétexte tout trouvé, lorsque dans d’autres occasions
ils en auraient suscité de très graves sans aucun motif apparent »319. Ici, le rapport particulier donne
beaucoup d’importance au « prétexte » qui est évidemment le maréchal Ney. Les émeutiers ont le
meilleur prétexte pour créer de véritables émeutes, mais ils ont échoué à cause du travail des policiers.
Par ailleurs, ce travail fut encensé par les puissances étrangères : « On sait d’une manière certaine
que ces considérations n’ont point échappé à plusieurs ministres des puissances étrangères qui ont
314 « Rapport particulier du 25 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 315 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 316 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 317 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 318 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33. 319 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
82
manifesté hautement leur satisfaction. C’est sous l’influence de cette heureuse impression que
M. Pozzo di Borgo en a écrit hier à sa cour [de Russie] »320.
L’Affaire des Nouveautés est l’un des meilleurs exemples d’implication policière dans le but de
contrôler un évènement en lien avec la commémoration du maréchal Ney. Bien que dans tous les
rapports particuliers analysés, le nom de Ney ne soit jamais mentionné, les autorités redoutent
fortement la force mobilisatrice de la figure de victime et de martyr du maréchal Ney. Sa figure, son
procès à la Chambre des pairs et son exécution sont autant de vecteurs de mobilisation qui autorisent
des parallèles avec des situations similaires des années 1830. Toutefois, les forces de l’ordre et le
gouvernement ont su ne pas sous-estimer cet effet de mobilisation. Cette réaction de la police montre
à quel point la mémoire d’un martyr bonapartiste n’est pas prise à la légère ; les autorités pensent
qu’elle peut créer des émeutes, une mobilisation politique. Dans la littérature portant sur la figure de
victime et de martyr du maréchal Ney, l’Affaire des Nouveautés fait figure d’exception puisque cette
pièce de théâtre fait le lien entre le monde littéraire et la rue qui implique une mobilisation politique
spontanée ou organisée.
La commémoration de la figure de victime et de martyr du maréchal Ney dans l’espace public
parisien, dans les arts, les écrits de nature juridique et au théâtre, se pratique d’une façon sporadique,
avec une apogée dans les années 1830-1831. Sans L’Affaire des Nouveautés et la tentative de porter
le buste de Ney au Panthéon, la figure de Ney est secondaire dans la légende napoléonienne, et dans
les actions politiques bonapartistes. Cette quasi-absence de Ney n’enlève rien à la potentielle
mobilisation de sa figure. Lors de son procès, de son exécution, et de l’Affaire des Nouveautés, les
sources policières ont conscience que la figure de Ney est un motif sérieux pour entreprendre des
actions subversives à l’intérieur de l’espace public contre le gouvernement. Les productions picturales,
majoritairement présentées sous le signe de la victime, rendent compte de l’attention particulière de
l’injustice faite au maréchal Ney. Sur ce point, bien que Louis-Philippe refuse de réhabiliter le maréchal
Ney, le roi permet la production d’écrits juridique qui prennent sa défense. Cette particularité de victime
judiciaire associée à Ney devient un argument utilisé par ceux qui sont jugés par la Chambre des pairs.
Comme Daumier le présente, Ney est la figure qui hante les Pairs dans leur rôle de tribunal politique.
Bien que généralement la figure de Ney demeure dans l’ombre de Napoléon, elle réussit à être un
320 « Rapport particulier du 26 octobre 1831 », Archives Nationales, F 1cl 33.
83
vecteur artistique et politique, à inspirer des discours politiques qui rappellent sa mémoire de victime
et de martyr de l’État bourbonien.
84
Chapitre 3 : Le héros
L’abrégé de la cinquième édition de Dictionnaire de l’Académie, publié en en 1821, définit le
héros comme : « Né d’un dieu ou d’une déesse, et d’une personne mortelle; ceux qui par une grande
valeur se distinguèrent des autres hommes; homme qui s’est distingué à la guerre par de grandes
actions; homme qui a donné des marques d’une grande fierté, d’une grande noblesse d’âme; fig. Objet
d’admiration ». Avant d’être un objet d’admiration au début du XIXe siècle, le héros est concurrencé
par la figure du grand homme qui était célébrée par les cercles intellectuels du XVIIIe siècle. Pour
ceux-ci, les grands hommes se démarquent du héros, et se distinguent par la somme des mérites et
talents acquis tout au long de leur existence. Contrairement au héros qui tient du « surnaturel », le
grand homme gagne son prestige par sa patience et son travail du quotidien. Cependant, Robert
Morrissey, auteur de l’ouvrage Napoléon et l’héritage de la gloire, pense que le héros n’avait pas
nécessairement perdu sa place au sein de la société française. Le héros militaire garde son attractivité
en France pour penser, exprimer et représenter la gloire de ce pays321. L’héroïsme est une rupture
avec le « réel commun »322. Celui qui porte l’héroïsme en lui, le héros, est un « homme de l’instant »323
qui brise la lenteur du quotidien.
Selon Philippe Sellier, la construction d’un récit portant sur le héros se fonde habituellement
sur 4 points : « […] d’arrachement à la banalité de la vie, de supériorité sur le reste du monde, de
réalisation éclatante de soi, d’élévation à une condition quasi divine […] »324. La construction d’un
Empire par Napoléon à l’échelle européenne peut répondre à ces quatre derniers points. Issu de la
petite noblesse corse, Napoléon impressionne par ses coups d’éclat et ses qualités militaires. Imposant
la supériorité française sur le continent européen, Napoléon fera l’objet d’un culte qui frôle cette
élévation quasi divine dont parle Philippe Sellier. Le héros est un « produit » de ce glorieux édifice
militaire, érigé par Napoléon et ses maréchaux. Grâce à un immense travail narratif qui soulignait à
grands traits leurs exploits militaires, les lieutenants de Napoléon ont été érigés en héros de cet Empire
français.
321 Robert Morrissey, Napoléon et l’héritage de la gloire, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 11. 322 Robert Morrissey, Napoléon et l’héritage de la gloire, 2010, p. 11. 323 Mona Ozouf, « Le Panthéon », in Pierre Nora. Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984, p. 148. 324 Philippe Sellier, Mythe du héros, Paris, Éd. Bordas, 1985, p. 14-15.
85
Dans sa toute première entrée des Bulletins de la Grande Armée, Napoléon se met en scène
dans cette campagne de 1805 qui mènera à la victoire d’Austerlitz : « Soldats, votre Empereur est au
milieu de vous. Vous n’êtes que l’avant-garde du grand peuple […] »325. Il ajoute : « Mais, soldats, nous
avons des marches forcées à faire, des fatigues et des privations de toute espèce à endurer; quelques
obstacles qu’on nous oppose, nous les vaincrons, et nous ne prendrons de repos que nous n’ayons
planté nos aigles sur le territoire de nos ennemis »326. Ces paroles placent Napoléon au centre du
dispositif qui célèbre les accomplissements militaires et patriotiques, et la gloire française.
Dans son ouvrage Napoléon et l’héritage de la gloire, Robert Morrissey ajoute que la gloire
héritée de la Révolution, et de ses armées, sert d’outil politique pour sortir de l’essoufflement
révolutionnaire. Ce dernier définit la gloire comme « […] une force discursive suffisante pour permettre
de sortir de l’impasse du contractualisme et de dépasser le problème posé par l’abstraction de la
volonté générale. Le sentiment et l’enthousiasme qui la caractérisaient sont générateurs de liens
sociaux, voire de fraternité. Elle a l’avantage de pouvoir lier dévouement et désintéressement avec le
souci de soi, de se manifester comme affirmation simultanée d’une grandeur individuelle et collective,
de jouer confusément à la fois sur l’estime de l’opinion publique et l’appel à la postérité […] »327. Dans
un contexte de volonté d’égalité citoyenne, la gloire pouvait compenser ce nivellement et donner des
distinctions autres que celles de l’argent ou de la naissance : « […] la gloire en tant que récompense
fonctionnerait comme une monnaie d’une autre espèce que la monnaie sonnante ou trébuchante »328.
C’est ainsi que Robert Morrissey parle d’une « politique de fusion » qui permet un syncrétisme des
valeurs révolutionnaires (égalité, liberté) avec celle de la gloire des armées, et de réconcilier : « […]
ambition personnelle et soumission à la cause collective […] »329. Dans sa conception de l’idéologie
de la gloire, Napoléon permet de fusionner « deux sociétés » dont les bases diffèrent (l’individualité et
la collectivité) pour les faire marcher au pas de la guerre.
Dans Quand les enfants parlaient de gloire, Jean-Paul Bertaud présente cet édifice militaire et
patriotique qu’est la France sous le Premier Empire. Plus précisément, il tente de comprendre par
quels moyens Napoléon a « glorifié la gloire » à l’intérieur d’une société française axée sur le culte de
325 Alexandre Goujon, Bulletin de la Grande Armée. Campagne d’Austerlitz et d’Iéna, Paris, Baudoin Frères, 1820, p. 2. 326 Alexandre Goujon, Bulletin de la Grande Armée. Campagne d’Austerlitz et d’Iéna, 1820, p. 2. 327 Robert Morrissey, Napoléon et l’héritage de la gloire, 2010, p. 107. 328 Robert Morrissey, Napoléon et l’héritage de la gloire, 2010, p. 3. 329 Robert Morrissey, Napoléon et l’héritage de la gloire, 2010, p. 110.
86
la guerre, la gloire de la Grande Nation, et sur Napoléon. Dans son essence même, la construction de
l’Empire se fonde sur l’exaltation de la gloire. Celle-ci s’assoit d’abord sur un climat martial qui règne
depuis les balbutiements de la République: sans cesse, la guerre semble être aux portes de la France.
À partir de 1792, la multiplication des campagnes militaires contre les couronnes d’Europe permettait
à de futurs hauts gradés de Napoléon de se distinguer. La gloire acquise lors des guerres
révolutionnaires est récupérée par l’Empereur et par les militaires dans leur ensemble. Lors de
l’Empire, la guerre est un horizon qui doit toujours être présent en France. La guerre, au sens large,
est partout: des parades militaires avec une ambiance musicale martiale deviennent le quotidien des
Parisiens330; les Bulletins de la Grande Armée sont lus par plusieurs et « […] le cortège des vaincus
traversant villes et villages dit le triomphe du nouveau César »331. Pour les généraux et maréchaux,
cette omniprésence guerrière est l’outil pour se construire une stature de gloire et d’héroïsme. Pour
Napoléon, trônant au sommet de l’édifice politico-militaire, la guerre devient un moyen de marquer
l’imaginaire de la société française.
La création des Bulletins de la Grande Armée est un élément central du dispositif napoléonien.
Ils placent la guerre et la gloire au cœur de la société française et deviennent un des grands outils de
mise en évidence des faits d’armes qui sont la condition de l’identification et de la reconnaissance du
héros. Jean-Pierre Bertaud en fait une description claire et précise :
Le récit ne verse ni dans la grandiloquence théâtrale, ni dans la sécheresse du compte rendu d’état-major. Martèlement de phrases claires, incisives et puissantes, le style se diversifie pour tenir en haleine le lecteur et adopte le rythme d’une action qui jamais ne se ralentit. Il passe brusquement du discours direct, multiplie les images, les anecdotes, surprend enfin par le contraste entre les idées et les faits exposés 332
Le maréchal Ney est une des figures de héros qui émerge de cet édifice. Ces Bulletins seront
un outil précieux pour la représentation du maréchal Ney dans ses habits du héros : leur dépouillement
permet de capter une partie des hauts faits militaires accomplis par le prince de la Moskowa, ainsi que
la propagation de ceux-ci dans toute la France. Les Bulletins, comme narratif des campagnes militaires
de l’Empire, peuvent aussi nous démontrer de quelle façon le maréchal Ney y est nommé et raconté.
Ils sont une porte d’entrée pour comprendre sa représentation à l’intérieur de cet édifice napoléonien.
Un autre moyen d’y parvenir est l’utilisation des biographies publiées entre 1815 et 1848 portant sur
Ney. Ces documents seront utilisés afin de comprendre comment ces auteurs ont décrit le maréchal
330 Jean-Paul Bertaud, Quand les enfants parlaient de gloire, 2006, p. 258. 331 Jean-Paul Bertaud, Quand les enfants parlaient de gloire, 2006, p. 249. 332 Jean-Paul Bertaud, Quand les enfants parlaient de gloire, 2006, p. 263.
87
Ney dans l’habit du héros. Dans leur grande majorité, ces biographies font un profil héroïque de la
carrière militaire de Ney et décrivent de façon précise son ascension dans l’armée et ses grandes
batailles militaires. Publiés après son exécution, ces ouvrages permettent de sceller la figure du héros
du maréchal Ney, et nous utiliserons ce matériel pour mieux comprendre cette figure du héros. Par la
suite, une autre catégorie d’ouvrages nous offre une incursion à l’intérieur des champs de bataille de
l’Empire, les récits d’anciens soldats. Nous avons décidé d’utiliser ceux de la campagne de Russie
(1812) et la bataille de Waterloo (1815) puisqu’elles sont les deux moments où Ney se distingue le
plus comme un héros. Ces récits nous permettent ainsi de capter le regard qu’un militaire pouvait
porter sur le maréchal Ney en action sur le terrain. Nous commencerons ce dernier chapitre avec les
minutes du procès pour montrer que le maréchal Ney s’était comporté en héros devant les
commissaires du roi.
Les derniers souffles du maréchal, en trois actes
Dans la pièce Le procès d’un maréchal de France, le personnage maréchal Ney, vivant alors
ses derniers moments, ordonne lui-même aux soldats du peloton d’exécution de faire feu sur lui :
« Soldats, garde-à-vous! Apprêtez armes! Vous hésitez…faites votre devoir…Hâtez-vous, et tirez-
là…joue…feu! »333. D’ailleurs, dans les Bulletins de la Grande Armée, on rencontre de nombreuses
descriptions de « derniers moments » de soldats, d’officiers, de généraux et même de maréchaux qui
sont ancrés dans la rhétorique du pathos334. Évidemment, les dernières paroles d’un soldat gisant sur
le champ de bataille vont toujours vers le plus grand éloge de Napoléon, de l’Empire, de ses camarades
d’armes et de la France. Ce genre de rhétorique participe de la notion de la belle mort. Tirée des
épopées grecques comme L’Illiade, ce concept représente pour le héros « le terme ultime de
l’honneur »335. En effet, « […] celui qui a payé de sa vie son refus du déshonneur au combat, de la
honteuse lâcheté, elle assure un indéfectible renom. La belle mort, c’est aussi bien la mort
glorieuse »336. L’un des exemples les plus éloquents de cette belle mort concerne un capitaine des
grenadiers à cheval de la garde impériale mort à la bataille d’Eylau en 1807. Pendant que des soldats
tentent de le ramener vers l’ambulance, le capitaine exprime ses dernières paroles:
333 Charles-Désiré Dupeuty et Louis-Marie Fontan, Le procès d’un maréchal, 1831, p. 50. 334 « Partie de la rhétorique qui traite des moyens propres à émouvoir l’auditeur », http://www.cnrtl.fr/definition/PATHOS 335 Jean-Pierre Vernant, « La belle mort et le cadavre outragé », 1990, p. 2. 336 Jean-Pierre Vernant, « La belle mort et le cadavre outragé », 1990, p. 2.
88
Laissez-moi, mes amis; je meurs content, puisque nous avons la victoire, et que je puis mourir sur le lit d’honneur, environné de canons pris à l’ennemi et des débris de leur défaite. Dites à l’Empereur que je n’ai qu’un regret; c’est que, dans quelques moments, je ne pourrai plus rien pour son service et pour la gloire de notre belle France… A elle mon dernier soupir. 337
Pour cerner les derniers moments du maréchal Ney, les principales sources sont les minutes
du compte-rendu du procès publié par L. G. Michaud, ainsi que 8 biographies du maréchal Ney
publiées après sa mort, entre 1815 et 1848338. De plus, les Souvenirs de l’organisateur de l’exécution,
le comte de Rochechouart, seront également utilisés comme un témoignage des derniers moments du
maréchal Ney. Contrairement à Rochechouart qui prétend avoir la « vraie » version des évènements
entourant l’exécution de Ney, notre objectif est de mettre en évidence les convergences dans la façon
dont la mort de Ney est mise en scène, au-delà de la multiplicité des récits et des contradictions qui en
découlent. Il s’agit de comprendre, au travers des sources mentionnées, la façon dont la figure d’un
Ney héroïque est affirmée par ceux qui écrivent sur sa sortie de la scène, mais aussi dans une certaine
mesure par lui-même, contrairement aux figures du traître et du martyr qu’il n’endosse pas. Avec le
croisement de ces sources, les derniers moments de Ney se décomposent en trois actes, et se
déroulent les 6 et 7 décembre 1815.
Le comte de Rochechouart entre en scène au deuxième acte: le 6 décembre au soir, il doit
prendre en charge le prisonnier du palais du Luxembourg et l’escorter le lendemain à la place de
l’Observatoire, lieux de l’exécution. Le troisième acte se situe donc le jour de l’exécution. Mais c’est à
la dernière séance du procès, le 6 décembre, que débute la mort héroïque du maréchal Ney. À
l’intérieur de l’enceinte de la Chambre des pairs, il revêt à cet instant l’habit du héros qu’il gardera tout
au long des trois tableaux.
« Jusqu’ici ma défense me parut libre […] »339
La dernière séance (6 décembre 1815) du procès du maréchal Ney semble être chaotique : le
commissaire du Roi, M. Bellart, refuse que les avocats de la défense utilisent la Convention militaire
du 3 juillet 1815 pour leur défense. Et plus particulièrement son article 12: « Les habitants, et en
337 Alexandre Goujon, Bulletin de la Grande Armée. Campagne de Prusse, Pologne et d’Autriche, Paris, Baudoin Frères, 1820, p. 18. 338 Ces biographies sont les seules disponibles, à l’intérieur de nos balises historiques, qui portent sur la vie entière de Ney, à l’exception de celle de d’Henri Welschinger (1893) qui traite uniquement de Ney en 1815. 339 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 37.
89
général tous les individus qui se trouvent dans la Capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés,
sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu’ils occupent ou
auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques »340. Le commissaire du roi prétend
que Louis XVIII n’avait pas ratifié cette Convention, qui par conséquent ne pouvait pas être utilisée par
les avocats de Ney.
Selon les comptes rendus publiés du procès, c’est lorsque l’avocat de Ney utilise le traité du
20 novembre341 que l’accusé endosse l’habit du héros : « […] l’accusé se lève avec précipitation et
s’écrie : Oui, Monsieur, je suis Français et je mourrai comme tel. Jusqu’ici ma défense a paru libre; je
m’aperçois qu’on veut l’entraver »342. Avec un papier à la main, comme le procès-verbal du procès le
stipule, Ney continue : « Je remercie mes généreux défenseurs de ce qu’ils ont déjà fait et de ce qu’ils
sont prêts à faire encore; mais j’aime mieux n’être pas défendu que de n’avoir qu’un simulacre de
défense. Je suis accusé contre la foi des traités, et l’on ne veut pas que je les invoque. Je fais comme
Moreau, j’en appelle à l’Europe et à la postérité »343. Par cette brève prise de parole, Ney dénonce
l’esprit vengeur de ce procès, ainsi que l’attitude de ses avocats. Mais surtout, il pose un véritable
appel à la postérité héroïque par la combinaison de ses deux affirmations. Celle de son attachement,
sa loyauté à la communauté nationale, et celle de son choix de la mort plutôt que du déshonneur.
Treize ans plus tard, dans le Précis historique et jugement d’un illustre guerrier (1829), l’ancien
magistrat Papy Descabanes montre que cet appel a été entendu : « On pourrait regretter que M. Dupin
eût fait valoir pour son illustre client le traité du 20 novembre qui sépare de la France la ville de
Sarrelouis […] si ce moyen suggéré par son défenseur, n’eût amené cette sublime interruption du
maréchal Ney : je suis français et je mourrai français! »344. Cette célébration du patriotisme de Ney
figure dans un éloge de Ney, homme aux cent combats et batailles qui pendant 25 ans a guidé et a
protégé des milliers de soldats français grâce à son héroïsme et son courage345.
Dans un autre ouvrage, Précis historique de la vie et du procès du maréchal Ney (1816), le
récit de la prise de parole du Ney à l’intérieur de la Chambre des pairs diffère par un lexique plus
négatif. Son auteur, François-Frédéric Cotterel, docteur de la faculté de Paris, considère le maréchal
340 https://www.senat.fr/evenement/archives/D26/le_marechal_ney/la_seconde_restauration.html 341 Ce traité exclut la ville de naissance du maréchal Ney, Sarrelouis, du royaume de France. 342 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 37. 343 Procès du Maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 37. 344 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, Paris, 1829, p. 17. 345 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 19.
90
Ney comme un traître à Louis XVIII. Cotterel ajoute quelques mots qui ne sont pas anodins à la prise
de parole du maréchal Ney. Alors qu’il n’en est pas question dans le compte-rendu publié par L. G.
Michaud, l’auteur explique que par ces mots le maréchal Ney aurait dit qu’il abandonnait sa défense.
Si, dans les faits, il abandonne sa défense, sous la plume d’un partisan de Louis XVIII qui voyait ce
procès comme une « grande et terrible leçon […] »346, le terme « abandonner » signifie beaucoup plus.
Dans ce sens, Ney renonce à prouver son innocence, et ce geste soutient qu’il était incapable de le
faire, ou bien qu’il ne possédait pas la fermeté nécessaire pour le faire. Pour ses partisans ou ses
détracteurs, ce moment précis est une clé pour établir ou détruire la stature héroïque de Ney.
Une autre biographie du maréchal Ney se penche sur cette prise de parole lors de la dernière
séance du procès. Bien qu’écrit en 1893, ce livre démontre la façon dont ce moment du procès marque
les récits biographiques sur Ney, et confirme ainsi son importance. Surtout, l’auteur présente la prise
de parole du maréchal comme une action préméditée avec ses deux avocats. Dans les mémoires de
M. Dupin, ce dernier affirme qu’il avait été convenu, en anticipation du rejet de ses observations sur la
Convention du 3 juillet 1815, qu’il rédigeât : « […] une protestation que j’irais communiquer à M. le
maréchal, pour qu’il fût prévenu de ce qui allait se passer, et afin qu’il pût lui-même, quand il verrait sa
défense contrariée, s’interposer, constater la violence qui nous serait faite, nous retirer lui-même la
parole et protester »347. Ceci était destiné à démontrer que le procès se déroulait « […] dans une
atmosphère d’intimidation »348, que les avocats du maréchal n’avaient plus les outils nécessaires pour
fournir au maréchal une défense adéquate. Toutefois, derrière ces stratagèmes d’avocats, c’est bien
en dernier ressort Ney qui affirme ici, à la première personne, la détermination qui sied au héros.
Lorsque l’un de ses avocats veut reprendre la parole, Ney lui interdit : « Vous voyez bien que c’est un
parti pris. J’aime mieux n’être pas défendu du tout que de l’être au gré de mes accusateurs! »349.
Tentative désespérée, moment d’exaspération, ou prise de conscience de son sort, le maréchal Ney,
voyant l’issue du procès se dessiner très clairement, clôt les débats judiciaires avec éclat, laissant à la
postérité l’image qu’il aura combattu cette « injustice » jusqu’au bout. Directement après que Ney a
346 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. iv. 347 André Dupin, Mémoires de M. Dupin. Souvenirs du barreau. Paris, H. Plon, 1855, p. 42. 348 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 316. 349 Pierre-Nicolas Berryer, Souvenirs de M. Berryer, doyen des avocats de Paris, de 1774 à 1838, Bruxelles, Hauman et Cie, 1839, p. 299.
91
interdit à ses avocats de le défendre, le commissaire du roi Bellart débute son réquisitoire : « […] au
moment où la défense est close, l’accusation doit être close aussi »350.
Le maréchal Ney donne le ton dans ce premier acte de ses derniers moments. L’issue du
procès verrouillé, le condamné quitte la Chambre des pairs après avoir laissé une marque claire et
précise: son innocence et son opposition à ce procès. Refusant de s’acharner, il abdique dans une
posture héroïque. Le président de la Chambre des pairs, après le réquisitoire, ordonne au maréchal
Ney de quitter l’enceinte sous escorte pour se rendre dans sa chambre du Luxembourg sans attendre
sa condamnation. De sa prison, ses paroles et ses gestes posés vont contribuer à sceller sa figure de
héros.
L’attente
Dans les sources consultées sur les derniers moments du maréchal Ney, ce deuxième acte
est probablement celui où les descriptions présentent la plus forte convergence. Ce deuxième acte se
situe dans le palais du Luxembourg où Ney était enfermé dans une chambre surveillée par des
grenadiers, du mercredi soir 6 décembre 1815 à 17:00 jusqu’au lendemain matin, jour de l’exécution.
Certaines versions sont plus longues, d’autres résument rondement ce moment passé dans la prison
du Luxembourg. Papy Descabanes passe directement du procès à l’exécution, le compte-rendu du
procès publié en 1815 par L. G. Michaud parle de ce moment en 19 lignes, Cotterel et Rochechouart
y consacrent 2 pages, et à la fin du XIXe siècle, Welschinger s’y attarde pendant environ 11 pages.
La scène au palais du Luxembourg contraste avec les épisodes précédents, dont le récit était
marqué par la mise en évidence de la fougue de Ney. Mais ce contraste renforce la figure du héros.
Après la dernière audience à la chambre des Pairs du 6 décembre 1815, les deux avocats de Ney
retrouvent un homme qui « […] témoignait le plus grand calme »351. L’un de ses avocats, Berryer, est
déconcerté devant la tranquillité du condamné à mort : « je le trouvai tranquille, mangeant de fort bon
appétit, comme en profonde paix »352. Donnant cette impression claire d’avoir accepté son sort, avec
même un ton d’insouciance et un brin d’humour353, le condamné à mort embrasse l’avocat Berryer : «
350 Procès du Maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 38. 351 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 325. 352 Pierre-Nicolas Berryer, Souvenirs de M. Berryer, 1839, p. 299. 353 Après avoir terminé son souper, le maréchal dit à un de ces gardes : « Je suis sûr que M. Bellart ne dîne pas avec autant d’appétit que moi ! ». (Henri Welschinger, p. 325).
92
Adieu, mon cher défenseur, nous nous reverrons là-haut »354. Après avoir démontré « à la postérité et
à l’Europe » son innocence, le maréchal Ney apparaît comme un homme serein, qui accepte la
dramatique séquence à venir. Ses paroles et ses gestes, tels que racontés et publiés par ses avocats,
l’ancrent ainsi dans cette figure du héros qui ne craint pas son exécution. En résonnance avec la
définition du héros dans le Dictionnaire de l’Académie française de 1821, le sang-froid de Ney
provoque l’admiration de ses avocats.
Le flegme et la détermination sont toujours aussi présents dans les récits lorsqu’ils abordent
le dernier matin du maréchal. Aux petites heures, un greffier vient lui lire l’arrêt qui le condamne à mort,
ce à quoi le maréchal, en lui coupant la parole, lui répond : « À quoi bon tout cela? Michel Ney, puis
un tas de poussière, voilà tout. […] Je suis tout prêt à mourir, quand on voudra »355. Le greffier lui
proposant les services du curé de Saint-Sulpice avant de mourir, le maréchal lui répond : « Je n’ai pas
besoin de curé pour apprendre à mourir »356. Toutefois, après qu’un des grenadiers lui suggère de
penser à Dieu avant de mourir, le maréchal accepte finalement d’entendre le curé de Saint-Sulpice à
l’intérieur de sa cellule, et de nouveau quelques minutes avant son exécution357. Grâce aux Souvenirs
sur l’Empire et la Restauration de Rochechouart, la scène se peaufine, décrivant un maréchal qui, au
seuil de la mort, écoute avec attention les conseils d’un simple grenadier. Celui-ci, selon le comte de
Rochechouart, aurait dit au maréchal : « Vous avez tort, maréchal. […] Je ne suis pas aussi illustre358
que vous, mais je suis aussi ancien »359. Faisant preuve d’humilité, le maréchal acquiesce à la réflexion
du grenadier : « Tu as peut-être raison, mon brave, c’est un bon conseil que tu me donnes là »360.
Cette partie du récit trace le portrait d’un homme qui accepte, embrasse sa mort. Le condamné y
consomme le sacrifice qu’il avait lui-même tracé dans sa dernière prise de parole devant la Chambre
des pairs, le tout dans un calme déconcertant.
Ce deuxième tableau est un interlude privé entre la scène du procès et le dernier acte durant
lequel la parole de Ney va de nouveau éclater dans la sphère publique. Ce dernier tableau, celui de
l’exécution, apporte la touche finale au portrait du héros qui affronte sans trembler son destin.
354 Pierre-Nicolas Berryer, Souvenirs de M. Berryer, 1839, p. 300. 355 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 55. 356 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 55. 357 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 55. 358 À noter que dans la version d’Henri Welschinger, le grenadier aurait plutôt utilisé « brave » que « illustre ». (p. 332). 359 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 433. 360 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 433.
93
« Voici une vilaine journée! »361
Vers 8h30 du matin, le maréchal Ney embarque dans la voiture qui doit le mener au lieu de
l’exécution, à l’Observatoire, au sud du palais du Luxembourg où il était emprisonné. Afin de démontrer
la sérénité du maréchal Ney devant son exécution, le comte de Rochechouart rapporte que Ney aurait
qualifié le mauvais temps de la matinée du 7 décembre de « vilaine journée »362. Supervisant
l’application du jugement de la Chambre des pairs et de l’exécution, en tant que commandant de la
Place de Paris, le comte de Rochechouart décrit point par point, dans ses Souvenirs, l’organisation
des dernières minutes de la vie du maréchal. Publiés par son fils, les Souvenirs du comte de
Rochechouart sont parus en 1889 bien après la mort de son auteur. Bien qu’il soit, à l’époque de
l’exécution, associé au gouvernement, son récit de la matinée du 7 décembre 1815 témoigne de son
admiration pour le maréchal Ney, et la supervision de l’exécution semble avoir été un fardeau bien plus
qu’un honneur. Dans son récit, la mort du maréchal Ney est un moment exemplaire et digne363.
Insistant sur son statut de témoin direct fiable, Rochechouart rapporte ce qu’il a entendu au moment
où les soldats ont fait feu sur le maréchal Ney :
Et là, dans une attitude que je n’oublierai jamais, tant elle était noble, calme et digne, sans jactance aucune, il ôta son chapeau, et profitant du court moment que lui laissait l’adjudant de place, pour se mettre de côté et donner le signal du feu, il prononça ces quelques paroles, que j’entendis très distinctement : ‘Français! Je proteste contre mon jugement, mon honneur…’ À ces derniers mots, comme il portait la main sur son cœur, la détonation se fit entendre; il tomba, foudroyé. 364
Parmi les biographies du maréchal Ney, publiées entre 1815 et 1848, d’autres versions avaient
été offertes de ses derniers moments. Les neuf récits qui rapportent sa dernière matinée sont
parcourus par le souci de mettre en évidence le caractère héroïque de cette « vilaine journée ». Les
paroles choisies par les auteurs de ses publications deviennent une synthèse du courage de Ney
devant les armes, la mort imminente, et renvoient à l’injustice de son procès. L’un des premières
versions à être publié fut probablement celle tirée du compte-rendu du procès publié par L. G. Michaud.
Ce récit diffère de la version de Rochechouart : « Mes camarades, tirez-là, leur dit-il, en enlevant son
chapeau de la main gauche et posant la droite sur son cœur »365, tout en précisant que le maréchal
361 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 438. 362 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 438. 363 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 439. 364 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 439. 365 Procès du maréchal Ney, Tome 4, 1815, p. 56.
94
Ney avait reçu trois balles dans la tête. Cependant, le propos rapporté est bien celui d’un héros, et Ney
n’est pas ici diminué.
Cinq ouvrages sont publiés entre 1815 et 1816, ceux de Raymond Balthasard
Maiseau (1816)366, de François-Frédéric Cotterel (1816)367, d’Évariste Dumoulin368 (1815), de M.
Delanoë (1815) et de J.B.E Charlemont (1815). Tous décrivent un maréchal Ney particulièrement
loquace devant le peloton d’exécution. Du fait de la proximité de leurs publications, les récits de ces
auteurs se recoupent essentiellement sur deux points : avant de mourir, le maréchal a crié son amour
pour la France, et il a rappelé avec force l’injustice de son procès. Les ouvrages ne diffèrent que par
le choix des mots ou les formes de dramatisation de ces propos. Ces ouvrages sont les premiers
témoins de l’appel à la postérité de Ney. Relayant « des » paroles qui définissent la figure du héros,
ces auteurs, qu’ils soient en accord ou non avec l’issue du procès, contribuent directement à la
construction de la figure héroïque du maréchal Ney.
La version de la biographie de Charlemont est identique à la version de L. G. Michaud, en
ajoutant, quoique subtilement, que le maréchal « […] voulut parler au public de son procès et du
jugement prononcé contre lui »369, sans pourtant établir que ce le maréchal voulait dire aux
spectateurs, ni s’il l’avait dit. La version du journaliste Évariste Dumoulin, publiée elle aussi en 1815,
comble le vide du récit de Charlemont. Il explique qu’après avoir refusé d’avoir les yeux bandés et de
se mettre à genoux, le maréchal Ney aurait répondu à son interlocuteur : « Ignorez-vous que depuis
vingt-cinq ans j’ai l’habitude de regarder en face la balle et le boulet? […] Je proteste devant Dieu et la
patrie, contre le jugement qui me condamne. J’en appelle aux hommes, à la postérité, à Dieu : Vive la
France! »370. La dernière version publiée en 1815, celle de M. Delanoë, reprend les grandes lignes du
récit de Dumoulin. Toutefois, l’auteur ajoute des éléments. D’abord en commentant le refus de
s’agenouiller et de se laisser bander les yeux : « dans ce moment suprême, le maréchal, toujours
calme et sans qu’aucune altération parût sur son visage, a dit à haute voix et en élevant la main vers
le ciel […] »371. Les paroles qui suivent cette scène presque théâtralisée par l’auteur reprennent celles
366 Selon le dictionnaire bibliographique « La littérature française contemporaine, 1827-1849, T.5 ». Maiseau fut ancien chef de bureau du commissariat de police d’Anvers et de la préfecture de police de la Seine. (p. 238). 367 Médecin et membre de plusieurs sociétés savantes. 368 Journaliste, ce dernier a publié plusieurs ouvrages sur des procès : Procès du général Drouot (1816), Procès du général Cambronne (1816), Histoire complète du procès du maréchal Ney (1815). 369 J.B.E. Charlemont, Procès du maréchal Ney, faisant suite à sa vie, Paris, Imprimerie Tiger, 1815, p. 107. 370 Évariste Dumoulin, Histoire du procès du maréchal Ney, Paris, Delaunay, 1815, p. 338. 371 M. Delanoë, Procès du maréchal Ney, Paris, Plancher, Eymery et Delaunay, 1815, p. 185.
95
rapportées par Dumoulin : il proteste devant Dieu, les hommes et la patrie son jugement. Il rajoute
toutefois en plaçant sa main sur son cœur « Soldats, hâtez-vous et tirez-là! »372. Les versions de 1815
contredisent ainsi celles de L. G. Michaud et de Rochechouart. Elles campent un maréchal Ney qui
s’exprime sans peur ni honte, tout comme à la Chambre des pairs mais dans des circonstances
autrement éprouvantes puisque 12 soldats pointent leurs fusils sur lui.
Les deux biographies publiées en 1816 ne diffèrent guère des versions de 1815. La version
de Maiseau semble être largement copiée des versions de Dumoulin et Delanoë : « Ignorez-vous que
depuis vingt-cinq ans je sais regarder en face les balles et les boulets? […] Je proteste contre le
jugement qui me condamne; j’eusse mieux aimé mourir pour ma patrie dans les combats; mais c’est
encore ici le champ d’honneur. Vive la France! […] Soldat! Faites votre devoir, et tirez-là »373. Toutefois,
chez Cotterel, le récit est plus court et ne fait pas allusion à un appel à la postérité. En lisant l’avant-
propos de l’ouvrage, on comprend que l’auteur est en accord avec le verdict du procès, et qu’il n’avait
peut-être pas intérêt à ajouter des paroles qui allaient à l’encontre de ses opinions. Ainsi, Cotterel
présente Ney refusant de s’agenouiller : « Depuis vingt-cinq ans, dit-il, j’ai toujours vu la mort en face,
et se présenta au peloton de vétérans qui l’attendait : ‘‘ Soldats, droit au cœur ’’, dit-il d’un ton ferme,
et il tomba, percé de douze balles, trois à la tête, neuf à la poitrine »374. De son côté, Cotterel, qui
entretient une opinion négative envers Ney, insère dans les dernières paroles sa propre opinion du
maréchal Ney. Pour l’auteur, Ney est un illustre guerrier qui s’est déshonoré lorsqu’il a trahi son roi375.
Même dans le déshonneur, le maréchal Ney, sous la plume de Cotterel, a su mourir en héros, n’ayant
pas peur d’affronter les fusils de ses exécuteurs.
Deux autres versions des dernières paroles ont été recensées en 1829 et en 1848, soit celle
du juriste Papy Descabanes et du républicain Anaxagore Guilbert. Contrairement aux autres récits
présentés, ces deux dernières versions ont une vision positive de la figure du héros de Ney. Du fait de
l’éloignement historique de l’exécution, Descabanes et Guilbert ont une admiration décomplexée pour
le condamné du 7 décembre 1815. La version de Papy Descabanes reprend les mêmes thèmes des
biographies de 1815 et 1816, avec une nuance intéressante: Ney aurait lui-même commandé aux
soldats de faire feu: « je déclare, dit-il, en face de Dieu et des hommes, que je n’ai jamais été traître à
ma patrie. Puisse ma mort la rendre heureuse! Vive la France. Il commande le feu et tombe de dix
372 M. Delanoë, Procès du maréchal Ney, 1815, p. 186. 373 L-Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, 1816, p. 351. 374 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 72. 375 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. iv.
96
balles »376. Dans ses Souvenirs, Rochechouart dément que Ney aurait lui-même ordonné de faire feu
sur lui377. Anaxagore Guilbert, dans sa version des dernières paroles, reprend mot pour mot celles de
Descabanes378.
Bien que les paroles du maréchal Ney lors de son exécution ne fassent pas consensus dans
les ouvrages consultés, un fil conducteur se précise: l’intention des narrateurs est de le présenter dans
une posture héroïque. En contestant l’issu de son procès, en professant son amour pour la France ou
sa patrie et en démontrant qu’il n’avait pas peur de la mort, le maréchal Ney a pris le soin de laisser
son « testament » politique et militaire à la postérité. Alors que le comte de Rochechouart déplorait la
mort du maréchal Ney, il dit à son ami Auguste de La Rochejaquelein, colonel des grenadiers : « Voilà,
mon cher ami, une grande leçon pour apprendre à mourir! »379. Dans les Souvenirs de Rochechouart,
il y a d’autres façons de souligner le caractère héroïque du maréchal Ney. L’une de celles-ci est
l’utilisation d’un des surnoms de de Ney, celui qui est passé à la postérité : Brave des braves. À la
place du Brave des braves, le commandant de la Place de Paris aurait pu tout autant dire l’Intrépide,
Le Rougeaud ou l’Infatigable, surnoms qui ont été souvent utilisés pour décrire les qualités militaires
du maréchal Ney. De son vivant, tous ces surnoms représentent en quelque sorte l’évolution de
l’héroïsme à travers la carrière du maréchal.
De l’infatigable au Brave des braves
Les différents surnoms qu’acquiert le maréchal Ney tout au long de sa carrière sont des
antonomases : « figure de style qui consiste à remplacer un nom commun par un nom propre, ou à
l’inverse, à remplacer un nom propre par un nom commun ou par une périphrase »380. Comme Petit
caporal pour Napoléon, Brave des braves est lié au maréchal Ney. De tous les surnoms que Ney a
acquis, le brave des braves est celui qui est resté dans le temps, jusqu’à aujourd’hui: une recherche
sur des moteurs de recherche démontre facilement que Ney est celui le plus associé à cette
antonomase. Toutefois, dans l’histoire, le maréchal Ney ne monopolise d’aucune façon ce surnom. En
1600, Louis des Balbes de Berton de Crillon est surnommé Brave des braves par Henri IV après avoir
376 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 18-19. 377 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 439. 378 Anaxagore Guilbert, Précis authentique sur la naissance et la mort du maréchal Ney, Paris, 1848, p. 8. 379 Louis-Victor-Léon Rochechouart, Souvenirs, 1892, p. 439. 380 http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=4095
97
accompli plusieurs exploits militaires en Savoie381. Napoléon, lui aussi, a droit à ce glorieux surnom.
Lors de l’épisode des 100 jours, les citoyens de Lyon s’adressent aux habitants des départements
voisins : […] nous qui, fiers de notre liberté conquise, n’avons voulu reconnaître comme souverain que
celui que ses victoires et son génie avaient fait proclamer par tous les peuples, le brave des braves
[…] »382. Lors d’un banquet organiser par le colonel Labédoyère, le prince Eugène, fils adoptif de
Napoléon, est lui aussi nommé ainsi: « au prince Eugène, au brave des braves, dont la devise a été,
est et sera toujours honneur et fidélité »383. Un autre maréchal de Napoléon avait acquis ce titre: le
maréchal Lannes duc de Montebello. À ses funérailles, la bravoure du maréchal duc de Montebello est
célébrée: « son courage de tous les jours lui avait mérité le surnom de brave des braves »384.
Après l’Empire, les royalistes utilisent également aussi le surnom de brave des braves, peut-
être pour coopter l’héritage de gloire derrière ce titre. Dans le journal Drapeau blanc du 20 août 1819,
on célèbre l’abbé Alari, confesseur des ducs d’Angoulême et de Berri: « c’est en la défendant [la cause
royale] que l’abbé Alari fut nommé, sur le champ de bataille, le brave des braves; et l’on sait ce que
vaut un pareil titre dans la postérité, quand un Condé le donne »385. Dans La Quotidienne du 17 juillet
1824, les guerriers vendéens, combattants contre-révolutionnaires se voient donnés ce titre dans un
discours du général Donnadieu : « à cette terre de la Vendée, à ces braves des braves qui au milieu
de toutes nos misères, lorsque tout se détruisit en France, conservèrent avec toute la candeur et le
courage du premier âge […] »386.
Si cette antonomase est utilisée et récupérée dans l’histoire de France, elle fait partie, pour le
maréchal Ney, d’un ensemble de surnoms utilisés durant sa carrière militaire. Suivant l’évolution de sa
carrière, la stratification des multiples surnoms qu’il reçoit contribue au dessin de Ney sous la figure du
héros.
381 William Duckett et al, Dictionnaire de la conservation et de la lecture. Inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, Tome 6, Paris, Michel Lévy Frères, 1853, p. 750. 382 Gazette nationale, 12 mai 1815, p. 3. 383 Gazette de France, 31 mars 1815, p. 2. 384 Gazette nationale, 14 juillet 1810, p. 2. 385 Drapeau blanc, 20 août 1819, p. 3. 386 La Quotidienne, 17 juillet 1824, p. 1.
98
Nommer le héros
Dans les récits de la carrière militaire du maréchal Ney, un élément s’impose: sa rapidité à
gravir les échelons militaires de l’armée française. Le jeune Michel Ney s’engage en 1787 comme
hussard dans le 4e régiment Colonel-général. Rapidement, il enchaîne les grades de brigadier,
maréchal-des-logis, d’adjudant sous-officier avant d’être nommé lieutenant en 1793, et capitaine en
1794. Trois ans plus tard, en 1797, il devient général. C’est en 1804 que Ney reçoit le plus haut grade
militaire pour devenir le maréchal Ney.
Parallèlement à cette rapide ascension, les journaux de la République mettent de l’avant les
qualités militaires du jeune Ney : son courage et sa bravoure rayonnent déjà dans la presse écrite.
Dans le Journal des hommes libres de tous les pays daté du 15 avril 1797, le nouveau général Ney,
commandant des hussards à Cologne, est décrit comme : « […] un officier d’un grand mérite et d’une
bravoure à toute épreuve »387. Dans les Nouvelles politiques du 28 avril 1797, on parle du « brave
général Ney »388. D’ailleurs, en 1797, Ney reçoit, aux côtés de futurs maréchaux comme Lefebvre ou
Soult, des félicitations officielles de la part du Directoire exécutif389. Poursuivant ses exploits dans les
armées républicaines, Ney est surnommé l’intrépide général Ney dans La Clef du cabinet des
souverains du 27 juin 1799. Le général Ney attirait déjà l’attention au sein des armées et auprès de la
presse écrite : peu à peu, sa figure du héros se construisait alors que sa carrière commençait à peine.
Les biographes de Ney mettent aussi en avant ses qualités militaires en début de carrière tout
en les articulant avec les surnoms qui lui ont été donnés. Selon Cotterel et M. Delanoë, la stature
physique du jeune Michel Ney était déjà un avantage pour lui : « […] une taille et un extérieur
avantageux, une force et une aptitude extraordinaires pour tous les exercices du corps »390 et que
« […] la nature l’avait formé pour la carrière militaire »391. Suivant le récit de Cotterel, c’est le général
Kléber qui, en 1793, nomme Ney l’Infatigable : « […] par son air d’assurance et sa persévérante
activité […] »392. Contrairement à Cotterel, Papy Descabanes, dans son Précis historique, explique que
ce sont plutôt les soldats qui auraient nommé Ney l’Infatigable et non le général Kléber lui-même393.
387 Le républicain, journal des hommes libres de tous les pays, 15 avril 1797, p. 2. 388 Nouvelles politiques, nationales et étrangère, 28 avril 1797, p. 2. 389 La Clef du cabinet des souverains, 4 mai 1797. 390 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 1. 391 M. Delanoë, Procès du maréchal Ney, 1815, p.186, p. 9. 392 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 1. 393 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 2.
99
Pour Raymond Balthasard Maiseau, les journées d’Altenkirchenm, de Dierdorf, de Montabaur et de
Bendorf lors de la campagne du Rhin : « […] accrurent sa réputation d’intrépidité »394. Cité par Cotterel,
le général Hoche crédite aussi le jeune militaire Ney de deux qualités : « […] d’autant plus précieuses
qu’elles semblent incompatibles dans le même homme, le sang-froid et l’impétuosité »395. Dans
l’ouvrage À la gloire du maréchal Ney, Charles Saint-Nexant de Gagemon explique que l’Intrépide Ney
avait jeté le désordre dans les rangs autrichiens à la bataille d’Hohenlinden en 1800396. Dans l’Histoire
du Consulat et de l’Empire d’Adolphe Thiers, Ney apparaît aussi sous le surnom de l’Intrépide. En effet,
à la bataille d’Iéna on apprend que « l’intrépide Ney […] »397 attend l’aide du maréchal Lannes pour se
sortir d’un guet-apens. En début de carrière, les surnoms d’Intrépide et d’Infatigable contribuent ainsi
à caractériser le maréchal Ney comme un soldat qui sort de l’ordinaire.
Au cours de l’Empire, l’intrépide est le surnom, l’adjectif ou le mot qui est le plus cité dans les
Bulletins de la Grande Armée. Dans le cadre du récit napoléonien, le héros se construit peu à peu.
C’est d’ailleurs lors de cette période de sa carrière que Ney acquiert les titres de duc d’Elchingen et de
prince de la Moskowa. Dans le 25e bulletin daté 16 novembre 1805: « Le maréchal Ney avait eu la
mission de s’emparer du Tyrol : il s’en est acquitté avec son intelligence et son intrépidité
accoutumées »398. À la bataille de Deppen lors de la campagne de Pologne de 1807, Ney défait les
Russes grâce à « […] l’intrépidité qu’il a montrée et qu’il a communiquée à toutes ses troupes […] »399.
À Friedland, bataille qui mène à la signature du traité de Tilsit, Ney démontre au courant des combats
« […] cette intrépidité qui lui est particulière »400. Enfin, dans une position critique lors de la bataille de
Smolensk en 1812, avec seulement 3000 hommes, Ney s’extirpa de cette situation « […] avec cette
intrépidité qui le distingue »401.
Un élément distingue toutefois les ouvrages publiés après la mort du maréchal Ney des
Bulletins: l’utilisation du surnom brave des braves. Le terme est absent des Bulletins. Peut-être que ce
titre aurait fait trop ombrage au prestige de Napoléon qui est lui-même parfois désigné par cette
antonomase. Les récits ne s’entendent point sur le moment où Ney devient le Brave des braves. Papy
394 L-Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, 1816, p. 7. 395 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 3. 396 Charles Saint-Nexant de Gagemon, De la gloire du maréchal Ney, Poitiers, Imprimerie de A. Dupré, 1854, p. 6. 397 Adolphe Thiers, L’Histoire du Consulat et de l’Empire, Tome 7, Paris, Paulin, 1847, p. 121. 398 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes d’Austerlitz et d’Iéna, 1820, p. 78. 399 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche, 1820, p. 85. 400 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche, 1820, p. 92. 401 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes de Russie et de Saxe, 1820, p. 159.
100
Descabanes et Anaxagore Guilbert affirment que ce sont les soldats qui attribuent ce surnom à Ney
lors de la bataille de Friedland en 1806. Selon Guilbert : « Le talent qu’il [Ney] déploya à la bataille de
Friedland, où il commandait l’aile droite, lui valut les félicitations de Napoléon qui exalta sa belle
conduite, en lui attribuant l’honneur de la journée. L’armée, après cette bataille, lui décerna le surnom
de Brave des Braves »402. De son côté, Descabanes précise que Ney décide la victoire de Friedland
et qu’il reçoit des soldats ce surnom403. Un commentateur des Bulletins, Adrien Pascal, mentionne que
Ney aurait plutôt reçu ce surnom de Napoléon après la bataille de la Moskowa qui eut lieu le 7
septembre 1812 lors de la campagne de Russie : « C’est sur ce champ de bataille qu’il mérita le nom
de Brave des braves que lui donna Napoléon […] »404. Les diverses façons de dire quand et qui
nomment Ney Brave des braves permettent de mettre en évidence différentes versions de certification
de la bravoure et de l’héroïcité. Mais, que ce soit par la bouche de Napoléon ou par les soldats, les
récits attestent du caractère héroïque de Ney.
Dans les Bulletins, Ney est le plus souvent désigné par ses titres de noblesse : celui de duc
d’Elchingen qu’il reçoit après la prise d’Elchingen en 1805, celui prince de la Moskowa qui lui est
octroyé en référence à son apport décisif à la bataille du même nom en 1812. Les Bulletins font donc
plus de place aux récompenses de la noblesse impériale, autres preuves de son prestige sur le champ
de bataille. La gloire de l’Empire, avec la création de cette noblesse impériale, profite ainsi à la figure
du héros du maréchal Ney. Campagne après campagne, le maréchal Ney gagne ces titres de noblesse
qui, publicisés dans toute la France grâce aux Bulletins, deviennent un gage d’admiration de ses
prouesses militaires. Du côté des « soldats », de l’armée régulière, Ney est une myriade de surnoms
démontrant la proximité que les soldats entretiennent pour ce maréchal d’Empire, alors que du côté de
« l’institution de l’Empire », Ney est tout autant célébré pour son héroïsme, mais avec des titres qui le
distinguent du soldat.
Toutes ces antonomases sont acquises très rapidement dans sa carrière : après seulement
19 ans de loyaux services, Ney est le Brave des braves des armées françaises. Après son exécution,
les publications traitant de Ney s’approprient plutôt les surnoms militaires que les titres de noblesse,
sans pour autant les passer complètement sous silence. Brave des braves est véritablement le surnom
402 Anaxagore Guilbert, Précis authentique sur la naissance et la mort du maréchal Ney, 1848, p. 5. 403 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 6. 404 Adrien Pascal, Les Bulletins de la Grande Armée : précédés des rapports sur l’armée française depuis Toulon jusqu’à Waterloo, Paris, E. Lesage, 1841, p. 147.
101
qui scelle clairement la figure du héros du maréchal après son exécution. Cette expression est en
quelque sorte la synthèse de toutes les qualités de caractère et militaires qui sont attribuées à Ney;
Brave des braves ne rappelle personne d’autre que Ney. Si l’expression est utilisée dans le procès en
1815 pour remettre en question l’honneur de Ney (comment pouvait-il être le brave des braves, s’il
était un traître?), l’utilisation du terme à la mort du maréchal est surtout l’apanage des ouvrages qui
défendent sa mémoire. Dans une biographie, le terme vient s’ajouter de façon ponctuelle dans le récit.
Chez Papy Descabanes, les soldats de la retraite de Russie ne doivent leur vie « […] qu’à l’intrépide
sang-froid du brave des braves! »405. Dans l’ouvrage Victoires, conquêtes, des Français, de 1792 à
1815 publié en 1822 qui comporte une biographie des militaires français nommée « tables du temple
de la gloire », l’auteur confirme l’utilisation de ce surnom : « Ainsi, périt à 46 ans, le héros à qui la plus
brave armée de la terre avait donné le nom de brave des braves »406. Lors de la demande de révision
du procès, le 12 novembre 1831 à la Chambre des députés, le brave des braves est utilisé par certains
députés. Le député M. de Corcelle appelle la Chambre à ouvrir les portes du Panthéon au brave des
braves407.
Cependant, ce tableau héroïque décrit par les récits est contesté par certains auteurs à la fin
de sa carrière : bien que brave, Ney avait apparemment multiplié les erreurs militaires lors de la
campagne de Waterloo. Pour quelques individus, le Brave des braves rimait avec le désastre de la
campagne de 1815.
L’effet Waterloo
Les vertus guerrières du maréchal Ney sont remises en question par des partisans de
Napoléon après la bataille de Waterloo, perdue par la France. Dans le Mémorial de Saint-Hélène,
Napoléon se questionne sur le caractère des généraux lors de cette dernière bataille : « Le caractère
de plusieurs généraux avait été détrempé par les évènements de 1814; ils avaient perdu quelque chose
de cette audace, de cette résolution et de cette confiance qui leur avaient valu tant de gloire […]408.
Parmi ces généraux, le maréchal Ney est critiqué pour ses mouvements de soldats lors de la bataille
405 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p .8. 406 Charles Théodore Beauvais de Preau, Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1822, p. 120. 407 De la révision du procès, Chambre des députés, 12 novembre 1831, p. 12. 408 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Tome. 5, 1823, p. 432-33.
102
des Quatre-Bras : « La bravoure que doit montrer un général en chef est différente de cette que doit
avoir un général de division, comme celle-ci ne doit pas être celle d’un capitaine de grenadiers »409.
Outre les « bruits » que Napoléon propageait par le biais du Mémorial, l’un des premiers ouvrages qui
ont remis en question le prestige de Ney est celui du général Gourgaud, Campagne de 1815. Il faut
préciser que ce général fût un compagnon d’exil de Napoléon jusqu’en 1818. Cette relation
essentiellement militaire a été écrite à Sainte-Hélène, ce qui n’est pas surprenant au regard de
l’orientation du texte à l’égard du maréchal Ney410. Les conclusions sont en elles-mêmes
représentatrices de l’opinion tant du général Gourgaud que de Napoléon :
Tous les commandants des corps se comportèrent avec la plus grande bravoure. Leurs intentions étaient pures et loyales; mais, ainsi que nous l’avons déjà dit, il régnait parmi eux une dissension d’opinion qui tenait aux évènements de 1814, et qui a eu un bien funeste résultat. Le maréchal Ney, peut-être en conséquence de sa situation morale, était tombé dans une aberration d’esprit dont il ne sortait qu’au milieu du feu, où la bravoure naturelle de son tempérament reprenait le dessus, et lui rendait ses facultés. Une des fautes que l’empereur se reproche est celle d’avoir employé ce maréchal, ou au moins de lui avoir donné un commandement si important. 411
Ainsi, la trahison de Ney lors de la première abdication aurait joué sur les possibles fautes
militaires commises lors de la campagne de 1815, mais aussi sur la bravoure de Ney sur les champs
de bataille. Car dans la description que Gourgaud fait des batailles, Ney est autant dans la gloire que
dans l’erreur : « […] le maréchal Ney, par son intrépidité, et par l’ardeur des troupes françaises, gagnait
toujours du terrain, et repoussait un ennemi supérieur en force »412. Ou encore : « Il est impossible de
se battre avec plus de courage et d’ardeur que ne le fit le maréchal Ney, avec ce qu’il fit donner de
troupes »413. Toutefois, toujours selon Gourgaud, Ney commet plusieurs fautes lors de la bataille des
Quatre-Bras et de Waterloo. En effet : « le maréchal Ney commit la faute de laisser, le 15, le premier
corps trop longtemps à Marchiennes, et de ne pas prendre un camp en avant des Quatre-Bras »414.
Pendant que les autres corps du centre et de la droite de l’armée accumulaient les succès : « […] de
grandes fautes se commettaient à la gauche : le maréchal Ney n’occupait pas la position des Quatre-
Bras »415. Lors de la bataille de Waterloo : « l’étonnement de l’empereur fut grand en voyant que le
corps du maréchal Ney était encore dans ses bivouacs en avant de Frasnes »416. Ou sinon, devant
409 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Tome. 5, 1823, p. 433-34. 410 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Tome. 5, 1823, p. 425. 411 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, Paris, P. Mongie Ainé, 1818, p. 123-124. 412 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 63. 413 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 64. 414 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 65. 415 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 61. 416 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 77.
103
l’empereur : « Le maréchal Ney parut; l’empereur lui témoigna sa surprise de la non-exécution de ses
ordres; il balbutia quelques excuses, disant qu’il avait cru que toute l’armée anglo-hollandaise était
encore aux Quatre-Bras »417.
Nous pourrions multiplier les fautes décrites par l’auteur. Ces erreurs atteignent clairement les
qualités militaires du maréchal Ney, pointent ce dernier comme l’artisan de la défaite de Waterloo,
même s’il a fait preuve de bravoure lors des combats. Cette « version Napoléon » est rapidement
contestée. Sur le plan militaire, Ney aurait fait face à un commandement complètement désorganisé,
un manque de troupes, et un empereur qui rejetait ses fautes sur ses subordonnés.
Au moins trois ouvrages paraissent pour se porter à la défense du comportement du maréchal
Ney lors de la campagne de 1815. L’objectif de ces auteurs est assez clair : stabiliser la figure héroïque
acquise lors de son parcours militaire sans tache. L’objectif de ces ouvrages est de rétablir la « vérité »
sur les supposées erreurs tactiques que Ney aurait commises. Le premier à s’engager dans cette
défense est le beau-frère du maréchal, M. Gamot. Il n’est pas tendre envers le général Gourgaud :
« Que trouve-t-on dans cette narration? Une suite de faits controuvés, d’explications forcées, des traits
perfides ou haineux! Cet homme semble avoir traversé les mers pour s’attaquer surtout aux pas du
maréchal »418. Dans un long exposé comparatif, M. Gamot rétablit les faits point par point afin de
dédouaner le maréchal Ney de la défaite de Waterloo. Pour rétablir les faits à propos du maréchal Ney,
son beau-frère utilise les ordres particuliers des états-majors de l’armée pour prouver que le maréchal
n’avait pas mal agi militairement lors de la campagne de 1815. Les dernières lignes de sa réfutation
sont un appel aux soldats ayant combattu aux côtés de Ney. Au-delà des erreurs stratégiques de Ney,
M. Gamot s’indigne dans son texte du tort que le général Gourgaud a fait à l’honneur du maréchal Ney.
Publiée en 1819 par C. Marchand, ex-adjoint aux commissaires des guerres, Lettre au général
Gourgaud, est une autre réponse critique au livre du général. Marchand incrimine directement
Napoléon : « […] Napoléon cherche à mettre sa responsabilité à couvert, en attribuant toutes les fautes
d’une campagne à ses généraux »419. Selon lui, le maréchal Ney avec son caractère bouillant a pu
commettre certaines fautes militaires. Toutefois, l’auteur attaque le comportement de l’empereur à
417 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 78. 418 Charles-Guillaume Gamot, Réfutation en ce qui concerne le maréchal Ney, de l’ouvrage ayant pour titre : Campagne de 1815, ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu pendant les cent jours, par le général Gourgaud, écrite à Sainte-Hélène, Paris, Bailleul, 1818, p. 48-49. 419 C. Marchand, Lettre au général Gourgaud, Paris, Brissot-Thivars, 1819, p. 45.
104
l’égard du maréchal Ney : « […] lorsque le jugement qui l’a frappé leur impose un religieux silence,
Napoléon devait-il oublier le respect à tant d’acharnement contre la mémoire d’un de ses anciens
compagnons d’armes? »420.
Finalement, publié en 1829, l’ouvrage de l’aide-de-camp du maréchal Ney, Pierre-Agathe
Heymès, se porte lui aussi à la défense de Ney au nom de sa propre expérience vécue sur le champ
de bataille de Waterloo: « C’est pour rétablir la vérité dans tout son jour que cette relation a été
entreprise : on n’y lit pas un mot qui ne soit rigoureusement exact […] »421. Heymès explique qu’un
ouvrage s’est établi comme le « récit officiel » de la campagne de Waterloo, et que plusieurs autres
écrivains ont contribué à fixer le « mensonge »422 en copiant celui-ci. Il est possible de penser que
l’ouvrage visé est le récit du général Gourgaud. Avec l’expérience acquise lors de la bataille, Heymès
fait un exposé militaire pour prouver que Ney n’était aucunement dans le tort. Surtout, pour M. Heymès,
sa publication vise à taire « les fausses insinuations qu’on a répandues sur l’un des plus braves
guerriers de notre siècle, qui fut à Waterloo (quoi qu’on en ait dit) ce qu’il avait toujours été durant sa
glorieuse carrière »423.
Nous comptons donc trois ouvrages qui ont l’objectif de rétablir les faits quant à la présence
de Ney à Waterloo. Que ce soit Napoléon ou le général Gourgaud, les bruits négatifs à propos de Ney
étaient, pour eux, tout simplement faux. Waterloo n’avait pas été un désastre pour le maréchal,
seulement pour Napoléon : preuves à l’appui, le prestige de Ney restait intact comme nous allons le
voir dans ses hauts faits militaires.
Le héros en action
Pour cette dernière partie du chapitre, nous allons expliquer comment les hauts faits militaires
de Ney, au fur et à mesure du temps, ont tracé les traits de la figure du héros, à la fois par l’entremise
des écrits contemporains, les Bulletins et journaux, ainsi que des récits parus après la mort du
420 C. Marchand, Lettre au général Gourgaud, 1819, p. 45. 421 Pierre-Agathe Heymès, Relation de la campagne de 1815, dite de Waterloo : pour servir l’histoire du maréchal Ney, Paris, 1829, p. 2. 422 Pierre-Agathe Heymès, Relation de la campagne de 1815, 1829, p. 4. 423 Pierre-Agathe Heymès, Relation de la campagne de 1815, 1829, p. 27.
105
maréchal, notamment les biographies et les souvenirs d’anciens soldats ayant combattus aux côtés
de Ney.
Les Bulletins de la Grande Armée ont été un outil pour publiciser les exploits commis par le
maréchal Ney dans toute la France. Derrière les antonomases du maréchal, on trouve plusieurs hauts
faits dont le récit était censé lui gagner l’attention et l’admiration de ses soldats et de ses concitoyens
dans un espace public français attentif aux épopées militaires de l’Empire. Comme plusieurs autres
maréchaux et généraux, les campagnes napoléoniennes ont été primordiales dans la construction de
cette figure du héros attachée au maréchal Ney. Les Bulletins sont scandés par des séquences qui
mettent en évidence certains exploits de soldats, hauts gradés ou non, ou d’un régiment particulier :
l’idée est d’exalter et d’encenser, pour les lecteurs de ces Bulletins, les valeurs militaires des armées
de Napoléon, ainsi que la gloire de son Empire. Bien que les éditions originales soient disponibles,
Alexandre Goujon, ancien officier de l’artillerie, les a compilés en trois tomes en 1820. Le premier tome
couvre Austerlitz (1805) et Iéna (1806), le deuxième, les campagnes de la Prusse (1806-1807), de
Pologne (1807) et d’Autriche (1809), et le troisième termine la série avec les campagnes de Russie
(1812) et de Saxe (1813). Notons que la campagne d’Espagne eût ses propres entrées dans le
Moniteur universel sous la mention « Bulletins des Armées d’Espagne », de novembre 1808 à janvier
1809424. De plus, les Bulletins des campagnes qui suivent celle de la Saxe (1813) n’ont plus d’existence
propre et ne sont plus numérotés. Ces « nouvelles » sont publiés dans le Moniteur universel sous
l’entrée « nouvelles suivantes sur la situation des armées reçues à Paris par l’Impératrice-Reine et
Régente »425.
Nous avons sélectionné les évènements les plus marquants, ceux qui pouvaient nous aider à
mettre en lumière cette figure du héros. Bien que l’objectif de cet outil de propagande soit de romancer
les campagnes et de mettre en valeur la gloire des armées françaises, certains passages sont
monotones et factuels, mettant l’emphase sur les stratégies militaires et les déplacements de divisions.
De plus, le maréchal Ney n’est qu’un acteur parmi tant d’autres maréchaux, généraux ou subalternes
qui tentent de se démarquer dans ces pages qui sont éventuellement publiées dans toute la France.
Par exemple, dans les deux premiers tomes d’Alexandre Goujon, le maréchal Ney apparaît 67 fois,
alors que le maréchal Murat est cité 91 fois. Dans le dernier tome, Ney est présent 30 fois, Murat
424 Jean-René Aymès, « La guerre d’Espagne dans la presse impériale (1808-1814) », Annales historiques de la Révolution française, No. 336, 2004, p. 130. 425 Jean-Paul Bertaud, « Napoléon journaliste », 2005, p. 32.
106
49 fois. Notons aussi que le maréchal Ney est progressivement nommé dans les Bulletins duc
d’Elchingen à partir de 1808, et prince de la Moskowa en 1812, signe de son ascension dans la
noblesse impériale.
Ney et les Bulletins de la Grande Armée
Il faut d’abord rappeler que, avant la création de ses Bulletins en 1804, il est déjà possible de
suivre les prouesses militaires du jeune Michel Ney en tant qu’adjudant-général dans l’Armée du Rhin
dans la presse républicaine. Sous le commandement du général Kléber, Ney se démarque lors de
deux épisodes. En juin 1796, il réussit un coup stratégique lorsqu’il s’empare des magasins de
Dierdorff : « […] ces prises arrivent bien à propos dans un pays désert, et où les transports sont de la
plus grande difficulté »426. Lors du combat sur la Sieg du 30 juin 1796 : « L’adjudant-général Ney
attaqua avec son impétuosité ordinaire […]427. En 1800, alors général de division, Ney dirige le blocus
d’Ingolstadt situé sur le Danube et effectue une charge sur les Autrichiens « […] couronnée du plus
heureux succès »428. Les mots de Dessolles, chef de l’état-major général de l’armée, stipule que : « Le
général Ney […] a déployé, à son ordinaire, talent et audace »429. Ses succès dans l’Armée du Rhin
lors des campagnes révolutionnaires permettent au maréchal Ney de laisser sa marque dans l’armée
française. À partir de l’Empire, les éloges envers Ney vont se poursuivre surtout à l’intérieur des
Bulletins.
Reportons-nous donc au cinquième bulletin de la Grande Armée, le 16 octobre 1805. La
bataille d’Elchingen y est décrite comme « […] un des plus beaux faits militaires que l’on puisse
citer »430 ; l’ennemi et le maréchal Ney se disputent l’emplacement d’Elchingen : « Le 22, à la pointe
du jour, le maréchal Ney passa ce pont à la tête de la division Loison. L’ennemi lui disputait la
possession d’Elchingen avec 16,000 hommes ; il fut culbuté partout, perdit 3,000 hommes faits
prisonniers, 1 général major, et fut poursuivi jusque dans ses retranchements ». Le maréchal avait
réussi à prendre cette position, dans un combat qui allait marquer sa carrière. Ce haut fait militaire est
repris par de nombreux récits publiés à la mort de Ney et fait entrer la bataille d’Elchingen dans les
426 Gazette Nationale, 13 juin 1796, p. 2. 427 Gazette Nationale, 7 juillet 1796, p. 1. 428 Gazette Nationale, 31 juillet 1800, p. 4. 429 Gazette Nationale, 31 juillet 1800, p. 4. 430 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes d’Austerlitz et d’Iéna, 1820, p. 20.
107
annales militaires françaises. Cotterel, malgré son hostilité, y consacre quelques lignes, relatant que
Ney y avait remporté une victoire longuement disputée431. De son côté, Papy Descabanes louange
cette bataille comme étant « l’un des faits d’armes les plus étonnants que le talent et l’audace aient
jamais exécutés […] »432. Aussi, le récit d’Anaxagore Guilbert célèbre la prise de la position
d’Elchingen, clef de voûte à la victoire d’Ulm433. Dans la publication parue en 1854, De la gloire militaire
du maréchal Ney, l’auteur décrit le rôle du maréchal Ney dans cette victoire : « […] le maréchal,
déployant une bravoure égale à sa ténacité, opposant à l’ennemi une fermeté comparable à son
invincible élan, parvint, après des efforts inouïs, à s’emparer du village et à enlever le couvent
[d’Elchingen] 434 ». Plus loin, le même auteur accorde le statut de héros au maréchal Ney : « […]
l’Empereur, […] céda à l’inspiration la plus heureusement juste en conférant le titre de duc d’Elchingen
au héros d’un des faits d’armes les plus étonnants, les plus merveilleux que l’audace réunie au talent
ait jamais exécutés »435.
Ce fait d’armes est par ailleurs immortalisé par Camille Roqueplan (1802-1855) dans le tableau
Le maréchal Ney s’emparant du pont sur le Danube lors de la bataille d’Elchingen (Fig.12). Produite
en 1835, cette toile est commandée par Louis-Philippe pour être exposée au Musée historique de
Versailles, lieu dédié à la réconciliation nationale. Éclairé au milieu de ses soldats, Ney indique la
direction vers laquelle ceux-ci doivent porter leur attaque en levant son sabre. Roqueplan présente ici
un Ney exposé au feu, au milieu de ses troupes et en plein contrôle de la situation. Sachant que ce
musée est dédié à « toutes les gloires de la France », l’exposition d’une victoire de Ney scelle
l’importance d’Elchingen dans l’Histoire de France.
431 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 5. 432 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 5. 433 Anaxagore Guilbert, Précis authentique sur la naissance et la mort du maréchal Ney, 1848, p. 4. 434 Charles Saint-Nexant de Gagemon, De la gloire du maréchal Ney, 1854, p. 11. 435 Charles Saint-Nexant de Gagemon, De la gloire du maréchal Ney, 1854, p. 12.
108
Figure 12: Le maréchal Ney s’emparant du pont sur le Danube lors de la bataille d’Elchingen
Camille Roqueplan.1835. Peinture à huile sur toile. 85 x 155 cm Musée national du château de Versailles et de Trianon
Dans le quarante-sixième bulletin du 28 décembre 1806, nous retrouvons encore le maréchal
Ney dans son intrépidité : « Le maréchal Ney, chargé de manœuvrer pour détacher le lieutenant
général prussien Lestocq de l’Wrka, déborder et menacer ses communications, et pour le couper des
Russes, a dirigé ces mouvements avec son habileté et son intrépidité ordinaire »436. Encore sur le
thème de l’intrépidité, le soixante-dix-huitième bulletin du 12 juin 1807 nous dit que : « Les manœuvres
du maréchal Ney, l’intrépidité qu’il a montrée et qu’il a communiquée à toutes ses troupes […] sont
dignes des plus grands éloges »437. Dans le bulletin suivant, le rédacteur rapporte que le maréchal Ney
s’est grandement distingué lors de la bataille de Friedland : « Le maréchal Ney, avec un sang-froid et
avec cette intrépidité qui lui est particulière, était en avant de ses échelons, dirigeait lui-même les plus
petits détails, et donnait l’exemple à un corps armé qui toujours s’est fait distinguer, même parmi les
corps de la Grande-Armée »438.
La succession de gestes de bravoure de la part du maréchal Ney atteste son statut du héros,
et aide à sceller cette figure aux yeux de ces contemporains. À travers le temps des victoires, comme
436 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes d’Austerlitz et d’Iéna, 1820, p. 292. 437 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche, 1820, p. 85. 438 Alexandre Goujon, Bulletins de la Grande Armée. Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche, 1820, p. 92.
109
celui des défaites, Ney a su être constant dans ses performances militaires héroïques. Nous allons
maintenant nous pencher sur deux campagnes dans lesquelles Ney a su prouver sa stature héroïque.
L’épreuve russe
Le 22 juin 1812, Napoléon annonce à l’armée française que la Russie viole les serments faits
à la France à propos de la Pologne. Débute la campagne de Russie dans laquelle Ney commande le
3e corps d’armée. Dans la phase victorieuse de cette campagne, c’est-à-dire jusqu’à la prise de
Moscou le 14 septembre 1812, Ney se distingue notamment à la bataille de Smolesk où il doit
s’attaquer aux ennemis hors de la ville. C’est surtout à la bataille de la Moskowa que Ney
triomphe : « Le duc d’Elchingen se couvrit de gloire, et montra autant d’intrépidité que de sang-froid […]
Tout le monde s’est distingué : le roi de Naples et le duc d’Elchingen se sont fait remarquer »439. Lors
d’une difficulté sur le champ de bataille, le maréchal Ney réussit à redresser la situation : « Mais le duc
d’Elchingen, l’infatigable, dont la haute intelligence militaire grandit et n’est jamais plus sereine qu’au
milieu des revers, a déjà reformé ses divisions, qui ouvrent sur les cuirassiers russes un feu si terrible,
qu’ils s’arrêtent subitement »440. Dans la retraite de Russie, le duc d’Elchingen est uniquement nommé
dans le vingt-neuvième bulletin, le 3 décembre 1812 : « Le duc d’Elchingen qui, avec 3,000 hommes,
faisait l’arrière-garde avait fait sauter les remparts de Smolensk. Il fut cerné et se trouva dans une
position critique; il s’en tira avec cette intrépidité qui le distingue »441. Le rôle que donnent les Bulletins
au maréchal Ney dans cette terrible retraite nous apparaît plus qu’effacé. Ce sont les récits d’anciens
soldats qui vont nous permettre de mieux entrevoir les actes héroïques qu’accomplit le maréchal Ney
lors de la retraite442. L’ampleur de la tragédie y est décrite tout comme les qualités morales et militaires
dont Ney fait preuve dans une situation aussi critique.
La première phase de la campagne de Russie permet au maréchal Ney de se distinguer
comme à son habitude. La deuxième partie de cette campagne, la retraite de Moscou, lui permet de
rayonner autrement dans un contexte de désespoir complet : face à une défaite qui paraissait
imminente, les actions militaires de Ney vont briller davantage. À la mi-octobre, Napoléon décide de
quitter Moscou pour Smolensk, première phase du repli : il n’a plus d’espoir de faire la paix avec la
439 Alexandre Goujon, Bulletin de la Grande Armée. Campagnes de Russie et de Saxe, 1820, p. 102. 440 Charles Saint-Nexant de Gagemon, De la gloire du maréchal Ney, 1854, p. 41. 441 Alexandre Goujon, Bulletin de la Grande Armée. Campagnes de Russie et de Saxe, 1820, p. 159. 442 La raison de la sélection de ces récits est la participation des tous les auteurs à la campagne de Russie ce qui renforce la pertinence de leurs propos.
110
Russie443. Dans cette retraite, le maréchal Ney doit s’occuper de l’arrière-garde. Les récits de soldats
posent d’abord l’atmosphère qui entoure le départ de Moscou où l’aspect tragique est omniprésent.
Dans son Journal de la Campagne de Russe en 1812, le lieutenant-colonel M. de Fezensac brosse un
portrait du début de cette retraite :
Cette marche avait quelque chose de lugubre; les ténèbres de la nuit, le silence de la marche, les ruines encore fumantes que nous foulions sous nos pieds, tout semblait se réunir pour frapper l’imagination de tristesse. Aussi, chacun de nous voyait avec inquiétude commencer cette mémorable retraite; les soldats eux-mêmes sentaient vivement l’embarras de notre situation; ils étaient doués de cette intelligence et de cet admirable instinct qui distinguent les soldats français, et qui, en faisant mesurer toute l’étendue du danger, semblent aussi redoubler le courage nécessaire pour le braver. 444
Cette ambiance lugubre, de désespoir, est aussi décrite par le général Freytag. Alors aux côtés
du maréchal Ney à l’extrême arrière-garde de l’armée qui quittait Smolesk, le général décrit une ville
en flamme, et une armée poursuivie par l’ennemi : « L’incendie était si violent, que la clarté des
flammes, au milieu d’une nuit très-obscure, nous éclaira […] »445. Un autre soldat, le capitaine Coignet,
présent lui aussi à Smolesk, parle de l’atmosphère morbide qui l’entoure : « Le froid était terrible déjà;
17 degrés au-dessous de zéro. Cela produisit de grandes pertes dans l’armée; Smolensk et les
environs regorgeaient de cadavres »446. Ces récits de désastre, si rares pour cette armée française,
étaient difficiles à raconter pour ces soldats. Le capitaine Gervais le confie dans ses Souvenirs édités
pour la première fois en 1938 : « La difficulté de raconter tout ce qui s’est passé dans cette retraite, les
traits de courage et ceux de barbarie, les évènements qu’on pourrait croire fabuleux est grande »447.
Ces histoires ramènent l’idée de la mort présente constamment autour d’eux. Eugène Labaume, officier
d’ordonnance pour le prince Eugène de Beauharnais lors de la campagne de Russie, décrit bien cet
aspect : « […] mais rien n’était horrible à voir, comme la multitude des morts qui, depuis cinquante-
deux jours, privés de sépulture conservaient à peine une forme humaine »448.
C’est sur cet arrière-fond dramatique que les récits des participants à la retraite de Russie
viennent ciseler le portrait d’un Ney dont la bravoure ne faiblit pas. Alors que le destin de ces hommes
pointe vers la mort, le maréchal Ney accomplit des actes héroïques. Dans son récit, le lieutenant-
colonel Fezansac cible la retraite de Krasnoï à Orcha comme le moment critique pour le maréchal Ney
443 Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la compagne de Russie, 1812, Paris, Armand Colin, 2012, p. 171. 444 Raymond de Monstesquion-Fezansac, Journal de la campagne de Russie en 1812, Tours, Mame et Cie, 1849, p. 71. 445 Jean-David Freytag, Mémoires, Paris, Nepveu, 1824, p. 167. 446 Jean-Roch Coignet, Les cahiers du capitaine Coignet (1799-1815), Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883, p. 331. 447 Capitaine Gervais, Souvenirs d’un soldat de l’Empire, Paris, Éditions du Grenadier, 2002, p. 244. 448 Eugène Labaume, Relation circonstanciée de la Campagne de Russie, 1814, p. 273.
111
dans l’organisation de l’arrière-garde. Le rôle du maréchal Ney est celui d’un sauveur auprès de ses
soldats par son expérience et son courage : « […] la présence du maréchal Ney suffisait pour nous
rassurer. Sans savoir ce qu’il voulait ni ce qu’il pourrait faire, nous savions qu’il ferait quelque chose.
Sa confiance en lui-même égalait son courage. Plus le danger était grand, plus sa détermination était
prompte; et quand il avait pris son parti, jamais il ne doutait du succès »449. Ses qualités militaires et
son expérience sont une motivation pour ces soldats. En ce sens, le général Freytag partage une
discussion entre lui et Ney, alors même que les Russes les attaquaient et qu’ils devaient traverser le
Dniéper: « C’est à cet instant que le Maréchal Ney s’approcha de moi et me dit : ‘‘ Eh bien! Freytag,
que pensez-vous de cela? -Que notre position n’est pas brillante, Maréchal, mais cela ne serait encore
qu’un demi-mal, si nous avions des cartouches. -C’est vrai; mais c’est ici qu’il faut savoir vendre
chèrement sa vie’’ »450. Presque teinté d’humour, le récit rappelle le calme que Ney dégage dans une
situation de désespoir. Freytag raconte même qu’avant de traverser ce fleuve, Ney refuse d’abdiquer
dans sa marche vers Orcha. Répliquant à un émissaire russe, il dit sèchement : « Allez dire à votre
général qu’un Maréchal de France ne se rend jamais »451. Ces deux moments rapportés par le général
Freytag alimentent la figure d’un héros qui refuse de se rendre même devant la mort imminente.
La marche vers Orcha obligeait les soldats de traverser le Dniéper. L’eau était partiellement
gelée, et plusieurs soldats sombraient : « […] tout autour de nous, on voyait des malheureux, enfoncés
avec leurs chevaux dans la glace, jusque par-dessus les épaules […] »452, comme le rappelle Freytag.
Rendu de l’autre côté du Dniéper, le général Freytag manque de force pour grimper la pente : « Les
forces commençaient à me manquer lorsque j’entendis la vois du Maréchal Ney qui me disait de me
hâter de monter. ‘‘ Il m’est impossible, lui répondis-je, si je ne suis aidé ’’. Aussitôt, le Maréchal coupa,
avec son sabre, une branche d’arbre, me la tendit et me tira ainsi à lui sur la hauteur ; sans son secours,
j’eusse infailliblement péri »453. Plus tard dans la retraite, à Kowno, le capitaine Coignet louange
l’intrépidité du maréchal Ney qu’il voit : « […] prendre un fusil avec cinq hommes et faire face à
l’ennemi »454. Fezansac, lui aussi présent à Kowno, raconte l’apparition de Ney, alors qu’il avait perdu
tout espoir pour sa vie: « il prit lui-même un fusil, les troupes revinrent à leur poste, le combat se rétablit
449 Raymond de Monstesquion-Fezansac, Journal de la campagne de Russie en 1812, 1849, p. 113. 450 Jean-David Freytag, Mémoires, 1824, p. 174. 451 Jean-David Freytag, Mémoires, 1824, p. 174. 452 Jean-David Freytag, Mémoires, 1824, p. 171. 453 Jean-David Freytag, Mémoires, 1824, p. 172. 454 Jean-Roch Coignet, Les cahiers du capitaine Coignet, 1883, p. 342.
112
et se soutint jusqu’à l’entrée de la nuit […] »455. L’épisode de Kowno est le deuxième fait de gloire de
Ney à avoir été l’objet d’un tableau conservé aujourd’hui au Musée du Louvre à Paris (Fig.13). Son
auteur, le peintre-illustrateur Auguste Raffet est reconnu pour puiser son inspiration dans des thèmes
guerriers qui sont le plus souvent liés à la légende napoléonienne. Cette œuvre montre le maréchal
Ney au-devant de ses soldats, pointant vers l’avant. Le maréchal Ney tient un fusil, comme les autres
soldats ce qui renvoie à la description faite par Fezansac. L’œuvre démontre la difficulté de la retraite
de Russie pour les soldats français456.
Figure 13: Le maréchal à la redoute de Kovno [Kowno]
Denis-Auguste-Marie Raffet. Vers 1840. Huile sur bois. 33 x 42 cm RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / A. Dequier - M. Bard https://www.histoire-image.org/fr/comment/reply/5316
De son côté, le capitaine Coignet veut que la patrie soit reconnaissante face à des soldats
comme Ney457. Le général Freytag, qui doit sa vie à Ney selon son récit, décrit la retraite jusqu’à Orcha
455 Raymond de Monstesquion-Fezansac, Journal de la campagne de Russie en 1812, 1849, p. 169. 456 https://www.histoire-image.org/fr/etudes/campagne-russie-1812 457 Jean-Roch Coignet, Les cahiers du capitaine Coignet, 1883 p. 342-343.
113
comme l’un des plus beaux faits militaires de France accomplit par le maréchal Ney458. Un rescapé de
cette débâcle russe, Adrien Bourgogne, exprime bien dans ses Mémoires comment les récits de ses
anciens soldats vont porter la figure héroïque du maréchal Ney lors de la retraite de Russie : « Je
n’oublierai jamais l’air imposant qu’avait le Maréchal dans cette circonstance, son attitude menaçante
en regardant l’ennemi, et la confiance qu’il inspirait aux malheureux malades et blessés qui
l’entouraient. Il était dans ce moment, tel que l’on dépeint les héros de l’antiquité. L’on peut dire qu’il
fut, dans les derniers jours de cette désastreuse retraite, le sauveur des débris de l’armée »459.
Quant à la stratégie de la retraite, à l’aide qu’il apporte à ses camarades militaires et à
intrépidité, le maréchal Ney est dans les récits de la retraite de Russie clairement représenté comme
un héros. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de lire dans les correspondances de Napoléon du 20
novembre 1812 qu’il s’inquiétait de l’absence de Ney : « Je n’ai point de nouvelles du maréchal Ney;
j’en désespère »460. Dans l’ouvrage Les fastes militaires de la France (1851), l’auteur décrit comment
Napoléon réagit lorsqu’il aperçoit le maréchal Ney à Orcha : « Ce ne fut qu’après des fatigues et des
efforts inouïs que Ney rejoignit le gros de l’armée à Orscha [Orcha]. Napoléon l’avait cru perdu; et en
le voyant reparaître, il s’écria : ‘‘J’ai donc sauvé mes aigles! J’aurais donné cent millions de mon trésor
pour racheter la perte d’un tel homme!’’ »461.
Dans les ouvrages publiés après la mort du maréchal Ney, les scènes décrites par les soldats
sont très présentes, et la retraite de Russie est un moment essentiel de la qualification héroïque de
Ney. Les biographies publiées dès 1815 consacrent de longs segments à cette retraite. Pour Cotterel,
sans le maréchal Ney, les pertes de l’armée française auraient été beaucoup plus grandes : « Les
Russes nous poursuivaient vivement; ils tombaient journellement sur notre arrière-garde, dont les
pertes eussent été bien plus grandes, sans les manœuvres hardies du maréchal Ney, qui ne cessa de
protéger la retraite »462. Évariste Dumoulin exploite lui aussi l’aspect du maréchal Ney incontournable
dans cette retraite pour la survie des armées. Rappelant la bataille de la Moskowa où Ney se
démarqua : « […] cet illustre et généreux guerrier, à la tête de quelques braves qui se dévouèrent avec
lui, sauva les débris d’une armée poursuivis à la fois par un ennemi vainqueur, par le feu, par la faim,
458 Jean-David Freytag, Mémoires, 1824, p. 177 459 Adrien Bourgogne, Mémoires du sergent Bourgogne, Paris, Hachette, 1905, p. 192. 460 À M. Maret, duc de Bassano, Orcha, 20 novembre 1812, p. 362. 461 Émile de La Bédollière, Les fastes militaires de la France. p. 307. 462 François-Frédéric Cotterel, De la vie et du procès du maréchal Ney, 1816, p. 25.
114
pour toutes les horreurs d’un climat où une prompte mort était le dernier vœu, et semblait être la seule
espérance du soldat »463. Dans le sombre tableau décrit par Dumoulin, Ney est celui qui « sauve » ces
soldats du calvaire russe. Sans lui, sans les gestes héroïques qu’il accomplit, l’issue de la retraite aurait
été différente.
Raymond Maiseau, de son côté, souligne d’abord les efforts et le calme du maréchal Ney lors
de sa retraite, et le courage qu’il inspire aux soldats. En effet, alors que les soldats avaient perdu de
vu leur chef, Ney : « On trouva le maréchal couché sur la neige, une carte à la main, méditant
tranquillement la route qu’il devait prendre. Tant de calme, au milieu du danger le plus imminent, ranima
le courage des soldats »464. Maiseau, et Papy Descabanes, sont les seuls à traiter de la rencontre
entre Ney et Napoléon à Orcha. Maiseau relate que l’armée salua Ney « par des cris de joie l’arrivée
inespérée de ses compagnons d’infortune » où Napoléon se précipita vers Ney pour l’embrasser465.
Chez Papy Descabanes, nous retrouvons le partisan de Ney dans sa description de la retraite. Les
rescapés de la retraite devaient tout simplement leur vie à Ney. En effet : « […] abandonné de l’armée,
sans guide, au milieu des ténèbres, il sait se frayer une route sanglante à travers un ennemi vingt fois
plus nombreux, jusqu’au quartier de l’empereur. Avec quelle joie, quel enthousiasme ne furent-ils
accueillis à Orcha, ces braves qui ne devaient la vie la liberté, qu’à l’intrépide sang-froid du brave des
braves ! »466.
Les derniers mots de Papy Descabanes résument en quelque sorte la façon dont les récits
posthumes construisent Ney comme un héros lors de la retraite de Russie. Ney traverse cette période
noire de l’Empire avec dévouement pour ses hommes, par sang-froid : il est celui qui sauve l’armée.
Ce sens du sacrifice, inhérent au héros, est également présent dans les récits de la dernière bataille,
à Waterloo.
« Venez-voir comment meurt un maréchal de France! »467
Les années 1814-1815 sont la période la plus trouble pour l’héroïsme du brave des braves.
Dans un habit politique lors de la première restauration, Ney joue un rôle de premier plan dans les
463 Évariste Dumoulin, Histoire du procès du maréchal Ney, 1815, p. xiv. 464 L-Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, 1816, p. 67. 465 L-Raymond-Balthasard Maiseau, Vie du maréchal Ney, 1816, p. 68. 466 Papy Descabanes, Précis historique et jugement d’un illustre guerrier, 1829, p. 19. 467 Victor Hugo, Les misérables, Tome 1, Paris, Nelson, 1862, p. 488.
115
négociations avec le Tsar de Russie pour régler la transition politique en France. Dans les Mémoires
du général Caulaincourt, Ney a un comportement plutôt ambigu : sa loyauté envers l’Empire était
compromise par ses paroles. Selon Caulaincourt, Napoléon tout en admirant les qualités de son
maréchal, se méfiait du caractère indépendant de Ney : « […] prenez-y garde, car l’ambition de ce
maréchal peut lui faire faire bien des sottises, s’il a l’espoir de jouer un rôle sous le nouveau
gouvernement »468. Nous le savons, le maréchal Ney « lâcha » Napoléon en 1814, se voyant plutôt
comme un serviteur de la France que de l’Empire ou de Napoléon469.
Le maréchal Ney fut pardonné par Napoléon en 1815. Lors de leur réunion après le
débarquement de Napoléon, ce dernier s’exprima sur sa rencontre avec Ney : « Il est sûr qu’il avait été
assez mal pour moi; mais le moyen d’oublier un aussi beau courage et tant d’actes passés! Je lui sautai
donc au cou en l’appelant le brave des braves, et dès cet instant tout fut comme jadis […] »470. Le
maréchal n’avait donc pas perdu son surnom le plus prestigieux, à tout le moins à ce moment précis
du retour de l’Aigle. Ce sont plutôt les premiers récits portant sur la campagne de Waterloo qui vont
accabler le maréchal Ney de tous les maux. Comme nous l’avons vu, la défaite, la fin des Cent-Jours
auraient été scellées lors des batailles des Quatre-Bras et de Waterloo où le maréchal Ney avait
multiplié les erreurs militaires. S’entretenant avec le maréchal Davout après la défaite de Waterloo,
Napoléon, hystérique, mettait la faute sur le maréchal Ney : « Eh bien! Davout! Eh bien! Tout est perdu!
...J’ai été trahi! Ney m’a trahi! […] »471. Le maréchal Davout répond à Napoléon : « Sire, Ney s’est mis
la corde au cou pour vous servir […] »472. La réponse de Davout à Napoléon fait référence à la trahison
du maréchal Ney à Louis XVIII.
Si certains ouvrages comme celui de Gaspard Gourgaud critiquent les tactiques de Ney sur le
champ de bataille, plusieurs autres décrivent Ney avec la même attitude héroïque qu’il avait lors des
campagnes précédentes. Sa bravoure n’est jamais remise en question. Peut-être par remords ou par
volonté de prouver son attachement à Napoléon, les auteurs de ces récits nous montrent le maréchal
Ney partout sur le champ de bataille, toujours le sabre à la main devant ses soldats. Dans cette ultime
468 Armand-Louis-Augustin de Caulaincourt, Mémoire du général de Caulaincourt, Tome 3, Paris, Librairie Plon, 1933, p. 192. 469 Frédéric Hulot, Le maréchal Ney, Paris, Pygmalion, 2000, p. 184. 470 Charles de Massas, Les derniers jours de l’empire. Paris, Swarz et Gagnot, p. 73. 471 Louis-Joseph Gabriel, Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davoust, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmuhl (d’après les documents officiels), Paris, Cosse, Marchal et Cie, 1866, p. 556. 472 Louis-Joseph Gabriel, Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davoust, 1866, p. 556.
116
campagne militaire, nous retrouvons Ney dans la bataille des Quatre-Bras comme commandant des
armées françaises sur place, ainsi qu’à Waterloo où il est aussi responsable du commandement sur le
terrain.
La bataille des Quatre-Bras, carrefour routier stratégique, se déroule le 16 juin 1815 et oppose
Ney aux Anglais dirigés par Wellington. Dans son ouvrage Campagne et bataille de Waterloo (1845),
Achille de Vaulabelle note que le combat s’entame à 15h15 lorsque Ney entend les canons de
Napoléon bourdonner à Ligny473. Selon l’auteur, c’est pour cette raison que Ney commence son
attaque : « Ney d’ailleurs, pour se révéler, avait besoin de l’excitation du feu de la bataille. C’était un
de ces rares courages à qui le sang-froid n’arrive, dont les facultés ne s’épanouissent qu’au bruit des
détonations de l’artillerie »474. Achille de Vaulabelle, alors que les armées ennemies grossissent à vue
d’œil, relate que l’énergie de Ney augmente avec l’arrivée de nouveaux opposants : « Ney, dans ce
moment poussait son attaque avec furie »475. Privé du 1e corps pour l’appuyer, Ney, toujours sous la
plume de Vaulabelle, exprime ses premiers désirs de mourir : « Voyez-vous ces boulets! s’écria-t-il
avec un sombre désespoir, en montrant les projectiles qui volaient autour de lui, je voudrais qu’ils
m’entrassent tous dans le corps! »476. Comme nous allons le voir plus loin, le maréchal Ney exprime
la volonté d’en finir sur le champ de bataille. Si cette bataille donne personne vainqueur, le général
Gourgaud, assez sévère dans sa critique sur les agissements de Ney, concède des éléments
d’héroïsme lors de la bataille des Quatre-Bras : « Cependant le maréchal Ney, par son intrépidité, et
par l’ardeur des troupes françaises, gagnait toujours du terrain, et repoussait un ennemi supérieur en
force »477. Ou encore : « Il est impossible de se battre avec plus de courage et d’ardeur que ne le fit le
maréchal Ney, avec ce qu’il fit donner de troupes »478. Dans une autre publication datée de 1829 et
écrite par l’aide-de-camp du maréchal Ney lors de Waterloo, le colonel Heymès, le génie militaire de
Ney s’est opéré lors de cette bataille « […] heureusement que le maréchal Ney possédait à un haut
degré les deux premières qualités du guerrier, la présence d’esprit dans le danger, et la patience dans
le malheur; il sut les mettre à profit dans cette occasion difficile »479.
473 Achille de Vaulabelle, Campagne et bataille de Waterloo, 1845, p. 77. 474 Achille de Vaulabelle, Campagne et bataille de Waterloo, 1845, p. 77. 475 Achille de Vaulabelle, Campagne et bataille de Waterloo, 1845, p. 81. 476 Achille de Vaulabelle, Campagne et bataille de Waterloo, 1845, p. 83. 477 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 63. 478 Gaspard Gourgaud, Campagne de 1815, 1818, p. 64. 479 Pierre-Agathe Heymès, Relation de la campagne de 1815, 1829, p. 15.
117
À Waterloo, Ney se distingue surtout à la fin de la bataille. Selon Henri Welschinger, il aurait
lui-même dit : « Les braves qui reviendront de cette affaire, me rendront, j’espère, la justice de dire
qu’ils m’ont vu sur pied, l’épée à la main, pendant toute la soirée, et que je n’ai quitté cette scène de
carnage que l’un des derniers […] »480. Si Achille de Vaulabelle ne parle pas précisément de cette
scène, il parle d’une autre charge où Ney se distingue : « Le sol se couvre de morts et de mourants.
L’intrépide général Michel, de la garde, est tué; le général Friant est blessé; Ney est renversé de cheval.
Ce maréchal, le plus brave, le plus grand des soldats au milieu du feu, se relève, et l’épée à la main
continue à commander, à guider nos soldats »481. Tout au long de Waterloo, sous la plume de
Vaulabelle, Ney est souvent devant ses troupes, les guidant vers l’ennemi à pied. C’est l’aide-de-camp
du maréchal, Heymès, qui va le mieux traduire la journée du maréchal Ney : « l’empereur fut mêlé
dans ce désordre affreux; la déroute était complète. Le maréchal Ney, qui avait eu cinq chevaux tués
sous lui dans cette fatale journée, à pied, à la tête des restes des quatre bataillons de la garde, fut le
dernier à quitter ce champ de carnage »482. Les plus beaux mots à l’égard de Ney sont de Georges de
Despots, membre de l’État-major de Napoléon. Bien que critique comme d’autres des agissements de
Ney : « […] ce qui est incontestable, cependant, c’est que dès le commencement de la bataille, le
maréchal Ney se montra Ney, le brave des braves; sa conduite fut héroïque, admirable; il déploya une
rare énergie et un courage surhumain »483.
Le désir du maréchal Ney de mourir sur le champ de bataille n’est pas mentionné par ces
auteurs. C’est Adolphe Thiers, dans L’Histoire du consulat et de l’Empire, qui dépeint un maréchal Ney
« […] sans chapeau, son épée brisée à la main, ses habits déchirés, et trouvant encore une poignée
d’hommes armés, courts à eux pour les ramener à l’ennemi : ‘‘ Venez, mes amis, leur dit-il, venez voir
comment meurt un maréchal de France! ’’ »484. Le récit par Thiers de la bataille de Waterloo décrit
l’héroïsme du maréchal Ney aux côtés d’une armée française à la déroute la plus totale. Ce contraste
nous permet de comprendre le rôle de Ney sur le champ de bataille : son désir de mourir resserre les
rangs. Après son appel à mourir : « Ces braves gens, entraînés par sa présence [Ney], font volte-face,
480 Henri Welschinger, Le maréchal Ney, 1893, p. 71. 481 Achille de Vaulabelle, Campagne et bataille de Waterloo, 1845, p. 185. 482 Pierre-Agathe Heymès, Relation de la campagne de 1815, 1829, p. 27. 483 George de Despots-Zenowicz, Waterloo. Déposition sur les quatre journées de la campagne de 1815, Paris, Ledoyen, 1848, p. 27. 484 Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire: faisant suite à l’Histoire de la Révolution française, Tome 20, Paris, Paulin, 1862, p. 250.
118
et se précipitent en désespérés sur une colonne prussienne »485. Devant la déroute, Thiers met en
scène la volonté de Ney de mourir comme un élément essentiel à la motivation des troupes. Si Ney
est prêt à affronter la mort, les soldats le suivront. Ce souhait de mourir rappelle le au concept de la
Belle mort, discuté ci-haut. La volonté exprimée par le maréchal Ney est de mourir sur le champ
d’honneur, même si la mort est partout autour de lui. Ney par ses paroles refuse le déshonneur de fuir,
au contraire, puisque la Belle mort « […] représente comme le terme ultime de l’honneur, son extrême
pointe, l’arête (excellence) accomplie »486. Victor Hugo, dans Les Misérables, met en scène le
maréchal Ney à Waterloo portant l’uniforme du héros. Hugo reprend la même phrase utilisée par
Thiers, mais en ajoutant de la sévérité au moment : « En sueur, la flamme aux yeux, l’écume aux
lèvres, l’uniforme déboutonné […], sanglant, fangeux, magnifique, une épée cassée à la main, il disait
‘’ Venez voir comment meurt un maréchal de France sur le champ de bataille!’’ »487. Alors que les
troupes fuient de tous les côtés pour leur vie, le maréchal Ney demeure sur le champ de bataille : « Il
criait au milieu de toute cette artillerie écrasant une poignée d’hommes ‘‘ […] je voudrais que tous ces
boulets anglais m’entrassent dans le ventre!’’ »488. Ne voulant fuir comme les autres, Ney veut mourir
sur ce champ de bataille, mais n’y arrive pas. De façon habile, Victor Hugo renvoie Ney à son
exécution: « […] tu étais réservé à des balles françaises, infortuné! »489.
Les journaux républicains ont été les premiers à publiciser les exploits du jeune Michel Ney
lors de son ascension dans l’Armée du Rhin. Sous ces publications antérieures aux Bulletins de la
Grande Armée, Ney impressionne par son courage et son intrépidité sur les différents champs de
bataille auxquels il participe. Les surnoms qu’il acquiert peu à peu, Intrépide et Infatigable, vont clarifier
la figure du héros qui se dessine au fil de son ascension dans les grades de l’armée française. Sous
l’Empire, le rôle que joue le maréchal Ney dans la construction de la gloire française et napoléonienne
accentue le prestige associé à son nom. De grandes victoires comme Elchingen, Friedland ou la
Moskowa sont associées à ses qualités militaires dans les Bulletins, outil puissant pour nourrir la figure
du héros de ce maréchal que l’on nomme dorénavant duc d’Elchingen et Prince de la Moskowa dans
les publications impériales. Parallèlement à ses titres impériaux, Ney reçoit celui du brave des braves.
Qu’il ait été donné par ses soldats à Friedland ou par Napoléon sur le champ de bataille de la Moskowa,
485 Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, T. 20, 1862, p. 250 486 Jean-Pierre Vernant, « La belle mort et le cadavre outragé », 1990, p. 2. 487 Victor Hugo, Les misérables, T. 1, 1862, p. 488. 488 Victor Hugo, Les misérables, T. 1, 1862, p. 487. 489 Victor Hugo, Les misérables, T. 1, 1862, p. 487.
119
selon les sources consultées, ce surnom surpasse tous ses autres surnoms: il confirme sa figure du
héros. Durant la retraite de Russie, ignorée dans les Bulletins, le regard des soldats ayant participé à
ce sordide épisode de l’Empire confirme l’aura héroïque du maréchal Ney. Son courage, ses stratégies,
et surtout le calme qu’il dégage sur le moral des soldats les motivent à continuer à se battre. Sa simple
apparition donne espoir aux soldats entourés par la mort. Si à Waterloo la figure du héros de Ney ternit
quelque peu, notamment du fait de la publication d’ouvrages lui attribuant la défaite de Waterloo, ses
derniers moments, au contraire, sont assumés pleinement. Tout au long des trois tableaux présentés
dans ce chapitre, la convergence des récits est remarquable : Ney nous apparaît courageux et calme
devant la mort. Grâce aux récits qui relatent et construisent les derniers moments de Ney, une
continuité s’installe entre le militaire et le condamné : les mêmes qualités militaires sont mises de
l’avant pour qualifier le maréchal Ney. Face à l’ennemi comme au peloton d’exécution, ce héros ne
craindra jamais la mort.
120
Conclusion
Les trois figures mémorielles du maréchal Ney qui ont été mises en évidence dans ce mémoire
ne fonctionnent pas en vase clos. La succession de deux régimes censitaires qui ont des attitudes très
différentes avec le passé napoléonien, et le foisonnement des oppositions à ces deux régimes nous
ont permis d’observer que les figures mémorielles du maréchal Ney ont existé dans l’espace public en
s’entremêlant et en s’opposant. Leur existence propre ne peut être complète sans la présence et les
interactions avec les autres figures.
Nous avons commencé ce mémoire par la présentation de la figure du traître, définie et
publicisée par le gouvernement de Louis XVIII et mise en avant lors du procès de Ney. Pour faire un
« exemple » la monarchie ne pouvait exécuter un quidam, un simple soldat. Afin d’avoir l’impact désiré
dans l’espace public, et pour affirmer sa revanche sur le passé impérial et révolutionnaire, le
gouvernement utilise le prestige militaire du maréchal Ney pour frapper l’imaginaire des Français : la
monarchie exécute un maréchal d’Empire, un individu placé tout en haut de la noblesse d’Empire créée
par Napoléon, un combattant réputé pour sa valeur. La dualité entre héros et traître nous semble ici
très forte. Lors du procès, les accusateurs développent justement leur argumentaire en puisant
allègrement dans l’héroïsme de Ney pour mieux l’expulser de la communauté nationale des loyaux
sujets du roi. Du simple paysan aux plus grands militaires français, aucun ne peut trahir la parole du
roi sans en connaître les conséquences. Par le fait que la figure du héros « préexistait » à celle du
traître, la monarchie peut investir un champ des possibles, et modeler un traître à sa façon. Pour les
autorités royales, le procès à la Chambre des pairs est devenu cet endroit de prédilection où elles ont
façonné la figure du traître du maréchal Ney en dévalorisant son héroïsme dont les hauts faits n’avaient
pas de valeur selon les logiques monarchistes des ultra-royalistes.
Bien que les autorités royales, comme nous l’avons vu, voulurent étouffer tout « culte des
vaincus », la création d’une figure du traître a activé celle de la victime et/ou du martyr. Les moyens
utilisés pour porter et exprimer cette figure mettent en évidence la fondation de cette figure : d’une part,
l’opposition, féroce ou modérée, à l’exécution du maréchal et à son étiquette de traître, d’autre part
l’opposition aux Bourbons ou au système monarchique dans son ensemble. Lors de l’analyse du
versant victime de cette figure, nous avons remarqué que les tenants de ce versant canalisaient leurs
efforts vers la contestation d’un processus judiciaire « tronqué ». À l’aide d’arguments juridiques, leurs
motivations cherchaient à prouver d’une part que Ney n’avait jamais été un traître, et que d’autre part,
121
la figure du traître avait été publicisée par un procès illégitime et tronqué, dans lequel les avocats de
Ney n’avaient pu défendre convenablement leur client. Il est intéressant d’observer que le sort réservé
au maréchal Ney a eu des échos dans d’autres procès de nature politique. L’évocation du procès
tronqué de Ney est un élément qui revient hanter les monarchies censitaires lors de certains procès
qui se déroulent dans l’enceinte de la Chambre des pairs : en 1835, celui des Insurgés de Lyon et en
1834 pour le procès d’Armand Carrel, ont rappelé à leurs accusateurs la mémoire du maréchal Ney.
Comme le caricaturiste Honoré Daumier l’a brillamment mis en image, le Ney victime devient un
argument politique dans ces occasions : les pairs sont des « assassins », et leur justice a perdu toute
légitimité lorsqu’ils ont prononcé la mise à mort de Ney. Dans l’ensemble, néanmoins, l’évocation de
la figure de la victime est davantage la critique judiciaire de la figure du traître, et elle forme le référent
d’une action plutôt axée sur la réhabilitation de la mémoire de Ney qu’une forme d’opposition politique
aux monarchies censitaires.
Ceci nous renvoie vers l’autre versant de la figure, celui du martyr. Cette déclinaison de la
figure est finalement peu présente dans les sources. Elle aussi s’attaque à l’injustice faite au maréchal
Ney, donc à la figure du traître, mais elle passe par des gestes et des paroles, accomplis dans l’espace
public parisien. Ney martyr est-il alors un symbole qui peut et doit unir une cause? La cause la plus
susceptible d’utiliser de mobiliser cette version de Ney en martyr, c’est celle des différents groupes
d’opposition aux monarchies censitaires. Le transport de bustes, dont celui de Ney, au Panthéon pour
célébrer les martyrs de la Restauration ou le rassemblement devant le Théâtre des Nouveautés après
l’interdiction de la pièce Le procès d’un maréchal de France sont les deux « moments-Ney » les plus
importants que nous ayons repérés dans l’espace public parisien.
Comme dans un miroir renversé, le maréchal Ney a quant à lui posé des gestes particuliers,
en réplique à la façon à son assignation de traître. Il prend la parole au procès, refuse les
échappatoires, accepte un verdict dont il repousse l’argumentaire. Le 7 décembre 1815, il continue ce
travail d’affirmation de soi, avant et pendant son exécution. Ney a-t-il voulu mourir en héros? En tout
cas, c’est avec ces gestes et ses paroles de 1815, souvent déformés, que se construit la figure du Ney
héros entre 1815 et 1848. Cette figure prend sens vis-à-vis de celles du traître et de la victime/martyr :
les porteurs de la figure de la victime et du martyr s’insurgent contre sa mort, et que ceux qui le voient
comme un traître s’inquiètent des conséquences du procès dont l’existence et les conséquences
escomptées « exigeaient » la figure du héros. Contrairement aux deux autres, cette figure du héros
122
intègre bien d’autres matériaux que ceux liés aux Cent-Jours et aux procès : l’héroïsme de Ney est mis
en évidence à partir de ses hauts faits militaires sous l’Empire, lors des batailles d’Elchingen, de la
Moskowa ou de la retraite de Russie dans son ensemble, mais aussi en se référant à sa carrière
militaire depuis le début de la Révolution française. Sous la plume des auteurs sélectionnés ayant
publiés pendant notre période historique, s’écrit peu à peu l’histoire héroïque du maréchal Ney. Cette
narration est basée sur des épisodes militaires particuliers, et plus généralement sur la mise en
évidence de la bravoure de Ney, notamment signalée par la référence à plusieurs surnoms qui lui ont
été donnés, et parmi lesquels « brave des braves » prend de l’importance jusqu’à devenir, dans les
récits héroïques, une antonomase spécifique au maréchal Ney. La parution des différents ouvrages
que nous avons utilisés contribue alors, modestement, à diffuser le récit héroïque du maréchal Ney.
Nous disons modestement puisque la figure du maréchal Ney n’a eu qu’une présence
secondaire dans l’espace parisien. Pourtant, tous les éléments nous semblaient être réunis: chef
militaire apprécié des soldats, aimé par Napoléon, figure romanesque voir romantique par son
caractère émotionnel et impulsif, exécuté par la monarchie, ennemie de la République et de l’Empire.
Toutefois, la mémoire de Ney est restée plutôt discrète, n’apparaissant qu’occasionnellement dans les
rues parisiennes. Les figures développées dans ce mémoire ont en effet dû faire face à la légende
napoléonienne, et son acteur principal : Napoléon. Bien que Ney en fût un pilier, avec d’autres
maréchaux, la légende napoléonienne, et sa courroie politique, n’a pas su faire une plus grande place
à Ney. D’une part, Napoléon restait la figure de référence pour celles et ceux qui voulaient s’opposer
aux monarchies censitaires. Comme l’a souligné Natalie Petiteau, la figure du Petit caporal « fédérait »
les partis autour de leur aversion à la Restauration. Dans ce contexte, la figure de Ney, reléguée au
second plan, pouvait être utilisée comme un appui additionnel au combat contre les monarchies
censitaires placé sous l’égide principale de Napoléon. La mort de ce dernier, la publication du Mémorial
de Sainte-Hélène, et le retour de ses cendres en 1840 ont permis de garder la mémoire de Napoléon
en vie tout pendant le règne des trois derniers rois français, au détriment d’autres figures de l’Empire.
D’autre part, malgré les demandes de révisions du procès et de réhabilitation formulées par la famille
de Ney, la monarchie de Juillet n’a finalement pas révisé l’issue du procès. Bien que porté dans
l’espace public comme une victime, un martyr et un héros, ces figures n’effaçaient pas le fait
« qu’officiellement » Ney restait un traître à la France.
123
Il faut attendre le 7 décembre 1853 pour que l’État proclame l’injustice affligée à Ney, et
accepte de le réhabiliter. Ce jour-là, on inaugure une statue à l’endroit même où, 38 ans plutôt, le
maréchal Ney a été exécuté. Bien que le neveu de Napoléon soit à la tête du régime sous lequel se
produit cette réhabilitation, la conception de la statue a montré comment plusieurs figures de Ney
cohabitent et peuvent entrer en concurrence lorsqu’il s’agit de choisir ce que le monument allait dévoiler
au public. L’idée de l’artiste sélectionné pour accomplir ce travail, François Rude, qui nourrit une
passion pour l’univers napoléonien490, se heurta alors à celle de Louis-Napoléon Bonaparte, d’abord
président de la IIe république puis empereur sous le nom de Napoléon III. Rude voulait représenter
Ney :
[…] tel qu’il s’est présenté aux soldats commandés pour le fusiller, tel qu’il avait comparu devant la cour des pairs, en grande capote militaire, avec les guêtres jusqu’au genou, la tête décoiffée du bonnet de police jeté à ses pieds, les cheveux au vent, montrant d’un geste sa poitrine découverte à l’endroit du cœur, commandant lui-même le feu, prêt à tomber courageusement sur la place de l’exécution. 491
Par le choix de l’exécution comme moment où saisir Ney en action, Rude mobilisait avant tout
la figure de la victime, quoiqu’avec une touche héroïque. Le gouvernement bonapartiste, pour sa part,
choisit résolument le héros et veut que ce soit le « brave des braves » qui fasse mémoire pour les
Parisiens et tous ceux qui passent par la Place de l’Observatoire. Le ministre de l’Intérieur et des
beaux-arts en 1852, Victor de Persigny492 prend même la peine d’écrire à Napoléon III pour influencer
la conception de la statue : « J’estime que le monument du maréchal Ney ne doit pas être considéré
uniquement comme l’expression d’une réhabilitation tardive, mais qu’il doit être aussi d’hommage à la
mémoire d’une de nos plus grandes gloires militaires »493. Rude cède aux pressions, et confectionne
une statue de 2,70 mètres qui met en scène la figure du héros du maréchal Ney. Le jour de
l’inauguration, le Moniteur Universel fait la description du résultat final : « Le héros de la Moskowa est
490 En 1847, Rude inaugure è Châteauroux son bronze Napoléon s’éveillant à l’immortalité; en 1852, avant la conception du bronze de Ney, le sculpteur termine son modelage du maréchal Bertrand, celui même qui rencontre Ney durant la nuit du 13 mars à Lons-le-Saulnier. (Eugène Spuller, Conférence faite le dimanche 25 juillet 1886, au grand théâtre de Diijon sur la vie et l’œuvre de François Rude, Dijon, Jacquot, Floret & Cie, 1886, p. 55.) 491 Eugène Spuller, Conférence, 1886, p. 56. 492 Victor de Pesigny est un compagnon de longue date de Louis-Napoléon Bonaparte, et il a participé aux tentatives de
coup d’État, préparées par Louis-Napoléon Bonaparte, de Strasbourg (1836) et de Boulogne (1840). De plus, Victor de Persigny épouse en 1852 la petite-fille du maréchal Ney, Eglé Ney de la Moskowa. 493 Louis de Fourcaud, « François Rude », Gazette des Beaux-Arts. Courrier Européen de l’art et de la curiosité, Tome 5, 33e année, 3e période, 1891, p. 111.
124
représenté en costume de maréchal, le sabre à la main, dans l’attitude énergique qu’il avait sur les
champs de bataille quand il criait : En avant ! »494.
Nous retrouvons ici plusieurs des thèmes décrits dans le chapitre de la figure du héros : un
titre impérial, conséquence d’un mérite militaire, l’attitude guerrière qui le caractérisait, et l’allusion aux
champs de batailles sur lesquels Ney a démontré son talent militaire. Le ministre de la Guerre, le
maréchal Saint-Armand, prend d’ailleurs le premier la parole lors de la cérémonie de l’inauguration, et
il fait de la réhabilitation un tribut au héros : « Cette réparation solennelle était due à la mémoire du
prince de la Moskowa. Elle était due à ses services et à ses compagnons d’armes; car s’il est un
privilège qui appartienne à ces grandes existences liées aux destinées des empires, c’est d’être jugées
par leurs services et non par leurs erreurs »495. L’un des avocats de Ney, André Dupin, prend lui aussi
la parole. Il emprunte un registre un peu différent, reprenant la figure de la victime pour attaquer le parti
ultra-royaliste, mais se rallie finalement à la figure du héros :
Le maréchal est tombé victime d’une réaction politique; victime de la haine implacable qu’une faction antinationale portait aux illustres chefs de cette grande armée […]. Le maréchal Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa, tant de fois victorieux sur nos champs de bataille, fut l’holocauste offert en expiation des gloires militaires de l’Empire […]. 496
Ainsi, la trajectoire mémorielle du maréchal Ney, tumultueuse et incertaine sous les
monarchies censitaires, termine sa course sous la figure du héros. Avec cette statue, le Second Empire
tenait à honorer le militaire des « champs de bataille glorieux », plutôt que celui mort sous les balles
de la monarchie bourbonienne. Aujourd’hui, sur la toile, le terme de recherche « Brave des braves »
renvoie inévitablement au maréchal Ney. C’est dire que de nos jours, la figure du héros est celle qui
caractérise et définit le maréchal Ney.
494 Le Moniteur Universel, 8 décembre 1853, p. 1. 495 Le Moniteur Universel, 8 décembre 1853, p. 1. 496 Le Moniteur Universel, 8 décembre 1853, p. 2.
125
Bibliographie
Sources Archives nationales F7 3028 Police générale : arrestations politiques et surveillances, 1815-1830 F7 6683 Police générale : Affaires politiques, 29 juillet 1815 – 21 août 1830; Français exilés en vertu de l’Ordonnance de juillet 1815; dossier Ney F7 6772 Police générale: Affaires politiques, Situation politique des départements, 1820-1830 F 1cl 33 Bulletins de police concernant le département de la Seine (1831-1832) Sources imprimées Description des cérémonies, fêtes, entrées solennelles et honneurs rendus à Louis XVIII en Angleterre et en France, Paris, F. Scheoll, 1814, 126 p. Procès des accusés d’avril devant la cour des Pairs, Tome 1, Paris, Pagnerre, 1835, 332 p. Procès des accusés d’avril devant la cour des Pairs, Tome 2, Paris, Pagnerre, 1835, 630 p. Procès du maréchal Ney ou recueil complet, 4 tomes, Paris, L. G. Michaud, 1815, 283 p. Procès du National de 1834 devant la Chambre des pairs, Paris, 1854, Imprimerie de Grégoire, 32 p. Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session de 1830, Tome 4 (Janvier- Février), Paris, A. Henry, 1831, 1034 p. Révision du procès du maréchal Ney, Paris, Imprimerie Pihan Delaforest, 1831, 8 p. ARNAUD, C.-P. Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris avec leurs épitaphes et inscriptions, Tome 2, Paris, Arnaud, 1825, 96 p. AUGUSTE, Vivien et BLANC, Edmond. Traité de la législation des théâtres, Paris, Brissot- Thivars, 1830, 443 p. BACHASSON, Camille, comte de Montalivet. Fragments et Souvenirs (1810-1832), Paris, Calmann Lévy, 1899, 586 p. BARGINET, Alexandre. Sur Napoléon ou réponse aux journaux contre-révolutionnaires, Paris, 1821, 19 p.
126
BOREL D’HAUTERIVE, André. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, Paris, Henri Plon, 1862, 427 p. BROC, Hervé (de). Mémoire du comte Ferrand, ministre d’État sous Louis XVIII, Paris, Alphonse Picard et fils, 1897, 313 p. CAPEFIGUE, Jean-Baptiste. L’Europe depuis l’avènement du roi Louis-Philippe, Tome 3, Paris, Comon et Cie, 1845, 472 p. COBBETT, William. Adresse à Sa Majesté Louis XVIII, 30 avril 1814, Paris, Imprimerie de Charles, 15 p. COTTEREL, François-Frédéric. Précis historique de la vie et du procès du maréchal Ney, Paris, J.- G. Dentu, 1816, 76 p. DELMAS, Germain. Mémoire sur la révision du procès du maréchal Ney, 1832, 70 p. DUPEUTY, Charles-Désiré et FONTAN, Louis-Marie. Le procès d’un maréchal de France (1815), Paris, Ambroise Dupont, 1831, 68 p. GUIZOT, François. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Tome 2, Paris, Michel Lévy Frères, 1859, 521 p. JOLIMONT, Théodore (de). Les mausolées français, Paris, Firmin Didot, 1821, 243 p. LAMARTINE, Alphonse (de). Trois mois au pouvoir, Paris, Michel Lévy frères, 1848, 328 p. LAUMOND, Antoine. De la Chambre des pairs et de la révision du procès du maréchal Ney, Paris, Moutardier, 1831, 130 p. LECOURBE, Claude-Jacques et PHILEBERT, Charles. Le général Lecourbe, d’après ses archives, sa correspondance et d’autres documents, Paris, Henri-Charles Lavauzelle, 1895, 573 p. MADIVAL, Jules et Laurent, Émile. Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série. 2 (1800-1860), Tome 12, 1868, Paris, Paul Dupont, 794 p. MADIVAL, Jules et LAURENT, Émile. Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série. 2 (1800-1860), Tome 15, Paris, Paul Dupont, 1869, 792 p. MADIVAL, Jules et LAURENT, Émile. Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série. 2 (1800-1860), Tome 66, Paris, Paul Dupont, 1889, 787 p. MADIVAL, Jules et LAURENT, Émile. Archives parlementaires, de 1787 à 1860, Série. 2 (1800-1860), Tome 71, Paris, Paul Dupont, 1889, 793 p. MAISEAU, Raymond-Balthasard. Vie du maréchal Ney, Paris, Pillet, 1816, 419 p.
127
MARIE DE SAINT-GEORGES, Alexandre. Consultation pour la veuve et les fils du maréchal Ney, 1832, 70 p. MOREAU-VAUTHIER, Charles. Gérôme, peintre et sculpteur : l’homme et l’artiste, d’après sa correspondance, ses notes, les souvenirs de ses élèves et de ses amis, Paris, Hachette, 1906, 295 p. MOLÉON, Victor (de). Rapports généraux du conseil de salubrité de la ville de Paris et du département de la Seine, Tome 1, Paris, Bureau du recueil industriel, 1828, 527 p. JOLIMONT, Théodore (de). Les mausolées français, Paris, Firmin Didot, 1821, 243 p. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN, Pierre. Dictionnaire historique, topographique et militaire de tous les environs de Paris, Paris, C. L. F. Panckoucke, 1816, p. 647 p. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN, Pierre. Promenade aux cimetières de Paris avec quarante-huit dessins, Paris, C.-L.-F Panckoucke, 1825, 191 p. ROCHECHOUART, Louis-Victor. Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1892, 541 p. Journaux Le Constitutionnel : 1815, 1830, 1831 Journal des débats politiques et littéraires : 1814, 1815 Gazette de France : 1815, 1838 Gazette du Languedoc : 1834 La Quotidienne : 1815, 1823 Journal général de France : 1817 Moniteur universel : 1820, 1830, 1831, 1853 Journal de la ville de Saint-Quentin : 1841 Le Figaro : 1838, 1868 Images Anonyme, Le maréchal Ney étendu mort sur un brancard ayant à ses côtés une sœur de la charité en prières, 1815, lithographie, BnF, Estampes et photographie, Rés. QB-201- (158)-Fol. Collection Michel Hennin
128
Anonyme, Assassinat juridique du maréchal Ney, date inconnue, lithographie, 15,6 x 25,6 cm, BnF, Dép. Estampes et photographie, Rés. QB-370 (74)-FT 4. Collection de Vinck Anonyme, Double pièce circulaire en l’honneur du maréchal Ney, 1835, estampe 8 cm, BnF Dép. Estampes et photographies, Rés. QB-370 (74)-FT 4, Collection de Vinck ARNAUD, C.-P., Tombeau du maréchal Ney, 1825, dessin, in ARNAUD, C.-P., Recueil de tombeaux des quatre cimetières de Paris avec leurs épitaphes et inscriptions. Tome 2 (1825)
BONIVET, Giraldon, Plan topographique du Cimetière de l’Est dit du Père-Lachaise. Présentant exacte du placement de plus de 1200 Mausolées, tombeaux et monuments funèbres, 1824, carte, 640 x 480 cm, BnF, Dép. Cartes et Plan, GE D-14531 DAUMIER, Honoré. Le Fantôme, 1835, épreuve sur blanc, 27 x 22 cm, BnF, Estampes et Photographie, Rés. Dc-180b (3)-Fol. DAVID D’ANGERS, Pierre-Jean, Armand Carrel, 1839, statue, plâtre et moulage, 215 x 66 x 62 cm, Galerie David d’Angers DAVID D’ANGERS, Pierre-Jean, Le maréchal Ney, 1839, médaille, bronze et fonte, 9,4 x 0,9 cm, Galerie David d’Angers GÉRÔME, Jean-Léon, Le 7 décembre 1815, 1867, Huile sur toile, 65,2 x 104,2 cm, Sheffield, City Art Gallery. Museums Sheffield/ Bridgeman Giraudon GOUBAUD, Louis-Innoncent, The execution of the sentence on Marshall Ney in the garden of the Luxemburg at Paris, 1816, gravure à l’eau forte, 25,8 x 36,5 cm, Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S. K. Brown Military collection MOTTE, Charles, Ney, 1821, lithographie, in JOLIMONT, Théodore (de), Les mausolées français, recueil des tombeaux les plus remarquables érigés dans les nouveaux cimetières de Paris (1821) RAFFET, Denis-Auguste-Marie, Le maréchal Ney à la redoute de Kovno, vers 1840, huile sur bois, 33 x 42 cm, RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / A. Dequier - M. Bard ROQUEPLAN, Camille, La bataille d’Elchingen, 1835, peinture à huile sur toile, 85 x 155 cm, Musée national du château de Versailles et de Trianon
Ouvrages de référence BOURQUELOT, Félix et LOUANDRE, Charles. La littérature française contemporaine, 1827-1844, Paris, Félix Daguin, 1848, 660 p.
129
DALLOZ, Armand et DALLOZ, Désiré. Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, Paris, Bureau de la jurisprudence général, 1853, 766 p. LAROUSSE, Pierre. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, Tome 3, Paris, Administration du grand dictionnaire universel, 1867, 1168 p. LITTRÉ, Émile. Dictionnaire de la langue française, Tome 4, Paris, Éd. Hachette, 1874, 1242 p. MASSON, Joseph-René Masson. Petit dictionnaire de l’académie françoise, Tome 2, Paris, Chez Masson et fils, 1821, 452 p. SIX, Georges. Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire: 1792-1814, Tome 2, Paris, Georges Saffroy, 1934, 588 p.
Monographies CASO, Jacques (de). David D’Angers : l’avenir de la mémoire, Paris, Flammarion, 1988, 223 p. CORBIÈRE, Jacques-Joseph. Souvenir de la Restauration, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 253 p. DÉMIER, Francis. La France de la Restauration (1814-1830). L’impossible retour du passé, Paris, Folio histoire, 2012, 1104 p. FUREIX, Emmanuel. La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Paris, Champ Vallon, 2009, 512 p. FUREIX, Emmanuel et JARRIGE, François. La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle, Paris, Éditions de la Découverte, Coll. Écriture de l’histoire, 2015, 391 p. GRIBAUDI, Maurizio. Paris, ville ouvrière : une histoire occultée (1789-1848), Paris, Découverte, 2014, 400 p. HAINE, W. Scott. The World of the Paris Café. Sociability amoung the French Working Class, 1789- 1914, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1996, 325 p. HALLAYS-Dabot, Victor. Histoire de la censure théâtrale en France, Paris, E. Dentu, 1862, 340 p. HAZAREESINGH, Suhdir. La légende de Napoléon, Paris, Tallandier, 2005, 414 p. HAZAREESINGH, Suhdir. La Saint-Napoléon. Quand le 14 juillet se fêtait le 15 août, Paris, Tallandier, 2007, 294 p. JAKOBOWICZ, Nathalie. 1830. Le peuple de Paris. Révolution et représentations sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 363 p.
130
JOUIN, Henri. David d’Angers et ses relations littéraires, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1890, 365 p. JOURDAN, Annie. Mythes et légendes de Napoléon. Un destin d’exception, entre rêve et réalité, Toulouse, Privat, 2004, 229 p. KRAKOVITCH, Odile. Les pièces de théâtre soumises à la censure (1800-1830), Inventaire, Paris, Archives nationales, 1992, 336 p. MURET, Théodore. L’Histoire par le théâtre 1789-1851. Le gouvernement de 1830, la seconde république, Tome 3, Paris, Amyot, 1865, 444 p. PETITEAU, Nathalie. Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil, 2004, 458 p. SCHEHR, Sébastien. Traîtres et trahisons : de l’antiquité à nos jours, Paris, Berg, 2008, 240 p. SPULLER, Eugène. Conférence faite le dimanche 25 juillet 1886, au grand théâtre de Dijon sur la vie et l’œuvre de François Rude, Dijon, Jacquot, Floret & Cie, 1886, 71 p. TESSIER, Arnaud. Louis-Philippe. Le dernier roi des français, Paris, Perrin, 2010, 450 p. WARESQUIEL, Emmanuel (de) et YVERT, Benoît. Histoire de la Restauration (1814-1830), Paris, Perrin, Coll. Tempus, 2002, 512 p. WELSCHINGER, Henri. Le maréchal Ney, 1815, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1893, 436 p.
Articles de revue et chapitres ABOUT, Edmond About. « Le salon de 1868 », in Revue des Deux Mondes, Tome 75, 1868, 1030 p. ALBERT, Jean-Pierre. « Sens et enjeux du martyre : de la religion à la politique », p. 19, in CENTLIVRES, Pierre (dir.). Saints, sainteté et martyre. La fabrication et l’exemplarité, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2001, 200 p. AYMÈS, Jean-René. « La guerre d’Espagne dans la presse impériale (1808-1814) », Annales historiques de la Révolution française, No. 336, 2004, pp. 129-145.
BERTAUD, Jean-Paul. « Napoléon journaliste : les bulletins de la gloire », Le temps des médias, No. 4, 2005, pp. 10-21. CARON, Jean-Claude. « La Société des Amis du Peuple », Romantisme, 1980, No. 28-29, pp. 169- 179. EVAIN, Brice. « La figure, entre histoire et mémoire. Parcours croisés du marquis de Pontcallec et de Marion du Faouët », Ad Hoc, No. 4, 2015, [En ligne].
131
FOURCAUD, Louis (de). « François Rude », Gazette des Beaux-Arts. Courrier Européen de l’art et de la curiosité, Tome 5, 33e année, 3e période, 1891, 536 p. KALIFA, Dominique. « Que reste-t-il du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, No. 47, 2013, pp. 11-14. SCHMIDT, Charles. « Le fonds de la police générale aux Archives Nationales. Une source de l’histoire contemporaine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Vol.4, No. 5, (1902/03), pp. 313-327.























































































































































!["El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852" in: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2009, [En línea], Puesto en línea](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320e14718429976e4066859/el-sermon-como-instrumento-de-intermediacion-cultural-sermones-del-federalismo.jpg)

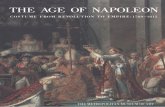
![Ezra Pound e il "canto" del 1815 napoleonico [Ezra Pound and the Napoleonic 1815 Canto]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631afa4a80cc3e9440059dad/ezra-pound-e-il-canto-del-1815-napoleonico-ezra-pound-and-the-napoleonic-1815.jpg)