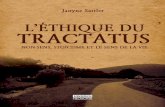Penser l'Autre: L'éthique de la théologie négative
Transcript of Penser l'Autre: L'éthique de la théologie négative
EXTRAIT
REVUE PHILOSOPHIQUE ·DELOUVAIN
FONDEE EN 1894 PAR D. MERCIER
PUBLIEE PAR L'INSTITUT_ SUPERIEUR DE PIDLOSOPHIE
TOME93 Numero3 AOUT 1995
SOMMAIRE
ARTICLES
·Jacob Schmutz. La philosophie de I'ordre d'EricVoegelin
Luce Fontaine-De Visscher. Un debat sur l'humanisme. Heidegger et E. Grassi
Emmanuel Tourpe. Difference ontologique et difference ontotheologique. Introduction a la pensee de Gustav Siewerth. I. ..
Martin Gagnon. Etonnement et interrogation. Essai sur Merleau-Ponty ...
Fabio Ciaramelli. Du ma! radical a· la banalite du mal. Remarques sur Kant et Arendt
ETUDE CRITIQUE
Philipp W. Rosemann. L'ethique de la theologie negative ·
COMPTES RENDUS
Histoire de la philosophie
Ouvrages divers ...
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
CHRONIQUES
Jean-Pierre Deschepper, Pascale Seys. Chronique generale
255-284
285-330
331-369 370-391
392-407
408-427
428-455
455-473
474-486
487A94
REVUE TRIMESTRIELLE PUBLIEE AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE BELGE ET L' AIDE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DELA RECHERCHE DU
MINISTERE DE LA COMMUN A UTE FRAN<;:AISE
LOUVAIN-LA-NEUVE EDITIONS DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE PHILOSOPHIE
La Revue philosophique de Louvain fondee en 1894 par D. Mercier, sous le titre de Revue Neo-Scolastique, est publiee par l'Institut supeneur de Philosophie de l'Universite Catholique de Louvain.
La. revue s'interesse au mouvement philosophique international dans toute son ampleur. _
Organe de recherche et de discussion par ses . articles; organe de documentation et de critique par ses bulletins, ses comptes rendus et ses notices bibliographiques; organe d' information par ses chroniques diverses, la Revue philosophique de Louvain veut etre un instrument de travail aussi silr et aussi complet que possible dans le domaine de la philosophie.
La publication d'un article n'engage pas la responsabilite de la Revue. Les droits de traduction et de reproduction sont reserves.
REDACTION Institut Superieur de Philosophie. - College Thomas More (SH3)
B-1348 Louvain-la-Neuve
Directeur: CLAUDE TROISFONTAINES
Comite de redaction: JACQUES ETIENNE, GHISLAINE FLORIVAL, GILBERT GERARD, MICHEL GRINS, JEAN LADRIERE, JAMES MCEVOY, JACQUES TAMINIAUX, CLAUDE TROISFONTAINES, GEORGES VAN RlET
Secretaire: MICHEL GRINS
Assistant a la redaction: JEAN-PIERRE DESCHEPPER
Les propositions d'articles sont a envoyer au secr6tariat de la redaction en trois exemplaires et sur disquette en systeme Word 5.
Les textes publies dans la Revue sont soumis a divers lecteurs. -La liste de ces lecteurs est donnee dans le demier numero de l' annee en cours ..
ETUDES CRITIQUES
Penser I' Autre: l'ethique de la theologie negative*
La nature de l'homme: transgression de la nature
«L'homme est, selon sa nature propre, transgression de la nature.» 1
Cette phrase, extraite d 'un ouvrage qui entend defendre l 'essence de l'ethique thomiste traditionnelle, ne peut manquer de surprendre. Car peut-on encore fonder l'ethique sur la loi naturelle, comme c'est le but de l'auteur, une fois admis que l'etre culture! de l'homme transcende irreductiblement l'ordre de la nature «brute», OU biologique? Assurement, a condition que la nature de I 'homme soit definie en sorte qu 'elle n' exclue point, mais englobe ce qui apparemment I' oppose, c'est-a-dire la culture, ou la raison. Admettons qu'une telle interpretation plus large de la notion de nature rend la «lecture» de la loi naturelle plus difficile et plus complexe; mais celle-ci devient aussi plus appropriee a l'etre humain.
Du Deus absconditus a /'homo absconditus
Cependant, que deviendrait la loi naturelle si l'homme n'etait pas seulement «transgression» de la nature, mais si la «nature» la plus profonde de l'homme etait de ne pas avoir de nature, d'essence et de definition? En fait, cette hypothese est moins absurde qu 'elle ne parai1: a premiere vue. Elle est l'aboutissement logique d'une certaine tradition de penser Dieu comme l' «absolument Autre», tradition qu'on a qualifiee de theologie «negative», ou «apophatique». Si, dans l'optique de l'apophasis, Dieu ne ressortit pas a l'etre, se trouvant, par contre, au-dessus de toute determination positive, alors la creation, elle aussi, doit porter l'empreinte du non-etre; elle est «essentiellement» rien - rien de ce
* Reflexions a partir de Paul MOYAERT, Ethiek en sublimatie. Over «De ethiek van de psychoanalyse» van Jacques Lacan. Un vol. 22 x 14 de 228 pp. Nimegue, SUN, 1994. Prix: 34.50 fl./690 BF.
1 A. LEONARD, Le fondement de la morale.Essaid' ethique philosophique generale (coll. «Recherches morales-Syntheses», 15). Paris, Cerf, 1991, p. 257. Sur ce livre, cfr notre etude critique in Revue philosophique de Louvain, 91 (1993), pp. 126-136.
L 'ethique de la theologie negative 409
qui releverait de l'etre, rien d'etant. Car elle est le moyen de Dieu de se reveler; or cette «theophanie» devoile et rend present ce qui est fondamentalement cache et absent. L'etre de la creation s'eleve comme presence sur fond d'absence. Reconnaitre et assumer cette empreinte du non-etre divin, c'est, pour l'homme, accepter qu'il ne saurait parvenir a aucune connaissance positive quant a sa nature propre - une conclusion explicitement tiree par Jean Scot Erigene, un des plus grands representants de la theologie negative au moyen age latin: «!;esprit humain se connait, et ii ne se connait pas. En effet, ii sait qu'il est, mais ii ne sait pas ce qu'il est. Et c'est par Ia, comme nous l'avons enseigne dans les livres precedents, qu'on peut le mieux montrer que !'image de Dieu est en l'homme»2• Ernst Cassirer a bien saisi cette liaison entre la theologie et l'anthropologie negatives: «La religion, ecrit-il dans son Essay on Man, n'eclaircit jamais le mystere de l'homme. Elle confirme et approfondit ce mystere. Le Dieu dont elle parle est un Deus absconditus, un Dieu cache. Des lors, meme son image, c'est-a-dire l'homme, ne peut etre que mysterieux. L'homme aussi reste un homo absconditus.» 3
L 'anthropologie negative et la transvaluation de la loi nature lie
Comme la theologie apophatique4, l'anthropologie negative a savoir, la conviction que l'homme n'a pas d'essence connaissable - joue un role considerable dans la reflexion philosophique d'aujourd'hui. Que les penseurs contemporains y arrivent souvent par des voies fort differentes de celles qui y avaient conduit la tradition apophatique medievale, cela ne fait guere de doute. En schematisant, on pourrait dire que pour l 'apophasis medievale, l 'homme etait essentiellement inconnaissable
2 «Humana siquidem mens et seipsam novit, et seipsam non novit. Novit quidam quia est, non autem novit quid est. Ac per hoc, ut in prioribus libris docuimus, maxime imago Dei esse in homine docetur» (Periphyseon, livre IV, P.L. I22, col. 771B). Pour la source de cette idee, voir S. GREGOIRE DE NYSSE, De hominis opificio I I, 3-4; P.G. 44, col. I56B.
3 «Religion, therefore, never clarifies the mystery of man. It confirms and deepens this mystery. The God of whom it speaks is a Deus absconditus, a hidden God. Hence even his image, man, cannot be other than mysterious. Man also remains a homo absconditus» (An Essay on Man. New Haven/Londres, Yale University Press, I944, p. I2). Cfr aussi J. SAWARD, Towards an Apophatic Anthropology, in Irish Theological Quarterly, 4I (1974), pp. 222-234.
4 Voir, par exemple, I.N. BULHOF/L. TEN KATE (eds), Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie. Kampen, Kok Agora, I992. Ce livre contient des contributions sur la question de la theologie negative chez S. Thomas d'Aquin, J.-L. Marion, Derrida, Bakhtine, Bataille, Nietzsche, Foucault et Adorno.
410 Philipp W. Rosemann
puisqu'il faisait partie de la nature creee, son etre «Sur fond de non-etre» etant en continuite avec la structure ontologique du cosmos. En revanche, poUr l'anthropologie negative clans la pensee contemporaine, l'homme ne sait rien de ce qu'il est, puisqu'il ne fait pas partie de la nature, puisque son etre «Culture!» le Coupe irremediablement de l'immediatete de la nature. L'homme est «culturel» au point que la notion meme de l'homme moderne est la propre «invention» de l'homme lui-meme; or etant donne la finitude historique d'une telle «invention» culturelle, non seulement il n'y a point d' «essence» humaine, mais l'homme meme, comme nous le connaissons, s 'effacera un jour, «comme a la lllnite de la mer un visage de sable» - c 'est la these celebre de Michel Foucault5• C'est dans la meme ligne que Jacques Lacan affirme que le sens et la signification humains - autrement dit, la culture - sont crees «ex nihilo», par !'introduction de differenciations dans le continuum de l'etre «naturel» moyennant les oppositions binaires du langage6. La signification n'ayant aucun fondement hors de ces oppositions, elle se definit de f~on exclusivement negative: tel signe est tel signe parce qu'il n'est pas tel autre; je suis Paul parce que je ne suis pas Pierre.
Quoi qu'il en soit de ces differences entre l'homo absconditus d'un Scot Erigene d'une part et d'un Jacques Lacan d'autre part, leurs conceptions «apophatiques» de l'etre humain debouchent sur la meme consequence: la loi naturelle se trouve subvertie par une negation de la nature au cceur de leurs systemes. La nature, semble-t-il, ne saurait desormais plus guider le cours du desir humain, ni comme son moteur ni comme sa norme .. : a moins qu'on n'etende encore une fois la notion de nature, pour y inclure, non pas seulement la transgression de la nature qu'est la culture, mais aussi l'absence de nature qu'est le neant7. Fonder l'ethique,
5 Les mots et les choses .. Paris, Gallimard, 1966, p. 398. 6 Sur la creation ex nihilo de la signification, voir surtout Sem. VII, ixe seance. Mal
gre cette these de la creation ex nihilo de la culture humaine, on n'est pas fonde a pretendre qu'il y ait, selon Lacan, une brusque «rupture entre nature et culture» (Moyaert, p. 33: «breuk tussen natuur en cultuur» ). De tels dualismes irreductibles sont etrangers a la pensee lacanienne. En effet, il n'y a aucune discontinuite absolue entre la nature (au sens de nature non humaine) et la culture, parce que c'est la nature elle-meme qui contient deja en germe la fonction symbolique comme fondement de la culture: «La fonction symbolique n'est pas nouvelle en tant que fonction, elle a des amorces ailleurs que dans l'ordre humain, mais il ne s'agit que d'amorces. L'ordre humain se caracterise par ceci, que la fonction symbolique intervient a tousles moments et a tousles degres de son existence» (Sem. II, p. 41).
7 En comprenant le terme de «nature» comme embrassant egalement «Ce qui est et ce qui n'est pas (ea quae sunt et ea quae non sunt)» nous ne suivons pas notre caprice, mais Jean Scot Erigene, qui enonce cette these au debut du Periphyseon (livre I, 441A; ed. Sheldon-Williams).
L 'ethique de la theologie negative 411
non plus sur un donne positif de l'etre, mais sur son absence, est-ce possible? Nous allons voir ou nous mene une telle «transvaluation» de la loi naturelle, en nous inspirant des remarquables reflexions sur l 'ethique lacanienne que Paul Moyaert vient de publier sous le titre Ethiek en sublimatie. Over «De ethiek van de psychoanalyse» van Jacques Lacan8•
Desirer quelque chose a cause de rien
II est vrai, meme empiriquement, qu'il ya dans le dtSsir humain quelque chose d'obscur et d'opaque, qui se soustrait a etre eclaire par la lumiere de la raison - quelque chose d'indefinissable, denue de forme concrete. Prenons seulement, avec P. Moyaert, l'exemple de !'amour (cfr pp. 152-157). Si quelqu'un que j'aime me demande: «Pourquoi m'aimes-tu?», je peux bien repondre que c'est (disons) a cause de son charme, de ses idees interessantes et de son beau physique. Cette reponse est peut-etre meme vraisemblable; de toute fa~on, elle donnera sans aucun doute plus de satisfaction a mon ami qu'un vague «je t'aime parce que tu es toi», voire que le tautologique «je t'aime parce que c'est comme ~a». II n'en reste pas mains que le langage comporte une «negation symbolique du sujet individuel» (p. 61); autrement dit, en lui appliquant des concepts universaux comme «intelligent» ou «beam>, le langage ne peut que nier ce qui est irreductiblement individuel dans la personne aimee. Celle-ci devient des lors comme si elle etait echangeable, c'est-a-dire comme si .elle faisait partie de I' «economie ordinaire de l'etre» (p. 27). C'est pourquoi vouloir trop expliquer I' amour est aussi blessant que de ne pas l'expliquer assez ... Qui plus est, l'essai d'une rationalisation complete de l 'amour implique une meconnaissance de son caractere fondamentalement opaque. Les raisons pour lesquelles une personne donnee et pas une autre a arrete le cercle d'echanges symboliques m'echappent enderniere analyse. Elles restent inconscientes:
«Le desir 'inconscient' est pour ainsi dire un nom generique pour tous les buts des aspirations et pour toutes les attitudes humaines qui ne peuvent plus etre reduits dans le cadre d'une economie ordinaire de l'etre» (pp. 26 sq.)9.
8 La presente etude critique continue im projet de repenser la psychanalyse lacanienne dans le cadre de la theologie negative que nous avons commence dans un article ecrit en collaboration avec Steve LoFrs, «Ai-je besoin ici d'evoquer les neo-platoniciens?», in S.G. LoFrs/P. MoYAERT (eds), La pensee de Jacques Lacan. Questions historiques-Problemes theoriques (coll. «Bibliotheque philosophique de Louvain», 39). Louvain-la-Neuve, Editions de l'Institut superieur de philosophie; Louvain/Paris, Peeters, 1994, pp. 107-124.
9 C'est nous qui avons traduit toutes Jes citations de l'ouvrage de P. Moyaert dans le present article.
412 Philipp W. Rosemann
Or, ce n'est pas seulement que j'aime quelqu'un finalement a cause de «rien» (rien qui puisse etre nomme, rien de clair); l'amour risque aussi toujours de devenir absolu et demesure, voire obsessionnel. L'amour a tendance a outrepasser les limites du «raisonnable», precisement parce qu'il est ab-solu de la chaine signifiante de l'ordre symbolique dans laquelle un signe peut, de principe, toujours etre remplace par un autre (cfr p. 28). De la sorte, une personne (ou une chose) peut devenir l'objet d'un desir qui doit paraitre «foll», ne se souciant plus des consequences de son adherence inconditionnelle a son but absolu. C'est d'ailleurs cette tendance vers le demesure - une tendance qui ne recule meme pas devant l'autodestruction du sujet- que Freud a decrite sous le terme de «principe du plaisir». On se meprend profondement en reduisant ce principe a quelque instinct egocentrique. Tout au contraire, le principe du plaisir enonce l'hypothese qu'en poursuivant sa satisfaction, le desir humain ne respecte pas de lui-meme les besoins du sujet (cfr pp. 90-98).
D'apres Lacan, tout desir humain doit etre analyse a l'instar de l'amour. Au cc:eur de tout ce que l'homme veut, fait, pense, il n'y a pas la clarte de la raison, mais une «opacite sa.ns fcmd» (p. 104); aussi bien que le desir naft du <<neant» de l'homme, il ne vise «rien», et non pas quelque bi en OU perfection qui pourrait etre Saisi dans les term es positif S de l'etre. C'est pourquoi le desir n'estjamais a l'abri du danger pose par des exces: exces de passion, de fanatisme, de violence, etc. Car l 'homme est l'etre qui <<fait et desire quelque chose a cause de rien» (p. 180). Dans toute sa vie, l 'homme cherche dans les ob jets qui l 'attirent quelque chose - das Ding, comme dit Lacau - qui depasse ces memes objets, n' appartenant pas a 1' ordre symbolique. Le desir circule autour d'un point dont on ne sait rien, sauf qu'il est sa condition de possibilite: «Le Ding( ... ), c'est ce autour de quoi s'oriente tout le cheminement du sujet» (Sem. VII, p. 65).
La, dialectique de das Ding et de l 'ordre symbolique. La Loi
Or, qu'est-ce qui empeche que ce point ne devienne un trou noir, qui, en exen;;ant une force attirante irresistible, engloutit 1' etre humain et l'aneantit? En outre, si le rien est pour ainsi dire la «loi naturelle» du desir, comment en tirer quelque enseignement positif sur la loi morale? Devant ces difficultes, une veritable «ethique» de l'anthropologie negative semble inconcevable. Et Lacan lui-meme ne fait-il pas la preuve de cette impasse quand il pose, comme principe principal de
L 'ethique de la thiologie negative 413
l'ethique, que «la seule chose dont on puisse etre coupable, c'est d'avoir cede sur son desir» (Sem. VIl, p. 370)10? N'oublions pas que ce desir est au fond desir de rien !
Une breve digression historique pourrait s'averer utile ici. La theologie negative, dont nous avons parle au debut de cet article, doit toujours etre pensee dans ses rapports dialectiques avec la theologie «affirmative». Le «neant» de Dieu, qui figure chez tous les grands auteurs de la tradition apophatique11 , est le correlatif polaire de son etre dans et par la creation. En dehors de cette polarite, ni l'etre ni sa negation n'aurait de sens12• Nous avons dit de la creation qu'elle constitue (ajoutons, pour etre precis: a travers la Trinite) la «theophanie» de Dieu, son moyen de se reveler ou de devenir «etant». Toutefois, !'absence ou la transcendance du Biett- cache n'est nullement plus primordiale que la presence ou !'immanence de Dieu dans la creation. A la verite, la «theophanie» ne devoile le secret de Hiett qu'en creant, en un sens, ce meme secret. Dieu n'est un Deus absconditus que par opposition au Deus revelatus de la creation. L'etre cree le neant de Hiett, puisqu'en meme temps que Dieu apparai1: dans l'etre, ce dernier fonctionne comme le voile de Hiett ... L' opposition entre Dieu et Hiett, ou entre l 'etre et le neant, n 'existerait pas si un Dieu, un ... , qui transcende absolument les oppositions binaires de notre pensee, ne s'etait pas revele en s'alienant de lui-meme13• En definitive, ce ... n'est ni Dieu ni Hiett, mais 6n:£p0wc;14, Plus-que-Dieu - voila la conclusion la plus radicale a laquelle nous amene la dialectique des deux theologies, affirmative et negative. Le 6n:£p0wc; est la coiilcidence de tousles opposes15•
Que nous apporte cette reflexion pour notre comprehension de l'ethique lacanienne? Eh bien, de meme que dans la theologie negative Biett et Dieu doivent etre penses ensemble, ainsi dans le systeme
10 C'est ce que P. Moyaert denomme «la Joi de la jouissance» («de wet van het genot»; p. 127).
11 Voir, par exemple, JEAN SCOT ERIGENE, Periphyseon, livre II, 589B (ed. Sheldon-Williams): «Quomodo igitur diunina natura se ipsam potest intelligere quid sit cum nihil sit?»
12 Ace sujet, voir Jes lucides explications de D. CARABINE, «Apophasis » and Metaphysics in the «Periphyseon» of John Scottus Eriugena, in Philosophical Studies (Dublin), 32 (1988-90), pp. 63-82.
13 Pour cette problematique, voir !'article cite a la note 8 ci-dessus, surtout p. 113. 14 Periphyseon, livre I, 460A. 15 Cfr ibid., 517C (ed. Sheldon-Williams): «Haec enim omnia pulchra ineffabilique
armonia in unam concordiam colligit atque componit. Nam quae in partibus uniuersitatis opposita sibimet uidentur atque contraria et a se inuicem dissona, dum in generalissima ipsius uniuersitatis armonia considerantur conuenientia consonaque sunt. »
414 Philipp W. Rosemann
de Lacan le rien qu'est das Ding ne se comprend point sans son enchevetrement avec l' ordre symbolique, qui peut seul expliquer les formes que prend le desir humain dans et par sa poussee vers le demesure et ab-solu. La dialectique de das Ding et de l'ordre symbolique est suspendue a «la Loi», dont Lacan ecrit dans son seminaire sur L'ithique de la psychanalyse:
«( ... ) je n'ai eu connaissance de la Chose [c'est-a-dire, de das Ding] que par la Loi. En effet, je n'aurais pas eu l'idee de la convoiter si la Loi n'avait dit - Tune la convoiteras pas. Mais la Chose trouvant I' occasion produit en moi toutes sortes de convoitises grace au commandement, car sans la Loi la Chose est morte» (Sem. VII, p. 101).
Si la Chose fonctionne' comme le dernier moteur du desir humain et rend compte de la possibilite d'une adherence absolue (comme dans l'amour inconditionnel), elle n'est pourtant elle-meme que l'effet de l'interdit primaire: «Tu ne possederas pas la Chose». L'interdit primaire, c'est-a-dire la Loi, etablit, comme P. Moyaert l'explique bien (cfr pp. 99-105), une distinction entre les regnes du sacre et du profane, laquelle differenciation constitue la «premiere» opposition binaire qui est a l'origine de toute signification humaine: «J'ajoute, das Ding en tant que le correlatif meme de la loi de la parole dans son origine la plus primitive, ( .•. ) c' est la premiere chose qui a pu se separer de tout ce que le sujet a commence de nommer et d'articuler» (Sem. VII, p. 100). Des lors, la distinction primordiale entre ce.qui peut et ne peut etre <lit, atteint, possede; entre ce qui circule et ne circule pas dans le cercle d'echanges economiques; entre ce qui' a et ce qui n'a pas de «sens» dans l'ordre symbolique, constitue la base sur laquelle le monde humain de signification repose tout entier. En d'autres mots, le sens (l'ordre symbolique) est toujours soutenu par le «non-sens», ou plutot le «hors-de-sens», de cet «hors-signifie» (Sem. VII, p. 67) qu'est das Ding. - Et qui edicte cette cruciale distinction entre le sens et le non-sens? D'ou vient la Loi? C'est comme poser la question de savoir pourquoi le fm£p9coc; s'est revele. C'est comme 9a parce que c 'est comme 9a.
La Loi comme origine de la loi morale
«L'ethique commence par une sujetion a une Loi (un interdit) que la raison ne peut fonder. C'est pourquoi l'ethique n'est pas possible sans un appel a des categories religieuses» (p. 145).
L 'ethique de la theologie negative 415
Si la Loi n'est pas deraisonnable (au vrai, elle est encore plus «horssignifiee» que das Ding), elle est certes foncierement au-dessus de toute possibilite d'etre justifiee par la raison. II n'en reste pas moins qu'elle est la condition necessaire de toute vie proprement humaine, c'est-a-dire culturelle. Sans la distance qu'elle produit entre le sujet et l'ordre sacre de das Ding, ii n'y aurait que l'indifferenciation de la «nature» au sens biologique. Le monde en tant que monde humain, et done aussi I 'homme lui-meme, n'existeraient pas.
La loi morale derive de cette Loi surrationnelle, sans pour autant pouvoir en etre deduite comme une conclusion logique. La loi morale traduit dans les termes d'un ordre symbolique historiquement et culturellement contingent, la necessite absolue et an-historique de la Loi de distance (cfr p. 125)16• Maintenir cette distance, c'est-a-dire mediatiser entre l'absolu du sacre et l'ordre profane d'echanges symboliques -voila comme on pourrait, en un premier temps, definir la tache qui est propre a I' ethique:
«L'ethique n'est pas possible sans un lien avec l'absolu, avec ce qui est de l 'ordre du sacral. Seulement si nous nous apercevons de cela, comprendrons-nous pourquoi l'ethique est si complexe et pourquoi l'ethique consiste dans I' effectuation d 'un geste assez paradoxal: l 'ethique, c 'est mettre dans un contexte de signification ce qui ne se laisse pas integrer dans un cadre; c'est comparer ce qui ne peut etre compare; c'est se detacher de ce qu 'on ne peut et ne veut pas Iiicher; c 'est remplacer ce qui ne saurait etre remplace; c'est lier a des signifiants ce qui n'est lie a rien» (pp. 150 sq.).
A vrai dire, I' ethique, comme la decrit ici notre auteur, revet une double face. Elle est fondee sur le desir de das Ding, mais ce desir doit etre canalise dans l'ordre symbolique du «service des biens» pour ne pas franchir les limites de la Loi. Le moyen de cette canalisation est !'interpretation de la Loi par la loi morale. Pour elucider comment ce processus d'interpretation pourrait etre corn;:u, P. Moyaert use d'une allegorie. Imaginons-nous que la Loi soit comme un oracle (cfr pp. 119-125). Un oracle est constitue de ce qu'on pourrait appeler des «lettres inertes» (p. 123), c'est-a-dire des signifiants qui ne signifient plus rien. Des lors, l' oracle est d 'un certain point de vue totalement opaque: il ne nous dit litteralement rien. Le paradoxe, pourtant, est que cette opacite n 'est pas
16 La distinction rigoureuse entre la Loi en tant qu'origine de toute signification humaine («de wet») et les formes historiques que cette Loi prend dans des lois morales contingentes ( «zedenwet») ne se trouve pas telle quelle chez P. Moyaert, encore qu'elle semble etre impliquee dans la logique de sa demarche.
416 Philipp W. Rosemann
due au fait que la formule de l'oracle serait extremement «dense»: elle est, d'une certaine maniere, parfaitement claire, et ceci au point meme d'etre «obscene». La lettre de !'oracle coincide totalement avec ellememe. C'est le caractere tautologique qui produit le secret de l'oracle, un secret qui consiste precisement en ceci, que rien n 'y reste cache.
La Loi, affirme l'auteur d'Ethiek en sublimatie, peut etre comparee a un tel oracle. En emettant comme son seul precepte: «Tu ne convoiteras pas la Chose» ou «Maintiens la distance», elle enonce tout ce sur quoi se fonde l'ethique, sans pour autant n'en dire rien de precis. Ou est la limite entre mon plaisir legitime et la jouissance qui me place hors de la Loi? De surcrol:t, pourquoi ne faut-il pas franchir cette limite? Mais en mettant en question la Loi comme principe du sens humain, j'ai pose une question qui n'a pas de sens.
M. Borch-Jacobsen a tres justement fait observer que la Loi lacanienne releve d'une ontologie negative17• En prescrivant la distance entre le sujet et le rien de son desir, elle erige la non-identification ou la differenciation entre l'etre et le neant en Loi universelle et necessaire, de la meme favon que le unsp9so~ erigenien cree, en se revelant, la distinction entre Dieu et 9iet.t. En plus, de par son opacite obscene, la Loi est apparentee a la coincidence des opposes qui caracrerise le Plus-que-Dieu.
Mais le probleme qui nous occupe a present est de savoir comment la Loi peut se monnayer en une loi morale particuliere qui soit effectivement en mesure de guider le cours du desir humain. Suivant encore l'allegorie de l'oracle, le seul moyen pour dechiffrer la formule cryptique est d'essayer d'integrer ses lettres inertes dans l'ordre symbolique du langage OU regne la loi de l'echange et done de !'interpretation. Cette integration n'est pas chose impossible, etant donne la communaute de nature qui unit les signifiants de l' ordre symbolique et les lettres de l'oracle qui sont, pour ainsi dire, des signifiants «in nucleo» (p. 126). 11 faut seulement tenter de provoquer Pythia (ou quel que soit le nom de l'origine de l'oracle) a reveler des indications qui puissent servir a trouver le mot de l' enigme. Ou, dans un langage moins pa!en, il faut chercher a decouvrir le sens de l'oracle divin dans un dialogue avec Dieu dans la priere. 11 reste neanmoins que Dieu ne se laisse jamais definiti-
17 Voir M. BoRCH-JACOBSEN, Lacan. Le maftre absolu (coll. «Critiques»). Paris, Flammarion, 1990, p. 267. Sur la parente structurale de la pensee lacanienne et de l'ontologie/theologie negative, cfr aussi Ph. LACOUE-LABARTHE/ J.-L. NANCY, Le titre de la lettre. Une lecture de Lacan (coll. «La philosophie en effet» ). Paris, Galilee, 1990, p. 167, ainsi que I' article cite a la note 8 ci-dessus.
L'ethique de la theologie negative 417
vement reduire a aucune de nos interpretations de sa volonte. C'est-adire, si l'opacite obsc~ne de la Loi peut etre differee par nos interpretations - si le langage peut «eclaircir le desir de Dieu en l'obscurcissant» (p. 144) -, elle n'en saurait jamais etre eliminee. Les tentatives humaines pour determiner la loi morale tournent autour d'une Loi transcendantale, qui, elle, se derobe a toute definition fixee de maniere qu'il n'y ait plus jamais a revenir sur les lettres inertes. En effet, celles-ci menacent toujours de revenir et de bloquer de la sorte le processus d'interpretation en le renvoyant a son fondement sans fond: «C'est comme ~a parce que c 'est comme ~a».
Il faut bien comprendre le sens de l'affirmation qu'il n'est pas d'interpretation definitive de la Loi, ou encore que «la loi morale traduit dans les termes d'un ordre symbolique historiquement et culturellement contingent, la necessite absolue et an-historique de la Loi» (voir p. 415 ci-dessus). Par fa, on n'entend point insinuer que la loi morale soit arbitraire, quoiqu'il soit indeniable qu'elle prend des formes concretes qui sont sujettes a de multiples variations historiques, culturelles, etc. Cependant, ces formes contingentes participent toujours de la necessite de la Loi, au sens que la loi morale se constitue dans l' ordre symbolique ou dans un ordre symbolique, sans que les individus ou meme la communaute vivant a l'interieur de cet ordre soient en mesure d 'operer le moindre choix quant a la maniere dont l'ordre symbolique/moral structure leur vie. Pour cela, ii faudrait pouvoir le regarder comme de l'exterieur. Mais «si la fonction symbolique fonctionne, nous sommes a l'interieur. Et je dirai plus - nous sommes tellement a l'interieur que nous ne pouvons en sortir» (Sem. II, p. 43). L'ordre symbolique et, avec lui, la loi morale sont contingents tout en etant necessaires, comme le formule P. Moyaert (p. 39 et cfr Sem. II, p. 46). Ajoutons encore que, si la loi morale se meut autour de la Loi, elle se meut tout de meme autour de la Loi. Les variations subies par la loi ne sont pas sans limite18•
18 A ce sujet, on pourra lire Jes remarques d'A. LEONARD, Le fondement de la morale (voir note 1), pp. 265-274: «Universalite et immutabilite de la Joi morale». Mgr Leonard, qui part du principe que «la nature humaine inclut l'historicite culturelle» (p. 265), ne nie pas «!'incontestable variete des regles morales que nous reve!ent, dans le temps, l'histoire des civilisations et, dans l'espace, l'anthropologie culturelle comparee» (p. 269). Mais ii maintient qu'il ya, dans cette variete, un noyau an-historique. C'est ce que Lacan appellerait la Loi.
418 Philipp W. Rosemann
Loi de la jouissance et loi morale
Le rien de la Chose, que nous avons provisoirement qualifie de «loi naturelle du desir» est soutenu par la Loi. Or cette derniere se manifeste empiriquement sous la forme de la loi morale. La Loi, en ce sens, suscite un desir ou un elan vers l'informe et le demesure, un desir auquel, en meme temps, elle impose la forme et la mesure de la loi morale. L'ethique commence par la Loi, a la fois parce que celle-ci est la condition de possibilite du desir (qui est foncierement desir de rien), et parce qu'elle conrere ace desir la forme de la loi morale qui le fait etre un desir (c'est-a-dire un desir de quelque chose, qui ne perit pas aussitot qu'il est ne). L'ethique comporte, des lors, et la loi de lajouissance («Ne cede pas sur ton desir! Jouis ! ») et la loi morale. Comme Lacan lui-meme l'ecrit au sujet des principes du plaisir et de realite, «l'un n'est pas seulement, comme on le croit d'abord, l'application de la suite de l' autre, chacun est vraiment le correlatif polaire de l' autre, sans lequel ni l'un ni l'autre n'aurait de sens» (Sem. VII, p. 91). S'il est encore possible de parler d'une «nature» de l'homme lorsque cette nature consiste au fond dans l'absence de nature - si l' «etre» de l'homme se realise dans la formation culturelle du rien de son desir, et dans l 'engendrement du rien de son desir par la culture -, al ors la «loi naturelle» ne peut s'articuler adequatement que dans le cadre forme a la fois par la loi de la jouissance et la loi morale.
Le heros et l'«homme du commun»
On va peut-etre nous objecter - et on pourrait faire le meme reproche a l' auteur dont nous nous inspirons en ecrivant ces lignes -que nous sommes en train de proposer une interpretation «bourgeoise» de l'ethique lacanienne. Apres tout, qu'en est-il de la «revision ethique» que le psychanalyste parisien reclame en posant «Cette question avec Sa valeur de Jugement dernier -Avez-vous agi conformement au desir qui vous habite? » (Sem. VII, p. 362). Sans doute avons-nous aussi oublie tousles sarcasmes de Lacan lorsqu'il vitupere l' «ethique traditionnelle» du «service des biens»: «Continuons a travailler, et pour le desir, vous repasserez» (ibid., p. 367). 11 semble egalement evident que le seminaire VII sur L'ethique de la psychanalyse abonde en eloges sur l'hero'isme de ceux qui cherchent leur desir «par quelque franchissement de la limite, benefique» (ibid., p. 357), tandis que le «puritanisme» de l' «homme du
L'hhique de la thiologie negative 419
commun» s'y trouve fortement censure et repudie. -Admettons qu'il y a des pages dans L 'ethique de la psychanalyse qui pourraient nourrir !'impression d'un enseignement peu dialectique en ce qui concerne les questions de l' ethique. Et pourtant, dans la derniere seance dudit seminaire, Lacan clarifie sa position:
«J'ai oppose la demiere fois le heros a l'homme du Commun, et quelqu'un s'en est offense.Jene les distingue pas comme deux especes humaines -en chacun de nous, il y a la voie tracee pour un heros, et c 'est justement comme homme du commun qu'il I'accomplit. Les champs que je vous ai traces la demiere fois - le cercle inteme que j'ai appele du nom de l'etrepour-la-mort, dans le milieu les desirs, le renoncement a l'entree du cercle exteme - ne s 'opposent pas au triple champ de la haine, de la culpabilite et de la crainte comme a ce qui serait, ici, l'homme du commun, et, ici, le heros. Ce n'est pas \:a du tout» (pp. 368 sq.).
Le heros et l'homme du commun ne sont pas des opposes irreconciliables, car l 'heroi"sme ne consiste pas necessairement a ne jamais trahir son desir, a le poursuivre jusqu'au bout, ce qui est !'horrible de l'aneantissement du sujet19. Tout sujet trahit parfois «Sa voie, se trahit luimeme» (Sem. VII, p. 370), puisque c'est necessaire pour vivre. La repression du desir est une <<felix culpa» (ibid., p. 14), au sens oii la culture lui doit son existence. Mais a la difference de l 'homme qui est oublieux de la verite de son desir, le heros s'efforce de ne jamais perdre de vue la Chose qui est au centre de tout ce qui l'occupe: il est «aui-6yvorcoc;», comme la tragectie de Sophocle le dit d'Antigone, «connaissant de soi» (ibid., p. 318). C'est en raison de cette connaissance de soi - de cette connaissance du rien autour duquel se cristallise son etre, de cette nonconnaissance20 - que le sujet heroi"que «peut impunement etre trahi» (ibid., p. 370) - impunement, sans dommage pour soi, puisqu 'il retrouvera toujours ce qui l'oriente dans son existence. Et puisqu'il ne se laisse pas absorber par les choses de son agir quotidien, le heros est toujours un peu entete dans son agir, se refusant a la «voie ordinaire» (ibid.): c'est cela aussi que le mot grec «aui-6yvonoc;» veut dire.
19 Rappelons que selon Heidegger, chez qui Lacan a puise bien des idees centrales de sa pensee, l'authenticite ne saurait etre coni;ue que sur fond d'inauthenticite: «Umgekehrt ist die eigentliche Existenz nichts, was tiber der verfallenden Alltiiglichkeit schwebt, sondern existenzial nur ein modifiziertes Ergreifen .dieser» (Sein und Zeit, § 38, p. 179 [15• ed. de 1979]). II nous semble que c'est exactement la position de Lacan au sujet de I' «heroisme».
20 P. Moyaert souligne tres justement cette dimension du non-savoir qui accompagne l'acte hero"ique (cfr pp. 183-185).
420 Philipp W. Rosemann
Sans doute pourrait-on resumer le sens de l'ethique lacanienne en disant qu'une vie Mro'ique - celle du Mros qui se trahit parfois, celle du heros veritablement humain - ne requiert pas uniquement le pas audela qui transgresse la rationalite de la morale ordinaire, mais egalement le pas en arriere, qui reinscrit le Mros dans cette morale21• La pudeur ( «Ulbffi<;») devant la barriere qui separe le sujet de la jouissance n'est pas absente de l'ethique lacanienne (cfr Sem. VII, p. 345; voir egalement pp. 90 et 206 dans l'ouvrage de P. Moyaert). C'est parce que le heros est pret a affronter son desir, qui, absolu, ne se laisse pas confiner dans la loi morale, qu 'il peut donner a cette demiere une direction et une orientation nouvelles. Le Mros, c 'est celui qui sait maintenir la transcendance du desir absolu dans !'immanence du «Service des biens». C'est celui qui fait face a l'ambigu'ite tragique de la Loi, laquelle suscite le desir pour la Chose tout en y barrant l'acces. C'est celui, somme toute, qui obeit pleinement a la «loi naturelle» constituee, comme nous l'avons dit, par !'implication mutuelle de la loi de la jouissance et de la loi morale.
Le probleme de la mystique
La pensee de Jacques Lacan, avec la Loi en son centre, presente d'importants paralleles avec la tradition de la theologie negative -nous l'avons deja fait observer plusieurs fois au cours du present article. Or, de meme que l' «hero'isme», dont nous avons tente de preciser le sens, est l'ideal ethique de la psychanalyse et ce a quoi !'analyse veritable, c'est-a-dire l'analyse didactique, veut conduire le sujet22, ainsi l' apophasis trouve son cote pratique dans la mystique sur laquelle elle debouche naturellement. Car si la theologie positive peut se contenter de la connaissance de Dieu a laquelle elle croit parvenir a travers la contemplation de ses traces dans la creation, la theologie apophatique est forcee de suivre une voie surnaturelle pour s'assurer qu'il y a quelque chose d'experimentable derriere les abstractions extremes que sont 9iett et le l>n:Ep8co<;.
21 Sur la notion de cette «reinscription transgressive», on lira le brillant ouvrage de J. DOLLIMORE, Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault. Oxford, Clarendon Press, 1991.
22 «Je pose la question - la terminaison de !'analyse, la veritable, j'entends celle qui prepare a devenir analyste, ne doit-elle pas a son terme affronter celui qui la subit a la realite de la condition humaine?» (Sem. VII, p. 351).
L'ethique de la theologie negative 421
Etrange paradoxe ! Le theologien de la voie negative, qui ne cesse d'insister sur l'absolue inconnaissabilite de Dieu, se met en route pour Le rencontrer ... 23
Comme le Mros lacanien, le mystique doit, pour penetrer jusqu'au fond de son desir, faire le pas au-defa de la Loi, qui est, dans son essence, Loi de distance. La mystique est impossible sans cette transgression24• Ceci reste vrai, meme si le mystique authentiquement chretien s'evertue a accomplir le pas au-defa en faisant plus que la loi ne lui demande, c'est-a-dire en depassant ses exigences, fa ou le mystique qui ne respecte pas I' enseignement evangelique les viole25 . Cependant, son comportement particulier par rapport a la Loi et aux lois ne peut qu'ecarter le mystique de la voie ordinaire de sa communaute, le rendre «ai':n:6yvo:rrni;» au sens de l'entetement. On comprend des lors aisement pourquoi la pratique mystique, avec ses connotations de transgression et d'individualisme, n'ait jamais cesse de paraitre suspecte aux yeux des autorites ecclesiastiques; si bien
23 Sur !es liens entre la theologie negative et la mystique, cfr D. CARABINE, «Apophasis» East and West, in Recherches de Theologie ancienne et medievale, 55 (1988), pp. 5-29, surtout pp. 18 sq.
24 Que la theologie negative et la mystique soient intimement liees a un mouvement transgressif, c'est ce qui ressort, par exemple, des la premiere page de cet admirable renouvellement de l'apophasis qu'est Dieu sans l'etre de Jean-Luc Marion. L'ouvrage commence, en fait, comme suit: «II faudrait enfin avouer que la theologie, de toutes !es ecritures, cause sans doute le plus grand plaisir. Justement pas le plaisir du texte, mais le plaisir - a moins qu'il ne s'agisse d'une joie - de le transgresser: des verba au Verbe, du Verbe aux verba, incessamment et en theologie seulement, puisque Ia seulement le Verbe trouve dans les verba rien moins qu'un corps. Le corps du texte n'appartient pas au texte, mais a Celui qui y prend corps. Aussi l'ecriture theologique ne cesse-t-elle de se transgresser elle-meme, tout comme la parole theologienne se nourrit du silence oil, enfin, elle parle correctement. Autrement dit, ii ne devrait falloir aucune justification a s'essayer a la theologie, que I' extreme plaisir d' ecrire. La seule limite a ce plaisir, en fait, se trouve dans la condition de son exercice; car le jeu des verba au Vebe irnplique que l'ecriture theologique se joue dans la distance [NB!], qui unit et separe aussi bien l'homme ecrivant et le Verbe dont ii s'agit - le Christ» (J.-L. MARION, Dieu sans l'etre [coll. «Quadrige», 129]. Paris, PUF, 2• ed. 1991, p. 9). Sur la pensee de Marion, cfr V. KAL, Onzegbaarheid als periode. Differentie en a/stand bij Jean-Luc Marion, in l.N. BULHOF/L. TEN KATE
(eds), Ons ontbreken heilige namen (cite a la note 4 ci-dessus), pp. 66-90, et notre etude Penser l'Autre: theologie negative et «postmodernitb, in Revue philosophique de Louvain, 91 (1993), pp. 296-310.
25 On n'ignore pas qu'une bonne partie des recherches de Georges Bataille est centree sur ces deux faces de la mystique que sont le mysticisme chretien et l'erotisme, l'un base sur un surpassement de la loi, l'autre sur !'infraction de celle-ci. Nous renvoy.ons ici a un chapitre de L'Erotisme qui est specialement consacre a cette question et en traite d'ailleurs sans porter la moindre atteinte a la sensibilite chretienne: G. BATAILLE, Mystique et sensualite, in L'Erotisme (coll. «Arguments»). Paris, Gallimard, 1957, pp. 245-277.
422 Philipp W. Rosemann
que des ecrits d'inspiration mystique ou apophatique ont souvent fait l'objet de condamnations, comme, par exemple, le Periphyseon, qui fut condamne en 1210 et 1225 et mis a l'Index librorum prohibitorum en 1684.
A la verite, il n'existe aucune contradiction irreconciliable entre le mysticisme et la loi morale, car une implication mutuelle les relie inseparablement. Par contre, toute tentative pour isoler ces deux p61es l 'un de l'autre entraine des inconvenients graves, voire tragiques. D'une part, un mystique qui se coupe de la loi morale s 'enferme dans un subjectivisme qui lui ote toute mesure. «Celui qui entre dans la proximite du tout Autre au-defa de la Loi, ecrit a ce sujet P. Moyaert, entre inevitablement dans la proximite de bestialites et de boucheries indignes de l'homme» (p. 144). Et l'auteur d'Ethiek en sublimatie de poursuivre en citant l' exemple d 'Abraham qui, dans le recit de la Genese, ne refuse pas a Dieu l'immolation de son fils unique. 11 est significatif que c'est par l'intervention de l'instance interpretative d'un ange que ce «commandement» de Dieu est annule. En dehors de l'ordre symbolique/moral qui prend corps dans le langage, c'est-a-dire dans la presence immediate de l' obscurite eblouissante de la volonte divine, l 'homme perd pied totalement: il lui devient impossible de distinguer le divin du demoniaque.
D'autre part, il serait faux de pretendre que l'ordre moral puisse fonctionner sans etre contrebalance par l' elan transgressif de la mystique. Dans un volume devenu classique qui fut consacre au probleme des rapports entre la mystique et la moralite, nous lisons sous la plume du P. E. Tesson que si «l'attitude religieuse et mystique n'est pas a l'abri de deviations», «un grand danger menace l'activite morale proprement <lite»: «elle est toujours tentee de se durcir dans le pharisa!sme de l'obeissance litterale et de se complaire dans la satisfaction puerile de sa propre perfection»26. Oui, «la vie mystique est vie morale», «la morale juge et guide la mystique»27, mais «Ce qui est plus prejudiciable a la vie spirituelle [que des manquements evidents aux obligations], c'est de s'enliser dans la mediocrite»28 d'une morale sterile qui ne consisterait que dans des «routines, exactitudes superficielles» relevant d'un «pharisai:sme legaliste»29.
26 E. TEsSON S.J., Sexualite, morale et mystique, in Mystique et continence. Travaux scientifiques du VII' Congres international d'Avon ( «Etudes carmelitaines», vol. hors sene). Bruges, Desclee de Brouwer, 1952, pp. 374 sq.
27 Ibid., p. 376. 28 Ibid., p. 372. 29 Ibid., p. 365 ...
L 'ethique de la theologie negative 423
Cette «inertie spirituelle»30 est comrne une mort; une mort a laquelle ii faut mourir pour pouvoir vivre de la v~e divine qui nous est promise. Autrement dit, «pour atteindre la vie divine, il faut passer par la mort» 31 •
«Nous pouvons ( ... ) revenir a la vie et ce retour est d'ordinaire prepare par des actes qui sans nous faire encore franchir la limite decisive, nous en font cependant approcher»32• C'est ici ou la mystique trouve sa place dans toute vie Veritablement chretienne, dont elle est «COnstitutive»33.
Pour surmonter une moralite purement superficielle, «une ceuvre de depouillement des valeurs superficielles sera necessaire en meme temps que de concentration et d'interiorisation»34. A l'oppose d'un moralisme formaliste, qui reste toujours profondement attache aux choses de l'agir quotidien dans le mouvement meme de les nier, la mystique chretienne cherche a ne jamais perdre de vue le vrai amour qui est au centre de tout ce qui occupe l'fune humaine, a savoir l'amour de Dieu. La mystique implique done, comrne l'hero'isme, une intime connaissance de soi.
Nous avons tellement rapproche les structures du mysticisme de celles de la vie hero'ique selon Lacan qu 'on serait presque tente ici de poser la question du P. Tesson: «La possibilite de la saintete dependraitelle d'une psychanalyse?»35 Ah! Nous somrnes loin de repondre par !'affirmative. Non, si les buts de la mystique et ceux de la psychanalyse ne sont pas toto coelo differents, c'est que la psychanalyse a retrouve la logique de l 'apophasis qu 'elle traduit dans les termes de la pensee contemporaine - ce qui, a son tour, nous permet de jeter une lumiere toute nouvelle sur les tres anciennes questions de la theologie negative.
La sublimation
Pour terminer, revenons encore une fois a !'excellent ouvrage de P. Moyaert, duquel nous nous somrnes assez eloigne en traitant de la dialectique des lois complementaires de la jouissance et de la morale, ce qui nous a conduit jusqu 'aux questions de la mystique. En parlant de l' amour au debut de cet article, nous avons vu qu'il ya des situations dans le cheminement du desir ou celui-ci se trouve coince: coince, par exemple,
30 Ibid., p. 364. 31 Ibid., p. 368. 32 Ibid., p. 364. 33 Ibid., p. 359. 34 Ibid., p. 361. 35 Ibid., p. 374.
424 Philipp W. Rosemann
clans un amour inconditionnel qui, quoiqu'il ne soit pas partage, ne peut lacher son objet36. Une telle impasse est due au fait, avons-nous explique, que l'amour s'est, pour ainsi dire, «ab-solu» de la chaine signifiante, en sorte que son objet est devenu non echangeable. Le cercle d'echanges dans l'ordre symbolique s'arrete; partant, le desir, voire la vie, cale. Et parce que l'immobile, c'est-a-dire ce qui ne change plus, se bloquant dans une identite sans difference, confine au neant, l' amour fou est une experience angoissante. Une semblable reaction est d'ailleurs provoquee par la situation opposee d'un jeu de differences dont la rapidite deconcertante efface toute impression d'identite. Autrement dit, si le cercle d'echanges symboliques va trop vite, cela aussi est angoissant, confrontant l'homme a cet autre signe du neant qu'est le chaos (cfr pp. 186-190).
Puisque le Mros et le mystique sont capables de transcender l'immanence, c'est-a-dire l'ordre economique des biens particuliers, ils sont, du moiris en principe, exempts de l'immobilisation angoissante du desir. Reste a savoir ce que font ceux qui n'en sont pas capables. La reponse que Lacan fournit a cette question porte le nom de sublimation. Celle-ci constitue un processus par lequel la transcendance apparait dans l'immanence, sans qu'il faille pour cela le double mouvement de transgression et de reinscription dans lequel nous avons tente de saisir l'essence de la vie Mroi:que. Toujours est-il que si la sublimation peut se passer de la transgression, cette limitation a son prix: «Sublimez tout ce que vous voudrez, il faut le payer avec quelque chose. Ce quelque chose s'appelle la jouissance» (Sem. VII, p. 371). Que se passe-t-il precisement dans la sublimation?
«Et la formule la plus generale que je vous donne de la sublimation est celle-ci - elle eleve un objet - et ici, je ne me refuserai pas aux resonances de calembour qu'il peut y avoir dans l'usage du terme que je vais amener - a la dignite de la Chose» (ibid., p. 133).
«A la Ding-nite de la Chose» 37 : un objet qui appartient au reseau des signifiants est detache de son contexte dans l' ordre symbolique, pour signifier non plus ceci ou cela qui, clans le monde empirique, pourrait susciter notre desir, mais le rien de das Ding. Cette «signification sans contexte»
36 Une belle description litteraire d'un tel amour a la fois obsessionnel et tragiquement vain se trouve dans le nouveau roman d'Alan HOLLINGHURST, The Folding Star. Londres, Chatto & Windus, 1994.
37 «'Dignite'» est bien sur un Witz sur l'allemand Ding: la dignite de la Chose, c'est la choseite de la Chose» (B. BAAS, Le desir pur. Parcours philosophiques dans les parages de J. Lacan. Louvain, Peeters, 1992, p. 187).
L'ethique de la theologie negative 425
(Moyaert, p. 204) produit dans le sujet un effet liberateur, car l'objet qui tout a l'heure semblait encore nous captiver, voire nous paralyser, de par toute les significations qu'il evoquait dans notre «systeme», est soudainement eleve dans une sphere au-defa du sens et du non-sens qui nous preoccupent habituellement: «La dichotomie 'dote de sens' versus 'depourvu de sens' est barree ou neutralisee» (p. 207). Et le sujet des lors d'etre en mesure de se distancer momentanement des emotions, identifications imagjnaires et blocages qui troublaient si tenacement sa vie dans l'ordre symbolique. L'homme ainsi affranchi devient un pur sujet, un «sujet sans moi» (Sem. II, p. 287).
Tout ceci appelle cependant encore quelques precisions. Surtout, ii est capital de ne pas oublier que la sublimation ne nous met pas en contact direct avec la Chose, mais avec un objet qui est devenu le signe privilegie de celle-ci: «pas avec le rien, mais avec des signes du rien» (Moyaert, p. 193; en italiques dans !'original). La presence non mediatisee de das Ding est strictement inimaginable et ne «signifie» rien, sinon la mort du sujet. Or, ce dont ii s'agit dans la sublimation n'est point la destruction de toute signification ou l'aneantissement du sujet; et si la signification y perd son contexte, elle n 'en reste pas moins une signification. Au vrai, ii serait done plus juste de dire que dans la sublimation, la signification est abstraite de son contexte strictement personnel, pour passer a un niveau plus objectif. L'objet dont on a sublime le desir est hisse sur le pavois d'un ordre symbolique transpersonnel et objectif (cfr surtout pp. 201-209). Un amour sublime reste toujours un amour, avec la difference que dans le poeme ou la chanson ( ou meme le texte philosophique ... ) ou je lui donne expression, j'opere une negation de mon interiorite pour celebrer I' ob jet de mon desir dans la distance liberatrice qui est l' effet de l' exteriorite de la forme culturelle (litterature, musique, philosophie ... ) dont j'use. Je prone done l'objet de mon amour tout en le niant - de la meme fai;:on que je dois nier les choses pour ne pas trahir la Chose. V oil a comment la sublimation «eleve un objet a la <lignite de la Chose» en evoquant le rien, la negativite de notre desir.
Sublimation et religion
«Die Sorge selbst [als Sein des Daseins] ist in ihrem Wesen durch und durch von Nichtigkeit durchsetzt» - d'un bout a l'autre, l'etre du Dasein est impregne, jusqu'en son essence, de negativite. Lacan aurait
426 Philipp W. Rosemann
pu ecrire cette phrase, qui se lit, bien entendu, dans Sein und Zeit38• Car selon le psychanalyste parisien, la vie de l'homme en tant qu'etre de desir «est comme telle conjointe a la mort» (Sem. II, p. 272), c'est-a-dire qu 'elle est inextricablement liee a une dialectique OU la vie quotidienne se paie de la mort de la Chose, la vraie vie, en revanche, exigeant que le sujet meure a soi. Quoi qu'il fasse, l'etre de desir ne saurait echapper a son destin, qui consiste a fonder et refonder continuellement un processus de neantisation: l'etre de desir est foncierement Grundsein einer Nichtigkeit39• «Et cela signifie, continue Heidegger dans Sein und Zeit, [que] le Dasein est comme tel coupable»40• C'est sur cette notion existentiale de culpabilite et de peche que repose l' argumentation de P. Moyaert concernant le role central que la religion joue dans la sublimation (cfr pp. 216-228).
Dans la perspective que nous venons d'esquisser, l'homme s'est toujours deja rendu «coupable», avant meme d'avoir,commis telle ou telle faute empirique. Le pecM est, en un sens tres formel, inseparable de l'etre humain41 . C'est pourquoi la vie psychique de l'homme risque d'etre troublee et etouffee par un sentiment indomptable de culpabilite lorsqu'une forme culturelle fait defaut ou ce sentiment peut etre sublime effectivement. Or, la forme culturelle (l'ordre symbolique) qui remplit cette fonction indispensable est la religion:
«Il est des lors sans fai;;on injuste de pretendre que la religion (le christianisme) excite la conscience individuelle et nevrotique de culpabilite en attirant !'attention sur l'etat insupprimable de peche dans lequel se trouve !'existence humaine. Au contraire, la religion nous libere plutot de notre sentiment nevrotique de culpabilite grace au fait qu'elle integre notre etat de pecheurs dans un cadre plus vaste et structure de symboles. Lorsque ce cadre objectif de la religion perd sa prise sur les individus ainsi que sur la communaute, cela ne signifie pas que par fa la conscience de la finitude humaine, de la negativite et du rien de cette vie, disparaisse aussi. Par contre, cela signifie qu 'un cadre disparait qui nous met a meme de trouver une forme pour le rien» (p. 223 [marquee 233]).
La possibilite de la sublimation depend de l'existence d'un ordre symbolique qui, tout comme le langage et la loi morale, preexiste a l'individu et le depasse de par une objectivite qui se soustrait a son caprice
38 § 58, p. 285 (ls< ed. de 1979). 39 Ibid. 40 Ibid. (en italiques dans !'original). 41 lei encore, la logique de la psychanalyse lacanienne n' est pas tres loin de celle de
la theologie negative. Cfr ace sujet notre article cite a la note 8, surtout pp. 118 sq.
L'ethique de la theologie negative 427
(encore que, d'un point de vue diachronique, ce soit bien sous !'influence des individus qu'un ordre symbolique peut evoluer). Que l'art ou la philosophie, mais surtout la religion, me donnent l' occasion de transcender temporairement I 'horizon limite de mon moi et de ses preoccupations est done, d'une certaine maniere, une grace (cfr pp. 227 sq.). Et avant tout, j'ai besoin d'etre pardonne pour la negativite dont mon existence est penetree: le fait que ne peux absolument pas m'accorder moi-meme ce pardon est ce qui demontre le plus nettement ma dependance de l' Autre. Il n'est pas necessaire de forcer la logique de la psychanalyse lacanienne pour arriver a cette conclusion. C' est pourquoi il est parfaitement juste que le livre de Paul Moyaert porte sur sa couverture une reproduction de I' admirable tableau de Salvador Dalf, Le Christ de saint Jean de la Croix.
Conclusion
L' «ethique de la theologie negative» n'est pas le nihilisme, OU
l'absence d'ethique. La conviction qu'au creur de la realite, il n'y a pas la rationalite de l'etre, mais l'opacite d'un «rien» qui depasse tout ce que l 'homme puisse saisir - cette conviction que la theologie negative partage avec la psychanalyse lacanienne - n'ote pas tout fondement a la morale. Mais on ne saurait tirer un enseignement ethique positif du neant absolu. Pourtant, suivant la logique a la fois de la theologie negative et de la psychanalyse, le rien doit toujours etre pense dans son enchevetrement necessaire avec l'etre. L'absence n'est pas le fin mot de l'ontologie, si I' absence elle-meme n'est «rien» en dehors d'une dialectique qui la retie a la presence, en dehors de l' occulti manifestatio, comme dit Jean Scot Erigene42 . C'est dans cette dialectique qui transcende !'opposition binaire entre l'etre et le neant que s'inscrit l'ethique de la theologie negative. Cette ethique est basee sur la «loi naturelle» que Lacan denomme la Loi.
Louvain-la-Neuve, Universite catholique de Louvain, Institut superieur de philosophie
42 Periphyseon, livre III, 633B.
Philipp. W. ROSEMANN.
Quelques publications recentes
L'homme et son univers au moyen age. Actes du 7e congres international de philosophie medievale. Edites par Ch. WENIN (Philosophes medievaux, 26-27), Louvain-laNeuve, Editions de l'Institut .superieur de Philosophie, 1986, 2 vol., xm-961 pp.
Avicenna Latinus. Liber tertius naturalium de generatione et corritptione. Edition critique et lexiques par S. VAN RIET. Introduction doctrinale par G. VERBEKE, Louvain-laNeuve, Editions Peeters; Leiden, E.J. Brill, 1987, vm-88*-336 pp.
Figures de la finitude. Etudes d'anthropologie philosophique. III. Editees par G. FLO-· RIVAL (Bibliotheque phiiosophique de Louvain, 32), Louvain-la-Neuve, Editions de l'Institut superieur de Philosophie - Editions Peeters; Paris, Vrin, 1988, vm-264 pp.
F. VAN STEENBERGHEN, Etudes philosophiques, 2e ed. revue et augmentee, Longueuil (Quebec),Le Preambule, 1988,308 pp.
Avicenna Latinus: Liber quartus naturalium de actionibus et passionibus qualitatum primarum. Edition critique et lexiques par S. VAN RrET. Introduction doctrinale par G. VERBEKE, Louvain-la-Neuve, Editions Peeters; Leiden, E.J. Brill, 1989, v-39*-230 pp.
D. LORIES, Experience esthetique et -ontologie de l'a:uvre. Regard «continental» sea: la philosophie analytique de !'art (Memoires de la Classe des lettres. Collection in-8°, 2e serie, tome 68, fascicule 1), Bruxelles, Palais des Academies, 1989, 286 pp. -
F. VAN STEENBERGHEN, Philosophie fondanientale, Longueuil (Quebec), Le Preambule, 1989, 512 pp.
M. GHINS, L'inertie et l'espace-temps absolu de Newton a Einstein. Une analyse philoso: phique (Memoires de la Classe des lettres. Collection in-8°, 2e serie, tome 69, fasci" cule 2), Bruxelles, Palais des Academies, 1990, 238 pp. -
P. STEVENS, Une introduction historique a la philosophie. T.I. Des origines a Hegel, Bruxelles, Editions Ciaco, 1990, 281 pp.; T. II. La philosophie post-hegelienne, Louvain-la-Neuve, Arte!, 1993, 410 pp.
Ph. VAN PARIJS, Le modele economique et ses rivaux. Introduction a la pratique de l'epistemologie des- sciences sociales (Travaux de droit, d'economie, de sciences politiques, de sociologie et d'anthropologie, 164 ), Geneve-Paris, Droz, 1990, 243 pp._
Figures de la rationalite. Etudes d'anthropologie philosophique. N. Editees par G. FLoRivAL - (Bibliotheque philosophique de Louvain, 34), Louvain-la-Neuve, Editions de l'Institut
supeneur de Philosophie; Louvain, Editions Peeters; Paris, Vrin, 1991, 362 pp. B. STEVENS, L'apprentissage des signes. Lecture de Paul Ricceur (Phaenomenologica,
121), Dordrecht, Kluwer Acadelnic Publishers, 1991, 310 pp. Ph. VAN PARIJS, Qu 'est-ce qu 'une societe juste? Introduction a la pratique de la philoso
phie politique (La couleur des idees), Paris, Editions du Seuil, 1991, 320 pp. Avicenna Latinus. Liber primus naturalium, I. De causis et principiis naturalium. Edition
critique par S. VAN RrET. Introduction doctrinale par G. VERBEKE, Louvain-la-Neuve, Editions Peeters; Leiden, E. I.Brill, 1992, v-108*-146 pp.
Finalite et intentionnalite: doctrine thomiste et perspectives modemes. Actes du colloque de Lou~ain-la-Neuve et Louvain 21-23 mai 1990 edites par J. FoLLON et!· Mc Evoy (Bibliotheque philosophique de Louvain, 36), Louvain-la-Neuve, Editions de I'Institut superieur de Philosophie; Paris, Vrin; Louvain, Editiqns Peeters, 1992, xrr-338 pp.
J. TAMINIAUX, Lafille de Thrace et le penseur professionnel. Arendt et Heidegger (Critique de la politique), Paris, Payot, 1992, 246 pp.
M. LECLERC, La destinee humaine. Pour un discemement philosophique, Namur, Culture et vente, 1993, 164 pp. -
J. FOLLON, Guide bibliographique des etudes de philosophie (Bibliotheque philosophique de Louvain, 37), Louvain-la-Neuve, Editions de l'Institut superieur de Philosophie - Editions Peeters; Pans, Vrin, 1993, x-220 pp.
SERVICE DES ABONNEMENTS ET ADMINISTRATION E. Peeters, B.P. 41, B-3000 Lorivain
Compte de cheques postaux n° 000-0425099-45: Editions Peeters, Louvain
Le prix de souscription a la Revue philosophique de Louvain, annee 1995, est de2.000 F.B. (port en sus): '
Le prix d'un numero isole simple de la Revue est de 600 F.B. (port en sus), le prix d'un numero isole double est de 1.000 F.B. (port en sus).
Comme complement a la Revue philosophique de Louvain, l'Institut superieur de Philosophie publie egalement le Repertoire biblipgraphique de la phiJosophie. Le prix de l' abonnement a la Revue, conjointement avec le Repertoire, est de 3.200 F.B. (port en sus). Le prix de l'abonnement au Repertoire, sans la Revue, est de 1.750 F.B. (port en sus).
REVUE TRIMESTRIELLE PUBLIEE AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE BELGE ET L' AIDE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION ET DE L'ENSE!GNEMENT ARTISTIQUE
DE LA COMMUNAUTE FRAN<;:AISE ~
BE ISSN 0035-3841