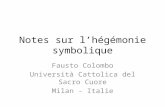COMMENT FIDELISER DANS UN MARCHE DE NICHE EN BAISSE D'ACTIVITE, OU EST LA PLACE DE LA VALEUR AJOUTEE
Leçons sur l'éthique et la théorie de la valeur. A
Transcript of Leçons sur l'éthique et la théorie de la valeur. A
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS
Le présent ouvrage constitue la traduction du texte principal (Haupt-text) et de deux annexes (Beilagen) du vol. XXVIII des Husserliana : Vorle-sungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914, publié en 1988 par UllrichMelle1. Il suit le texte des cours professés par Husserl à Gœttingen pen-dant le semestre d’hiver 1908/1909 et pendant les semestres d’été 1911et 1914. Nous avons conservé l’ordre de présentation, inversant l’ordrechronologique, pour les raisons convaincantes exposées par l’éditeur, etque nous rappelons brièvement ici. Le cours de 1908/1909 se composaitde deux parties, dont seule la première fut reprise en 1911 et en 1914,avec des remaniements et des compléments substantiels. La partie Acomporte le texte des leçons de 1914, c’est-à-dire la version la plusaboutie de cette première partie. La partie B reprend les segments queHusserl a professés en 1911 seulement, c’est-à-dire une longue Introductionà l’Idée de la philosophie, précédant les développements proprement éthi-ques et axiologiques2, et une section finale qui s’écarte sensiblement de lafin de cette première partie dans sa version professée en 1908/19093,
1. La pagination de cette édition originale figure entre crochets en marge de la présentetraduction.
2. Cette introduction remplace en 1911 celle de 1908, reproduite ici en annexe VIII.– L’axiologie (du grec 5xioV, « valable », « digne ») est la théorie des valeurs.
3. Elle-même reproduite en annexe IX.
5554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:32
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mais aussi de celle de 1914. La partie C, enfin, présente la seconde partiedu cours de 1908/1909, qui n’a pas été reprise ultérieurement, « faute detemps »1.
Les leçons de 1914 sont pour l’essentiel identiques, quant à leurcontenu, à celles de 1911 et à la première moitié du cours de 1908/1909 ;mais elles s’efforcent de rendre le propos plus explicite et, notammentpar l’ajout de nombreuses récapitulations, plus accessible. L’innovationprincipale, par rapport aux versions de 1911 et de 1908/1909, est la sec-tion III, consacrée à la phénoménologie de la volonté. La version de 1911avait apporté des développements inédits sur la différence entre somma-tion et production de valeur, repris en 1914 dans le § 12 b. La présentetraduction couvre donc l’essentiel du contenu des leçons éthiques et axio-logiques dispensées par Husserl entre 1908 et 1914.
Malgré leur intérêt, les autres textes (annexes et textes complémentaires) deHusserliana, XXVIII n’ont pas été retenus ici, pour des raisons diverses,dont certaines concernent la nature même des matériaux, soit qu’ils fus-sent déjà traduits ailleurs, soit qu’ils revêtissent un caractère trop frag-mentaire, voire trop labile.
En 1897, Husserl constatait un regain d’intérêt pour les questionséthiques, imputable aux « convulsions ayant ébranlé l’ensemble de la viejuridique et politique au cours des dernières décennies », et en réaction à« la skepsis éthique » que nourrissait « l’instabilité des relations économi-ques, engendrée par des changements brutaux des modes de productionet de consommation », ainsi que la « malveillance cynique contre tous lesintérêts idéaux ». Il est difficile de décider si, de nos jours, nous assistonsà une reviviscence comparable, voire à « un renouveau de la littératureéthique »2 ; mais il est du moins manifeste que les rapports de la phéno-ménologie et de l’éthique en son sens husserlien bénéficient depuis
56 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Non seulement la première partie était devenue plus longue, mais le semestre d’été esttraditionnellement plus court que celui d’hiver. Husserl lui-même le signale dans les leçons,p. [69], où il déplore de n’avoir pas encore traité du problème central (de la deuxième partie desleçons de 1908/1909), celui de la relation entre actes logiques et actes affectifs, dans le cadred’une « phénoménologie qui élucide de façon ultime les structures de la raison » et de devoirremettre ce travail à plus tard, « s’il reste encore du temps ».
2. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, Husserliana, XXVIII, Ergänzende Texte, Nr. 1,p. [381-382] (Fragment des leçons sur « Éthique et philosophie du droit », de 1897).
5654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:32
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
quelque temps d’une attention qui, comme le désintérêt relatif qui l’a pré-cédée, continue peut-être de se placer sous le signe du paradoxe.
Si l’on excepte en effet quelques allusions sporadiques, la phénomé-nologie en France – dans le sillage des figures pionnières de Levinas,Sartre, Merleau-Ponty ou Ricœur – s’inscrit sous le signe de ce qu’onpourrait appeler « la phénoménologie au risque de l’éthique », plutôt quecelui d’une phénoménologie travaillant à une critique de la raison axiolo-gique et pratique. Or, tel est le premier paradoxe, malgré une telle préten-tion à assigner ainsi des limites au phénoménologique comme tel, on n’aguère pris appui sur le matériau (pourtant immense) des recherches hus-serliennes en la matière, on n’y a même vu, après Heidegger1, qu’unrepoussoir (ce qu’il est convenu d’appeler l’ « intellectualisme husser-lien »). Pouvait-on imputer cela à l’indisponibilité des textes sur le sujet ?Pourquoi en ce cas, alors même qu’ils commençaient à devenir accessi-bles, est-ce dans les marges de ce courant (certes multiforme, mais domi-nant) de la « phénoménologie en France » que l’on trouve les études pre-nant au sérieux – ne fût-ce que pour les critiquer – les investigationshusserliennes sur l’éthique ? En effet, même lorsqu’elles ressortissent à lalittérature en langue française sur le sujet, ces études émanent le plus sou-vent de chercheurs ou de courants étrangers, sinon hostiles, à la phéno-ménologie (déontique, logique des normes, positivisme juridique)2.
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 57
1. Cf. Einführung in die phänomenologische Forschung, Gesamtausgabe, vol. 17, Francfort, Klos-termann, p. 271-272.
2. Mentionnons, entre autres, l’étude ancienne de Carlos Cossio, La norma y el Imperativo enHusserl (Revista de la Facultad de Derecho, Buenos Aires, 23 [1951]), traduite dans les Mélanges enl’honneur de Paul Roubier, t. I, Dalloz & Sirey, 1961, p. 145-198. Mais surtout Jerzy (alias Georges)Kalinowski, dont les premières recherches remontent à 1953, mais ne prennent en compteHusserl qu’à partir de 1965, avec un article sur « La logique des normes d’Edmund Husserl »,Archives de Philosophie du Droit, 10, p. 107-116 (en se fondant principalement sur les Recherches logi-ques, et les Prolégomènes en particulier), bientôt suivi, en 1968, d’une étude critique de « Lalogique des valeurs d’Edmund Husserl », Archives de Philosophie du Droit, 13, p. 267-282, sousl’impulsion du livre d’Alois Roth, Edmund Husserls ethische Untersuchungen, avec présentation desmanuscrits de ses leçons de 1908-1914 (La Haye, Martinus Nijhoff, 1960). Voir La Querelle de laScience normative, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), Paris, 1969, p. 20. Cettetentative sera suivie de peu par la thèse de Jean-Louis Gardies, Essai sur les fondements a priori de larationalité morale et juridique, LGDJ, 1972, sur un corpus phénoménologique plus large, qui prenden compte principalement l’apport d’Adolf Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichenRechts, publié par Husserl dans son Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, à Halle,en 1913.
5754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:32
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
I
Il est vrai que Husserl est lui-même partiellement responsable de cettesituation puisque, malgré une attention continue aux « problèmes fonda-mentaux de l’éthique » depuis 1891, il n’a jamais pris la peine de rendrepubliques ces recherches, encourant le risque, bien réel, de créer la sur-prise, et s’exposant à de nombreux malentendus, au moment où, dans laKrisis, il aborde ce monde de la dpxa et de la pr2xiV qu’est le monde dela vie1.
Les indications de l’existence et de l’importance de ces rechercheséthiques ne manquaient certes pas dans l’œuvre publié. Une fois écartéle contresens normativiste, le lecteur des Recherches logiques pouvaitapprendre que la logique pure, comme en général toute objectité logique,étaient susceptibles de prendre une tournure normative2 ; que les actesnon-objectivants (c’est-à-dire les actes affectifs) pouvaient à l’inverse fairel’objet d’une objectivation, voire d’une prédication3. Lisant Philosophie pre-mière, il pouvait également se faire à l’idée que l’épochè phénoménologiqueet transcendantale impliquait une « épochè éthique universelle » concer-nant, en premier lieu, « toute espèce de validité qui était mise en jeu dansles actes personnels de ma vie passée », à commencer par « tous les actesse rapportant à un devoir absolu et à ce qui à cet égard est d’importancedans le champ universel pratique », mais que cette époché éthique, parcequ’elle laissait intacte « la validité existentielle du monde », et, corrélative-
58 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Husserliana,VI, Nijhoff, 1976, p. [127], trad. fr. G. Granel, La Crise des sciences européennes et la phénoménologietranscendantale, Gallimard, p. 141.
2. Prolegomena, § 13 sq., en particulier A/B [48], Logische Untersuchungen. Erster Band, Husser-liana, XVIII, Nijhoff, 1975, p. 60. Cf. ici même p. [5], p. [49], cf. mention des Prolégomènes,p. [285].
3. C’est, dans les Recherches logiques, la vieille question litigieuse qui ouvre la SixièmeRecherche au § 1 concernant l’expression des souhaits, des volitions, des ordres, etc., et trouve sasolution, au § 70. Cf. Logische Untersuchungen, Zweiter Band ; zweiter Teil, Husserliana XIX/2,Nijhoff, 1984, p. 749 [A 691, B 219]. Cf. ici même, p. [60], ainsi que les références dans laPartie C.
5854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:32
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ment, un ensemble d’actes du moi qui l’établissent, tels que « les expérien-ces actives » ou les « jugements d’expérience »1, devait être distinguée dela réduction phénoménologique transcendantale. On pouvait égalementapprendre, grâce à une note infrapaginale au § 50 de Logique formelle etlogique transcendantale, que Husserl s’était essayé depuis 1902, dans le cadrede son enseignement, à l’élaboration systématique de « l’idée d’une axio-logie et d’une pratique formelles »2, et que celle-ci importait, comme lesignalait le § 35, particulièrement dans l’optique d’une critique de lalogique formelle, au double motif que (1) « l’élargissement nécessaire d’unelogique formelle est déterminé par ceci que les modifications modales du juger et des juge-ments entrent dans la logique de la certitude ou de la vérité en tant que possibilités for-melles générales, étant donné que toute modification de cette sorte peutentrer dans la teneur prédicative du jugement et ne peut pas dès lors être consi-dérée comme extra-formelle », les « modalités de la vérité » et de la « la probabi-lité comme une de ces modalités » faisant donc partie intégrante de lalogique formelle ; et (2) qu’un « élargissement apparenté, quant à sonsens, à celui que nous venons de mentionner, se produit en outre quandon prend en considération le fait que l’affectivité apporte des modalitésdu quelque chose en général qui sont insérées de même dans la sphèredoxique (cf. sur ce point Ideen I, p. 243 sq. et plus loin ci-dessous, § 50,p. 184) »3.
Cependant, ce pan du travail de Husserl a été, de son vivant aussi bienque de façon posthume, moins sollicité, ou l’a été selon d’autres modali-tés, dont l’ « emprunt dissimulé », comme en témoigne exemplairementl’affaire Theodor Lessing4. S’il est probablement excessif d’abonder dans
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 59
1. Erste Philosophie (cours de 1923/1924, publié en 1959), Husserliana, VIII, p. [319],trad. fr. Philosophie première, t. II, PUF, p. 276-277.
2. Formale und transzendentale Logik, Husserliana, XVII, p. 142, p. [121], trad. fr., p. 185.Husserl nomme « pratique » (Praktik) la théorie de la pratique.
3. Logique formelle et logique transcendantale, note (a), trad. fr., p. 137-138, p. [88].4. Ibid., p. 185, p. [121], note. Ce philosophe avait assisté aux séminaires de Husserl
en 1906 et 1907. Au printemps 1908, il publia ses Studien zur Wertaxiomatik dans l’Archiv für syste-matische Philosophie, vol. XIV, 2e édition, Leipzig, 1914, d’abord sans même faire la moindre allu-sion à Husserl. Celui-ci se vit spolié du fruit de recherches auxquelles il accordait la plus hauteimportance et réagit avec indignation. S’ensuivit une correspondance tendue et un échangesous forme de notes dans divers ouvrages, qui devait se poursuivre jusqu’en 1935. Cf. Husser-liana, XXVIII, introduction d’Ullrich Melle, p. XXIV à XXVII.
5954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
le sens de Husserl et de dire que « tous les développements ayant un sensanalogue qui sont intervenus depuis [1902] dans la littérature philoso-phique, avant tout très directement l’axiomatique des valeurs de Th. Les-sing, se reportent à ces leçons et à ces exercices de séminaire, quelqueimportantes qu’aient été les modifications qu’ont subies les pensées com-muniquées », il est incontestable qu’on assiste, après ces leçons, à uneexplosion des tentatives de formalisation du côté de l’éthique à partir desannées 1900-1902, et qu’on peut reconnaître à Husserl un rôle de « pré-curseur », à côté d’autres auteurs dont Bolzano et Brentano1.
Le hasard du travail éditorial a voulu que les efforts déployés parHusserl en vue d’une fondation phénoménologique de la théorie de lavaleur et de l’éthique ne nous soient devenus accessibles que depuis unevingtaine d’années. Les lacunes documentaires en ces matières se sontprogressivement comblées grâce à la publication, notamment, du courssur « l’éthique et la théorie de la valeur » donné à plusieurs reprisesentre 1908 et 1914, à Gœttingen (Husserliana, XXVIII, 1988), puis descinq articles de 1922/1923 sur le « renouveau » comme problèmed’éthique individuelle et collective (Husserliana, XXVII, 1989), et enfin ducours d’introduction à l’éthique des semestres d’été 1920 et 1924 (Husser-liana, XXXVII, 2004) ; de sorte qu’il est devenu possible de reconstituerpartiellement l’itinéraire parcouru par Husserl, de l’ébauche de constitu-tion d’une éthique formelle exploitant toutes les ressources du parallé-lisme logico-éthique au développement d’une éthique de l’accomplisse-ment de soi, où l’obéissance au devoir absolu prend la forme duconsentement à une vocation intime et réfléchie.
Après une tentative malheureuse en 1889/1890, où il dut suspendreson cours, faute d’auditeurs en nombre suffisant, Husserl reconnut « lanécessité de ces dernières disciplines en tant qu’analogon exact de lalogique formelle fondée par Aristote »2. Parallèlement à des travaux histo-riques sur les doctrines éthiques classiques (Schopenhauer, Kant, Mill,
60 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. G. Kalinowski n’hésite pas à lui reconnaître la paternité de la « logique des normes » etde la « logique des valeurs », in Querelle de la science normative, p. 20, et surtout dans sa Logique desnormes, PUF, 1972, en le plaçant aux côtés de Bolzano et d’Alois Höfler, p. 38 sq.
2. Ms. M III 2 I 4/73 a, cité d’après la Husserl-Chronik, publiée par Karl Schuhmann, LaHaye, Nÿhoff, 1977, p. 25.
6054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Hume, Spinoza, Fichte, etc.) ou sur des essais plus contemporains aux-quels il se réfère plus ou moins explicitement (Brentano, Drobisch1, Mei-nong2, Lipps3, Münsterberg4, etc.), Husserl dispense des cours sur les« Problèmes fondamentaux de l’éthique » en 1891, 1892, 1893, 1895.En 1897, dans ses Leçons sur « Éthique et philosophie du droit », il s’at-taque pour la première fois à la réfutation de la skepsis éthique. Les« Questions fondamentales de l’éthique » de 1902 marquent la premièretentative « pour développer de façon critique et concrète l’idée d’uneaxiomatique [des valeurs] et d’une pratique formelles »5. Parallèlement, il atenu sans discontinuer de 1892 à 1905 un cours sur « la liberté de lavolonté », qui cède peu à peu la place, à partir de 1906, à une investigationphénoménologique sur la volonté et l’affectivité. Ces investigations, donton trouvera un aperçu dans la section III de la partie A des Leçons ici pré-sentées, ont pour objectif une « critique non psychologique (bien que nonhostile à la psychologie) de la connaissance et de la volonté »6, critique dela raison théorique et pratique qui passe par une réfutation du « psycholo-gisme dans la logique » et du « psychologisme dans l’éthique »7. Bien queLudwig Landgrebe, assistant de Husserl, ait transcrit, sous forme dactylo-graphiée, des manuscrits de recherche sous le titre « Wertkonstitution,Gemüt und Wille »8, ces investigations phénoménologiques sur l’affecti-vité et la volonté (ses formes et ses modalités) restent inédites, et corres-pondent au volume d’Analyses de l’affectivité et de la volonté (Études de la struc-ture de la conscience) [Analysen zu Gemüt und Wille (Studien zur Struktur des
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 61
1. Moritz Wilhlem Drobisch, Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit, Leip-zig, Leopold Voss, 1867.
2. Alexius Meinong, Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie, Graz, Leuschner& Lubensky, 1894. Husserl mentionne ces « recherches psychologiques et éthiques sur lathéorie de la valeur », Ms. K II 3/2 b, cf. Husserl-Chronik, p. 70.
3. Theodor Lipps, Vom Fühlen, Wollen und Denken, Leipzig, Barth, 1902.4. Hugo Münsterberg, Philosophie der Werte, Leipzig, Barth, 1908.5. Ms. F III I/161 ; cf. note infrapaginale in Ideen, I, Husserliana, III/1, La Haye, Nijhoff,
1976, p. 279 (p. [250]), trad. fr. Ricœur, Paris, Gallimard, p. 410. Références signalées dans laHusserl-Chronik, p. 72.
6. Lettre à Brentano, 22 août 1906.7. Cf. le plan de travail conservé avec la lettre de Hocking à Husserl du 11 octobre 1903,
cité par U. Melle, Husserliana, XXVIII, Introduction, p. XXII.8. Il s’agit de la deuxième des trois études transcrites en 1926/1927 sous le titre global Stu-
dien zur Struktur des Bewusstseins (cf. n. 2, p. XXXVIII de l’introduction d’U. Melle).
6154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Bewusstseins)] annoncé en 1988 par Ullrich Melle lors de l’édition des Vor-lesungen über Ethik und Wertlehre, et toujours en préparation1. Les leçonsdont nous présentons ici la traduction correspondent donc principale-ment au volet formel de ces investigations.
II
Parmi les influences décelables et les impulsions décisives d’une telleexploration de la sphère de l’affectivité et de la volonté, ainsi que d’unetelle méthode de mise en parallèle du logique et de l’éthique, une placerevient, bien entendu, à Franz Brentano, dont Husserl a été l’élève dansles années 1884-1886. Il a notamment suivi durant deux semestres lecours de cinq heures hebdomadaires consacré par son maître à la philo-sophie pratique2. Dans ses « souvenirs concernant Franz Brentano »(Husserliana, XXXV, p. 306), il mentionne également le séminairede 1884/1885 consacré à l’Enquête sur les principes de la morale de Hume. Àen juger d’après les fragments de manuscrits conservés, cet enseignementa été réinvesti dans la conception des leçons d’éthique professées par lePrivatdozent (assistant) Husserl à Halle durant les années 1890. Du reste,on n’aurait guère de peine à déceler l’influence de Brentano – et notam-ment de sa conférence de 1889 sur « L’origine de la connaissancemorale » – depuis le fragment conservé du cours d’éthique et de philo-sophie du droit de 1897, jusqu’aux leçons de 1908 qui s’y réfèrent explici-tement.
Cette influence ne doit cependant pas être surestimée, ni conduire àméconnaître la prise de distance, voire la rupture discrète mais profondequi, sous des similitudes de surface, couvait depuis 1897, c’est-à-dire
62 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Les éditeurs (Ullrich Melle et Thomas Vongehr) en prévoient la publication pour 2008ou 2009.
2. Ce cours n’a été publié qu’en 1952 par les soins de Franziska Mayer-Hillebrand, sous letitre Grundlegung und Aufbau der Ethik (Berne, Francke), mais Husserl en possédait une copie,aujourd’hui conservée aux Archives Husserl de Louvain.
6254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
depuis le moment où Husserl travaillait à « un grand ouvrage dirigécontre la logique psychologico-subjectiviste de notre époque (donccontre le point de vue que, en tant qu’élève de Brentano, j’ai moi-mêmereprésenté) »1. La rupture, même imparfaite, réalisée dans ces leçons,avant 1902 donc, est très exactement parallèle à celle qui a été opérée surle plan logique, dans la Cinquième Recherche en particulier, en même tempsqu’elle en est étroitement solidaire. Dans les deux cas, la divergence portesur un point central, dont dépend la rigueur même de la mise en parallèle,ainsi que la compréhension de la constitution des actes objectivants aussibien que des actes affectifs, et, par suite, celle de l’essence générique del’intentionnalité ou de l’avis (Meinung) : celui de la fondation des actes.Celle-ci, comme le rappelle le cours de 1908, met en jeu des différencesdans les « modes de la référence » de l’acte (une perception, un jugement,un souhait, un plaisir) à son « sur quoi » (worauf), à son « objet intention-nel », qui sont irréductibles à des différences de représentation considéréescomme des actes fondateurs simples. Or « Brentano, qui, avec sa discus-sion sur les vécus intentionnels dans sa Psychologie <du point de vue empi-rique> de 1874, a donné une impulsion ayant fait époque, a méconnutoutes ces différences »2. La thèse, longuement discutée dans la CinquièmeRecherche logique, selon laquelle les différences entre actes de jugements etactes affectifs en particulier ainsi que leur « intentionnalité » s’explique-raient par les représentations fondatrices (auxquelles Brentano attribueune « intentionnalité simple ») est considérée par Husserl, dès cetteépoque, comme le produit d’une « construction »3, qui fait obstacle à lasaisie de la manière dont sont respectivement fondés les jugements et lesactes affectifs, et occulte « l’essence de la fondation »4 elle-même, com-promettant, par suite, l’élargissement de l’intentionnalité aux actes affec-tifs (y compris volitifs). Chaque fondation d’acte (d’un jugement, d’unsouhait, etc.) suppose en effet des modifications de la référence elle-même, de l’avis (Meinung). Un tel avis n’est pas nécessairement doxique,
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 63
1. Lettre à Natorp, 21 janvier 1897.2. Voir la longue et précise critique de la conception de Brentano, infra, p. [335-345].3. Infra, p. [344].4. Infra, p. [337].
6354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
puisqu’il faut précisément compter à côté du « tenir-pour-étant » (Für-seiend-halten) constitutif des actes objectivants (i.e. doxiques), l’ensembledes espèces intentionnelles du « tenir pour-digne-de » (Für-wert-halten)1.En outre, un tel avis n’est pas non plus nécessairement positionnel, carchaque forme de l’aviser (Meinen) constitue le noyau d’une multiplicité deséries de modifications secondaires, et en particulier de modalisationsparmi lesquelles la logique nouvelle (à laquelle travaille Husserl) comptel’affirmation et la négation2, ainsi que leurs analoga affectifs3. Cette dimen-sion insiste tout au long des Leçons, aussi bien dans le déploiement del’analogie entre actes affectifs et actes objectivants4, que dans l’explora-tion analytique des essences intentionnelles5.
C’est en elle aussi que trouvent leur position et leur solution deux pro-blèmes, qui risquent d’arrêter le lecteur au seuil de ces Leçons sur l’éthique et lathéorie de la valeur, comme ils ont arrêté nombre d’auditeurs contemporainsdes leçons. Le premier touche au statut de la « valeur ». Le second, étroi-tement lié au précédent, concerne celui de la science éthique.
1 / On ne peut manquer d’être frappé de la manière dont l’approchephénoménologique des valeurs qui sous-tend l’ensemble des investiga-tions axiologiques formelles tranche sur les approches qui prévalent dansla littérature qui lui est contemporaine, et contribue à déplacer le centrede gravité de « la question de la valeur ». Alors que ces approches oriententd’emblée la question de façon massive et, au final, confuse sur le problème del’objectivité des valeurs6, compromettant, par une telle précipitation, l’élu-cidation des réquisits de sciences de la culture7, Husserl s’attache à éluci-der le statut non objectif de la valeur. Le principe du parallélisme strict entreintentionnalité objectivante et intentionnalité affective (qui, même si ellecomporte une « direction » et est par suite constituante8, en tant que senti-
64 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Cf. infra, p. [60].2. Cf. infra, p. [124].3. Cf. infra, p. [59-60].4. Cf. infra, p. [48-49], [59-60], [205-212], [326-327].5. Cf. infra, p. [102-106].6. Cf. infra les critiques adressées à Rickert et Windelband, ouvertes, p. [63], ou voilées,
p. [202].7. Cf. infra, p. [201].8. Cf. infra, p. [266].
6454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ment « n’objective pas »1) se révèle en cela bien plus qu’un simple artificeméthodologique. Par valeur2, il convient en effet d’entendre rigoureuse-ment le corrélat ou noème d’un acte affectif qui, en tant que tel, n’avisepas la valeur en tant qu’objet, mais l’éprouve et par suite la constitue selon lemode de l’affectivité à chaque fois en jeu (en tant que valeur relative ouabsolue, indéterminée ou déterminée, non existentielle ou existentielle,volitive, optative, etc.). Tout acte affectif est un acte d’évaluation (Wer-tung), une tenue-pour-valable (Werthaltung)3, qu’il faut se garder deconfondre avec le « jugement de valeur » (Werturteil)4, qui, en tant que juge-ment (prédicatif ou non) implique, présuppose et exprime, lorsqu’il esténoncé, une objectivation de la valeur, en même temps qu’il manifeste unacte affectif, sincère ou feint, éprouvé ou non5. Et tout comme la noéma-tique des actes objectivants s’accompagne d’un élargissement du sens del’être – puisque les modes (ou le comment) de la donation font intégrale-ment partie de son sens –, de même la noématique des actes affectifs sup-pose un élargissement de la sphère des « valeurs », au terme duquel il fautcompter comme valeur non seulement ce qui est digne d’être réalisé prati-quement, voulu, ce qui est digne d’être aimé, souhaité, goûté esthétique-ment, etc. (donc le pratiquement bon, l’aimable, le souhaitable, le beau, leplaisant, etc.), mais également l’ensemble des valeurs modifiées : ce quiest clairement, obscurément, de façon déterminée ou non, dérivée ounon, etc. peut-être, apparemment, probablement, certainement, etc. digned’être réalisé, voulu, souhaité, etc. selon la multiplicité des lignes de modi-fication (Abwandlung) en général, et de modalisation (Modalisierung) enparticulier6.
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 65
1. Infra, p. [253].2. Cf. la note de mise en garde, p. [89]. Les leçons de 1920-1924 reprennent et prolongent
cette mise en garde en attirant l’attention sur la différence qu’il y a entre l’évaluer (werten, werthal-ten) inhérent à tout acte affectif (à tout sentiment), l’évaluer (auswerten, nachwerten) qui recourt àune norme et l’évaluer en tant que mesurer (ausmessen). Cf. Einleitung in die Ethik, Husserliana,XXXVII, p. 315-316.
3. Cf. infra, p. [152], [174], [205], [337].4. Cf. infra, p. [168-169], [253-255].5. Cela en rapport étroit avec les divers sens de la locution « expression d’acte » distingués
au début de la Sixième Recherche logique, § 2-3 (A[482]-[486], B2 [10]-[14]), Husserliana XIX/2,p. 548.
6. Cf. infra, p. [102], [124-125], [208-212], [237].
6554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
La question critique, celle qui doit faire l’objet d’une critique de la raisonaxiologique au sens large, ne saurait donc se réduire à celle, trop équivoque,de l’ « objectivité des valeurs », mais doit plutôt être formulée, selon lamême « analogie intime »1, comme celle de leur validité axiologique (Wert-geltung)2, c’est-à-dire de leur justesse (Richtigkeit), ou corrélativement de lafondation ou justification (Begründung) proprement affective3. Le déploie-ment d’une telle critique s’opère sur deux niveaux, formel et matériel. Surle plan formel, ce qui entre en jeu c’est l’ensemble des lois de l’axiologieformelle, auxquelles correspondent des lois formelles de la justesse del’évaluer (lois du quart exclu, de la dérivation de valeur, de la sommation,de la production de valeur, de l’absorption de valeur, etc.), y compris cel-les de la pratique formelle (lois du choix conséquent, du bien pratiquesuprême, etc.). On s’engage dans le volet matériel d’une telle critique avecla description phénoménologique des structures de fondation d’actes etde fusion noématique, des dynamiques et téléologies de remplissementd’intentions (affectives), et par suite des modes de validation effectifs desvaleurs (depuis le renforcement de la présomption jusqu’à l’évidenceaffective ultime).
Husserl relève un à un les paradoxes qui jalonnent une telle entrepriseet qui semblent provenir d’un rejet de l’existence d’un parallèle axiologiqueau doxique pris en son sens strict ou, ce qui revient au même, par le refusde principe d’un élargissement de l’intentionnalité à une sphère nondoxique. Outre le paradoxe que représente l’idée même d’une raisonaffective, comment comprendre que cette raison qui est « muette et, pourainsi dire, aveugle »4, « dissimulée pour ainsi dire à elle-même »5, incapabledonc de se réfléchir elle-même, puisse néanmoins prétendre à une évi-dence propre, purement axiologique6 ? Est-ce par les lumières de la raisonlogique, grâce aux yeux de l’entendement que les valeurs (y compris prati-ques) se donnent dans une pleine évidence intuitive ? La suprématie
66 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Cf. infra, note p. [280].2. Cf. infra, p. [82].3. Cf. infra, p. [167] sq.4. Infra, p. [68], [281].5. Infra, p. [63].6. Infra, p. [142] sq.
6654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
affirmée de la raison logique implique-t-elle, génétiquement, son inter-vention dans la constitution des valeurs et, téléologiquement, son inter-vention dans la justification des valeurs ? Nous sommes là au cœur del’embrouillamini que ces leçons s’efforcent de dissiper, et qui resurgit dèsque se relâche le fil conducteur du parallélisme logico-éthique. Car si la« raison purement axiologique ne voit pas, ne saisit pas, n’explicite pas, neprédique pas », la raison logique, pour sa part, se borne à donner une formeprédicative à l’ensemble des objectités catégoriales (ou non) que l’évi-dence rationnelle découvre ; les seuls objets qu’elle « crée » sont lesformes catégoriales « qui n’agglutinent, ne nouent, n’assemblent pas lesparties entre elles de telle manière qu’il en résulte un tout réel, perceptiblepar les sens »1. La raison purement axiologique est alogique ; tout comme laraison logique est apraxique et apathique. Ou comme le disent les Leçons,« établir, constater, déterminer, bref objectiver au sens spécifique est l’af-faire de la raison logique ». Aussi la raison affective « ne devient[-elle]manifeste que par la connaissance qui s’accomplit sur la base des actesaffectifs », car « la connaissance n’invente pas, elle exhibe seulement cequi, d’une certaine manière, est déjà là » ; si « l’affectivité n’était pas undomaine de présomptions, si, en elle, mais précisément sur le mode de l’affecti-vité, des décisions n’avaient déjà donné leur suffrage, la connaissance netrouverait rien [qui soit de l’ordre] des valeurs et des contenus-de-valeur,elle ne découvrirait que des vécus aveugles, un peu comme des vécus dusentir-le-rouge ou du sentir-le-bleu »2.
Aussi ne faut-il pas se méprendre sur le passage des Ideen auquel Hus-serl se réfère de nouveau en 19143. Si tous les actes – y compris les actesde l’affectivité et de la volonté – y sont dits « “objectivants” » au motif« qu’ils “constituent” originairement des objets », c’est pour poser que lesuns et les autres sont « sources de différentes régions d’être et par suiteaussi des ontologies qui s’y rapportent », mais que pour l’affectivité ou lavolonté en tant qu’elles font l’expérience de ce qu’elles constituent, il n’y a
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 67
1. Recherches logiques, Sixième Recherche, t. III, p. 224 [186].2. Infra, p. [63].3. Ideen I, § 117, Husserliana, III/1, La Haye, Nijhoff, 1976, p. 268-272 (p. [241]-[245]),
trad. fr. Ricœur, Paris, Gallimard, p. 397-402.
6754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pas à proprement parler d’objet ni d’objectivation sur le mode d’uneconnaissance, mais sur un mode affectif (gemütsmäßig). « Par exemple : laconscience évaluante constitue l’objectité d’un nouveau type, l’objectité“axiologique” par opposition au simple monde des choses, un “étant”d’une nouvelle région, dans la mesure où précisément des thèses doxi-ques actuelles se trouvent pré-tracées en tant que possibilités idéales parl’essence de la conscience évaluante en général, thèses qui mettent enrelief des objectités dotées d’une teneur nouvelle – des valeurs – en tantque “présumées” dans la conscience évaluante. » Et la fin du texte sou-ligne que « dans les actes affectifs ces valeurs sont présumées sur le modede l’affectivité », qu’ « elles viennent à faire l’objet d’un avis doxique et,par suite, logique et explicite, par l’actualisation de la teneur doxique deces actes ».
Faut-il s’étonner dans ces conditions que l’axiologie formelle en tantque discipline ontologico-formelle soit impuissante à trancher le moindreproblème éthique concret ? Que, par suite, l’objection que Moritz Geiger aadressée à Husserl tombe à plat, et ne manifeste au final qu’un contresensde lecture ? Que veut en effet l’éthique husserlienne ?
2 / Husserl n’a pas attendu, en effet, l’objection de Geiger d’aprèslaquelle « il serait ridicule d’exiger d’une mère d’examiner d’abord si lesbesoins de son enfant sont ce qu’il y a de meilleur dans son domaine pra-tique total »1, pour reconnaître que la « règle de Brentano », c’est-à-direl’impératif catégorique formel selon lequel il faut choisir le meilleur parmiles biens accessibles – et par suite, « toute l’éthique » développée de cepoint de vue formel – « ne peut avoir le dernier mot »2. Ce serait donc uncontresens de croire que les investigations éthiques husserliennes en vuede fonder une éthique scientifique exigeraient de nous, ou nous imposeraient,que nous fondions toute action et toute évaluation sur une telle connais-sance, ou même sur une connaissance quelconque. L’on méconnaîtraitainsi « le droit effectif de la vocation et de l’appel intime », i.e. de l’impéra-tif catégorique inconditionnel « qui s’applique à la personne et qui, pourcelui qui éprouve cette affection absolue, n’exige pas une justification ration-
68 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Ms. F I 49, 144 a, conservé aux Archives Husserl de Louvain.2. Ms. B I 21, 65 a.
6854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
nelle et dont le caractère légitimement contraignant n’en dépend nulle-ment » (ibid.), « un droit [qui] peut exister sans être vu », « sans êtreramené sous des concepts de droit, sans être explicité ou pensé sous laforme d’un jugement, sans être exprimé dans la forme de l’énoncé d’uneloi »1. Mais cela revient surtout à inverser le sens des investigations éthi-ques husserliennes. Car c’est principalement dans la perspective d’unethéorie critique de la connaissance elle-même, dans la perspective architec-tonique d’un « système de la théorie des catégories et des disciplines onto-logiques », que les « manques » de disciplines scientifiques dans la région« axiologique et pratique » se font proprement sentir. Ces « disciplinesmanquantes » fournissent en effet par leur absence même un terreau pro-pice aux fausses théories de la connaissance. Leur est imputable ainsi« l’incapacité d’élaborer de façon pure et systématique des ontologiesaxiologiques et, en liaison avec cela, une théorie pure des catégories »2. Orune éthique « véritablement scientifique » ne peut être envisagée à sontour qu’à titre de « science phénoménologiquement fondée de la raison pra-tique et axiologique »3. Ce sont les derniers mots du dernier cours deHusserl sur l’éthique, en 1924, auxquels font écho les déclarations desLeçons qui rappellent que les tâches d’une « éthique scientifique » sont depart en part philosophiques, c’est-à-dire théoriques, et renvoient à la« pédagogie » l’application éventuelle de ces disciplines éthiques et leurconversion en outil de formation et de réforme de l’évaluer ou de l’agir4.
On ne s’étonnera plus dès lors que le philosophe, contraint à une cri-tique radicale de la raison absolue, ne puisse se cantonner dans le rôled’architecte dessinant les lignes fondamentales d’une logique philoso-phique, d’une logique transcendantale5, mais doive endosser également lafonction de « stratège dans le combat contre la déraison »6 ; ni que, dansles multiples querelles qui agitent l’époque (celle de la science normative,du relativisme axiologique, du psychologisme, de l’objectivité des
INTRODUCTION DES TRADUCTEURS 69
1. Infra, p. [68-69].2. Infra, p. [202].3. Husserliana, XXXVII, p. 255.4. Infra, p. [140-141].5. Cf. infra, p. [347].6. Infra, p. [202].
6954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
sciences de la culture, etc.), il s’attache dans un premier temps à constituerles disciplines formelles qui permettent de détruire dans son principe lescepticisme éthique responsable de la « stagnation de la littératureéthique », et de s’attaquer ainsi aux racines affectives du scepticismelogique. Car si le scepticisme logique (par exemple celui qui pose l’impos-sibilité d’une science éthique) n’implique pas affectivement et pratiquementun scepticisme éthique, et s’il peut idéalement y avoir un scepticisme éthi-que sans scepticisme logique1, l’épochè éthique, en s’attaquant aux racinesde l’évaluer et de l’agir, contribue à nourrir l’indifférence et le décourage-ment vis-à-vis de toute recherche authentiquement logique. Montrer quel’on peut continuer de vouloir le vrai même et surtout lorsque tout sembleincertain et indifférent, n’est-ce pas la tâche, toujours urgente, qui s’im-pose comme philosophie et constitue sa possibilité la plus intime2 ?
Conformément à l’usage, nous avons indiqué entre crochets obliques < > lesinterventions de l’éditeur dans le texte, et entre crochets droits [ ] celles des traduc-teurs. Nous utilisons les abréviations N.d.A. pour « note de l’auteur », N.d.E. pour« note de l’éditeur », N.d.T. pour « note des traducteurs ».
La traduction de la partie A a été réalisée par Carlos Lobo, puis retravaillée parPatrick Lang. Pour la partie B, Philippe Ducat a traduit les § 1 à 4, Patrick Langles § 5 à 8 de l’introduction ainsi que la partie finale. Patrick Lang et Philippe Ducatse sont partagé, respectivement pour moitié (§ 1 à 8, § 9 à 12), la traduction de lapartie C. Les annexes VIII et IX ont été traduits respectivement par Ph. Ducat etC. Lobo. Indépendamment de cette division pratique des tâches, la totalité de la tra-duction a été relueet retravaillée en détail par les trois traducteurs, qui se sont étroite-ment concertés sur les solutions retenues. Le glossaire en fin de volume et quelques notesde bas de page matérialisent une partie de ces échanges. Enfin, Dominique Pradelle etPatrick Lang ont procédé à une révision d’ensemble de la traduction.
70 LEÇONS SUR L’ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR
1. Cf. infra, p. [25].2. Cf. infra, p. [353].
7054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
A. LEÇONSSUR DES QUESTIONS
FONDAMENTALESCONCERNANT L’ÉTHIQUE
ET LA THÉORIE DE LA VALEUR(1914)
7154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
page 72 bl
7254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<SECTION ILE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE>
<§ 1. La logique en tant que technologie [Kunstlehre] et la logique pure>
Traditionnellement, la vérité, le bien et la beauté sont posés commedes Idées philosophiques coordonnées, et sont admises des disciplinesphilosophiques normatives parallèles qui leur correspondent : la logique,l’éthique, l’esthétique. Cette mise en parallèle a des motifs profonds etinsuffisamment élucidés, elle recèle de grands problèmes philosophiquesque nous comptons aborder dans l’intérêt d’une fondation [Begründung]scientifique de l’éthique, mais aussi dans un intérêt philosophique plusgénéral.
Pour la fondation d’une philosophie scientifique, il s’avère commeune affaire de grande importance que l’Idée ancienne d’une logique for-melle soit déterminée conformément à sa nature ou, comme nous dironsplus précisément, par la mise en évidence de démarcations pré-tracéesa priori, et que, par suite, une telle logique elle-même dans sa puretéapriorique parvienne à son élaboration effective. C’est de cela qu’il nousfaudra parler en premier lieu. Pour l’essentiel, nous devons rappeler briè-vement les développements que j’ai déjà livrés dans le premier volumede mes Recherches logiques, les Prolégomènes à une logique pure, et que j’ai déve-
[3]
7354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
loppés plus en détail dans le premier livre de mes Idées pour une phénoméno-logie pure.
Si l’on suit à présent les parallèles entre la logique et l’éthique, ouencore le parallèle entre les types d’actes et les types de raison auxquels serapportent essentiellement ces disciplines – à savoir la raison judicatived’une part, et la raison pratique d’autre part –, la pensée s’impose alorsqu’à la logique, au sens précisément et étroitement délimité d’une logiqueformelle, doit aussi correspondre en parallèle une pratique [Praktik] for-melle et également apriorique en un sens analogue. Il en va à peu près demême pour le parallèle avec la raison évaluative [wertend], évaluante ausens le plus large, et non pas simplement évaluante esthétiquement, parexemple. Cela conduit à l’Idée d’une axiologie formelle en tant que disci-pline formelle apriorique de valeurs, ou encore de contenus de valeur etde significations de valeur – discipline qui, pour des raisons essentielles,est intimement entrelacée à celle de la pratique formelle. Délimiter cesIdées de nouvelles disciplines formelles, que la tradition philosophique atoujours ignorées, et en réaliser effectivement des échantillons, tel est lethème principal de ces leçons. Il nous faudra ensuite, s’il nous reste dutemps, passer aux grands groupes de problèmes de la phénoménologie etde la critique de la raison, qui s’orientent d’après ces disciplines formellesradicales. À la logique formelle correspond un système de structures fon-damentales de la conscience-de-croyance (de la conscience doxique,comme j’ai coutume de dire), et par suite une phénoménologie et unethéorie de la connaissance formelle ; il en va de même pour l’axiologie etla pratique formelles eu égard à la discipline phénoménologique qui leurest principiellement associée, c’est-à-dire la théorie de l’évaluation et lathéorie de la volonté (termes qu’il faut entendre ici en un sens analogue àcelui de l’expression de « théorie de la connaissance »). Venons-en à pré-sent aux choses !
Pour ce qui est de la logique, on sait qu’elle provient de besoins pra-tiques de la vie du jugement et de sa normation conformément aux Idéesde justesse ou encore de vérité. Historiquement, elle a surgi du combatcontre la skepsis qui, par ses excès subjectivistes et sceptiques, menaçait lascience grecque nouvellement apparue. Elle a été fondée par Aristote, lepère de la logique, comme une méthodologie de la connaissance scienti-
74 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[4]
7454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:33
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
fique. Nous pouvons dire à juste titre qu’elle vaut à ses yeux comme unetechnologie [Kunstlehre] de la connaissance scientifique, et ce point de vuetechnologique a dominé une tradition millénaire. Jusqu’à ce jour, la majo-rité des philosophes est acquise au point de vue que les matières traitéesdepuis l’Antiquité sous le titre de « logique » n’acquièrent d’unité et ne seregroupent légitimement en une discipline scientifique propre, face auxsciences particulières, que dans la mesure où, en tant que technologie dela connaissance, elle cherche à découvrir toutes les normes et toutes lesprescriptions pratiques requises pour la direction pratique de la connais-sance et, en particulier, pour la direction du connaître scientifique. Avecle développement de sciences rigoureuses toujours nouvelles, le champde cette logique méthodologique s’est sans cesse élargi. De nos jours, onlui assigne de préférence pour but la réalisation de l’Idée d’une méthodo-logie de la connaissance scientifique en général et, par suite, l’ébauche deméthodologies particulières pour les groupes de sciences particuliers etjusque dans les sciences singulières. Bien entendu, cette technologielogique est, quant à ses fondements théorétiques, dépendante de la psy-chologie.
Assurément, l’Idée d’une technologie logique générale fondée psy-chologiquement est pleinement légitime, tout comme le sont des techno-logies spéciales adossées à divers groupes de sciences et à des sciencessingulières. D’un autre côté, on a souvent et avec raison contesté que lepoint de vue d’une technologie, d’une méthodologie de la connaissance,fût le seul capable de conférer une unité aux vérités traitées sous le titre de« logique », face à celles de toutes les sciences particulières. Il est cepen-dant plus correct d’exprimer et de signifier les choses ainsi : le but de lanormation de la connaissance humaine et de l’avancement pratique de laconnaissance dans le sens des normes unit sans doute de multiples élé-ments théorétiquement hétérogènes, comme c’est le cas en général pourdes technologies, c’est-à-dire pour des disciplines qui se proposent de ser-vir non pas l’exploration d’un domaine concrètement [sachlich] unifié,mais la réalisation la plus parfaite possible d’un but universellement direc-teur. Mais si nous considérons le contenu de la logique traditionnelle, etplus précisément de la logique générale et « formelle », nous pouvonsalors mettre hors circuit tout ce qui est affaire de finalité [Abzweckung]
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 75
[5]
7554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pratique, visant à l’avancement d’une connaissance parfaite ; et par consé-quent nous pouvons aussi mettre hors circuit tout ce qui est d’ordre psy-chologique empirique ; et nous conservons alors des groupes de connais-sances concrètement interdépendants, qui s’étendent au-delà de ceux detoutes les sciences particulières et se fédèrent en une science propre quiconstitue le fondement théorétique le plus essentiel de la technologiepratique.
Que l’on considère le fonds essentiel des vérités de l’analytique aristo-télicienne, à savoir ce qu’on appelle les principes logiques : le principe decontradiction, celui du tiers-exclu et d’autres propositions similaires, quiont été, à l’occasion, formulées ultérieurement dans une intention princi-pielle identique, comme le principe de la double négation ; que l’on consi-dère la syllogistique aristotélicienne, en y incluant aussi tous ses dévelop-pements ultérieurs jusqu’à la logique mathématisante la plus récente ;toutes ces vérités et théories manifestent alors un caractère propre etintrinsèque et, en un certain sens, un caractère théorétique, dans lamesure en effet où la pensée d’une normation empirique et pratique desfonctions de connaissance humaines, d’une régulation pratique de laconnaissance leur est étrangère ou s’y ajoute comme un habillage exté-rieur dont elles peuvent toujours et a priori se dépouiller. Il en va de cesvérités comme de celles de l’arithmétique, qui se présentent à nous assezsouvent sous un habillage normatif, alors que nous savons fort bien qu’ils’agit là de propositions théorétiques d’une science théorétique, aux-quelles nous ne donnons une forme normative que pour les buts pra-tiques du calcul. Dans l’attitude théorétique de l’arithmétique, on a :(a + b) × (a – b) = a2 – b2. Mais dans l’attitude pratique, nous disons : pourmultiplier la somme et la différence, construisez la différence des carrés.C’est là une simple tournure normative de la proposition théorétique, unetournure que nous pouvons accomplir en définitive pour chaque propo-sition dans une application pratique. C’est ainsi que nous pouvons égale-ment dire : ou bien A est b ou bien A n’est pas b, il n’y a pas de troisièmepossibilité. Et tourné normativement : on ne doit pas approuver à la foisdeux propositions contradictoires ; si l’on approuve l’une, on doit alorsrefuser l’autre. De même pour toutes les propositions syllogistiques.Lorsque nous énonçons le principe suivant : de deux propositions de
76 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[6]
7654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
forme « tous les A sont B » et « tous les B sont C » découle la propositionde forme correspondante « tous les A sont C », il s’agit d’une propositionthéorétique qui ne comporte aucune normation ni régulation pratique.Pour toutes les propositions de ce type, on peut également se convaincre,par une analyse plus approfondie, que toute immixtion de pensées psy-chologiques dans leur contenu les falsifie, comme je l’ai montré en détaildans mes Prolégomènes.
Si l’on part de telles propositions de la logique traditionnelle, ou si onles regroupe d’emblée avec toutes les propositions qui leur sont essentiel-lement apparentées, comme celles de la syllogistique tout entière, on voitalors aussitôt, pour autant qu’on ne se laisse pas déterminer par des préju-gés psychologistes, s’ouvrir ici un domaine scientifique d’un genrepropre, dont la délimitation naturelle est désormais une tâche importante,notamment du point de vue philosophique. De cette manière, on s’élèveà l’Idée d’une logique pure – plus exactement, formelle –, d’une disciplineapriorique d’un genre tout à fait propre qui se distingue nettement detoutes les autres sciences réelles et possibles et se rapporte cependant àtoutes, pour autant que toute science possible est a priori un champ d’ap-plication possible de cette logique formelle.
On en vient d’abord à une Idée restreinte, à savoir celle d’une logiquede l’apophansis ou, en d’autres termes, d’une science des propositions engénéral, des jugements en général. J’ai assimilé ici propositions et juge-ments. Proposition ne signifie pas ici proposition grammaticale, mais signi-fication idéale-identique de propositions énonciatives [Aussagesätze] gram-maticales, quels que soient les sons contingents allemands, chinois ouceux de toute autre langue qui, d’une façon ou d’une autre, les sertissentempiriquement dans une langue. C’est en ce sens que nous parlons tousdu théorème de Pythagore, qui reste un et le même, quel qu’en soit lelibellé allemand ou français, etc. Mais est également « proposition » en cesens, une unité idéale-identique qui est insensible à la différence des sujetscontingents qui jugent, à leurs actes de jugement, au fait que ceux quijugent ainsi soient des hommes ou des anges ou tout autre être. Lorsquela logique parle de jugements au lieu de propositions, il est clair qu’elle neveut pas dire des vécus de jugement au sens psychologique, tels qu’ils sur-viennent, d’après l’expérience, chez des animaux de l’espèce homo. Et il est
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 77
[7]
7754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
également évident que jugement ou proposition n’est pas ici un conceptgénéral qui s’individualiserait dans des actes de jugement, dans un com-portement judicatif, mais [qu’il s’individualise] dans le « quid » [Was] jugé,i.e. dans les significations respectives des propositions énonciatives. Ceque je veux dire en jugeant, ce que j’énonce en parlant, c’est la proposi-tion, la signification de l’énoncé.
C’est donc à la proposition, au jugement logique en ce sens idéal que se rapporte lalogique apophantique ; elle peut être comprise comme une science de signifi-cations idéales, et tout d’abord, à son niveau inférieur, comme unescience qui répertorie les formes possibles de propositions relevanta priori de l’Idée de signification ou, comme nous pouvons en l’occurrencedire aussi, de l’Idée de proposition, que les propositions soient ou nondes vérités. De là résulte l’Idée d’une morphologie pure des propositions(des significations en général), sur laquelle s’édifie, comme niveau supé-rieur, l’Idée d’une théorie de la validité [Geltungslehre], c’est-à-dire d’unediscipline qui recherche les lois de validité se fondant a priori sur les for-mes de propositions possibles a priori. Cette logique proprement apo-phantique traite donc de la vérité et de la fausseté des propositions, maissur la base de leur simple forme. S’y rattache la théorie des modalisationsde la vérité : la théorie de la possibilité et de la probabilité formelles, etc.La généralité « formelle » de cette logique tient à ce qu’il n’est absolument pasquestion en elle d’une quelconque sphère concrète [Sachsphäre] déter-minée, à laquelle se rapportent le cas échéant des propositions effectives.Rechercher ce qui vaut pour des choses déterminées, des objets indivi-duels, et ce qui vaut en général pour des objets d’un domaine concretdéterminé, c’est une tâche qui incombe aux sciences matérielles, parexemple à l’astronomie, à la philologie, à la physique générale, à la géo-logie, etc. Et relèvent également de ces sciences toutes les assertions quivalent pour des propositions géologiques, philologiques, physiques, brefpour des propositions matériellement déterminées. La logique enrevanche se prononce sur des propositions en général, et la généralitéformelle signifie qu’elle laisse les termes des propositions – termes parlesquels des propositions se rapportent précisément à leurs sphèresconcrètes déterminées – dans une généralité indéterminée, tout commel’arithmétique laisse indéterminées les unités du dénombrement, ou
78 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[8]
7854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
comme l’algèbre énonce des propositions au sujet de nombres en général,les nombres étant pensés dans une généralité indéterminée, et de ce faitdésignés au moyen de lettres. Dans l’application des lois algébriques, leslettres sont, selon le cas d’application [dem Anwendungsfall gemäß], rempla-cées par les nombres déterminés. La logique apophantique est donc enquelque sorte une algèbre des propositions, et, comme dans toute algèbre, cequi est déterminant, c’est la simple forme de la formation [Bildungsform],en l’occurrence la forme de la formation des propositions. C’est juste-ment ainsi que devient compréhensible l’universalité de la référence de lalogique formelle à toute science déterminée réelle ou possible. La sciencedéterminée énonce des propositions déterminées et cherche à fixer desvérités déterminées. À chaque étape, elle se place sous les lois formellesque la logique énonce pour des propositions en général et des vérités engénéral, en se fondant sur leur simple forme. Si nous nommons catégoriesde signification les concepts fondamentaux de la logique formelle – ceuxqui, dans ses vérités fondamentales immédiates ou axiomes, figurentcomme concepts déterminants – il faut alors caractériser la logique for-melle comme la discipline apriorique fondée sur les catégories formellesde signification, discipline qui ne comporte en soi absolument rien depsychologique.
Or, comme nous ne tardons pas à nous en convaincre, les catégoriesformelles de signification sont, par essence, entrelacées aux catégories for-melles objectives. Par exemple, il est évident a priori que toute proposition serapporte à des objets et que tout objet possible est objet de propositionsvraies possibles. Nous avons donc par là même mis en relation, et mêmedans une relation d’essence, la catégorie proposition avec la catégorie objet.De même la signification de prédicat, la signification de relation, la signi-fication de connexion, etc., sont des catégories formelles de significationqui se rattachent, par essence, à des concepts tels que propriété, rela-tion, etc. Et l’entrelacement d’essence est tel que toute proposition valideportant sur des vérités, et par conséquent toute proposition logique apophan-tique peut être également considérée comme, ou convertie en une proposition ontologiqueformelle.
Si nous suivons la piste de cette indication, nous voyons alors qu’il neserait pas bon de séparer logique formelle et ontologie formelle. Dès lors
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 79
[9]
7954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
qu’on a saisi la pensée de ce qu’est l’ontologie formelle, on est naturelle-ment contraint de reconnaître toutes les propositions qu’elle embrassecomme étant de la même essence que les propositions logiques. Or, onobtient ainsi un élargissement extraordinaire de l’Idée de logique for-melle. On finit alors par reconnaître que toutes les disciplines fort impro-prement intitulées analyse, théorie des nombres, théorie de la multiplicité– bref, l’ensemble des mathématiques, pour autant qu’elles excluent toutconcept matériellement déterminé – relèvent de la logique formelle, etqu’avec certains contenus originaires de la logique traditionnelle, elless’intègrent à un contenu scientifique essentiellement unitaire, à unescience qui, certes, se déploie en de multiples disciplines particulières. Ilfaut ici entendre l’expression d’ontologie « formelle » de la même façonque plus haut celle de théorie formelle des propositions. De même quecelle-ci traite de propositions en général et de leur validité, de même celle-là traite des objets en général, objet en général devant être défini, confor-mément à la corrélation avec la catégorie de signification « proposition »,comme tout ce qui peut devenir sujet d’un énoncé vrai. De la catégorieformelle originaire « objet » découlent d’autres catégories formelles,comme celles d’état de choses, propriété constitutive [Beschaffenheit], rela-tion, connexion, pluralité ou ensemble, nombre, série, nombre ordinal,grandeur, etc. Et toutes les vérités fondées a priori dans de tels conceptsformels d’objets constituent le contenu de l’ontologie formelle.
Mais, comme nous l’avons dit, en vertu de la corrélation entre catégo-ries (formelles) de signification et catégories formelles objectives, il estindispensable, comme cela a déjà eu lieu dans mes Recherches logiques,d’étendre l’Idée d’une logique formelle au point de lui faire embrassertout l’a priori qui se fonde dans les deux types de catégories. Il semble queLeibniz, dans ses pensées éparses sur une mathesis universalis, ait eu en vuela même discipline qu’ici nous avons simplement déterminée de façonscientifiquement plus approfondie ; c’est pourquoi j’aime à utiliser moi-même cette expression leibnizienne pour désigner cette discipline. Laréférence à la totalité des sciences possibles s’ensuit aussi d’elle-mêmepour les propositions ontologiques formelles : chaque science a undomaine, ses objets ; chaque science matérielle possède sa sphère d’objetsdélimitée par un concept matériel (et non pas ontologico-formel). Or
80 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[10]
8054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
l’ontologie formelle, pour autant qu’elle explore l’a priori inhérent à l’Idéeformelle « objet en général », donc sans considération d’aucune particula-rité matérielle, trouve une application possible dans toute science pen-sable. C’est ainsi, par exemple, qu’il ne peut y avoir aucune science où desobjets ne puissent être rassemblés en groupes et dénombrés, de sorte quela théorie ontologique formelle des ensembles et des nombres doit êtrenécessairement applicable à toute sphère scientifique.
En dépit de cette unification d’essence qui se manifeste entre lalogique apophantique et l’ontologie formelle et qui requiert une scienceenglobante dans laquelle toutes deux puissent être intégrées, il est pour-tant clair qu’une logique apophantique, en tant que science des formes depropositions possibles et des lois de vérités possibles (de propositionsvraies) sur le fond de leur seule forme, peut être saisie pour elle-même etpurement délimitée dans son Idée propre. Cette discipline fera plus parti-culièrement l’objet de nos considérations ultérieures. Pour l’heure, il fautencore considérer qu’en vertu de la corrélation du juger et du jugement(en tant que le « jugement rendu » dans le juger), toute propositionlogique apophantique doit être convertie en une proposition noétiqueformelle, c’est-à-dire en une proposition qui se prononce a priori sur lajustesse ou la non-justesse formelles du juger.
<§ 2. L’opposition entre empirisme éthique et absolutisme éthique>
Venons-en à présent à l’éthique ! Elle aussi a historiquement vu lejour comme une discipline normative et pratique. Pour le traitement desproblèmes éthiques, le point de vue pratique est d’ailleurs resté dominant.Cela se comprend par les motifs pratiques qui ont de tout temps donnélieu à des réflexions éthiques et n’ont cessé de faire apparaître l’élabora-tion [Ausbildung] d’une discipline éthique comme un important desideratumpratique.
Nous accompagnons notre propre agir tout comme celui de nossemblables de jugements [Beurteilungen] constants sur ce qui est « juste »et « injuste » [ « recht » und « unrecht » ], « conforme au but » et « nonconforme au but » [ « zweckmäßig » und « unzweckmäßig » ], « raisonnable »
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 81
[11]
8154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
et « déraisonnable », « moral » et « immoral ». Comme dans le domainethéorétique, d’assez fréquents conflits et divergences dans les jugementsse produisent ici également. Souvent, nous sommes en désaccord avecnous-mêmes, nous réprouvons ce que nous avions approuvé aupara-vant, ou approuvons ce que nous avions tantôt réprouvé, ou bien nousnous trouvons placés dans un pénible conflit avec autrui ou sommes sol-licités comme juges pour arbitrer un conflit étranger. Le conflit de cesjugements ne suscite en général aucun intérêt théorétique, mais il n’enémeut que davantage notre affectivité [Gemüt]. Tout notre bonheur ounotre malheur dépendent souvent de ces prises de position et de leurcohérence ou incohérence ; il y va, en effet, de la conservation de notrepropre estime de soi ou du respect de nos semblables. Ainsi, la questiondevient brûlante pour quiconque aspire à s’élever plus haut : commentdois-je ordonner rationnellement ma vie et mes aspirations, commentéchapper à la déchirure qui me tourmente, comment échapper à laréprobation légitime de mes semblables ? Comment puis-je faire de mavie tout entière une vie belle et bonne et, comme le dit l’expression tradi-tionnelle, comment atteindre l’authentique eudaimonia, la véritable félicité[Glückseligkeit] ?
Dès lors qu’elles en viennent à occuper le foyer de la réflexion, cesquestions conduisent d’abord, de par leur nature, à une éthique en tant quediscipline pratique. Je dis d’abord, car, non pas tant dans l’Antiquité qu’àl’époque moderne se manifeste une aspiration de plus en plus insistante àadjoindre à cette discipline éthique pratique (qui ne renie pas son carac-tère empirique et anthropologique) une éthique apriorique, et à délimiterun système de principes absolus et purs de la raison pratique. Ceux-ci,affranchis de toute référence à l’homme empirique et à sa situation empi-rique, doivent pourtant assumer la fonction de fournir des étalons [Richt-maße] absolument normatifs pour tout agir humain, que ce soit unique-ment formellement ou aussi matériellement. Aussi l’analogie avec ce qui sepasse pour la logique saute-t-elle aux yeux. Et ici non plus, à savoir dansl’éthique, on ne niera pas l’utilité, voire la nécessité d’une « technologie »,celle qui porte précisément sur l’agir rationnel ; mais on soutiendra assu-rément que les fondements théorétiques les plus essentiels de la techno-logie résident non dans la psychologie des fonctions de connaissance et
82 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
8254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
des « fonctions affectives » [Gemütsfunktionen], mais bien plutôt dans cer-taines lois et théories a priori, qui sont appelées, conformément à leur senspropre, à fonctionner comme normes rationnelles pour tous les juge-ments éthiques aussi bien que logiques, et comme les étoiles tutélairespour quelque praxis rationnelle que ce soit.
L’idéaliste dira : pas plus que l’Idée de la vérité ne peut être tirée dela psychologie de la connaissance, l’Idée de la bonté morale et du bien-fondé pratique en général ne saurait être tirée de la psychologie desfonctions affectives et des fonctions pratiques. Des faits on ne peutextraire aucune Idée. Mais dès que, de part et d’autre, nous mettons horscircuit les Idées, les disciplines normatives et pratiques qu’on appelle tra-ditionnellement logique et éthique perdent leur contenu central [Kernbe-stand] et leur sens propres. Il est à remarquer que l’Idée d’une théorieapriorique des principes éthiques a surgi dans le contexte d’un renou-veau du platonisme, au début de l’époque moderne, à savoir au sein del’école de Cambridge, et que le courant de l’éthique de l’entendement[Verstandesethik] qui en est issu, aime à mettre en parallèle l’éthique et lamathématique pure, mise en parallèle que nous trouvons encorereconnue par Locke.
Contre l’apriorisme éthique (représenté aussi par Kant, à sa façon,dans la période critique de son développement) se dresse, comme on sait,l’éthique empiriste. Historiquement, l’opposition entre éthique pure etéthique empirique a laissé son empreinte sous la forme trompeuse d’uneopposition entre éthique de l’entendement et éthique du sentiment ; nousne le rappelons ici que pour souligner expressément qu’il est bon de com-mencer par mettre hors circuit la question de l’origine des concepts éthi-ques (à savoir s’ils proviennent de la sphère de l’entendement ou de cellede l’affectivité) et de s’en tenir exclusivement à l’opposition entre éthiqueapriorique et éthique empiriste. De sorte que, sous le titre d’éthiqueapriorique, il faut penser à une discipline qui, à la manière de la mathéma-tique pure, précède toute expérience et lui prescrit cependant sa norme.De même que l’arithmétique pure fixe les lois qui se fondent dans l’es-sence pure du nombre, qui valent ainsi dans une universalité incondi-tionnée, et qu’il ne faut pas enfreindre si l’on veut que les nombres mis enœuvre et calculés dans un dénombrement factuel et empirique puissent
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 83
[12]
8354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
véritablement être des nombres ; de même que ces lois prescrivent doncdes normes rationnelles à tout dénombrement empirique, de même doit-il en être ainsi pour les lois éthiques pures par rapport aux corrélats pursdes concepts éthiques, aux décisions et aux actions rationnelles. Demême que l’arithmétique pure est le fondement essentiel de l’art pratiquedu calcul [praktischen Zählkunst], de même une éthique pure devrait doncêtre le fondement essentiel d’un art ou d’une technologie de l’agir humainrationnel. C’est donc ainsi que se présente d’emblée, par analogie avec lalogique pure et l’arithmétique pure, l’Idée d’une éthique pure. Mais ducôté opposé se dresse l’empirisme éthique, en tant que psychologisme oubiologisme, qui réfère tout ce que l’aprioriste revendique comme principepur, à la particularité de la nature humaine et de la vie du sentiment et dela volonté humains, et qui, par suite, ne considère et ne tient pour valablel’éthique que comme une technologie adossée à la psychologie et à labiologie.
Ce conflit, tout comme le conflit parallèle en logique, touche manifes-tement à des enjeux philosophiques suprêmes. De même que la consé-quence du psychologisme logique et de l’anthropologisme en général estle scepticisme théorétique, de même l’anthropologisme éthique nousconduit au scepticisme éthique. Or, cela revient à renoncer à la validitévéritablement inconditionnée des exigences éthiques, à nier, pour ainsidire, tout devoir effectivement obligatoire [verpflichtenden Pflicht]. Desconcepts comme « bien » et « mal », « rationnel » et « irrationnel d’unpoint de vue pratique », deviennent de simples expressions de faits empi-rico-psychologiques de la nature humaine, telle qu’elle se trouve être enfait, telle qu’elle s’est formée au cours de l’histoire de la culture, dans lescirconstances contingentes du développement culturel humain et, plus enamont, telle qu’elle s’est développée biologiquement dans l’évolution del’espèce humaine dans la lutte pour l’existence, etc. Si l’empiriste a raison,ces concepts n’expriment aucunement des Idées absolues, qui auraient le sensuniversel de devoir [Sollenssinn] pour tout être doué de volonté et de sensi-bilité, à quelque monde, réel ou pensable de façon cohérente, qu’il appar-tienne. Conformément à cela, toutes les normes éthiques, telles qu’ellesdoivent être tirées des principes éthiques en tant que conséquences, n’au-ront qu’une simple validité de fait. « Des normes éthiques valent », cela
84 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[13]
8454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
veut dire que des hommes se sentent, de fait, obligés de telle ou tellefaçon, qu’ils sentent en eux, pour des raisons relevant de la causalité psy-chologique, une certaine pression et contrainte intime à se comporterpratiquement d’une certaine manière et d’échapper ainsi à un malaise quiserait sinon psychologiquement inévitable. C’est une affaire d’utilité bio-logique, que se soit développé chez les humains quelque chose commeune fonction de conscience morale [Gewissensfunktion], une forme de jugementconsistant à approuver ou réprouver éthiquement des actions, des inten-tions, des caractères, selon les catégories du « bien » et du « mal ». Com-ment se déroulera l’évolution ultérieure, nous ne le savons pas ; il se pour-rait qu’à terme cette fonction se révèle biologiquement superflue, qu’elles’étiole et qu’à sa place apparaisse une autre fonction, qui, tout en conser-vant une certaine communauté de forme, aurait pourtant des principesdivergents, de sorte que bien et mal, par exemple, permuteraient leurspositions respectives.
Naturellement, ces Idées et idéaux absolus, comme tous les autres,perdent de la sorte la signification métaphysique qui leur est attribuée, ducôté des idéalistes, pour la totalité de la réalité effective. L’homme pro-jette ses Idées et idéaux, apparus de façon contingente et temporaire, surl’Univers infini, il se forge une raison absolue comme ultime principetéléologique de l’être, et, dans sa filiation divine, il se sent désormais àl’abri. Cette hypostase et absolutisation des Idées qui lui sont biologique-ment utiles peut elle-même avoir une valeur biologique, et peut-êtremême revêtir une utilité biologique d’une dignité particulièrement élevée ;mais prendre au sérieux l’hypostase, ce serait tomber dans une mytho-logie de concepts. Ici comme partout, comme le dit Vaihinger, la véri-table philosophie serait la philosophie du « comme-si ». Il est bon de pro-céder en pratique comme si ces fictions avaient une validité absolue, maisd’un point de vue théorétique, on doit se rendre à l’évidence que tout celane vaut que relativement, anthropologiquement, du point de vue de l’éco-nomie de la pensée, de l’économie de la conservation, que tout cela nepossède qu’une utilité relative.
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 85
[14]
8554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 3. Les conséquences anti-éthiques de l’empirisme éthique>
Ce conflit touche manifestement aussi aux intérêts pratiques su-prêmes. La théorie sceptique requiert une praxis sceptique, ce qui signifieune praxis anti-éthique. Quelle que soit l’ardeur avec laquelle les pragma-tistes éthiques s’empressent de nier précisément cela, ils ne le peuventqu’à condition de renoncer à la conséquence effective. À présupposerune conséquence rigoureuse en théorie et en pratique, cela ne ferait-ilvraiment aucune différence, que, comme empiriste, on professe le relati-visme sceptique ou, comme idéaliste, l’absolutisme éthique ?
1 / Supposons que celui qui agit se tienne sur le terrain de l’absolu-tisme éthique ; il croit alors en un Bien en soi, en tant que validitéabsolue, qui vaut respectivement dans chaque cas qui se présente, parcequ’il est conforme à une Idée valant a priori (indépendamment de toutefacticité de ceux qui veulent et agissent, de leur constitution psycho-physique contingente, etc.). Supposons que cette Idée, avec toutes sescomposantes, soit connaissable avec évidence [einsichtig] dans sa validitéabsolue, et que soient également connaissables les principes absolus quise fondent dans sa pure essence ; et de même pour le cas singulierempirique : dans quelle mesure une action, par exemple, serait conformeà ces principes ou bien contraire à leur sens pur. Eh bien, celui qui agitsait alors qu’il est absolument lié ; il sait qu’il est tout aussi fermementlié dans son comportement pratique aux principes éthiques, qu’il l’estdans le calcul à des principes arithmétiques. Ainsi on dit en calculant :tant qu’est maintenu le sens de 2 et 4 – qui est ce qu’il est, que cela soitbiologiquement utile ou non de le penser – l’équation 2 × 2 = 4demeure valide. Il se peut qu’il soit biologiquement utile de calculerfaux, mais calculer faux reste calculer faux et ne deviendra jamais chosevraie par une quelconque utilité biologique. Le sens identique prescrit laloi. Exactement de la même façon, le sens des Idées éthiques et pra-tiques (s’il y a ici quelque chose de tel, comme l’absolutiste en est préci-sément convaincu) prescrit des principes. Ce qui est bon reste bon, cequi est mauvais reste mauvais. Aussi longtemps que le sens de telsconcepts est maintenu, tout ce qui appartient purement à ce sens, et à
86 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[15]
8654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
quoi l’on ne peut renoncer qu’en renonçant au sens, est valide. Et cettevalidité n’est pas théorétique, mais pratique. De même qu’à la vérité, etpar suite aussi à la vérité éthique, correspond une reconnaissance théo-rétique dans la croyance, de même au bien correspond une approbation[Billigung] évaluative et, le cas échéant, une volition, une réalisation pra-tique ; d’autre part, au mal correspond une réprobation, et cela, de partet d’autre, en un sens idéal et non pas en un sens empirique. Un acte dejugement qui reconnaît comme vrai quelque chose de non-vrai est toutà la fois incorrect et sans valeur ; un agir qui réalise ce qui n’est pas bon,est tout à la fois incorrect, irrationnel et sans valeur. Ce que ce genre deconvictions et d’avis [Ansichten] signifient pratiquement, est clair. Saisirle vrai dans l’évidence, c’est, du moins au moment de l’intuition évi-dente, le poser comme vrai et, ce faisant, juger correctement. Avoirl’évidence pleine et entière du bien pratique, l’avoir clairement devantles yeux comme quelque chose qui, le cas échéant, s’impose [Gebotenes],cela signifie, du moins au moment de l’intuition évidente, se tournervers lui en le voulant. Et saisir avec évidence en général, et même êtreseulement fermement convaincu que, dans tout agir, il y a une normeabsolue qui est directrice, d’après laquelle il doit précisément se diriger,cela veut dire d’emblée, d’une façon générale, tendre la volonté danscette direction, vouloir suivre l’orientation générale vers le bien. Cela neveut certes pas dire qu’il parvienne à une réalisation effective etcomplète.
2 / Il en va tout autrement pour celui qui tire les conséquences del’anthropologisme sceptique. Pour lui, parler de bien en soi ou de malen soi se réduit à un simple préjugé. Pourquoi donc devons-nous, sitelle est notre conviction, nous laisser déterminer par les modes d’éva-luation si prétentieux qui, sous les titres de « bien » et de « mal », fonttant parler d’eux alors qu’ils n’expriment que des contingences de laculture et de l’évolution humaines ? Pourquoi ne devrions-nous pas, sinous en avons envie sur le moment, nous opposer aux sentiments quidécoulent de ces sources, et montrer à cette conscience morale dont onfait tant de cas, et qui n’est pourtant qu’une voix d’instincts historiques,la prépondérance de notre puissance subjective ? Pourquoi nous laisserenchaîner par elle ? Faisons ce qui nous plaît et montrons ainsi que
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 87
[16]
8754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
nous sommes libres ! Si le monde environnant réagit là-contre, il estpossible alors que la crainte de telles réactions nous contraigne de fait,mais peut-être cela nous convient-il de braver un monde de souffrance.Si l’on nous dit que ce serait insensé, nous répondrons qu’il n’y a iciaucune Idée absolue de folie, non plus que de raison ; sinon, ce serait sesituer encore de façon inconséquente, sur ce point, sur le terrain del’absolutisme. En outre, la dissimulation [Verborgenheit] de notre agirpeut nous protéger d’éventuels dangers. Si l’on invoque l’utilité biolo-gique, le sceptique peut alors répondre que c’est assurément bien là sonprincipe, que le bien est ce qui est biologiquement utile, et que c’est jus-tement pourquoi ce mode d’évaluation en est venu à s’imposer et à seconstruire des remparts dans le sentiment. Mais si, après tout, cela nousplaisait de faire quelque chose qui est biologiquement inutile, voiredommageable ? Nous ne tenons peut-être pas à notre vie et ne faisonsaucun cas de toute la biologie, de l’existence du monde des bêtes et deshommes, etc. Dans ce cas, nous sommes libres d’agir comme nous ledésirons. On ne pourra plus alors recourir à l’objection selon laquellefaire quelque chose qui nous est dommageable serait irrationnel, qu’agircontre son autoconservation et celle de l’ensemble de la communautéhumaine serait insensé, répréhensible, etc. Car que signifie « insensé »,« irrationnel », etc. ?
Il est donc clair que la théorie empiriste ou, ce qui revient au même,anti-éthique requiert une praxis anti-éthique, tout comme la théorie idéa-liste requiert une praxis véritablement éthique. D’un côté, l’idéaliste (l’abso-lutiste) éthique, s’il est conséquent, ne peut pas faire autre chose qu’obéir àsa raison, il ne peut éviter de s’efforcer, de façon pleinement consciente,de subordonner sa vie à des étalons éthiques. Il choisit par là même ceque, selon sa conviction, une raison pratique exige de lui comme étantl’unique et absolument juste [Richtige]. Le subjectiviste éthique, en revanche,récuse précisément toute raison pratique, donc toute obligation se pré-sentant avec une prétention à la rationalité. On ne peut, à proprementparler, dire qu’il doit agir de façon immorale, c’est-à-dire selon le modedu mal moral et plus généralement du mal éthique. Car celui qui neconnaît ni ne reconnaît aux exigences morales aucune validité authen-tique, c’est-à-dire absolue, ne peut non plus avoir la moindre conscience
88 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[17]
8854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:34
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
de pécher. Le « scio meliora... »1 ne peut se produire dans son cas. Du pointde vue de l’absolutisme éthique, il faudrait donc dire : l’empiriste éthiquene peut agir mal, mais seulement de façon éthiquement erronée, mais il nepeut pas davantage agir éthiquement bien, au sens où le bien est l’opposédu mal. À l’un comme à l’autre appartient l’évidence et la tendance pra-tique vers le bien. Le méchant agit en dépit de cette évidence, il fait vio-lence à la tendance au bien qui va de pair avec cette saisie évidente. Lebon, là où il agit moralement, agit en cédant consciemment à cette ten-dance. Et la conviction peut alors aussi servir de support à l’évidence.C’est précisément pour cela que je parlais à l’instant de conviction anti-éthique. À terme, c’est l’ensemble du mode d’estimation du prochain etdes prétendus idéaux d’humanité qui se modifie. Que peut bien signifierla « vénération » ou l’ « admiration » pour un sceptique, que peut signifierle discours sur les valeurs suprêmes de la personnalité, etc. ?
Ce conflit a son analogon dans la sphère logique. À la question de lavalidité objective et absolue des normes éthiques correspond celle de lavalidité absolue des normes logiques. Le conflit au sujet de l’Idée d’unbien en soi a son parallèle dans le conflit au sujet de l’Idée de la vérité ensoi, le conflit concernant le rapport de la « technologie éthique » à la psy-chologie a son parallèle dans le conflit concernant le rapport de la techno-logie logique à la psychologie également.
De part et d’autre, le psychologisme puise une force toujours nouvelledans les mêmes arguments, qui nous paraissent dans un premier tempsaller de soi, être à première vue entièrement contraignants et irréfutables.Des normes scientifiquement fondées pour une activité psychique présup-posent la connaissance scientifique de cette activité ; donc règles de lapensée et règles du vouloir reposent respectivement, cela va de soi, sur unepsychologie du penser et une psychologie du vouloir. Les fondementsessentiels de l’éthique résident par conséquent dans la psychologie. Et toutaussi puissant paraît l’argument sur l’origine des concepts normatifs fon-damentaux de part et d’autre. Tous les concepts, dit-on, sont produits par
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 89
[18]
1. Recte : « Video meliora proboque, deteriora sequor » (Je vois le meilleur et je l’approuve, mais jefais le pire) : Ovide (Métamorphoses, VII, 20-21) place ces mots dans la bouche de Médée. Brentanocite fréquemment ces vers dans ses cours et ouvrages, par exemple au § 25 de l’Origine de la connais-sance morale, en remplaçant video par scio (ce qui atteste que Husserl cite d’après Brentano). (N.d.T.)
8954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
abstraction à partir d’intuitions de cas singuliers concrets. Manifestement,les concepts logiques fondamentaux, tels que ceux de vérité et de fausseté,et tous les autres concepts essentiellement logiques (« concept », « juge-ment », « inférence », « démonstration », etc.) ressortissent au domaine dujugement, au domaine de la psychologie de l’intellect. Si je veux com-prendre et me rendre parfaitement clair ce que veut dire vérité, je dois faireretour à des jugements ; si je veux comprendre ce que signifie inférence, jedois me transposer dans un acte d’inférer, etc. De même je dois, pour lesconcepts de « bien » et « mal », faire retour à certaines activités affectives[Gemütsbetätigungen], à certaines approbations et réprobations qui se rap-portent à des volitions ou à des convictions [Gesinnungen]. Vertu et vicesont manifestement des noms pour des dispositions psychiques ; bref, depart et d’autre je suis reconduit à du psychique. La psychologie est donc lefondement [Fundament] de la logique et de l’éthique.
De l’autre côté, l’absolutisme, qui défend la valeur absolue et incondi-tionnellement objective du logique et de l’éthique, considère les consé-quences de la doctrine psychologiste et cherche dans les inconvénients decelle-ci des arguments vigoureux en faveur de son propre point de vue.Relativement à l’éthique, cela se produit dans des considérations du typede celles que nous avons développées précédemment. On montre qu’unethéorie anti-éthique aurait pour conséquence une praxis anti-éthique. Onpeut aussi essayer de montrer d’une façon semblable que la négationparallèle de la validité absolue du logique requerrait une praxis anti-logique. Si le relativiste logique (le psychologiste et le biologiste) estconséquent, il devrait renoncer à toute science, l’effort scientifique per-drait son but propre.
Admettons que la pertinence [Triftigkeit] ou validité logique ne signifierien d’autre que ceci : notre nature humaine est de fait constituée et biolo-giquement conditionnée de telle sorte que nous, hommes, devonsapprouver certains principes fondamentaux, certains théorèmes, certai-nes démonstrations, etc. comme soi-disant scientifiques, et en réprouverd’autres appelés « non scientifiques » ; l’évolution ultérieure pourrait alorsfort bien apporter des changements, il pourrait se faire que les hommes secomportent dans leurs évaluations logiques tout à l’inverse de mainte-nant. Parler d’une vérité effectivement valide objectivement n’aurait alors
90 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
9054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pas de sens, se proposer comme but sa découverte, aspirer à connaître leschoses telles qu’elles sont en vérité, ce serait là un but chimérique,absurde du point de vue pratique.
Toutefois, les argumentations à partir des conséquences peuvent etdoivent être saisies d’une autre manière encore, plus aiguë et plus pro-fonde. Il est d’un intérêt capital de remonter jusqu’à l’ultime et radicalcontresens [Widersinn] qui affecte le scepticisme. En particulier, il est d’ungrand intérêt de voir si et jusqu’à quel point ce qui a été accompli dèsl’Antiquité, à cet égard, à l’encontre du scepticisme logique, peut l’êtreaussi et avec la même force contraignante contre le scepticisme éthique.Celui qui connaît les analyses platoniciennes et aristotéliciennes du sub-jectivisme et du scepticisme sophistiques, finit par acquérir l’évidence quetout négativisme logique se détruit lui-même par contradiction, et celaabstraction faite de toute praxis.
Or on est en droit de douter qu’une argumentation à partir des consé-quences pratiques, que la déduction d’une praxis anti-éthique à partir d’unnégativisme éthique représente une réfutation aussi vigoureuse, ou qu’enprocède quelque chose comme un contresens. Quelque chose comme uncontresens pratique ? Mais qu’est-ce qu’un contresens pratique ? Uncontresens n’est-il pas quelque chose de théorétique, une contradiction,une incompatibilité dans les choses mêmes ? Le « contresens pratique »ne consiste-t-il pas simplement, à la fin, en des conséquences désagréa-bles, fatales, devant lesquelles nous reculons, contre lesquelles notre sen-timent [Gefühl] se cabre ? Cependant, des sentiments ne peuvent rienprouver. Et qui dit que d’autres êtres vivants ne sont pas dotés d’autressentiments, de sorte que les mêmes conséquences pourraient leur appa-raître fort aimables ? En tout cas, la méthode de l’analogie que nous vou-lions suivre requiert que l’on commence d’abord par ce point et que l’oncherche à établir par une analyse précise si, et dans quelle mesure, l’auto-suppression propre au scepticisme logique possède véritablement un ana-logon dans une autosuppression du scepticisme éthique1 et en quoiconsiste cette autosuppression.
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 91
1. Le texte porte : in einem Sich-Aufheben des Ethischen ( « dans une autosuppression del’éthique » ) ; nous lisons : in einem Sich-Aufheben des ethischen. (N.d.T.)
[19]
9154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 4. La réfutation du scepticisme et du psychologisme>
<a) L’invalidation [Aufhebung] du scepticisme logiquepar son contresens formel>
Tâchons d’abord de nous rendre totalement claire la situation dans ledomaine logique. N’abordons pas d’emblée les diverses formes particu-lières de l’anthropologisme relativiste, et du scepticisme qui lui est équi-valent. Attachons-nous aux formes les plus simples et les plus ancien-nes ! Protagoras, comme on le sait, dit : « La mesure de toutes choses estl’homme, l’homme individuel avec son état individuel ; vrai est pour cha-cun ce qui lui apparaît comme vrai, et ainsi tout est vrai, à savoir tout ceque quiconque énonce comme lui apparaissant. » D’autre part, Gorgiasdit : « Rien n’est vrai ; et s’il y avait une vérité, elle serait en tout casinconnaissable. »
Si nous comprenons ces affirmations tout à fait radicalement, aussiradicalement que Platon et Aristote les ont comprises et ont cherché àles réfuter, la réfutation prend une tournure bien connue et pleinementsatisfaisante. Le subjectiviste sceptique pose une thèse et la justifie. Ilprétend donc que ce qu’il énonce par elle vaut effectivement et que lajustification qu’il avance pour elle [la] justifie effectivement. Celaimplique que ce qui est ainsi énoncé est censé exclure les opinions diver-gentes ou opposées concernant l’état de choses à connaître [Erkenntnis-sachlage]. Le sceptique peut bien personnellement expliquer qu’il n’élèveaucune prétention ; c’est peine perdue. Car nous voyons que l’essencede son assertion, comme manifestement de toute assertion et de toutejustification en général, implique, comme appartenant inséparablement àson sens, qu’il y a une vérité objective et une connaissance de la véritéobjective, et que n’est pas vrai ce qui semble vrai à chacun. Mais c’estexactement le contraire que stipule le contenu des thèses et des justifica-tions chez le sceptique. Il y a donc un conflit, nous le voyons de façonpleinement évidente, entre ce que le sceptique avance et justifie préten-dument dans le contenu de ses thèses, [d’une part], et, d’autre part, ceque présupposent d’après leur sens général toute thèse et toute fonda-
92 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[20]
9254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tion en tant que telles, quel que soit par ailleurs leur contenu. En celaconsiste, comme l’a remarqué Platon, le contresens caractéristique duscepticisme.
Si nous procédons à une généralisation adéquate, ce type de contra-diction est également caractéristique d’une classe entière de théories scep-tiques en un sens plus large, comme vous le trouverez exposé dans le pre-mier tome de mes Recherches logiques1. Car si une thèse est fondée par unethéorie d’un certain type logique, et si l’état de choses est tel que la vali-dité de cette théorie, en tant que théorie d’un tel type logique, présupposeprécisément, conformément à son sens essentiel, ce que la thèse nie et ceque cette théorie, d’après son contenu, fonde prétendument, alors lathéorie se supprime elle-même par un contresens, d’une manière tout àfait semblable à celle du scepticisme extrême. Par conséquent : sont scep-tiques toutes les thèses et théories qui nient de quelconques conditions depossibilité sensée de la vérité en général, d’une théorie en général ; sontsceptiques des théories déductives visant à établir des thèses qui nient cesans quoi des théories déductives seraient tout simplement absurdes ;mais sont également sceptiques des théories inductives établissant desthèses qui nient ce sans quoi des théories inductives seraient tout simple-ment absurdes, et il en va ainsi par suite en général pour n’importe quellesthéories établissant des thèses qui nient ce sans quoi des théories de cetype logique général seraient tout simplement absurdes. Toutes les thèseset théories de ce genre, dis-je, sont, au sens élargi, sceptiques, et se détrui-sent par contradiction.
Ainsi, les théories psychologistes de l’expérience de l’école de Hume,par exemple, relèvent du type suivant : les principes dont dérive la validitéde toutes les inférences empiriques, de la validité desquels dépend parconséquent la validité de toute théorie empirique et de toute scienceempirique, sont dépourvus de toute rationalité. Ils ne se laissent pas saisirdans l’évidence comme des nécessités, mais tout au plus fonder psycholo-giquement. Ce sont de simples indices pour certaines propriétés de lanature humaine, telle qu’elle est de fait, propriétés qui s’expriment sous la
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 93
[21]
1. Recherches logiques, « Prolégomènes à la logique pure », chap. VII, § 32, Husserliana,XVIII, p. 118-120 (p. [A/B 110-112], trad. fr., p. 122-124). (N.d.T.)
9354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
forme des fameuses lois de l’association et de l’habitude. Ce faisant, oncherche à montrer en détail comment, du jeu des forces psychiques del’association, surgissent des tendances au jugement relevant de l’habitude,et finalement une impulsion aveugle de jugement orientée sur le contenude ces principes empiriques, et comment cette contrainte aveugle est fata-lement confondue avec l’authentique nécessité rationnelle, qui fait icitotalement défaut.
Toutes les théories de cette espèce sont sceptiques au sens que j’aidéfini, ce qui veut dire aussi qu’elles se suppriment elles-mêmes à caused’un contresens du type indiqué. Car, dans la construction de telles théo-ries, l’empiriste s’appuie sur la psychologie, et traite, par là même, cettedernière comme une science valant effectivement. Or, si la psychologieest tenue pour valide, elle doit être fondée rationnellement ; s’il n’est paspossible de la fonder rationnellement, alors elle ne peut valoir, ni servir debase à une théorie valide. Mais quelle est donc la thèse que veut fonder lathéorie empiriste ? Précisément celle-ci : que les principes de l’expérienceet par suite les sciences empiriques en général sont irrationnels, ne com-portent aucune validité rationnelle universelle. Et pourtant l’on présup-pose la valeur rationnelle de la psychologie, qui est elle-même une scienceempirique.
On peut encore formuler la chose de la façon suivante. La théoriehumienne s’appuie sur la psychologie. Si la psychologie n’a pas de fonde-ments accessibles à une évidence rationnelle, alors la théorie humiennen’en a pas davantage. Mais si la théorie en question prétend être ration-nelle et démontrer rationnellement qu’aucune science empirique n’estrationnelle, elle présuppose que, dans le cas particulier de la psychologie,ne vaut pas ce qu’elle vise à établir comme valide dans une généralitéinconditionnée ; en quoi réside précisément le pur contresens.
On pourrait certes penser qu’il s’agit là d’une particularité précisé-ment propre à cette théorie humienne, cherchant à réduire spécialementet expressément les principes de l’expérience, par exemple la loi de cau-salité, à l’habitude. Toutefois, un tel contresens est présent – quoique laplupart des psychologistes n’en soient guère conscients – dans touteinterprétation psychologiste du logique, et surtout dans toute dissolu-tion, effectuée en toute généralité, de la logique dans la psychologie, telle
94 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[22]
9454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
qu’elle se présente dans la doctrine tellement en vogue depuis Mill1 etBeneke, selon laquelle la psychologie fournirait le fondement théorétiqueessentiel de la logique, et selon laquelle les lois logiques ne seraient aufond2 rien d’autre que des lois psychologiques. La preuve du contresenssceptique est ici relativement facile, pour la raison suivante. Si, d’après laconception psychologiste, les lois logiques en général, et parmi ellescelles de l’analytique aristotélicienne, sont rapportées essentiellement à lanature humaine, si par conséquent elles expriment des particularités del’équipement de l’âme humaine [menschlichen Seelenausstattung], alors leurrevient une validité seulement temporaire, elles sont prises elles-mêmesdans le flux de l’évolution. Des psychologistes extrêmes, qui avaient lesalutaire courage d’être conséquents, l’ont d’ailleurs reconnu expressé-ment. Or considérons que toute assertion, dans la mesure où elle élèveune prétention à la vérité, présuppose le principe de contradiction. Elleveut énoncer le vrai, elle dit « il en est ainsi », et il appartient bienentendu à son sens qu’il est exclu qu’ « il n’en soit pas ainsi ». Qu’un « ilen est ainsi » exclue l’ « il n’en est pas ainsi » correspondant, c’est cela etrien de plus qu’énonce le principe de contradiction ; d’où il suit que, sansla validité de ce dernier, toute assertion élevant une prétention à la véritéperd son sens. Nous prenons conscience alors de l’absurdité de laconception psychologiste. Lorsqu’elle affirme qu’il est possible qu’unjour le principe de contradiction, et avec lui toute notre logique, nesoient plus valides, elle peut tout aussi bien énoncer la proposition sui-vante : il est possible que le principe de contradiction ne vaille pas toutcourt ; or cette proposition, comme toute proposition affirmant deschoses semblables, est absurde, puisqu’une telle proposition présupposepar son sens même la loi de contradiction. Toutes les vérités sur les-quelles s’appuie la théorie biologiste, toutes les vérités des sciences de lanature et toutes les vérités en général ne sont des vérités que dans la
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 95
[23]
1. L’interprétation psychologiste du principe de contradiction par John Stuart Mill appa-raît dans le Système de logique, livre II, chap. VII, § 4 (trad. fr. par L. Peisse, Paris, 1866, rééd.Pierre Mardaga, 1988, p. 315), et se trouve exposée et réfutée par Husserl dans le tome intro-ductif des Recherches logiques (chap. V, § 25-26, Husserliana XVIII, p. 88-93 (p. [A/B 78-84]),trad. fr., p. 87 sq. (N.d.T.)
2. En français dans le texte. (N.d.T.)
9554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mesure où vaut le principe de contradiction, car celui-ci ne dit riend’autre que ce qui appartient au sens de toute vérité en tant que telle.Mais construire une théorie qui, à partir de prétendues vérités quel-conques, veut inférer, comme une vérité, que ne vaut pas ou que n’estpas nécessairement valide une proposition qui explicite le pur sens dumot de vérité, c’est là une entreprise qui se détruit de façon sceptiquepar une contradiction.
On peut donc transposer mutatis mutandis [passend umgestaltet] la réfuta-tion platonicienne du scepticisme extrême de la sophistique à l’ensembledes formes de l’empirisme et du psychologisme. Qu’elles cherchent tantqu’elles veulent à nous aveugler par l’imposant appareil de la plus récentepsychologie, de la biologie, de la sociologie et de quelque autre théoriemoderne que ce soit, rien n’y fera : le contresens l’invalide. Dans ledomaine logique, il est donc possible de rendre évidente, dans sa forme laplus forte, la nécessité d’un absolutisme et par suite aussi la nécessité del’idéalisme : on peut rendre évident que toute conception contraire sedétruit elle-même, par un contresens qui est le plus universel, le contre-sens formel.
<b) L’analogon du contresens sceptique dans la sphère pratique :le contresens pratique>
Peut-on également procéder ainsi en éthique ? Peut-on discréditer decette façon le scepticisme éthique, d’abord sous ses formes plutôt gros-sières, mais aussi par suite dans ses formes plus raffinées ? Il y a unemanière très puissante de le combattre à partir des conséquences, nous enavons déjà parlé. Elle ne met pas en lumière de contresens théorétique,mais elle examine plutôt les inacceptables conséquences pratiques. Onpourrait certes dire que, de cette façon, elle s’adresse avant tout au cœur[Gemüt]. Elle présuppose que nous faisons quelque cas de la morale et, aufond, que nous sommes nous-mêmes convaincus qu’une raison pratiquenous donne à voir avec évidence la différence entre le juste et l’injuste,entre le devoir et le péché, et exige avec évidence de nous l’agir juste. Sil’on nous montre ensuite que le scepticisme éthique extrême, mais aussile scepticisme plus subtil du psychologisme, conduisent pratiquement à
96 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[24]
9654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
un amoralisme absolu, alors cela nous apparaît comme quelque chosed’inadmissible. Nous reculons devant une telle conséquence.
Une théorie qui égare l’homme au point qu’il ne comprend plus lavoix de la conscience et qu’il perd tout intérêt pour la réalisation desvaleurs suprêmes, toutes les valeurs qu’il est appelé à réaliser, est unethéorie bien triste. Elle est complètement inacceptable. Mais une tellethéorie peut bien, par ses conséquences pratiques, prévenir contre ellenotre affectivité, elle peut en même temps nous sembler fausse, elle n’estpas pour autant formellement contradictoire. Un contresens formel, telqu’il se niche dans les théories qui nient in thesi quelque condition de pos-sibilité que ce soit de la vérité ou de la théorie en général ne saurait semanifester ici, puisque la négation sceptique de l’éthique ne nie justementpas de telles conditions.
Dans son ingénieux [geistreich] ouvrage sur la Philosophie des valeurs1 (etauparavant déjà dans ses Fondements de la psychologie2), Münsterberg a sansdoute cherché à construire une argumentation éthique parallèle à l’ar-gumentation platonicienne. À l’encontre de la théorie d’un scepticismeéthique extrême, il dit en effet : celui qui affirme qu’il n’y a pas de devoirl’obligeant de façon inconditionnée, veut par cette affirmation – qui estune action – atteindre un but, à savoir la reconnaissance de la dénégationéthique [sittliche Leugnung] de la part de l’auditeur. Or, l’auditeur qui vou-drait se fier au sceptique devrait alors par avance douter que le sceptiquese sente lui-même tenu en général d’exprimer sa véritable conviction. Lesceptique ne devrait donc pas attendre qu’on accorde le moindre crédit àson assertion. Il entreprend une action dont le but est rendu inaccessiblepar son propre acte, par sa propre assertion.
Je ne puis approuver cette argumentation. Le sceptique se prononceet l’auditeur peut bien, en effet, se demander s’il peut se fier au locuteurquant à sa sincérité [Wahrhaftigkeit]. Ici comme ailleurs, il se fiera à cetégard au locuteur, s’il ne trouve pas occasion de supposer le moindremotif qui pourrait rendre vraisemblable l’absence de sincérité du locu-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 97
1. Hugo Münsterberg, Philosophie der Werte, Leipzig, 1908. (N.d.E.)2. Hugo Münsterberg, Grundzüge der Psychologie, Band 1, « Allgemeiner Teil, Die Prinzipien
der Psychologie », Leipzig, 1900. (N.d.E.)
9754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
teur, ou bien inversement, s’il trouve occasion de supposer d’autresmotifs plaidant positivement en faveur de sa sincérité. Or on ne voit paspourquoi de telles raisons de croire devraient être récusées, lorsque lelocuteur explique que, selon sa conviction, il n’y aurait aucun devoirinconditionné, et pourquoi par ailleurs le sceptique ne serait pas en droitd’attendre raisonnablement, lors d’un tel énoncé, la moindre créance de lapart de l’auditeur. Nous croyons bien même des menteurs notoires ; nouscroyons des hommes que nous tenons pour totalement mauvais et quenous savons disposés à mentir aussitôt que leur intérêt l’exige. Nousavons seulement besoin de trouver dans la situation donnée des raisonsde supposer qu’il est en l’occurrence fort utile au menteur de parler vrai.Mais du sceptique au menteur, il y a encore une grande distance. Il a laconviction théorique qu’il n’y a aucun devoir au sens propre. C’est ellequ’il veut faire partager, et pas nécessairement pour la raison précise quece faisant il remplirait son devoir. Et assurément, rien, dans le fait de lacommunication, n’implique que celui qui communique suive ou doivesuivre en tant que tel un devoir. Cela lui fait peut-être plaisir de s’expri-mer, d’enseigner, de montrer à d’autres sa supériorité, etc.
L’argumentation de Münsterberg échoue. N’y aurait-il pas cependantun moyen, par le constat d’un contresens, de réfuter la thèse éthico-sceptique de façon analogue à celle qu’on a pu mettre en évidence au sujetdes thèses logico-sceptiques ? Effectivement, il y a ici un contresensparallèle et une réfutation parallèle. Pour les obtenir, au lieu de proposi-tions théorétiques, prenons plutôt des exigences, des propositions-de-devoir [Sollenssätze]. Des propositions comme : « Il n’y a pas de bien ensoi », « il n’y a pas de devoir inconditionné », « il n’y a pas de raison dansl’agir » sont des propositions énonciatives, des propositions théorétiques.Une exigence, en revanche, dit : tu dois agir ainsi, fais ton devoir, agis rai-sonnablement, etc. Ce sont de telles propositions, non de simples asser-tions théorétiques, mais des exigences pratiques, que formule l’éthique,pour autant qu’elle cherche à être une discipline pratique, qu’elle estcensée nous offrir des normes de l’agir pratique. Le sceptique en matièred’éthique peut éviter le contresens formel, lorsqu’il énonce théorétique-ment : il n’y a pas de devoir. La situation devient plus périlleuse pour luis’il exprime des exigences, s’il nie l’éthique ou de quelconques conditions
98 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[25]
9854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
essentielles de la possibilité d’une éthique (en tant que technique régula-trice de l’agir) tout en continuant à être un éthicien pratique, et donc àformuler des exigences, des règles de l’agir. Il n’est pas nécessaire en celaque se manifeste une contradiction et un contresens pratique ou théo-rique, si la skepsis n’est ni absolue ni générale mais se restreint seulement àune sphère particulière de la praxis. Celui qui entend l’éthique en tant quemorale et comprend sous le titre d’action morale un groupe particulierd’actions, comme celles qui se réfèrent à de supposés motifs originairesde l’amour du prochain, celui-là ne tombe nullement dans un contresensformel s’il nie à leur égard l’existence de devoirs éthiques, s’il récuse dequelconques exigences se présentant avec une prétention à la validitéabsolue et positivement évaluées comme morales, tout en continuant àformuler des exigences.
Il en est ici comme dans la sphère du logique. Quelqu’un de sceptiquevis-à-vis, par exemple, des possibilités d’une connaissance empirique entant que connaissance de la réalité extérieure, peut échapper à tout con-tresens tant qu’il n’est pas sceptique vis-à-vis de la connaissance en géné-ral. Ce n’est pas lorsqu’il a combattu la possibilité d’une justificationrationnelle de la connaissance scientifique empirique que Hume esttombé dans le contresens, mais plutôt lorsqu’il a en même temps donnéune théorie psychologique de cette connaissance – théorie qui, en tantque théorie scientifique reposant sur l’expérience, présupposait la possi-bilité d’une connaissance scientifique reposant sur l’expérience. Il tenaitfermement à la validité objective, et même inconditionnellement objec-tive, de la logique analytique et de la connaissance analytique qui lui cor-respond, ou plus généralement, à la validité objective de la connaissanceau sens des « relations entre idées », se distinguant par là avantageusementdes empiristes ultérieurs à la1 Mill. Mais certes, celui qui réduit au psycho-logique la pensée analytique et ses principes de validité [Geltungsprinzipien]et devient sceptique dans cette sphère, celui-là ne peut éviter le contre-sens. Cela tient à ce que les principes analytiques de la pensée, comme leprincipe de contradiction, impliquent les conditions les plus générales dela possibilité d’une pensée valide en général. Que nous pensions analy-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 99
1. En français dans le texte. (N.d.T.)
[26]
9954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tiquement ou empiriquement, dans la mesure où nous énonçons, dansla mesure où nous formulons des propositions assertoriques[Behauptungssätze], des propositions qui élèvent en général une prétentionà la vérité, nous sommes soumis aux lois triviales [selbstverständlichen] quiappartiennent de façon inéliminable [unaufhebbar] au sens de la vérité engénéral. Bien que la pensée analytique soit un domaine spécial de lapensée, il n’en reste pas moins que les principes qui la régissent sont desconditions de possibilité de toute pensée valable en général, y compris dela pensée scientifique empirique, dans la mesure où celle-ci aussi doit enfin de compte se mouvoir dans des prédications.
Il en va de façon semblable en éthique. Nous pouvons nous intéres-ser particulièrement à une morale en un quelconque sens restreint, mais ilnous faut prendre garde au fait que le vouloir et l’agir moraux sontd’abord précisément un vouloir et un agir, et que, si des différences dejustification rationnelle appartiennent à la sphère morale, c’est biend’abord dans la sphère la plus vaste qu’il faut les repérer. En d’autrestermes, nous ne pouvons pas nous consacrer à une éthique scientifiquesans avoir au préalable soulevé la question la plus générale, celle de la rai-son dans la sphère pratique [im Praktischen], et sans avoir exploré les prin-cipes d’une raison pratique en général en tant que principes formels de laraison dans la praxis. Qu’est-ce que l’agir rationnel en général, et quelssont les principes sous lesquels se tient l’agir rationnel en général, qu’ilsoit ou non jugé moral ? En effet, il n’est pas partout question de morale.Si je me demande si je dois [soll] écouter ce soir un vaudeville sans pro-fondeur ou bien la sublime [Symphonie] Héroïque de Beethoven, je puis medécider rationnellement pour la seconde, mais il ne s’agit là nullementd’une question de conscience au sens moral. Si donc nous assignons àune éthique ses limites naturelles, nous devons la comprendre commeune « technologie » de l’agir rationnel en général, tant selon la forme queselon la matière. Celle-ci, par elle-même, n’explorera pas seulement selonla forme ce qui relève du sens universel de la rationalité, mais chercheraaussi à cerner, en fonction de la matière, les différents ordres ou niveauxdes valeurs pratiques, et à déterminer ce qui est rationnel au suprêmedegré et les règles qui en relèvent. Si nous avons établi adéquatement l’a-nalogie avec la logique, il est aisé de voir qu’on devra retrouver la diffé-
100 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[27]
10054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
rence entre éthique formelle et éthique matérielle, et que le véritable con-tresens sceptique dans la sphère pratique se manifeste dans des exigencesqui s’énoncent avec le sens d’exigences rationnelles et qui, en mêmetemps, abandonnent dans leur contenu la rationalité en général.
Reconnais ceci en tant que règle ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Suiscette règle, cela ne veut pas dire : agis toujours de sorte que ton agir soitconforme à cette règle, et qu’une considération comparative de tesactions établisse donc qu’elles ont toutes tel ou tel type général – un peucomme les processus naturels se tiennent sous une loi de la nature –, maisplutôt : agis de sorte que tu te laisses guider par la règle, que tu accomplis-ses ce qu’elle prescrit.
Cela peut, certes, être signifié à la manière d’une suggestion, commelorsque l’hypnotiseur adresse à son médium une exigence générale en tantque règle, ou comme lorsque le maître parle à l’esclave, lequel, élevé dansune obéissance aveugle, laisse l’exigence générale (le commandementgénéral) exercer aveuglément sur lui son effet, à la manière d’une sugges-tion. (De même chez l’enfant encore déraisonnable.) Mais si je dis :« Reconnais cette règle ! », il y a pourtant quelque chose de plus qui estsignifié, à savoir : « Reconnais la validité rationnelle de cette règle pra-tique, reconnais qu’agir ainsi, c’est agir de façon juste, qu’il est rationnelde se laisser conduire volontairement par cette règle ! » et plus encore :« Laisse-toi effectivement guider ainsi ! » Celui qui ordonne appréhendecelui qui est placé sous sa volonté impérative comme celui par qui l’ordresera transposé dans les faits, et cela en vertu de l’ordre ; [il considère]donc que l’injonction du donneur d’ordre devient un acte ordonné pourl’exécutant, accepté et réalisé en ce sens par celui-ci ; ainsi, le sens de touteinjonction pratique implique l’attente que l’injonction en vienne à s’exer-cer comme motif pour l’action correspondante de celui qui est enjoint,par cela même que celui qui est enjoint a justement compris l’injonction.
Si je dis à présent : « Ne reconnais aucune règle comme valable pourton action ! », que se passe-t-il ? Si je dis : « Ne respecte pas une certainerègle, telle ou telle règle ! », cela revient à dire : reconnais qu’elle n’est pasrationnellement contraignante, ne te laisse pas déterminer positivementpar elle, ne la prends pas comme une règle ! Or il y a là encore une règle :d’un côté, il faut voir qu’agir comme l’exige cette règle ne serait pas agir
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 101
[28]
10154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:35
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
rationnellement, et d’un autre côté, il faut voir que la volonté contradic-toirement opposée de ne pas se lier, dans les groupes d’actions probléma-tiques, à cette règle, serait une volonté rationnelle et que, de ce fait même,conformément à la raison, il faudrait reconnaître la règle de volonté néga-tive, i.e. ne pas agir conformément à la règle initiale. S’il est demandé àprésent : « Ne reconnais aucune règle pratique ! », il y a là la règle, à recon-naître comme rationnelle, qu’aucune règle en général ne serait rationnelle,que toute volonté liée par une quelconque règle serait irrationnelle, ouencore que la volonté de ne suivre aucune règle serait rationnelle. D’unautre côté, si je dis : « Ne reconnais aucune règle pratique ! », j’énoncealors une règle pratique et même une règle qu’il serait rationnel de recon-naître et qu’il serait juste de suivre pratiquement. Cela réside dans le sensde toute règle de cette forme, toute règle qui est plus que simplement sug-gestive. D’un autre côté se trouve posé comme pratiquement irrationnel,dans le contenu de cette règle, ce que la règle présuppose comme ration-nel en son sens même. Nous avons donc bien là l’analogon exact du con-tresens sceptique.
De quelle espèce est la contradiction de la règle : « Ne reconnaisaucune règle logique en tant que contraignante pour ton activité judica-tive ! » – ce qu’il faut compléter ainsi : « Pour autant que tu veux atteindrepar son moyen le but de la vérité » ? Par conséquent : ne reconnais aucunerègle logique comme contraignante pour ton « vouloir-penser-vrai », pourton aspiration à la vérité ! On ne peut pas ici argumenter en disant : touterègle comprend une énonciation sur un devoir, tout énoncé, s’il veut êtrevrai, présuppose comme valide le principe de contradiction, donc cetterègle se supprime elle-même. La règle en l’occurrence ne nie aucune règlelogique, en tant que vérité logique (pas plus qu’elle n’affirme quoi que cesoit à son sujet). Elle dit simplement que, scilicet conformément à la rai-son, aucune vérité logique ne doit déterminer normativement, en tant querègle, l’aspiration à la vérité.
Il faut par conséquent compléter : si le principe de contradiction estvalide (en tant que partie intégrante du sens de tout énoncé, et donc éga-lement de tout énoncé de devoir), il serait irrationnel de ne pas le recon-naître pratiquement comme règle du jugement. La règle : « Ne te lie pas àlui ! » signifierait bel et bien : « Ne le respecte pas ! », ce qui serait évidem-
102 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[29]
10254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ment absurde, car de cette façon un juger contradictoire ne serait plusexclu du but visé par la volonté, alors même que ce dernier est de recon-naître exclusivement comme but le juger vrai. Aucune règle pratique nepeut se supprimer de façon purement logique ; une telle règle se supprimepar un contresens pratique, qui peut par ailleurs s’enchaîner à un contre-sens logique ; mais rien de plus.
<c) Récapitulation. L’analogie entre l’affirmation sceptiqueet l’exigence sceptique>
Après cette longue pause, à laquelle nous ont condamnés la Pentecôteet les dies academicae, renouons le fil de nos considérations là où nous enétions restés avant les vacances. Il s’agissait de mener à leur terme les ana-logies entre éthique pure et logique pure, entre idéalisme (ou absolutisme)éthique et idéalisme logique. Le conflit au sujet de l’Idée d’un bien en soi,de valeurs en soi, avait dans sa généralité un analogon dans le conflit ausujet d’une vérité en soi ; au psychologisme éthique correspondait le psy-chologisme logico-théorétique.
Si l’on suit ces analogies, se pose alors la question de savoir si la réfu-tation du psychologisme dans le domaine éthico-axiologique se laisseeffectivement mettre en forme aussi radicalement que dans le domainelogico-théorétique. Au sujet de ce dernier, les considérations critiquesnécessaires ont été développées suffisamment loin ; il s’agit de mettre enévidence – et nous l’avons fait – le contresens radical qui réfute le psy-chologisme dans la sphère de la vérité, ou encore dans la sphère pure-ment logique, à partir d’une raison ultime. Pour ce qui concerne lasphère éthique, nous avions parlé dans les leçons antérieures de consé-quences pratiques insoutenables du psychologisme et du relativismesceptique en général, mais le doute subsistait quant à la question desavoir si nous pouvions nous satisfaire de cela. Le psychologisme éthi-que et axiologique se supprime-t-il également par quelque chose commeun contresens ? Par quelque chose comme un contresens pratique ? Maisqu’est-ce, demandons-nous, qu’un contresens pratique ? Ne s’agit-il quede conséquences pratiques devant lesquelles nous reculons du point devue du sentiment, contre lesquelles notre sentiment se cabre ? Cepen-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 103
[30]
10354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
dant, des sentiments ne peuvent rien réfuter. La réfutation est affaire dethéorie et doit se manifester théoriquement en tant que contresensthéorétique.
Pour pénétrer plus avant, nous avons d’abord fait la pleine clarté surla situation dans le domaine logique, sur la manière dont l’extrême relati-visme et l’extrême scepticisme s’invalident eux-mêmes et dont le conceptd’une théorie sceptique déclarée ou larvée se laisse déterminer par un typede contresens des plus universels. On qualifie de sceptiques à l’extrêmedes thèses et les théories corrélatives lorsqu’elles nient des conditions depossibilité sensée d’une vérité en général, de théories en général, et parconséquent nient par là même implicitement ce qu’elles-mêmes présup-posent, d’après leur sens, en tant que thèses, que théories. On qualifieencore de sceptiques en un sens élargi les théories voulant démontrer desthèses qui nient quelque chose sans quoi des théories du type général enquestion – sous lequel tombe la théorie donnée – seraient en généralabsurdes. Dès que la considération réflexive d’une théorie nous a renduévident que sa thèse nie ce sans quoi elle-même perdrait son sens, nousen avons terminé avec elle ; elle est pour nous définitivement invalidée. Ilen va ainsi de toutes les théories psychologiques ou biologiques, lesquel-les sont censées, par exemple, établir la possibilité que les principes de lalogique formelle ont seulement une signification humaine de fait et qu’el-les changent avec l’évolution de l’homme, etc.
Pour ce qui regarde la logique, nous avons donc un sol ferme. Quelleque soit la façon dont nous délimitons l’Idée de la logique, pour peu quenous reconnaissions l’analytique aristotélicienne, ce qu’on appelle lalogique formelle, avec le principe de contradiction et les principes syllo-gistiques en tant que noyau fondamental, nous sommes assurés de laposition objectiviste, absolutiste, idéaliste – du moins concernant précisé-ment le domaine d’ensemble de la logique formelle et, par voie de consé-quence immmédiate, concernant celui de la mathesis universalis. La questionest à présent : peut-on procéder de même dans la sphère éthique ? Peut-on aussi réfuter le relativisme, l’anthropologisme, le psychologisme éthi-ques dans leurs formes plus ou moins grossières ou subtiles d’unemanière aussi puissante et leur imprimer le stigmate d’un contresenssceptique au sens propre ?
104 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[31]
10454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Nous avons entendu que Münsterberg, dans sa Philosophie des valeurs,avait fait une tentative malheureuse pour mettre en évidence, au sujet duscepticisme éthique, un contresens parallèle au contresens logique. Sonargument était le suivant : celui qui affirme qu’il n’y a pas de devoir l’obli-geant de façon inconditionnée, veut par cette affirmation (qui est uneaction) atteindre un but – à savoir la reconnaissance de la dénégationéthique de la part de l’auditeur. Or l’auditeur qui voudrait se fier au scep-tique devrait alors douter par avance que le sceptique se sente lui-mêmetenu en général d’exprimer sa véritable conviction. Le sceptique nedevrait donc pas attendre qu’on accorde le moindre crédit à son assertion.Il entreprend une action dont le but est rendu inaccessible par son propreacte, sa propre assertion. Une rapide analyse des motifs psychologiquesqui déterminent la créance ou la défiance de l’auditeur quant à la véracitédu locuteur, a montré l’inconsistance de l’argumentation – et surtout qu’iln’y a ici contresens ni de la part du locuteur qui présuppose la confiance,ni de la part de l’auditeur qui l’accorde.
Pour obtenir à présent un meilleur résultat, il nous faut prendre encompte deux choses. En premier lieu, pour réfuter une logique psycholo-giste, il faut avant toute chose réfuter le scepticisme et le subjectivismeradical le plus extrême, celui qui nie l’objectivité de la vérité ou qui la sup-prime implicitement. C’est là une première étape qui doit impérativementêtre franchie. S’y enchaîne aussitôt le constat de la pure idéalité de lalogique analytique, c’est-à-dire qu’elle est pure de tout élément psycholo-gique. On peut mettre en évidence les principes de la logique analytiqueen tant que conditions de possibilité inéliminables de la vérité en généralet d’une théorie déductive en général – et cela se transpose à toutes leslois syllogistiques, bref, à la totalité du contenu de la logique formelle, etce jusqu’à son élargissement à la mathesis formelle. Et l’on voit par suiteimmédiatement que la psychologisation des lois analytiques supprimeleur caractère d’idéalité, et par là même leur objectivité inconditionnée, etqu’être psychologiste en logique formelle équivaut ainsi pleinement à êtreun sceptique extrême, c’est-à-dire un sceptique qui abandonne l’objecti-vité de la vérité en général.
La sphère des lois logiques analytiques est l’unique sphère de loispourvues d’une validité générale absolument universelle pour toutes les
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 105
[32]
10554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
sphères d’être ou de connaissance concevables. Des lois comme, parexemple, celle de contradiction, n’expriment rien d’autre que des véritésqui appartiennent de façon inéliminable au sens de propositions vraies entant que telles. Dans la mesure donc où nous énonçons [quelque chose]en général, où, quel que soit l’objet sur lequel elles portent, nous formu-lons des propositions qui prétendent à la validité, nous sommes bienentendu liés par des lois qui ne font qu’expliciter le sens de propositionsvalides en tant que telles, de la vérité en général. Par conséquent, bien quela pensée analytique soit un domaine spécial de la pensée, les principesdont elle tire sa validité sont pourtant les conditions de possibilité d’unepensée valide en général, y compris celles, par exemple, de la pensée dansles sciences empiriques, pour autant que celle-ci doit aussi procéder à desprédications. La réfutation radicale du psychologisme logique exiged’abord, selon un ordre naturel clair, sa réfutation sous sa forme la plusgénérale, c’est-à-dire celle du scepticisme extrême. Ce n’est qu’après avoirmené à bien celle-ci qu’on abordera l’éradication de formes délimitées depsychologisme, par exemple du psychologisme de la logique de l’expé-rience, qui cherche à fonder par la psychologie – c’est-à-dire par unescience empirique particulière – les principes dont dépend la possibilitéd’une connaissance scientifique empirique en général.
Or, si l’analogie a effectivement la portée que nous lui supposons,nous devons alors admettre qu’un scepticisme éthique radical correspon-dra au scepticisme logique radical et que son radicalisme consistera à nierla validité objective de ce qui est éthique dans la sphère la plus large pen-sable, ainsi que les principes qui éventuellement la délimitent et les puresconséquences qu’ils renferment. Il nous faudrait en outre admettre qu’unpsychologisme éthique universel consistera, dans cette sphère la pluslarge de toutes, à dériver toute validité éthique de sources psychologi-ques ; et en outre, que le contresens qui affecte le scepticisme éthiqueextrême en tant que tel aura eo ipso partie liée avec le psychologisme, dansla mesure où, conformément au parallélisme, on parviendra à démontrerqu’un psychologisme universel et un scepticisme extrême, dans la sphèrela plus large de l’éthique, sont équivalents.
Les étapes ultérieures qu’il y aurait ensuite à franchir consisteraient àmontrer dans des sphères plus étroitement délimitées de l’éthique – déli-
106 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[33]
10654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mitées, bien entendu, non de façon arbitraire, mais sur la base de motifsprincipiels – qu’ici aussi les théories psychologistes et anthropologistesde la validité sont contradictoires. Peut-être qu’il est possible de mon-trer, ici comme dans la sphère logique, que l’examen des Idées les plusgénérales de validité logique et pratique permettrait d’emblée de mettreen évidence qu’idéalité et objectivité sont inséparablement liées, qu’onne peut ainsi abandonner aucune des deux, et que par suite on peut sedispenser d’une analyse spéciale des théories psychologistes et anthropo-logistes, en tout cas pour les réfuter – une telle analyse pouvant à larigueur servir à mettre en lumière les motifs qui inspirent les tentationspsychologistes. À partir de là l’investigation aborderait ensuite, de part etd’autre, les problèmes radicaux de la conscience, les problèmes dethéorie de la connaissance et de théorie de la volonté, qui cependant nesont pas ici d’emblée visibles.
Si nous poursuivons ces analogies de cette façon, nous devons poser laquestion : qu’est-ce donc que l’éthique au sens le plus large pensable,censée correspondre au logique au sens le plus large ? Il est manifestementréducteur d’identifier l’éthique à la morale. En quelque sens que ce soit,l’éthique se rapporte à l’agir, tout comme la logique se rapporte au penser ;de même que celle-ci porte sur le penser juste ou rationnel, celle-là portesur l’agir juste ou rationnel. L’agir moral, de quelque façon plus précisequ’on le détermine, est une sphère restreinte de l’agir en général ; parconséquent, l’éthique doit, si nous voulons obtenir le concept le plusenglobant, être ordonnée à la raison dans la praxis en général. « Scepticismeéthique extrême » doit, par la suite, signifier d’abord négation d’une raisonpratique en général, négation de toute valeur objective inconditionnéequelle qu’elle soit, dans le champ entier de la praxis. C’est ici que nousdécouvrons l’analogie. Des assertions sceptiques auraient ceci de caractéris-tique qu’elles nieraient généralement dans leur contenu ce qu’elles présup-posaient de façon sensée en tant qu’assertions. Des exigences sceptiquesseraient par suite, et de façon strictement parallèle, des exigences qui nie-raient généralement dans leur contenu ce que suivant leur sens elles pré-supposaient rationnellement en tant qu’exigences. Les exigences, ellesaussi, peuvent être négatives, et non pas simplement les énoncés ; au « celan’est pas » correspond un « ne fais pas cela ! ». Or, lorsqu’un « ne fais
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 107
[34]
10754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pas ! » général veut empêcher ce qui est présupposé par toute exigencerationnelle en tant que telle, nous avons un contresens sceptique.
De cette manière, ce serait donc <un contresens>1 si le sceptiquedisait – comme le voulait au fond la célèbre proposition protagoréenne« est bon ce qui semble bon à chacun » : ne te laisse pas persuader qu’il y aquelque chose comme une action qui l’emporte sur une autre action parsa prétendue rationalité ; agis de telle sorte que jamais tu n’accordes à tonaction une préférence du point de vue de la rationalité ; ou peut-êtremieux encore : n’agis jamais en sorte d’accorder à une quelconque actionpossible une préférence du point de vue de la rationalité et de te laisserdéterminer pratiquement par cela. Le « n’agir jamais ainsi » exigé est lui-même une exigence pratique, et cette exigence se présente avec une pré-tention à la rationalité. C’est comme si le sceptique disait théoriquement :« La seule action rationnelle est de ne reconnaître aucune rationalité dansl’action. » Si le sceptique énonce théoriquement : « Reconnaître (théori-quement) dans l’action une différence entre le rationnel et l’irrationnel estirrationnel (i.e. théoriquement irrationnel) », il n’y a alors aucun contre-sens sceptique in forma. Mais s’il parle sur le plan pratique, s’il dit qu’ilserait pratiquement rationnel de ne laisser aucune place dans l’action à lamoindre raison pratique, et s’il formule cela sous la forme de la règle : agisde sorte que jamais aucune différence rationnelle pratique n’exerce lemoindre effet – il y a alors bel et bien un contresens sceptique. Manifeste-ment, il en serait de même si l’on énonçait très généralement l’exigencesuivante : « Ne reconnais aucune exigence comme valable. » Ce qui estainsi exprimé est précisément une exigence, qui en son sens élève uneprétention à être reconnue, une prétention à la validité, laquelle entre enconflit avec son contenu inconditionnellement universel.
Bien entendu, tout cela concerne les propositions normatives quisont formulées avec le sens de la validité rationnelle. Il en va autrementpour des propositions impératives qui expriment des exigences sousforme de suggestions. Le locuteur attend que l’expression de l’ordreexerce psychologiquement un effet, mais il n’élève pas de prétention à lavalidité rationnelle ni à sa reconnaissance.
108 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Ajout de l’éditeur. (N.d.T.)
10854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
À l’issue de cette investigation, nous pouvons donc dire : il y a des exi-gences pratiques, des normes pratiques qui sont sceptiques à l’extrême, quise suppriment en tant que « formellement contradictoires » d’une manièrerigoureusement analogue à celle dont s’auto-invalident des énoncés« théorétiques » sceptiques à l’extrême. Les unes le font par une contradic-tion pratique, une contradiction entre le contenu de l’exigence pratique etce que présuppose le sens formel d’une exigence pratique en tant que telle ;les autres, par une contradiction théorétique entre le contenu de l’énoncéet ce que présuppose en son sens la forme logique d’un énoncé en tant quetel. Si nous avons découvert une analogie authentique en un point qui estvraiment radical, alors nous devons chercher à la prolonger et à la générali-ser. Mais ce qui nous frappe, c’est que, dans le conflit traditionnel entrescepticisme éthique et absolutisme ou idéalisme éthique, il manque toutela couche de discussions qui devrait fournir le parallèle rigoureux avec leconflit entre scepticisme théorétique et idéalisme théorétique ; et cela neconcerne pas seulement le parallèle entre scepticisme éthique et scepti-cisme théorétique extrêmes. Manquent également toutes les discussionsqui devraient se présenter comme strictement parallèles aux interpréta-tions psychologistes de la teneur de la logique traditionnelle.
La réfutation radicale du psychologisme et sa caractérisation commeune forme de scepticisme en un sens élargi, qui se supprime précisémenta priori comme intrinsèquement absurde et laisse apparaître comme uneaberration l’édification d’une doctrine logique des normes sur un fonde-ment psychologique empirique – une telle réfutation procède par recoursà l’analyse du sens des principes logiques formels. Ceux-ci ont été trans-mis par la tradition et il était facile par conséquent de s’y rattacher et d’ex-poser proprement, avec évidence, précisément par un simple appel à leursens, l’aberration sceptique du psychologisme. Or, nous ne nous trou-vons pas dans une situation aussi favorable en éthique, avec le psycholo-gisme éthique. Nous ressentons ici une grande lacune. Examinons plusexactement la situation générale dans une réflexion méticuleusementparalléliste !
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 109
[35]
10954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 5. Pratique formelle et axiologie formelle en tant qu’analogade la logique formelle>
<a) Le desideratum d’une pratique formelle pour la réfutationde l’empirisme éthique. Le sens des principes logiques>
On se bat en éthique, comme en logique, pour la possibilité d’unefondation absolue des concepts rationnels et normatifs, directeurs depart et d’autre, et des principes qui en relèvent. Relativisme et absolu-tisme, empirisme et idéalisme se font face en ennemis, et de part etd’autre le relativisme se décline sous les formes bien connues du psycho-logisme, du biologisme et de l’anthropologisme. On peut de part etd’autre caractériser le conflit comme une protection contre le scepti-cisme. Dans la sphère logique, le scepticisme se présenta d’abordcomme un négativisme ouvert, avec la négation ouverte de la possibilitéd’une connaissance objectivement valide et de l’existence d’une vérité ensoi. Sa contradiction fut clairement exposée par la célèbre réfutation pla-tonico-aristotélicienne. Dans le domaine logique, il fut alors possible demontrer que les différentes formes de scepticisme larvé, qui se croient siéloignées du scepticisme déclaré de la sophistique, équivalaient au scepti-cisme sophistique – et cela touchait toutes les tentatives modernes del’empirisme cherchant à psychologiser les principes logiques. En ce quiconcerne l’éthique, nous avons ainsi trouvé qu’il était certes possible deproduire une réfutation du scepticisme éthique déclaré, parallèle à laréfutation platonicienne, et qui met en évidence un contresens tout à faitanalogue à celui du scepticisme théorétique extrême. Mais nous avonsvu aussi que la situation, pour la suite de la réfutation de l’empirismeéthique d’usage courant, n’était nullement aussi favorable que pour cellede l’empirisme logique.
Il était possible de démontrer de manière nette et radicale que la psy-chologisation de la logique, sa transformation en une discipline psycholo-gique, l’interprétation des lois et des normes logiques comme psycholo-giques est une entreprise absurde [widersinnig]. Il suffisait pour cela deséparer nettement les principes et les théories apophantiques qui, formu-
110 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[36]
11054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
lés déjà depuis Aristote, formaient le noyau de toute logique, et que lenouvel empirisme, avec sa prédilection pour l’Idée d’une technologie dela connaissance humaine, a mélangés avec toutes sortes de doctrinesempirico-psychologistes. On n’avait besoin pour cela que de la constitu-tion d’une logique purement formelle et d’une simple analyse du sens deses principes. Il suffisait de porter le regard sur le sens pur et clair deceux-ci, et surgissait alors dans une parfaite évidence le caractère idéal etabsolu de ces lois et, par suite, le contresens que représentaient leursinterprétations psychologiques. Cela suffisait à rendre complètement évi-dent le fait que la logique et la psychologie sont des disciplines à séparernettement, et que, par voie de conséquence, il y a quelque chose commeune raison absolument connaissante en tant qu’Idée, dont l’essence doitêtre circonscrite par des lois idéales ; d’où résulte que tout empirismelogique doit être marqué au sceau du contresens.
En éthique, la chose se présente mal, puisque nous chercherions envain l’analogon de la logique formelle, telle qu’elle s’est développée tradi-tionnellement et dès l’Antiquité. Aristote fut le père de la logique parcequ’il a été proprement le créateur de l’analytique logique, de ce que nousnommons aussi logique formelle – quand bien même la pureté de l’inter-prétation des principes et des lois qu’il a en tout cas formulés laisseraitbeaucoup à désirer chez lui. Par son Éthique à Nicomaque, en dépit de toutce qu’elle nous offre de beau, il n’est pas, en ce même sens, devenu lepère de l’éthique. Si la conjecture qui nous conduit dans nos considéra-tions analogisantes est correcte, il devrait y avoir aussi dans la sphère éthi-que, celle de la praxis rationnelle, quelque chose comme une analytique,une pratique formelle, un système de principes et de lois qui font abstrac-tion de la « matière » de la praxis et formulent des légalités régissant lapure forme, en un sens analogue à ce que font les lois logiques formellesau regard de la connaissance et à la manière dont elles font abstraction dece qu’on appelle matière de connaissance.
On pourrait conjecturer que la raison théorétique devrait avoir sonanalogon dans une raison pratique, et qu’à l’essence de chaque type de rai-son ainsi que de ses corrélats devraient appartenir en un sens analoguedes distinctions entre forme et matière ; tout comme d’un côté, dans laforme logique des contenus possibles de jugement, résident des condi-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 111
[37]
11154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tions de possibilité aprioriques de la vérité, de même, dans la forme pra-tique, dans la forme des contenus possibles de volonté devraient résiderdes conditions de possibilité de l’analogon de la vérité rapportée à descontenus de jugement, et par conséquent des conditions de possibilité dela validité pratique, de la bonté pratique. On pourrait aussi conjecturerque la fondation de la logique analytique, l’orientation de l’intérêt sur laforme purement logique et ses légalités, était favorisée par le fait que, dutemps d’Aristote déjà, des fragments de sciences théorétiques étaient dis-ponibles, en particulier de science purement mathématique, et que dansles démonstrations et théories de celles-ci, les similitudes de la formes’imposaient franchement ; mais, d’autre part, l’éthique n’allait pas aussibien, parce que, pour la sphère de la praxis, de solides figures [Gestalten]analogues de la validité objective faisaient défaut, et qu’il manquait parconséquent un analogon de la science théorétique.
Ces considérations analogisantes m’ont conduit, il y a déjà de nom-breuses années, dès avant mes Recherches logiques, au problème de la consti-tution d’une pratique formelle, et j’ai cherché dans mes leçons de Gœttin-gen, depuis 1902, à montrer qu’il y avait là un desideratum réellementfondamental à prendre au sérieux, dont la réalisation n’est nullementinenvisageable.
Pour se rendre claire la situation en éthique, il faut prêter attention aufait que, depuis l’Antiquité, on a certes constamment parlé en éthique deprincipes éthiques, mais que ce qu’on appelle ici principe éthique n’estrien moins que l’analogon authentique de ce qui existe en logique sous letitre de principe logique. Et pas plus que les principes, les théories qui endépendent n’ont de part et d’autre aucune analogie authentique. Ce qu’onappelle traditionnellement « principes logiques », ce sont des lois for-melles ; ce qu’on nomme « principes éthiques », ce sont des lois nonformelles. Examinons d’abord de plus près le sens des principes logiqueset de la logique elle-même : dans quelle mesure elle est formelle.
Ce qui, dans la logique analytique apophantique, se présente sous letitre de principes, ce sont des propositions universelles qui énoncent cequi réside immédiatement dans le sens de la vérité en général ; et toute lalogique analytique apophantique ne veut rien de plus qu’exposer des loisprincipielles, et des lois et théories qui en dépendent, résidant dans l’es-
112 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[38]
11254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
sence de l’énoncé du point de vue de sa signification. Si nous nommonsla signification de l’énoncé proposition au sens logique, alors la logiqueanalytique traite de propositions, et ce dans une universalité formelle.D’une part morphologiquement, dans la mesure où elle donne une doc-trine des formes de propositions possibles, abstraction faite des objectitésparticulières auxquelles se réfèrent les propositions. La question est alorssimplement celle-ci : à partir de quelles catégories d’éléments les proposi-tions se construisent-elles en général ? Quelles sont, en relation avec cela,les formes fondamentales, les formes élémentaires de propositions et lesformes de leurs complexifications possibles ? D’autre part, et telle est latâche proprement logique : quelles conditions faut-il en général remplirpour des vérités ? Des conditions formelles sont des conditions qui sefondent dans la simple forme : une contradiction enfreint les conditionsformelles d’une vérité possible, dans la mesure où la teneur matérielle del’énoncé n’importe pas du tout par ailleurs.
Une proposition géométrique peut être fausse parce qu’elle pèchecontre des états de choses spécifiquement géométriques, contre des véri-tés qui se fondent dans la nature particulière de l’espace. Une proposi-tion géométrique peut cependant aussi être fausse pour des raisons quin’ont rien à faire avec l’espace, qui valent de la même façon pour toutdomaine et qui, de la même façon, sont sans rapport avec aucun d’entreeux, par exemple la contradiction : si une proposition a la forme« A est B » et si je vois que dans B est impliqué non-A, de sorte que j’ai« A n’est pas A », alors cette proposition est fausse pour des raisons for-melles. Je n’ai pas besoin de considérer de plus près A et, s’il signifiequelque chose de géométrique, je n’ai pas besoin de m’engager dans desconsidérations spécifiquement géométriques. Une proposition contra-dictoire est fausse en tant que telle. Il en va de même pour les complexesde propositions qui, en tant que touts, élèvent à leur tour une prétentionà la vérité, et doivent par conséquent être traités comme des proposi-tions. Une inférence, une démonstration peut être manquée parce qu’ellea eu recours à quelque chose de matériellement [sachlich] inadmissible.Mais elle peut aussi être manquée parce qu’elle se déploie dans uneforme qui, en général et abstraction faite de la particularité du domaine,exclut la vérité, i.e. la validité de l’inférence. Alors on dit que l’inférence
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 113
[39]
11354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
est fausse au sens spécifiquement logique, ou plus clairement : fausse ausens logique formel.
Après cette courte explication, il est désormais bien clair que lalogique formelle ne détermine pas ce qui est vrai à l’égard d’une quel-conque sphère matérielle. Elle se borne en effet à dire quelles conditionsdoivent être remplies quant à leur forme par des propositions en général,simples aussi bien que complexes, par exemple des démonstrations, desthéories, etc., pour qu’elles puissent être vraies en général. La significationuniverselle de ces propositions réside en ce que toute science sans excep-tion veut naturellement poser des vérités, et que des vérités sont précisé-ment des propositions vraies.
Si nous passons à présent à la sphère pratique, ce qu’on a toujourscherché à formuler sous le titre de « principes éthiques », et par suite delois éthiques, ce sont bien des propositions, et plus précisément des normesqui énoncent – et ce sur un mode convenant à tous les cas – ce qui estbon, à savoir ce qu’il faut aspirer à atteindre de façon rationnelle. Etcomme nous avons, dans le domaine des biens pratiques comme danscelui des valeurs en général, la différence entre « bien » et « meilleur » ainsique la différence entre « bon en soi » et « bon en vue d’autre chose », lesprincipes voulaient dire quels sont les biens suprêmes et quel est le souve-rain bien ; ils cherchaient à fixer quel est le but suprême de l’actionhumaine, à quoi il faut rationnellement aspirer.
<b) Le sens traditionnel des principes éthiques.La justesse formelle selon l’impératif catégorique de Kant
par opposition avec la justesse logique formelle>
Nous nous sommes entendus dans la dernière leçon sur le sens des« principes logiques » et des « lois logiques ». Ce sont des lois qui se rap-portent aux simples formes de signification (formes de proposition, deconcept, d’inférence et de démonstration), lesquelles expriment précisé-ment les conditions de possibilité de la vérité qui se fondent dans lasimple forme, et de même, de façon modalisée, pour la non-vérité, lapossibilité, la probabilité, etc. Nous pouvons dire aussi : a priori ce qui estpensé en tant que tel dans un penser possible, ce qui est jugé en tant que
114 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[40]
11454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:36
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tel dans un juger possible est constitué de telle sorte que, dans la simpleforme catégoriale des objectités jugées, abstraction faite de la particula-rité matérielle de ce qui est jugé, résident des conditions de possibilité dela vérité, ou, si l’on veut, de la justesse du juger qui s’y rapporte. Quelleque soit la chose que je puisse juger, le jugement ne peut être valide ques’il ne comporte aucune contradiction manifeste ou latente in forma. Laforme de la contradiction dans ses diverses configurations possiblesexclut le « vrai » et prescrit le « faux », abstraction faite de la matière dujugement. Quel que soit le domaine de connaissance matérielle, des syl-logismes peuvent entrer en jeu, et ils peuvent entrer en jeu en tout etsous toutes les formes. Mais si l’on veut que l’inférence soit valide, il nefaut pas qu’elle ait, par exemple, la forme « Tous les A sont B et tous lesB sont C, donc aucun A n’est C. » La vérité possible dépend légalementde certaines formes d’inférence. La possibilité de la vérité accomplit,pour ainsi dire, une sélection dans la totalité des formes d’inférence pos-sibles. Celles qui sont exclues exigent légalement l’adjudication de lafausseté ; et cela partout.
Ce qui est vrai ou faux dans une sphère concrète, la logique formellen’en préjuge [präjudiziert] que sous la forme de nécessités analytiques.Naturellement, l’universalité des lois logiques formelles se laisse particu-lariser dès lors qu’on détermine materialiter les termes algébriques des lois,donc exactement de la même manière que la pure proposition arithmé-tique 3 + 3 = 6, dans l’application à des pommes, acquiert la forme :3 pommes et 3 pommes font 6 pommes. Je peux donc, par exemple, direanalytiquement de deux propositions chimiques, optiques, ou philolo-giques, dont l’une affirme ce que l’autre nie, que l’une est vraie et l’autrefausse, et autres choses du même genre. Mais personne ne croira que, parces transpositions triviales de lois logiques formelles à la chimie, à la phy-sique et de même à d’autres domaines matériels de connaissance, on fassequelque chose comme de la chimie, de la physique, etc. Les nécessitésanalytiques résultent d’elles-mêmes du logico-formel par simple transpo-sition, par simple introduction de termes matériels. Mais ce que veut uneconnaissance matérielle, plus particulièrement ce qu’elle veut établir sousune forme de science, qu’il s’agisse de physique, de chimie, de philo-logie, etc., ce sont les vérités spécifiquement matérielles, des vérités qui,
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 115
[41]
11554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pour ce qui regarde le matériel, ne sont pas vraies sur la base de sa simpleforme catégoriale mais sont vraies précisément pour ce matériel, ou sontvraies pour le matériel sur la base de ses genres et espèces matériels géné-raux. Les nécessités analytiques laissent donc intacts des champs de véritéinfinis qui, par opposition, sont nommés synthétiques, et ce sont là leschamps des sciences extra-logiques. Ce n’est qu’en tant qu’auxiliaires, entant que chaînons de la méthode [Kette in der Methode], selon l’expressionde Kant, que des lois logiques et des nécessités analytiques entrent en jeudans les sciences matérielles. C’est donc à bon droit que l’on dit que de cequi est vrai dans une quelconque sphère de connaissance (en excluantbien évidemment la sphère analytique), nous ne pouvons décider par lesseules lois logiques. Elles ne nous fournissent que des remparts contre lafausseté formelle ; donc non pas contre toute forme de fausseté, maisseulement contre celle qui dépend de la simple forme logique.
Passons maintenant à la sphère pratique. On a cherché ici à formulersous [le titre de] principes éthiques et par suite [de] lois éthiques, précisé-ment des lois normatives qui prescrivent positivement, d’une façonuniversellement valide, ce qu’est le bien, ce à quoi il faut rationnellementaspirer. Puisque, dans le domaine des biens pratiques (comme, analogi-quement, dans celui des valeurs en général), se présentent des distinctionsentre « bon » et « meilleur » et en outre, entre bon en soi et bon en vued’autre chose, les « principes » voulaient dire quels sont les biens suprêmesou quel est le souverain bien. On cherchait donc par eux à mettre enlumière positivement quel est, dans le domaine total des biens pratique-ment accessibles, le bien qui mérite rationnellement d’être poursuivi pourlui-même et non pas simplement en vue d’un autre [bien], et qui occupe unrang si privilégié par rapport à tous les autres biens accessibles que tous cesautres biens, à supposer qu’ils puissent entrer en ligne de compte, ne lepourraient que comme moyens au service de ce bien désigné comme lebien suprême. La situation est ici par conséquent autre qu’en logique.Celle-ci avec ses principes logiques (dans lesquels sont analytiquementincluses toutes les autres lois logiques) ne veut ni ne peut jamais déciderpositivement de ce qui est le vrai dans chaque sphère de connaissance pos-sible. Elle ne peut préjuger, dans ses légalités [Gesetzmäßigkeiten], que de lavérité analytique et non de la vérité synthétique.
116 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[42]
11654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
En revanche l’éthique, et en particulier la doctrine éthique des princi-pes, cherche, à tort ou à raison, à prescrire positivement pour chaquesphère pratique et dans chaque cas singulier, ce qu’est le bien pratique etce qu’est le meilleur, et ce en dépit du fait que l’universalité principiellen’inclut en elle rien de la particularité des cas singuliers. Néanmoins, unéclaircissement est ici nécessaire. L’éthique, dans la hauteur de ses généra-lités scientifiques, ne parle pas, bien entendu, du cas singulier concretdans lequel je dois me décider hic et nunc en tant que sujet agissant. Maissous le titre de « principes » universels, elle recherchait des critères par-tout applicables, grâce auxquels on pourrait tout de même déchiffrer danschaque cas singulier la bonté ou la mauvaiseté1 éthiques, ou encore déter-miner positivement, avant la décision pratique, quand la décision seraitéthiquement juste et quand elle ne le serait pas. L’analyse du cas singulieret l’accomplissement correct de la subsomption peuvent bien comporterleurs difficultés particulières, aussi ardues qu’on voudra, l’essentiel estque cela doit tenir à une pure et simple subsomption ; qu’aucune sorted’évaluation ne doit précéder le principe, mais qu’elle doit être produiteseulement à partir du principe, ou du moins que la pleine et entière justifi-cation [Rechtsgrund] de l’évaluation soit renfermée dans le principe d’unefaçon principiellement universelle, de sorte que ce qui est rationnel auplan pratique dans le cas en question puisse être obtenu par simple sub-somption sous le principe.
Remarquez que, dans cette perspective, il est indifférent que, dans latradition historique, des principes éthiques aient été recherchés et tenuspour possibles en tant que principes dits matériels ou formels. Que dansles principes éthiques le plaisir, la prospérité publique, la perfection, etc.soient posés comme les buts pratiques suprêmes, ou que l’on écarte avecKant tous ces principes en tant que « matériels » et qu’on déclare seuladmissible un impératif catégorique en tant que « principe purement for-mel » – cela revient au même. Jusqu’à quel point une telle opposition
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 117
[43]
1. Cet antonyme (dont l’usage s’est raréfié) de « bonté » est l’équivalent exact de l’alle-mand Schlechtigkeit. Bien qu’au XVIIe siècle, « mauvais » et « méchant » aient été synonymes( « une méchante étoffe » ), il n’est plus possible aujourd’hui de recourir à « méchanceté », quiconnote trop massivement un vice moral chez les personnes ; la suite (cf. par ex. § 5 d, p. [50])montrera encore plus clairement qu’il n’est pas question de cela. (N.d.T.)
11754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
entre « matériel » et « formel » est analogue à l’opposition logique homo-nyme, telle est la question, et elle requiert une enquête plus approfondie.Mais d’avance, il est clair, pour qui est familiarisé avec l’éthique kan-tienne et les controverses qui s’y rapportent, que, par la manière mêmedont l’opposition est introduite et dont il est fait usage dans l’éthiquekantienne du principe formel, l’analogie défaille sur le point essentiel quinous intéresse. Car, avec l’impératif catégorique, Kant voulait donner leseul et unique critère, non pas simplement nécessaire, mais aussi suffi-sant, de la moralité [Sittlichkeit]. Il nous donne lui-même des instructionssur la façon dont nous devons procéder, au moyen de l’impératif catégo-rique, dans chaque cas donné, de manière à déterminer ce qui en lui estbon moralement, ce qui est véritablement conforme au devoir, ouencore de manière à juger éthiquement le vouloir et l’action déjà accom-plis. C’est purement et exclusivement l’évaluation [Wertung] universelled’où procède l’exigence de l’impératif catégorique qui détermine lavaleur des cas singuliers. Aussi « formel » que soit le principe, aussi loinqu’il puisse pousser l’exclusion du matériel au sens kantien, c’est un prin-cipe de décision positive, parfaitement suffisant pour le cas donné, saisidans sa pleine concrétion et sa pleine individualité. Cette justesse for-melle conformément à l’impératif catégorique ne laisse donc aucuneplace pour une non-justesse [Unrichtigkeit] matérielle. Tout au contraire,nous avons appris que dans la sphère de la connaissance, la justesselogique formelle ne préjuge en rien de la justesse matérielle. La forme dela connaissance, ou disons la forme du jugement, de la proposition s’ydistinguent de la matière de la proposition, représentée par les conceptsà teneur matérielle présents dans chaque proposition. Et nous avonsdeux sortes de vérités, et plus spécialement deux sortes de vérités aprio-riques, les unes formelles ou analytiques, les autres matérielles ou synthé-tiques. Et c’est précisément pourquoi ici, dans la sphère de la connais-sance, la logique pure et formelle se distingue des diverses sciencesmatérielles.
Par cette mise en contraste, on aboutit cependant à la question ou à lasérie de questions suivante : la division ayant eu cours jusqu’ici entre éthi-que matérielle et éthique formelle, ainsi que la fondation d’une éthiqueformelle par Kant sont-elles suffisantes, et même sont-elles les seules
118 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[44]
11854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
possibles ? La mise en parallèle historique entre logique et éthique, quidoit bien être fondée sur des motifs non pas seulement historiques, maistenant à la chose même, ne doit-elle pas être effectuée de façon plus largeet plus profonde, ou d’une autre manière qu’elle n’a eu lieu historique-ment, de façon à révéler non seulement une analogie superficielle, maisune analogie radicale et continue ? Le progrès que nous avons [d’ores et déjà]pu accomplir grâce à la présentation du parallèle exact entre scepticismelogique formel et scepticisme éthique, plaide par avance en faveur d’unetelle hypothèse.
<c) Sur la possibilité de principes formels pratiques et axiologiques>
Les réflexions que nous venons d’accomplir nous conduisent toute-fois à des interrogations plus précises. Nous devrons nous demander eneffet si la distinction entre logique et science matérielle ou encore entrevérités simplement analytiques et vérités synthétiques ne doit pas avoirson analogon rigoureux dans la sphère pratique. Par suite, ne doit-il pas yavoir aussi dans la sphère de la praxis un analogon rigoureux de ce qui,dans la sphère théorétique, s’appelle logique pure ou analytique ? Nous ytrouvions le rapport entre des jugements déterminés et l’Idée la plus uni-verselle du juger en général. Il nous fallait en outre distinguer a priorientre le juger et le quid du juger, la proposition ou le jugement qui estjugé. On pouvait y examiner [d’abord], dans l’universalité la plusextrême et pure, les formes de proposition possibles en général tellesqu’elles se trouvent pré-tracées génériquement dans l’Idée de proposi-tion ; puis, eu égard aux prédicats logiques de vérité et de fausseté appar-tenant a priori à l’Idée de proposition, on pouvait considérer les loisaprioriques qui énoncent des conditions de possibilité de la vérité, pro-pres aux formes possibles de jugement. Ne faut-il pas, pour tout cela,dégager les parallèles dans la sphère pratique ? Les actes pratiques déter-minés – disons, des volitions et des actions déterminées – se tiennentdonc sous une Idée du vouloir et de l’agir en général, qu’il sera possibled’explorer, à la manière d’une Idée, dans ses constituants et lois apriori-ques. Il nous faudrait ensuite voir si, au vouloir en tant que tel, ne cor-respond pas a priori un quid voulu, de la même façon qu’au juger corres-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 119
[45]
11954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pond le quid jugé, ou si l’on préfère le jugement rendu. À l’acte du se-décider, par exemple, nous aurions alors à attribuer en tant que corrélatla décision, à la proposition de jugement « il en est ainsi ! », la proposi-tion de volonté « cela doit être ainsi ! », « il doit en aller ainsi ! ». Et demême que des propositions judicatives, des propositions au sens théoré-tique, ont leurs prédicats d’estimation vrai et faux, ont leurs prédicats delégitimité théorétique (abstraction faite des modalités du probable, dupossible, etc.), de même les propositions pratiques ont leurs prédicatsparallèles, ceux de légitimité et d’illégitimité pratiques (qui sont commeune vérité et une fausseté pratiques). Tout comme, d’un point de vuenoétique, le juger doit être estimé en tant que juger correct ou incorrect,de même le vouloir devrait corrélativement être estimé comme vouloircorrect ou incorrect. Et, tout comme les propositions théorétiques, lespropositions du genre « il en est ainsi ! », ont leurs formes variables etpar ailleurs, en un tout autre sens, leurs matières variables (c’est-à-direles termes), [de même] nous aurions aussi des formes pour les proposi-tions de devoir, pour des propositions de la forme du « ainsi soit-il ! »pratique, « il faut que A se produise ! », « il faut que A devienne B ! », « siA est, alors B doit se produire ! », etc. Les lettres représentent ici aussides termes.
En outre, s’il est possible d’effectuer l’analogie de façon continue : demême que des conditions de possibilité de la vérité (ou de la fausseté)théorétique(s) (i.e. les lois purement logiques) appartiennent à la « formepure des jugements », à la forme des propositions théoriques à explorera priori selon ses pures figures possibles, de même appartiendraient auxformes des propositions pratiques – formes qu’il faudrait bien, là aussi,considérer a priori – des conditions parallèles de possibilité de légitimitépratique qui, en tant qu’aprioriques, s’exprimeraient à leur tour sousforme de lois, et ce seraient les lois pratiques formelles. Tout comme il estpossible de désigner également les lois purement logiques comme condi-tions de possibilité de la rationalité du jugement – noétiquement parlant :comme normes formelles de la rationalité du comportement judicatif –,de même, les lois purement pratiques peuvent être désignées comme desnormes formelles de la raison pratique, de la raison formelle dans le vou-loir. Cela veut donc dire que toute volition et par suite toute action qui
120 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
12054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
transgresserait les lois de légitimité ou de validité prescrites précisémentpar la forme, serait a priori et formaliter irrationnelle (irrationnelle sansconsidération de la matière de la volonté, ou encore en considérant sim-plement la forme pratique).
Dans le domaine de la raison théorétique, de la raison judicative, leslois formelles et leurs pures conséquences se rassemblent sous l’unité dela logique formelle, de l’analytique. La simple application à des matièresdonnées de façon quelconque produit le royaume des vérités analytiques,des vérités qui, abstraction faite de l’attestation de l’existence des objetsd’application, sont saisissables dans l’évidence par simple subsomptionsous des lois logiques formelles. À côté de cela, nous avions, dans lasphère théorétique, le royaume infini des vérités non analytiques, ou sivous préférez, des vérités synthétiques, soit aprioriques soit empirique-ment existentielles, qui se distribuent en différents domaines derecherche et ne peuvent être fondées que par l’approfondissement de lateneur matérielle [das Sachhaltige] des significations de jugement.
De même, il devrait y avoir dans la sphère pratique, une analytiquepratique, d’une part, à laquelle correspondrait une sphère de praxis analy-tique, donc un domaine clos de la volonté, dans lequel on pourrait fonderla rationalité de façon purement formelle ; et il faudrait adjoindre à celle-ci, d’autre part, un domaine proprement concret du vouloir, une sphèrede la volonté, dans laquelle la rationalité ne pourrait être fondée qu’à par-tir de la matière particulière du vouloir, que ce soit de façon immanente eta priori sur la base de ses connexions d’essence, ou empiriquement et exis-tentiellement par rapport au contexte global de réalité, pour autant qu’ilest le champ de volitions ou d’actions réelles et possibles.
Si nous pouvions réussir dans cette tâche, nous aurions alors desparallèles stricts ; par suite, à la logique formelle ou analytique ferait face,en tant que parallèle strict, une pratique formelle. Même l’expressiond’ « analytique éthique » ou d’ « éthique analytique » serait pertinente. Sesprincipes auraient une signification pratique suprêmement universelledans la mesure où aucune volition et action rationnelles ne pourraient lestransgresser, à savoir du point de vue de leur forme. D’un autre côté, sil’analogie était effectivement parfaite, rien ne serait énoncé par là dans lasphère matérielle propre, dont relève tout ce qu’il y a de spécifiquement
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 121
[46]
12154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
moral, rien sur la valeur du vouloir réel eu égard à ses buts, ni sur la hié-rarchie des biens, ni rien enfin sur le contenu du souverain bien pratiquequi doit, en tant que but, éclairer tout vouloir de sa lumière.
Toute cette considération qui vient d’être mise en œuvre requiert unélargissement qui vient facilement à l’esprit et qu’il faut exposer demanière succincte. Manifestement, ce que nous avons développé à pro-pos de l’Idée d’une éthique ou d’une pratique au sens le plus large (etdonc en dépassant la sphère spécifiquement morale), concernant la divi-sion entre une éthique analytique ou simplement formelle et une éthiquematérielle, peut être transposé tel quel au domaine de l’axiologie, et il est pré-visible que si une pratique formelle existe, elle devrait être essentiellemententrelacée à une axiologie formelle en général. Tant qu’on parlera à bondroit d’une raison, la question se posera de la distinction entre sphèrerationnelle analytico-formelle et sphère rationnelle matérielle, et doncaussi entre une axiologie analytique ou formelle et une axiologie maté-rielle. Il est en outre facile de comprendre que ce domaine soit intime-ment uni au domaine pratique formel, et qu’il y ait donc une unité supé-rieure qui embrasse encore, outre l’éthique, d’autres domaines partiels,comme par exemple l’esthétique ; et ce type d’unité fait même entrevoir lapossibilité d’une axiologie formelle en un sens élargi.
Isolons, en excluant d’abord le domaine du désirer et du vouloir, undomaine de valeurs non existentielles en tant que domaine des valeurs de beautéau sens le plus large ; incluons-y les valeurs pour lesquelles l’existence oula non-existence de l’objet porteur de valeur est sans importance pour lesens et la validité de la prédication de valeur ; opposons-lui la sphère desévaluations existentielles, dans lesquelles c’est le contraire qui se produit, etnommons « biens » les valeurs qui forment le corrélat d’évaluations exis-tentielles conformes à la raison ressortissant au genre « joie », et « maux »les valeurs négatives correspondantes. Cela présupposé, il est clair quechaque objet beau est en même temps un objet bon ; c’est dire que ce qui,dans une évaluation esthétique rationnelle, s’atteste comme beau doitaussi, dans une évaluation existentielle rationnelle, nécessairement s’attes-ter comme bon ; c’est-à-dire que s’il existe ou se présente comme existantdans la conviction, alors il est nécessairement, c’est-à-dire universelle-ment et conformément à la raison, objet d’une joie légitime ; de même
122 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[47]
12254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pour le cas contraire de la non-existence, il est objet d’une tristesse légi-time. Plus encore : supposons que fasse défaut pour la conscience lecaractère d’existence de l’objet, mais que l’assomption de l’existencefonde rationnellement un plaisir présomptif – nous nous projetons doncpar la pensée dans l’existence et, dans cette pensée « supposé qu’il [l’ob-jet] soit », est fondée une quasi-joie rationnellement légitimable, de l’ordrede « ce serait une juste joie ! » ; – il est alors clair que le même objet ou lemême état de choses serait support légitime d’un souhait rationnel et, s’ilse présente comme réalisable, d’un légitime vouloir. Si nous nommons« valeurs de désir »1 les corrélats de valeur du souhait rationnel, « valeursde volonté » ou « valeurs pratiques » ceux de la volonté rationnelle, alors ilapparaît clairement que toutes ces valeurs se rattachent a priori les unesaux autres. Que le beau soit en même temps un bien ; que tout bien, lors-qu’il n’existe pas, soit une valeur de désir ; que toute valeur de désir, si elleest réalisable, soit une valeur de volonté, de sorte que nous obtenons unélargissement en règle du concept du bien : tout cela a une validité a priori.Ce qui est à bon droit désirable aussi s’appelle un bien, et la valeur pra-tique est pratiquement bonne.
Si ces connexions valent dans une généralité inconditionnée, ellessemblent bien être déjà de nature formelle. Parce que leur généralité esttelle que la « matière » de la beauté et de la bonté n’importe pas, c’est bienquelque chose comme des lois formelles qui semble s’exprimer dans lespropositions énoncées. En tout cas, il est certain que des principes qui,indépendamment de cette matière de l’évaluer (c’est-à-dire de la particula-rité des objets qui y sont évalués), se rapportent aux catégories de valeur,à la simple « forme », revendiquent une grande et universelle significationaxiologique ; mais cela vaut avant tout pour les propositions qui se réfè-rent à la catégorie la plus universelle de « valeur en général », abstraction
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 123
[48]
1. Husserl joue ici sur les ressources de la langue allemande qui qualifie l’ensemble dudomaine des possibilités axiologiques au moyen du suffixe -wert, par exemple, begehrenswert (oubegehrenswürdig), Begehrungswert, le désirable, le convoitable au sens de ce qu’il est affectivementpossible de désirer, de convoiter et, par implication, de ce qui mérite de l’être. Le possible éthi-que est un possible axiologique. Au lieu de « valeurs de désir », de « valeurs de volonté », il fau-drait parler du « désirable », du « praticable », etc., en laissant résonner dans le suffixe -able, lespossibilités affectives et à partir d’elles l’ensemble des modalités affectives. (N.d.T.)
12354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
faite de la particularité des domaines de valeur selon leurs différenciationscatégoriales. En tout cas, s’ouvre ici l’idée d’une axiologie formelle pos-sible, par analogie avec une logique formelle.
<d) La distinction entre acte et contenudans la sphère pratique et axiologique.
La tournure normative des lois pratiques et axiologiques>
Enfin, il faut encore ajouter un point non négligeable si l’on veutmener à bonne fin l’analogie. Dans la logique formelle, si elle est prised’une manière aussi pure et théorétique que j’ai montré qu’elle doit l’être,nous avons affaire à des significations, en particulier à des significationspropositionnelles du point de vue de leur forme et des lois de validité quidécoulent de la forme. Toute loi de cette sorte est susceptible de recevoirune tournure normative ; ce qui veut dire qu’à chacune correspond, dansune stricte équivalence, une norme du juger correct en général, unenorme de validité absolument universelle, c’est-à-dire valable pour toutesphère de connaissance dans laquelle peut s’exercer le juger. Par exemple,le principe de contradiction signifie théorétiquement que de deux propo-sitions à contenus contradictoires, l’une est vraie et l’autre fausse. À celacorrespond normativement la règle de jugement : celui qui a jugé queA est n’a pas le droit de juger que A n’est pas, et inversement. À toute loid’inférence établie théorétiquement en logique formelle, selon laquelle dedeux prémisses ayant telle ou telle forme s’ensuit une proposition ayanttelle ou telle forme assortie, correspond de la même façon la norme dejugement : quiconque pose des prémisses de telle ou telle forme, est auto-risé à en inférer rationnellement que vaut le jugement de telle ou telleforme. Les lois théorétiques portent sur des propositions, mais ne disentrien du tout sur le juger et le devoir-juger de qui que ce soit. Les tournu-res normatives de ces lois sont au contraire censées être précisément desnormes s’imposant à celui qui juge et énoncent comment il doit jugerpour juger rationnellement.
Cette situation d’après laquelle à toute loi théorétique analytique cor-respond dans une équivalence évidente une norme universellementvalide, c’est-à-dire valide pour toute sphère d’exercice possible du juger
124 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[49]
12454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
en général, repose sur le fait que tout jugement possède un contenu idéal,à savoir ce que l’on nomme proposition au sens logique, et sur le fait quedes conditions légales idéales de possibilité de la justesse du jugement,donc de la possibilité d’un juger évident, se fondent sur ce qu’il y a de plusuniversel dans le contenu du jugement en général.
Si nous suivons à présent l’analogie directrice, il devrait en aller demême dans la sphère pratique et axiologique. Il devrait y avoir là aussides lois formelles aprioriques et, parallèlement à elles, des normes aprio-riques qui leur sont évidemment équivalentes : non pas cette fois desnormes du juger rationnel, mais des normes de l’évaluer rationnel, dusouhaiter ou du vouloir rationnels. L’analogie exigerait par suite que,conformément à la distinction entre juger et contenu de jugement (entrepenser et contenu de signification de la pensée), nous puissions etdevions distinguer dans la sphère pratique entre le vouloir en tant qu’acte etle contenu de volonté, pour ainsi dire en tant que signification de volonté, ouen tant que proposition pratique. À la forme du contenu de volonté,c’est-à-dire aux configurations fondamentales qui résident dans l’essenced’un tel contenu en général, devraient appartenir les lois théorétiques quicourraient parallèlement aux lois analytiques, aux lois logiques formel-les ; et la tournure normative de ces lois devrait produire des règles équi-valentes du vouloir rationnel en général, autrement dit des normes quine pourraient pas être transgressées si l’on ne veut pas que le vouloir soitirrationnel pour la raison la plus radicale de toutes – à savoir parce qu’ilirait contre le « sens » du vouloir en général, contre ce qu’exige sa« teneur de signification » en général. Néanmoins, le vouloir relève d’unesphère plus vaste, et c’est bien plutôt pour la sphère la plus vaste – cellede l’axiologique – qu’il faudrait distinguer tout cela ou, du moins, qu’unetelle distinction devrait être possible.
Pour rendre un peu plus clair le sens de l’exigence, attardons-nousencore un instant. Juger, c’est avoir un avis [meinen], au sens d’êtreconvaincu. L’avis judicatif [Urteilsmeinung] a nécessairement une teneur designification ou, comme on disait aussi, un contenu, à savoir la proposi-tion logique. Lorsqu’on oppose le juger et le jugement, ce dernier n’estalors rien d’autre que la proposition logique indépendante. Juger, c’estêtre d’avis relativement au contenu « ce S est P », « S en général
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 125
[50]
12554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
est P », etc. D’un autre côté, la conscience de souhait ou de volonté est enquelque sorte un avis de souhait ou de volonté, et cet avis pratique pos-sède aussi un « contenu » ; non pas le contenu « ce S est P », mais lecontenu « ce S doit être P » ou « un S en général doit être P », etc. C’estainsi que, pour la volonté, nous exprimons la décision, mais non pascomme expression du se-décider évanescent, de l’acte de volonté, maisdu contenu ; il en va de même pour l’agir et l’action, pour le souhaiter etle souhait.
De même, l’évaluer en tant que plaisir ou déplaisir est une présomp-tion-de-valeur [Wertvermeinen] et possède son contenu, que, du reste, nousne pouvons pas désigner clairement de façon verbale : nous ne pouvons,là encore, utiliser que les expressions du devoir. De même que vérité oufausseté reviennent à un contenu de jugement et que rationalité ou irra-tionalité affectent corrélativement l’acte de jugement, de même, dans ledomaine axiologique, les contenus d’évaluation sont affectés des prédi-cats « être-une-valeur » ou « être-une-non-valeur », ou encore de bonté oude mauvaiseté. Mais aux actes reviennent [les qualités de] rationalité oud’irrationalité axiologiques. Donc la décision est bonne ou mauvaise,mais le se-décider, la volonté est rationnelle (éventuellement moralementrationnelle) ou irrationnelle d’un point de vue pratique ; de même le sou-haiter est rationnel ou irrationnel, le souhait est un bon souhait ou lecontraire.
Du côté intellectif, on dit que la signification se rapporte logiquementà une objectité signifiée. Tout juger a un contenu de jugement, le quid quiest jugé, sa signification, mais il ne lui correspond pas toujours un objet.L’objet, dit-on, existe en vérité si le jugement est correct, rationnel. Il enva à peu près de même du côté éthique : à l’avis de volonté appartienttoujours un sens, au se-décider, la décision, à l’agir, l’action. Mais ce n’estque lorsque la volonté est rationnelle et, respectivement, lorsque la déci-sion est bonne, que la décision a une validité pratique et que la valeur pra-tique a une réalité [Realität] éthique, une réalité axiologique. En tout ceci,le concept de réalité est, bien entendu, un concept transposé.
126 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[51]
12654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 6. La relation formelle entre moyen et finn’est pas une relation logique.
La souveraineté universelle [Allherrschaft] de la raison logique>
Si nous cherchons à présent à déceler réellement, dans la sphère axio-logico-pratique, un fonds de propositions parallèles à ce qui est bienconnu en tant que logique formelle, nous penserons probablementd’abord aux rapports formels qui existent entre moyens et fins et, demême, entre valeurs médiates et immédiates.
Il est remarquable que Kant ait également senti à l’occasion cetteanalogie. Si vous ouvrez les Fondements de la métaphysique des mœurs <KantsWerke, édition de l’Académie, vol. IV, p. 4171>, vous trouverez laremarque suivante : « La proposition “Celui qui veut la fin veut aussi lemoyen indispensablement nécessaire à cette fin” est, pour ce quiconcerne le vouloir, analytique. Car dans le vouloir d’un objet en tantque mon effet, est déjà pensée ma causalité en tant que cause agissante,c’est-à-dire l’emploi des moyens. » En revanche, explique-t-il <p. 4202>,l’impératif catégorique serait un a priori synthétique pratique. Ce seraitune « proposition pratique, qui ne dérive pas analytiquement l’acteconsistant à vouloir une action d’un autre vouloir déjà présupposé, maisqui le rattache immédiatement au concept du vouloir (en tant que vou-loir d’un être rationnel), comme quelque chose qui n’est pas compris enlui ».
Assurément, je ne puis approuver à tous égards ce que Kant énoncelà. Le vouloir de la fin n’est pas, au sens propre (et cela ne pourrait êtreque le sens psychologique ou phénoménologique), un acte complexe quiimpliquerait réellement [reell] le vouloir du seul moyen nécessaire ; et si cen’est pas au sens propre, nous aurions à demander : en quel sens alors ? Ilfaudrait pourtant le préciser. Le vouloir du moyen est « pensé avec ». Pro-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 127
[52]
1. Trad. fr. de V. Delbos revue par F. Alquié : Kant, Œuvres philosophiques, éd. sous ladirection de F. Alquié, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1985, t. II, p. 280.(N.d.T.)
2. Trad. fr., p. 284 en note. (N.d.T.)
12754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
prement pensé avec ? Certes non. Il peut se faire que nous voulions unbut, sans avoir la moindre idée des moyens, et donc non plus d’un moyenqui serait « seul nécessaire ». Bien entendu, le vouloir est impossible sansune certaine conviction de réalisabilité [Erreichbarkeit], encore qu’il yaurait tout lieu de se demander à quoi ressemble une telle conviction. Unvouloir quel qu’il soit, pouvons-nous dire pour le moins, se dirige sur unbut, et dans la représentation du but est co-donné – et ce, nécessaire-ment – qu’il doit être le terme [Ende] d’un chemin qui y conduit. Lavolonté du but est nécessairement volonté du but par le biais du chemin.Mais cela ne revient pas à dire que le chemin soit représenté en tant quechemin déterminé. Il y a des représentations déterminées et des représen-tations indéterminées, et les deux sortes de représentations peuvent sous-tendre la volonté. Par conséquent, même la représentation d’un butcomme devant être atteint « n’importe comment » peut fonder un vou-loir, et le « n’importe comment » y reste éventuellement fort indéterminé.Il se peut que la connaissance après coup d’un chemin déterminé commeétant l’unique chemin actuellement possible devienne ultérieurement unsoubassement de la volonté. La volonté antérieure à présent reproduiteen se « déterminant » de plus près, se transforme en la nouvelle volonté :l’action indéterminée posée dans la décision se transforme en l’action àprésent posée dans la déterminité du chemin. Il se peut qu’on disealors qu’il s’agit de « la même » volonté, simplement déterminée plus pré-cisément, et que la volonté du but ait « impliqué » nécessairement un che-min à suivre, qu’elle ait donc également « impliqué » l’unique chemin àsuivre. Mais il faut comprendre tout cela comme une façon impropre deparler.
En fait, il en va exactement comme dans l’inférence analytique : lesjugements qui servent de prémisses doivent, comme on dit, inclure « ana-lytiquement » le jugement de conclusion. Or il serait radicalement aber-rant de croire qu’on trouverait réellement [reell] le jugement de conclusiondans les jugements-prémisses en tant que vécus ou corrélats des vécus,phénoménologiquement ou psychologiquement. La relation n’est pas psy-chologique, mais logique. Selon la raison, on ne peut pas juger les prémisses etnier la proposition de conclusion, car celle-ci réside « logiquement » dansles prémisses, c’est-à-dire purement dans les propositions ; la validité de
128 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
12854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:37
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
la proposition conclusive se fonde dans les significations des prémisses,celles-ci étant prises comme des significations valides. Il me suffit d’ap-profondir un tant soit peu le sens de ce qui est énoncé pour le découvrir.Et c’est pourquoi je dis, de façon imagée, que le juger de la conclusion yréside. Il en va tout à fait de même dans la sphère de la volonté. Le vou-loir du moyen se fonde rationnellement dans le sens du vouloir-le-but. Enrevanche, dans le vouloir du but ne se trouve pas inclus réellement, niexplicitement ni implicitement, le vouloir du moyen.
Il nous faut cependant être ici un peu plus précis. En ce qui concerne,tout d’abord, la sphère logique, l’inférer n’est pas toujours rationnel ; eneffet, nous concluons souvent faussement ; donc le jugement de conclu-sion n’est pas toujours « inclus », de façon effectivement conforme à la rai-son, i.e. logiquement, dans les jugements-prémisses. D’un autre côté, noussommes pourtant d’avis [meinen], en jugeant les prémisses, que le jugementde conclusion, ce qui est jugé dans le juger conclusif, y est inclus. Nous nepensons naturellement pas que nos actes psychiques consistant à juger lespropositions prémisses renferment réellement, psychologiquement, l’actepsychique du jugement de conclusion. Lorsque nous inférons, nous nesommes pas des psychologues ; nous ne considérons et n’analysons pasnos phénomènes psychiques. Nous jugeons et, en jugeant, nous énon-çons : tous les hommes sont mortels, et Socrate est un homme ; « en celaest inclus » que Socrate est mortel. Et parce que nous voyons cet « êtreinclus dans », qui est vu manifestement dans la direction des contenus dejugement, nous disons, en réfléchissant, que quiconque voudrait rendredes jugements comportant le contenu des propositions prémisses et nepas reconnaître ce que dit la proposition de conclusion, serait irrationnel.Tout cela fait partie du sens de l’inférer, de son avis [Meinung], c’est-à-direde ce qui est présumé en lui en tant que tel, même lorsque l’inférer est faux.Même dans l’inférer erroné, pourvu que j’infère effectivement, je « vois »l’être-inclus de la conséquence dans l’antécédent [Grund] – seulement, cevoir n’est [alors] qu’une simple apparence, tout comme lorsque, bien sou-vent, nous percevons par les sens et reconnaissons par après que la per-ception était en fait une perception trompeuse, une illusion.
Or, il va de soi que tout cela se transpose tout à fait à la sphère de lavolonté. Nous voulons un but et sommes d’avis qu’un moyen est néces-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 129
[53]
12954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
saire, et même totalement indispensable, pour atteindre ce but. Nousvoulons à présent ce moyen. Dans l’essence d’un but de la volonté en tantque tel réside le fait, je l’ai déjà dit, qu’il soit le terme d’un chemin qui yconduit ; donc ce qui appartient nécessairement à ce chemin, partant toutmoyen nécessaire, est posé avec le but et en quelque sorte inclus en lui. Etcorrélativement, le vouloir du moyen est, conformément à la raison, exigépar le vouloir du but, et le vouloir-du-but « implique au sens de la raison »le vouloir-du-moyen. Cela appartient au sens de toute situation-de-volonté [Willenssachlage] en tant que telle et de tout contenu-de-volonté,peu importe que ce qui y est posé existe ou non, c’est-à-dire que le moyenprésumé appartienne effectivement au chemin, qu’il soit ou non effec-tivement le moyen approprié, qu’il soit même l’unique moyen appropriéou non.
Il est, en tout cela, particulièrement important de porter à l’évidenceque la situation-de-volonté n’est nullement un simple cas particulier de la situationintellectuelle ou logique, que par conséquent, le vouloir rationnel n’est pasnon plus un cas particulier de la raison logique propre à l’inférer. Il estsurtout clairement compréhensible que l’implication, conforme à la rai-son, du moyen dans le but, ou celle de la volition du moyen dans la voli-tion du but, ne saurait être une relation « analytique », quelque chosecomme une relation d’inférence logique. Cela ressort dès lors que nous expri-mons prédicativement la situation de la volonté. À partir de la proposi-tion « je veux le but B » et de la proposition « M est un moyen nécessairepour B », personne ne peut conclure, selon des principes logiques for-mels, que « je dois [muß] vouloir M, c’est-à-dire, je dois [soll] rationnelle-ment vouloir M », à moins qu’il n’introduise en outre la proposition géné-rale : « Qui veut en général un but “doit” vouloir le moyen nécessaire à cebut. » Or, précisément, cette proposition exprime, de façon universelle, leprincipe du mode d’inférence et est par conséquent en question. Ellen’est manifestement pas une proposition logique analytique, une proposi-tion qui serait clairement compréhensible à partir de l’essence du juge-ment en général, une proposition qui serait valable, abstraction faite de samatière de jugement particulière, à partir de la forme du jugement engénéral. Si nous analysons ce qu’énonce cette proposition, et doncd’abord ce que disent les termes de « moyen et fin », nous sommes
130 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[54]
13054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
conduits à un rapport causal : le devenir-réel [das Realwerden] du faitM entraîne ou devrait entraîner le devenir-réel du fait B. De surcroît(pour le mode d’inférence ici en question), l’agent ne peut pas réaliserimmédiatement B, mais seulement un cheminement causal qui conduità B, et par ailleurs, il ne peut réaliser aucune autre cause suffisante de Bque celle qui implique M en tant que membre [Glied] nécessaire. Là oùtout cela se présente, nous pouvons en effet conclure : dans de tels cas,nous devons vouloir M. Nous « devons » – cela n’exprime aucune néces-sité psychologique, mais une nécessité rationnelle, un devoir rationnel.Mais après cette analyse, nous voyons d’autant plus clairement que cemode d’inférence du vouloir de B au devoir-vouloir rationnel de M n’arien d’analytique, qu’il n’est nullement fondé sur la simple forme du juge-ment. Car elle devrait alors rester valide, quand bien même nous rempla-cerions tous les concepts qui apparaissent ici – « cause », « effet »,« volonté », bref tous les concepts qui ne sont pas purement logiques –par des concepts indéterminés. Il n’en est évidemment pas question. Iln’y aucune contradiction logique, si irrationnel que cela soit, à vouloir lafin et à ne pas vouloir le moyen.
Si donc l’inférence n’est pas logico-analytique, si la raison qui opèreen elle n’est pas une raison analytique, n’est-elle pas néanmoins une rai-son logique au sens large, par exemple une raison logico-empirique, c’est-à-dire la raison qui est à l’œuvre dans la connaissance des « faits », dans laconnaissance scientifique de la nature et la connaissance psychologique ?Il est clair que ce n’est pas le cas. Certainement, cette raison prend part,elle aussi, au mode d’inférence pratique rationnel. Entre but et moyen,selon la conviction de celui qui se décide ou qui envisage une conclusion-de-volonté, il y a bel et bien un rapport de causalité. Il faut qu’il juge defaits empiriques et de leurs relations causales. Mais naturellement, cela n’ysuffit pas. J’ai, par exemple, une importante communication personnelle àfaire à un ami. Pour cela, il faut que je le rencontre. Si je considère ce pro-cessus réel [real] en lui-même, tels ou tels mouvements corporels, tels outels phénomènes psychiques propres au communiquer, telles ou tellesrelations causales, ils peuvent bien avoir des propriétés réelles, qui sontprésupposées lorsqu’on parle de moyens rationnels en vue d’une fin ;mais des propriétés réelles n’enferment rien en elles [qui soit de l’ordre]
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 131
[55]
13154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
d’un moyen et d’une fin ou d’une raison. Même si l’on considère spéciale-ment les actes de volonté en question, il reste beaucoup à faire, s’il s’agitde [se] rendre compte [gerecht werden] effectivement des raisons pourlesquelles il faut rationnellement vouloir le moyen si l’on veut la fin. Sousle simple aspect de la considération logico-empirique, c’est-à-dire desconsidérations psychologiques, physiques, et psychophysiques, nousavons élargi la sphère des factualités en y incluant les actes de volonté,mais nous n’y trouvons pas la raison de volonté. Les faits physiques, lesmouvements des jambes, les mouvements dans l’organe vocal et autreschoses de ce genre, s’intègrent à l’ordre de la nature physique d’après deslois physiques, les processus psychiques du communiquer et du vouloir-communiquer, de vouloir-aller, etc., dans la sphère de la nature psy-chique, et toutes deux ensemble, dans la sphère de la nature psychophy-sique. Ce qu’est ici une vérité, c’est la raison empirico-logique qui ledétermine. Mais que la volonté-de-communiquer, que le vouloir dumoyen, que le vouloir me-rendre-chez-mon-ami, etc. exige que, si je veuxcela, je doive vouloir de manière rationnelle ceci, cela la raison logico-empirique ne peut pas me le dire. Le devoir conforme à la raison n’est pasun fait empirique ; la volonté de fait, qui entre en jeu dans l’enchaînementpsychologique, n’est pas un devoir-vouloir.
Même la conscience du devoir-vouloir entrant en jeu dans la considéra-tion du but ne nous est d’aucun secours, n’est pas elle-même un devoir-vouloir. Plus généralement, valeur et conscience d’une valeur se distin-guent de la même façon que vérité et tenir-pour-vrai, juger. Le surgisse-ment et la disparition de jugements dans l’enchaînement de conscience[Bewußtseinszusammenhang], la constatation qui fonde causalement le faitque, le cas échéant, c’est précisément ce jugement, cette conscience devérité (et même conscience d’évidence) qui doit surgir dans la conscience– cela n’est pas la fondation rationnelle de la vérité. En l’occurrence, il enva exactement ainsi : la considération logico-empirique peut seulementétablir que la conscience de volonté et la conscience de devoir entrent enjeu, elle peut établir que, dans ces circonstances, elle doit entrer en jeud’après une nécessité empirique, à savoir en tant que fait réel-causal. Maiselle ne peut établir que vouloir un tel moyen soit rationnellement exigé auregard du but qui est voulu. La rationalité de cette exigence a ses fonde-
132 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[56]
13254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ments dans une tout autre dimension que celle des faits. La fondation dufait que le vouloir s’exerce de telle sorte [daß so gewollt wird] qu’une telleconscience d’exigence est vécue – cette fondation de matter-of-fact estquelque chose de tout autre que la fondation de l’exigence elle-même, entant qu’exigence rationnelle, qu’exigence qui serait encore rationnelle sil’agent venait à la négliger, si elle n’entrait pas en jeu en tant que fait. Il estclair en effet que la loi du devoir « Qui veut la fin, doit rationnellementvouloir le moyen nécessaire » est une loi a priori, qu’elle vaut de façon évi-dente dans une universalité et une nécessité inconditionnées, tandis quetous les faits établis par expérience et toutes les lois à découvrir par expé-rience sont précisément empiriques.
Mais on pourrait précisément enchaîner sur ce point pour prouverqu’il n’y a qu’une seule raison, à savoir une raison logique et que, par suite, raisonpratique et raison axiologique en général ne sont qu’un domaine d’applicationparticulier de la raison logique. Il est certain, pourrait-on dire, qu’une considé-ration logico-empirique, relevant donc des sciences de la nature au sens leplus large, ne produit pas le devoir conforme à la raison ni la loi-du-devoir. Mais n’avons-nous pas parlé de loi ? Ne parlons-nous pas de savalidité apriorique, et de sa fondation, qui peut assurément se situer surune tout autre ligne qu’une fondation relevant des sciences de la nature ?Or, une loi est un énoncé et, partant, quelque chose de logique ; et c’est laraison logique qui établit sa vérité, qui prouve sa validité apriorique, quifonde. De même qu’elle se réfère à d’autres domaines, la pensée logiquese réfère au domaine de l’évaluer et du vouloir ; et de même que, par ail-leurs, elle découvre et fonde des vérités – soit analytiques, soit empi-riques, soit synthétiques a priori –, elle le fait aussi dans ce domaine. C’esttout de même sans réplique ! Eh bien, ce qui est en effet démontré ainsisans appel, et qui va de soi, c’est que, pour autant qu’une chose quel-conque est connue, elle est justement connue ; c’est que, pour autant quedes objets sont posés dans un domaine quelconque, que des prédicatsleur sont attribués, que des lois universelles sont établies, ce sont des acti-vités de connaissance au sens d’une raison logique qui se déroulent entout cela. Par conséquent, si nous discourons sur des exigences et des loisd’exigence axiologiques, et que nous en discourons rationnellement, nousdiscourons et jugeons alors logico-rationnellement, et si nous opérons
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 133
[57]
13354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
une fondation [begründen], c’est au moyen de la raison logique. Cette souve-raineté universelle de la raison logique, personne ne peut le nier. Mais cela doit-il signifier qu’une raison pratique et axiologique, en analogie avec la rai-son logique, n’a aucun sens ?
Dans la pensée logique, dans la connaissance, nous nous référons,premièrement, à la sphère de la connaissance elle-même et nous distinguonsjugement et vérité, juger en tant que fait psychologique et juger en tantqu’il est pour ainsi dire dirigé sur un but idéal, sur le but de la vérité. Dansune universalité formelle des plus universelles, nous considérons le jugeren général et le juger qui est dirigé sur un but, qui est conforme au but dujugement, à la norme de jugement de la vérité. En connaissant, nousposons par suite des lois formelles pour cet être-conforme-au-but [Ziel-richtigkeit] idéal, des lois pour des jugements conformes à la raison engénéral, ou si l’on préfère, nous posons des lois formelles pour la véritéen tant que telle et ses constituants essentiels.
Mais dans la pensée logique, dans la connaissance, nous nous réfé-rons aussi, deuxièmement, aux sphères de l’évaluer au sens prégnant, aux sphè-res du plaisir et du déplaisir, du souhait, du vouloir. Et de nouveau, nousy opposons l’évaluer [Werten] en tant que fait psychologique, et la valeur,qui est comme le but idéal sur lequel l’évaluer se dirige. Nous opposonsl’évaluer de fait et l’évaluer conforme à une norme, c’est-à-dire l’évaluerqui évalue comme on doit évaluer [wie gewertet werden soll]. Et, par suite,nous posons des lois idéales suprêmement universelles pour ce devoir ou,si l’on préfère, des lois de la valeur en tant que telle, non pas de l’évalué,mais plutôt de la valeur conforme à la raison en tant que telle.
Ne devrait-il pas être possible, cependant, en dépit de la toute-puissancede la raison logique, dont le champ est précisément le tout du connaissableen général, de mettre en évidence qu’il y a deux ou plusieurs sortes dedevoir ou de valoir, rapportées à plusieurs genres d’actes, qui donnentautant de formes différentes de conscience-de-raison ? Et ne devrait-ilpas apparaître que, de même que juger, prendre plaisir [Gefallen], souhaiteret vouloir diffèrent par essence selon le genre, de même aussi les devoirset validités [Sollungen und Geltungen] accédant en eux à la conscience diffè-rent donc selon le genre ? Et en retour : si, dans l’absolu, une justificationest nécessaire pour fonder la prétention de devoir et si une justification
134 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[58]
13454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
est, pour ainsi dire, le remplissement des espèces correspondantesd’ « intentions », d’ « avis » (avis-de-jugement, avis-de-plaisir, avis-de-sou-hait ou avis-de-volonté), ne devrait-il pas apparaître que ces remplisse-ments fondateurs sont fondamentalement et par essence différents, qu’ilscorrespondent aux différences de genre ? On comprend ainsi aisémentque l’on ait parfois essayé de soutenir carrément que le juger appartien-drait, en tant qu’espèce, à l’extension de l’évaluer au sens courant (alorsque nous ne parlons qu’analogiquement de valeurs dans le juger), car ils’agirait là d’une espèce de volonté ou de sentiment. Ou encore, que l’onait cherché à soutenir que ce qui introduirait dans le domaine du juge-ment l’idée de vérité et ferait la différence entre connaissance authentiqueet quelque autre jugement, résiderait dans l’adjonction d’un sentimentévaluateur, dans une conscience de nécessité ou de devoir qui constitue-rait les différences de valeur. De la sorte, l’intellectif proprement dit, laraison spécifiquement logique est interprétée comme une espèce de la rai-son évaluative au sens plus étroit.
<§ 7. Les analogies pour la prise de position judicative de la croyancedans la classe des actes affectifs et celle des actes de volonté
en tant que fondement pour le parallélisme des types de raison>
Au terme de la dernière leçon, une difficulté principielle nous préoc-cupait, qui touchait à la mise en parallèle de la raison axiologique et pra-tique et de la raison logique. Ce parallélisme doit s’achever dans des loisparallèles : les lois formelles du devoir doivent être parallèles aux lois for-melles de l’être, des lois de validité formelles pour les activités de l’affecti-vité et de la volonté (et pour les analoga de propositions qui en relèvent)doivent être parallèles aux lois formelles de validité pour les activités dujugement [Urteilstätigkeiten] et les propositions judicatives. La logique etl’ontologie formelles doivent avoir leur strict analogon dans une axiologieet une pratique formelles. Mais on peut objecter que toutes ces lois sontpourtant bien des lois, que ces disciplines sont bien des disciplines etqu’en tant que telles elles se tiennent sous les lois logiques formelles, quetous les domaines s’inscrivent donc, comme de bien entendu, dans le
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 135
[59]
13554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
cadre de la raison logique. Il n’y aurait donc proprement qu’une seule etunique raison, celle qui juge et fonde des jugements. La différence entrediverses espèces de raison ne peut se rapporter qu’à des particularisationsmatérielles de différentes sphères de jugement.
Cette souveraineté universelle de la raison logique est indéniable. Elle résideen ceci que toutes les Idées que nous résumons sous les titres de raison,sont précisément des Idées, donc quelque chose de logiquement saisis-sable, désignant des domaines pour des jugements possibles – des juge-ments qui se tiennent à leur tour sous des principes rationnels, ceux de lalogique. Une exploration de la raison et de toute raison en général estnaturellement une opération logique. Mais cela revient-il à dire que touteraison est elle-même une raison logique ?
Le parallélisme des espèces de raison a sa racine dans le parallélismedes espèces fondamentales d’actes, et dans chaque espèce fondamentalede tels actes nous trouvons une espèce fondamentale d’avis ; en un cer-tain sens, au sens le plus large, une espèce fondamentale de prises deposition. La sphère de la connaissance, la sphère de la représentation ausens le plus large est caractérisée par ceci que les actes qui en relèvent seregroupent tous autour des actes du belief 1. Ce qui veut dire que les prisesde position ou prises de position fondamentales [fundamentalen] apparte-nant à cette classe sont des prises de position du « croire », du tenir-pour-étant ou, si l’on préfère, du tenir-pour-vrai. Connaître c’est présumer ;présumer que quelque chose existe ou est constitué de telle ou tellefaçon, etc. Les actes de croyance, les actes doxiques, comme j’ai coutumede les nommer, occupent ici la position centrale. Tous les autres actessont de simples modalités des actes de croyance, par exemple en tantqu’actes de la négation ou, dans une autre direction, en tant qu’actes duconjecturer, du tenir-pour-possible, etc. Il y a donc certes ici bien d’autresprises de position, mais celles-ci sont, d’après leur essence, caractériséescomme des modifications d’actes de la croyance originaire, de la certitudede croyance.
À la classe des actes de connaissance s’oppose, comme une classeessentiellement distincte, la classe des actes de l’affectivité, les actes du
136 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. En anglais dans le texte. (N.d.T.)
13654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ressentir, du désirer et du vouloir, qui, manifestement, se distribuent àleur tour en des genres étroitement interdépendants. Ici apparaissent denouvelles espèces fondamentales de prises de position, de nouvellesespèces du présumer, du tenir-pour... Dans le plaisir esthétique, nousavons conscience de quelque chose en tant que beau. Il faut ici prendregarde au fait que juger de la beauté est autre chose que prendre plaisir au beau. Envivant dans la jouissance du beau, nous effectuons une présomption deplaisir – repoussés par le non-beau1, nous effectuons une présomption dedéplaisir –, et ce présumer est, en tant qu’attitude qui présume, l’analogondu présumer qui juge, et plus généralement, du présumer concernantl’être, appartenant au type de la croyance. De même tout souhaiter, toutdésirer est une espèce du présumer, en eux-mêmes réside un tenir-pour-bon, ou un tenir-pour-mauvais dans le cas d’un désir négatif. Par consé-quent, ce tenir-pour..., qui réside purement dans l’acte affectif, est l’analo-gon du tenir-pour-étant ou du tenir-pour-étant-tel propre au jugement.C’est seulement sur la base des actes affectifs préalables qui évaluent lebeau ou le bon qu’un juger vient éventuellement s’édifier ; une prise deposition est alors effectuée, des concepts et des mots sont mobilisés, etsurgissent alors des jugements prédicatifs sur un évaluer et des valeurs et,parmi eux, des jugements posant des lois.
Des actes de connaissance, des actes de simple perception et expé-rience ou des actes d’intuition idéatrice, et à un niveau supérieur, desactes de la prédication subsumant sous des concepts et mettant logique-ment en relation, peuvent naturellement se diriger sur toute sphère deconscience. Nous pouvons donc nous diriger, sur le mode de la penséelogique, sur la conscience logique elle-même ; nous pouvons, sur le modede la connaissance scientifique, faire de la sphère de conscience de laconnaissance elle-même un domaine scientifique. Nous pouvons sou-
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 137
[60]
1. Le style soutenu allemand affectionne les litotes et les euphémismes ; aussi Husserlemploie-t-il souvent unrichtig, unschön, ungut, etc., ainsi que les substantifs correspondants, quisont couramment utilisés comme synonymes élégants de falsch, hässlich, schlecht, etc. Pourtant,par souci de cohérence, nous avons évité de traduire unschön par « laid », etc. En effet, on verraplus loin (§ 11 a, p. [85]) que Husserl lui-même remet en question l’usage courant en stipulantune trivalence axiologique : le non-beau n’est pas forcément laid, mais peut être indifférent(adiaphoron). (N.d.T.)
13754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mettre cette sphère à une exploration d’essence, tant du côté des actesque du côté de leurs « contenus » et de leurs « objets ». Nous pratiquonsalors une phénoménologie de la conscience de connaissance, de sesniveaux les plus bas jusqu’aux plus élevés, parmi lesquels les niveaux spé-cifiquement logiques, et par ailleurs, à l’égard des teneurs-de-significationde cette conscience et de ses objets en général (eux-mêmes saisis dansune universalité formelle), nous faisons de la logique pure, au sens le pluslarge, de la logique apophantique et de l’ontologie formelle.
Mais au lieu diriger notre connaissance sur la conscience de connais-sance et ses corrélats, nous pouvons également la diriger sur les configu-rations universelles de la conscience affective et de la conscience devolonté, et ici la seule question est de savoir si l’on s’est analytiquementrendu compte de ce que les premiers éthiciens avaient omis de mettre enlumière, à savoir que, dans les actes eux-mêmes en tant que prises de position,existe effectivement cette analogie radicale que nous avons brièvement signaléeprécédemment ; que par conséquent évaluer c’est également tenir-pour,présumer – et nous parlons de l’évaluer en tant que conscience affectiveen elle-même, avant tout juger qui s’y ajouterait. Aux actes de jugement,plus généralement aux actes de croyance, appartiennent des estimationsidéales selon des Idées de la validité et de la non-validité, et corrélative-ment leur appartiennent les Idées d’être véritable et de non-être ; demême, aux actes affectifs en tant que prises de position, appartiennentdes estimations idéales selon des Idées de la validité et de la non-validitéet, corrélativement, des Idées du beau et du bon, ou bien de non-beau etde non-bon, au sens de la validité.
Tout comme, dans la sphère du jugement, le juger en tant que faitpsychologique peut être envisagé dans des enchaînements de réalité psy-chophysique, il est possible de faire de même pour le sentir, le désirer, levouloir, avec les prises de position qui leur sont propres. De part etd’autre, la considération réelle-causale se situe dans une tout autre pers-pective que la considération par une estimation idéale, qui explore dansles différentes sphères différents enchaînements de l’a priori. A priori lejuger se distingue, en tant que tenir-pour-vrai en général, du juger juste,du juger qui, pour ainsi dire, atteint le but idéal de la vérité. Que tout jugeren général, à parler dans une universalité inconditionnée (donc a priori),
138 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[61]
13854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
relève de l’Idée normative de justesse et non-justesse, c’est axiomatique-ment évident [einzusehen]. Et il en va exactement de même, parallèlement,pour les actes de l’affectivité en tant qu’ils présument. Ils se placent sousles Idées de justesse et de non-justesse. A priori, un tenir-pour-bel-et-bonquelconque se distingue donc de celui qui est précisément juste, quiatteint son but idéal, qui évalue comme il faut évaluer. Et par suite, nouspouvons dans une considération a priori poser des lois idéales, les plusuniverselles, concernant ce devoir, et corrélativement, des lois idéalespour des valeurs possibles en tant que telles, du point de vue de leurforme, par analogie avec les lois logiques.
La toute-puissance de la raison logique consiste en ce qu’elle couvre lechamp entier du connaissable en général, et donc aussi du connaissableque nous avons désigné comme essence des espèces de raison. Elleconnaît donc justement l’existence a priori de plusieurs genres, différentspar essence, d’actes présomptifs, de prises de position, et ce qui en relève,comme nous croyons le voir, à savoir des espèces fondamentales de vali-dité ou, comme nous pouvons dire aussi, des espèces fondamentales denormation, d’obligation avec des espèces fondamentales de corrélats nor-matifs, de propositions valides ou encore d’objets, de valeurs. Les analo-gies essentielles qui existent ici se sont sans cesse imposées aux philoso-phes, mais elles requéraient une analyse plus approfondie, capable depénétrer jusqu’aux sources ultimes des analogies et de déceler effective-ment les structures parallèles des actes et des corrélats d’acte. C’est ainsique s’expliquent les confusions si chères à notre temps, de la raison judi-cative avec la raison évaluative. On aime à considérer tout uniment lejuger comme une espèce de l’évaluer, de l’évaluer au sens d’un acte del’affectivité.
Certes, en un certain sens très élargi, on peut dire que toutes les pré-somptions, toutes les prises de position doivent être désignées commedes « positions-de-valeur », que toutes se tiennent sous des Idées dudevoir ; à toutes, en tant que, précisément, elles présument, on doit poserla question de la justesse ou non-justesse, et donc, si l’on veut, la questionde la valeur [Wertfrage]. Mais au lieu de distinguer radicalement selon lesgenres fondamentaux et de se convaincre qu’il y a, à l’intérieur du genresuprême « acte », des genres irréductibles auxquels correspondent des
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 139
[62]
13954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
genres irréductibles de prises de position, et par conséquent d’obligationsou de validités ; en d’autres termes, au lieu de se convaincre que, sous letitre de « valeur », on a désormais conquis un concept universel, élargi parrapport au concept courant, qui se divise en genres fondamentaux irré-ductibles, on mélange tout d’une façon très confuse. On confond leconcept de valeur plus général avec le concept usuel qui est plus étroit,celui qui se rapporte à la sphère de l’affectivité. On prend le juger lui-même pour quelque chose d’affectif, ou encore : on cherche à faireaccroire que ce qui introduit dans le domaine du jugement la prétenduedifférence de valeur de la vérité et de l’erreur, consisterait dans l’interven-tion de sentiments évaluateurs, dans des sentiments d’un devoir transcen-dantal, dans l’intervention de sentiments de nécessité-de-pensée. C’estdonc ainsi que la raison spécifiquement logique se voit réinterprétée enune raison évaluative, qui se manifesterait exclusivement dans des senti-ments. Tandis que l’intellectualisme est enclin à supprimer toute raisondans la sphère émotionnelle et à la dissoudre dans des activités d’une rai-son logique, cet émotivisme procède à l’inverse : la raison logique estréinterprétée en raison émotionnelle ; une évaluation rationnelle, une éva-luation tout court, est simplement affaire du sentiment, sous réserve, bienentendu, de toutes les analyses plus fines, qui pourraient à leur tourrendre intelligible la manière dont le sentiment peut en général constituerune validité objective.
Naturellement, cette critique est dirigée contre les théories de Rickertet de Windelband, si prisées à notre époque. La raison axiologique,négligée par la tradition, fait en quelque sorte irruption dans ces théories.De fait, sa spécificité devient fortement et particulièrement sensible auxchercheurs mentionnés, qui s’adossent à Fichte, de sorte qu’ils tombentdans l’exagération de réinterpréter axiologiquement la raison logique. Parailleurs, et pour en revenir à notre point de départ, il ne faut pas que lasouveraineté universelle de la raison logique nous induise en erreur dansla mise en parallèle des espèces de raison. En elle s’exprime un certainentrelacement d’essence de la conscience doxique avec la conscienceaffective, et donc avec toute conscience en général, selon lequel toutprendre-position, tout évaluer-comme-beau ou -bon peut être a prioriconverti en un prendre-position judicatif. Ainsi ce n’est pas seulement la
140 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[63]
14054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
multiplicité des actes affectifs en tant que data phénoménologiques ou,dans une attitude psychologico-empirique, en tant que faits de la naturepsychophysique, qui deviennent objets d’activités judicatives et, plus spé-cifiquement, objets d’activités scientifiques ; mais ce sont aussi le droit etle non-droit des prises de position affectives et les « unités de droit » leurappartenant corrélativement, les valeurs et les connexions de valeur, leslois-de-valeur matérielles et formelles, qui deviennent le champ de cons-tatations s’accomplissant dans des actes logiques. Établir, constater,déterminer, bref objectiver au sens spécifique est l’affaire de la raisonlogique. La raison axiologique avec ses fonds est pour ainsi dire dissimuléeà elle-même. Elle ne devient manifeste que par la connaissance qui s’accom-plit sur la base des actes affectifs. Or la connaissance n’invente pas, ellemet seulement au jour ce qui, d’une certaine manière, est déjà là. Si l’af-fectivité n’était pas un domaine de présomptions, si, en elle, mais précisé-ment sur le mode de l’affectivité, des décisions n’avaient déjà donné leursuffrage, la connaissance ne trouverait rien [qui soit de l’ordre] desvaleurs et des contenus-de-valeur, elle ne découvrirait que des vécusaveugles, un peu comme des vécus du sentir-le-rouge ou du sentir-le-bleu. Un simple sentir, le simple fait d’éprouver un datum sensible ne pré-sume rien ; mais un plaisir présume, un souhait présume, etc. Présumern’est pas toujours juger (au sens courant), à savoir un mode du tenir-pour-quelque-chose doxique ; mais c’est bien un analogon du juger.
Par exemple, il est sûr que la volonté ne juge pas – vouloir en tant quetel n’est pas croire, ni connaître –, elle ne perçoit pas, elle ne prédique pas,elle n’effectue aucune déduction ni aucune induction, etc. Pourtant, en uncertain sens et métaphoriquement parlant, elle juge tout de même. Carelle n’est pas simplement là comme un fait psychologique semblable àn’importe quel autre, sur lequel la raison logique éventuellement statue,qu’elle insère dans l’enchaînement de la nature ; mais, que l’on porte ounon sur elle un jugement logique, elle parle elle-même, elle donne pour ainsi direson vote, elle est un évaluer et un se-décider. Nous nommons aussi le jugerun se-décider.
Il y a donc différentes espèces du se-décider, du voter. Le jugementest une conscience du « il en est ainsi », la volonté est une conscience d’uncertain « il doit en être ainsi ». Mais, assurément, la volonté ne peut pas
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 141
[64]
14154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:38
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
exprimer, énoncer seule ce dont, à sa façon, elle est conscience ; c’est là sanon-indépendance. Elle a besoin d’actes logiques pour pouvoir prendrela parole, et le résultat en est le jugement-de-devoir, qui est un jugementet non une volonté. La raison logique doit donc pour ainsi dire regarder lechamp de la raison pratique, elle doit donner à celle-ci l’œil de l’intellect,et ce n’est qu’alors que peut se manifester objectivement ce qu’exige lavolonté-raison et ce qui réside nécessairement dans le sens de ses exigen-ces. Surgissent alors des normes et des lois normatives qui, pour une part,possèdent leur vérité logique, pour autant qu’elles expriment fidèlementl’avis de la raison pratique et ce qui appartient au sens de cet avis, et qui,pour une autre part, se rapportent, sous la forme de leur rationalitélogique, à quelque chose qui n’est pas de la rationalité logique tout enayant bien quelque chose de commun avec cette dernière – qui peut, enun sens précisément nouveau, être nommé raison.
Bien sûr, ce ne sont pas là des démonstrations pleinement suffisantes.Ce sont des possibilités clairement vues et qui requièrent encore de plusprofondes confirmations par l’analyse. Elles suffisent pour ne pas laisserd’emblée apparaître comme inadmissible notre conception du parallé-lisme. Nous nous sommes en même temps avancés assez loin pour queles problèmes qui sont ici à résoudre soient à notre portée. Nous voyonsen quoi consiste ici la difficulté fondamentale, à savoir l’entrelacement dela raison logique et des prétendues raisons pratique et axiologique. Et leproblème fondamental est, dans un tel entrelacement, d’en discerner lescomposantes.
<§ 8. Récapitulation. La logique formelleen tant que fil conducteur pour la découverte
des structures parallèles dans la sphère de l’affectivité.La primauté de la raison logico-prédicative>
Résumons les considérations qui nous ont occupés dans les dernièressemaines avant les vacances. Depuis longtemps, on met en parallèle lescepticisme théorétique et le scepticisme éthique, tout comme on met enparallèle l’éthique et la logique elles-mêmes. Nous avons suivi ces analo-
142 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[65]
14254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
gies ; nous avons recherché ses sources les plus profondes ; nous avonscherché sa formulation la plus authentique et la plus prégnante ; nousavons distingué les analogies authentiques des analogies inauthentiques etnous avons découvert effectivement de telles analogies authentiques.Dans ces considérations se trouvaient déjà de profonds motifs pour sup-poser qu’il devait y avoir une discipline parallèle à la logique purementformelle, une éthique formelle apriorique, généralement parlant, uneaxiologie et une pratique formelles. En effet, les démêlés avec le scepti-cisme éthique nous renvoyaient spécialement au domaine scientifique dela logique en un sens étroit et fermement délimité, à savoir précisément àla logique analytique, à ladite logique formelle ; et, de même, le scepti-cisme éthique, en tant qu’il a été construit comme un analogon exact duscepticisme logique, nous indiquait une éthique formelle en un sens cor-respondant.
Même si, depuis l’Antiquité, l’on avait considéré la logique et l’éthiquecomme des disciplines philosophiques parallèles, il s’en fallait de beau-coup que le parallélisme eût été effectivement mis en œuvre de façonrigoureusement scientifique. La division qui s’était accomplie historique-ment dans la sphère logique, à savoir entre logique apriorique et aposté-riorique, logique formelle et matérielle – une distinction qui, assurément,a sans cesse été brouillée par les philosophies empiristes –, ces divisionsfondamentales, dis-je, en ce qui concerne l’éthique, n’avaient jamais étéaccomplies parfaitement et de la manière scientifiquement requise. Kant,qui avait donné ici les impulsions décisives et avait, comme nul autre,reconnu la signification fondatrice des divisions radicales à accomplir,avait certes cherché à fonder une éthique formelle apriorique. Mais nousnous sommes convaincus que cette éthique kantienne formaliste ne pou-vait valoir comme analogon de la logique formelle. Si Kant avait raison,l’analogie entre conscience théorétique (connaissante) et conscience pra-tique, entre le logique en général et l’éthique en général serait bien plutôtréduite à néant, et à sa suite s’effondrerait également l’analogie entre lelogico-formel et le pratico-formel. L’éthique matérielle, l’analogon de lalogique matérielle, était en effet abandonnée ; et l’éthique formelle seréduisait à un principe formel, à l’impératif catégorique, qui, bien qu’il aitéliminé toute matière de l’évaluer et du vouloir, devait cependant être
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 143
[66]
14354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
capable, pour chaque cas de l’agir concrètement donné, matériellementdéterminé, de prescrire ce qui était pour lui le bien conforme au devoir, cequi était éthiquement exigé. Or un principe logique au sens de la logiqueformelle est totalement incapable de discerner par simple subsomption,dans chaque cas de connaissance qui se présente concrètement, ce queserait pour lui le vrai positif.
Mais l’éthique formelle de Kant n’avait nullement été conçue commeun analogon de la logique formelle, de la logique analytique. Bien que l’op-position entre forme et matière dût être de part et d’autre analogue, Kantne se laissa pourtant pas guider, de façon radicale, par l’idée d’un parallé-lisme continu entre conscience rationnelle théorique et conscience ration-nelle pratique, et par l’idée d’une discipline analogue à la logique analytique,portant sur l’évaluer et le vouloir du point de vue des formes pures.
Pour notre part, nous avions mis toute notre énergie à traquer ce qu’ilfallait établir dans la sphère de la conscience affective et de ses corrélats, sil’on voulait qu’un analogon authentique, dans la forme d’une axiologie etd’une pratique formelles, existe. Nous avions cherché à nous procurer unereprésentation approfondie de l’essence de la logique formelle, et nousl’avions utilisée comme fil conducteur paralléliste pour la découverte éven-tuelle des structures, formes, lois formelles parallèles que nous conjectu-rions dans la sphère de l’affectivité. La logique se rapportait à la conscienceque nous nommions croyance, plus clairement : à la conscience doxique.Celle-ci se caractérise comme un présumer que quelque chose est. Plusspécialement, elle se rapporte à la doxa prédicative, dont le corrélat est laproposition prédicative. Lorsque nous en ôtons la forme linguistique, c’estle jugement rendu. Mais celui-ci a son corrélat objectif dans l’état dechoses. Il faut donc ici opérer une triple distinction : l’acte de juger ou, cequi revient au même, de présumer sur le mode du jugement, lequel se placesous la juridiction de la rationalité ou irrationalité doxique ; le jugement lui-même, ou apophansis, la proposition qui était le thème propre de la logiqueformelle traditionnelle, que nous avons nommée pour cette raison logiqueapophantique, en reprenant le terme aristotélicien ; et l’état de choses.
Des propositions sont vraies ou fausses, et le but de la logique formelleest d’énoncer des lois formelles de la vérité. Ces lois se laissent convertir enlois pour les objets et les états de choses en général, qui, tout comme les
144 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[67]
14454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
lois apophantiques et en un sens corrélatif, laissent toute « matière » dansune généralité indéterminée. Par cette conversion, nous entrons dans l’on-tologie formelle. Nous avons donc ici proprement une chaîne de discipli-nes formelles, se rapportant l’une à l’autre par des corrélations : la noétiqueformelle, l’apophantique formelle, l’ontologie formelle.
Or dans tous ces rapports, nous cherchions les parallèles, et nous lesavons trouvés. Nous avons trouvé que la conscience évaluative, qu’ellesoit conscience évaluant le beau ou le bon, ou conscience pratique, pré-sentait une telle analogie avec la conscience judicative, que nous pouvionsparler partout, en un sens très général, d’un présumer ; et il apparut aussique les parallèles du côté des corrélats d’acte, les analoga des propositionset les analoga des états de choses (en l’occurrence, comme états-de-valeur,états pratiques), ne manquaient pas. Certes, nous ne nous sommes paslaissé le temps d’une réalisation exacte et approfondie de ces parallèles ;nous aspirâmes aussitôt à aller plus loin. Après en avoir vu suffisammentpour être assurés d’une vaste analogie, nous avons cherché des parallèlesaux lois logico-formelles. Kant nous y a aidés par une remarque incidentedans les Fondements. Elle concernait des relations-de-volonté « analyti-ques », au sujet desquelles se trouvait convoquée la loi stipulant que qui-conque veut la fin doit vouloir le moyen qui est seul à y conduire.
Ici il faudrait d’abord commencer par ne pas manquer le sens légitimede cette expression d’ « analytique » et bien comprendre que cet « analy-tique » ne signifie pas, comme le croyait Kant, la même chose que l’ « ana-lytique » au sens logico-formel, mais que nous avons là plutôt un simpleanalogon du logico-analytique. Et il y avait là un point par lequel nousentrions dans la sphère authentique et tant recherchée d’un parallèle à lasphère logico-formelle. Les lois axiomatiquement évidentes qui règlentles relations de moyens à fins sont manifestement au sens propre du motdes lois aprioriques se rapportant à la sphère de la volonté et de ses corré-lats essentiels. Elles valent, manifestement, dans une nécessité et une uni-versalité inconditionnées, et ce sont des lois formelles, dans la mesure oùelles ne renferment pas la moindre parcelle de la matière de ce qui estvoulu. Seule la forme, en l’occurrence la forme de la volonté, est ici enquestion. À quoi que puisse se référer la volonté, une distinction possibleentre vouloir-le-but et vouloir-le-moyen appartient à son essence en tant
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 145
14554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
que volonté, et à ceci correspondent, du côté des corrélats, des étants-voulus en tant que tels, certaines formes intelligibles uniquement danscette corrélation, auxquelles font allusion les termes de fin et moyen. Or,à ces formes pures se réfèrent des lois de la rationalité de la volonté, les-quelles sont manifestement parallèles aux lois formelles de la rationalitédu juger au simple point de vue des formes du jugement.
Certes, une sérieuse difficulté entravait ici notre chemin, une diffi-culté dont l’élucidation complète [nous] entraîne dans des recherchesphénoménologiques très profondes. C’est, pour le dire brièvement, leproblème de la souveraineté universelle de la raison logique. En soi etpour parler en position de surplomb, il va entièrement de soi qu’unepensée logique est toujours à l’œuvre là où sont posées des propositionsou des lois. Si nous procédons en cela rationnellement, nous procédonsévidemment selon la rationalité logique. Mais nous ne sommes pas auto-risés pour autant à conclure qu’il n’y a qu’une seule et unique raison, laraison logique, la raison qui se manifeste dans le croire et les activitéssupérieures du déterminer conceptuel, du prédiquer.
Par souci de netteté, je souligne que le mot de raison n’est pasentendu ici au sens d’une faculté de l’âme humaine, donc psychologique-ment, au sens courant, mais plutôt pris comme un titre pour la classe,close par essence, d’actes et de corrélats d’acte leur appartenant, qui setiennent sous des Idées de la légitimité [Rechtmäßigkeit] et de l’illégitimité,corrélativement de la vérité et de la fausseté, du consister et du ne-pas-consister, etc. Autant nous pouvons discerner d’espèces fondamentalesd’actes pour lesquelles cela vaut, autant [il y a] d’espèces fondamentalesde raison. En premier lieu sont ici envisageables les actes doxiques, lesactes de la certitude-de-croyance avec leurs modalités. Mais il faut allerplus loin. Un acte, de quelque sorte qu’il soit, qui a le caractère d’un pré-sumer, d’un tenir-pour... au sens le plus large du terme (et nous voyonsbien que cette généralisation se fait à bon droit) se tient sous de tellesIdées normatives, qui sont des généralisations correspondant à celles quise produisent dans la sphère logique. La raison logique possède néan-moins l’insigne privilège de formuler le droit, de déterminer la légitimité,de prédiquer et de formuler des lois juridiques en tant que lois, non seu-lement dans son propre champ, mais dans le champ de tous les autres
146 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[68]
14654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
genres du présumer, donc dans toute autre sphère de la raison. Raisonévaluative et raison pratique sont, pour ainsi dire, muettes et, d’une cer-taine manière, aveugles. Même le voir, en un sens plus ou moins restreintou élargi, donc aussi au sens de l’ « intuition évidente », est un actedoxique. Un droit peut exister sans être vu, il peut exister sans êtreramené sous des concepts de droit, sans être explicité et pensé sous laforme d’un jugement, sans être formulé dans la forme énonciatrice d’uneloi. Il est là en tant que droit d’une raison évaluative, lorsque des actesévaluatifs d’une certaine spécification et formation d’essence sont effec-tués ou bien effectuables. Or, une raison simplement évaluative ne voitpas, ne conçoit pas, n’explicite pas, ne prédique pas. À elle doivent doncs’entrelacer des actes de la sphère logique au sens le plus large du terme,des actes de la sphère doxique. Ce n’est que dans l’accomplissement detels actes que des actes en général et que ce qu’ils présument peuvent sedonner à nous objectivement et que nous pouvons par suite saisir dansl’évidence que des actes évaluatifs sont des actes présomptifs, des actesqui tiennent pour beau, pour bon, et en outre, qu’ils se tiennent sous desprédicats idéaux de la rectitude et de la non-rectitude, etc. Il faut doncque le flambeau de la raison logique soit brandi, pour que ce qui est caché entant que formes et normes dans la sphère de l’affectivité et de la volontépuisse surgir en pleine lumière. Cependant, les actes logiques ne fontqu’éclairer et rendre visible ce qui est déjà là. Ils se bornent à constituerles formes logiques, mais non les contenus-de-raison, adéquatement sai-sis dans ces formes, des sphères de raison parallèles. Certes je dois insistersur le point suivant : pour comprendre par des raisons ultimes commentdes actes doxiques et comment les actes logiques supérieurs peuvent opé-rer ce qui leur incombe ici et, de l’autre côté, pour comprendre par desraisons ultimes ce que cela signifie, que des actes affectifs soient des sour-ces originaires de valeurs rationnelles qui leur sont propres, et qui se prê-tent ultérieurement à une saisie et une détermination logiques, tout celarequiert de très difficiles investigations dans le domaine des structuresd’essence universelles de la conscience. S’il nous reste du temps, noustenterons de proposer plus tard un échantillon de cette phénoménologiedes structures de la raison, qui accomplit une élucidation ultime.Renouons maintenant le fil principal de nos discussions.
SECTION I. LE PARALLÉLISME ENTRE LOGIQUE ET ÉTHIQUE 147
[69]
14754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
page 148 bl
14854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<SECTION IIAXIOLOGIE FORMELLE>
<§ 9. Lois aprioriques de la motivation en tant que loisde la conséquence rationnelle. Connexions de motivation
entre sphère logique et sphère axiologique>
Certaines analogies se sont offertes à nous entre la pensée analytico-logique, telle qu’elle règne dans l’inférer syllogistique, et le vouloir pourainsi dire analytico-pratique, tel qu’il règne dans tout comportement-de-volonté selon fins et moyens. De même que, dans le domaine logique etspécialement dans les rapports de pensée médiate, nous parlions d’anté-cédent [Grund] et de conséquence [Folge] analytiques, il nous faudrait iciparler d’antécédents et de conséquences analytico-pratiques. Par suite,c’est dans le but que résiderait l’ « antécédent » pratique du moyen. Il yaurait lieu de caractériser la décision-de-but, le projet-de-but, comme unprincipe de la volonté [Willens-Grundsatz], comme prémisse-de-volontépour la décision relative au moyen, elle-même proposition-conséquencede la volonté [Willens-Folge-Satz].
Du point de vue logique normatif, on dit à propos des actes de juge-ment que le juger de la proposition conclusive est rationnellement
[70]
14954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
motivé par le juger des prémisses – nota bene, quand la conclusion estprécisément une conclusion effectuée rationnellement. Ou, pour parlerde façon plus générale : le juger d’une conclusion est théorétiquementmotivé par le juger des prémisses, et cette motivation est ou n’est pasune motivation rationnelle. Elle est soumise à la question théorétique dedroit [der theoretischen Rechtsfrage]. Pour ce jugement de droit [Rechtsbeurtei-lung] valent les lois logiques formelles qui se fondent sur la forme descontenus de jugement (des propositions logiques) ; elles fonctionnentnormativement par rapport au juger rationnel en général, dans la mesureoù, précisément, il est déterminé dans sa rationalité par la forme descontenus de jugement.
Parallèlement, on dira dans la sphère pratique, à propos des enchaî-nements d’actes de volonté, que le vouloir du moyen est motivé prati-quement par le vouloir des prémisses. À la motivation du jugement cor-respond ici la motivation de la volonté, qui doit également subir lejugement de droit et se tient sous des règles d’une rationalité pratique.Ces normes, elles aussi, doivent reposer dans un « contenu », dans l’ana-logon du contenu de jugement ou de la proposition logique. Lorsquel’acte logique de la prédication-du-droit extrait ici des fondements dedroit [Rechtsgründe], il ne les obtient précisément que parce qu’ils résidentdans le domaine de la volonté en tant que droit de la volonté qui lui estpropre.
Et tout cela vaut manifestement pour la sphère axiologique la plus univer-selle : partout où l’on peut parler en quelque façon d’évaluer et de valeur,règne la différence entre antécédents-de-valeur et conséquences-de-valeur, entrevaleurs présupposées et valeurs qui reposent sur elles ou en dérivent. Cesdernières sont des valeurs en vue d’autres valeurs, les premières sont pourainsi dire des valeurs-prémisses ou des valeurs-fondements. Les fonde-ments ne sont nulle part, en ce domaine, des fondements logiques, maisdes fondements de valeur. Et pour ce qui concerne les enchaînementsd’actes d’évaluation, des enchaînements de la motivation existent danstoutes les sphères : l’évaluer fondateur motive l’évaluer en faveur desvaleurs dérivées. Et la motivation, sous toutes ses formes, est soumise aujugement de droit ; elle est rationnelle ou irrationnelle et elle est soumise àdes lois normatives, mais plus particulièrement à des lois normatives for-
150 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[71]
15054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
melles qui font abstraction de la matière de chaque valeur-fin ou valeur-moyen. En tout cela, nous pouvons parler de lois de la conséquence, qui sontprécisément partout des lois de motivation rationnelle ; et, corrélative-ment, le terme de motif est partout à sa place.
Des enchaînements de motivation empiètent et pénètrent égalementde façons diverses dans les différentes sphères. C’est déjà le cas dans ledomaine intellectif. Dans celui-ci, on ne range pas simplement en règlegénérale des jugements (au sens de convictions certaines), mais aussi dessuppositions [Vermutungen], ou encore des questions et des doutes. Ils’agit, dans tous les cas, de différentes spécifications modales des actesintellectifs originaires, ceux du croire certain. Or, les lois de la motiva-tion ne se bornent pas à relier un croire certain à un croire, l’être-convaincu avec certitude à l’être-convaincu. Prenons d’abord des exem-ples illustrant cela : si je crois que si A vaut, B vaut aussi, et si je croisque B ne vaut pas, alors il ne m’est pas permis de croire de façon ration-nelle que A vaut ; et de même pour les tournures normatives de toutesles autres lois logiques formelles. Nous avons cependant aussi, dis-je, desmotivations reliant différentes sphères : celui qui est convaincu que A vaut, nepeut pas douter de manière rationnelle que A vaille. Celui qui estconvaincu de façon certaine que A ne vaut pas, ne peut pas rationnelle-ment conjecturer que A vaut. Qui est sûr que A est, ne peut pas, ration-nellement, poser la question : A existe-t-il ou non ?, etc. Tout cela estl’affaire de la « conséquence » rationnelle. Mais une telle conséquence lie aussi ledomaine intellectif aux domaines de l’affectivité ; la raison théorétique et la rai-son évaluative sont partout entrelacées. À ce sujet, la raison théorétiqueest bien plus libre et indépendante. Car la raison évaluative est nécessai-rement entrelacée à la raison théorétique. Cela est d’abord lié au fait quedes actes intellectifs, des actes « objectivants » (des actes représentant oujugeant ou conjecturant) – dans lesquels les objectités évaluées accèdentà la représentation et se présentent éventuellement en certitude ou enprobabilité comme étant ou n’étant pas –, sont nécessairement au fondementde tout acte évaluant. Et cet être-fondé [Fundiertsein] n’est pas simplementpsychologique. C’est bien plutôt conformément à son essence que l’acteévaluant est fondé sur l’acte intellectif, précisément dans la mesure où ilconstitue l’apparition de valeur.
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 151
[72]
15154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Cet entrelacement induit aisément en erreur, car il conduit à dire queles actes évaluatifs ne sont intentionnels qu’au sens où ils sont dirigés surles objectités représentées. Mais nous aurons à exposer en détail que, ausens propre, seuls des actes objectivants sont dirigés sur de l’objectif, surde l’étant ou du non-étant, tandis que des actes évaluatifs sont dirigés surdes valeurs, et plus précisément, sur des valeurs positives et négatives.Certes, ces deux types de corrélats sont fusionnés matériellement, oumême, dans les actes, essentiellement : des valeurs ont leur côté-objet eten même temps leur côté-valeur spécifique, celui-là fondant celui-ci, etlorsque les valeurs deviennent elles-mêmes objets de la connaissancejudicative, le côté-valeur se trouve lui-même objectivé. Cependant, quoiqu’il en soit, à ces relations quelque peu compliquées se rattache unemotivation de raison qui relie de l’intellectif et de l’axiologique. Parexemple, celui qui est convaincu que certainement A est, ne peut pas vou-loir A ; celui qui est convaincu que A n’est pas, ne peut pas vouloir queA ne soit pas ; il en va de même lorsque, au lieu de « celui qui estconvaincu », nous disons « celui qui présume avec une probabilité empor-tant la conviction ». Il n’est pas question ici, bien entendu, d’un pouvoirou d’un ne-pas-pouvoir psychologiques, mais d’un a priori de la raison.
Examinons encore d’autres exemples, plaçons sous nos yeux le plusgrand nombre possible de telles propositions aprioriques, de façon ànous familiariser avec la nature de l’a priori dans la motivation – ou, pourle dire autrement, dans la conséquence – et à prendre un peu aussi lamesure de son étendue. Considérons la différence entre plaisir existentielet plaisir non existentiel, entre évaluer comme beau et évaluer commebon. Celui qui prend un plaisir non existentiel à un A (c’est-à-dire l’évaluecomme beau), celui-là doit rationnellement se réjouir dans le cas où il estcertain que ce « beau » est ; et il doit s’attrister dans le cas où il est certainqu’il n’est pas. Joie et tristesse sont ici des actes motivés rationnellement.Se réjouir ou s’attrister dans de tels cas, la conséquence rationnelle l’exigepour ainsi dire ; c’est une trivialité affective [Gefühlsselbstverständlichkeit] etmême une trivialité rationnelle, dont ce serait un contresens affectif[Gefühlswidersinn] de s’écarter. Bien sûr, aucun homme normal ne se com-portera autrement, mais nous n’avons cure ici du fait ; un fait contraire,comme chez un fou, n’aurait pas plus d’importance que le fait que se pro-
152 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[73]
15254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
duise, dans quelque intellect anomal, la conviction que 1 + 1 = 3. Joie ettristesse, disais-je, sont ici motivées : elles le sont, d’une part, par l’évalua-tion de beauté présupposée (elle constitue la présupposition de l’évalua-tion) et d’autre part, simultanément, par la conviction, par le jugementque le beau [en question] est. De façon semblable, une conjecture (éven-tuellement un jugement de probabilité) peut fonctionner comme motifsous une présupposition d’évaluation semblable ; la joie se transformealors en espoir. Vaut donc a priori [la loi] que les degrés de probabilité« déterminent » ici rationnellement la plénitude de la réjouissance de l’es-poir ; et de même dans le cas inverse de la crainte.
Remplaçons à présent la conjecture par l’hésitation du doute relatif àl’être ou au non-être du beau. Cette hésitation intellectuelle motive doncrationnellement l’hésitation affective entre l’espoir et la crainte. Précisonscela : si nous remplaçons l’hésitation intellectuelle par une indécisiontotale, dans un équilibre des poids de supposition parlant respectivementpour et contre l’être du beau, cet équilibre intellectuel motive alors unéquilibre affectif correspondant.
En outre, partout où, sous une même présupposition d’évaluation, lacertitude d’être du beau fait défaut, ou plutôt : partout où la conscienceest incertitude, celle-ci motive rationnellement le souhait que le beau soit ;de même s’il s’agit d’une chose déplaisante, le souhait négatif qu’elle nesoit pas. Il y aurait bien d’autres principes de motivation : si un jugementpositif motive une joie, alors le jugement négatif correspondant motiveune non-joie, et inversement. Et il en va de même pour d’autres actesd’évaluation.
<§ 10. Les lois de la valeur en tant qu’expression objectivedes lois de la motivation. Les lois axiologiques
formelles de la conséquence>
Dans la dernière leçon, nous avons commencé à discuter d’une sériede lois de la motivation, de lois d’une conséquence rationnelle, et j’aisignalé comment la motivation intellective et la motivation axiologique serelient entre elles, comment elles fonctionnent unitairement comme pré-
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 153
[74]
15354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
misses d’un motivat axiologique. Or, d’entrée de jeu, il faut à présentprendre garde, dans tous ces exemples, au fait qu’à la norme qui, à chaquefois, enjoint d’être conséquent, et qui veut être une norme de l’évaluerrationnel, correspond, parallèlement, une expression idéale et objective,qui porte sur des propositions axiologiques ou bien sur des valeurs, ouencore, sur ce que le sens du type d’évaluation à chaque fois concernéexige de façon purement idéale.
Nous énoncions, d’un point de vue subjectif : celui qui est convaincuque A est, ne peut pas vouloir A, cela serait irrationnel. Celui qui estconvaincu que A n’est pas, ne peut pas, rationnellement, fuir A. À celacorrespond objectivement la proposition selon laquelle il appartient ausens d’une décision que seul quelque chose qui n’est pas encore peut en être lebut. Nous disions : celui qui, sur la base d’une simple représentation,évalue sur un mode non existentiel, celui pour qui A se présente commequelque chose de beau (comme nous disions par extension extraordinairede l’expression), celui-là doit, rationnellement, se réjouir dans la certitudeque ce beau existe effectivement et s’attrister dans la certitude qu’iln’existe pas. Une probabilité, prépondérante dans le conjecturer, que cebeau existe motive l’espoir ; l’abondance de la réjouissance rationnelle del’espoir étant déterminée par la force de la conjecture.
À ces propositions correspondent des propositions objectives quiportent sur les corrélats correspondants et ne s’adressent pas au sujet ni àses actes singuliers. On dit, de ce point de vue objectif : si A est quelquechose de beau et s’il existe effectivement, alors c’est un bien ou, si l’onveut, il est bon que A existe si A est beau et existe effectivement. Mainte-nant, il n’est plus question des actes et de leur normation. « Bon » est icientendu comme le corrélat axiologique de la joie rationnelle, donccomme ce qui est digne de joie [das der Freude Werte]. De même : lorsqu’unnon-beau (le corrélat d’une évaluation négative non-existentielle) existeeffectivement, alors c’est un mal [Übel], et le fait qu’il existe effectivementest quelque chose de mauvais, est un « mal » [ « von Übel » ] (comme unevaleur de tristesse).
Ou encore : le non-être d’un non-beau est bon (réjouissant), l’êtred’un non-beau est un mal. L’être-possible et aussi l’être-probable d’unbeau sont bons, son être-improbable est non-bon. Le beau, dans la
154 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[75]
15454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mesure où il est probable, est digne d’espoir [hoffenswert] et, dans le casinverse, digne d’être déploré [bedauernswert]1. Si un non-beau est probable-ment existant, alors il est digne d’être déploré, il est un digne objet de tris-tesse [ein Trauernswertes], etc. Bien sûr, il nous manque ici des expressionssuffisamment empreintes d’objectivité. Poursuivons : le degré objectif del’espoir légitime est déterminé par le degré de la probabilité du beau, et ilen va exactement de même pour la crainte légitime (dans laquelle la non-valeur objective constitue le corrélat du craindre lorsque celui-ci estrationnel) : son degré objectif est rationnellement déterminé par lesdegrés de la probabilité du non-beau. En outre : le non-être de quelquechose de beau justifie la valeur-de-souhait objective ou, si l’on veut, la jus-tesse de la proposition de souhait : « Si seulement cette beauté existait ! » ;l’être d’un non-beau, la valeur-de-souhait négative objectivement consis-tante ou, si l’on veut, la proposition de souhait négative : « Si seulementelle pouvait ne pas exister ! », etc.2.
Considérons à présent les modifications hypothétiques (et causales)des actes affectifs qui sont les parallèles des modifications hypothétiquesdes actes intellectifs3. Voici une nouvelle loi : si quelqu’un se réjouit hypo-thétiquement, à savoir à l’idée que V4 soit et s’il tient compte du fait que Vserait si A était, alors la joie portant sur V se transfère rationnellementà A, A acquiert pour lui de la valeur. La pensée hypothétique que A soitmotive par suite une joie également hypothétique : celle qui considèreque, à la suite de A précisément, V aussi serait. Cela aussi est une légalitéde raison. Ainsi la joie se transfère hypothétiquement et par suite aussithétiquement. Si l’on se réjouit réellement de V et si l’on sait que, puisque
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 155
1. Nous touchons ici à la fois à l’une des ressources de la langue allemande en mêmetemps qu’à l’une de ses limites, qui ne lui est pas propre cependant. Une ressource : puisque lesuffixe -wert (ou -würdig) permet de forger l’ensemble des corrélats noématiques des actes affec-tifs. Une limite ce faisant : car pour des raisons qui tiennent à la nature de la chose elle-même,comme le dit Husserl, des expressions portant l’empreinte objective adéquate font nécessaire-ment défaut. (N.d.T.)
2. Ici aussi des « degrés ». (N.d.A.)3. De manière générale, catégoriquement-hypothétiquement-disjonctivement : « rela-
tion ». Positivement-négativement : « qualité » ; aussi affirmer, approuver, agréer, refuserc’est.à.dire désapprouver. (N.d.A.)
4. Husserl emploie la lettre W pour désigner la valeur (Wert). Pour des raisons compré-hensibles, nous lui substituons la lettre V. (N.d.T.)
15554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:39
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
A est, V est aussi, alors la joie se transfère rationnellement à A. Si l’on estconséquent, lorsqu’on a jugé et ressenti de telle ou telle façon, on doit res-sentir de telle façon.
À la loi de motivation, nous le voyons, fait face la légalité objective : siV est une valeur et s’il est vrai que, si A existe, alors V existe aussi, alorsA est aussi, eu égard à cela, une valeur. Par suite, les signes de valeur[Wertvorzeichen] pour A et pour V respectivement, sont les mêmes. La pro-priété-de-valeur se transfère continuellement, par application constantede la proposition, selon une ligne ascendante, si nous avons des consécu-tions existentielles : si M, alors N, si N, alors P, si P, alors Q, etc., et enfin,si Q, alors V. Tout cela vaut a priori. Nous avons ici une inférence axiolo-gique, où l’une des prémisses est un fait-de-valeur et l’autre, un état de chosesintellectuel. Les deux prémisses sont prises ensemble dans l’inférence axio-logique ; sous la forme du « ensemble » précisément, du « et » : si V est unevaleur et s’il est vrai que si A, alors V.
On doit bien distinguer ce « et » axiologique du [« et »] simplementlogique qui unit les prémisses d’une inférence intellectuelle. Si nousremontons, de part et d’autre, à la conscience dans l’inférer, dans l’accom-plissement de la conséquence, la réunion des prémisses (dans la cons-cience d’inférence théorétique) se présente à nos yeux comme unensemble [Bestand] théorétique homogène. Dans le cas de l’évaluer, enrevanche, il y a, d’un côté, un évaluer de V et, d’un autre côté, le juger : siA vaut, V vaut aussi. En soi, cela ne donne pas encore une unité. Il y asituation d’unité intellectuelle si nous unifions intellectuellement le juge-ment « V est une valeur » et le jugement « si A vaut, V vaut » ; mais nousn’effectuons en aucune façon une inférence intellectuelle. L’unité entrel’acte de l’évaluer et le juger s’accomplit par cela même que nous expri-mons par « prendre en considération axiologique ». Nous évaluons V etnous prenons en considération que V serait si A était. Cette « considéra-tion » n’est pas un acte théorétique. Nous « prenons en considérationaxiologique », cela veut dire précisément que la conviction théorétiqueacquiert une fonction affective et devient affectivement motivante, nonthéorétiquement motivante. L’inférence dit donc que, si B est une valeur,alors – en considération de la situation selon laquelle, si A était, alorsB serait – A est aussi une valeur. Au lieu de « en considération de », nous
156 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[76]
15654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
disons aussi « en référence à » ou simplement : si B est une valeur « et »qu’à cela s’ajoute que, si A était, B serait. Il ne s’agit donc nullement d’unsimple « et » et d’un « en référence à », d’un « en considération de ce que »logiques. Il faut y prendre garde, de la même façon, dans tous les cas sem-blables ; ainsi dans le cas des disjonctives.
La loi de valeur énoncée admet encore des délimitations ou, si l’onveut, des particularisations plus précises. Nous avons dit : si V est unevaleur et s’il est vrai que, si A est, V est, alors A est, au sens de valeurdécoulant de, valeur relative à V, valeur dérivée. La prémisse « si A est,V est », voilà ce qu’il faut ici délimiter. L’existence de V doit être nécessai-rement liée à l’existence de A, de telle sorte que l’être de A entraîne celuide V. En tout cas, cela est exact si A est un tout, incluant en lui V à titrede partie réelle [reellen]. Nous aurions ainsi la loi : la valeur d’une partieconfère au tout une valeur relative, lui confère donc éventuellement unevaleur grâce à la partie qui primitivement est une valeur.
Il faut ici prendre garde à ce qui suit. Un tout peut comporter unepartie qui n’est proprement valeur, c’est-à-dire qui ne déploie ses proprié-tés-de-valeur, que lorsqu’elle n’est pas dans le tout, mais qu’elle est poursoi, séparée du tout, et qu’alors elle fonctionne éventuellement dans telsou tels contextes nouveaux. Par suite, le tout n’a de valeur que relative-ment au fait que la partie peut être éventuellement séparée de lui, et il n’aplus de valeur transférée si la partie est purement et simplement insépa-rable. Par exemple, l’or dans le soleil ne confère au soleil aucune valeurutile [Nutzwert], on ne peut le prélever et il n’est pas utilisable aux finspour lesquelles l’or est valeur. Il en va autrement lorsqu’un tout com-prend des parties qui déploient leurs propriétés de valeur tout en étantintégrées au tout. Donc, chaque partie qui est valeur véritable dans letout, confère au tout lui-même une valeur dérivée ; et c’est cela qu’énoncela loi. En outre, le tout acquiert également de la valeur dérivée par rapportà des processus causaux possibles du détachement de parties dotées devaleur. Mais, dans ce cas, entre en lice une autre loi de valeur encore, dontnous allons parler dans un instant.
Par parties, nous entendions ici parties concrètes. Habituellement, onne pense pas, en effet, à des moments – ou, si l’on préfère, à des proprié-tés – non autonomes. Néanmoins, des objets concrets sont valables grâce
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 157
[77]
15754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
à certaines propriétés qui leur « confèrent » de la valeur : autrement dit, despropriétés comme une belle couleur, une forme agréable, qui, de façonnon-autonome, ont leur être dans l’objet, sont primitivement valables ; etsi elles sont valables, alors le tout est lui aussi, par transfert, valable. Vautainsi l’universelle loi de valeur : si une propriété est dotée de valeur, alorstous les objets qui la possèdent sont, grâce à elle, dotés de valeur. En liai-son avec la loi précédente, il résulte, à titre de proposition conséquente,que des propriétés de valeur des parties d’un tout confèrent au tout lui-même une valeur dérivée. Une autre conséquence est que des touts ayantune valeur dérivée en vertu des ces raisons perdent leur valeur dérivéelorsque les propriétés ou parties fondatrices de valeur ont perdu par altéra-tion leur caractère fondateur de valeur. Il n’est pas besoin de dire commentil faut envisager ici la différence entre valeur positive et valeur négative.
Si, dans la formule générale, nous prenons en compte la dépendanceexistentielle spécialement en tant que conséquence [Folge] réelle-causale,nous obtenons la loi suivante : si V est un objet-valeur ou encore un étatde choses doté de valeur, et si A est une cause de V (ou si l’état de chosesV est une conséquence réelle de l’état de choses A), alors la valeur V setransfère sur A, de l’effet à la cause, de la conséquence réelle à l’antécé-dent réel. Donc, la cause d’une valeur (ne serait-ce qu’à titre de cause par-tielle) est elle-même, du fait de cette relation, une valeur dérivée et, natu-rellement, une valeur de même signe, comme dans les relationsprécédentes. En application constante de la loi, il en résulte alors que lavaleur d’un effet se transfère à la série entière des causes, en ligne ascen-dante, sans que rien ne soit dit néanmoins des grandeurs-de-valeur, desrelations d’accroissement ou de diminution de valeur, auxquelles nousn’avons jusqu’ici prêté absolument aucune attention.
Nous pouvons aussi modifier la loi universelle de valeur et obtenir,par suite, la nouvelle loi suivante : si V est quelque chose de valable et s’ilest vrai que si A est, V n’est pas, alors A est quelque chose de non valablerelativement. Il en résulte par exemple : si A n’est pas une cause positive,mais plutôt une cause négative, non pas une cause productrice, mais plu-tôt une cause inhibitrice de V, alors A est certes aussi une valeur dérivéerelativement à V, mais une valeur de signe opposé. Bien entendu nouspouvons dire aussi : si V est une valeur, alors, en présupposant que seul
158 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[78]
15854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
l’un des deux, A ou V, peut être, A est une non-valeur. Nous maintenonsdans ce dernier cas que, si A, alors non-V. Si V est une valeur, alors, enprésupposant que V et A ne peuvent venir à l’existence qu’ensemble (quetous deux sont nécessairement liés l’un à l’autre dans l’existence), A estlui-même une valeur dérivée de même signe. Mais alors, les lois incluentmanifestement des composantes redondantes.
Nous pouvons bien sûr, abstraction faite de la causalité, énoncer aussil’application suivante des deux lois générales : s’il est valable que S est P,alors il est non valable que S n’est pas P. Si un état de choses est valable,alors un état de choses incompatible avec lui, l’excluant, voire l’excluantlogiquement, est non valable. De même, si un état de choses est valable,alors tout état de choses équivalent est aussi valable, avec le même signe[Vorzeichen]. Cependant, nous ne pouvons pas dire que tout état de chosesqui s’y trouve contenu analytiquement soit valable, car il n’est pas certainque chacun contienne en général les moments fondateurs de valeur.
Nous trouvons donc ici des lois formelles qui se fondent sur l’essencede la valeur. Du moins au sujet des formules les plus générales – dans les-quelles il est question seulement en général (sans immixtion de choséitéréelle) de valeur et de non-valeur, d’être-conditionné, d’être-compatible,d’être-incompatible, etc. –, nous pouvons dire que ce sont des lois pure-ment formelles, fondées purement sur l’Idée la plus universelle de valeur etd’état de choses de valeur ; et les lois énoncées traitent, dans une tellegénéralité, de valeurs dérivées, qui sont des valeurs grâce à d’autresvaleurs, c’est-à-dire sur la base de la présupposition que quelque chosesoit déjà une valeur. Il y a donc des lois évidentes de la consécution-de-valeur, deslois évidentes sur des inférences de valeur, et corrélativement leur correspon-dent des normes de l’inférer évaluatif, des normes qui disent : si l’on tientdéjà V pour une valeur, et si l’on prend en compte tels ou tels enchaîne-ments existentiels, on doit alors, si l’on est conséquent, se comporter detelle ou telle façon dans la poursuite de l’évaluation. En cela, parmi lesprésuppositions axiologiques, se présentent toujours aussi des jugementsmotivants, des convictions ou des conjectures motivantes ; éventuelle-ment aussi d’autres actes intellectifs.
À ces lois appartient aussi celle selon laquelle tout enchaînement de moti-vation – ou, si l’on veut, tout enchaînement entre valeurs fondatrices et
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 159
[79]
15954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
valeurs dérivées – est toujours un [enchaînement] fini. La fondation devaleur ne peut, pas davantage que dans la sphère de l’inférence théoré-tique, dégénérer en une régression à l’infini. Il est possible que les prémis-ses d’une conclusion soient à leur tour inférées, et qu’à leur tour les pré-misses de la nouvelle conclusion le soient aussi. Mais cela ne peut sepoursuivre in infinitum. Nous devons arriver à des raisons premières quine soient pas à nouveau elles-mêmes des raisons déduites. De même,toute justification axiologique doit conduire, elle aussi, à des raisons-de-valeur premières qui ne soient pas elles-mêmes à leur tour, pour ainsidire, des valeurs « inférées », donc à des valeurs qui ne soient pas à leurtour des valeurs en vertu d’autres valeurs présupposées.
Il faut cependant ajouter aussitôt que l’on peut douter qu’avec cettenécessaire présupposition de valeurs non dérivées, la question de l’objec-tivité inconditionnée de telles valeurs se trouve eo ipso résolue. Celui quenous avons pu convaincre que la conséquence dans l’évaluer n’est passeulement une caractéristique empirique des vécus d’évaluation, mais que(tout comme la conséquence dans le juger) elle se tient sous des normesaprioriques auxquelles correspondent des lois aprioriques pour des rap-ports de valeur idéaux – celui-là, dis-je, qui s’en est laissé convaincre, peuttenter encore d’adopter le point de vue suivant : si j’évalue A (pourrait-ildire), il me faut, dans les contextes de motivation donnés, évaluer B C...selon une direction descendante ; c’est ce qu’exige la raison dans la consé-quence, c’est ce qu’exigent les lois formelles de la conséquence ; et il estcertain que je dois par là même (si A n’est pas déjà valable en lui-même,mais seulement de façon dérivée) en venir finalement à un premierA valable en soi. Mais cela ne revient pas à dire que A serait valable en soiau sens de l’objectivité authentique, au sens de l’indépendance vis-à-visdu sujet évaluant de façon contingente et vis-à-vis de son humeur contin-gente. Il y a précisément à chaque fois des évaluations non motivées, et ilfaut qu’il y en ait de telles ; mais j’évalue de façon non-motivée tantôt A,tantôt non-A ; de même, un tel évalue A et tel autre, non-A. Il se pourraitque quelqu’un refuse le scepticisme sous le rapport théorétique, et qu’ilsoit pourtant sceptique sous le rapport axiologique, et cela quand bienmême il reconnaîtrait l’axiologie de la conséquence. Que je doive aussime comporter avec conséquence, au sens où je devrais nécessairement et
160 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[80]
16054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
par devoir évaluer toujours et encore, pour toute éternité, le même A– cela (dirait-il), aucune raison ne le prescrit. Ce qui importe ici, c’est queles axiomes précédents n’excluent pas le scepticisme axiologique. Maisavec la mise en lumière de la raison axiologique, sous la forme de laconséquence axiologique, nous n’avons pas non plus épuisé notre tâche.Il n’en reste pas moins que c’est là un premier domaine important. Nousverrons bien comment aller plus loin.
<§ 11. Le principe de contradiction dans la sphère axiologique.>
<a) La référence à la situation de motivation dans l’analogondu principe de contradiction dans la sphère affective.
L’exemption de valeur et les axiomes qui en relèvent>
Si, conformément aux lois que nous avons appris à connaître, nousdistinguons des valeurs non-dérivées et des valeurs dérivées, il fautprendre garde au fait qu’un seul et même A, en fonction des dérivationsde valeur dans lesquelles il se tient (et subjectivement, en fonction desenchaînements-de-motivation dans lesquels se tient son évaluer), peutprendre une valeur tantôt positive, tantôt négative. Il faut, dans ledomaine de la valeur, prendre garde à ce fait fondamental que des valeurspeuvent entrer en collision les unes avec les autres ; par exemple, si A estune valeur, alors, relativement à cela, tout ce qui exclut l’existence de Aest une non-valeur. Ce qui exclut de la sorte peut cependant, pour d’au-tres raisons, être une valeur. Partout où deux valeurs se heurtent dansl’existence, l’une est relativement à l’autre – en tant qu’elle la supprimeexistentiellement – non-valable. D’un autre côté, elle est, en elle-même,valable. La conciliation est obtenue ici par les lois de la liaison de valeur etde la comparaison de valeur [Wertabwägung], auxquelles nous n’avons pasencore eu affaire.
Mais d’abord, il faut énoncer une loi fondamentale qui, à peu de cho-ses près, ressemble au principe de contradiction, surtout lorsque nousl’énonçons crûment ainsi : si A est une valeur positive, il n’est pas unevaleur négative. S’il est une valeur négative, il n’est pas une valeur posi-
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 161
[81]
16154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tive ; ceci en référence à la même espèce d’évaluation (qualité de valeur).Mais dans le domaine axiologique, la loi s’applique dans une situation demotivation particulière qu’il faut maintenir à l’identique de part etd’autre.
Nous pouvons formuler les choses ainsi : pour une même matièred’évaluation, des évaluations positives et négatives du même genre dequalité ne s’excluent certes pas, mais il est vrai en revanche qu’elles s’ex-cluent lorsqu’elles portent sur une même matière d’évaluation dans unemême situation de motivation. Pour couvrir l’ensemble, incluons égale-ment le cas où une chose présente de la valeur en elle-même (et où, éven-tuellement, elle est attestable comme telle devant la raison). Nous disonsalors que l’évaluer est motivé en soi-même, ce qui est donc une autrefaçon de dire qu’il n’est pas motivé par un deuxième évaluer ; en d’autrestermes, que, corrélativement, on n’a pas conscience de la valeur présuméecomme d’une valeur dérivée, comme d’une valeur en vertu d’une autrevaleur présumée. Nous prenons donc la loi suivante au sens large : unemême matière d’évaluation et une même situation de motivation étantprésupposées, si l’évaluer positif est rationnel, l’évaluer négatif du mêmegenre d’évaluation est irrationnel, et inversement. Corrélativement : avecles mêmes présuppositions de valeur (les mêmes prémisses de valeurs),des valeurs « contradictoirement » opposées dans le même contenu s’ex-cluent ; [il est exclu] par exemple que – dans le même contenu « S est p » –ce soit à la fois réjouissant et non réjouissant. Ce serait irrationnel, ceserait une contradiction axiologique de se réjouir que S est p et, pour lesmêmes motifs, de s’attrister que S est p.
Dans la sphère du jugement, l’analogon est en l’occurrence le suivant :pour la même matière, disons « S est p » (entre guillemets, donc pris entant que simple matière), le poser judicatif « il en est ainsi ! » et le nier judi-catif « il n’en est pas ainsi ! » s’excluent rationnellement. Mais ici, nousn’ajoutons pas la restriction : eu égard à la même situation de motivation,même s’il est exact qu’il serait irrationnel, en concluant sur la base desmêmes prémisses, de juger qu’ « il en est ainsi ! » et qu’ « il n’en n’est pasainsi ! ». Ici, le principe du tiers exclu nous dit en complément que, pourtoute matière propositionnelle, l’une des deux choses se produit effecti-vement et nécessairement : ou bien « il en est ainsi » ou bien « il n’en est
162 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[82]
16254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pas ainsi », et si l’un, alors non l’autre, et inversement. Le « il en est ainsi »déduit a en même temps la validité du « il en est ainsi absolument ».
La situation est-elle cependant la même dans la sphère de l’affecti-vité ? Un analogon du principe du tiers exclu vaut-il ici, et en un sens quiassure que validité dérivée et validité en général sont équivalentes1 ? Ici ilfaut ajouter la référence restrictive à la situation de motivation, et il estclair que, s’il est possible de mettre effectivement en évidence quelquechose comme un analogon du principe de contradiction, la fonction de cedernier ne peut pas être la même. Ici des prédicats de validité opposés ausujet d’un même contenu sont tout à fait compatibles, eu égard à des pré-misses d’évaluation différentes.
Aussi grande donc que soit l’analogie de part et d’autre, dans lamesure où nous avons, en effet, trouvé de part et d’autre des relations dela conséquence, des relations entre antécédent et conséquence, il y apourtant, en tout cas, cette différence fondamentale : dans le domainelogique, nous savons que, lorsque nous dérivons une conséquencecontradictoire à partir de systèmes de prémisses différents, l’un ou l’autredes systèmes de prémisses doit contenir quelque chose de faux. Noussavons cela, précisément, grâce aux principes de contradiction et du tiersexclu. Il n’y a pas, sur la base de prémisses valides, une vérité relative : Sest p, qui serait compatible avec une autre vérité relative : S n’est pas p.Mais, d’un autre côté, là où, sur la base de présuppositions de valeur dif-férentes, on conclut à des validités-de-valeur [Wertgeltungen] relativesopposées, il n’est pas possible de dire que l’un ou l’autre système de pré-suppositions de valeur est forcément non valide. Une validité de beautéou une validité de bonté sous un certain rapport sont compatibles avecune validité de non-beauté et une validité de méchanceté sous un autrerapport. À cela se rattache [le fait suivant] : si nous jugeons que S est p,alors il peut se révéler que le juger soit erroné, mais nous savons en ce casque le juger opposé est juste, il ne peut pas rationnellement s’avérerqu’aucune prise de position judicative ne soit exigée.
Il en va autrement dans le domaine de l’affectivité. Car il peut s’avérerque l’évaluer référé à l’être-p de S soit irrationnel non seulement dans la
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 163
1. Non. (N.d.A.)
[83]
16354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
qualité d’évaluation déterminée, mais dans toute qualité, à savoir quandune valeur du contenu « S est p » n’existe pas du tout, ni en tant que valeuren soi, ni en tant que valeur dérivée. À tout présumer judicatif correspondun jugement vrai – ou bien un jugement de même sens, ou bien un juge-ment de sens opposé –, et cela indépendamment de toute référence à desprémisses. Mais il n’en va pas ainsi pour tout présumer évaluatif. Ici nouspouvons certes aussi énoncer une loi, mais son contenu se limite à ceci :toute matière d’évaluation possible ou, plus distinctement, tout contenususceptible d’évaluation, ne doit pas être évalué négativement s’il est éva-lué positivement ; ou plus exactement : pour toute catégorie d’évaluation,si une évaluation positive est rationnelle ou valide dans telle situation-de-motivation donnée, l’évaluation négative est non valide, et inversement.Il nous faudrait seulement ajouter la loi stipulant que la différence entrepositivité et négativité appartient précisément à l’essence de l’évaluer ;que, si un contenu est rationnellement évaluable en général, il est précisé-ment évaluable et valable [wertbar und wert] positivement ou négativement,selon la catégorie de valeur concernée ; en quoi, cependant, les prédicatsde valeur positifs et négatifs ne s’excluent que dans des situations demotivation identiques.
Ce sont donc là des différences essentielles entre le domaine de lavérité théorétique et celui de ce qu’on pourrait nommer vérité axiolo-gique, validité axiologique. Elles s’expriment de différentes manières, etavant tout en ceci que, dans ce dernier domaine, il manque l’analogon duprincipe du tiers exclu, selon lequel il n’y a pas entre oui et non de troi-sième terme, ou, inversement, que dans le domaine de la vérité théoré-tique, il n’y a pas de neutralité, tandis qu’il y en a une dans le domaineaxiologique ; ou encore en ceci que tout état de choses représentable est,quant à l’être et au non-être, objectivement décidé, tandis que tout état dechoses évaluable n’est pas décidé quant à son être positivement valableou non valable. Le sauvage qui vénère superstitieusement un féticheévalue peut-être quelque chose qui non seulement n’a pas une valeur etn’est pas une valeur positive sous l’aspect et au sens dont il a conscience,mais qui est absolument « sans valeur ». Il peut bien y avoir des possibili-tés empiriques grâce auxquelles la chose sans valeur qui lui sert de féticheacquiert quelque valeur relative ; mais, d’une part, il est douteux que l’on
164 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[84]
16454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
puisse affirmer a priori de toute chose qu’il doit y avoir des relations danslesquelles elle acquerrait, d’une façon dérivée, par transfert, de la valeur ;et d’autre part, il n’est nullement exclu que la même chose, selon la réfé-rence, soit positivement dotée de valeur, négativement dotée de valeur outotalement dénuée de valeur.
Après ces précisions, il faut cependant insister sur le fait que nousdevons énoncer, en référence au cas des adiaphora1 propres au domaine del’évaluation, des axiomes propres. Il faut prendre garde au fait que l’adia-phorie est un cas que la raison évaluative doit établir en tant que tel.Qu’un état de choses donné possède des prédicats de valeur spécifiquesou qu’il soit exempt de valeur, il n’est possible de l’établir que grâce à desexamens axiologiques rationnels ; et d’un autre côté, dans toute critiqueaxiologique, il faut nécessairement prendre en compte le cas d’une pos-sible exemption de valeur. Une critique d’évaluations effectuées peut tou-jours et a priori fournir deux sortes de résultats : 1 / l’état de choses n’estabsolument pas un état de valeur ; 2 / il en est un, et alors seulement sepose la question de savoir si c’est le prédicat positif ou le prédicat négatifqui est juste. Il en va ainsi, manifestement, pour toute région axiologique,donc à l’intérieur de toute catégorie d’évaluation.
Nous formulons à présent, puisque le cas de l’exemption de valeur estdécidé par une raison évaluative, des axiomes y afférents. Certes, ils pré-supposent de difficiles formations de concepts, pour être tout à faitexacts et suffisamment universels, surtout le concept de matière. Dans ledomaine intellectif, nous distinguons, aussi bien noétiquement qu’onti-quement, matière et qualité ; dans le domaine spécifiquement logique
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 165
1. Du grec 3di0joron, « indifférent ». Appartenant à la terminologie des Stoïciens, levocable a été rendu en latin par indifferens, et est généralement traduit par chose indifférente s’ils’agit du substantif, indifférent s’il s’agit de l’adjectif. Cf. Sextus Empiricus, Contre les moralistes,III, 59-63 ; Cicéron, De finibus, III, XVI, 52-53 ; Diogène Laërce, VII, 101-102 ; Plutarque, Contreles Stoïciens. Selon Diogène Laërce, les Stoïciens divisent les choses existantes en biens (vertus,réflexion, justice, courage, etc.), maux (irréflexion, injustice, couardise, etc.) et choses indiffé-rentes, qui ne sont ni des biens ni des maux, mais dont on peut se servir en bien ou en mal (vie,santé, plaisir, force, richesse, etc., et leurs contraires, mort, maladie, douleur, faiblesse, etc.). Ladoctrine cicéronienne est plus complexe, et tend à identifier l’adiaphoron à ce qui possède undegré moyen de valeur. Husserl n’en retient que la notion d’indifférence, qui caractérise ce quiest axiologiquement neutre ou possède une valeur nulle. (N.d.T.)
16554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
– celui de l’expressivité possible, celui des jugements logiques, des énon-cés –, cela donne la différence entre proposition logique (i.e. le jugementlogique lui-même) et matière-de-proposition, contenu-de-proposition,i.e. l’identique abstrait dont on a conscience comme étant le contenu de laposition « S est p ! » et en tant que contenu de la négation, du refus, entant que contenu du non. Dans la sphère intellective, le contenu estnécessairement contenu d’une proposition-de-vérité positive ou négative,c’est-à-dire d’un jugement valide positif ou négatif, d’un oui ou d’un non,et même d’un oui ou d’un non valides.
Éventuellement, la même chose qui fonctionne là comme contenud’un oui ou d’un non valides, d’une vérité ou d’une fausseté, peut à pré-sent fonctionner aussi comme contenu d’un oui ou d’un non axiolo-giques, être le contenu d’une proposition axiologique, voire d’une validitéou « vérité » axiologiques. Nous aurions alors la loi suivante : toutematière axiologique est ou bien matière d’une vérité axiologique, d’uneproposition axiologique valide, ou bien matière d’une indifférence[Gleichgültigkeit] axiologique, ou (ce est équivalent) : un objet (ou état dechoses) représenté comme tel par le contenu correspondant, ou bien estvalable absolument au sens d’une catégorie de valeur sous-jacente, oubien est exempt de valeur, il est un adiaphoron ; par exemple : le contenuest envisageable comme contenu de souhait en général, ou il est, aucontraire, indifférent de ce point de vue ; il est susceptible d’une évalua-tion de beauté – ou non, il ne concerne pour ainsi dire en rien l’Idée debeauté ; et, en complément, la loi que nous avons déjà établie précédem-ment énonce à présent que si le contenu, au sens étroit, est évaluable, s’ilconcerne en quoi que ce soit l’évaluer dans cette catégorie, alors il est uncontenu d’un contenu-de-valeur positif ou négatif ; il n’y a pas de troi-sième terme. Dans cette mesure donc, nous aurions bien une espèced’analogon du principe du tiers exclu. C’est dire que nous avons besoin,dans le domaine axiologique, d’un concept propre de « valeur », qui estl’universel de la valeur positive et de la valeur négative, et d’un conceptpropre pour l’attitude [Verhalten] axiologique et la validité axiologique, quis’oppose à l’attitude de l’indifférence ou, si l’on veut, à la privation devalidité axiologique – alors même que l’indifférence au sens plus large estaussi quelque chose dont on décide objectivement dans un comporte-
166 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[85]
16654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ment évaluatif et une réflexion axiologique. Pour une axiomatique com-plète de la sphère de l’évaluation, il faudrait alors bien sûr énoncer aussil’axiome selon lequel, la même situation de motivation étant présupposée,l’être-doté de valeur [Werthaftigkeit] en général et l’être-indifférent[Gleichgültigkeit] s’excluent réciproquement : si A est une valeur, alors il nepeut pas n’être pas une valeur, ou (formulation équivalente) il n’est pas unadiaphoron (principe d’identité).
Par rapport à nos lois, on doit se garder de les tenir pour des trivialitésanalytico-logiques. Par exemple, on pourrait croire qu’il serait évidem-ment impossible, de par la logique analytique, que A soit bon sous certai-nes conditions, et que, sous les mêmes conditions, il ne soit pas bon. Àcela, deux objections peuvent être opposées. Premièrement : si nous par-lons dans nos axiomes de valeur positive et de valeur négative, de bon etde mauvais, cela ne revient en aucune façon à parler de bon et de pas-bon. Certes, dans le langage courant, on utilise aussi « non-bon » et « pas-bon » pour dire « mal » ou « mauvais ». Mais c’est là une distinction équi-voque. Analytico-logiquement, des prédicats comme « bon » et « non-bon » s’excluent au même titre que a et non-a en général, en tant que pré-dicats quelconques, c’est-à-dire comme [s’excluent] l’attribution du a[Zusprechen des a] (du « bon ») et la privation du « bon » [Absprechen des« gut »]. Mais analytico-logiquement, il n’est pas plus possible d’attribuerau « non-bon » le « mauvais », que d’attribuer au « non-blanc » le « noir »,plutôt que n’importe quelle autre qualité visuelle.
En second lieu, il faut noter que le transfert de propositions purementlogiques quelconques sur des prédicats de valeur, et d’abord sur le prédi-cat général « valable » [wert], présuppose des lois axiologiques : celles quiétablissent qu’on peut traiter la valeur comme un prédicat. Seuls des axio-mes appartenant à l’espèce établie précédemment font que quelque chosecomme « valable » puisse être objectivement défini comme un prédicat.Le fait de l’évaluer, du prendre-plaisir, du répugner, du souhaiter, etc. nesignifie au premier abord rien d’autre que ceci : nous prenons intérêt àdes objets de telle ou telle manière, nous sommes émus de telle ou tellefaçon à leur propos, et autres choses de ce genre. Or, nous objectivons lereprésenté dans la mesure où il nous apparaît pour ainsi dire coloré affec-tivement. Le plaisant apparaît dans une lumière rose, le déplaisant dans
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 167
[86]
16754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
une lumière terne et ainsi de suite. Mais que nous puissions conformé-ment à cela aller plus loin et assigner aux états de choses évalués un prédi-cat qui leur revient indépendamment de l’évaluer contingent, c’est làquelque chose de nouveau et c’est cela même que la raison évaluativeapporte avec ses légalités. Ainsi, c’est certainement un fait, par exemple,que des actes de l’affectivité peuvent se fonder sur des représentationsgénérales. Nous éprouvons du déplaisir non seulement au singulier, maisaussi dans une conscience de généralité : par exemple, la bassesse engénéral déplaît. Mais le déplaisir que nous éprouvons alors est bien unphénomène singulier, toute comme la conscience de généralité fonda-trice. Mais que la conscience affective, dans la mesure où la conscienced’universalité intellective la fonde, possède elle-même son universalitéaffective, et que cet acte de la conscience évaluant universellement (com-prise intellectivement, i.e. comme objectivante) possède le caractère del’être-donné, voire de l’être-donné évident d’une valeur universelle oud’une non-valeur universelle, c’est là quelque chose de totalement nou-veau. C’est ce qui est présupposé si nous voulons énoncer des lois devaleur universelles.
<b) La loi du quart exclu pour les valeurs fondamentales.L’objectivité des valeurs>
Dans la dernière leçon, nous avons parlé des analoga du principe decontradiction et du principe du tiers exclu dans la sphère axiologique. Ilsconsistent en ceci que, légalement, pour une même matière d’évaluationet par rapport à une seule et même catégorie axiologique, des qualitésd’évaluation positive et négative, sous les mêmes présuppositions devaleur, s’excluent l’une l’autre du point de vue de la validité, et en mêmetemps excluent toutes deux le cas de l’adiaphorie ; mais on ne peut pasdire, pour une même matière, que vaudrait une qualité positive ou unequalité négative – on ne le peut que si, en général, une qualité intervient.Nous avons ainsi trois types de possibilités a priori : qualité positive, ouqualité négative, ou encore exemption de valeur.
Au lieu de rapporter des positions d’évaluation à des présuppositionsde valeur, donc au lieu de nous mouvoir dans la sphère des dérivations de
168 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[87]
16854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:40
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
valeur et d’y comprendre éventuellement les valeurs non dérivées en tantque cas limites, envisageons plutôt ces cas limites pour eux-mêmes. Limi-tons-nous par conséquent à présent de manière à maintenir hors circuittoutes les dérivations de valeur. Nous pouvons alors dire : si M est valableen soi, alors il n’est pas en soi une non-valeur et il n’est pas en soi un adia-phoron, et inversement, selon toutes les combinaisons disjonctives. Nouscomprenons ici l’ « être-valable-en-soi », en fonction de ce qui a été dit, ausens où l’être-valeur n’est pas dérivé d’un autre être-valeur, de sortequ’aucune valeur n’est présupposée afin de poser les valeurs concernées.Cela n’exclut pas que l’être-valeur dépende de présuppositions ; seule-ment, ces présuppositions ne sont pas de nature axiologique, elles consis-tent simplement, par exemple, en un être ou un non-être.
Nous avons déjà dit précédemment que toute dérivation de valeurconduit à des valeurs de fond ultimes, qui ne sont pas par elles-mêmesdérivées. Mais il ne suffit pas de dire : s’il se trouve que l’évaluer d’unA est effectué de fait, il est rationnel, en conséquence, d’évaluer B, etB est donc ainsi valable relativement au fait que l’on présuppose précisé-ment A et qu’on le tient pour valide. Il faut plutôt revendiquer commeune évidence de pouvoir d’emblée exprimer cela objectivement ainsi : « SiA est une valeur, alors B est une valeur » ; et en outre, de pouvoir dire :« Toute présupposition de valeur doit être décidée objectivement quant àla validité et la non-validité. » Mais pour cela il faut, premièrement, que siM est la matière de la position de valeur A, on puisse dire a priori : si M estmatière d’une position de valeur positive, alors, si cette position estvalide, la position négative correspondante (ou la position adiaphoriquecorrespondante) est non valide, et inversement, selon toutes les combi-naisons disjonctives. C’est précisément cela que nous avons énoncé sousforme de loi, voire en tant que loi valide pour toute matière quelle qu’ellesoit.
Parallèlement à cela, nous posons l’axiome : si M est une matièrequelconque, alors l’un des trois cas suivants est vrai (et cela toujours àl’intérieur d’une région axiologique quelconque) : M est ou bien matièred’une valeur en soi positive, ou bien d’une valeur en soi négative, ou bienelle est en soi exempte de valeur. Donc, pour la sphère des valeurs-en-soiet des exemptions de valeur [Wertfreiheiten], nous avons là un analogon du
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 169
[88]
16954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
principe de contradiction et du tiers exclu, à ceci près que ce dernier esten l’occurrence une loi du quart exclu, qui s’applique par suite, commenous allons le voir dans un instant, aux valeurs dérivées, qui deviennentainsi des valeurs objectives.
Avec ces propositions se trouve exprimée la rigueur et l’objectivitépropre de la validité pour la sphère axiologique. Il est énoncé que si M estune matière quelconque, elle ne peut pas simplement être en général lecontenu d’un comportement évaluatif, d’un comportement d’évaluationpositive ou négative ou indifférente, mais qu’à l’être-tenu-pour-valablecorrespond un être-valeur objectif, un être-valeur positif ou négatifobjectifs au sens strict ou bien un être-sans-valeur objectif. Car c’est enréférence à cela que toute valeur dérivée et (comme nous pouvons ajou-ter) toute exemption de valeur dérivée acquièrent leur objectivité et unevalidité qui n’est pas simplement hypothétique. Toute valeur fondamen-tale en soi a, par conséquent, une co-référence à des relations de dériva-tion, comme par exemple celle entre tout et partie, ses conséquences devaleur, et elles valent effectivement en tant que conséquences (objective-ment en soi, indépendamment de la subjectivité) lorsque la valeur fonda-mentale est effectivement valide, donc lorsqu’elle est effectivementvalable en soi.
Mais ce que nous avons dit au sujet des possibilités de conflits devaleurs n’en demeure pas moins [vrai], dans la mesure où il n’est pas excluque quelque chose soit en même temps valable en soi et non valable defaçon relative, eu égard à une dérivation de valeur en relation à d’autresvaleurs positives ou négatives. Ce qui persiste, cependant, si les axiomessont justes, c’est que la « valeur » ne se dissout pas dans la subjectivité etpar suite dans la relativité de l’évaluer, comme si ce qui est valable pourl’un était pour un autre non valable, et pour un troisième, indifférent. Pasplus qu’il n’y a un vrai et un faux pour quelqu’un, mais bel et bien un être-tenu-pour vrai et pour faux par quelqu’un, il n’y a pas davantage, et en unmême sens, un beau et un laid, un bon et un mauvais, un digne-de-sou-hait et un digne-d’être-redouté pour quelqu’un. Bien entendu, il faudratoujours demander quelle est la matière intégrale [vollständige] et quelle estla catégorie d’évaluation ; et on devra en outre demander si la matière estévaluée en soi ou considérée dans telle dérivation de valeur et sous telles
170 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[89]
17054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
présuppositions en général. Ce qui est, dans certaines circonstances, unevaleur-de-souhait (souhaitable, comme nous disons), peut, sous d’autresprésuppositions, être indifférent ou digne-d’être-redouté. Mais, une foisposées les présuppositions, tout est objectivement déterminé.
On doit ici prendre garde aussi au sens du « valable pour l’un, non-valable pour l’autre », « bon pour l’un, mauvais pour l’autre ». Il s’agit icide la relation de la valeur présumée à l’acte de présumer et à la personnequi présume. Mais tout autre chose est la relation entre personne etvaleur-de-la-personne, ou entre les personnes et les utilités qui se rappor-tent à elles, et autres choses du même genre. Naturellement, l’évaluerpeut se référer à la personne, à ses actes, à ce qui est, pour elle et sous lesprésuppositions qui existent spécialement pour elle, bon ou mauvais.Mais, en ce cas, se trouve précisément déterminé en soi ce qui est bon etutile pour cette personne, dans sa situation, et ce qui ne l’est pas. Ici, lapersonne appartient à l’état de choses évaluable ; c’est à elle que se réfèrela matière d’évaluation. On ne prétendra tout de même pas, en effet, déri-ver à partir de là la relativité, entendue comme subjectivité de la vérité,c’est-à-dire que ce qui pour une personne est vrai est faux pour l’autre,puisqu’en effet l’une peut être aveugle et l’autre non. Tout comme la per-sonne est ici l’ « objet à quoi » se réfère la matière de jugement ou lamatière de vérité, il peut en aller de même pour la personne par rapport àla matière axiologique.
Naturellement, le point de vue de l’objectivisme, qui englobe égale-ment celui de l’idéalisme, doit ici, comme dans la sphère intellective, êtreimposé contre les attaques du scepticisme relativiste, tantôt psycholo-giste, tantôt anthropologiste et biologiste. Cela représente un chapitre àpart. Nous ne voulons pas nous y engager ici et traiter le combat commes’il s’agissait d’une affaire réglée1.
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 171
1. Nous n’avons ici malheureusement pas de mots qui correspondent exactement auxmots de vérité et de fausseté. Le mot « valable » [wert] est plurivoque : sa signification se déplaceselon que, par lui, nous nommons valables des objets ou que nous désignons ainsi des matières.Dans le domaine intellectif, nous rapportons vérité à la matière, et nous disons des objets qu’ilsexistent, et des états de choses, qu’ils subsistent. Dans le domaine axiologique, nous nous heur-tons à la complication qui veut que l’on distingue, d’un côté, les objets qui ont valeur et qui,éventuellement, sont posés comme étant ou n’étant pas, et d’un autre côté, les valeurs elles-mêmes. En outre, nous avons ici les matières en tant que contenus axiologiques ainsi que leur
[90]
17154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 12. Les lois de la comparaison de valeurs.>
<a) Lois concernant les relations de gradation de valeurs[Wertsteigerungsverhältnisse] et les collections de valeurs>
Nous passons à présent à une autre série de lois formelles, qui n’ontaucun analogon dans la sphère logico-apophantique plus restreinte (maisplutôt dans la sphère de la logique formelle des probabilités). Je veux par-ler des lois qui se réfèrent à des relations ordinales des valeurs. Nous pouvons icinous reporter à l’écrit génial de Brentano, De l’origine de la connaissancemorale (1889), qui, le premier, a formulé de telles lois, comme d’ailleurs cetécrit a donné en général l’impulsion à toutes mes tentatives d’axiologieformelle. Brentano se tient, certes, sur le terrain de la psychologie et, pasplus qu’il n’a reconnu [erkannt] la possibilité et la nécessité d’une logiqueformelle de la signification dans la sphère logique, il n’a reconnu, en l’oc-currence, celles d’une éthique et d’une axiologie idéales et formelles. Maiscela n’empêche pas que l’on trouve chez Brentano les germes féconds quiont vocation à être développés ultérieurement.
Entre des valeurs peuvent exister des relations de gradation, et celles-ci comportent, comme toutes les relations de ce genre, trois possibilitésexclusives, les types de relation « égal », « supérieur », « inférieur ». Mais ilfaut dire d’emblée que nous ne pouvons pas prétendre que des valeurs ausens le plus large soient comparables sous tous les rapports, mais nousnous limitons plutôt aux valeurs d’une région de valeur (ou si vous voulez,d’une catégorie de valeur). Il me semble qu’il n’y a aucun sens viable à
172 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
qualité axiologique. Toutes deux conjointes donnent la proposition axiologique, qui peut être àson tour une proposition valide ou non valide (une vérité ou une fausseté axiologique). Toutcomme nous distinguons, dans le domaine intellectif, proposition et état de choses (ou objet),de même nous devons distinguer, dans les domaines parallèles, proposition axiologique et étataxiologique ou, si l’on préfère, valeur. Il faut renvoyer à ces différences afin que ne subsiste pasle soupçon que, si nous préférons, assez souvent, à cause de la commodité et de la tournurenaturelle, [employer] les expressions équivoques de « valeur positive et négative », nous pour-rions avoir été victime de confusions. Nous veillerons bien à éviter totalement de tellesconfusions. (N.d.A.)
[90]
17254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
comparer une valeur de souhait à une valeur de plaisir et une valeur exis-tentielle à une valeur non existentielle (une valeur de bien avec une valeurde beauté) et à dire que l’une serait davantage digne de souhait que l’autren’est digne d’être goûtée, et autres choses semblables. Si nous nous entenons aux limites d’une catégorie, il existe alors des relations de compa-raison universelles et, en tout cas, pour autant qu’elles existent, valentdes axiomes qui appartiennent absolument à l’essence de toutes lesformes de comparaison. Donc, par exemple (a = b) ⇒ (b = a) ; de mêmepour < et >. [Si] a ! b, b ! c, ⇒ a ! c. L’égal substitué à l’égal donne l’é-gal, mais uniquement dans des relations de sommation (de touts [obte-nus] par sommation). C’est pourquoi l’ « égal » ne peut pas être effective-ment considéré en général comme une égalité, mais bien comme ni plusgrand ni plus petit.
Ces lois doivent donc également être énoncées au sujet des relationsde comparaison de valeurs. S’y ajoutent les lois propres au domaine de lavaleur. Chez Brentano, nous trouvons énoncée d’abord la proposition :« Un bien reconnu comme bien doit être préféré à un mal reconnucomme mal »1. Je distinguerais ici, comme partout ailleurs, lois noétiqueset lois ontiques. Noétiquement, on peut dire de façon plus générale quene l’a fait Brentano : « Il est rationnel de préférer un tenu-pour-bon à untenu-pour-mauvais ». Mais cela appelle des restrictions. Si le tenu-pour-bon (ou pour mauvais) se révèle n’être pas bon (ou pas mauvais), alors lapréférence n’est pas objectivement juste. Comment résoudre l’antinomie,qui existe manifestement pour toute espèce de valeurs ? Dès que j’ai tenuquelque chose pour bon ou pour mauvais, c’est une exigence de la consé-quence rationnelle que de préférer ce qui est tenu pour bon à ce qui esttenu pour mauvais. Une raison [Vernunft] de la préférence est motivée parles actes de tenir pour bon et de tenir pour mauvais en tant que tels. Cetteraison subsiste, même si les actes de tenir pour bon [Guthaltungen] et lesactes de tenir pour mauvais [Schlechthaltungen] sont irrationnels. Le fait que
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 173
1. Cf. F. Brentano, Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, 2e éd., suivi de compléments à lathéorie de la connaissance éthique et à la sagesse, éd. et introduit par O. Kraus, Leipzig, 1921,p. 24. (N.d.E.). Trad. fr. L’origine de la connaissance morale, par M. de Launay et J.-C. Gens, Paris,Gallimard, 2003, p. 70. (N.d.T.)
[91]
17354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
la valeur de la préférence soit conditionnée par les valeurs de ces actes detenir-pour-bon, etc. n’y contredit pas.
Nous pouvons le dire également ainsi : le fait de préférer ce qui esttenu pour meilleur est, considéré en soi, une valeur, mais cette valeur serasupprimée si les positions de valeur des actes motivants sont fausses. Cen’est que lorsque nous faisons abstraction de la question de la valeur ducôté des motivats que nous attribuons une valeur à la préférence pure etsimple ; par exemple, dans la sphère pratique : achat d’une contrefaçond’une Madone de Raphaël vs. achat d’un tableau authentique d’un peintrede troisième ordre. Nous disons que cet homme a choisi et acheté irra-tionnellement. C’est donc comme lorsque nous disons dans l’inférencelogique : puisque celui qui juge a cru à la vérité des prémisses, il était tota-lement rationnel de sa part d’avoir cru la conclusion qui en était correcte-ment dérivée. L’ « inférer était rationnel », le juger de la propositionconclusive était motivé rationnellement, mais cette raison subit une déva-lorisation du fait de l’irrationalité [Unvernunft] dans les attendus desprémisses. De même, dans la sphère axiologique, la raison dans la consé-quence est certes une raison, la valeur est certes une valeur, mais chacuneest telle qu’elle peut subir un renforcement ou un affaiblissement, etmême, dans ce dernier cas, une annihilation par la mise en évidence de lanon-valeur des valeurs présupposées, ou encore par l’inversion desvaleurs qui avaient été posées dans les prémisses. Nous aurions quelquechose comme la loi suivante : la rationalité d’une conséquence subit uneaugmentation de valeur [Wertsteigerung] lorsque se découvre dans uneintuition évidente la rationalité des prémisses. Elle subit non seulementune diminution [Minderung], mais une dévaluation [Entwertung] complètelorsque l’intuition évidente constate qu’il faut inverser les prédicats devaleur des prémisses.
Passant aux cas plus particuliers de la préférence pratique, il nous fau-drait donc dire : il est rationnel, au sens de la conséquence, de préférer cequi est tenu pratiquement pour bon à ce qui est tenu pratiquement pourmauvais. Il est non seulement conséquent, mais inconditionnellementrationnel, de préférer, dans le vouloir et dans l’agir, ce qui est tenu pourbon selon la raison, à ce qui tenu pour mauvais selon la raison. À quoicorrespond corrélativement la loi ontique d’après laquelle tout bien pra-
174 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[92]
17454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tique, considéré en soi et pour soi, est pratiquement meilleur que tout malpratique considéré en soi. Il est clair cependant que nous pouvons resteraussi dans la sphère plus générale et énoncer la loi pour des valeurs engénéral, dans des relations de comparaison de valeur ou de préférence [derWertvergleichung bzw. Bevorzugung] : tout ce qui a valeur en soi à l’intérieur desa catégorie est plus valable que tout ce qui est en soi non-valeur [Unwert](toute belle chose en soi a plus de valeur que toute chose non belle, etc.).Par suite, dans le cadre d’une dérivation de valeur déterminée, référée àune valeur fondamentale qu’il faut maintenir dans son identité, nouspourrons également dire : le beau dérivé est meilleur que le laiddérivé, etc. Partout, le beau en tant que tel (en maintenant ses présupposi-tions) a plus de valeur que le laid.
Une autre loi énoncée par Brentano pose que l’existence d’un bien estmeilleure que l’existence d’un mal, et inversement pour la non-existence.En généralisant quelque peu, j’énoncerais la loi suivante : si une valeur debeauté est plus valable qu’une autre valeur de ce type (peu importe quelsen sont les signes), l’existence de la première valeur est plus valable quecelle de l’autre : B1 > B2 ⇒ (E(B1) > E(B2)), et inversement, la non-exis-tence de B2 > N(B1)1.
Brentano pose en outre la loi : un bien tout seul est meilleur que lemême bien mélangé à un mal B > B + M2. Je préfère être plus précis etexclure dans un premier temps le mélange proprement dit, c’est-à-dire lacomposition. Je pose [la loi] : l’existence d’un bien seul est meilleure quel’existence conjointe de ce bien et simultanément d’un mal. De même :l’existence de deux biens est meilleure que l’existence d’un seul d’entreeux. En outre : l’existence conjointe d’un bien et d’un mal est meilleureque celle du mal tout seul. Donc : E(B) > E(B + M) ; E(B + M) > E(M) ;E(B + B1) > E(B) ; E(B + B1) > E(B1). De là découle par déduction la
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 175
1. Husserl emploie les symboles suivants : S pour Schönheitswert ; E pour Existenz ; N pourNicht-Existenz. Nous employons donc les symboles B (beauté) et E (existence), N (non-exis-tence). De même nous substituons ci-dessous les symboles B (bon, bonté) et M (mauvais, mal)à G (Gut, Güter) et U (Übel). (N.d.T.)
2. Cf. ibid. (N.d.E.) Trad. fr., p. 70 : « Nous préférons rien que pour lui-même un bien à cemême bien mêlé de mal, ou, au contraire, un mal mêlé de bien à ce même mal purement ensoi. » (N.d.T.)
[93]
17554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
conséquence pour un nombre quelconque de membres ; leur sommepour ainsi dire est meilleure que celle d’une partie de la somme, la valeurde la somme diminuerait si un mal entrait dans la somme, etc.
Nous pouvons en outre poser la loi : soit a un adiaphoron, [on a] alorsB = B + a. De là découle que E(B) = E(B + a). Par suite, il en découlequ’une somme quelconque conserve la même valeur lorsque quelquemembre se trouve « augmenté » d’adiaphora ; l’adiaphoron joue donc le rôledu zéro.
Si des biens de valeur parfaitement égale entrent dans une somme, lessommes formées se comportent comme des grandeurs. On peut alorsénoncer [la loi] : la somme d’existence de deux de ces biens vaut deux foisplus que l’existence d’un seul d’entre eux ; l’existence collective de quatrebiens de valeur égale est deux fois meilleure que celle de deux d’entreeux, etc.
Enfin, il faut encore remarquer que, dans des sommes d’existence,des valeurs « égales » pourraient être substituées l’une à l’autre, et que, parconséquent, dans de telles sommes, des biens appartenant à un groupe,auxquels s’appliquent des relations possibles de comparaison, fonction-nent de telle sorte que le cas où deux biens ne sont ni plus grands ni pluspetits l’un relativement à l’autre, doit être traité comme une égalité. Carnous ne pouvons pas affirmer sans plus que [la caractéristique] « de rangégal » comporte toutes les propriétés de l’égalité, donc la substituabilité àtout point de vue.
Nous avons formulé les lois de sommation comme des lois de la som-mation de biens et de maux coexistants ; nous pensions à l’existerensemble, à l’exister en même temps. « Coexistence » doit plutôt êtrecompris de façon simplement collective et peut en outre se référer àl’être-ensemble au même moment [Zeitpunkt] ou à des moments diffé-rents. Mais il existe encore une autre forme de connexion entre existenceet existence qui fonde des lois axiologiques analytiques. En effet, à unbien ou à un mal peuvent se rattacher des conséquences bonnes ou mau-vaises, et l’on peut désigner analogiquement cette connexion comme uneconnexion sommative, car d’après la forme valent derechef les lois desommation qui, en l’occurrence, doivent, bien entendu, être énoncéescomme de nouvelles lois. À savoir : si B est une valeur existentielle et si
176 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[94]
17654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
CB en est une conséquence existentielle bonne, cette conséquence aug-mente alors la valeur de B. Et B est meilleur avec une telle conséquenceque sans une telle conséquence. Et chaque nouvelle conséquence de cetype crée une nouvelle et plus haute valeur pour B.
De même, une conséquence néfaste diminue la valeur de B, et chaqueconséquence néfaste supplémentaire la diminue d’autant. Dans les deuxcas, on considérera de la même façon des conséquences de valeur immé-diates et médiates. Dans ces conjonctions, des conséquences bonnes oumauvaises, qui peuvent se produire à propos du même bien, se compor-tent comme dans les sommes de valeur, donc d’une façon semblable àcelle de grandeurs positives et négatives. Nous pouvons naturellement,en lieu et place d’une valeur existentielle positive B, prendre aussi commepoint de départ une non-valeur existentielle ; elle sera diminuée par uneconséquence bonne et augmentée en un sens négatif par une consé-quence mauvaise.
De cette façon, il existe donc, dans le domaine des valeurs, des relati-vités réglées par des lois. Si une réalité [Sachlichkeit] est valable, alors l’êtrevaleur peut être déterminé de multiples façons eu égard à ses propresmoments fondateurs de valeur et à son enchaînement avec d’autres cho-ses, avec des conséquences de valeur. Et, dans la mesure où des chosesont des relations de ce type, qui deviennent déterminantes quant à lavaleur, nous avons ici déjà des cas de composition de valeur, de toutsaxiologiques. Considérons à présent les touts axiologiques de toutes sor-tes et examinons les relations qui les règlent.
<b) Les différentes relations entre tout-de-valeuret composantes-de-valeur : sommation de valeur
et production de valeur. La signification de l’étalement temporelet de l’intensité pour la détermination de la valeur>
Les relations de touts et parties donnent lieu, du point de vue axiolo-gique, aux distinctions suivantes. Si le tout est une valeur, on peut alorsparler de valeur en différents sens à propos des parties, et, de ce point devue, nos développements précédents appellent des compléments essen-
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 177
[95]
17754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tiels. Si une partie a en soi et par soi de la valeur, si en tout cas elle a unevaleur qui n’est pas exactement conditionnée par l’être-partie dans ce toutmais est cependant efficace dans cet être-partie, alors elle importe a prioripour la valeur du tout. Toute modification qui l’altère intrinsèquementdans son caractère de valeur, influence également la valeur du tout ; nousincluons ici sous le titre de « modification » la fragmentation [Abstückung]et la suppression éventuellement possibles. Nous appellerons de tellesparties des composantes axiologiques du tout de valeur. Si, inversement,nous partons du tout, nous pouvons dire aussi que sa valeur peutdépendre de la valeur propre de n’importe laquelle de ses parties. Cesvaleurs propres, dans la mesure où elles déterminent la valeur du tout,forment ses composantes axiologiques ou composantes de valeur.
Par ailleurs, le tout peut lui aussi avoir, et en général aura des partiesqui n’ont pas en elles-mêmes de valeur, mais sont des pré-conditionspour sa constitution ou pour la constitution de parties ayant, quant à elles,de la valeur en elles-mêmes. Pour autant que ce sont des pré-requis de lavaleur, elles ont aussi une valeur, à savoir une valeur de conséquence,mais elles ne sont pas des composantes de valeur. Nous disons parexemple qu’elles ont « simplement une valeur de condition préalable ».Des composantes de valeur, telles que nous les avons définies, pourraientelles-mêmes être à leur tour des touts dont la valeur dépend de compo-santes de valeur, et ces touts pourraient par ailleurs comporter d’autrescomposantes qui n’ont pas vraiment de valeur en soi. Dans la sphère desvaleurs en soi, nous aboutissons manifestement ainsi à de pures composantesde valeur, à des propriétés authentiques et purement fondatrices de valeur.
Si nous considérons les relations entre des touts de valeur et leurscomposantes de valeur, il faut distinguer alors deux cas de figure. Il peutse faire que le tout n’ait de la valeur que par la prise en compte axiolo-gique du fait qu’il possède précisément ces parties qui composent lavaleur, et de telle sorte que la simple possession en général de ces partiesdétermine la valeur du tout, exclusivement sur le mode du transfert devaleur. Donc, la liaison des parties fondatrices de valeur ne doit avoiraucune autre signification axiologique que celle d’être précisément liées ;de la liaison en tant que liaison précisément d’une telle espèce, ne doitrésulter aucun produit axiologique de nature spécifique.
178 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[96]
17854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Deuxième cas de figure : celui où ce qui vient d’être exclu a précisé-ment lieu. Par la liaison spécifique des parties en un tout de cette espèceet par la manière dont les valeurs propres des parties concourent axiologi-quement à une synergie, doit naître une unité de valeur qui est plus quel’unité collective des composantes de valeur ; une unité qui, contraire-ment au cas précédent, n’a pas simplement en soi des valeurs partielles etne se borne pas à les relier, mais qui, sur la base de l’influence réciproquede ces valeurs, en crée une nouvelle, qui certes dépend d’elles ; elle ne lescompose donc pas au sens propre, mais les compose un peu à la manièredont nous parlons de composition en musique. En effet, toute harmoniede sons et, de même, une harmonie de couleurs, constitue un exempleadéquat. Les valeurs sensibles et sentimentales des éléments singulierscontribuent, en un certain sens, à la valeur totale, mais elles ne la compo-sent pas [zusammensetzen], elles la fondent [fundieren] seulement commequelque chose de nouveau face à elles. Si nous nous figurons les élémentspermutés de façon quelconque, chacun continue de posséder soncontenu et, considéré en lui-même, [il continue de posséder] son carac-tère de valeur. On peut dire que chaque tout ainsi formé a, en référence àla possession de ces éléments de valeur, une valeur relative, dérivée. Mais,de façon distincte, toute combinaison fonde [begründet] un tout axiolo-gique avec un caractère d’unité axiologique, qui est fondé [fundiert] dansles éléments, mais ne se construit en aucune façon à partir d’eux parsimple sommation [summatorisch]. Une certaine combinaison produit labeauté de l’harmonie, qui se transforme, par altération de la combinaison,en dysharmonie ou en un amalgame confus. À ce sujet, quelque chose debeau en soi et quelque chose de laid en soi, quelque chose de bon en soiet quelque chose de mauvais en soi, peuvent fonder [begründen] une unitéaxiologique positivement valable, qui n’est en rien entamée par la pré-sence en son sein [Mitgegebensein] du mauvais, mais au contraire s’entrouve augmentée. L’omission [Weglassen] d’un élément en soi déplaisantou d’une conjonction d’éléments déplaisants peut diminuer la valeurpositive de l’harmonie au lieu de l’augmenter et, de même, l’omissiond’un élément beau en soi ou une substitution d’un moindre beau en soipeut augmenter la valeur du tout au lieu de la diminuer, etc. Il est doncpossible que B + B′ < B, B + M > B au lieu d’être < B, etc.
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 179
17954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Il y a donc bien des distinctions essentielles dans les touts axiologi-ques, selon qu’ils ont ou non le caractère de touts de valeur par somma-tion ou, ce qui revient au même, selon qu’ils sont des touts formés decomposantes de valeur qui sont des valeurs dans le tout autant que pourelles-mêmes isolément, qui ne s’influencent donc pas dans l’unité du toutet ne fondent [fundieren] pas de nouvelle valeur d’unité, ou bien selon quece n’est précisément pas le cas. Dans ce dernier1 cas, le tout de valeur est,d’après sa valeur, une simple valeur dérivée des composantes fondatricesde valeur [wertbegründenden] et, pour cette espèce de touts, valent manifes-tement les lois de sommation, c’est-à-dire formellement les mêmes loisque celles que nous avons précédemment énoncées pour des collectionsde valeurs, pour des valeurs d’existence collective de valeurs. La coexis-tence d’une pluralité de valeurs et l’existence d’un tout de plusieursvaleurs n’ayant pas d’influence mutuelle sont équivalentes. Donc, parexemple, pour une liaison de valeurs par sommation vaut la loi qui posequ’une somme de biens est meilleure qu’un seul bien de cette somme etque toute diminution de cette somme ; ou encore : le bien partiel quientre dans la somme de biens est moins valable que le tout par somma-tion de simples biens. De même, l’immixtion par sommation [summato-rische] d’un mal diminue toujours la valeur, etc. Dans tout jugement devaleur sur des touts, il faut naturellement prendre garde (cela s’appliqueaussi à la question des valeurs dérivées) à ces différences fondamentalesentre sommation de valeur et production de valeur. Et grâce à notre distinction,les lois brentaniennes se trouvent aussi améliorées substantiellement ;elles ne peuvent et ne doivent être maintenues que dans la restriction auxvaleurs [obtenues] par sommation.
Cette restriction faite, il faut ensuite ajouter également que l’étalementtemporel d’un bien ou d’un mal, eu égard à la possibilité de la division dutemps, doit être traitée comme une somme de valeurs partielles corres-pondant aux parties de temps. Brentano, lui aussi, a déjà mentionné l’éta-lement temporel dans le contexte des lois de sommation2. Si nous dési-
180 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Le sens du raisonnement qui précède et qui suit suggère : « dans le premier cas » (celuide la simple addition de valeurs). (N.d.T.)
2. Cf. ibid. (N.d.E.) Trad. fr., p. 70. (N.d.T.)
[97]
18054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:41
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
gnons symboliquement deux durées de temps par t1 et t2 et que t1 > t2, lebien Bt1 étalé sur la durée t1 est plus grand que le bien Bt2 rapporté à ladurée t2. Nous pouvons également dire par suite : Bnt = n Bt, c’est-à-direque – considéré en soi, rien d’autre n’intervenant dans une comparaisonde valeur – un bien étendu sur n temps est n fois plus valable dans l’exis-tence que celui qui est étendu sur [l’unité de] temps simple ; et nous affir-mons qu’il est égal en valeur à n biens semblables coexistant dans uneunité par sommation, qui seraient tous étalés dans la durée simple.
Imaginons le cas suivant : il existe dans le monde une personne noble,dont la valeur se maintiendrait continuellement inchangée dans le temps.En général, elle sera un foyer d’où émanent des effets remarquables pourle monde environnant, et les courants de valeur procédant d’elle seront engénéral très inégaux dans des temps égaux. Eu égard à cela, on ne pourrapas dire en général que la valeur de la personnalité, en tant que valeur debien dans le monde, s’accroîtra simplement en fonction du temps. Mais sinous imaginons un intervalle de temps [Zeitstrecke] dans lequel de telles iné-galités n’ont pas lieu, si nous envisageons pour elle-même la pure valeurexistentielle de la personnalité, en présupposant qu’elle reste égale dansdes temps égaux, nous pouvons alors affirmer, et de façon pleinement évi-dente, que l’étalement temporel agit comme une sommation, que le dou-blement de la longueur d’être donne un doublement de la valeur ; mais dela même façon aussi, en supposant des fictions d’égalité correspondantes,que le temps double d’une personnalité est équivalent [gleichwertig] à l’exis-tence de deux personnalités de même valeur rapportées à l’unité simple dedurée de temps, etc., abstraction faite des autres déterminations de valeur.
Naturellement, le cas limite idéal, d’après lequel deux nobles person-nalités, œuvrant séparément à des choses nobles, œuvrent à égalité dupoint de vue de la valeur, ne sera généralement pas réalisé ; en général, cesera bien plus important pour le monde si plusieurs personnalitésœuvrent côte à côte, que si une seule œuvre sur une durée allongée enconséquence. D’ailleurs, les temps n’entrent pas du tout en ligne decompte, pour la sommation, en tant que simples grandeurs mathéma-tiques. En vivant moins d’une certaine durée de temps, une personnaliténe peut rien produire d’important, et la possibilité d’une efficacité pleineet riche ne va guère au-delà d’un certain temps ; et l’on peut ainsi alléguer
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 181
[98]
18154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
différentes choses. Mais si nous prenons les pures valeurs existentiellesen soi, en faisant abstraction des conséquences ; ou encore si nous y ajou-tons les conséquences, mais idéalement de façon égale, ainsi que la divi-sion du temps (pour autant qu’elle est permise par l’essence du bien quidure), on doit alors dire en effet que l’étalement dans la durée fonde lecaractère d’une grandeur de valeur par sommation, que les lois de la som-mation valent donc [ici].
Brentano accorde à l’intensité1 une importance analogue à celle de l’éta-lement temporel. Nous devons sans doute délimiter celle-ci plus stricte-ment qu’il ne l’a fait. Nous présupposons une propriété fondatrice, ausens propre et pur, de valeur et nous supposons en outre qu’y résidequelque chose comme de l’intensité, qu’elle soit, pour exprimer la chosele plus universellement possible, capable d’accroissement [steigerungsfähig].Attendu que nous nous sommes limités à ce qui est purement fondateurde la valeur, cela revient à dire que la capacité à subir des augmentationsne se réfère pas à des moments simplement entrelacés à ceux qui yfondent proprement la valeur. Dans ces conditions, nous pouvons direqu’avec l’augmentation de ce qui est fondateur de valeur, la valeur aug-mente elle-même, d’abord la valeur qui appartient de façon primaire à lapropriété elle-même, et par suite la valeur du tout qui comporte lemoment fondateur de valeur – et cela exclusivement en tant qu’il la pos-sède et que ne s’y ajoutent pas d’autres complications déterminant etmodifiant la valeur. Les intensités ne sont pas comme des grandeurs detemps. Néanmoins, il y a bien des différentiels d’intensité et ceux-ci joue-ront un rôle analogue aux intervalles de temps.
Brentano a souligné ce qu’il n’est plus guère nécessaire de soulignerdans l’attitude d’ensemble qui est la nôtre, à savoir qu’il ne faut pasconfondre l’intensité de la valeur (c’est-à-dire la différence du plus ou dumoins valable qui lui appartient en propre) et la propriété d’intensité del’évaluer ; comme si, lorsqu’une relation d’augmentation entre des valeursest constatée, cela revenait à dire qu’il y aurait alors un prendre-plaisir, unsouhaiter, bref un évaluer en général plus ou moins vifs2. Par exemple,
182 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Cf. op. cit., p. 25. (N.d.E.) Trad. fr., p. 71. (N.d.T.)2. Cf. op. cit., p. 22. (N.d.E.) Trad. fr., p. 68. (N.d.T.)
[99]
18254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
que « quelque chose est plus digne de souhait qu’autre chose » ne signifiepas que le souhaiter soit ou doive être plus vif. Naturellement, il y a aussides normes de la vivacité d’évaluations, comme, par exemple, celle qu’ilest non juste [unrichtig] de se réjouir moins vivement d’une valeur plushaute que d’une valeur plus basse.
Par ailleurs, je suis tenté de penser qu’avec la prise en compte dutemps et de l’intensité, on déborde de la sphère de lois proprement analy-tique. Dans cette sphère, il est question de valeurs en général, et que dutemporel ou de l’intensif existe et soit évaluable, cela ne concerne précisé-ment pas la sphère de la valeur ou alors la restreint.
Une loi capitale est, en outre, la suivante : si D1 est une valeur dérivéepar rapport à V1 et si D2 est une valeur dérivée par rapport à V2, alors, siV1 > V2, « eu égard à cela », D1 > D2 également. Cette loi inclut, commeon le voit immédiatement, la loi de la sphère de la volonté : si M1 est unevaleur en tant que moyen par rapport à V1 et si M2 est une valeur en tantque moyen pour V2, alors, si le but de la volonté V1 > V2, en référence àcela le moyen M1 > M2 également.
On pourrait élever contre cette loi une objection qu’un monsieurm’avait effectivement faite, il y a quelques années, à savoir que si la loiétait valide, il faudrait que toutes les dérivations de la même valeur soientéquivalentes, ce qui n’est manifestement pas le cas. Mais cette consé-quence, après plus ample réflexion, ne s’impose pas. Par exemple, diffé-rents moyens d’un même but ne sont effectivement pas égaux ; mais onn’en peut pas moins rétorquer que, quel que puisse être le niveau hiérar-chique [Rangstufe] des valeurs des moyens d’une seule et même fin, il resteque si l’on considère celles-ci précisément comme des valeurs dérivées deleur but, elles peuvent toutes être équivalentes en cela qu’elles sont toutesde moindre valeur par rapport à tous les moyens d’une fin ultime de plusgrande valeur. Qu’elles soient carrément à rejeter d’un point de vue pra-tique, cela résulte encore d’une autre loi qui nous occupera tantôt.
Avant d’aller plus loin, je dois à présent signaler aussi que les lois quenous avons énoncées étaient des lois ontiques. Elles se rapportaient, entant que lois formelles, à du « plus valable » et du « moins valable ». Or, lacomparaison de valeur s’effectue sur la base d’actes originaux de préfé-rence et de négligence, qui sont eux-mêmes des actes affectifs. Il faut
SECTION II. AXIOLOGIE FORMELLE 183
[100]
18354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
prendre garde au fait que tous les énoncés logiques, tous les jugements àleur propos, ont besoin pour leur attestation de l’effectuation de ces actesaffectifs et ne doivent pas être confondus avec ceux-ci. Nous incluonsdonc la comparaison de valeur, en tant que titre commun pour la préfé-rence et la négligence, dans la sphère de l’affectivité. Au lieu de comparai-son, nous disons aussi examen de valeur [Wertabwägung]. Si nous considé-rons à présent ces actes d’examen de valeurs eux-mêmes et les évaluons,ils sont soumis tout comme de simples actes à la juridiction de la raison.Nous avons donc ici, parallèlement aux lois ontiques, des lois noétiques,c’est-à-dire des lois de la préférence et de la négligence rationnelles. Ainsi,c’est une loi de la conséquence au sens propre que si, lors d’un examenaxiologique, on a préféré V1 à V2, on doit, rationnellement, placer plushaut toute valeur dérivée de V1 que toute valeur dérivée de V2, etc. Il fauten outre noter que préférer et négliger se comportent l’un vis-à-vis del’autre comme des actes affectifs respectivement positif et négatif ; que,pour cette positivité et négativité, vaut comme pour toutes les autres la loi[qui pose] que si le préférer est rationnel, le négliger de la même matièreest irrationnel, et réciproquement ; ou corrélativement, que si la préfé-rence existe, la négligence – la post-position [Hintansatz] – (je ne trouvepas, en effet, de mot adéquat) n’a pas lieu, et réciproquement. Tout celarelève d’une noétique détaillée des actes affectifs dont, comme pour lanoétique des actes logiques, on ne s’acquitte nullement avec les lois noé-matiques et ontiques correspondantes, par exemple par une simpleconversion de celles-ci.
184 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[101]
18454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<SECTION IIIÀ PROPOS
DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ>
<§ 13. La sphère de la volonté au sens restreint et au sens large>
Considérons à présent plus spécialement le domaine de la volonté.Nous avons fait la connaissance de nombreuses lois dont nous avons ditqu’elles prétendent à une signification axiologique en un sens élargi, ausens le plus universel. Mais les différentes sphères d’actes et, respective-ment, les différentes sphères de valeurs qu’embrasse le titre d’ « affecti-vité » [Gemüt] ne se tiennent pas sous des légalités totalement identiques.Les différentes espèces de raison n’ont que partiellement des lois formel-les identiques. Dans la sphère des actes désirants et a fortiori dans la sphèrede la volonté entrent en jeu des lois d’une espèce tout à fait propre.
Pour élaborer de manière sûre la logique de la volonté (pour ainsidire), le mieux serait, à mon avis, d’énoncer systématiquement et une parune toutes les lois de la volonté, par conséquent de ne pas se contenter dufait que, par exemple, l’on puisse énoncer des lois axiologiques plus géné-rales qui enveloppent toutes sortes de lois de la volonté, pour ensuite,éventuellement, chercher des lois spéciales complémentaires qui valentprécisément pour la seule sphère de la volonté et non pour d’autres sphè-res de l’affectivité. Ce n’est qu’en procédant ainsi qu’on aura une vued’ensemble complète et claire de ce qui réside dans la sphère de la
[102]
18554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
volonté, ou de ce qui reste encore à formuler à son sujet. Mais je ne puisici procéder ainsi, car cela entraînerait bien des longueurs.
Quelques points généraux doivent être plus précisément discutés defaçon préliminaire. D’abord, il faut toujours prendre garde au fait quenous comprenons le domaine de la volonté de façon convenablementélargie, de même que, corrélativement, nous saisissons le domaine de lacroyance, de la doxa, de façon tout aussi élargie. Nous n’avons pas alorsen vue uniquement le croire-certain, mais aussi toutes sortes de modalisa-tions de cette même croyance : d’une part, le non-croire, le refus decroire ; d’autre part, le tenir-pour-possible au sens où quelque chosedonne l’impression d’être [sich als seiend anmutet], où nous inclinons, en uncertain sens, à croire, en ayant conscience que « quelque chose parle enfaveur de l’être », sans pourtant croire effectivement ; ce qu’il y a d’objec-tif [das Gegenständliche] ne se présente pas là purement et simplementcomme étant (aussi ne disons-nous pas que nous en sommes certains), ilest là comme « tout à fait possible ». Certes, c’est une possibilité en unsens déterminé, celui dans lequel, par exemple, on parle de comparer despossibilités à des possibilités, par exemple dans la théorie des probabili-tés. De même, on retrouve ici l’ « incliner » [ « Zuneigen » ] à préférer unpossible parmi plusieurs possibilités se présentant sur la base d’un tel exa-men [Erwägung] dans la croyance ; à le supposer, ou bien encore, au lieude cela, à être disjonctivement dans une attitude de questionnement ou dedoute, etc. Ce réfléchir et examiner [Überlegen und Erwägen] qui entre ici enjeu doit lui-même être intégré au domaine de la croyance, pourvu quenous excluions tout acte délibéré, tout acte volontaire, aussi profondé-ment entrelacé avec lui soit-il.
De façon semblable, par acte-de-la-volonté au sens le plus large, nouscomprenons non seulement le vouloir au sens le plus restreint, mais aussimaintes autres modalités, dont certaines propres à la volonté. Parexemple, nous devons faire une différence entre le vouloir qui n’est pasdéjà en lui-même un vouloir agissant, comme tout vouloir au sens de se-décider-à-quelque-chose, et le vouloir au sens d’un vouloir agissant, parexemple dans la réalisation d’une décision prise antérieurement. Nousrencontrons également d’autres modes de la sphère de la volonté, le plussouvent tels qu’ils ont leur analogon dans toutes les autres sphères d’actes.
186 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[103]
18654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Vouloir au sens courant, qui est plus étroit, c’est vouloir positivementet dans la certitude-de-volonté. Je suis purement et simplement décidé,ou bien même je fais, j’agis : le vouloir qui y est inclus est toujours unvouloir positif et une certitude-de-volonté. Or, il y a également d’autresoccurrences dans la sphère spécifique de la volonté qui se détachent, neserait-ce que par les expressions marquantes choisies à l’instant.
Tout d’abord, il est clair que nous avons également un vouloir négatifet, de même, des modes de l’incertitude-de-volonté. À l’égard de ces der-niers, la distinction entre vouloir et souhaiter, aspirer, désirer devient sou-vent confuse. Le simple souhaiter ne comporte rien de l’ordre du vou-loir ; il ne comporte rien de l’ordre des modalités pratiques et n’est paslui-même un acte pratique, un acte de la volonté au sens le plus large. Il ya pur et simple souhait là où le souhaité n’est pas conscient, à quelquedegré que ce soit, comme quelque chose de pratiquement réalisable, là oùil n’est conscient comme tel ni sur le mode de la certitude, ni de façonentièrement problématique, donc pas même sur le mode de ce qui peutêtre réalisable – ou bien là où il est directement conscient comme irréali-sable. « Tout possible » [alles Mögliche] peut être souhaité, et non pas seule-ment tout ce qui est possible en pratique. Un marchand aspire à êtreriche. On ne peut pas dire qu’il le veut au sens le plus restreint du terme.Il ne peut vouloir que ce dont il est conscient, dans la certitude ou la pro-babilité, comme d’une fin pratique d’un chemin-de-volonté qui y mène.Dans toute affaire à laquelle il se décide ou qu’il réalise vit une volonté ence sens étroitement déterminé. D’un autre côté, son aspiration à larichesse n’est cependant pas un simple souhait, bien qu’elle soit aussi unsouhait. Il tient bien le but de l’aspiration pour un « but possible ». Il nepeut certes pas se dire que ses forces suffiront, que les circonstances de lafortune [Glücksumstände] soumises au hasard, etc., seront suffisammentfavorables, mais cela pourrait bien se faire, peut-être que cela réussira.Aussi incertain et indéterminé qu’on suppose le chemin conduisant à cebut et aussi indéterminée que soit la position du but lui-même, ce dernierest et a pu être posé en tant que but. Cette aspiration à la richesse est déjàun mode de la volonté qui dépasse le souhait, et même un mode positif.
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 187
[104]
18754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 14. Souhait et volonté>
Nous avons commencé, lors de la dernière leçon, à nous plonger plusspécialement dans le domaine de la volonté, et nous avons d’abord consa-cré quelques efforts à la détermination et à la clarification des conceptsfondamentaux de référence. Nous avons parlé, à la fin de la leçon, de ladifférence entre souhaiter et vouloir. Les deux se présentent souvententrelacés, mais le simple souhaiter, aussi vif soit-il, n’est pas encore unvouloir. Cela est attesté aussi par le fait que les degrés du vouloir, les dif-férences de tension de la volonté [Willensanspannung] qui lui sont propres,ne suivent pas nécessairement un cours parallèle aux degrés du souhaiter.Quelque chose de passionnément souhaité peut être voulu sans tensionénergique de la volonté, pour ainsi dire dans une volonté molle. En cela ilfaut bien sûr prendre garde au fait que nous parlons de degrés dans l’actelui-même et non des dispositions habituelles, qui ont elles-mêmes leursdegrés : une personnalité peut avoir des orientations de volonté fermesqui tiennent sur le long terme, une autre en a de moins fermes, changeplus facilement ses orientations de volonté, et en particulier, elle se com-porte à l’égard des mêmes buts de volonté en étant plus ou moins ferme-ment dirigée sur eux. Cette fermeté habituelle, tout comme l’habitude depoursuivre les buts avec énergie, doivent être distingués, bien entendu, dela tension plus ou moins grande qu’admet l’acte singulier de la volonté.
C’est une question ouverte que de savoir si tout vouloir renferme undésirer, un souhaiter. En tout cas, ils sont souvent entrelacés. La volontéd’entreprendre un voyage n’abolit pas le désir de le faire, et même pen-dant l’effectuation réalisatrice du voyage, il est possible que le désir de lasuite ou du but continue encore et toujours de nous affecter, ou que cedésir réside dans la conscience comme une couche inférieure perma-nente. <On dit> qu’il est impensable de vouloir sans désirer, que je nepeux rien vouloir qui ne me soit souhaitable ; si cela m’est en soi-mêmedésagréable, c’est nécessairement souhaité en vue d’autre chose. Mais celan’est pas sans plus une réelle implication d’un souhaiter dans le vouloir. Ilserait irrationnel de vouloir quelque chose qui ne fût pas digne d’être sou-haité en lui-même ou en vue d’autre chose. Il y a donc là une implication
188 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[105]
18854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
au sens rationnel. Pour autant, il n’est pas nécessaire qu’un souhaiter enacte soit contenu dans le vouloir en tant que soubassement. Que cela soitsouhaité ne veut pas toujours dire que c’est actuellement souhaité, maiscela a maintes fois le sens de : cela est digne de souhait.
Mais d’un autre côté, le fait que souhaiter un but et vouloir ce mêmebut soient compatibles démontre assurément que les propriétés qualitati-ves des caractères d’acte du souhaiter et du vouloir ne sont pas des diffé-rences homogènes d’un seul et même genre, car de telles différences s’ex-cluent essentiellement l’une l’autre – comme deux espèces de couleurss’excluent en tant qu’elles recouvrent la même portion de surface et dansle même temps, et autres choses du même ordre.
Le souhait et la volonté se dirigent tous deux, d’une certaine façon,sur un être, comme d’ailleurs, d’une certaine façon, tous les actes se diri-gent sur de l’être. La croyance est un présumer de l’être, les modalisationsdu croire sont des présomptions sur un être modalisé, sur un « être-possible », sur un « être-probable », etc. Il faut également saisir les actesaffectifs comme des modalisations de l’être, bien que d’une nouvelledimension : le souhaiter présume un « que cela soit », le vouloir, un « celadoit être » où le « cela doit » est à prendre, bien entendu, en un sensdéterminé.
La volonté, dit-on, tend à une réalisation. Ce n’est que dans certainscas, par une voie détournée, que la volonté se dirige, comme il nous fautcertes l’ajouter en complément, sur quelque chose d’étant déjà à l’avanceet dont elle a conscience en tant qu’étant ; à savoir en tant que volontéque quelque chose reste tel qu’il est.
Excluons provisoirement ces cas et tenons-nous en à l’orientation dela volonté sur quelque chose dont elle n’a pas conscience d’avancecomme étant effectivement. La volonté, dit-on alors, ne peut pas se diri-ger sur quelque chose d’idéal, mais seulement sur quelque chose de réel,et non pas sur quelque chose de passé, mais sur quelque chose de futur ;et cela par opposition à la joie et au souhait. Quelqu’un peut se réjouir oubien encore souhaiter que soit établie une relation mathématique idéale,qu’une proposition et une démonstration se révèlent valides. Mais en celail se peut que joie et souhait, au lieu de porter sur le processus réel du « serévéler » [reale Sich-Herausstellen], portent également sur l’être idéal lui-
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 189
[106]
18954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
même, qui de son côté est au-delà de tout vouloir et de tout faire. L’inté-rêt pour l’établissement de la vérité peut mener, par transfert, à l’intérêtpour l’être d’une prétendue vérité elle-même. Quelqu’un peut ressentir ensoi-même : il est dommage que cette vérité par moi présumée et affirméen’en soit pas une ; j’aurais pu m’épargner ce ridicule, et autres chosessemblables. Mais la volonté se trouve ici liée. La sphère idéale lui resteclose, tout comme celle du passé. Cette limitation de la volonté est sansdoute, une fois de plus, une limitation de la raison. Qu’un fou ne puisseen définitive produire des actes de volonté rapportés à du passé ou à del’idéal, c’est ce que nous ne saurions affirmer.
<§ 15. Volonté d’action et décision volontaire dirigée sur un futur>
Si la volonté porte sur un futur, elle le fait sur un mode propre, qui ladistingue de tous les autres actes se rapportant à du futur. Par exemple, lajoie au sujet d’un futur présuppose la croyance en l’être futur, l’attente dufutur la sous-tend en tant que soubassement. L’évaluation en tant que joie[Freudenbewertung] ou encore la position en tant que bien [Gutsetzung] portesur ce qui est déjà posé comme une réalité future, posé dans la croyancesous-jacente. La volonté dirigée sur un futur implique aussi d’une certainefaçon la croyance en ce futur, mais elle ne présuppose pas cette croyance ;elle ne l’implique pas en tant que soubassement [als Unterlage]. Car celuiqui veut et, disons plus exactement, qui veut positivement (et qui veut surle mode de la certitude de volonté) que quelque chose arrive [geschehensolle], croit par là même aussi que cela arrivera. La décision d’aller à Parisimplique d’une certaine manière, naturellement, que le voyage à Paris seraune réalité [Wirklichkeit], à plus forte raison dans la volonté d’agir qui vitdans l’accomplissement en acte [handelnden] du voyage. Mais le voyagefutur, ou encore, le séjour futur à Paris n’est pas en premier lieu une réa-lité certaine, et n’est pas non plus voulu en tant que certain d’avance, maistout au contraire : s’il était déjà d’avance certain qu’il soit, il ne pourraitpas du tout être voulu. Au lieu d’être d’avance certain, il n’est certainqu’en vertu de la certitude de volonté. La volonté en tant que certitude devolonté pose le futur d’une manière telle qu’elle lui confère seulement,
190 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[107]
19054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pour la conscience, la certitude d’être. La conscience, en quelque sorte, nedit pas : « Cela sera, et pour cette raison même je le veux » ; mais :« Puisque je le veux, cela sera. » En d’autres termes, la volonté prononceson « que cela soit ! » créateur. La position de volonté est position de laréalisation [Verwirklichung]. Mais réalisation ne veut pas dire ici simple-ment devenir réel, mais rendre réel, opération de la réalisation [Leistung derVerwirklichung]. Mais c’est là quelque chose d’absolument original, qui a sasource précisément dans l’essence propre de la conscience volontaire etne se laisse comprendre que là.
Du côté des actes, au lieu de dire que le vouloir serait fondé sur lacroyance en l’être futur, nous devrions bien plutôt dire que la croyancedans le futur est une croyance qui prend sa source dans le vouloir. Et si levouloir est un vouloir de l’action, alors dans chacune des phases où la réa-lisation est accomplie (où donc le devenir-réel a le mode de l’être-réel-maintenant), ce réel-maintenant est caractérisé comme originairementcréé, comme fait ; corrélativement, l’apparition-de-perception (et la certi-tude de perception) a le caractère d’une certitude et d’une apparitionissues du vouloir. Tandis que n’importe quelle autre perception a le carac-tère d’une passivité, dans laquelle nous appréhendons ce qui précisémentest là, dans laquelle nous nous tournons vers un existant, la perceptionqui entre ici en jeu, celle de toutes les phases actuelles de l’action, a lecaractère d’une perception ayant sa source dans la subjectivité créatrice,dont l’objet est consécutif au « fiat » créateur. Telle est donc la singularitéincomparable de la position de volonté en tant que position créatrice.
Pourtant nous devons ici mettre en relief la différence triviale quenous avons déjà effleurée dernièrement, mais sans l’expliquer plus à fond.Le « que cela soit » créateur, qui fait l’essence de la position de volonté,peut être créateur actuellement – la volonté est volonté d’action, volontéréalisatrice, effectivement agissante – ou elle peut être seulement dirigéesur un créer, sur un créer futur. Il en va ainsi de toute décision dirigée surun agir futur. Car il nous faut distinguer avec précision la référence de lavolonté à l’événement [Geschehen] futur et à l’ « adviens ! » qui se rapporteà ce dernier, et la référence de la volonté au vouloir futur ou encore àl’agir futur. Ce qui prête ici à confusion, c’est qu’un vouloir du vouloir etde l’agir futurs est également possible et que le « que cela soit ! » posant
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 191
[108]
19154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
l’agir futur pose aussi par là même, mais seulement au moyen d’uneconnexion apriorique, l’événement futur, lui confère implicitement, à luiaussi, l’ « adviens ! ». Si la volonté porte effectivement sur l’agir futur,c’est alors l’agir lui-même, la réalité future qui reçoit dans la décisionactuelle sa position pratique, et si tout vouloir dirigé sur un futur était unvouloir d’un agir futur, nous tomberions manifestement dans une régres-sion à l’infini. Ce qui existe ici, ce sont précisément des implicationsrationnelles : celui qui veut quelque chose de futur, plus précisémentquelque chose dont le devenir n’a pas son commencement dans le pré-sent, ne pourrait pas le vouloir s’il ne voulait l’action future. C’est un dis-cours équivoque, qui dit cependant que le vouloir du futur exclut le ne-pas-vouloir, le refus de l’action future.
Assurément, le vouloir dirigé sur un événement futur et qui n’a passon commencement dans le point du maintenant, implique [schließt ein]aussi, quant à la conscience, l’agir réalisateur futur, et même, entendue ausens réel [reell verstanden], une conscience de certitude de l’agir futur. Levoyage futur que je projette et que j’ai maintenant décidé, je n’en ai pasconscience seulement comme d’un processus, mais précisément commed’un voyage, c’est-à-dire d’une action, et cela de façon absolument néces-saire. Mais la volonté présente, en tant que volonté, en tant que positionspécifique de la réalité du « que cela soit ! », ne pose pas la volition ouencore l’action futures, mais envoie à travers elles [sendet durch sie hindurch]la thèse « que cela soit ! » ; ou, comme nous pourrions encore dire : lathèse de la volonté s’étend sur un intervalle de temps [Zeitstrecke] futur et yexige un intervalle de volonté [Willensstrecke] rempli, à travers les phasesduquel elle s’étend, et dès lors, ce que la volonté future fait parvenir, danschaque phase, à la position de volonté, à la création future, est aussi lepositum-de-volonté de la volonté décisionnelle actuelle ; ce qui est ainsiposé, c’est donc le processus à réaliser et non pas la volonté, ou encorel’action. Mais bien sûr, nous avons [là] ceci d’original que la volontéfuture, elle aussi, dans tout son déroulement continu, et corrélativement àl’action future, se caractérise comme un réel futur et un réel qui prend sasource, pour ce qui est de son être réel futur, dans la volonté décisionnelleactuelle. Conformément à cela, c’est quelque chose qui ne vient à l’êtreque par la volonté et ce n’est que par elle qu’il a le caractère de certitude
192 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[109]
19254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
d’un être futur. Mais pour cette raison même, il reste que la thèse devolonté n’est pas dirigée sur cela, mais précisément sur le processusvoulu, et seule la réflexion nous apprend que le caractère créateur [dasSchöpferische] de la volonté dirigée sur un intervalle de temps futur vanécessairement plus loin que le thème propre de la volonté. (Ce sont làdes relations très difficiles, que l’on doit toujours et encore repenser àfond.) La volonté dirigée sur le futur est, en un certain sens, une intentioncréatrice, et celle-ci se « remplit » dans l’action réalisatrice.
<§ 16. La structure de la volonté d’action>
Nous insérons ici un point important. La volonté porte sur une effec-tivité, non pas idéale, mais individuelle, réelle [reale] (par quoi il ne faut paspenser directement à une réalité au sens spécifiquement substantiel-cau-sal, encore que les cas ordinaires relèvent de cette sphère). En cela, toutevolonté présuppose non seulement en général une représentation duvoulu, mais elle possède nécessairement un vaste soubassement de repré-sentation et par suite, en dépit de l’absence de présupposition en ce quiregarde la croyance en l’être du voulu, elle possède aussi un soubasse-ment de croyance rapporté à de l’être réel [reales]. Là où une réalité n’estpas déjà posée ou, si l’on préfère, n’est pas consciente doxiquement surun mode quelconque, une réalisation créatrice ne peut surgir. Parexemple, dans cet environnement concret, je veux quelque chose :quelque chose qui ne s’y trouve pas encore doit y advenir. La volonté sedirige sur un maintenant déterminé en tant que commencement d’unesérie temporelle remplie, et ce maintenant, dans sa déterminité, nousrenvoie déjà à un champ d’effectivité.
Or, l’agir est un agir originaire ou un agir réalisant un dessein [Vor-satz]. La volonté réalisatrice fait suite, au niveau de la conscience, à lavolonté de décision ; et de son intervalle de temps découle, dans le coursdu temps et à l’intérieur de la conscience du temps, le maintenant déter-miné auquel, en tant que point de départ du processus à réaliser, il étaitrapporté. Si elle n’a pas été maintenue de façon vivante dans l’intervallede temps depuis la décision, la volonté peut cependant entrer en jeu en
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 193
19354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tant que volonté réitérée et ne faire qu’un avec la volonté antérieure pré-sentifiée à nouveau par souvenir, et entrer en jeu comme elle le doit enl’occurrence, c’est-à-dire comme volonté d’action remplissante. Sa pre-mière phase est immédiatement créatrice en acte ; ce qui, en elle, estdonné comme étant maintenant et constitué perceptivement surgitcomme advenu à partir du fiat, comme quelque chose de créé. Mais en cepoint de temps est en même temps présent à la conscience un horizon defutur de ce qui reste encore à réaliser. C’est un horizon dont on est d’oreset déjà conscient comme d’un horizon de la volonté, et ce dans une conti-nuité de volonté anticipée. La thèse de volonté ne se dirige pas seulementsur le maintenant avec son commencement créateur, mais sur l’intervallede temps ultérieur et sur son contenu. Au présent créateur est uni unfutur créateur qui est ici, dans l’action, constitué en tant que tel dans sonoriginarité particulière. Or, le maintenant se change en un maintenanttoujours nouveau ; continûment le futur qu’on s’est proposé [vorgesetzte]se convertit en un présent créateur et devient par conséquent un crééeffectif. Ce qui vient d’être créé reçoit le caractère du passé créateur, tan-dis que, d’un autre côté, l’horizon de futur continue à subsister [weiterfortbesteht], mais se rétrécit toujours davantage en vertu de la limitation del’intervalle de temps de l’opération envisagée. À la fin, l’action est ter-minée, elle touche à son terme, et en tant que tout elle n’est elle-mêmequ’un passé créateur, qui éventuellement laisse un résultat subsistant entant qu’œuvre, c’est-à-dire quelque chose qui est advenu par un tel pro-cessus créateur et se caractérise comme tel.
Pendant l’action, nous avons une structure caractéristique du vouloir ;à chaque phase d’action correspond un point du créer actuel : le point del’à-chaque-fois-maintenant avec son actuelle opération-de-maintenant[Jetzt-Leistung] ; à celle-ci correspond une phase de volonté insigne danslaquelle la volonté manifeste son originalité créatrice. Mais à chaque pointcorrespond aussi un horizon, en général double, de changements de lavolonté caractéristiques, dans lesquels se constituent, au niveau de laconscience, le passé créatif et le futur créatif, le terminé et ce qui resteencore à accomplir. En outre, [il y a] les deux points insignes : le point ini-tial avec le premier fiat qui, en quelque sorte, octroie l’impulsion créatrice ori-ginaire, et le point final avec le caractère « c’est achevé » – deux points se dis-
194 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[110]
19454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:42
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tinguant dans leur horizon par des unilatéralités corrélatives. Pendant leprocessus, le vouloir jaillit sans cesse du vouloir, ce qui se convertitensuite en reproductions, de sorte qu’en général, dans les continuités devolonté appartenant à chaque point de temps, les moments du vouloir nesont pas juxtaposés, mais se tiennent dans des relations continues dusurgir-l’un-de-l’autre. Cela ne vaut pas moins, d’une manière quelquepeu différente, pour les continua de volonté intégraux, dans la succession[Reihenfolge] des points de temps : tout nouveau continuum de volonté, dansle passage du maintenant au nouveau maintenant, ne s’écoule pas seule-ment à partir du précédent, comme en général, dans la conscience origi-naire du temps, le maintenant s’écoule à partir du maintenant passé, maiselle surgit plutôt à partir de lui grâce à la création propre de la volonté.
Dans tout maintenant, la direction de volonté et le « que cela soit ! »créatif traverse la continuité des moments de volonté ; avec chaque nou-veau point de création actuel se remplit une intention de volonté anté-rieure, dirigée sur son contenu. Les volitions ne se dirigent pas sur lesvolitions ultérieures, mais toute volonté se dirige sur les choses en ques-tion [die Sachen] : [en tant que] créativement remplie, sur chaque nouvellephase-de-maintenant du processus [auf die jeweilige Jetztphase des Vorgangs]et, [en tant qu’] « intentionnante », sur tout le reste du processus comme àréaliser. Se confirme aussi de la sorte l’analyse que nous avons donnéedernièrement au sujet des directions de volonté de la décision anticipa-trice. Dans le faire, ce n’est pas la volonté future que nous faisons, maisplutôt ce qui est fait [das Getane], même si effectivement cela implique quedes continuités de volonté s’écoulent à partir de la volonté d’intervention[Einsatzwillen], à partir du fiat, et que toute nouvelle phase de volontés’écoule à partir de la précédente.
Une volonté d’agir peut être réalisatrice, remplissant une volonté dedessein [Vorsatzwillen] antérieure. (Même si toute volonté d’action pos-sède en quelque sorte aussi des intervalles de dessein [Vorsatzstrecken],nous ne la nommons pourtant pas dessein, car nous comprenons précisé-ment par ce terme le cas d’une intention de volonté rapportée simple-ment à des intervalles futurs). Il n’est cependant pas nécessaire qu’unevolonté d’action soit la réalisation d’un dessein ; elle peut commencerdirectement comme agir pur et simple.
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 195
[111]
19554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Il y a dans la sphère de la volonté encore bien des différences à expli-citer. Il faudrait à cet endroit mentionner encore, par exemple, la diffé-rence entre une volonté de dessein et la décision. Une décision au sensprégnant du terme renvoie à un réveil de la volonté, à un passage par uneimpression-de-volonté [Willensanmutung] antérieure, des questions-de-volonté, etc. L’issue d’un examen de volonté [Willenserwägung] est uneprise de position de la volonté en tant que vouloir au sens étroit, et c’estalors que nous parlons de décision, voire de se-décider, un mot quirenvoie spécialement à des possibilités opposées [Gegenmöglichkeiten] : onse décide pour une possibilité au détriment de l’autre. La volonté, etmême la volonté décidée, apparaît donc ici après que d’autres actes, quenous devons désigner comme modalités de la volonté, ont précédé. Maistoute volonté n’est pas une décision [Entschluß], n’a pas toujours le carac-tère d’une décision [Entscheidung]. En relève tout acte de volonté qui suitsimplement une stimulation [Reiz], sans hésiter et sans douter, sans déli-bération et sans prise de parti. Par exemple, je lève les yeux : mon petitdéjeuner est là. Immédiatement, je dis : je veux déjeuner maintenant. Icise pose assurément la question de la relation de ces volitions qui suivent,sans plus, une « excitation », aux activités instinctives [triebartigen] quenous qualifions d’involontaires. Pour le moment, nous ne nous y arrête-rons pas.
<§ 17. Les parallèles entre modalités de jugementet modalités de volonté>
<a) Le vouloir au sens originaire en tant qu’analogonde la croyance certaine. La modification problématique,
hypothétique et disjonctive du vouloir>
À la fin de la dernière leçon, j’ai commencé à parler de modalités de lavolonté, en parallèle avec les modalités du jugement. Lorsque nousavions dégagé précédemment, de façon tout à fait générale, les parallèlesentre la sphère du jugement et la sphère de l’affectivité prise globalement,la sphère axiologique entendue de façon tout à fait universelle, nous
196 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[112]
19654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
avions aussi, très brièvement, évoqué les modalités de la volonté. Ce quinous importe maintenant, c’est de fournir quelques développements plusdétaillés.
Sous le titre de « modalités », nous ne visons pas ici n’importe quellesmodifications [Abwandlungen] que peuvent subir des actes de n’importequelle classe. Si nous prenons, par exemple, une croyance certaine decontenu A, telle qu’un jugement prédicatif selon lequel S est p, ce n’estpas une modalité du jugement si nous lui opposons l’acte de se placerdans la pensée que S soit p, sans le croire soi-même. C’est un genre demodification que nous trouvons dans tous les domaines d’acte, commeon l’a déjà précédemment mentionné. On peut, par exemple, se transpor-ter par la pensée dans un vouloir, sans vouloir effectivement, sans effec-tuer la moindre prise de position pratique. De même, un jugement stipu-lant que S est p peut être effectué de manières fort différentes, et les vécusdont nous disons qu’ils sont le « même » jugement, sont extraordinaire-ment divers. Tantôt le jugement est effectué dans une spontanéitévivante, nous posons étape par étape le sujet, puis le prédicat, etc. ; tantôtle jugement surgit devant nous sans un tel accomplissement authentiqueet articulé, un peu comme une idée subite, tout d’une pièce, et nous l’ac-cueillons, nous nous comportons passivement, et pourtant le jugementapparaissant [ainsi] se tient là sur le mode de la croyance certaine. Demême, il y a une différence entre le fait d’avoir une conscience de l’être del’état de choses dans un juger spontané et, une fois ce processus de juge-ment terminé, celui d’avoir encore en vue l’être, de croire encore à l’étatde choses et de le maintenir dans l’être. Ou encore, [il y a] les différencesde la clarté et de la non-clarté, du juger à la suite de raisons claires et don-nées et du juger dépourvu de toute justification. Il peut aussi y avoir desraisons déterminantes au niveau de la conscience, mais sous la forme d’unsimple souvenir, voire d’un souvenir très obscur, d’une justification anté-rieure. Tout cela, ce sont des phénomènes fort divers qui appellent desdescriptions détaillées, et qui ont leurs analoga dans toutes les classes d’ac-tes. Il y a ainsi un vouloir entièrement dépourvu de soubassement fonda-teur [Begründungsunterlage] et un vouloir motivé par des raisons [Gründe], unvouloir sous forme de raison pratique claire, et [encore] un vouloir quirenferme des motifs rationnels, mais obscurs, etc.
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 197
[113]
19754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Toutes ces différences, aussi extraordinairement importantes soient-elles, ne nous concernent pas maintenant, ce ne sont pas elles que nousavons en vue sous le titre de « modalités ». Elles peuvent changer diver-sement dans la sphère du jugement, tandis que nous continuons à dire,en un certain sens avec raison, que le même jugement « S est p » setrouve accompli, déterminé précisément par la même qualité de juge-ment (thèse de jugement), à savoir une croyance certaine, et la mêmematière, à savoir, le même « S est p », qui est ce qui y est cru. Et demême, nous parlons du même souhait « que S puisse être p » et de lamême volonté « que S soit p », sans égard aux diverses variations phéno-ménologiques du type évoqué. Nous adoptons donc à présent la mêmeperspective que le logicien lorsqu’il ébauche une morphologie de juge-ments possibles, mais où le concept de jugement est pris de façonélargie, de sorte que vaut aussi comme jugement la série des modifica-tions du croire certain que nous nommons tenir-pour-possible, tenir-pour-probable, douter, questionner, réfléchir, se-décider, etc. De cela,nous avons donc des parallèles dans la sphère de la volonté, là aussi il y aune morphologie pure des configurations de la volonté comprises en unsens plus large, et cela tant du point de vue des actes de la volonté que,parallèlement, du point de vue de leurs corrélats, c’est-à-dire des propo-sitions et contenus de volonté.
Au lieu de simplement juger (i.e. d’être certain d’une chose), je peuxaccomplir un être-incertain, mais non pas comme une simple privation del’être-certain. En effet, la chose donne l’impression d’être [mutet sich alsseiend an], éventuellement sur la base de raisons déterminées dont j’aiconscience ; quelque chose parle en faveur de l’être, sans que j’en aiecependant la certitude. Mais, le cas échéant, elle en donne l’impressionsans que j’aie conscience de raisons déterminées pour cela. La chose setient là comme possible, et cette conscience de possibilité est une modali-sation de la croyance ; elle est une modification de la thèse de croyance,qui a elle-même le caractère d’une thèse, et d’une thèse appartenantessentiellement au domaine doxique.
De même dans la sphère pratique : au lieu de vouloir au sens normaldu terme, je peux effectuer une conscience pratique qui est apparentée auvouloir et caractérisée essentiellement comme modification d’un vouloir :
198 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[114]
19854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
la matière de la volonté donne l’impression d’un devoir-être sur le planpratique [praktisch sein-sollend], soit pour des raisons de volonté détermi-nées, soit pour des raisons indéterminées et non claires. Il n’y a pas là unsimple jugement : « Je devrais peut-être [faire] cela » (indépendamment dufait qu’il n’y a pas lieu de penser ici à un devoir, à une norme, à un devoir-être au sens particulier du terme). Il n’est pas nécessaire que je juge, maisc’est bien plutôt l’état de choses concerné qui se tient là, caractérisé defaçon spécifique, dans une conscience de volonté ; il donne précisémentl’impression d’être à vouloir [mutet sich als zu wollender an].
Si l’on nomme la conscience de possibilité dans la sphère de lacroyance, une [conscience] problématique (ce qui n’est certes pas une trèsbonne expression), il faudrait alors qualifier, analogiquement, cette cons-cience de volonté de problématique. Le vouloir au sens originaire estl’analogon de la certitude ; je pose simplement et pratiquement cela commedevant être : « Que cela advienne ! » Dans le comportement probléma-tique, j’ai la simple impression [Anmutung] du « que cela advienne ! ». Jesuis seulement enclin à vouloir – le concept d’inclination devant certes encela être orienté exactement selon les descriptions.
D’autres modalités encore sont le poser [Ansetzen] hypothétique et lefait d’accomplir une thèse-conséquence sur la base d’une suppositionhypothétique [auf einen hypothetischen Ansatz hin] : si A est b, alors C est d.De même du point de vue pratique : au lieu de simplement vouloir, jepeux accomplir un vouloir hypothétique, et en retour, si je fais cela,accomplir sur cette base un vouloir-conséquence [Nachsatzwollen]. Parexemple : supposé que j’aille cet été en Suisse – alors j’irai en Engadine.Cela s’exprime comme un jugement hypothétique. Mais l’hypothèse et cequi repose sur l’hypothèse se produit, antérieurement à tout jugement,dans le vouloir.
Il en va de même avec les modifications disjonctives du vouloir. Jeveux A ou B. Je veux ou bien aller à la mer, ou bien aller en Suisse. Celane veut pas dire que je veux l’un, que je veux l’autre, mais pourtant il y a làune volonté, et pour chaque membre, une modalité de volonté, et c’estseulement d’après cela que s’oriente le jugement disjonctif énoncé. Quedans ce comportement disjonctivement volontaire se trouve égalementimpliqué un vouloir au sens restreint, c’est une chose à part. Je veux l’un
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 199
[115]
19954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
des deux. Mais chaque membre de la disjonction n’est pas pour autantsimplement représenté, mais voulu, et non pas simplement voulu, maisvoulu d’une manière modalisée.
<b) La question de volonté comme analogon de la question d’être.À propos de la morphologie des questions>
Pour toutes les modifications de la conscience de jugement, nous trou-vons ainsi et a priori des modifications parallèles dans la conscience devolonté ; à toutes les occurrences [Vorkommnissen] de la morphologie despropositions et des modifications modales de propositions correspondentdes occurrences parallèles pour les propositions de volonté [Willenssätze].Nous relevons plus particulièrement ce qui suit : parcourons la série tenir-pour-possible, douter, questionner, réfléchir, se décider ! Il y a un douterpratique, un questionner pratique, un réfléchir et un se-décider pratiques,qui sont purement affaire de la volonté, si important que soit le rôle jouépar un questionner doxique, un réfléchir doxique, etc., lors de la fondation[Fundierung] de la volonté dans des occurrences de la sphère de la représen-tation et du jugement, même au niveau inférieur. De même que je peuxdouter théorétiquement [quant à la question de savoir] si c’est A ou B quiest, chacun des termes du doute étant présupposé comme quelque chosequi donne l’impression d’être [als ein Sich-als-seiend-Anmuten], de même jepeux aussi douter dans la sphère de la volonté.
A est présent à la conscience dans une impression de volonté [Willens-anmutung], et B dans une autre. Chacun donne l’impression d’être « dû »[ « gesollt » ], chacun sollicite en quelque sorte le vouloir. Voici que monvouloir hésite entre A et B. Dans la volonté elle-même s’effectue l’être-rapporté indécis à l’un ou à l’autre. L’ambiguïté [Zwiespältigkeit] qui résidedans la volonté elle-même confère au doute de la volonté le caractèred’analogon du doute théorétique.
De même, nous avons, en tant que parallèle au phénomène étroite-ment apparenté de la question d’être, la question pratique ou question devolonté. Cette dernière expression est certes équivoque dans la mesureoù, ici comme partout ailleurs, des éléments doxiques peuvent s’édifier ets’édifient très souvent sur les occurrences de la volonté concernées, élé-
200 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[116]
20054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ments qui s’énoncent alors dans des propositions interrogatives doxiquesrapportées au pratique [auf das Praktische]. Il appartient à l’essence de laquestion de viser [zielen] une réponse, et ce viser se remplit précisémentdans la réponse en acte. Par conséquent, la question de volonté recèle ensoi l’intention d’une réponse de volonté correspondante.
Question et doute ou, si l’on veut, question et simple tenir pour pos-sible sont étroitement apparentés, mais ne sont pas une seule et mêmechose. Les questions peuvent avoir un ou plusieurs membres. On peutcertes être tenté de nier l’existence d’une question à un seul membre et dene voir en elle qu’une formulation abrégée d’une question à plusieursmembres – ainsi, si nous demandons « A est-il ? », nous pouvons certesajouter « ou bien n’est-il pas ? », et nous avons alors une relation deconséquence rationnelle ou, si l’on veut, d’implication rationnelle, dans lamesure où la position de l’une des questions justifie rationnellement sacomplétion en question disjonctive – mais, indubitablement, un tel pas-sage à la contre-question complémentaire [Gegenfrage] ne s’impose pas.Nous pouvons précisément, dans une interrogation simple, être dirigésuniquement sur l’être de A [et demander] si, justement, il est. Si la ques-tion est une question authentique et non apparente, on trouve alors à labase une impression-d’être [Seinsanmutung], et cela nécessairement. Ce enfaveur de quoi rien ne parle dans l’ordre de la conscience, ce qui ne donnede soi aucune impression d’être, ne peut pas être en question précisémentquant à son être. D’un autre côté, manifestement, une impression d’êtren’est pas encore par elle-même une question ; en elle ne réside pas encorel’intention tournée vers la réponse, qui constitue proprement la question.Il en va de même pour les questions à plusieurs membres, par quoi l’oncomprend habituellement des questions disjonctives. Pour être ici un peuplus exacts, jetons un coup d’œil sur la morphologie des questions.
Comme avec les jugements (ou, si l’on veut, les propositions judica-tives), il nous faut ici distinguer questions simples et composées. Il fautensuite définir une question composée (comme on définit, de façon sem-blable, un jugement composé) comme une question unique dans laquelleune pluralité de questions sont distinguées en tant que membres subor-donnés, où par conséquent une question est réellement composée dequestions ; et nous entendons ici par questions des questions réelles, tout
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 201
20154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
simplement, et non pas des modalisations de questions. En tout cela, laquestion n’est pas de savoir si la matière de la question est composée ousimple ; car des questions simples peuvent avoir une matière composée.Ainsi, par exemple, la question à matière hypothétique, ou disjonctive,ou conjonctive, est une question simple suivant les formes « si A est b,C est-il d ? », « de A, B ou C, l’un d’eux est-il ? » ; comme lorsque quel-qu’un demande : parmi les améliorations proposées au texte dans cetraité, faut-il en retenir une ? De même pour des matières composéesconjonctivement : les deux événements A et B ont-ils eu lieu ?
C’est de cela qu’il faut désormais distinguer les questions véritable-ment composées, composées sous la forme de questions conjonctives etde questions disjonctives. Dans la question conjonctive « A est-il et B est-il, etc. ? » sont comprises deux questions autonomes séparables, corres-pondant à chacun des membres ; et, en même temps, c’est une questionqui comprend en soi précisément plusieurs questions. Les questionsconjonctives correspondent exactement au jugement conjonctivementcomposé.
De même, les questions disjonctives de la forme « A est-il, ou bienB est-il, ou bien C est-il, etc. ? » sont composées ; et à chaque membrecorrespond une question propre. N’allons pas croire qu’il est demandé sil’une de toutes ces choses vaut : A ou B ou C. De cela, je peux d’avanceêtre convaincu. Cela n’est donc absolument pas en question, et pourtantje demande : « A est-il, ou bien B est-il, etc. ? », ou encore, de façon indé-terminée : « Lequel d’entre eux est ? » Notons en passant qu’une diffé-rence se manifeste ici par rapport au jugement disjonctif : ou bien A est,ou bien B est. Ce jugement, en effet, n’est pas composé, tandis que laquestion disjonctive est toujours (au sens ci-dessus défini) composée. Enrevanche, il n’y aurait aucune question composée au sens défini, si nousdevions considérer la modalisation de forme hypothétique : si A est,B serait-il ?
En même temps, il faut néanmoins ici remarquer partout que leconcept de question composée, tout comme le concept de jugementcomposé, peut être pris de façon plus large, de telle sorte qu’on n’affectepas le concept de composition à la croyance non modalisée, à l’être-certain, et qu’ainsi parallèlement, il ne se rapporte pas au questionner tout
202 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[117]
20254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
court au sens courant du terme, c’est-à-dire au questionner non modalisé,mais qu’on y comprenne également toutes les modalisations. Alors unjugement disjonctif serait composé (à savoir, doxiquement composé), demême le phénomène du questionner sous une hypothèse serait composéd’une supposition et d’une question modalisée, etc.
Si nous considérons à présent, pour revenir à notre point de départ,des questions disjonctives, donc des questions de la forme « A est-il, oubien B est-il ? », celles-ci présupposent manifestement, à titre de soubas-sement, le doute entre A et B. Elles vont cependant plus loin que le douteet apportent quelque chose de nouveau, sous la forme de l’intentiontournée vers une réponse ; donc le questionner spécifique apparaîtcomme quelque chose de nouveau. Cette intention ne signifie pas lemoins du monde une attente d’une certitude qui opte pour l’un des mem-bres du doute ; car il n’est nullement nécessaire qu’une telle attente soitprésente. Il est tout aussi peu juste de chercher le questionner spécifiquedans un souhait dirigé sur une telle certitude, bien que, très souvent, unsouhait de réponse se mêle intimement à la question. Dans le cas habitueldes interrogations adressées à d’autres personnes, nous trouvons, fusion-nés en un, attente et souhait, si ce n’est carrément [attente et] ordre. Maisce sont, précisément, des complications. Et surtout nous n’avons pasbesoin (aussi forte que soit la tentation) de faire entrer le souhait dans leconcept de la question (bien que cela se produise habituellement). Ledouter avec le souhait d’une certitude, rapportés à l’une des possibilitésdisjonctives, ne forment pas une question demandant qui, de A ou B, est.Il y a là une tendance intentionnelle caractéristique que nous devons iso-ler et désigner comme l’essence spécifique de la question. C’est en elleseulement que se constitue pour la conscience l’en-question en tant quetel, que nous devons considérer comme une modalisation de l’être toutcourt, tout comme le questionner constitue une modalisation du croire. Sile spécifique de la question est donné, d’autres actes peuvent alors s’yentrelacer, et c’est ainsi que nous appréhendons déjà, par exemple, laquestion-de-souhait comme une complication par rapport à la questionpure et simple.
À regarder les choses de façon plus précise, on devra dire, en outre,que la fondation [Fundierung] du questionner dans le douter, explicitement
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 203
[118]
20354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
et proprement entendue, ne se présente précisément que dans les cas duquestionner explicitement effectué : aussi le douter doit-il d’abord êtreeffectué, et c’est ensuite qu’entre en jeu l’intention questionnante, qui estd’un type nouveau et qui fait subir au douter une modification caractéris-tique, de sorte qu’il ne continue nullement à exister sous la forme qui étaitla sienne sans la question.
À une question peut éventuellement se rattacher le processus quidétend l’intention questionnante et la remplit en un certain sens, et qui setermine par la réponse. La croyance qui, dans ce contexte, entre en jeucomme réponse est caractérisée de façon particulière. Ce qui se présentelà, ce n’est pas simplement un passage du doute, ou de l’impression[Anmutung], à une certitude, mais un remplissement de l’intention ques-tionnante dans la croyance, et c’est cela qui la caractérise comme réponse.Si nous nous en tenons à des questions disjonctives, le processus deréponse prend alors la forme de la réflexion disjonctive, voire de l’exa-men disjonctif de raisons. C’est un cas tout à fait spécial que celui del’examen rationnel, qui est éclairé par l’évidence, par cette clarté danslaquelle les raisons et les enchaînements de justifications parviennent àune donation parfaite, grâce à quoi la réponse s’atteste comme réponserationnelle.
Naturellement, nous n’avons entrepris toute cette considération quedans le dessein de montrer que l’essentiel de sa teneur se laisse transposerau domaine de la volonté. L’analogon du doute doxique, disions-nous, estle doute de la volonté, et la « question-de-volonté » (si nous voulonsemployer l’expression analogique) est à celui-ci ce que la questiondoxique est au doute doxique. La question de volonté disjonctive s’ex-prime en ces termes : « Dois-je ceci ou bien cela ? », la question à unmembre devient : « Dois-je cela ? » Il est vrai que cette proposition inter-rogative exprime aussi en même temps et avant tout une questiondoxique, mais il n’en va pas autrement en général des énoncés sur desévaluations et des valeurs, sur des volitions et des devoir-être, qui sontprécisément d’abord des « énoncés » [Aussagen], c’est-à-dire des événe-ments doxiques. Tous les événements de la sphère affective et volitivesont précisément des objets possibles de l’appréhension, de la prédicationthéorétiques, de la question théorétique, etc. Mais ce qui importe, ce sont
204 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[119]
20454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ces analoga des événements spécifiquement doxiques qui interviennentavant tout énoncé dans la sphère affective et spécialement dans la sphèrede la volonté. Ce que l’accomplissement d’actes doxiques présuppose, lecas échéant, comme structures et, d’un autre côté, ce qu’il introduit denouveau, c’est là un thème d’analyses spécifiques et difficiles.
<c) Les analogies entre réfléchir, décider et conjecturerdans les domaines théorique et pratique>
Par notre analyse et les divisions données à l’instant, nous avonsmanifestement préparé l’analyse des phénomènes que nous avons l’habi-tude, conformément à l’expression courante, de nommer phénomènes duchoix ou encore de la réflexion pratique. Une réflexion pratique n’est riend’autre que l’accomplissement d’une question-de-volonté, mais elle ne s’ylimite pas, elle inclut aussi, à sa suite, l’accomplissement de ces modifica-tions et complétions de l’acte questionnant qui se trouvent sur le cheminde la décision de la question, donc [l’accomplissement] de processus duremplissement de l’intention questionnante : ceux-ci conduisent, dans lescas favorables, au terminus ad quem du processus de remplissement, c’est-à-dire à la réponse de volonté accomplie. Mais cela n’est ici rien d’autre que ceque nous avons l’habitude de nommer la décision pratique, l’acquiescerpratique et, dans le cas des questions disjonctives, le choix. Le mot estcertes équivoque. Il désigne tantôt la conclusion du processus, donc laréponse pratique à la question pratique disjonctive ; comme lorsque, lorsd’un achat, nous disons : je choisis ce vêtement, c’est sur lui que monchoix s’est arrêté. « Choix », cela désigne également le processus entier dela réflexion, le cas échéant avec la conclusion dans la décision de choix enacte [in der aktuellen Wahlentscheidung]. L’acheteur choisit, dit-on, mais iln’est pas encore décidé. Mais on dit aussi, de façon équivalente : il réflé-chit à ce qu’il devrait choisir. Dans la deuxième expression, le « choisir »est l’accomplissement de la décision conclusive, dans la première, il est leréfléchir lui-même qui est dirigé sur la conclusion ; mais, de surcroît, leréfléchir incluant la conclusion peut, comme il a été dit, être désigné par« choisir ». Cela est manifeste : nous avons les analoga exacts dans le réflé-chir ou l’examiner théorétiques, dont l’issue est également une question.
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 205
[120]
20554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Et il va de soi que l’analyse entière vaut pour toutes les espèces d’actes,car partout nous trouvons les analoga des questions, des réflexions, desréponses, qui, en outre, peuvent partout être positives ou négatives.
Pour être complet, il faut ici considérer encore un point. La décisionen faveur du membre A de la disjonction donne une réponse positive.Or, par essence, [il] lui appartient la possibilité d’envisager l’un quel-conque des autres membres de la disjonction, ceux-ci étant caractériséscomme à refuser – à refuser théorétiquement dans la question théoré-tique, à refuser pratiquement dans la question pratique, et ainsi de suitepartout ailleurs.
Les relations dans tous les domaines parallèles possèdent cependantencore leurs délicates complications. Dans la sphère doxique, la réflexion,éventuellement comme réflexion rationnelle menant à un approfondisse-ment continu des raisons qui viennent à être données [zur Gegebenheit kom-menden Gründe], conduit à différentes conclusions possibles ; pour la ques-tion « est-ce A, ou B, ou C qui est ? », la décision peut être : c’est A ! L’êtrede A se présente peut-être dans une démonstration évidente [einsichtigen],voire dans une fondation d’expérience parfaitement motivée. Il peut aussise faire, naturellement, que dans la réflexion [il] s’avère d’abord queC n’est pas, que B n’est pas, et que dès lors, en vertu de la conviction quidomine souvent implicitement la question disjonctive, celle que « de Aou B ou C..., l’un est », l’on en vienne à décider que A est.
Mais il peut aussi en aller tout autrement. Dans la réflexion, je ne par-viens à être certain d’aucun membre, et pourtant j’en viens à une décision.Les « raisons » pour A, B ou C ont un poids différent, et le poids en faveurde A l’emporte sur celui des membres restants. Je prends pour ainsi direparti pour lui. Si je me plonge dans les impressions [Anmutungen] et dans cequi parle en faveur de A, en faveur de B, en faveur de C, si j’explicite, noéti-quement parlant, les motivations, alors se présentent des différences plusou moins claires entre les poids ; la réflexion prend la forme d’un « exa-men ». Par exemple, dans la sphère de l’expérience, j’examine les possibili-tés, ou si l’on préfère, je prends garde [ich sehe zu] aux raisons empiriquesqui parlent en faveur de l’une ou de l’autre, et je les pèse. D’aucun côté, jen’arrive à la certitude, et cependant, d’une certaine façon, je me décide. Ladécision ne déclare pas ici « A est tout simplement » – car je n’en suis pas
206 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[121]
20654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
certain –, mais « A est probablement ». Il y a là une préférence que nousnommons un décider conjecturant [vermutendes Entscheiden]. Tout conjectu-rer est un se-décider dans un examen, et ce en faveur de quoi la décision aopté a ici le caractère du « probable ». L’examen peut en outre être évidentou non évident, les raisons de conjecture, les poids des possibilités restentdans l’obscurité, dans le vague ; telles possibilités donnent l’impressionvague d’être « meilleures », d’être telles que quelque chose de plus sembleparler en leur faveur, sans que cela soit clairement explicite.
Dans certains domaines où les poids respectifs de ce que l’on appelleraisons de probabilité peuvent être traités comme des grandeurs, il y a despossibilités évidentes de mesurer quantitativement et de déterminer lagrandeur de la probabilité ou, si l’on veut, [des possibilités] pour lamesure du poids relatif du probable face aux cas improbables. C’est làque s’enracine la théorie mathématique de la probabilité. À ce propos, ilfaut remarquer, comme un fait fondé dans l’essence phénoménologiquedes états de choses, que le réfléchir et l’examiner s’accomplissent dansune conscience d’impression et de préférence, donc dans les modalités dela conscience doxique, mais que c’est sur la base de ces actes que doivents’effectuer des jugements au sens prégnant, des jugements sur des proba-bilités, sur des valeurs de grandeur des probabilités, etc.
Si nous passons à présent au domaine de la volonté, au domaine des actespratiques, la décision dans une réflexion pratique peut se dérouler defaçon correspondante. Dans un premier temps, l’examen (qui, ici nonplus, n’est pas nécessairement un examen rationnel, mais peut l’être) nousconduit, dans une disjonction exclusive entre A et B et C, à simplementrefuser B et C pratiquement. La volonté énonce en quelque sorte son nonpratique, peut-être à partir de motifs rationnels de la volonté (des raisonsde volonté) ; il apparaît avec évidence que B et C sont des non-valeurs,mais que A est une valeur. Nous nous décidons en sa faveur. Cependant,une évidence rationnelle [Vernunfteinsicht] n’est pas nécessaire, il suffitd’un tenir-pour-valable ou d’un tenir-pour-non-valable. En tout cas : ladécision est un vouloir décidé, positif ou négatif.
Mais il peut aussi se faire qu’un analogon de la conjecture entre ici en jeu àtitre de décision. C’est un peu comme si, lors de l’examen en vue d’unachat, nous avions déjà accompli toutes les décisions négatives, dans la
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 207
[122]
20754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
mesure où certaines marchandises ont été écartées du choix, commen’ayant manifestement pas la valeur requise. Reste le choix entre A ou B.Peut-être sommes-nous d’avance déjà décidés en général à acheter iciquelque chose et donc à choisir, c’est-à-dire à acheter, l’un des deux. Laquestion de volonté est à présent : lequel ? Dans l’examen de valeur, nonseulement chacun donne l’impression d’être une valeur, mais maintes rai-sons de valeur confèrent une plus grande valeur à l’un, maintes autres, àl’autre. Tout bien considéré, la valeur de l’un des objets semble être plusélevée que celle de l’autre ; elle n’est supérieure à l’autre que par conjecture.En conséquence, nous lui donnons parfois une préférence pratiquedécidée, en dépit de la fondation imparfaite – tout comme, lors d’un exa-men théorétique d’être, il nous arrive, en dépit de l’imperfection de lapréférence théorétique, de nous décider, dans le croire judicatif, en faveurde l’une des parties. Nous jugeons « c’est ainsi », mais sans avoir bonneconscience au plan logique. Souvent, pourtant, nous sommes plusscrupuleux et ne jugeons pas que « c’est ainsi », mais nous nous rangeonsde ce côté seulement en conjecturant, et nous jugeons alors simplement :« C’est là ce qui est probable. » De même dans la sphère pratique. Parfoisnous n’allons pas jusqu’à la décision assertorique, au décider : « C’estcela que j’achète. » Mais, à la place, entre déjà en jeu une modalité dela volonté qui s’exprime judicativement en ces termes : cette marchandisesemble être pratiquement préférable ; c’est probablement elle que j’auraià choisir. Le jugement qui doit être énoncé ici sur la base de la situationspécifique du choix présuppose, dans la sphère de l’évaluer et du vouloir,des modalités de préférence, ainsi que des prises de positions modaliséesen faveur de l’une des parties qui sont les analoga des prises de positionconjecturantes et qui, dans le comportement judicatif, se transfor-ment elles-mêmes, sur la base de ces mêmes prises de position, en conjec-tures doxiques ou encore en énoncés de probabilité. Comment celacontinue ensuite – si cela en vient, pour finir, à une décision effectivedans laquelle je choisis, et surtout, si des lois rationnelles objectivementvalides, exigeant une décision, ont cours ici –, c’est là un problème à partentière.
Mais il faut encore remarquer que, par ce type de prise de positionpréférentielle, la question théorétique et la question de volonté reçoivent
208 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[123]
20854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:43
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
respectivement, en un certain sens, leur réponse, et pourtant une réponseimparfaite ; et c’est pourquoi elles peuvent subsister encore comme ques-tion, et cela de façon rationnelle. Si je me suis décidé purement et simple-ment pour oui ou non, alors la chose en question pour moi n’est plus enquestion et, rationnellement, je ne peux plus questionner là où je me suisdécidé ainsi. Là où je sais déjà, je ne puis interroger. On ne doit pas ici selaisser induire en erreur par la confusion entre questions authentiques etquestions apparentes. Des questions comme celles que le professeur poseà l’élève, l’examinateur au candidat, sont des questions apparentes et, entous cas, ce ne sont pas des questions relevant véritablement des conte-nus qu’on leur attribue à tort. La question authentique dans un examenne demande pas, par exemple : qu’entendait Platon par Idée ?, mais : que savez-vous au sujet de ce que Platon entendait par Idée ?, etc.
Croire de façon certaine que A est, exclut de demander si A est, toutcomme cela exclut les autres modalités parallèles, par exemple, douter siA est, etc. Dans l’unité d’une conscience, la modalité peut certes se chan-ger en doxa certaine, mais elle subit alors, précisément à cause de cela, uneconversion de valeur. Pour revenir à notre réflexion : il est clair qu’unsimple conjecturer que A est, peut certes se présenter comme réponse à laquestion, mais de telle sorte qu’il se présente alors comme une réponseinsuffisante qui permet tout à fait de réitérer la question. Je sais certes queA est probablement, mais je pose de nouveau la question : est-il réelle-ment ? Et il en va exactement de même dans la sphère de la volonté : c’estpourquoi, lorsque je voudrais bien acheter, je n’en ai pas terminé avec ladécision pratique par conjecture, mais je pose à nouveau la question pra-tique : dois-je à présent acheter cela ? Et l’examen peut se poursuivre.Mais ce n’est pas une possibilité seulement realiter, c’est également unepossibilité rationnelle.
Cette investigation nous a donc procuré une certaine évidence de l’es-sence du choix ou encore de la réflexion pratique, et cela par la mise enparallèle avec la question et la réflexion théorétiques, qui sont elles-mêmes devenues claires du même coup. En même temps, lors de l’appro-fondissement de telles relations, nous découvrons des relations d’essenceet, parmi celles-ci, des lois de la raison qui commandent aussi bien lequestionner théorétique que le questionner pratique, le réfléchir et le se-
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 209
20954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
décider en choisissant [das Sich-wählend-Entscheiden], et leurs modalités.Toutes ces lois devraient naturellement être explorées systématiquement,formulées et exposées dans un ordre plus correct.
<d) Affirmation et négation dans les domainesde la croyance et de la volonté>
Outre celles dont nous avons discuté de façon plus précise, il y auraitencore bien d’autres modalisations du vouloir au sens restreint – du vou-loir originaire en tant qu’acte auquel tous les autres actes renvoient essen-tiellement – à soumettre à une analyse plus approfondie. Nous ne vou-lons plus avancer que dans une seule direction, et examiner de plus prèsune forme fondamentale, à savoir la négativité de la volonté, qui se situepar rapport au phénomène originaire de la position de volonté positived’une façon analogue à celle dont la non-croyance, dans le domainedoxique, se situe par rapport à la croyance positive. Je m’empresse d’ajou-ter un autre parallèle : à côté du phénomène originaire de la croyancepositive, nous avons, dans la sphère doxique, la modalité de la croyanceaffirmative au sens propre ; à côté du jugement positif « c’est ainsi », lejugement affirmatif « oui, c’est ainsi » ; de sorte que trois formes se pré-sentent ici : la forme non modalisée ( « c’est ainsi » ), d’une part, et d’autrepart la forme affirmative ainsi que la forme négative ( « non, ce n’est pasainsi » ).
La même chose vaut pour le domaine de la volonté. À côté du « jeveux » simplement positif, nous avons le « oui, je veux » et le « non, je neveux pas ». L’ancienne logique n’avait en effet pas su reconnaître que lanégation et l’affirmation sont des phénomènes certes coordonnés, maisqui s’opposent à la croyance originaire, et que ce sont des modalisations.Elle ne range sous le titre de « qualité », en règle générale, que les deux for-mes prétendument coordonnées, l’affirmation et la négation, et confondce faisant position et affirmation. Mais il faut voir que la conscience du« cela n’est pas » exprime, non seulement verbalement, mais aussi phéno-ménologiquement, un refus qui renvoie de lui-même à un « cela est », doncà une position, certes non accomplie effectivement, laquelle à son tour necomporte plus de rétro-référence dans sa structure. Et la même chose vaut
210 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[124]
21054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
pour l’affirmation proprement dite, pour l’acquiescer à proprement parler.De même que la négation biffe, pour ainsi dire, de même l’affirmation sou-ligne et possède, de la sorte, une structure intentionnelle plus complexe,du type qui caractérise précisément toutes les modalisations. À présent,nous nous rendons compte de ce même état de choses quant à la négationde volonté et à l’affirmation de volonté. Le refus volontaire du « je ne veuxpas » implique une disposition de volonté [Willenszumutung] positive ; il estun biffer volontaire d’un « je veux » non accompli, mais qui se manifeste[sich anmutenden] cependant. Par l’expression « n’être pas disposé à » [unwil-lig sein], il nous arrive de désigner cette négativité, mais l’expression estéquivoque, car la non-volonté et le « n’être pas disposé à » désignent trèssouvent le phénomène de l’indignation.
Un cas spécial de refus de volonté est l’omission [Unterlassung], ordi-nairement entendue comme le contraire du faire et comme une négationdu faire, i.e. ici d’une volonté antérieure, voire [comme une négation] duparachèvement d’une action. Nous avons, par exemple, déjà conçu lavolonté de faire un voyage et entrepris des préparatifs à cet effet ; maispar la suite, au lieu de se maintenir et d’être convertie en une pleineaction, la volonté en vient plutôt à être biffée : nous « omettons » levoyage.
Naturellement, omettre et, en général, vouloir négativement, bienqu’exprimé souvent par les mots « je ne veux pas », ne veut pas dire lamême chose que n’accomplir aucun vouloir, au sens de la privation.Certes, en éthique, la privation, le ne-pas-vouloir en ce sens du « n’ac-complir aucune volonté du tout », là où éthiquement une volonté seraitexigée, joue souvent un rôle semblable au ne-pas-vouloir au sens del’omettre, mais je ne rangerais pas dans l’éthique formelle les légalités quis’y rapportent. En tout cas, je n’en traiterai pas.
Dans le contexte des négations de volonté, il faut encore mentionnerce qui suit. Un simple vouloir se rapporte à un réaliser, par conséquent àun advenir [Sein-Werden], et précisément à un advenir volontaire, et non,par conséquent, à quelque chose qui est déjà. Mais il y a aussi un vouloird’un déjà-réalisé ; or, c’est là un vouloir qui passe médiatement par desnégations. Si je récuse une disposition de la volonté [Willenszumutung]disant que quelque chose doive arriver, alors cette volonté négative doit
SECTION III. PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA VOLONTÉ 211
[125]
21154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
être convertie essentiellement en une volonté positive, c’est-à-dire dansl’affirmation de volonté que la chose reste telle qu’elle est. La volontéd’un déjà-réalisé n’est possible que sous cette forme, précisément dans lepassage par le refus d’un changement.
Il faut considérer en outre les actes itérés [iterierte]. Je peux vouloirun A, je peux ensuite vouloir le vouloir de A, etc. De même : je peuxomettre A, je peux vouloir l’omission de A ou bien encore omettre cetteomission, etc.
212 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
21254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<SECTION IVPRATIQUE FORMELLE>
<§ 18. Les lois rationnelles s’appliquant aux modalitésde la volonté et à leurs corrélats>
<a) Les lois relatives à la fondation d’acte et à l’itération d’acte>
Pour toutes les modalités des actes et pour les corrélats qui se consti-tuent avec eux, on obtient des lois rationnelles, et la tâche est donc, d’unepart, d’inventorier systématiquement, dans une morphologie, toutes lesmodalités primitives ainsi que celles qui sont obtenues par complicationet itération, et ensuite, <d’autre part,> en suivant étape par étape cesconstructions de formes, d’établir les lois rationnelles correspondantes,les lois axiomatiques comme les lois dérivées. C’est là une tâche pénible,requérant beaucoup de soin et de patience. Mais après qu’elle a été com-prise clairement comme tâche et que des réalisations exemplaires en ontdéjà été proposées dans la sphère purement logique, la résolution de cettetâche et le développement effectif de la pratique formelle ne constitue-ront qu’une difficulté de moindre degré.
Beaucoup de lois à établir systématiquement pour la sphère de lavolonté sont des cas particuliers de lois générales qui s’étendent à tous lesgenres de prises de position et à leurs corrélats. C’est par exemple le cas
[126]
21354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
de la proposition : « Si le vouloir positif est juste, alors le vouloir négatifcorrespondant (l’omission correspondante) est injuste, ou encore, si ladécision ou l’action ont un statut légitime [rechtmäßigen Bestand], alors lanon-décision, l’abstention de l’action (le négatif du faire [Negat der Tat] enquelque sorte) n’a aucune légitimité [Rechtmäßigkeit]. » Ces propositionssont des cas particuliers de la proposition universelle valant pour tous lesgenres de thèses, selon laquelle, si une thèse est juste, alors l’antithèse cor-respondante est erronée et inversement. Nous avons déjà parlé de ceprincipe précédemment.
En outre, est également de nature universelle une proposition relativeaux thèses fondées : de même que des conjectures sont habituellementfondées sur des certitudes, ou de même que des évaluations peuvent êtrefondées sur des certitudes ou des probabilités, <de même> des volitionsà leur tour sont fondées sur des thèses doxiques et en même temps surdes thèses relevant de la sphère des évaluations. Des thèses fondées n’ontpas simplement leur validité en général et au sens où elles ont leur véritéou non-vérité doxique, axiologique, pratique, mais en outre elles se« règlent » sur leurs thèses-fondements [Fundament-Thesen]. Cela veut dire,par exemple à propos de la joie [que donne] l’existence d’un fait, que nonseulement, phénoménologiquement parlant, la qualité de joie ne peut seprésenter sans que la matière de la joie soit doxiquement qualifiée d’unecertaine manière, mais que le présumer [Vermeinen] de l’être-réjouissant[Erfreulichkeit], en tant que « présumer », présuppose une certaine convic-tion d’être, et c’est là une relation particulière des qualités. Le tenir-pour-réjouissant se règle sur la croyance en l’être et l’inclut en soi d’une certainefaçon. Et là où ce « se régler » (qui est une sorte de modification) a lieu,vaut la loi d’après laquelle l’acte entier est, pour ainsi dire, faux si le sou-bassement est faux, le se-réjouir est erroné si la conviction sous-jacenteest erronée – non pas erronée à tout point de vue, mais précisémentcompte tenu de cette présupposition.
Pour la sphère de la volonté, il faut tenir compte tout particulièrementdu fait que le vouloir (corrélativement, la proposition-de-volonté, le des-sein), se fonde et se règle, d’une part, sur des présuppositions doxiques,d’autre part, dans une mesure encore plus stricte et plus insigne, sur desprésuppositions axiologiques. Je dis : dans une mesure plus insigne, car il
214 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[127]
21454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
s’en faut de beaucoup qu’une joie soit juste pour cette seule raison queses soubassements doxiques sont justes, et de même, une volonté. Enrevanche, la justesse de la volonté (ou encore du dessein) est déjà pré-tracée par la justesse de l’évaluation qui est présupposée en elle. Le vou-loir juste se règle, pour ainsi dire, sur la justesse de l’évaluer. À cela cor-respond également la loi suivante : le dessein qui se propose un bien pos-sède (considéré en soi et pour soi) sa justesse. Et comme tout acte justeen tant que juste est lui-même un bien axiologique (selon une loi axiolo-gique universelle), on peut également dire qu’un projeter [Vorsetzen] et unfaire qui porte sur un bien est en lui-même bon, d’un point de vue axiolo-gique ; qu’un vouloir de ce qui est bon est bon, de même un vouloir de cequi est mauvais est mauvais, et un vouloir de quelque chose d’indifférent,indifférent.
On voit ici également – et cela exigerait une fixation terminologiqueparticulière – que la fausseté qui affecte le dessein dirigé sur quelquechose qui en vérité n’est pas bon, mais mauvais, est une fausseté toutautre et plus radicale que celle qui résulte du fait qu’il est dans l’erreur auregard de ses présuppositions doxiques, qu’il veut par exemple quelquechose qui n’est pas réalisable, alors même que cela était peut-être tenupour réalisable. Naturellement, il reste à formuler les principes inversescorrespondants pour l’omission.
Je mentionne également, comme quelque chose de remarquable,quelques-uns des axiomes relatifs aux actes itérés et à leurs corrélats. Onpeut, disions-nous, au lieu de simplement vouloir A, vouloir aussi le vou-loir de A, etc., au lieu d’omettre A, omettre l’omission de A, etc. Il y a làdes implications aprioriques, des implications au sens de la raison. On nepeut pas vouloir le vouloir de A et ne pas vouloir A tout court. Ce seraitune contradiction dans l’ordre de la volonté. Un dessein positif, dirigé surun dessein positif, implique donc ce dessein comme tel. En outre, vaut àl’évidence aussi l’axiome suivant : l’omission d’une omission de Aimplique le faire de A. On peut exprimer également cet axiome commesuit : si l’omission d’une omission est juste, alors le faire est juste.
Ce sont là des propositions qui n’ont pas d’équivalents stricts dans ledomaine doxique. Je peux aussi croire en la croyance. Mais si la croyanceque je crois A est juste, la croyance en A n’en est pas pour autant juste.
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 215
[128]
21554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Certes, si le consentement à une croyance, donc si une approbation estjuste, alors la simple croyance est juste, et si celle-ci est juste, alors leconsentement à cette croyance l’est lui aussi. Mais l’analogue de ce prin-cipe dans le domaine de la volonté énonce : si le consentement volontaireest juste, alors la simple volonté est juste, et inversement. Consentir à unevolonté ne revient pas à vouloir la volonté. Cette dernière expressionsignifie plutôt : je veux le fait que je veuille, et il faut ici prendre garde aufait que la locution de vouloir d’un vouloir se réfère à un seul et mêmemoi, au sens de l’interprétation qui vient d’être donnée.
On devrait ici aussi réfléchir à la manière dont cela se passe avec le« j’évalue le fait que j’évalue ». Il faudrait dire alors ceci : si un évaluer serapporte à un évaluer, et qu’il est juste, intrinsèquement juste, alors l’éva-luer direct est également juste. Si ce dernier est intrinsèquement juste,alors l’évaluer qui s’y rapporte est également juste. Mais c’est là quelquechose qui vaut universellement et non pas simplement à l’intérieur demon moi. Il faut, du reste, bien méditer ces choses ; elles comportentleurs embûches. Je ne m’y engagerai pas plus avant.
Il faudrait ensuite considérer aussi les modalités complexes, parexemple les modalités conjonctive et disjonctive. Si la volonté conjoncti-vement dirigée sur (A et B) est juste, alors chacune des volontés singulièrescorrespondantes est juste. Si l’omission conjonctivement dirigée sur(A et B) est juste, alors à son tour, chacune des omissions singulières cor-respondantes est juste. Si, en revanche, il est injuste d’omettre les deuxensemble, alors au moins l’un des deux doit être pratiquement bon. S’il estdisjonctivement juste de faire A ou B, ou plus clairement, de faire n’im-porte lequel de A et B, alors l’un des deux peut être mauvais ; ou encore, ilest alors injuste de ne faire aucun des deux. S’il est injuste d’omettre n’im-porte lequel de A et B, alors il est juste de faire l’un des deux, etc. Naturel-lement, l’analogon de l’ « axiome de contradiction » joue ici partout son rôledans la dérivation des propositions : il est impossible que la même chosesoit pratiquement juste en tant qu’à-vouloir positivement et qu’elle soitpratiquement juste en tant qu’à-omettre ; et si le positivement voulu est unà-omettre, alors c’est le négativement voulu qui est un à-vouloir positive-ment, etc. Naturellement, on devrait ici, tout comme dans le calcullogique, procéder de façon rigoureusement systématique et même de
216 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[129]
21654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
façon bien plus systématique encore ; on devrait distinguer exactementtoutes les modalités de la volonté, et les faire fructifier pour l’obtention delois, en procédant par déduction, à partir des axiomes primitifs, ferme-ment établis, au moyen de démonstrations rigoureuses et ordonnées.
<b) Les lois de volonté du choix. La loi d’absorption.L’Idée du domaine pratique et le problème de l’impératif catégorique>
Nous en venons maintenant à un nouveau et important groupe delois de la sphère pratique, qui se rapportent aux préférences pratiques et àl’impératif catégorique. Au préalable, nous posons une loi plus générale.Nous avons parlé du « se-fonder » caractéristique de prises de positionsur des prises de position, de thèses sur des thèses, et entre autres, du« se-régler » particulier des prises de position axiologiques et pratiques surd’autres prises de positions de ce genre, par exemple des volitions sur desévaluations. Si nous prenons en considération à présent la différence depréférabilité, vaut alors la loi selon laquelle la préférabilité du côté de lafondation entraîne la préférabilité au sein des prises de position qui se« règlent » sur elle. Si nous appelons le préférable le meilleur, vaut alors leprincipe suivant : si V1 > V2 dans une sphère quelconque, et que d(V1)et d(V2) sont des valeurs qui se règlent respectivement sur V1 et V2, alorson aura aussi d(V1) > d(V2). Par exemple, l’évaluer comme bon découlede l’évaluer comme beau1. Si quelque chose est beau, alors, sous ce rap-port, son existence est eo ipso un bien. Donc si V1 est une valeur de beautémeilleure que V2, alors l’existence de V1 est une valeur de bonté meilleureque V2. De même, si le souhait ou si la volonté qui avise la premièrevaleur de bonté est meilleure que celle qui avise la seconde, ou encore, siB1 > B2, alors FB1 > FB2, i.e. l’un est préférable à l’autre en tant que but dela volonté. En général, un bien considéré en soi et pour soi est donc éga-lement un meilleur but de la volonté qu’un mal ou qu’un adiaphoron.
Compte tenu de ce que la relation V1 > V2, ou encore la relation depréférence pensée de façon généralisée, n’implique pas que V1 et V2
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 217
[130]
1. Husserl emploie le symbole f pour Folge et, plus bas, Z pour Ziel. Nous transposons end pour « dérivée » et F pour « fin ». (N.d.A.)
21754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
soient des valeurs positives, puisqu’un moindre mal est « préférable » à unmal plus grand, il nous faudrait donc dire également qu’un moindre malest un meilleur but de volonté qu’un mal plus grand – le vouloir du malest certes en soi mauvais, mais le vouloir du mal moindre est moins mau-vais que le vouloir du plus grand mal ; de même un adiaphoron est meilleurqu’un mal en général.
Nous passons maintenant à des lois de la plus haute importance, leslois du choix volontaire. Une loi fondamentale [énonce] : soit un sujet quel-conque de la volonté placé dans un choix relatif à des possibilités prati-ques quelconques, parmi lesquelles figurent les valeurs positives V1 et V2.Si à présent V1 < V2, alors la décision pratique en faveur de V1 tout seuln’est pas simplement pire que la décision pratique en faveur de V2 toutseul, mais elle est intrinsèquement mauvaise ; la négligence du meilleur etla préférence pour le pire, toutes deux considérées ensemble, sont erro-nées ; et le choix doit donc être évalué comme mauvais.
Par conséquent, alors que vouloir ou faire un bien, considéré en soi-même, a un caractère de valeur positif, la loi enseigne que cette valeurnon seulement diminue, mais disparaît complètement, dès lors que lebien en tant que possibilité pratique entre en jeu dans le choix, à côté d’unmeilleur qui se voit simultanément négligé. Dans ce contexte, ce qui estvalable positivement considéré en soi-même devient non seulement devaleur moindre, mais même de valeur négative. Cette curieuse dévalorisa-tion s’exprime du reste, on ne peut mieux, dans l’équivoque verbale deslocutions telles que « moindre valeur » [ « minderwertig » ] qui ont pris, pré-cisément, eu égard à de tels contextes de choix, une signification en règlegénérale dépréciative [abschätzige].
On peut chercher à rendre compte de ce phénomène de la dévalua-tion du moindre bien par la négligence du meilleur de la façon suivante :un bien en soi auquel sont attachées des conséquences pour la plupartfâcheuses, sera par là même dévalorisé, il perd sa valeur. Si nous le consi-dérons en lui-même, il est et reste un bien, mais à cause de cet enchaîne-ment de conséquences, il devient le substrat de valeurs négatives dérivées,et celles-ci, par sommation, diminuent la valeur du bien et peuvent même,comme dans le cas supposé, l’emporter au point d’absorber toute sa posi-tivité. Il faut interpréter la situation qui nous occupe de la même façon :
218 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[131]
21854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
toute volonté de bien est, considérée en elle-même, bonne, de valeurpositive, [elle est] à sa façon et considérée en elle-même, juste. Mais dèsque cette volonté entre en jeu ou est envisagée dans le contexte d’unchoix – d’un choix qui, certes, suit le bien, mais néglige en même tempsun bien plus élevé, excluant celui-ci de la réalisation –, alors se joint à lavaleur de volonté positive appartenant au moindre bien, une non-valeurde la négligence du meilleur, qui, conformément à cette loi, l’emporte. Ils’agit donc d’une espèce d’effet de sommation.
On peut sans doute le comprendre ainsi. En tout cas, il y a ceci d’ori-ginal que la négligence d’un meilleur altère en toutes circonstances à telpoint la valeur positive de la préférence simultanée d’un bien, qu’ellecesse d’être positive. C’est en quelque sorte une force supprimée, sup-primée par une force antagoniste s’exerçant au même point d’application(sur le même moi et dans le même temps). La circonstance même quecette loi et des lois semblables qui lui sont parallèles existent, fait que tou-tes les lois qui se rapportent à des valeurs pratiques, à des « justesses »pratiques de volitions, de desseins, d’actions s’orientant d’après desvaleurs, mais sans prendre en considération le choix, s’accompagnenttoujours d’une phrase restrictive, de cette singulière locution de valeurs« considérées en elles-mêmes ». Il en va donc comme dans la mécaniquedes forces et dans la physique traitant des forces, où des lois de la forma-tion de résultantes ont pour effet que ce qui vaut pour des forces, abstrac-tion faite de nouvelles forces, reçoit sa modification aussitôt que de nou-velles forces, voire de nouvelles formes de forces entrent en jeu.
Allons plus loin : à bien y regarder, ce qui se trouve impliqué analyti-quement dans notre loi, c’est la présupposition que la réalisation de l’unedes possibilités pratiques et la non-réalisation de l’autre (de celle qui est lameilleure possibilité) sont compatibles l’une avec l’autre. Mais il pourraitaussi en aller autrement, si la réalisation de l’une entraîne d’elle-mêmecelle de l’autre. Se décider pour V1 signifie alors réaliser simultanément V2
par implication, et cela donne une valeur plus élevée qui unifie par som-mation V1 et V2.
En général, les lois de la dévalorisation pratique sont dépendantes deslois qui ont affaire à la dépendance d’existence de biens. Prenons parexemple les lois suivantes : tout comme dans le cas où, de par son exis-
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 219
[132]
21954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tence, un bien a pour conséquence un autre bien, la valeur de bon en soidu premier bien subit une augmentation du fait même qu’elle acquiert lavaleur d’un bien dérivé, de même une diminution de valeur correspon-dante se produit là où l’existence d’un bien empêche l’existence d’unautre bien ; et il y a dépréciation complète si son existence empêche l’exis-tence d’un bien relativement supérieur ; la valeur, positive en elle-même,sombre sous le point zéro. Si des biens ne s’entraînent ni ne s’entraventl’un l’autre dans l’existence, ils s’accroissent dans l’exister-ensemble sousla forme de la fondation d’une somme de biens.
De telles lois ont des conséquences dans la sphère pratique : car lavolonté vise la réalisation. Par exemple, si l’on se reporte aux axiomesprécédents, on obtient la conséquence que là où la réalisation volontaired’une moindre valeur empêcherait celle d’une valeur plus élevée qui, deson côté, se situe elle-même à portée de choix, la volonté et la réalisationde ce qui est de moindre valeur seraient non seulement quelque chose demoindre valeur, mais quelque chose de valeur négative. Si les deux possi-bilités pratiques étaient incompatibles du point de vue de la coexistence,alors la réalisation de la possibilité la meilleure empêcherait certes celle dumoindre bien et produirait, dans cette mesure, une non-valeur dérivée.Or, non seulement un résidu positif subsiste à cet égard par la réalisationde la meilleure possibilité, mais il s’y ajoute également la valeur du choixdu meilleur comme d’un moment qui, par lui-même, augmente la valeur.Il faudrait étudier à fond et précisément ces relations dans le cadre d’unethéorie systématique de la praxis ; les faire fructifier par des déductions.
La loi principale que nous avons énoncée pour [le choix] à deux mem-bres s’élargit évidemment en une loi [du choix] à plusieurs membres. Sin biens entrent en jeu dans un choix, en tant que possibilités pratiques, etcela de sorte que chacun d’entre eux puisse être choisi exclusivement,donc que chacune des autres possibilités puisse être en même tempsrejetée pratiquement ; et si ensuite l’un de ces n biens problématiques àchoisir est le meilleur, alors le choix de chacun des autres biens de la sérieest non seulement de moindre valeur, mais sans valeur tout court. Le choixest un choix erroné ou, comme nous pouvons également exprimer lachose, étant donné que tout délibérer en vue d’un choix est un questionne-ment : la question de volonté a trouvé une réponse de volonté fausse.
220 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[133]
22054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Il faut ici insister derechef sur le fait que nous n’avons pas encore ditque le choix du meilleur des n biens soit déjà le choix juste, pas plus quenous n’avons dit et énoncé comme conséquence de la loi que dans l’ac-complissement d’une comparaison de valeur deux à deux, tout membre demoindre valeur devrait être biffé. À quel point cela serait incorrect, on levoit immédiatement à partir de la considération supplémentaire suivante :les n biens étaient à réaliser ou à refuser de façon singulière, et chacun pou-vait être choisi en même temps que tous les autres étaient rejetés. Mais celane disait nullement si plusieurs ou tous les biens de la série ne seraient pascompatibles, donc s’ils ne pourraient pas être réalisés ou choisis ensemble.Si tel est le cas, ils déterminent alors, selon la loi de sommation, unesomme de biens, qui est elle-même à son tour un bien, et même un bienplus élevé que chacun des biens singuliers pris ensemble. Des relations,non seulement de sommation, mais de production conformément à nosprécédents développements, sont même éventuellement possibles. Dèslors donc que l’une de ces valeurs plus élevées entre dans le cercle de ceque le choix envisage, la réponse juste de la volonté se déplace ; ce quiauparavant était le meilleur est désormais, en tant que membre singulierd’une somme, un moindre bien, qu’il serait donc mauvais de choisir. Notreloi stipule constamment que le relativement meilleur [das Bessere] ou lemeilleur absolument [das Beste] l’emporte, mais toujours uniquement en cesens qu’il serait erroné de choisir un moindre bien, là où un meilleur est àportée de choix [im Wahlkreis liegt]. Par ailleurs, vous comprenez mainte-nant pourquoi il n’est pas dit que le meilleur de la disjonction à chaque foisen cause soit le bien pratique. Il est d’avance clair pour nous, en effet, quece n’est pas seulement sous la forme de l’implication possible d’unesomme de biens à dresser, mais aussi sous la forme de l’implication éven-tuellement possible d’autres possibilités pratiques, qu’on pourrait parvenirà un meilleur. Aussi longtemps que quelque chose de nouveau – à savoir,de nouveaux biens – doit entrer en ligne de compte dans le choix, nousn’avons manifestement aucune exigence pratique positive, bien que notreloi conserve sa validité pour tout cercle de choix quelle qu’en soit l’exten-sion. Nous voyons aussi qu’à cause de cela précisément, c’est-à-dire tantqu’un élargissement du cercle est possible, aucun des biens mis en réservene doit être effectivement biffé : il reste toujours en délibération.
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 221
[134]
22154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
Avant d’engager plus avant nos investigations dans cette direction,nous avons encore d’autres compléments à ajouter. Si nous n’avons àchoisir qu’entre des biens égaux, donc tels qu’aucun d’entre eux ne seraitobjectivement favorisé par rapport à un autre, ils sont alors aussi prati-quement de même valeur ; la décision de la volonté en faveur de l’und’eux n’est pas caractérisée comme mauvaise par opposition à celle quiest en faveur d’un autre. De même, il peut se faire qu’au sein d’un choixse trouvent placés côte à côte un groupe de biens de moindre valeur et ungroupe de biens qui les surpassent, mais qui entre eux sont d’égale valeur.Il n’y a pas alors de meilleur univoque pour ce choix, et la décision pourchacun des biens plus élevés mais équivalents est également juste – tou-jours dans le choix considéré. Nous avons un meilleur plurivoque.
Nous devons, en outre, prendre en compte l’apparition des maux etdes adiaphora. Tout décider ou vouloir dirigé sur une non-valeur est,considéré en lui-même, non juste. Donc un choix, une question devolonté qui porte exclusivement sur des non-valeurs, fournit la réponseque toute décision de choix [Wahlentscheidung] qui conclut ici positivementest non juste. Ce qui signifie aussi que les omettre tous est juste, sans quese pose davantage la question de ce qui est plus ou moins mauvais1. Si desbiens apparaissent également à côté de maux, les maux sont alors à élimi-ner quelles que soient les circonstances, et il ne faut pas davantage lesprendre en compte en tant qu’éventuels membres d’une somme.
Il me faut en outre mentionner encore les adiaphora, qu’il faut manifes-tement considérer, dans le cadre de tout choix, comme des nullités, et celaau sens de notre loi qui n’a toujours en vue qu’une question de volonté, àsavoir : est-ce que ceci ou cela qui se présente dans le choix est à réaliserseul, sans les membres concurrents ? Il va de soi qu’il serait erroné de réali-ser un adiaphoron, là où un bien serait réalisable. Si aucun bien n’est à réali-ser, mais seulement un mal ou de quelconques adiaphora, alors toutevolonté dirigée sur un adiaphoron est en tout cas indifférente [gleichgültig].
Nous ajoutons ici quelques éclaircissements essentiels. Une volontédirigée sur une valeur positive, en tant que volonté se réglant sur quelque
222 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Sans doute avons-nous ici aussi des lois de la préférence : la décision en faveur dumoindre mal est elle-même moins mauvaise que celle en faveur du pire. (N.d.A.)
22254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:44
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
chose qui est doté de valeur positive, est elle-même « juste ». Cela exprimeune convenance [Konvenienz] particulière, qui doit elle-même être évaluéeaxiologiquement et qui est alors dotée de valeur positive, considérée enelle-même. Une volonté se dirigeant contre une valeur positive (donc reje-tant cette valeur) ou se dirigeant, en affirmation, sur une non-valeur estinjuste, est « inconvenante », et cette inconvenance, cette contradiction dela volonté contre la valeur positive est axiologiquement une non-valeur. Ilen va de même des relations de convenance d’une négation de volonté sedirigeant contre une non-valeur, et de l’inconvenance d’une affirmationde volonté se dirigeant sur une non-valeur.
Pour cela1 nous pouvons employer également d’autres expressions quidoivent ainsi recevoir leur définition. Nous appelons « exigée » [gefordert]une action envisagée, ou encore, nous appelons « objectivement exigé » ou« devant-être objectivement [sein-sollend] » un état de choses pris en consi-dération ou représenté en tant que possibilité pratique (c’est-à-dire unesituation pratique), lorsque la volonté dirigée sur lui serait convenante, et[nous l’appelons] « devant-ne-pas-être », « exigé négativement », en casd’inconvenance. L’exigence négative est en l’occurrence équivalente àl’exigence du refus [Ablehnung]. Naturellement, les expressions de« devoir » et d’ « exigence » sont des expressions métaphoriques, prove-nant de commandements, d’ordres, mais en réalité il n’est nullement ques-tion de cela ici. Nous devons nous en tenir rigoureusement à notre défini-tion. Dans le cas des adiaphora, l’inconvenance fait tout autant défaut que laconvenance ; il n’y a là ni devoir positif, ni devoir de non-être ou encoreexigence de refus. Celui qui choisit quelque chose d’indifférent – sous laprésupposition qu’aucun bien positif n’est impliqué [dans le choix] –n’entre en conflit avec aucun devoir, ne se comporte pas de façon incon-venante, ne procède donc pas incorrectement, mais il n’est pas non plus,au sens de la volonté, juste, convenant. Il ne fait rien qui soit dû [Gesolltes],mais c’est qu’il n’y a là aucun devoir. Mais il n’exerce pas de raison volitive[Willensvernunft], celle-ci ne porte précisément que sur de la « convenance ».
Dans les constatations ou dans les légalités établies jusqu’ici, nousnous sentons très à l’étroit. Si je me trouve dans un choix, si je pose la
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 223
1. « Non ! » ajouté après coup en marge de cet alinéa. (N.d.E.)
[135]
22354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
question de la volonté : dois-je A ou B, etc., alors dans le cadre de leurdisjonction le devoir pratique, compris objectivement, passe des valeursmoindres à la valeur la plus haute ; il sera complètement « absorbé » parcelle-ci. Vous vous convaincrez ainsi que le sens de la question disjonc-tive de volonté correspond exactement aux présuppositions de notre loi.À savoir : « Dois-je A, ou B, ou C ? », cela ne veut d’emblée dire riend’autre que « est-il juste de choisir A et en même temps ne pas choisir Bet C ? », et de même pour chacun des membres. Si l’on s’en tient stricte-ment au sens de cette question disjonctive de volonté, on peut alorsénoncer simplement la loi : Dans tout choix, le mieux [das Bessere] absorbe lebien, et le meilleur absolument [das Beste] absorbe toute autre chose appréciable pra-tiquement comme bonne en elle-même. Cette absorption ne produit cependantaucun devoir absolu, mais seulement, en général, un devoir relatif, ouencore, comme nous dirons mieux, aucun devoir tout court, mais seule-ment un devoir sous réserve [Vorbehalt]. Nous pouvons égalementreprendre des expressions kantiennes et dire : nous n’obtenons pas, de lasorte, un « impératif catégorique ».
Qu’est-ce qui définit un « impératif catégorique » ? Précisément, enfait, son incapacité à être absorbé. Mais savons-nous donc déjà d’avancequ’il y a pour le moi voulant, dans tous les cas, un devoir non absorbable,un meilleur que rien ne peut surpasser ? La seule chose que noussachions, c’est que, dans tout choix qui possède un champ pratique déli-mité de façon déterminée, comportant un nombre fini de membres, il y aun meilleur, à condition que s’y trouve (en général) un bien. Le meilleurest éventuellement plurivoque ; nous pouvons néanmoins nous enaccommoder. C’est un axiome que, parmi plusieurs optima égaux, il esterroné de n’en faire aucun, ou encore, qu’il est juste et pratiquement dûde choisir l’un d’entre eux, peu importe lequel, quoique de façon seule-ment relative.
Manifestement, la relativité, la validité sous réserve pour un choixquelconque réside en ceci qu’il lui manque une certaine validité ultime dela délimitation, tant que rien de plus précis n’est repéré à son sujet. Ce surquoi le sujet choisissant dirige sa question de volonté, et jusqu’où il étendla disjonction questionnante, est en effet quelque chose de contingent. Ilpeut éventuellement, dans le champ de la question, prendre en compte
224 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[136]
22454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
des possibilités toujours nouvelles, et à chaque élargissement du domainepratique, pour dire les choses généralement, l’optimum se modifiera. Enoutre, avec cet élargissement précisément, les membres absorbés dans lesniveaux antérieurs pourront acquérir éventuellement une nouvelle signifi-cation. Ce qui est le meilleur dans un choix et selon les limites de sondomaine pratique est ce qui est exigé pratiquement, mais seulement sousréserve, c’est-à-dire dans la mesure où après élargissement du domainepratique ne se trouve aucun meilleur qui l’absorbe. Pour ce dernier,cependant, la même chose vaut également. Il est clair que la possibilitéd’un impératif catégorique dépend en l’occurrence de ce que nous puis-sions découvrir un domaine pratique déterminé lui appartenant, unchamp d’exercice [Wirkungsfeld] pratique lui appartenant objectivement,qui soit objectivement clos et qui ne soit plus, de ce fait même, suscep-tible d’élargissement, et ce pour chaque moment [Zeitpunkt] auquel unequestion de volonté en général peut se poser au moi. Y a-t-il possible-ment quelque chose de tel pour des moi singuliers, ou cela existe-t-ila priori pour tout un chacun ? Notre considération, que nous pouvonsbien dire portée par des nécessités aprioriques et évidentes, nous aconduits au problème le plus central de l’éthique, au problème de l’impéra-tif catégorique.
<§ 19. L’idée de la parfaite justesse de volonté.L’ordre des disciplines éthiques>
Notre investigation formellement objective avait atteint son terme[Abschluß] dans la dernière leçon. Elle donnait une détermination pure-ment formelle de ce qui est exigé pour chaque sujet et pour chaque pointde temps de son agir. Nous nous représentons, assigné à chaque sujet, sonchamp d’action pratique idéalement complet, et ce, pour n’importe quelpoint de temps envisageable. Nous supposons en outre comme accordéque tout sujet idéalement possible qui possède en général un tel domained’action peut aussi y vouloir et y faire quelque chose de bon. Par suite, fairele meilleur parmi tous les biens accessibles, c’est ce qui est absolumentjuste et, par conséquent, ce qui est catégoriquement exigé. Ce qui est bon,
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 225
[137]
22554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
cela ne peut pas être décidé formaliter, pas davantage que ce qui est vrai nepeut l’être par la simple logique formelle, et l’on ne peut donc pas décidernon plus formaliter de ce qui est le meilleur objectivement et de ce qui estpratiquement exigé. Mais il n’en est pas moins vrai d’avance que quelquechose d’objectivement bon et meilleur est pré-tracé. Comme la vérité, lebien et le préférable excluent eux aussi toute relativité contingente ; end’autres termes, il n’y a pas d’anomie [Gesetzlosigkeit] qui placerait la teneurmatérielle de ce qui est à chaque fois bon ou meilleur dans une relationcontingente avec le sujet contingent de l’évaluer, du préférer, du vouloir.Comme la vérité est vérité objective sur la base de fondements de loisaprioriques, de même beauté, bonté, préférabilité, être-dû [Gesolltheit] pra-tique sont pré-tracés à partir de fondements de lois aprioriques. L’objecti-vité renvoie donc à des lois aprioriques, dans lesquelles la matière, le quiddéterminé, qui est à chaque fois évalué dans l’évaluation, est entrelacéconformément à sa spécification universelle d’essence. Même si ledomaine de volonté pratique de chaque sujet est différent de celui desautres – si, pour parler en général, ce ne sont pas des biens de même espècequi entrent dans chacun des domaines de ce type, et si, par conséquent, cequi est pratiquement meilleur est différent pour chacun de ces sujets –,tout sujet rationnel doit néanmoins reconnaître que, là où quelqu’unévalue à bon droit [quelque chose] comme bon de telle ou telle façon, tousceux qui prennent en considération la même matière devraient évaluer demême ; et de même tout sujet rationnel doit reconnaître que, si undomaine comporte tels ou tels biens en tant que possibilités pratiques,pour ce domaine le meilleur se trouve pré-tracé idealiter, et que le sujetconcerné par ce domaine est par conséquent lié par l’Idée et la loi.
C’est ainsi que nous faisons droit à la seule teneur pleinement valablede l’exigence kantienne d’une loi pratique et d’un impératif catégorique.Si quelqu’un, dans une situation donnée, agit de sorte qu’une généralisa-tion sous forme de loi soit impossible, il agit certainement de façonfausse. Mais cela ne signifie et ne doit signifier rien d’autre que le fait quela parfaite justesse de la volonté est une Idée qui s’édifie sur l’Idée dudomaine pratique, sur l’Idée du meilleur dans ce domaine, et que toutesces Idées fondatrices [fundierenden Ideen] ainsi que l’Idée fondée [fundierte]se tiennent sous des lois d’un idéal d’après lesquelles il est sûr que, si un
226 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[138]
22654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
sujet agit justement, tout autre sujet, si nous transformons son champpratique en celui du sujet agissant, devrait agir de même ; et cela se justifie[gründet] précisément en ce que ce sont exclusivement de pures lois d’es-sence qui prescrivent la justesse et qu’elles trouvent simplement uneapplication au cas singulier donné de fait et au sujet de fait.
Nous faisons droit ainsi également à la fiction convoquée par mainteséthiques historiques : celle du spectateur impartial. Nous agissons avecjustesse dès lors qu’un spectateur impartial quelconque, en se mettant ànotre place, devrait approuver notre action. Nous nous glissons nous-mêmes dans le rôle de spectateur impartial lorsque nous jugeons notrepropre agir du point de vue de sa justesse. Le spectateur impartial est iciun sujet fixant la valeur rationnellement, qui se convainc de ce que lesconvictions qui fondent l’agir sont justes, que les évaluations du bien sonteffectuées avec justesse, que ce que nous évaluons comme bon devrait eneffet, d’après son essence, donc généralement, et d’après des lois apriori-quement matérielles de la valeur, être évalué comme bon ; et que demême, dans l’essence des valeurs de biens, ce sont exactement telles pré-férences et aucune autre qui ont leur soutien légitime, que par là même lemeilleur est effectivement le meilleur. La différence entre les décisions (àsavoir, entre les décisions objectivement justes) de différents sujets agis-sants n’a donc et ne doit avoir ses fondements que dans [cette circons-tance] que la situation de fait, selon le cas, est différente ; les mêmes loisd’essence, matérielles et formelles, exigent bien sûr, selon le cas d’applica-tion, des décisions différentes, mais dans chaque cas, elles exigent unedécision déterminée.
La pratique formelle, la seule que nous ayons eue en vue, avec des loiscomme celles de la conséquence et celles du bien pratique suprême, ne seprononce eo ipso sur rien de matériel ; elle ne comporte rien de l’ordre devaleurs et de biens matériels déterminés, exactement comme la logiqueformelle ne dit rien d’objets déterminés, de leurs espèces et de leursgenres, d’un monde déterminé avec ses particularités empiriques, donc nefonde rien qui soit de l’ordre de vérités matérielles déterminées. Mais qu’ilpuisse y avoir ou qu’il y ait de telles vérités et que des vérités matériellessingulières soient, quant à leur matière, liées par des lois d’essence danslesquelles entrent les espèces et les genres de contenus matériels, c’est ce
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 227
[139]
22754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
qu’elle présuppose dans une universalité formelle, ou encore, c’est à quoise rapportent des axiomes propres, et il en va de même pour l’axiologie etla pratique formelles. S’il n’y avait aucun a priori matériel, si l’on ne pou-vait distinguer des espèces et des genres d’objets qui, de par leur essencegénérique, s’accompagnent a priori de prédicats de valeur, le concept devaleur objective ne s’appuierait sur rien et, par conséquent, l’Idée d’unpréférable objectivement pré-tracé n’aurait pas non plus d’ancrage, nil’Idée d’un meilleur. Une régulation formelle [formale Regelgebung] de l’éva-luer et du vouloir sous la présupposition que la matière de l’évaluer et duvouloir – donc la particularité de contenu [inhaltliche] des objets-valeurs etdes objets-de-volonté – pourrait être laissée hors concours, est une absur-dité. Sous ce rapport, notre chemin doit se séparer nettement de celui dela doctrine kantienne.
Nos considérations parallélistes, qui se sont avérées partout prati-cables, nous montrent que l’analogie du formel et du matériel dans lasphère pratique avec le formel et le matériel dans la sphère logique estparfaitement pertinente, et grâce à elle nous sommes prémunis contrel’erreur de vouloir, à partir de simples lois formelles et avec le seulsecours de l’impératif catégorique vide de contenu, pré-tracer danschaque cas singulier donné et matériellement déterminé, ce qui y est exigé[Geforderte] pratiquement, ce qui est dû [Gesollte] absolument. La logiqueformelle avec toutes ses lois ne nous met pas en état de dériver lamoindre vérité factuelle. Elle n’embrasse même pas toute vérité aprio-rique, mais précisément les seules vérités formelles. [S’il est vrai que] lalogique nous dit que toute proposition de matière contradictoire estfausse, elle ne peut néanmoins nous dire, pour aucun cas de propositionde matière déterminée matériellement [sic], si elle est contradictoire ounon. Si elle nous dit que telles ou telles formes d’inférence sont justes,que telles ou telles sont fausses, elle ne nous dit cependant pour aucuneinférence munie de termes matériellement déterminés, si elle est juste oufausse. Déjà l’application à ce qui est matériellement déterminé est un pasqui dépasse la logique, et a fortiori la fixation des vérités et des lois relevantde matières particulières en vertu de leurs spécifications particulières.
Il en va exactement de même pour l’axiologie et la pratique formelles.Dans le cercle de ce qui est accessible pratiquement, le mieux [das Bessere]
228 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[140]
22854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
est l’ennemi du bien ; négliger le mieux est inconditionnellement non-juste, choisir le meilleur possible [das Bestmögliche] est inconditionnelle-ment exigé comme la seule chose qui soit juste et, par conséquent,comme ce qui est absolument juste. Tenir sous les yeux ce principe for-mel, l’énoncer expressément, peut être utile, tout comme il peut être utilede formuler des lois logiques formelles et de se laisser rappeler à l’ordre[mahnen] par elles. Mais à la question de ce qui est bon, de ce qui est meil-leur et de ce qui est le meilleur, nous ne trouverons pas ainsi de réponse ;et même théorétiquement, seule une petite partie, certes la plus fonda-mentale, de la tâche d’une éthique scientifique et tout d’abord aprioriqueaura été menée à bien. Car il faudrait à présent fixer les classes fondamen-tales des valeurs ou encore celles des biens pratiques, et ensuite recher-cher théorétiquement les lois de préférence qui en relèvent. Comment sesituent des biens sensibles par rapport aux biens qui résident dans lasphère de la raison elle-même ? L’évidence en tant que telle, les évalua-tions et les volitions justes et éclairées par l’évidence ne sont-elles pas entant que telles objectivement évaluables [wertbar] et des classes de biensobjectifs ne se signalent-elles pas de la sorte ? Et qu’en est-il des valeursde la personnalité, de l’évaluation des qualités personnelles [persönlicherEigenschaften], par exemple de celles se rapportant aux actes que nousappelons actes de la raison ? Qu’en est-il donc de l’évaluation d’un êtrepersonnel en tant qu’être rationnel ? Qu’en est-il si nous nous représen-tons un sujet rationnel dans un contexte social, quelles valeurs et non-valeurs spécifiques en résultent, dans quelle mesure une unité spirituellesupérieure comme celle d’une famille, d’une association, d’un État, d’unpeuple, etc., peut-elle se constituer par la socialité, et dans quelle mesurecette unité supérieure est-elle à son tour idéalement évaluable, saisissablecomme une sorte de sujet de prestations [für Leistungen] qui peuvent êtrebonnes ou mauvaises ? Les lignes qui partent de là conduisent donc à l’é-thique proprement dite, à l’éthique individuelle et sociale.
L’axiologie et la pratique formelles représentent donc un premierniveau, extraordinairement important et manifestement le premier en soi,dans l’ordre des disciplines éthiques. Le niveau supérieur est un dégage-ment systématique de l’ensemble de l’a priori matériel, où certes, commeje ne puis le développer plus précisément, les oppositions du « formel » et
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 229
[141]
22954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
du « matériel » peuvent encore être orientées diversement. À ces discipli-nes aprioriques correspondent donc corrélativement des disciplines noé-tiques aprioriques ; tout comme, analogiquement, à la logique formellequi traite de façon purement formelle des propositions ou des vérités, despossibilités, des présomptivités [Vermutlichkeiten] et des probabilités, des« problématicités » [Fraglichkeiten], etc., correspond une doctrine des actesrationnels corrélatifs et de leur régulation normative ; et la recherche seprolonge ensuite dans la phénoménologie entière de la conscience ration-nelle logique. De même en ce qui concerne l’éthique. Du point de vueobjectif, ou, si l’on veut, noématique, nous passons au point de vue surles actes et leur régulation, et à partir de là nous nous retrouvons, au gréd’une exploration systématique autonome, dans une phénoménologiepure de la raison évaluative et volitive, qui s’intègre elle-même dans laphénoménologie universelle de la conscience en général. Toutes cesinvestigations sont philosophiques. Ne sont pas proprement philosophi-ques [en revanche] les applications que l’on doit faire ensuite en vue del’édification de disciplines pratiques. La logique pratique, [qui est] pourainsi dire une pédagogie du penser et du connaître justes, je ne la nomme-rais pas une discipline proprement philosophique, pas davantage que jene le ferais d’une semblable pédagogie de l’évaluer esthétique juste etintuitivement évident, ou de celle du vouloir et de l’agir justes et évidents,toutes ces disciplines étant rapportées à l’homme dans un monde donné.
Je voudrais ajouter encore une remarque. Des conversions vers lapratique peuvent naturellement aussi être accomplies a priori et, par suite,elles appartiendraient précisément au stock des disciplines aprioriquessignalées précédemment. C’est bien ainsi que la géométrie, par exemple,donne souvent à ses lois théorétiques une tournure pratique, qui n’en estpas moins apriorique ; il en va ainsi lorsqu’on examine des possibilités deconstruction, lorsqu’on pose des problèmes de construction, lorsqu’onindique des procédés empiriques dans la solution, comment on peutrésoudre telle ou telle tâche au moyen de la règle et du compas, et autreschoses du même ordre. De telles constructions et règles de constructionsont manifestement aprioriques de part en part et ne sont en aucunemanière sérieusement rapportées à l’homme et à la réalité donnée.
230 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[142]
23054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 20. Le vouloir éclairé par l’évidenceen tant que but de la volonté>
Pour conclure, j’aimerais expliquer une antinomie, qui s’interposelorsqu’on passe de l’éthique formelle à la noétique. L’impératif formelle-ment objectif dit : « Fais le meilleur parmi les biens accessibles dans leslimites de la sphère pratique totale qui est à chaque fois la tienne ! »1 Cemeilleur circonscrit formellement la justesse de volonté objective etdésigne corrélativement ce qui doit être voulu et fait. Mais qu’en est-il dela valeur d’une volonté juste ? La volonté qui vise ce qui est absolument juste est-elle déjà, par là même, la meilleure volonté ? L’impératif catégorique n’a-t-il pasen vue la meilleure volonté ? N’est-il pas impliqué dans l’exigence éthiqueformelle suprême qu’elle s’adresse au sujet de la volonté et exige de luicatégoriquement la volonté la meilleure qu’on puisse à chaque fois conce-voir ? Et l’on voit aussitôt, de ce point de vue, que l’impératif objectifauquel nous étions parvenus ne doit pas, pour ce qui concerne la volonté,être surévalué. Dans notre déduction, qui détermine pourtant le sens del’impératif objectif d’une justesse parfaite, la raison du sujet volontaire n’ajamais été présupposée, il n’était pas même présupposé que celui-ci s’en-gageât dans une réflexion et dans un examen. Mais s’il en est ainsi, c’estque la volonté peut être une volonté totalement aveugle. Sans aucune évi-dence, cédant à une pulsion aveugle, par exemple à une habitude aveugleprovenant d’une éducation conformiste, le sujet voulant peut toucher parhasard ce qui en soi est le meilleur, le « juste » unique, tel que peut lereconnaître dans une pleine évidence [in voller Einsicht] quelqu’un qui jugerationnellement. Celui-ci effectue les réflexions rationnelles, les évalua-
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 231
1. L’expression est inspirée de la formule de Brentano, plus restreinte néanmoins dans saportée, puisqu’elle s’intéresse à une « partie » – capitale, il est vrai – de la sphère pratique : lathéorie formelle du choix ou, si l’on veut, la « prohaïrétique formelle ». Cette formule énonce :« Wähle das Beste unter dem Erreichbaren » [choisis le meilleur parmi les [biens] accessibles], VomUrsprung sittlicher Erkenntnis, op. cit., p. 14 (trad. fr. op. cit., p. 45 : « Choisissons donc ce qui,parmi les choses accessibles, est le mieux ! »). Cf. également la note 17 de la page 47 (trad. fr.,p. 44, n. 20). Quant à l’unification des biens accessibles sous la forme d’une sphère pratiquepropre et la signification éthique de cette sphère pratique, cf. p. 27-28 (trad. fr., p. 74-76).(N.d.T.)
23154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
tions et justifications valant pour le cas donné, que le sujet voulant n’a paslui-même accomplies ; le résultat de son calcul éthique coïncide avec celuide l’orientation aveugle de la volonté du sujet agissant. Manifestement, ilen va ici exactement comme dans le domaine du jugement. La questionobjective est celle de la vérité, et vérité veut dire, dans la perspective del’acte du jugement, justesse ou pertinence [Triftigkeit]. Dans le jugement[Beurteilung] objectif, on dit alors que le jugement est juste, que la proposi-tion énoncée est vraie et que, dans cette mesure, elle a une valeur, alorsmême que celui qui juge a peut-être jugé au hasard, en suivant une incli-nation aveugle, c’est-à-dire de façon fort peu louable. N’adressons-nouspas, cependant, à celui qui juge l’exigence de juger avec justesse, et corré-lativement, n’exigeons-nous pas de tout jugement qu’il soit juste ? Ensomme, d’un côté, nous attribuons au jugement juste de la valeur et nesemblons exiger presque rien d’autre que la justesse ; d’un autre côté,cependant, nous disons que juger avec justesse mais aveuglément est sansvaleur. Et quelque chose de semblable semble se produire dans ledomaine de la volonté.
Mais dans le domaine du jugement, à considérer les choses de plusprès, nous sommes renvoyés au domaine de la volonté. Une exigence quenous adressons à quelqu’un s’adresse bien à sa volonté ; une exigence dejugement s’adresse par conséquent à un vouloir-juger. Le sujet qui jugedoit donc diriger volontairement son jugement de telle sorte que celui-cisoit pertinent [triftig], qu’il reconnaisse ce qui est vrai comme vrai. Pourpouvoir le faire, celui qui juge doit pouvoir reconnaître [ansehen] la jus-tesse et la non-justesse des jugements ; en d’autres termes, il ne doit pasaspirer à juger en général, mais à un juger rationnel. Car juger rationnelle-ment, ce n’est effectivement rien d’autre que juger de telle sorte que lejugement rendu n’atteigne pas simplement et par hasard la vérité, maisl’atteigne d’une façon évidente, de sorte que celui qui juge puisse en celase convaincre de la pertinence [Triftigkeit].
Comment cela se passe-t-il à présent dans la sphère éthique ? Si nousénonçons des exigences éthiques, nous exigeons [muten zu] du sujet agis-sant des volitions qu’il doit accomplir, et [nous exigeons] que ce soientdes volitions justes. Nous le représentons par là même comme quelqu’unqui, en voulant, gouverne la vie de sa volonté, fait de celle-ci même le
232 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[143]
23254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
champ de la praxis, le domaine de la volonté, et aspire désormais à unvouloir juste. Cela exige naturellement une intuition évidente de la jus-tesse, donc un vouloir qui ne soit pas aveugle, mais éclairé d’intuition évi-dente [einsichtiges].
Devons-nous dire à présent sur la base de cette réflexion que ce n’estpas le vouloir juste en général, mais le vouloir éclairé d’intuition évidentequi est le meilleur vouloir ? Que ce n’est pas le meilleur en général au seindu domaine pratique qui serait le meilleur, mais une volonté intuitive-ment évidente, dirigée sur le meilleur, et, à la suite de celle-ci, un faire réa-lisant ce qui est intuitivement évident comme meilleur [das Tun des einsich-tig Besten] ? Mais quelle étrange sorte de discours est-ce là : ce n’est pas lemeilleur du domaine pratique qui serait le meilleur, mais la volontééclairée d’intuition évidente qui s’y rapporte, etc., comme si cette volonténe devait pas elle-même, à son tour, être prise en compte ici dans ledomaine pratique ? Comment pouvons-nous sortir de cet embrouilla-mini ? Je pense bien [que nous y parviendrons] de la façon suivante : sinous entrons par la pensée dans des actes de volonté, en étudiant leuressence et l’essence de leurs corrélats, nous découvrons des possibilitésde clarification afférente du but de la volonté, de vérification des présup-positions doxiques, des évaluations qui s’y rapportent, etc. Il est de l’es-sence de la volonté que de telles séries d’actes puissent par principe êtreincluses en elle, et lorsque nous les accomplissons en nous, nous voyons[erschauen] des différences entre justesse et non-justesse ; et si nous préfé-rons le cas de la justesse, et que nous étudions ce que cette Idée renfermedans la sphère de la volonté, nous en venons à la loi du meilleur. C’estexactement comme lorsque nous sommes, en nous transportant par lapensée dans un juger quelconque (même un juger librement imaginé),entraînés dans des enchaînements de justification [Begründung] qui sontpré-tracés par l’essence du jugement concerné, et même, plus précisé-ment, par la qualité et la matière de ce même jugement, d’après leuressence typique. Que ces enchaînements soient tels, nous le reconnais-sons – ici comme dans le domaine du jugement – par une connaissancephénoménologique réflexive de l’essence. De cette façon, nous effec-tuons des intuitions évidentes, dans lesquelles nous reconnaissons quepour tout jugement en général est pré-tracée une Idée de justesse ou
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 233
[144]
23354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
encore de vérité, et nous reconnaissons des lois formelles comme étantdes lois qui se rapportent universellement à l’Idée de la vérité en tant quetelle. De même, nous saisissons par idéation dans l’intuition évidente– dans des enchaînements d’actes qui entraînent des actes de volontédans des enchaînements où ils atteignent leur but rationnel – que les actesde la volonté en tant que tels se tiennent sous l’Idée de la justesse etque, pour eux, valent des lois formelles de la volonté, parmi lesquelles laloi du souverain bien pratique. Cette validité est une validité apriorique etinconditionnée.
Mais vaut également a priori pour tout sujet en général, [le fait] que lesvolitions elles-mêmes appartiennent au domaine de la volonté du sujetvolontaire, c’est-à-dire que je peux, dans le maintenant, diriger mavolonté sur un vouloir futur, que je puis tout aussi arbitrairement sus-pendre [suspendieren] des motions de ma volonté, détourner des inclina-tions et orienter ma volonté sur une délibération et un choix rationnels et,ce faisant, sur des décisions de volonté rationnelles. Eu égard à cela, ellesfont elles-mêmes partie de tout domaine de la volonté, et la loi du meil-leur énonce dès lors qu’il faut prendre garde plus particulièrement auxbiens qui résident dans ces actes rationnels, et que ces actes rationnelssont des conditions nécessaires de la possibilité d’atteindre le but consé-quent de la justesse de la volonté. Je ne dois donc pas seulement deman-der ce que je peux et examiner ce qu’est le meilleur, et par suite adopterde moi-même une attitude rationnelle, mais je dois de propos délibérétendre au but de la plus grande clarté et de la plus grande rationalité possi-bles – par quoi je ne m’assure pas seulement d’un meilleur par ailleursseulement relatif, mais, dans l’intuition évidente elle-même, j’ajoute unenouvelle valeur. Mais tout le reste est l’affaire de considérations complé-mentaires. Car, généralement parlant, il faut examiner comment l’Idée dubien pratique suprême peut être pratiquement satisfaite – à quoi il fautprendre garde pour des raisons idéales –, et comment peuvent être levéesles difficultés de principe apparentes qui surgissent alors.
234 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[145]
23454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
<§ 21. L’objectivité des possibilités pratiques et leur relativité au sujet.La convenance ou l’inconvenance se fondant dans l’essence
de l’acte de volonté. Les composantesde la parfaite justesse de volonté>
Nous avions, dernièrement, formulé le problème de l’impératif caté-gorique. La loi d’absorption établissait seulement que si, dans un choix,ou pour le dire plus clairement, dans une question-de-volonté en général,des valeurs positives sont précisément en question, la meilleure d’entreelles absorbe toutes les autres. Mais cela ne revient pas à dire que cettevaleur la meilleure soit le devoir objectif [das objektiv Gesollte] sans plus,qu’elle soit le juste but de la volonté absolument parlant. Ce n’est quelorsque nous concevons le domaine des biens pratiques s’offrant au moicomme étendu jusqu’au point où il embrasse tous les biens de ce type,i.e. tous les biens accessibles au sujet dans le présent en question, et quenous rapportons ensuite la question de volonté à tous ces biens – [c’estalors seulement] que le meilleur de ce cercle le plus large n’est plus absor-bable, qu’il n’est plus simplement un meilleur de façon relative ; il n’y aplus d’élargissement pensable du cercle qui comporterait encore un bienpratique pouvant être meilleur encore.
Au lieu de quoi, nous pouvons également dire : si nous imaginons ledomaine pratique entier du moi dans le point de temps concerné de l’ac-tion, comprenant toutes les réalisabilités pratiques de ce même moi, alorsce domaine contient en général, mais non nécessairement, des biens, et [ilcontient] en partie des biens, en partie des maux, et en partie des adia-phora. S’il comporte des biens en général, il y a alors, en référence à laquestion de volonté à poser par rapport au domaine entier selon tous seséléments, un absolument meilleur, déterminé de façon univoque ou pluri-voque, et celui-ci est alors ce qui est dû tout simplement. Dans le cas de laplurivocité, le sujet reste libre de choisir l’un quelconque des optima plu-riels, sans qu’aucun choix soit non-juste ; n’importe lequel, l’un quel-conque d’entre eux est absolument dû. Si le domaine pratique entier engénéral ne renferme qu’un seul bien, celui-ci serait eo ipso le bien absolu-ment dû, le but de la volonté absolument juste. Mais, bien sûr, la présup-
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 235
[146]
23554718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
position reste ici en suspens selon laquelle le sujet de la volonté a effecti-vement, en chaque cas, un domaine pratique clos, susceptible d’êtreépuisé par disjonction dans un choix complet. Un problème essentielreste ici, par conséquent, non résolu. Nous n’orienterons cependant pasnotre méditation ultérieure d’après ce problème, car il importe avant toutde clarifier encore le sens de ce qui a été acquis jusqu’ici.
Si nous y regardons de plus près, toutes nos constatations sont indé-pendantes de l’actualité d’un choix du sujet de volonté concerné ; il n’im-porte pas que celui-ci se pose des questions de volonté. Objectivement, ilfaut dire qu’ « il a le choix », même lorsqu’il ne choisit pas. Il a le choix,cela veut dire qu’il pourrait choisir et choisir rationnellement, et cet « ilpourrait » exprime à son tour une possibilité simplement idéale. Quandnous nous figurons un sujet de volonté quelconque dans une considéra-tion purement apriorique, ce qui est, pour ce sujet, une possibilité pra-tique, et ce qui ne l’est pas, se trouve alors déterminé en soi. En outre, setrouve objectivement déterminé ce qui, parmi ces possibilités pratiques,est un bien et ce qui ne l’est pas ; sont objectivement déterminées les rela-tions entre valeurs des biens et le meilleur univoque ou plurivoque (si cen’est infiniment plurivoque). Entre tout cela, [le sujet] a le choix, mêmes’il ne songe pas le moins du monde à choisir sérieusement et encoremoins à embrasser du regard le domaine pratique en son entier, à l’arti-culer selon ses membres [gliedern] et à exercer des comparaisons devaleurs. Et si, le cas échéant, il choisit effectivement, il peut se faire qu’ilse comporte alors de façon totalement fausse, qu’il transgresse ledomaine objectif de la volonté, qu’il considère comme une possibilitépratique quelque chose qui ne l’est absolument pas ou qu’à l’intérieur despossibilités véritables ou envisagées à tort, il prenne pour un bien ou pourle meilleur quelque chose qui est, en vérité, mauvais ou de moindrevaleur. Mais tout cela est à présent hors de considération. Assurément,que le moi en question ait tel ou tel domaine objectif de volonté et encelui-ci quelque chose comme un summum bonum, c’est là une vérité quidoit être connaissable dans un sujet idéalement possible, et par là mêmedoit également être pensable idealiter un choix qui, d’une manière absolu-ment évidente, embrasse le domaine entier de volonté de ce moi, connaîtsa complétude, évalue de façon évidente toutes ses valeurs et détermine
236 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[147]
23654718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:45
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
ce qui est absolument meilleur d’un point de vue pratique. Nous, specta-teurs, nous pourrions, au moyen d’une intelligence suffisante, accomplirpour ainsi dire ce jugement intuitivement évident, nous choisissons enquelque sorte pour le sujet de volonté concerné, qui lui-même ne choisitpas nécessairement. Mais nous disons alors : objectivement parlant, il a lechoix entre telles possibilités pratiques exactement et nulle autre, etobjectivement, c’est exactement ceci et rien d’autre qui est pour lui le biensuprême pratiquement accessible et par conséquent ce qui est catégori-quement juste, ce qui est objectivement dû. Mais, en tout cela, nousincluons dans la considération des possibilités seulement idéales, qu’iln’est précisément pas nécessaire d’y inclure. Si nous y renonçons, il restealors un domaine en soi consistant de possibilités pratiques avec sonmeilleur éventuel.
Il en va ici de la justesse objective de la volonté comme de la justesseobjective du jugement ou, mieux encore, de la justesse de la conjecture.Que le sujet qui conjecture ait choisi de façon juste parmi les possibilitésfavorables et défavorables qui sont à sa disposition, et même qu’il ait, engénéral, choisi ou non : sa conjecture est objectivement juste ou non-juste,et elle est juste si elle est conforme aux possibilités qui ont le plus de poids,non-juste si elle va du côté des possibilités de moindre poids. De mêmequ’il y a, dans la théorie des probabilités, des lois objectives et formellesqui, dans leur objectivité, ne s’inquiètent pas de savoir si le sujet quiconjecture a une évidence rationnelle ou non, de même nous avons ici uneloi formelle objective de la justesse de volonté. Enfin, nous avons aussi dessimilitudes avec le domaine du jugement au sens plus restreint du terme.Un jugement qui pose comme existante une contradiction est non-juste,[peu importe] que le sujet jugeant sache ou non qu’il se contredit.
Si nous envisageons à présent d’un peu plus près quel rôle jouent lemoi et l’acte de la volonté dans cette situation objectivement saisie, il estalors d’emblée clair que l’essence propre de l’acte de la volonté considérédétermine entièrement s’il est convenant ou non. Il est justement tel,exclusivement selon qu’il se dirige ou non sur une valeur objective. S’il nele fait pas, il se dirige alors sur une non-valeur objective ou sur un adiapho-ron, et ce sont alors l’inconvenance ou l’indifférence qui sont à leur tourobjectivement déterminées par l’essence propre de l’acte de volonté. Cor-
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 237
[148]
23754718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
rélativement, la même chose vaut des desseins qui relèvent de l’essenceimmanente des actes de volonté à chaque fois en question. Si nous quali-fions les desseins d’adéquats ou d’inadéquats, selon la convenance ouinconvenance des actes de la volonté, nous pouvons alors dire égalementque pour la convenance et l’inconvenance, pour l’adéquation et l’inadé-quation, seule est en question l’essence de l’acte de volonté ou du desseinà chaque fois en jeu, de même que, dans le domaine des jugements, c’estseulement l’essence du juger ou encore la simple proposition qui sont enquestion. « Seulement », cela veut dire que cela ne fait aucune différenceque ce soit tel sujet ou tel autre qui juge. Le juger est un juger juste, la pro-position est en soi une proposition vraie, quel que soit celui qui juge ainsi,qui énonce la proposition dans une prédication. De même, un vouloir estconvenant et, en ce sens, dirigé de manière appropriée, et le dessein cor-respondant (l’analogon de la proposition logique) est adéquat, à quelquesujet que nous attribuions le vouloir en question. Par exemple, une purejoie de connaissance est valable en soi, un vouloir qui se règle sur cettejoie est en soi convenant, un dessein qui la suit est en soi adéquat, demême qu’un vouloir qui se dirige vers une joie vile, comme celle prise àtorturer les animaux, est en soi inconvenant et par suite, axiologiquementconsidéré, une non-valeur, abstraction faite du sujet qui veut de la sorte.
Mais la convenance n’est pas tout. À la considérer avec précision, laquestion de la réalisabilité du dessein, de la remplissabilité du vouloir, nese pose même pas en ce qui la concerne. Si nous la faisons ressortir danssa pureté comme l’unique composante constitutive de la validité objectivepossible de la volonté, alors nous ne pouvons pas, comme nous l’avonsfait tantôt, parler déjà d’un devoir objectif dans le cas de la convenance.Nous faisons bien de modifier de façon appropriée notre terminologie detantôt. Qu’un dessein soit objectivement un dessein dû, objectivementexigé, implique certes – si nous nous immergeons dans le sens que de telsmots possèdent dans la langue usuelle – non seulement la convenance oula conformité, mais encore quelque chose de plus. Il vaut donc mieux,comme nous le faisons maintenant, extraire [herausdestillieren] la simpleconvenance et, pour le dessein correspondant, parler seulement d’adé-quation, mais non pas encore d’être-dû [Gesolltheit]. Le fait que nousayons opté tantôt pour une autre terminologie tenait à ce que nous avions
238 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
[149]
23854718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
déjà inclus tacitement, dans la convenance, au moins [l’idée de] l’accessi-bilité pratique, ce dont nous nous abstenons précisément maintenantpour de bonnes raisons. La convenance est complètement indépendantede l’accessibilité [Erzielbarkeit] de ce qui est voulu, puisque aussi bien,avant toute considération de celle-ci, on peut se prononcer sur celle-là.D’un autre côté, rien n’est a priori exigé objectivement d’un sujet, qui nesoit pour ce même sujet atteignable. Ce que quelqu’un ne peut pas, il ne ledoit pas non plus. Le dessein qui a le prédicat du devoir possède donc dece fait un prédicat plus riche que celui de la convenance. Mais nousvoyons dès lors qu’avec cet élargissement déjà, la subjectivité joue un rôlequi n’a aucune analogie dans le domaine du jugement ou encore de lavérité.
Une vérité objective est une vérité en soi, et cet « en soi » signifie que lesujet jugeant ne relativise pas la vérité : la vérité en soi n’est pas une véritépour untel ou untel. Tout jugement objectif est décidé en soi. Quiconquejuge, pourvu qu’il juge avec justesse, juge la même chose par rapport à uneseule et même matière de proposition ; il juge précisément une seule etmême proposition, qui est vérité. La vérité est ce qu’elle est, quand bienmême personne ne la jugerait. En revanche, il n’est pas nécessaire que cequi est pour moi une possibilité pratique le soit par là même pour toutautre. Les possibilités pratiques sont essentiellement référées au sujetcapable de volonté. Qu’un faire soit une possibilité pratique pour un sujetou, si l’on préfère, la question de savoir s’il l’est, cela est déterminé en soi,le sujet lui-même en jugeât-il de façon erronée, tînt-il pour pratiquementpossible quelque chose qui, en vérité, ne l’est pas. Dans cette mesure, nousavons ici quelque chose d’objectif. Mais l’objectivité de la possibilité pra-tique est essentiellement liée au sujet concerné, et la même chose vautpour le domaine pratique entier du sujet à chaque moment de son agir pos-sible, c’est-à-dire pour le domaine de toutes les possibilités pratiques exis-tant objectivement pour le sujet à un moment donné. S’il a en général despossibilités pratiques, donc un domaine total pratique, celui-ci est alors entout cas le sien, et l’on pourra en tout cas énoncer au moins cet a priori, àsavoir que deux sujets-ego ne peuvent avoir par principe un domaine pra-tique total identique, des sphères d’action possibles identiques. En mêmetemps, ce domaine se modifie en général d’instant en instant.
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 239
23954718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
En outre : si, dans l’optique du point de vue en question, l’analogiefait défaut entre la justesse suprême de la volonté et la justesse du juge-ment, la vérité objective du jugement, ce qui alors réapparaît pourtant,c’est une analogie dans la comparaison avec les cas de justesse de laconjecture1 ; car la justesse du conjecturer se rapporte à un fonds, objecti-vement fixable, de supputations [Anmutlichkeiten] favorables et défavora-bles, ou encore à un fonds de savoir et de non-savoir. Avant la questionde la prise de position juste, de la préférence juste, des meilleures possibi-lités, on trouve ici la question du domaine total du savoir et du non-savoirentrant en compte et, de ce fait, la question du domaine total des possibi-lités réelles, entre lesquelles le sujet conjecturant a objectivement le choix.Mais ce domaine total est lié aux sujets. En général, le fonds du savoir etdu non-savoir est différent pour différents sujets, et différent pour lemême sujet à différents moments. Le jugement rendu sur la justesseobjective de la décision conjecturale est fondé en l’occurrence sur le juge-ment rendu sur le domaine du savoir existant objectivement pour le sujet,ou encore sur le domaine de possibilités ; en quoi, comme il a déjà été dit,la question ne se pose pas de savoir si et comment le sujet lui-même jugede son savoir et de son domaine de possibilité. Engageons-nous plusavant, à présent, dans l’examen des composantes de l’être-dû objectif, entant que justesse absolument parfaite de la volonté !
Un vouloir ou encore un dessein qui porte sur quelque chose de prati-quement possible pour le moi concerné, dans le moment donné, possède
240 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Choisis le meilleur ! Fais le meilleur ! Le meilleur est la seule chose juste. De même dansla sphère de la conjecture : conjecture ce qui est le « plus probable » ! Décide-toi présomptive-ment pour la supputation qui possède le plus grand poids ; décide-toi présomptivement, dans ledomaine total de tes « possibilités problématiques », pour celle qui a le plus grand poids !Comme ce domaine total est par essence susceptible de déplacements, comme des possibilitésproblématiques toujours nouvelles peuvent ultérieurement entrer dans le domaine, la décisionconjecturante est quelque chose qu’il faut toujours de nouveau modifier. Et noétiquement par-lant, il en résulte l’exigence de déterminer les poids et de s’assurer des rapports respectifs depoids relatifs, de façon à pouvoir accomplir toujours de nouveau, aussi exactement que pos-sible, les examens, et de pouvoir faire entrer en compte fermement la « valeur », [c’est-à-dire] lerapport entre les poids correspondant à chaque conjecture. Les conjectures ont leurs« valeurs ». Les conjectures s’absorbent en fonction de leurs valeurs. Et là où la certitude faitprécisément défaut, les conjectures ont, elles aussi, axiologiquement parlant, une valeur rela-tive, en fonction de leur « probabilité » (de leurs valeurs dans l’autre sens du terme). (N.d.A.)
[150]
24054718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
dès lors, abstraction faite de la convenance ou de l’inconvenance, uneespèce de justesse ; nous pourrions dire également qu’il a de l’objectivité[Gegenständlichkeit] ; alors que, là où il porte sur du « non-réalisable », surquelque chose d’impossible pratiquement, il est « sans objet » [gegenstands-los]. Si nous relions la justesse de la convenance à la justesse au sens del’objectivité, cette liaison ne produit pas encore une volonté qui, au sensle plus élevé du terme, aurait de la justesse. La volonté porte sur un « bienpratique » ; en vertu de quoi nous pourrions être tentés de qualifier le des-sein de bon, au sens pratique, mais ce bon est encore très imparfait. Defaçon tout à fait générale, une volonté est d’une valeur d’autant plusélevée que le bien vers lequel elle se dirige est plus élevé. Il y a des diffé-rences dans l’excellence [Vorzüglichkeit], abstraction faite, dans un premiertemps, de l’accessibilité et de la référence d’un quelconque moment à unseul et même sujet et à son domaine pratique. Mais si nous comparonsdes volitions ou encore des desseins qui se rapportent à ce domaine pra-tique, si donc nous fixons le sujet-ego, le point de temps et le domaine pra-tique total qui lui appartient, alors les lois d’absorption entrent en vigueuret, avec elles, la différence de l’être-dû objectif et, corrélativement, del’être-répréhensible entre en jeu. Vouloir le moins excellent est pratique-ment répréhensible, vouloir le plus excellent est relativement un dû ; lenégliger est répréhensible. Et tout cela est ici entendu objectivement, sansqu’il soit question de savoir comment le sujet lui-même juge, avec ou sansjustesse, de l’excellence, ni même de savoir si, simplement, il choisit. Maisl’excellent, lui aussi, doit céder la place à un plus excellent encore, et celaen général, aussi longtemps qu’il y a des biens plus élevés à découvrirobjectivement dans le domaine pratique total (dont nous présupposonsl’existence et que nous présupposons doté de biens). Il résulte de cetteconsidération que seule l’excellence insurpassable, que seul le meilleur[Beste], dans la sphère pratique entière du moment donné, est ce qui nepeut plus abandonner son caractère objectif de devoir ; cela seul est dû,non pas de façon simplement relative, mais absolument parlant, un dûtoujours entendu en un sens objectif.
Certes, une relativité subsiste : celle qui a trait au sujet et au moment.Mais, bien que chaque sujet doive en général quelque chose de différent,et que le même sujet doive différentes choses à différentes époques, tout
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 241
[151]
24154718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
sujet en tout temps ne doit pourtant qu’une chose qui est objectivementdéterminée, si tant est qu’il doive quelque chose tout court. Ce « si tant estque [falls] » signifie : si tant est que le sujet a, au moment donné, en géné-ral, une sphère d’action pratique, et en outre, si tant est qu’en celle-ci setrouvent en général des biens. Dans quelle mesure ce sont là des condi-tions restrictives, cela doit naturellement faire l’objet d’un examen spécial.Pour ce qui est de l’unité du meilleur, il faut d’ailleurs renvoyer à notredistinction de l’univocité et de la plurivocité. Nous pouvons dire aussique le « meilleur », ou le dû, peut éventuellement avoir la forme d’une dis-jonction : l’un d’entre A1, A2, …, etc., peu importe lequel, chacun des Aétant précisément le meilleur au même titre que les autres.
Sommes-nous arrivés au terme ? Ce que nous avons conquis est-il, àtout point de vue, satisfaisant ? Notre considération objective est ter-minée ; elle a produit une détermination purement formelle de ce qui estabsolument dû pour tout temps et pour tout sujet ; mais ce dû catégo-rique est-il un véritable impératif catégorique ? Le concept du devoir-fairen’a-t-il pas encore un autre sens auquel jusqu’à présent nous n’avons pasfait droit ? Qu’en est-il dans le domaine parallèle du jugement ou de laconjecture ? Quelqu’un peut, en effet, y juger de façon totalementaveugle, il peut, comme on dit, « parler à la légère » sans [le moindrerecours à] la raison et il peut néanmoins atteindre le juste « par hasard ».Pour le jugement objectif, on dira que ce qu’il dit est vrai ; et nous parlonsaussi, éventuellement, de la valeur de la vérité1, ou encore de la valeur dujuger juste, et cependant, nous ne créditons nullement de cette valeurcelui qui juge ; il n’a en cela, disons-nous, pas le moindre mérite, nousallons même jusqu’à dire [que] son juger [est] sans valeur. Un juger dotéde valeur serait un juger effectué pour des motifs rationnels, un juger quiprend la bonne direction parce qu’il est guidé par des motifs rationnels[Vernunftgründe] et qui dans le meilleur des cas serait parfaitement évident.Ce n’est que dans de tels cas que ce qui confère de la valeur résiderait ori-ginairement dans le juger lui-même ; la justesse résiderait, originairement
242 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
1. Nous nous écartons ici du texte des Husserliana : au lieu de und <wir> sprechen auch even-tuell vom Wert oder der Wahrheit bzw. vom Wert des richtigen Urteilens ; nous lisons : und <wir> sprechenauch eventuell vom Wert der Wahrheit bzw. vom Wert des richtigen Urteilens. (N.d.T.)
[152]
24254718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
donnée, dans l’évidence intuitive [in der Einsichtigkeit] et détermineraitdonc originairement la tenue-pour-valable [Werthaltung]. Au sens origi-naire, ce qui aurait de la valeur, c’est le jugement intuitivement évident, entant que jugement donnant la justesse ou la vérité, et lorsque nous éva-luons néanmoins positivement un juger non évident, cela ne tient qu’à lapossibilité idéale de convertir ce jugement en un jugement intuitivementévident, ou encore, de voir dans une intuition évidente qu’il rend pos-sible, par son sens, une évidence idéale. Ce n’est que dans le juger intuiti-vement évident que le sujet jugeant éprouve [erlebt] lui-même le devoirauthentique ; et cela signifie, dans le domaine du jugement, qu’il éprouveprécisément la motivation rationnelle, qu’il n’effectue pas sans détour lathèse du « c’est ainsi », mais l’oriente d’après d’authentiques raisons ; leschoses en question et les enchaînements concrets sont eux-mêmes don-nés et, en tant que donnés, ils expriment pour ainsi dire des exigencesauxquelles se plie le jugement. Cette conscience originaire de la justesse,qui réside dans le jugement rationnel lui-même, n’allons pas croire quec’est un spectateur extérieur qui l’accomplit, [quelqu’un] qui pour ainsidire réaliserait, en lieu et place du sujet jugeant, le calcul du jugement.[Cette conscience originaire de la justesse] présente une saturation spéci-fique de l’intention de jugement, une saturation par le but lui-même, uneplénitude [Erfülltheit] intime, celle de l’adéquation de l’avis dans l’être-donné de ce qui est avisé.
Il en va ainsi, manifestement, dans tout domaine d’acte, pour touteespèce de présomptions, de prises de position, donc spécialement aussidans le domaine de la volonté. Dans l’attitude objective, nous jugionsdans une évidence intuitive de la justesse de la volonté. Nous accomplis-sions en cela une analyse d’essence des composantes constitutives de lapleine justesse au sens le plus élevé. Le but de la volonté réside tout entierdans ce que nous désignions comme ce qui est objectivement dû. Lavolonté du meilleur parmi ce qui est réalisable possède la justessesuprême du but, une convenance au sens élargi. Mais la valeur, à la consi-dérer en elle-même, originairement, ne réside pas dans le vouloir justequant au but. Ici aussi, nous avons la distinction entre volonté aveugle etvolonté rationnelle. Une volonté aussi peut être considérée objective-ment ; sa justesse est susceptible d’être, pour ainsi dire, recalculée par
SECTION IV. PRATIQUE FORMELLE 243
[153]
24354718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut
n’importe quel sujet rationnel. Mais ce n’est que lorsque le sujet voulantlui-même calcule, pour ainsi dire en lui-même, c’est-à-dire lorsqu’il selaisse déterminer dans son vouloir par des motifs rationnels authentiques,lorsqu’il accorde son vote-de-volonté [Willensvotum] non pas aveuglément,mais de telle façon que se constitue originairement dans son vouloir lajustesse du but, [c’est alors seulement] qu’il est en lui-même conscienced’un devoir auquel correspond adéquatement le vouloir ; ce n’est qu’alorsqu’il a une valeur originaire.
Assurément, l’impératif objectif « fais le meilleur de ce qui est acces-sible » est inattaquable, car nous saisissons sa validité objective dans uneintuition évidente. Une volonté qui veut autrement est de façon évidentenon-juste, pour ainsi dire non-vraie ; elle manque le but qui est pré-tracédans l’essence universelle de la volonté. C’est la même chose que lorsquenous constatons dans l’examen objectif de la logique : il n’est pas permisde juger une contradiction ; ce que nous pouvons exprimer aussi, analogi-quement, en tant qu’impératif : ne commets pas de contradiction ; res-pecte les lois logiques en tant que lois de la justesse possible du jugement !Or, bien que les lois logiques ne parlent pas d’évidence, nous exigeonscependant, dans la noétique, un juger intuitivement évident, et de même,dans la noétique de la volonté, un vouloir évident. Nous avons donc aussil’impératif : veuille et agis rationnellement ! Si ton vouloir est juste, il n’estpas encore pour autant pleinement valable ; seul un vouloir rationnel a dela valeur.
244 ÉTHIQUE ET LA THÉORIE DE LA VALEUR (1914)
24454718.prnV:\54718\54718.vpmercredi 5 novembre 2008 08:25:46
Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØriqueComposite Trame par dØfaut