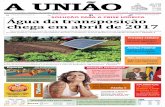La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal
La crise malienneet ses leçons pour le
Sénégal Mouhamadou El Hady Ba
Pierre Amath Mbaye
IPODE > WORKING PAPER N°1 /2013.02
IPODE > WORKING PAPER N°1 /2013.02 w w w . t h i n k t a n k - i p o d e . o r g
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal 2
Le Think Tank IPODE est une association laïque et à but non lucratif. Son développement repose sur la qualité et l’implication des hommes et des femmes qui le composent.Ils sont sa principale richesse.
IPODE est un Think Tank progressiste, indépendant et panafricain qui produit et diffuse des solutions politiques innovantes au Sénégal et dans le reste de l’Afrique.»
IPODE a pour vocation de faire des propositions, produire de l’expertise, animer le débat public, développer des méthodes dans tous les domaines des politiques publiques et participer à la refondation des idées progressistes et humanistes.
Website: http://thinktank-ipode.org/
IPODE > WORKING PAPER N°1 /2013.02 w w w . t h i n k t a n k - i p o d e . o r g
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal 3
Avant Propos
Pour traiter de la crise malienne et des premiers en-seignements que peut en tirer le Sénégal, nous avons
opéré des choix, privilégiant les aspects qui nous sem-blaient fondamentaux, et, accepté le risque d’élaborer sur une situation encore en cours de développement.
IPODE > WORKING PAPER N°1 /2013.02 w w w . t h i n k t a n k - i p o d e . o r g
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal 4
RESUME 5
SUMMARY 6
INTRODUCTION 7
LES CAUSES DISTALES DE LA CRISE MALIENNE 8A L’ORIGINE, LA QUESTION DES FRONTIERES 81963/1990 : LES ERREURS D’UNE REPRESSION ET LES OPPORTUNITES PERDUES D’UNE REBELLION POUR «L’INTEGRATION» 12LES TENSIONS INTERNES AU NORD MALI 15L’IRRUPTION DES GROUPES SALAFISTES ET LA CRIMINALISATION DE L’ESPACE SAHARO-SAHELIEN 16
LES CAUSES PROXIMALES DE LA CRISE MALIENNE 21LA CHUTE DE KADHAFI ET LE CHOC DES AGENDAS 21LA REDISTRIBUTION DES CARTES POLITICO-MILITAIRES AU NORD 22LE COUP D’ÉTAT DU 22 MARS : CAUSE OU CONSEQUENCE ? 23L’EFFONDREMENT DE L’ELITE MALIENNE 25
LEÇONS POUR LE SENEGAL 27DISTINCTIONS CONCEPTUELLES 27LES INEGALITES : UN RISQUE POUR LA NATION ? 28LA LEGITIMITE DES ELITES 28L’EDUCATION ET L’INSERTION DE LA JEUNESSE : UN ENJEU DE SECURITE NATIONALE ? 29LA CRISE DE BASSE INTENSITE SENEGALAISE 29
RECOMMANDATIONS 31
BIBLIOGRAPHIE 32
TAble deS mATièreS
1 Modèle d’analyse du risque proposé par James Reason. Celui-ci considère que la réalisation du risque doit s’analyser
comme la conjonction d’une succession de défaillances aux différents stades (plaques) censés la prévenir, laissant ainsi
advenir le risque, comme des trous à travers des plaques, qui, alignés, laissent passer la lumière. 2 Bourgeot, André. “Le lion et la gazelle: États et touaregs.” Politique Africaine no. 34, Karthala, Paris. États et Sociétés
Nomades (Juin 1989): 19–29. http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/034019.pdf 3 Senghor, à cet égard, refusera de voter la loi-cadre Defferre du 23 juin 1956. 4 Ceux du Dahomey et de la Haute-Volta (aujourd’hui Bénin et Burkina-Faso) et des représentants Mauritaniens. 5 Peu désireuses de voir se constituer un grand ensemble indépendant, elles demanderont au Dahomey de choisir entre un port
– infrastructure stratégique financée par leur soin - et la participation à la fédération. 6 Opposé dès l’origine à ce projet, Boigny fera pression notamment sur la Haute-Volta en mettant en jeu l’indispensable
débouché ivoirien pour les travailleurs agricoles saisonniers de ce pays.
7 Voir notamment l’ouvrage de l’un des témoins privilégiés de cette période, Roland Colin : Sénégal, notre pirogue, Présence
africaine, 2007. 8 Le « centralisme démocratique » et le « socialisme scientifique » de Modibo Keïta s’opposant à une approche sénégalaise
moins autoritaire et plus « libérale », dans le contexte de la guerre froide et de celui des décolonisations en cours à cette
époque. 9 Pour faciliter la lecture de ce document à nous utiliserons le mot, popularisé, Touareg, en sachant que l’expression Kel
Tamasheq est cependant la plus appropriée. 10 « L'indépendance de l’Algérie et des anciens pays autrefois regroupés au sein de l'AOF et de I'AEF se traduisit par un
transfert des rênes du pouvoir remis aux mains de nouvelles « élites » nationales. En Algérie, celle-ci étaient presque
uniquement originaire du Nord tandis qu'en Afrique noire, elles venaient principalement des régions sahélienne et non
sahariennes à l'exception de la Mauritanie. » in Afrique noire et monde arabe, Les Éditions de l’Aube (Institut de Recherche
pour le Développement), 2000.
11 Bourgeot, André, « Sahara : espace géostratégique et enjeux politiques (Niger) », Afrique noire et monde arabe, Les
Éditions de l’Aube (Institut de Recherche pour le Développement), 2000 12 Notamment sur les approches romantiques de « L’Homme Bleu » exploitées au plan marchand, mais aussi en politique, par
exemple en Europe, où l’on présente, parfois, les Touaregs comme un peuple frère au prises avec des noirs et des arabes pour
les tenant de la rétractation identitaire ; un peuple en lutte pour son émancipation sur fond de régionalisme politique
européen ; un rempart contre l’islamisme dans un contexte d’islamophobie rampante, etc. 13 Nous avons choisi de réserver la question du caractère géostratégique de certains espaces de l’hinterland (ressources
naturelles, etc.) et celle de la compétition des acteurs étatiques dans ce contexte pour un développement ultérieur. Notons
simplement, s’agissant de cette compétition (ie : Etats-Unis, Chine, France etc.) et des déstabilisations qu’elle peut
provoquer, qu’il s’agit d’un arrière-plan durable autant qu’inévitable. Les Etats de la région n’ayant d’autres choix, selon
nous, que de devoir affronter cette situation dans le meilleur état de préparation possible et au mieux de leurs intérêts. 14 De Lattre, Jean-Michel, « Sahara, clé de voûte de l’ensemble eurafricain français », Politique étrangère n°4, Paris (1957):
345–389.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1957_num_22_4_6196 15 Bourgeot, 2000 16 Le choix des guillemets, ici, s’explique par les représentations très contrastées et localisées des approches « raciales ».
Ainsi, un touareg perçu comme « blanc » en Afrique, ne le sera pas forcement sur le sol européen, par exemple. Par ailleurs,
les sociétés touarègues et arabes du Nord Mali comptent en leur sein de très nombreux « Noirs».
17 Le commandant supérieur des troupes de l’AOF écrira en 1917 : « Il semble que le rôle des administrateurs dans ces
régions "inadministrables" serait plutôt platonique. Il faut et il suffit qu'une paix relative y règne et surtout qu'aucune
incursion ne puisse se produire dans les régions productives. Cela est purement de la police. L'administration n'y a, pour
l'heure, à peu près rien à faire et le peu qui peut être tenté est trop subordonné à la sécurité du pays pour ne pas lui céder le
pas » in Grémont, Charles. Touaregs et Arabes dans les forces armées coloniales et maliennes. Une histoire en trompe-l’œil.
Note de l’Ifri. Paris: Institut Français des Relations Internationales (IFRI), 2010 18 Gestion des territoires délégués aux « chefs indigènes » au profit de la nation coloniale, particulièrement utilisé par
l’Empire Britannique. 19 Pour les communautés touarègues comme pour d’autres - les rites de socialisation, la transmission des savoirs faire etc.
s’effectuant à l’âge de la scolarisation - le risque de « perdre » un membre de la communauté, devenu inutile dans son
écosystème traditionnel sans ces apprentissages, représentait un danger. 20 Au sens occidental du terme. 21 Des pétitions, peut-être inspirées, refusant le rattachement à un État nouvellement créé, ont pu êtres déposée à Tombouctou
et Agadès.
22 Source inépuisable de tensions. Mamadou Dia rencontrera les mêmes difficultés, sur le même sujet, au Sénégal. 23 Songhay, Peuls, Bérabiches etc. 24 Pour le meilleur comme pour le pire. 25 Poulton, Robin-Edward ; Youssouf, Ibrahim ag, La paix de Tombouctou. Gestion démocratique, développement et
construction africaine de la paix, Genève : Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), 1999,
p.32 26 Keita, Kalifa. Conflict and conflict resolution in the Sahel: the Tuareg insurgency in Mali. Carlisle, Pennsylvania: Strategic
Studies Institute, U.S. Army War College, May 1, 1998
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub200.pdf - consulté le 15/02/2013 27 Le chef traditionnel des touaregs de l’Adagh (Amenokal), Zeid ag Attaher, rebelle, par exemple ne sera pas sur la même
ligne que son frère Intallah ag Attaher, opposé aux idées indépendantistes. 28 Le même Zeid Ag Attaher, passé en Algérie, sera capturé par les autorités de ce pays qui l’extraderont ensuite vers le Mali,
ou il purgera une lourde peine de prison. Par ailleurs, Ahmed Ben Bella, président de l’époque, va octroyer à l'armée
malienne, le droit de poursuivre les rebelles à l'intérieur du territoire algérien. 29 Aucun chiffre officiel n’est disponible. Pierre Boilley, dans ce brouillard, évalue environ 1 500 morts pour 200/300
combattants touaregs. Le cercle de Kidal, en particulier, sera interdit aux étrangers et placé sous le contrôle exclusif de
l’armée. Cette situation n’est donc pas sans rappeler celle des années 1916-1920 où la surveillance et les opérations policières
étaient la priorité absolue des militaires coloniaux en charge des populations nomades (touarègues et arabes principalement)
Voir Grémont, 2010
30 Actes de rétorsion, mais aussi asphyxie du milieu dans lequel évoluent les insurgés, méthode typique des stratégies de
contre-insurrection de l’époque (cf. guerres d’Algérie, du Vietnam, etc.). Les militaires maliens aux affaires s’inspirant sans
doute beaucoup, de ce point de vue, de leurs expériences antérieures au service de la France, comme leurs homologues
sénégalais s’agissant de la crise Casamançaise. 31 Le « Guide » libyen Kadhafi ayant choisi d’aider de nombreux mouvements politico-militaires (IRA, ETA, Brigades
Rouges etc.), qu’il utilisera parfois comme outils pour sa politique extérieure. 32 Notamment au Burkina-Faso, lequel va jouer un rôle de médiation important, notamment en 2012/début 2013 33 Il s’agit de la grande sécheresse des années 1984-85, à la suite de celle des années 1972-1974 34 Les autorités algériennes procèdent en mai/juin 1986 au refoulement de nombreux Touaregs installés à Tamanrasset. 35 Les deux pays étant alors opposés aux projets indépendantistes des touaregs 36 Témoignage d’Hama ag Sid Ahmed, Le Mali (4/4), La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 07.02.2013.
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-le-mali-44-2013-02-07 37 MFUA était l’appellation qui fédérait les quatre principaux mouvements de la rébellion : le MPA (Mouvement populaire
de l’Azawad), le FPLA (Front populaire de libération de l’Azawad), l’ARLA (Armée révolutionnaire de l’Azawad) et le
FIAA (Front islamique armé de l’Azawad). Les trois premiers étaient composés par des Touaregs, et le quatrième
essentiellement par des Arabes. (Grémont, 2010) 38 Des réfugiés, des « libyens » etc.
39 Par exemple, jusqu’aux années 1990, les Touaregs qui le souhaitaient ne pouvaient que très difficilement gravir les
échelons de la hiérarchie militaire, leur principal débouché au sein de l’État malien avec les autres forces de sécurité, compte
tenu de la sous-scolarisation des communautés touarègues au regard des populations du sud (voir infra). Si ce n’est dans les
textes, l’École militaire interarmes (EMIA) qui assurait la formation des officiers, était, dans les faits, fermée aux Touaregs.
Pour les deux premiers régimes du Mali indépendant (présidences de Modibo Keïta et de Moussa Traoré), l’idée même de
confier aux Touaregs de véritables fonctions de contrôle et de défense était impensable (Grémont, 2010). 40 La lettre de ces accords prévoyait, officiellement, la démilitarisation de la région de Kidal, l’octroi d’un statut particulier
pour les régions du Nord et l’affectation de 47,3 % des crédits d’investissement aux régions du Nord. 41 Le 26 mars 1991, un coup d’État renverse le général d’armée Moussa Traoré, lui-même arrivé au pouvoir par le même
moyen en 1968. Un Comité de transition pour le salut du peuple est mis en place avec à sa tête le Lieutenant Colonel
Amadou Toumani Touré, qui deviendra plus tard Chef de l’État, « par les voies naturelles », à la suite de son élection en
2002, avant d’être renversé à son tour en 2012 dans le contexte d’une mutinerie liée à la crise du nord Mali, deux mois avant
la fin de son mandat. L’armée malienne s’est donc malheureusement toujours invitée dans la vie institutionnelle de son jeune
pays, à l’image de certains de ses voisins : l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Burkina-Faso et la Guinée. 42 Principalement s’agissant de la décentralisation, de l’utilisation des budgets prévus pour la région et de l’intégration des
combattants. 43 Pour une chronologie de la crise malienne, voir par exemple :
http://www.irinnews.org/fr/Report/95263/MALI-Chronologie-du-conflit-dans-le-nord-du-pays
44 Ce passage doit beaucoup à l’utilisation du travail de Charles Grémont (Touaregs et Arabes dans les forces armées
coloniales et maliennes. Une histoire en trompe-l’œil. Note de l’Ifri, Institut Français des Relations Internationales (IFRI),
Paris, 2010) 45 Grémont, 2010 46 Troupes coloniales auxiliaires composée d’autochtones. 47 « Vassaux libres » devant payer un tribut aux premiers. Aujourd’hui, ce rapport, comme le tribut, semblent relever plus de
la symbolique, dans la pratique, même si la hiérarchisation au sein des communautés touarègues demeure. 48 Il commencera en 1974 et se poursuivra ensuite dans les années 80 49 Poulton, Robin-Edward ; Youssouf, Ibrahim ag, La paix de Tombouctou. Gestion démocratique, développement et
construction africaine de la paix, Genève : Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), 1999,
p.47
50 Entre le 22 février et 23 mars 2003, six groupes de touristes sont enlevés avec leurs véhicules dans le désert, près d’Illizi:
trente-deux personnes au total, dont seize Allemands, dix Autrichiens, quatre Suisses, un Néerlandais et un Suédois. Les
otages seront libérés en deux fois, le 13 mai et le 18 août 2003 (Gèze, Mellah : 2007) 51 Appelé aussi Amari Saïfi, entre autres multiples identités. 52 Autour de 5 millions de dollars, selon diverses sources 53 Le 08 février 2013, Vicki J. Huddleston, ambassadrice des États-Unis au Mali de 2002 à 2005, déclare sur la chaîne
française iTélé, que la France aurait versé, indirectement, des rançons à Aqmi pour libérer les quatre otages français enlevés
au Niger en 2010. Ces rançons seraient passées entre les mains du gouvernement malien pour ensuite retourner, en partie,
aux salafistes. Le montant des sommes évoquées par Mme Huddleston est de 17 millions de dollars. (Ndlr : les intermédiaires
connus à cette époque, pour les affaires d’otages, ne sont pas exclusivement des maliens du sud, à l’image de Moustapha ould
Limam Chafi, mauritanien très introduit à Ouagadougou, Iyad ag Ghali que l’on ne présente plus, Baba Ould Cheick maire
arabe de Tarkint etc.). 54 Rémy, Jean-Philippe, « « El Para », le chef salafiste capturé dont personne ne veut », Le Monde, 26.05.2004 55 La question de contreparties financières exigées éventuellement par le MDJT comme facteur bloquant étant à mettre en
relation avec les sommes considérables allouées aux rançons payées aux ravisseurs pour libérer les otages. 56 Tlemçani, Salima, « Hattab assigné à résidence, Abderrazak El Para en prison », El Watan, 201.06.2011
57 Verront le jour les initiatives américaines Pan-Sahel en 2002, puis Trans-Sahara Counterterrorism Initiative (TSCTI) en
2005 et son volet militaire, Enduring Freedom. En réaction, les autorités algériennes, soucieuses de ne voir s’installer aucun
acteur puissant dans ce qu’elles considèrent comme leur profondeur stratégique, créeront, en 2010, le Comité d'état-major
opérationnel conjoint (CEMOC) regroupant quatre des pays les plus touchés par les actions d'AQMI (Algérie, Mali, Niger,
Mauritanie). Ces initiatives échoueront à atteindre leurs objectifs affichés. L’Union Européenne, quant-à elle, restant en
retrait, car toujours aux prises avec la difficile construction d’une politique de défense et d’action extérieure commune, et,
compte tenu d’approches nationales différentes s’agissant de la libération de ressortissants retenus en otage dans la région. 58 Mines et gisements d’énergie fossile exploités industriellement. 59 La question du Sahara occidental, pour le Maroc. 60 Ammour, Laurence, Évaluation des risques liés à la criminalité dans l’arc sahélien, Research Paper n° 53, Nato Defense
College, November 2009. 61 Initialement avion de ligne moyen-courrier, c’est un appareil, qui, vieillissant, fut par exemple utilisé pour le transport de
carburant vers des mines reculées en Angola, exploitant des « pistes » d’atterrissage extrêmement rudimentaires. Apprécié en
raison de sa rusticité, de la position de ses réacteurs (réduisant le risque d’ingestions) et naturellement de son coût à l’achat. 62 Champin, Christophe. « La drogue au cœur du conflit au Mali », Radio France Internationale, 12.02.2013
63 Map courtesy of the EMCDDA, Monitoring the supply of cocaine to Europe, (October 2008), p.14:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/technical-datasheets/cocaine-trafficking - consulté le 15/02/2013 64 Berghezan, Georges. Côte d’Ivoire et Mali, Au cœur des trafics d’armes en Afrique de l’Ouest. Les Rapports Du GRIP.
Bruxelles: Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), February 7,
2013. http://grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2013/Rapport_2013-1.pdf- consulté le 15/02/2013
65 Mandraud, Isabelle. « Al-Qaida, une tentation pour de jeunes Touareg », Le Monde, 15/10/2010 66 http://www.cerium.ca/Le-bon-eleve-le-Mali-et-nous - consulté le 15 février 2013 67 Nous partageons l’analyse de Roland Marchal : « D'abord, la France et son allié américain doivent faire le bilan de leur
incapacité à peser dans les années qui ont précédé la crise : la célébration de la trop fameuse démocratie malienne et la
coopération militaire avec ce pays ont trop duré pour qu'on puisse accepter l'apparente surprise du printemps où deux tiers du
pays ont été conquis sans résistance de l'armée malienne et la démocratie réduite aux acquêts par un mouvement de colère de
jeunes officiers conduits par le capitaine Amadou Saya Sanogo, responsable du coup d'État du printemps ». in « Il faut
assortir l'engagement militaire de réformes économiques », Le Monde.fr, 2012.10.25
68 L’attentat à la bombe contre une discothèque de Berlin-Ouest fréquentée par des soldats américains le 5 avril 1986, la
destruction en vol d’un 747 de Pan American le 21 décembre 1988 aux environs de Lockerbie et celle d’un DC-10 d’UTA le
19 septembre 1989 au dessus du Sahara occasionnant au total 432 victimes, lui étant, par exemple, imputés. 69 Levée de l’embargo et des sanctions internationales. 70 Amesys, filiale de Thalès entre autres fournisseurs. 71 « Kadhafi plante sa tente à Paris », Le Figaro, 08/12/2007 –
http://www.lefigaro.fr/international/2007/12/07/01003-20071207ARTFIG00430-visite-controversee-de-kadhafi-a-paris.php,
consulté le 15/02/2013 72 http://www.frontex.europa.eu/ 73 Avec des camps de rétention de migrants, dans une Libye n’ayant jamais signé la Convention de Genève sur les réfugiés.
http://www.courrierinternational.com/article/2008/06/18/les-camps-de-retention-toujours-plus-nombreux (2008) - consulté le
15/02/2013 74 De nombreux témoignages et des rapports d’ONG ont dénoncé des conditions d’incarcération indignes, la violence etc.
Pendant le printemps libyen, l’accusation –aux relents souvent expressément racistes– d’être des « mercenaires » noirs rendra
encore plus difficile leur situation. Certains rejoindront inévitablement les laissés pour compte amers de la région. 75 La solution du Niger étant peu probable compte tenu de l’origine majoritairement malienne des touaregs « libyens » et des
infrastructures sensibles liées à l’industrie extractive de l’uranium dans ce pays, et, l’Algérie déjà réticente sur l’intervention
en Libye ne souhaitant pas ajouter de la turbulence dans le sud de son territoire.
76 Véhicules 4x4 armés en nombre, transport de troupes, armement lourd etc. 77 Ronald Reagan avec la crise des otages en Iran lors de la campagne présidentielle pour son premier mandat (1981), Jacques
Chirac et les otages du Liban entre les deux tours de l’élection présidentielle de 1988. 78 Associée à des acteurs nord Maliens comme le MNLA etc. 79 L’administration Sarkozy reprochant à celle d’Amadou Toumani Touré son peu d’efficacité en général et sur la question
des otages, en particulier. 80 Probablement le français Pierre Camatte. 81 « Du rififi chez les émirs d'AQMI », Maghreb Confidentiel, 12/01/2012 82 Kheira critiquera également Abdelmalek Droukdel, à qui il reprochait de ne pas attribuer de postes importants aux non-
Algériens
83 http://www.rfi.fr/afrique/20121109-mali-nord-mujao-deserteur-niger-bilal-hicham-cicr - consulté le 15/02/2013 84 Cette assurance avait été reportée à l’époque dans toute la presse malienne. On peut en trouver la trace dans cet article en
ligne : « Mali, l’effondrement d’une grande Nation III : de la bérézina militaire à la déconfiture intellectuelle. » in Mali actus
le 24/07/2012 : http://maliactu.net/mali-leffondrement-dune-grande-nation-iii-de-la-benezina-militaire-a-la-deconfiture-
institutionnelle/ - consulté le 15/02/2013 85 Corruption, instrumentalisation des tensions internes, patrimonialisation de la vie politique, rétractation sur Bamako etc. 86 Repris le 27 mai par Le Parisien : « Nord du Mali: Les rebelles touareg et les islamistes d’Ansar Dine fusionnent. »
Leparisien.fr (avec AFP), May 27, 2012. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/nord-du-mali-les-rebelles-touareg-et-
les-islamistes-d-ansar-dine-fusionnent-27-05-2012-2019055.php.
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal
déclaration surréaliste venant d'un chef d'État montre 1 'étendue de la méfiance qui existait entre l'armée et les autorités politiques en place. Du fait de cette méfiance et de l'absence totale de réaction crédible de la classe politique malienne (opposition comme parti au pouvoir), des manifestations de plus en plus violentes secoueront les villes du Sud au fur et à mesure que la situation se détériorera au Nord du pays. Notons que l'apathie de la classe politique s'expliquait en grande partie par le fait que les présidentielles étaient prévues pour avril 2012 et que tous les candidats potentiels espéraient décrocher le soutien du président sortant dont c'était le dernier mandat.
Ce n'est qu'après ces mois de troubles et une succession de défaites au Nord que, le 22 mars 2012, une junte menée par le Capitaine Amadou Haya Sanaga prend le pouvoir et décide de suspendre la Constitution, affirmant réagir à l'incompétence manifeste du pouvoir politique. Exactement 15 jours plus tard, cette armée débarrassée du contrôle politique se faisait chasser de toutes les villes du Nord par le MNLA et ses alliés. Le 6 avril 2012, le MNLA déclarait de manière unilatérale l'indépendance du Nord Mali qu'il rebaptisait Azawad. Si l'on tient compte de la séquence d'événements ayant mené au coup d'État, il est difficile de faire du coup d'État la seule (ou même la principale) cause proximale du désordre malien actuel. De manière plus profonde, le coup de force lui-même, ainsi que la partition subséquente du Mali, est une conséquence de l'incompétence d'autorités politiques incapables de se mobiliser face au problème crucial que posait à l'État malien, la jonction des forces touarègues avec les forces islamistes. Ce coup de force fut également l'illustration d'une armée malienne trop peu républicaine pour admettre qu'en toute circonstance, le sort d'une armée est d'être subordonné au strict commandement du pouvoir civil, ce dernier fut-il incompétent.
La seconde cause proximale que nous identifions est l'effondrement des élites maliennes, plutôt qu'un événement ponctuel. Par effondrement, nous entendons ici l'ensemble des facteurs85 ayant conduit au discrédit d'une grande partie de l'élite politique et administrative malienne auprès de sa population, et, singulièrement, les déchirements au sein de ces groupes dans leur compétition pour le pouvoir même au plus fort de la crise malienne. Nous gardons naturellement à l'esprit les très nombreux maliens, de toutes conditions, remarquablement attachés au service de leur pays. Si nous acceptons cette hypothèse, la séquence qui suit le coup d'État s'éclaire d'un jour nouveau. En effet, après le coup d'État, l'incapacité de l'armée malienne à réduire la rébellion n'a fait que s'accroître. La classe politique de Bamako s'étant montrée, de manière constante, incapable d'aboutir à des positions communes que ce soit pour condamner le coup d'État ou pour travailler avec les nouvelles autorités face aux menaces mettant en jeu l'intégrité territoriale du pays. Si l'on prend en considération l'élite touarègue, qui après tout n'est pas moins malienne, elle ne s'est pas montrée moins inconséquente que celle du Sud. En effet, les Touaregs après s'être alliés aux islamistes -annonçant même dans un communiqué à l'Agence France Presse du 25 mai 201286 l'autodissolution du MNLA et d'Ansar Dine- perdront l'essentiel du Nord Mali au profit de forces islamistes notamment exogènes. Les élites du nord Mali ne valent donc pas mieux que celles du Sud.
RIE> ._IWIIILPIJBniJII www. th 1 n kt an k-1 pod a .or a
88 Rappelons encore une fois l’image du Mali sous ATT auprès de la communauté internationale, du FMI et de la Banque
Mondiale : un exemple démocratique doublé d’un statut de « bon élève » au plan économique.
89 L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de vie...)
90 Signalons que selon certaines sources, il existerait, dans les régions aurifères du Sénégal oriental, au voisinage de la
Guinée, des villages qui échapperaient au contrôle de l’État, dans un contexte de prédation des ressources naturelles.
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal
L'éducation et l'insertion de la jeunesse :un enjeu de sécurité nationale ? Comme nous l'avons vu, une chose importante que la crise malienne souligne, c'est la nécessité d'avoir des élites solidement formées et mettant l'intérêt de l'État au dessus de leurs propres intérêts. Nous avons pointé comme principale cause proximale de la crise malienne l'effondrement des élites locales. Il est indéniable, comme nous l'avons vu que le système éducatif sénégalais est meilleur que celui du Mali. Nous avons également une élite mieux formée que ce soit à travers l'École Nationale d'Administration et de Magistrature ou les deux principales universités sénégalaises que sont I'UCAD et I'UGB. Contrairement au Mali également, le flot d'étudiants sénégalais allant étudier dans les grandes universités et écoles étrangères ne s'est jamais tari depuis l'indépendance. Le Sénégal contrairement au Mali a toujours fait le choix de conserver le système élitiste et sélectif hérité de la colonisation française. De ce fait, même si les inégalités sont plus fortes au Sénégal qu'au Mali comme nous l'avons vu en comparant les deux coefficients de Gini, il n'en demeure pas moins que le niveau de formation générale est meilleur au Sénégal ainsi que le montrent les indicateurs du PNUD que nous avons cité plus haut. Cela dit, même si la situation actuelle du Sénégal semble meilleure que celle du Mali, on peut difficilement se réjouir de la qualité de notre système scolaire. Si le recours massif aux volontaires et vacataires de l'éducation a permis à notre pays de tenir ses engagements de réduction du taux d'encadrement et d'augmentation du taux de complétion de l'enseignement primaire et secondaire, il n'en demeure pas moins que ces enseignants, peu sélectionnés, moins bien formés et payés que leurs collègues sont également moins compétents que ces derniers. Or ce programme de recrutement d'enseignants au rabais perdure depuis l'année scolaire 1995-1996. De plus depuis au moins la fin des années 80, les grèves sont devenues une constante de la vie scolaire sénégalaise, notre école perdant chaque année au minimum un mois d'enseignement. Ces facteurs font que toute une génération de sénégalais a eu une éducation tronquée tout autant en quantité qu'en qualité. En termes de sécurité nationale et à la lumière de la crise malienne, cela signifie que la majorité de la population risque de manquer du minimum de formation nécessaire à l'exercice du contrôle démocratique. Si cette situation devait perdurer, elle ne manquerait pas de creuser le fossé entre une élite capable d'éduquer ses enfants et une population dont les enfants fréquentent un système scolaire déficient. Cela minerait la légitimité des élites et, d'abord, la loyauté envers un État tenu par ces élites puis, selon un processus semblable à celui que nous avons décrit pour les Touaregs maliens, le sentiment national. Une hypothèse alternative serait que cette population mal formée accède effectivement au pouvoir mais dans ce cas nous nous retrouverions face à une élite aussi médiocre que celle dont nous avons décrit les agissements durant la crise malienne. L'un et l'autre terme de l'alternative sont un danger pour la sécurité de notre pays.
La crise de basse intensité sénégalaise Un autre aspect selon lequel le Sénégal ressemble au Mali est que le Sénégal aussi gère une CBI depuis 30 ans maintenant. Tout comme pour le Mali d'avant fin 2011, tous les observateurs semblent convenir que la crise casamançaise ne remet pas fondamentalement en cause la stabilité et la pérennité de l'État sénégalais. De fait, depuis le début de l'année 2013, des progrès semblent être fait dans la voie de la résolution de la crise casamançaise. Une question que l'on pourrait se poser cependant est celle de savoir ce qu'il en serait de cette crise si l'un de nos voisins du Sud ou la Gambie en venait à plonger dans le chaos. Ne pourrait-on pas imaginer un effet domino par lequel des armes guinéennes90 ou gambiennes se retrouveraient aux mains de groupes armés au Sud. Sommes-nous parés à une telle éventualité ? Le Sénégal a-t-il une politique de défense sophistiquée intégrant de tels scenarii et y réagissant le cas échéant. Ce que le cas malien nous apprend, c'est
RIE> ._IWIIILPIJBniJII www. th 1 n kt an k-1 pod a .or a
91 « Démission du chef de corps du bataillon des commandos : A l’origine, une rupture du stock de munitions », Sud
Quotidien, 2012.02 - http://www.lequotidien.sn/index.php/societe/item/8515-confidences-demission-du-chef-de-corps-du-
bataillon-des-commandos--a-lorigine-une-rupture-du-stock-de-munitions - consulté le 15/02/2013 92 Obaidullah, Farah ; Osinga, Yvette. How Africa is Feeding Europe; EU (over)fishing in West Africa. Expedition Report.
Greenpeace International - greenpeace.org, September 2010.
La crise malienne et ses leçons pour le Sénégal
qu'une CBI non résolue peut avoir une évolution foudroyante à la faveur d'un changement géopolitique imprévu. La chute de Kadhafi et l'afflux d'armes subséquent dans un pays peu préparé à une telle éventualité ont contribué à la partition du Mali. Que se passerait-il en cas de déstabilisation de la Gambie et de démantèlement et transfert de l'arsenal de ce pays vers des groupes armés ? C'est là une question que nos stratèges doivent penser avant que notre CBI se transforme en CFI.
Enfin, un dernier facteur de CBI ignoré nous semble être la situation des militaires sénégalais. De manière symétrique à ce qui se passe dans le reste de la société sénégalaise, l'armée sénégalaise est extrêmement inégalitaire avec une poignée d'officiers supérieurs choyés par la Nation et le reste y compris les officiers vivant des conditions financières assez difficiles. Par ailleurs, des militaires de retour d'opérations extérieures ont été jusqu'à devoir manifester, par le passé, pour recevoir les primes qui leur étaient dues, à plusieurs reprises. Cette situation est extrêmement préoccupante car même si l'armée sénégalaise s'est toujours illustrée par son républicanisme ce type de mouvement d'humeur est un mauvais signal. C'est, après tout, d'une mutinerie semblable que la calamiteuse aventure du capitaine Sanogo et de ses hommes a débuté au Mali. Enfin, l'armée sénégalaise à pu être prise en défaut à plusieurs reprises en Casamance, jusqu'à voir 8 de ses soldats pris en otage au cours d'une seule attaque, et un officier supérieur commandant une unité d'élite, menacer de démissionner en opération, à la suite de graves dysfonctionnements logistiques91
.
La question, par exemple, des moyens aériens disponibles aujourd'hui pour assurer un appui feu efficace, l'évacuation de blessés et l'approvisionnement sur un théâtre d'opération reste ouverte. Celle des objectifs et moyens de l'appareil de renseignement militaire et civil et ceux nécessaires, au plan économique, à la protection des ressources halieutiques sénégalaises également92
.
Les questions touchant à la défense des intérêts nationaux et leurs enjeux ne devraient pas être réservées à l'ombre. C'est après tout l'affaire de tous les sénégalais qui seraient mieux disposés à des sacrifices pour leur sécurité et plus généralement pour l'intérêt national, en étant éclairés.
RIE> ._IWIIILPIJBniJII www. th 1 n kt an k-1 pod a .or a
> Siége social Yoff Dj~ Mbaye Lot No 12 Bis BP : 25318 Dakar ~ > Sénégal
>Contact Tél. : 77 977 7310177 612 40 40 Email : [email protected]
Retrouvez-nous sur ; - 0
1 DE Innovations Politiques
& Démocratiques
•• www. thinktank-ipode.org