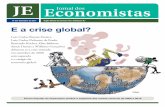L’Islande et le Portugal : une crise financière, deux gestions différentes de la crise
-
Upload
minoan-aegis -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L’Islande et le Portugal : une crise financière, deux gestions différentes de la crise
1
Jean-Marc FOBE 2ième BAC POLS HD Année académique 2012-2013 Titulaires de cours : O. Paye et P.-P. Van Gehuchten Université Saint-Louis de Bruxelles
Séminaire de Sciences Politiques : Les textes fondateurs
Travail final à l’aide de 3 textes fondateurs :
L’Islande et le Portugal : une crise financière, deux gestions différentes de la crise
2
1. Introduction
Le travail portera sur la crise financière vécue par 2 pays (l’Islande et le Portugal), qui
essaient avec des approches différentes de s’en sortir. N’oublions pas que le Portugal fait
partie de la zone euro et de l’UE.
Et que l’Islande ne fait pas partie de la zone euro ni de l’UE mais qu’elle fait bien partie de
l’association européenne de libre-échange. Le Portugal connait une croissance négative tandis
que l’Islande a «le vent en poupe» avec une croissance positive, et ce depuis un certain
nombre d’années.
Pourtant les deux pays ont fait appel au FMI, qui ont par la suite mené à des résultats
différents. La dernière question de la partie I nous enseignera sur les raisons qui ont conduits
à ces différences.
Une des raisons de s’intéresser à ce problème politique est le pouvoir croissant des marchés
financiers, et plus particulièrement les agences de notation qui peuvent rehausser ou rabaisser
leur niveau de confiance dans la capacité d’un pays à rembourser leur dette publique.
L’Islande est un exemple d’une démocratie où le peuple s’est retourné contre son
gouvernement, à tel point qu’il a réussi à le faire démissionner. Les citoyens de ce pays ont
manifesté leur colère en faisant valoir la mauvaise gestion de la crise financière par leurs
gouvernants… Une deuxième raison de s’intéresser à ce pays est le refus par référendum de
rembourser les épargnants britanniques et hollandais.
Le Portugal est un des cinq pays de la zone euro à avoir demandé l’aide de l’UE et du FMI.
Et ceci afin de rassurer e.a. les marchés financiers.
Une autre raison est une question de ressources puisqu’une personne de notre classe est
d’origine portugaise.
Une dernière raison de s’y intéresser est que les deux pays ont été particulièrement exposés à
l’influence que peuvent avoir les marchés financiers sur leur économie.
Dans un premier temps, on reprendra la chronologie des événements au Portugal et en
Islande. Cette structure du temps m’a semblé la plus adéquate pour décrire et analyser le
phénomène politique contemporain. Dans les 2 pays on commencera cette ligne du temps par
l’année 2008, l’année où le Portugal et l’Islande ont secouru leurs banques avec des approches
différentes. Et l’actualité ira même jusque 2012-2013. On terminera cette partie 1 avec 3
questions sur la santé économique des 2 pays, l’évolution des banques et le pourquoi de la
croissance de l’économie islandaise par rapport à la décroissance de l’économie portugaise.
Dans un deuxième temps, on préparera le cadre d’analyse en présentant les lignes directrices
des trois concepts, tirés de trois textes fondateurs qui ont marqué la discipline des sciences
politiques. La souveraineté populaire de Jean-Jacques Rousseau du contrat social y est
abordé. Une souveraineté qui appartient au peuple selon le philosophe français. Le deuxième
concept est celui de la post-souveraineté de Bertrand Badie. Pour l’auteur contemporain les
états ne sont plus souverains actuellement, et on y mentionnera les 8 critères en se concentrant
en particulier sur deux d’entre eux (le jeu triangulaire et la transaction) qui expliqueront
pourquoi les états actuellement ont perdu toute leur souveraineté. Le troisième concept est
celui du marché concurrentiel où d’après Smith le marché est lui-même le garant de l’égalité
de l’offre et de la demande sur le marché des biens et services. Les interventions d’états ne
font que créer des inégalités.
3
La troisième partie traitera de l’application des concepts au phénomène politique. On
reprendra chacun des concepts en confrontant le Portugal à l’Islande. On verra notamment
que la souveraineté populaire de Rousseau a néanmoins produit plus de résultats jusqu’à
présent en Islande qu’au Portugal. Adam Smith avec son marché concurrentiel s’est avéré
plus difficile à placer dans le contexte des 2 pays, vu les interventions faites par les nations en
question dans le secteur bancaire. Néanmoins le concept de Smith s’appliquera bien aux
marchés financiers tels qu’ils les sont aujourd’hui.
L’application du dernier concept de la post-souveraineté n’a au contraire pas connu des
difficultés de transposition au cas du Portugal et de l’Islande.
On terminera avec une conclusion qui doit démontrer l’intérêt et les limites des ressources des
textes fondateurs. Dans cette dernière partie on survolera les points importants qu’il faut
retenir concernant la souveraineté populaire de Rousseau et la post-souveraineté de Badie,
ainsi qu’une plus grande difficulté pour le concept de marché concurrentiel d’Adam Smith.
Tout cela en reprenant les points importants vis-à-vis de son application au Portugal et à
l’Islande.
2. Le phénomène politique contemporain:
2.1 La crise financière au Portugal
Par le biais d’une chronologie des événements, on va précéder à la description et à l’analyse
de la crise financière au Portugal. Pour faire une analyse correcte on remontera dans le temps,
de sorte qu’on puisse connaître les facteurs déterminants qui ont conduit le pays à demander
l’aide du FMI et de l’UE au mois d’avril 2011.1
Lorsque la bulle immobilière a éclaté, mieux connu sous la crise des ‘subprimes’ ou la crise
financière, au Etats-Unis en 2007, il a fallu un an avant qu’elle ne se propage vers le Portugal.
Tout comme de nombreuses banques européennes, les banques portugaises ont elles aussi
investi dans les fonds réputés « toxiques » proposées par les grandes banques
d’investissement. Lorsque ces fonds ne valaient plus grand-chose, dû à l’éclatement de la
crise des ‘subprimes’ au niveau mondial, les banques portugaises ont présenté des bilans
chargés de passif.
Ceci obligeait l’état portugais à intervenir pour sauver les épargnes des portugais en
renflouant certaines banques, à commencer par une des plus importantes: Banco Português de
Negócios (BPN). En 2008 la banque privée BPN a une dette de 1,8 milliard d’€2, et le
gouvernement décida d’intervenir suite à la découverte d’irrégularités dans sa gestion. Elle fut
nationalisée et recapitalisée (2 milliards d’Euros) sous le contrôle de la banque publique CGD
en 2008. Plus tard cette même banque CGD connaitra des difficultés et devra à son tour être
recapitalisée pour un montant de 1,65 milliard d’€.3
1 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 2 The Portugal News Online, The Lusa News Agency, State nationalises troubled Portuguese bank [en ligne],
http://theportugalnews.com/news/state-nationalises-troubled-portuguese-bank/25480 (consulté le 22 avril 2013) 3 NB, AFP, Dette/Finance: Le Portugal injectera 665 mds d’euros dans trois banques dont la CGD publique [en ligne], http://www.news-
banques.com/dette-finance-le-portugal-injectera-665-mds-deuros-dans-trois-banques-dont-la-cgd-publique/012197425/
(Consulté le 3 avril 2013)
4
Trois autres banques portugaises suivront dans la foulée: la banque BPI (1,5 milliard d’€)4, la
banque BCP en 2012 (3 milliards d’€)5 et finalement la banque BANIF en 2013 (1,1 milliard
d’€).6 Ces efforts apparaissent malgré le défaut de la ‘Banco Privado Português’ (BPP), qui
est mise en liquidation après avoir été déclarée dans l’impossibilité de rétablir sa croissance
par la banque centrale portugaise le 15 avril 2010.7
Dans ce cas précis, ce sont deux cadres de l’entreprise qui ont été mis en accusation de
malversations et qui ont précipité la perte de leur institution financière. Ces deux personnes
sont maintenant poursuivies en justice pour une fraude collective pour un montant de 41
millions d’€8.
Tout a commencé avec le déficit public de 9,3% du PIB9 pour l’année 2009 (le triple par
rapport à 2008: un déficit public de 2,9% du PIB), annoncé le 8 mars 201010, qui a provoqué
une perte de confiance dans la capacité du Portugal d’honorer ses engagements au cours de
l’année 2010, et ce malgré l’annonce le même jour que le gouvernement allait procéder à un
premier programme de mesures d’austérité. Ceci a provoqué une hausse de 20% des taux
d’intérêts des bons d’état lusitaniens (pour une durée de 5 ans)11.
Entretemps, et suite à l’annonce du gouvernement portugais du déficit public, les agences de
notation ont tour à tour rabaissé leur note sur les bons d’état portugais. Les trois agences
principales, Fitch Ratings, Standard & Poor’s et Moody’s, ont pris ces décisions entre le mois
de mars et le mois de juillet 201012.
Il est intéressant de rappeler que les agences de notation analysent e.a. la valeur des bons
d’état pour chaque pays qui en émet. Ces analyses permettent aux investisseurs potentiels de
faire le choix d’acheter ou non des bons d’état d’un pays en question.
Le gouvernement essaya encore à deux reprises de calmer la volatilité des marchés financiers:
d’abord en annonçant un nouveau programme d’austérité le 13 mai 201013, puis 6 mois plus
tard en novembre 201014 en faisant adopter par le parlement un nouveau budget d’austérité.
Ceci ne fut toujours pas suffisant puisque les taux d’intérêts des bons d’état portugais
restèrent toujours aussi haut, avec comme conséquence que l’état portugais dut continuer à
emprunter de l’argent sur les marchés financiers à des taux d’intérêts extrêmement
désavantageux. Le résultat fut l’augmentation croissante et rapide de la dette publique
portugaise ces dernières années.
4 NB, AFP, Dette/Finance: Le Portugal injectera 665 mds d’euros dans trois banques dont la CGD publique [en ligne], http://www.news-
banques.com/dette-finance-le-portugal-injectera-665-mds-deuros-dans-trois-banques-dont-la-cgd-publique/012197425/ (Consulté le 3 avril 2013) 5 NB, AFP, Dette/Finance: Le Portugal injectera 665 mds d’euros dans trois banques dont la CGD publique [en ligne], http://www.news-
banques.com/dette-finance-le-portugal-injectera-665-mds-deuros-dans-trois-banques-dont-la-cgd-publique/012197425/
(Consulté le 3 avril 2013) 6 NB, AFP, Dette/Finance: Le Portugal injectera 665 mds d’euros dans trois banques dont la CGD publique [en ligne], http://www.news-
banques.com/dette-finance-le-portugal-injectera-665-mds-deuros-dans-trois-banques-dont-la-cgd-publique/012197425/ (Consulté le 3 avril 2013) 7 Business, The Portugal News Online, EU approves 450m loan to BPP [en ligne], http://theportugalnews.com/news/eu-approves-450m-loan-to-bpp/91 (consulté le 22 avril 2013) 8 Business, The Portugal News Online, EU approves 450m loan to BPP [en ligne],
http://theportugalnews.com/news/eu-approves-450m-loan-to-bpp/91 (consulté le 22 avril 2013) 9 Challenges, SDV Plurimedia, La chronologie de la crise financière dans la zone euro [en ligne],
http://www.challenges.fr/monde/20110721.CHA2212/la-chronologie-de-la-crise-financiere-en-zone-euro.html (Consulté le 4 avril 2013) 10 Challenges, SDV Plurimedia, La chronologie de la crise financière dans la zone euro [en ligne], http://www.challenges.fr/monde/20110721.CHA2212/la-chronologie-de-la-crise-financiere-en-zone-euro.html (Consulté le 4 avril 2013) 11 Truyens, J., « Ierland en Portugal Terugkeer op de financiële markten», Puilaetco Dewaay Analyses Monthly, n°16, Maart 2013, p. 5 12 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 13 Challenges, SDV Plurimedia, La chronologie de la crise financière dans la zone euro [en ligne],
http://www.challenges.fr/monde/20110721.CHA2212/la-chronologie-de-la-crise-financiere-en-zone-euro.html (Consulté le 4 avril 2013) 14 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013)
5
Le troisième facteur est d’ordre politique, puisque le quatrième plan d’austérité prévu par le
gouvernement minoritaire de José Socrates n’a pas reçu le feu vert du parlement le 23 mars
201115. Ce plan d’austérité devait éviter au pays de demander de l’aide au FMI et à l’UE.
Suite au refus du parlement, le premier ministre démissionna. Ce ne fut, plus que jamais,
qu’une question de temps avant que le Portugal fasse appel à son tour à la troïka (l’EC, la
BCE et le FMI).
Cette instabilité politique a eu pour conséquence une hausse brutale des taux d’intérêt des
bons d’état portugais (à cinq ans) à 7,51% (le soir même)16. Ceci est bien une preuve que, sur
les marchés financiers, le manque de stabilité politique est considéré comme un critère
important pour une hausse des taux d’intérêts.
Et ce qui devait arriver, arrivât. Le 6 avril 201117 le Portugal demande officiellement l’aide
du FMI et de l’UE. Le 5 mai 201118, un mois plus tard, les Portugais obtiennent un accord
pour un prêt de 78 milliards d’€, moyennant l’application d’un programme d’austérité. Et dire
que 6 semaines plus tôt le parlement, avec une opposition majoritaire, avait rejeté un nouveau
plan d’austérité! 12 milliards seront notamment qui seront alloués au sauvetage éventuel des
banques portugaises. A ce jour, plus de 6 milliards ont déjà été consacré au sauvetage de 4
institutions financières.
D’abord on rejette l’austérité, et puis on en arrive malgré tout à négocier un nouveau plan
d’austérité, qui cette fois-ci est imposé par l’extérieur. Le 6 juin 201119, l’opposition prend le
pouvoir à la suite d’élections anticipées. Cette même opposition de droite qui a refusé le plan
d’austérité quelque mois auparavant, devra, ironie du sort, appliquer elle-même le plan
d’austérité du FMI et de l’UE. Les citoyens ne sont pas contents de leur gouvernement, et les
remplacent par l’opposition qui devra malgré tout appliquer les mêmes préceptes: des mesures
d’austérité!
Malgré toutes les mesures d’austérité prises par l’état portugais depuis début 2010, et l’accord
conclu avec le FMI et l’UE au mois de mai 2011 les agences de notation continuent à
rabaisser leur note sur la dette portugaise. La première à le faire est l’agence Moody’s qui
abaisse la dette du pays lusitanien au mois de juillet 201120.
En novembre 201121 la nouvelle coalition de droite vote à son tour un nouveau programme
d’austérité, ce qui provoque une grève générale.
Le même mois, l’agence Fitch Ratings annonce à son tour qu’elle baisse la note de la dette
portugaise. Une fois de plus, et ce malgré l’adoption d’un nouveau programme d’austérité,
une autre agence contribue à enfoncer le Portugal dans une spirale dont il aura du mal à s’en
sortir. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque la dernière agence de notation,
Standard & Poor’s, décide elle aussi de baisser sa note sur la dette portugaise au statut de
« spéculative » au mois de janvier 201222.
15 International Europe, Le Monde, Portugal : de la crise financière à la crise politique [en ligne], http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/03/24/portugal-de-la-crise-financiere-a-la-crise-politique_1497778_3214.html,
(consulté le 6 avril 2013) 16 International Europe, Le Monde, Portugal : de la crise financière à la crise politique [en ligne], http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/03/24/portugal-de-la-crise-financiere-a-la-crise-politique_1497778_3214.html,
(consulté le 6 avril 2013) 17 Challenges, SDV Plurimedia, La chronologie de la crise financière dans la zone euro [en ligne], http://www.challenges.fr/monde/20110721.CHA2212/la-chronologie-de-la-crise-financiere-en-zone-euro.html (Consulté le 4 avril 2013) 18 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 19 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 20 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 21 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 22 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013)
6
Néanmoins, le mois de septembre 201223 donne enfin une première bonne nouvelle au
Portugal, puisque la troïka permet aux Lusitaniens d’atteindre le but de faire diminuer le
déficit public à moins de 5,5% du PIB en recevant un délai supplémentaire d’un an. Ceci
encourage le parlement portugais à adopter un nouveau budget d’austérité au mois de
novembre 201224.
Le Portugal, pour honorer ses obligations internationales, devra faire face à une nouvelle
année de mesures d’austérité pour atteindre le but imposé par le FMI et l’UE. En attendant le
Portugal peut se réjouir d’une deuxième bonne nouvelle en voyant ses taux d’intérêts baisser
dans le cours de 2012 avec une diminution de 66%25 pour les bons d’état lusitaniens (à cinq
ans) par rapport au niveau record de 2010 et 2011.
Quel est l’état de l’économie portugaise en 2013?
La croissance du PIB était encore positive en 2010 (+1,9)26, et ce malgré une première année
d’austérité imposée par le gouvernement. Après elle est devenue négative en 2011 (-1,6%) et
en 2012 (-3,2%) avec le programme d’austérité mise en place du FMI et exécuté par l’état
portugais.
Le taux de chômage a monté en flèche depuis le début de la crise financière en 2008 et s’est
accentuée une deuxième fois depuis 2011. En 2008 le chômage était de 8% et il a atteint
16,9% fin 2012.
Le déficit public atteignait un record en 2009 avec 10,2% du PIB. En 2010 et en 2011 il
descendait à 9,8% et 4,4% respectivement, pour ensuite remonter à 6,4% du PIB. La dette de
l’état par rapport au PIB ne fait, par conséquent, que croître depuis 2009 (juste après
l’éclatement de la crise financière). De 83,7% en 2009 elle est passée à 123%27 du PIB en
2012.
En analysant ces chiffres, tout laisse à penser que le Portugal est encore loin d’être sorti de
problèmes, avec une croissance en berne, une dette publique en hausse et un chômage
croissant. L’austérité imposée au Portugal ne permet clairement pas de relancer la
consommation des ménages et l’investissement des entreprises. Les indicateurs économiques
en sont la preuve.
Comment vont les banques portugaises depuis leur recapitalisation par l’état?
La banque BANIF a été recapitalisée en 201328. C’est trop récent pour en tirer des
conclusions.
La banque BPN quant à elle, a été reprise par la banque publique CGD .
La banque privée BPI a affiché en 2012 un profit de 249 millions d’euro29. La banque
publique CGD a affiché une perte de 395 millions d’euro en 201230. Par rapport à 2011, ils
ont fait mieux (488 millions dans le rouge), mais ça reste une perte conséquente. La banque
publique BCP tient le triste record de la plus grosse perte du secteur en 2012 : de 1,2 milliard
d’€31, mais plus de la moitié de la perte est dû à une opération en Grèce (694 millions d’€).
23 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 24 BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013) 25 Truyens, J., « Ierland en Portugal Terugkeer op de financiële markten», Puilaetco Dewaay Analyses Monthly, n°16, Maart 2013, p. 5 26 Instituto Nacional de Estatistica, Statistics Portugal, Portal do Instituto Nacional de Estatistica [en ligne], http://www.ine.pt (consulté le 7 avril 2013) 27 Instituto Nacional de Estatistica, Statistics Portugal, Portal do Instituto Nacional de Estatistica [en ligne], http://www.ine.pt
(consulté le 7 avril 2013) 28 NB, AFP, Dette/Finance: Crise : une aide temporaire de 11 milliard d’euros pour la banque Banif [en ligne],
http://www.news-banques.com/crise-une-aide-temporaire-de-11-milliard-deuros-pour-la-banque-banif/0121109481/
(Consulté le 2 avril 2013) 29 Enjalbert, BNP Paribas, Banques portugaises : bilan d’une année en transition [en ligne],
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21824 (consulté le 7 avril 2013) 30 Enjalbert, BNP Paribas, Banques portugaises : bilan d’une année en transition [en ligne], http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21824 (consulté le 7 avril 2013) 31 Enjalbert, BNP Paribas, Banques portugaises : bilan d’une année en transition [en ligne],
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21824 (consulté le 7 avril 2013)
7
Apparemment, les banques qui sont privées affichent des meilleurs résultats que les banques
étatiques.
Comment peut-on expliquer que l’économie portugaise n’arrive toujours pas à reprendre sa
croissance, depuis l’instauration des mesures d’austérité en 2010?
Une des mesures prises par le gouvernement est la hausse de la TVA à 23%. Une telle mesure
n’encourage pas la consommation puisque les prix vont alors automatiquement monter aussi.
Une telle décision diminue la consommation des ménages et au final l’état voit ses recettes
fiscales diminuer au lieu d’augmenter. En diminuant les allocations diverses les gens ont aussi
moins de pouvoir d’achat, ce qui ne relance pas du tout l’économie puisque la consommation
stagne ou même recule.
2.2 La crise financière en Islande
Pour comprendre les causes de la crise financière en Islande, il est nécessaire, comme avec le
Portugal, de retracer les évènements chronologiquement. L’île a dérégulé ses services
financiers en 200132 et a privatisé dans la foulée ses banques en 200233. Ceci semble être un
indice important pour expliquer les conséquences ci-dessous.
Le surendettement devenait ensuite la norme, notamment avec le crédit immobilier facilement
accordé sans contrepartie exigée de la part des banques (avant la crise financière). Toujours
pour l’immobilier, les taux d’intérêts des banques étaient indexés sur l’inflation, ainsi que leur
rattachement aux devises étrangères. Lorsque celles-ci prenaient de la valeur par rapport à la
monnaie locale, la dette, contractée par les crédits, augmentait aussi.
Lorsque la bulle immobilière explosait aux Etats-Unis avec la faillite de Lehmann Brothers
le 15 septembre 200834, la crise financière a vite rejoint l’Islande. Il ne fallait pas grand-
chose pour faire basculer cette île de 320.000 habitants, de plus en plus endettée, dans une
spirale de difficultés financières. La tourmente de septembre 2008 fit se tarir le prêt
interbancaire. Les trois banques islandaises se trouvèrent alors rapidement à court de
liquidités, effet renforcé par le surendettement et la chute des prix de l’immobilier.
Le gouvernement, voyant ses trois banques principales en danger, prend la décision
courageuse de reprendre leur contrôle. La première banque à être nationalisée est Glitnir,
le 29 septembre 200835. Pour 600 millions d’euros de liquidités, l’état devient actionnaire à
75% de la troisième banque du pays.
Le 6 octobre 200836 le premier ministre Geir Haarde promulgue des lois d’urgence qui
permettent à l’état, le cas échéant, de reprendre le contrôle des banques lorsqu’elles se
trouvent en difficulté.
32 Pascal Riché, Comment l'Islande a vaincu la crise, éditions Versilio, 115 p. 33 Ibid. 34 Ibid. 35 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne], http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013) 36 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne],
http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013)
8
Le 7 octobre 200837 le gouvernement prend le contrôle de la deuxième banque du pays ,
Landsbanki. Sa filiale Ice-Save (une banque en ligne), détient plus de dépôts étrangers que de
dépôts nationaux. Les dépôts étrangers proviennent essentiellement de la Grande-Bretagne et
des Pays-Bas, Ice-Save offrant jusqu’à 6%38 de taux d’intérêts aux détenteurs de comptes
d’épargne.
Et lorsqu’Ice-Save s’effondra, le gouvernement décida de garantir uniquement les dépôts de
ses citoyens islandais. La réaction de la Grande-Bretagne ne se fit pas attendre et n’eut d’autre
alternative légale que de mettre l’Islande sur la liste des pays terroristes, afin d’être en mesure
de geler les avoirs des établissements islandais au la Royaume-Uni. Dans la foulée, le
gouvernement britannique prend le contrôle sur les avoirs de la banque islandaise Kaupthing à
Londres. Cette décision britannique sera lourde de conséquence pour les Islandais, puisque
pratiquement plus personne ne voudra prêter de l’argent à un pays jugé comme « terroriste ».
Le 9 octobre 200839 la plus grande banque du pays, Kaupthing, est à son tour reprise par
l’état islandais.
Le 24 octobre 200840, l’Islande fait appel au FMI pour éviter qu’on puisse douter de la
capacité de l’Islande d’emprunter de l’argent, et obtient un accord de principe.
Le 10 novembre 200841 le FMI remet à plus tard la ratification d’un prêt à l’Islande. Cette
décision pourrait être est liée au fait que les Pays-Bas et à la Grande-Bretagne mettaient une
obstruction du à l’incertitude, liée au refus de l’Islande de garantir les dépôts étrangers
provenant de ces mêmes pays. Les trois pays en conflit règlent leurs différents, et le 19
novembre 200842 le FMI ratifie enfin le prêt de $ 2,1 milliards à l’Islande.
Ceci entraîne un effet « boule de neige » puisque soudain d’autres nations européennes
commencent à accorder des prêts au pays nordique. Le pays se voit donc à nouveau considéré
comme solvable !
En janvier 200943, suite aux manifestations et un changement de coalition politique, Geir
Haarde, le premier ministre, et son gouvernement démissionnent. Les manifestants en veulent
au gouvernement : la raison principale évoquée est, selon ce qui a été véhiculé par les media,
la mauvaise gouvernance de la crise financière et la nationalisation précipitée de la banque
Glitnir. Les manifestants obtiennent aussi, dans les semaines qui suivent, la démission des
autorités de surveillance des banques et la démission de la direction de la banque centrale
islandaise.
C’est inédit puisque les manifestants avaient trois demandes : les démissions du
gouvernement, des autorités de surveillance bancaires et de la banque centrale islandaise, et
ils ont obtenu gain de cause. Il est remarquable qu’une population soit capable de changer les
choses si elle s’organise, et les Islandais en ont montré l’exemple en 2009.
37 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne], http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013)
38 Pascal Riché, Comment l'Islande a vaincu la crise, éditions Versilio, 115 p. 39 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne],
http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013) 40 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne], http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013) 41 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne],
http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013) 42 Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne],
http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013) 43 BBC News Europe, BBC, Iceland profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17386859 (consulté le 5 avril 2013)
9
Depuis lors, les Tunisiens et les Égyptiens ont fait de même en renversant leur dictateur lors
du printemps arabe en 2011. C’est bien la preuve que lorsque les gouvernés ne sont pas
contents de la gestion des gouvernants, le peuple est alors capable de renverser ses dirigeants.
En décembre 200944, le gouvernement fait passer de justesse une loi devant le parlement,
acceptant de rembourser les dépôts des épargnants britanniques et hollandais pour un montant
n’excédant pas € 3,9 milliards, mais le public refuse et manifeste devant le parlement pendant
plusieurs jours en soumettant une pétition réclamant au président de la république de ne pas
signer cette loi. Le président obtempère et soumet la question à la population par référendum.
Le 6 mars 201045 la population vote non, à la loi en question, à 93% des voix.
Un an après le gouvernement, réitère au mois de décembre 201046 et sous la pression des
britanniques et des Pays-Bas, en faisant passer une nouvelle loi, avec une majorité
confortable, cette fois plus en faveur du remboursement des dépôts Ice-Save britanniques et
néerlandais. La population, à son tour, refuse à nouveau de payer l’addition et arrive à
convaincre le chef de l’état, avec une pétition de 40.000 signatures, de refuser à nouveau de
signer cette loi.
Comme la première fois il fait organiser un référendum pour soumettre cette loi à l’avis de ses
concitoyens, et le 9 avril 201147, et à nouveau le non l’emporte à 58%. Les citoyens islandais
ne se sentent pas responsables de la mauvaise gestion de leurs dirigeants. C’est pour ça qu’ils
ont voté non à deux reprises puisqu’ils considèrent cette dette illégitime et non souveraine,
puisque ce sont les dirigeants des banques privées qui ont contracté ces dépôts étrangers et
non la population islandaise ni l’état islandais. En effet : pourquoi l’état devrait-il être tenu
responsable de la mauvaise gestion des banques privées?
Le président Grimsson s’est vu récompensé pour sa ténacité en se faisant réélire en juillet
201248 avec une avance confortable sur sa rivale, et ce pour un cinquième mandat consécutif à
la tête de l’état.
Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, en revanche, n’en sont pas restés là puisqu’ils ont
poursuivi, par l’intermédiaire de la Commission européenne, l’Islande devant le tribunal de
l’association européenne de libre-échange (AELE). Le 28 janvier 201349 le tribunal a
exonéré l’Islande de toute infraction sur la garantie des dépôts bancaires et de toute
discrimination entre épargnants nationaux et étrangers. Dans la foulée, le gouvernement
islandais répéta à Londres et à La Haye que la vente des actifs de Landsbanki permettra de
toute façon de rembourser les gouvernements britanniques et hollandais. A l’époque, les
épargnants hollandais et britanniques ont été remboursés de leurs dépôts par leurs
gouvernements respectifs, ce qui explique sans doute leur détermination.
44 Pascal Riché, Comment l'Islande a vaincu la crise, éditions Versilio, 115 p. 45 Ibid. 46 Ibid. 47 Ibid. 48 BBC News Europe, BBC, Iceland profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17386859 (consulté le 5 avril 2013) 49 Bauer, Les Echos, L’Islande gagne en justice contre Bruxelles et Londres [en ligne],
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202530163189-l-islande-gagne-en-justice-contre-bruxelles-et-londres-
533093.php (consulté le 30 mars 2013)
10
Comment va la santé économique de l’Islande actuellement?
Malgré la crise financière ,qui a durement touché le pays de 2008 à 2010, le pays nordique
renoue depuis 2011 avec une croissance positive: 2,9% en 2011 et 1,6% en 2012.50
L’inflation est sous contrôle: en 2010 plus de 8% et elle se maintient en légère décroissance à
3,9% en janvier 2013.
Le chômage est de 4,7% au mois de février 2013. Fin 2010, le chômage était de 8% en
Islande. En observant ces chiffres, on peut conclure que l’Islande va mieux et se trouve sur
une pente ascendante.
Qui l’aurait cru en décembre 2008? Le FMI fait même l’éloge de la reprise économique de
l’Islande en septembre 2012.
Qu’est-il advenu des trois banques Islandaises?
L’état a laissé les trois banques faire faillite, pour ensuite en créer de nouvelles. Puis, ils ont
donné le choix aux créanciers des banques faillites de choisir entre 2 options: soit recevoir des
actions de ces nouvelles banques, soit de recevoir des titres de dette. Les créanciers de Glitnir
et de Kaupthing ont accepté de devenir actionnaires des nouvelles banques Islandsbanki et
Arion. Ceux de Landsbanki ont préféré recevoir des titres de dette. Ces deux décisions ont eu
comme conséquence que deux des trois banques sont passées dans des mains privées.
Landsbanki, quant à elle, est restée sous le contrôle de l’état islandais. Tout cela s’est décidé
rapidement dans le courant de l’automne 200851, juste après le mois d’octobre critique qui a
vu le gouvernement prendre le contrôle des trois banques principales du pays.
Comment les Islandais ont-ils fait pour relancer leur économie aussi rapidement?
Le syndicat des patrons, le gouvernement et les nouveaux représentants du secteur bancaire
ont décidé d’écrêter ou de rééchelonner les dettes des ménages et des entreprises surendettés.
Les banques ont également fait un geste en effaçant la dette des ménages propriétaires de leur
maison au dessus de 110% de la valeur de leur bien immobilier.52 Tout ça, et encore bien
d’autres mesures, ont permis de créer à nouveau un climat propice aux investissements et à la
consommation, ce qui explique en grande partie comment l’économie Islandaise en quelque
années seulement.
3. Le cadre d’analyse
Cette partie définira trois concepts des textes fondateurs: le premier est la souveraineté
populaire du livre «Du contrat social» de Jean-Jacques Rousseau, le deuxième concept est la
post-souveraineté de l’ouvrage de Bertrand Badie « D’une souveraineté fictive, à une post-
souveraineté incertaine» et le dernier est le marché concurrentiel d’Adam Smith du livre de
Pierre Manent « Les libéraux ».
Le contenu abordera d’une part une définition exhaustive des trois concepts de chacun des
auteurs des textes fondateurs avec les principaux points en relation avec ces mêmes concepts.
D’autre part on abordera une définition plus personnelle de l’auteur de ce travail final des
trois concepts. Pour démontrer ma compréhension des concepts je le traiterai en relation avec
l’objet de l’étude : à travers des exemples bien précis avec comme but de personnaliser ma
propre définition des concepts.
50 Hagstofa Islands, Statistics Iceland, Statistics [en ligne], http://www.statice.is/ (consulté le 7 avril 2013)
51 Pascal Riché, Comment l'Islande a vaincu la crise, éditions Versilio, 115 p. 52 Ibid.
11
3.1 Jean-Jacques Rousseau: la souveraineté populaire
Dans le cadre du sujet politique contemporain il me semblait judicieux de suivre la
recommandation de Monsieur Paye de prendre la souveraineté populaire de Rousseau à la
place de la souveraineté de Bodin. Puisque la population qui représente la souveraineté d’un
état a joué un rôle prépondérant en Islande et dans une moindre mesure au Portugal.
Selon ma définition de la souveraineté populaire de Rousseau, elle est incarnée par le peuple,
avec un souverain comme exécutant de la volonté générale du peuple.
Le souverain est à la tête de l’état. L’état a pour fonction de faire le bien commun. Dès que
le souverain sait prendre sans conséquences des décisions particulières au nom de l’état,
le peuple a perdu de facto sa souveraineté. Qui ne dit mot consent!
Il était dés lors judicieux d’accepter ce concept puisqu’on se retrouvait face à une opposition
entre le Portugal qui n’a pas suivi la volonté générale de son peuple par rapport à l’Islande qui
a à plus d’une reprise tenu compte de l’avis de sa population.
Là où il y a eu de la délibération avec le peuple on constate que l’économie se porte mieux.
Rousseau fait finalement une distinction importante entre la volonté générale du peuple qui
est représenté par sa puissance législative et la force du souverain qui est représenté par sa
puissance exécutive. Mais ces deux puissances se retrouvent dans la même personne
puisqu’elle est indivisible. Aujourd’hui le parlement ferait figure de puissance législative
aussi bien au Portugal qu’en Islande. Et la puissance exécutive est symbolisé par le
gouvernement, ensemble avec le président de la république qui doit signer les lois pour les
rendre effectifs. Et ce, dans les deux pays : l’Islande et le Portugal !
La première référence dans le contrat social de Rousseau à la souveraineté est ce qu’on
appelle de nos jours le droit de propriété. Le droit de propriété s’arrête là où elle entrave celle
des autres. Ca veut dire qu’elle appartient d’abord et avant tout à la communauté. L’intérêt
particulier est subordonné à la volonté générale du groupe. C’est une ligne directrice à travers
tout le chef d’œuvre du philosophe des Lumières.
Dans le livre II les chapitres I, II et III forment la pierre angulaire de la définition de
souveraineté selon Rousseau.
Dans le chapitre I la souveraineté inaliénable représente la volonté générale, qui elle-seule
peut diriger l’état. A la tête de l’état est le souverain qui représente le peuple et ne peut être
que l’exécutant de la volonté générale du collectif. Et la fin de l’état est le bien commun. A
aucun moment la volonté générale ne peut devenir un intérêt particulier. Rousseau est clair et
net en définissant la différence entre volonté générale et volonté particulière : « la volonté
particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l’égalité ».53
La souveraineté ne vaut plus rien dans le cas suivant : « Si donc le peuple promet simplement
d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître
il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. »54 Mais tant que les
décisions du souverain vont de pair avec l’accord préalable de sa population, la souveraineté
reste intacte.
Dans le chapitre II Rousseau considère le principe de la souveraineté comme indivisible. Si
on la divise en plusieurs groupes elle ne représenterait plus qu’un intérêt particulier d’un
groupe en particulier, et certainement pas la volonté générale de l’ensemble.
53 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, Amsterdam, 1762, p.11 54 Ibid., p.11
12
Mais l’objet de la souveraineté est divisible selon la classe politique « en force et en volonté,
en puissance législative et en puissance exécutive. »55 Et la souveraineté ne peut être
partagée : « les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous
subordonnées ».56
Dans le chapitre III le philosophe nous donne quelque conseils empreint de sagesse pour
arriver à la volonté générale d’un peuple. Il faut que le peuple soit suffisamment informé
premièrement. Que la délibération est basée sur le consensus deuxièmement. Tertio qu’il ait
une bonne délibération sans qu’un groupe en particulier impose sa volonté aux autres. Que
les personnes qui participent à la délibération soient représentatifs de la société et
suffisamment nombreuses pour éviter l’inégalité de la décision. « Ces précautions sont les
seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée, et que le peuple ne se
trompe point. »57
Et finalement Rousseau en arrive aux limites du pouvoir souverain dans le chapitre IV. Les
décisions qui sont prises par le souverain avec le consentement de son peuple est appelé le
contrat social. Le but de cette convention générale est la suivante :
« que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu’ils s’engagent tous sous les
mêmes conditions, et doivent jouir tous des mêmes droits. »58
Et qu’une autre limite est « ne peut passer les bornes des conventions générales ». Il définit
aussi ce que doit être un acte de souveraineté : « Ce n’est pas une convention du supérieur
avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres. »59 Voulant dire
qu’un contrat est seulement valable uniquement pour ceux qui font partie de ce ‘corps’.
3.2 Bertrand Badie: La post-souveraineté
Il me semblait très pertinent d’inclure la post-souveraineté de Bertrand Badie dans mon
travail. Parce qu’au niveau de la zone euro les états ne semblent plus être souverains de leur
politique monétaire (le Portugal) dû à l’ingérence d’acteurs internationaux, et même en dehors
de la zone euro (l’Islande).
Selon mon interprétation personnelle la post-souveraineté de Badie est une post-souveraineté
vidée de toute sa substance: signifiant qu’un état post-souverain ne dispose plus d’une
souveraineté, et que cette souveraineté n’a jamais existé selon l’auteur. En nommant 8
critères il fait table rase du contenu de la définition de souveraineté qu’on entend aujourd’hui
au sens commun: la capacité des peuples à disposer d’eux-mêmes. On se limitera seulement à
2 critères pour expliciter la notion de post-souveraineté: le jeu triangulaire et les transactions
qui s’en suivent entre ces mêmes acteurs du jeu triangulaire. Le jeu triangulaire est composé
d’acteurs étatiques, d’acteurs transnationaux et d’acteurs identitaires.
Le jeu triangulaire dans l’objet d’étude implique des acteurs étatiques des 2 pays concernés,
avec l’acteur transnational le FMI, qui a conduit chacune des nations à conclure une
transaction avec cette organisation internationale.
55 Ibid., p.11 56 Ibid., p.12 57 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Marc-Michel Rey, Amsterdam, 1762, p.13 58 Ibid., p.14 59 Ibid., p.14
13
On en abordera seulement deux: le jeu triangulaire et les transactions. Les transactions sont
des contrats entre 2 acteurs au minimum du jeu triangulaire. Les acteurs étatiques (p.ex. l’état
islandais et l’état portugais), les acteurs transnationales (p.ex. les multinationales et les
marchés financiers) et les acteurs identitaires (p.ex. l’Ecosse, le Pays basque, etc.) font tous
partie de la mondialisation des acteurs. Dans ce travail apparaitront des tensions entre les
marchés financiers et l’état. D’où la perte de souveraineté de l’état qui doit composer malgré
lui avec des acteurs qui n’obéissent qu’aux lois du marché (les agences de notation
notamment et les marchés financiers).
Les agences de notation et les marchés financiers ont contribué à la dégradation croissante de
la crédibilité de la dette portugaise publique. Ce qui a suivi est une transaction entre un acteur
étatique (le gouvernement portugais) et deux acteurs transnationaux (le FMI et l’UE). Une
transaction qui lie le Portugal à diminuer sa dette publique par rapport à son PIB.
D’où la pertinence d’avoir abordé la transaction et le jeu triangulaire qui eux-mêmes sont très
liés. Puisque le premier critère explicité la transaction est la conséquence directe du deuxième
critère : le jeu triangulaire entre les différents acteurs.
Pour Bertrand Badie la souveraineté n’a jamais existé puisque sans la reconnaissance d’autrui
je ne peux pas être considéré comme souverain. C’est très subjectif d’après lui :
« La souveraineté n’existe que dans le regard de l’autre ».60 Ma souveraineté s’arrête là où
elle empiète celle des autres. Mais si il devait quand même donner une définition ce serait la
suivante : « La souveraineté, c’est l’irresponsabilité absolue, en ce qu’elle dispense l’Etat de
rendre compte de ses actes à la communauté internationale ».61 Pour en revenir à la
limitation du concept « la souveraineté d’un Etat est limitée par le respect des traités. »62
Pour Badie un état post-souverainiste est un état, qui n’a plus de souveraineté.
Dans son texte il donne toute une série d’éléments pour démontrer qu’on se trouver plutôt
dans un monde post-souverain.
Les 8 critères pour expliciter la post-souveraineté sont: le nombre croissant des états dans le
monde, l’interdépendance des états, la mort du cavalier seul, la communication, le multi-level,
le jeu triangulaire, les transactions et l’ingérence de la communauté internationale.
Dans un contexte mondialisé les états doivent rendre des comptes puisqu’ils sont
interdépendants. Ce qu’un état fait, peut nuire aux autres états. D’où le principe de
responsabilité. Le deuxième critère avec lequel les états doivent tenir compte, est l’idée
d’obligation qu’on est soumis à protéger « les biens communs de l’humanité partout où ils
sont menacés ».63 Et qui va faire respecter ça ? Les états puissants post-souverainistes, qui
cette fois-ci « sous le regard de tous ces acteurs internationaux que nous sommes »64, ne
pourront plus faire ce qu’ils veulent. Ils seront dorénavant tenus responsables de leurs actes.
60 BADIE, B., « D’une souveraineté fictive à une post-souveraineté incertaine », Studia Diplomatica, vol LIII, 2000, p.7 61 Ibid., p.12 62 Ibid., p.7 63 Ibid., p.12 64 Ibid., p.13
14
3.3 Adam Smith (d’après Pierre Manent):
Le marché concurrentiel
Le choix du concept du marché concurrentiel est logique, vu le rôle croissant des marchés
financiers dans la politique des pays. Combien de fois n’avons-nous pas entendu l’annonce
d’une mesure… parce que ça calmerait les marchés financiers ? Et dans le cadre de mon
travail le Portugal a été une victime des marchés en faisant monter tellement haut les taux
d’intérêts que le pays n’a pas eu d’autre choix que de demander de l’aide au FMI et à l’UE.
Selon la définition de l’auteur de ce travail le marché concurrentiel d’Adam Smith est sous-
entendu comme l’équilibre entre l’offre et la demande qui satisfera ainsi les besoins de chacun
d’entre-nous, à condition d’avoir une libre concurrence au niveau de l’offre et au niveau de la
demande. Ce qui conduira à plus d’égalité selon Smith. Dans le cas du Portugal et de
l’Islande les banques offraient du crédit, et d’un autre côté les citoyens étaient demandeurs de
crédits. Mais la demande était plus forte que l’offre, et ce qui a entrainé un déséquilibre sur le
marché bancaire des 2 pays ! A voir plus en détail dans la partie I et la partie III du travail !
Pour l’économiste écossais le marché doit décider lui-même de l’organisation d’une société,
et certainement pas l’état qui à travers ses interventions ne ferait qu’augmenter
vraisemblablement l’inégalité au sein de cette même communauté.
Selon Adam Smith le marché fonctionne le mieux lorsqu’il n’y a le moins possible
d’interventions de la part de l’état. C’est à ce moment-là que l’offre et la demande se tiennent
le plus en équilibre. Démontrons cette théorie sur le marché de l’emploi : les métiers
attrayants où tout le monde voudrait travailler, vont faire baisser les salaires par le nombre
croissant de concurrents. Les métiers les moins attrayants vont avoir de moins en moins de
concurrents. Ce qui conduira à une hausse substantielle de leurs rémunérations qui avoisinera
les salaires des professions attrayantes à la condition sine qua non qu’on laisse le marché
faire.
Mais l’interventionnisme de l’état peut augmenter ou diminuer la concurrence sur le marché.
C’est pour ça que la libre concurrence est le meilleur moyen pour l’économiste écossais de
garantir l’équilibre au niveau notamment des salaires, de l’emploi et le prix de vente du
produit (=le prix d’équilibre). Ce que les économistes appellent aujourd’hui un marché
concurrentiel.
Dans un marché autorégulateur le libre-échange est capital puisque « le libre-échange permet
à l’industrie de chaque nation de profiter des avantages comparatifs des autres nations (en
achetant leurs produits aux prix relatifs les plus bas) en même temps que des siens
propres. »65
Un des principes est de se spécialiser dans ce qu’on sait faire le mieux dans l’intérêt de la
société « à acheter l’un de l’autre , que de faire eux-mêmes ce qui ne concerne pas leur
aptitude particulière ».66 Un boucher ne saurait pas faire ce qu’un boulanger sait faire, et vice
versa !
L’écrivain de « La richesse des nations » parle de deux bornes au principe de libre-échange
dans un marché concurrentiel : la première « c’est quand une espèce particulière d’industrie
est nécessaire à la défense du pays ».67
65 P. Manent, Les Libéraux, Paris, 1986, p. 363 66 Ibid., p. 369 67 Ibid., p. 369
15
Par exemple on ne peut pas confier la défense d’un pays à l’armée d’un autre pays, parce que
cette armée-là coûte moins chère que l’armée nationale.
La deuxième borne est « de laisser la concurrence entre l’industrie étrangère et l’industrie
nationale, aussi près que possible des conditions où elle se trouvait auparavant. »68
Signifiant de mettre « lui-même de quelque impôt sur le produit du même genre, de
fabrication étrangère. »69
Ces deux bornes sont des mesures de protectionnisme. Mais Smith n’en reste pas là puisque
deux autres cas nécessitent éventuellement aussi de défendre l’intérêt national en péril.
Le premier cas était la taxation forte par une nation étrangère à l’entorse du principe de la
libre circulation de biens et de services. De ce fait on gêne l’importation d’un de nos produits.
Uniquement « dans ce cas, on est naturellement porté à user de représailles ».70 Ce qui
permettra à terme de fléchir la position de la nation étrangère en question.
La deuxième éventualité de taxation est une situation de domination nationale qui emploie
tellement de monde que lorsque il s’agit d’enlever des barrières douanières il faut le faire
graduellement. Voulant dire que ça devrait être fait lentement et annoncé très tôt avec une
application très tardive de permettre à l’industrie nationale de s’adapter aux nouvelles règles
en vigueur du marché. Aujourd’hui on appelle ça une libéralisation graduelle du marché des
biens et services (par l’entremise de l’OMC).
Si on ne le fait pas graduellement mais soudainement «il pourrait se faire que le marché
intérieur fût inondé aussitôt de marchandises étrangères à plus bas prix».71
4. L’application du cadre d’analyse
au phénomène politique contemporain
Préambule
La partie III abordera l’application des concepts au Portugal et à l’Islande dans l’ordre
suivant: le marché concurrentiel d’Adam Smith, la souveraineté populaire de Jean-Jacques
Rousseau et la post-souveraineté de Bertrand Badie.
Lors de chaque concept énuméré et appliqué on confrontera les différences et les similitudes
entre le Portugal d’une part, faisant partie de la zone euro et de l’UE, et l’Islande d’autre part,
ne faisant pas partie de la zone euro et de l’UE.
Le contenu abordera aussi les actions des gouvernants (l’état) par rapport aux actions des
gouvernés (le peuple). En ce qui concerne le marché concurrentiel on se penchera plus
particulièrement sur les cas de protectionnisme qui ont eu lieu durant la gestion de la crise
bancaire des 2 pays. Si ces actions rentrent dans les exceptions établies par Mr. Smith.
Le concept de souveraineté populaire subira lui la comparaison entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, en application sur le pays nordique et sur le pays lusitanien.
On finira avec la post-souveraineté du seul auteur contemporain Bertrand Badie en reprenant
deux dimensions qui me semble le plus judicieux à retenir: le jeu triangulaire et la transaction.
68 Ibid., p. 370 69 Ibid., p. 370 70 P. Manent, Les Libéraux, Paris, 1986, p. 370 71 Ibid., p. 371
16
Aussi bien le Portugal que l’Islande sont des états post-souverains sur lesquels on peut
appliquer ces deux critères.
Néanmoins une question fondamentale est à reprendre ici :
Qu’est-ce qui a précipité l’intervention de l’état dans le secteur bancaire des 2 pays?
C’est la faillite de la banque américaine Lehman Brothers le 15 septembre 2008 qui entraînera
une réaction en chaîne des autres banques. Les institutions financières vont arrêter du jour au
lendemain de se prêter de l’argent mutuellement. Les banques portugaises et islandaises vont
tomber à cours de liquidités. Ce qui entraînera l’état à intervenir, mais avec des actions
différentes.
4.1 L’application du marché concurrentiel au Portugal
et à l’Islande
Le marché concurrentiel est un marché de libre-échange où l’offre et la demande se
rencontrent en fonction des besoins de chacun.
En Islande l’offre des banques ont rencontré une demande qui s’endettait de plus en plus.
Au Portugal les banques ont également connu une demande de plus en plus insolvable.
La conséquence de tout cela est un manque à gagner qui conduira à des problèmes de
liquidités pour les banques concernées.
Quelles furent les actions des gouvernants dans le secteur bancaire suite à l’éclatement de la
bulle immobilière?
Une grande différence est tout d’abord à faire entre le Portugal et l’Islande : la crise a
commencé au Portugal en 2010 et en Islande en 2008.
Parce que le Portugal a mené une politique interventionniste dans le secteur immobilier avec
la construction d’habitations sociales et un emprunt hypothécaire subsidié par l’état.72
Ce qui a évité dans ce pays l’éclatement de la bulle immobilière. Néanmoins la période est la
même pour les 2 pays pour le début de la crise bancaire : l’année 2008 suite à la faillite de
Lehman Brothers.
Le gouvernement portugais a décidé de recapitaliser ses banques problématiques afin de
garantir des liquidités suffisantes: pour que les banques puissent subvenir à leurs obligations.
De son côté l’état islandais a repris le contrôle de ses banques principales. Après, le
gouvernement a donné le choix aux créanciers des 3 banques: deux d’entre eux ont préféré
devenir actionnaire des nouvelles banques. La troisième est restée aux mains de l’état. Là les
créanciers ont préféré des titres de dette.
Dans les 2 pays on a assisté à des interventions étatiques pour venir en aide aux banques.
Cela n’aurait sans doute pas enchanté Adam Smith.
Mais est-ce que ces interventions auraient pu remplir une des 4 exceptions de
protectionnisme, écrit dans «La richesse des nations»?
Malheureusement il n’y a aucune exception qui remplit les critères de l’économiste écossais:
ni en Islande, ni au Portugal.
La quatrième exception se rapproche le plus (l’industrie nationale forte?) puisque les banques
islandaises représentaient dix fois le PIB de leur pays en 2008.
72 Montagu-Pollock, Global Property Guide, House price falls continue in Portugal [en ligne],
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Portugal/Price-History (consulté le 9 avril 2013)
17
Mais le changement international (l’arrêt des prêts) avec la faillite de Lehman Brothers fût
soudain et il ne s’est pas fait graduellement. L’effet fût le même au Portugal avec l’arrêt
brutal des prêts dans le secteur bancaire à l’annonce de la faillite de la banque américaine.
Comment le peuple (les gouvernés) a-t-il réagi?
Aussi bien au Portugal qu’en Islande le peuple a manifesté son mécontentement des politiques
de leurs gouvernements respectifs de la crise, mais avec des résultats différents.
Le peuple islandais a réagi très rapidement à la gestion de la crise financière en manifestant
son ras-le-bol, et au bout de quelque mois le gouvernement a dû démissionner sous la pression
populaire. Par la suite le peuple du pays nordique a encore réagi à deux reprises (en 2010 et
en 2011) en votant deux fois non à des référendums concernant le remboursement ou non des
dépôts étrangers.
Pierre Manent en analysant Adam Smith l’a bien défini que le citoyen doit chercher « à faire
prévaloir sa volonté dans l’Etat qui le représente».73 Les citoyens islandais ont réussi cette
gageure trois fois (la démission du gouvernement en 2009, et les deux référendums). Au
Portugal les manifestants ont démontré leur volonté mais jusqu’à aujourd’hui ils n’ont pas
encore prévalu puisque les mesures d’austérité continuent à être implémentées, et ce sur le dos
des citoyens portugais.
Concernant l’application du marché concurrentiel d’Adam Smith au Portugal et à l’Islande:
dans le secteur bancaire, qui fait partie du marché des biens et services, on peut dire à juste
titre que ce n’est plus un marché concurrentiel puisque il y a eu des interventions d’état.
Et qu’on a encore des banques aux mains de l’état dans les deux pays.
Et finalement qu’en est-il des marchés financiers qui ont un grand rôle au Portugal et en
Islande? Est-ce qu’on peut les considérer comme étant un marché concurrentiel d’après
Adam Smith?
Les marchés financiers sont des marchés concurrentiels, non-régulés, avec un équilibre de
l’offre et de la demande avec une fixation de prix d’équilibre qui existe dans les salles des
bourses ou sur internet et où il existe une procédure de négociation.
Sachant aussi que l’information est accessible très rapidement et où la mobilité des capitaux
est pratiquement instantanée.74 Bref Adam Smith aurait vu ce marché d’un très bon œil.
Les marchés financiers ont provoqué la demande d’aide du Portugal au FMI et à l’UE en
faisant monter très rapidement les taux d’intérêts des bons d’état portugais. L’Islande a elle
aussi vu monter ses taux d’intérêts durant la crise financière. Ce qui a aussi provoqué la
demande d’aide au FMI, mais pas de l’UE. Parce que l’Islande ne fait pas encore partie de
l’Union Européenne.
73Pierre Manent, Les libéraux, p. 317 74 Verdonck, M. (2013). Politique économique : Deuxième Baccalauréat en Sciences Politiques, ECPO720. Syllabus, Université Saint-Louis de Bruxelles, Diffusion Universitaire
18
4.2 L’application de la souveraineté populaire
au Portugal et à l’Islande
Quelles furent les actions des gouvernants durant la crise?
En Islande durant les mois de septembre et octobre 2008 le gouvernement de Geir Haarde a
légiféré des lois d’urgence leur permettant de reprendre le contrôle des trois plus grandes
banques du pays. Ils se sont vite rendu compte que l’état (la puissance exécutive selon
Rousseau) ne pouvait pas nationalisé ses banques. Ils ont dés lors donné le choix aux
créanciers de ces banques.
Au Portugal dans le secteur bancaire l’état (la puissance exécutive) a renfloué ses banques.
Depuis 2008 le gouvernement a déjà renfloué 5 banques au total.
Au Portugal, depuis le début 2010 le gouvernement (la puissance exécutive) a instauré des
mesures d’austérité qui ont touché de plus en plus durement sa population. Le peuple a réagi
massivement en manifestant dans les rues pour montrer leur mécontentement envers le
gouvernement. Qu’est-ce que le gouvernement fait? Il continue à propager des mesures
d’austérité les unes plus draconiennes que d’autres. Jean-Jacques Rousseau nous fait valoir
qu’une fois que le souverain prend des décisions sans le consentement préalable du peuple, le
souverain perd sa légitimité.
Aussi bien en Islande et au Portugal le président signe les lois du gouvernement. Les
présidents ont dans les deux pays la possibilité de refuser de signer les lois. Aux yeux de
Rousseau le gouvernement et le président représentent la puissance exécutive de l’état. Le
parlement de chaque pays représente la puissance législative de Rousseau. Et le peuple est le
garant de la souveraineté.
En Islande le Président de la république islandaise a organisé un référendum en 2010 et en
2011 : sur la question du remboursement ou non des dépôts étrangers de la banque Ice-Save,
une banque en ligne islandaise. Le peuple représente aux yeux de Rousseau la souveraineté
du pays et l’exécutant de cette souveraineté est le souverain. Le souverain ( le Président
Grimsson) a à deux reprises refusé de signer la loi et il a décidé à chaque fois de la soumettre
à la population.
Le président l’a fait puisque le peuple a mis la pression sur lui. A chaque fois, à un an
d’intervalle, une pétition a été massivement signé par les citoyens islandais lui demandant de
ne pas signer cette loi. Aux yeux du Président la pétition était représentative de la société
islandaise mais il a prononcé la tenue d’un référendum pour augmenter la représentativité du
refus et avoir une base légale pour tenir tête aux Pays-Bas et à la Grande-Bretagne.
La population a apprécié l’attitude de son souverain en le reconduisant pour un cinquième
mandat d’affilée à la tête de l’état. Il ne voulait même plus se représenter mais sous la
pression du peuple, qui a apprécié sa conduite en respectant la volonté générale, il s’est quand
même représenté… avec succès. Ce président a clairement agi au bien commun de l’état. Et
d’après le philosophe le bien commun est la fin de l’état.
Au Portugal l’actuel président (la puissance exécutive) a déjà refusé plusieurs fois d’apposer
sa signature. Il y a trois mois Monsieur Silva a refusé de signer la loi approuvant le budget
pour 2013. Il a transmis 9 articles du budget à la cour constitutionnelle du pays qui doit les
vérifier s’ils sont conformes aux lois du pays.
19
Et le 5 avril la cour a rendu son verdict : 4 des 9 articles sont inconstitutionnelles.75 Ce qui
oblige le gouvernement, qui forme ensemble avec le président la puissance exécutive, à revoir
sa copie.
Néanmoins d’autres programmes d’austérité ont été signés dans le passé entre 2010 et 2012
avec l’accord du souverain (le président Silva) qui exécute avec le gouvernement la volonté
générale de sa population. Est-ce qu’on peut dire, malgré les protestations massives des
citoyens, que le souverain a respecté la volonté générale du collectif? A première vue d’après
mon analyse des écrits de Rousseau la souveraineté populaire a été mise à mal par son
souverain le président de la république portugaise à plusieurs reprises.
La comparaison entre le Portugal et l’Islande est similaire au niveau des gouvernants :
aussi bien du côté de la puissance exécutive que du côté de la puissance législative. Dans les
2 pays on a assisté à plusieurs reprises à une dissension de la branche exécutive. Les
présidents islandais et portugais ont refusé, au moins deux fois, de signer des lois du
gouvernement, qui ont été votés en premier par la puissance législative (le parlement du
pays).
Comment le peuple (les gouvernés) a-t-il réagi?
En Islande fin 2008, le peuple a fait valoir une première fois sa souveraineté au
gouvernement en leur reprochant la mauvaise gestion de la crise financière, et au bout de
quelque mois de protestations en janvier 2009 les trois demandes du peuple islandais ont été
respectées: la démission du gouvernement, la démission des autorités de surveillance des
banques et la démission de la direction de la banque centrale islandaise.
Là le peuple s’est considéré souverain et a obtenu (selon Rousseau) le départ de la puissance
exécutive et le renouvellement de la puissance législative avec des élections anticipées.
A aucun moment ils ont demandé le départ de leur souverain!
Le Portugal de son côté a connu à des maintes reprises des manifestations et des grèves
contre la politique d’austérité du gouvernement, et ce depuis 2010 lorsque le gouvernement
Socratès a pris pour la première fois des mesures d’austérité, suite à l’annonce d’un déficit
public de 9,3% de son PIB.
Mais peut-on dire aussi que les manifestants sont suffisamment nombreux, qu’ils représentent
dans son ensemble la société portugaise? Puisqu’une des conditions de Rousseau pour
déterminer la volonté générale d’un peuple est la représentativité de la société lors de la
délibération. Le gouvernement n’a à aucun moment procédé à une délibération de son peuple
en organisant un référendum sur les programmes d’austérité. En se basant sur Rousseau on
aurait pris des décisions qui auraient augmenté les inégalités.
Au mois de juin 2011 la puissance législative et la puissance exécutive a été remplacée. Et on
n’a pas vu de changement dans la politique du pays. Les protestations ont continué, signifiant
que la population ne se retrouvait toujours pas dans la gestion publique de son pays.
Signifiant aux yeux de Rousseau qu’il n’y a pas eu de consentement préalable de la
population et que la puissance exécutive se comporte comme un maître.
75 The Irish Times, Reuters, Portugal court rejects some government austerity measures [en ligne], http://www.irishtimes.com/news/world/portugal-court-rejects-some-government-austerity-measures-1.1351536
(consulté le 8 avril 2013)
20
Et plus comme un souverain. Voulant dire que le peuple a perdu sa souveraineté et que le
souverain se comporte comme un maître. Et que le corps politique n’est plus représentatif de
son peuple puisqu’il ne sert qu’un intérêt particulier. Celui des institutions internationales tels
que le FMI, la BCE et la Commission Européenne.
La comparaison entre le Portugal et l’Islande au niveau des gouvernés est différente !
Le peuple islandais a poussé le gouvernement vers la sortie au bout de quelque mois de
manifestations devant le parlement. De son côté les manifestations de masse des citoyens
portugais n’a pas réussi à faire démissionner la puissance exécutive (le gouvernement), ni
même à fléchir la politique des gouvernants (les exécutants de la volonté générale du peuple).
La conclusion est que la population portugaise, ne réussissant pas à imposer sa volonté
générale, a perdu toute sa souveraineté d’après Rousseau. De son côté la population
islandaise a néanmoins réussi à préserver sa souveraineté : deux fois pour les référendums en
refusant de payer pour les dépôts étrangers et une fois en poussant son gouvernement dehors
lui blâmant la mauvaise gestion de la crise financière.
Une parenthèse:
Le Portugal et l’Islande sont des démocraties représentatives qui au parlement ne dispose que
d’une majorité de la puissance législative. Et que nous dit Rousseau comme conseils pour
arriver à la volonté générale du peuple ? Qu’il faut un consensus, une représentativité de tout
le groupe, et qu’un groupe ne peut pas dominer un autre groupe. Qu’est-ce qu’on a au
parlement ? Les décisions se prennent à la majorité des parlementaires, la majorité ne reflète
pas toute la représentativité de tout le groupe des parlementaires, et le groupe majoritaire
domine sur le groupe minoritaire du parlement. La question qu’on peut se poser alors est la
suivante : est-ce que le parlement dans une démocratie représentative reflète la volonté
générale d’un peuple ?
4.2 L’application de la post-souveraineté au Portugal
et à l’Islande
Le Portugal a son jeu triangulaire avec des acteurs étatiques (national, régional et local), des
acteurs identitaires (s’identifier à Porto ou à Lisbonne p.ex.) et des acteurs transnationaux qui
ont joué un rôle crucial dans la crise financière du pays lusitanien (les agences de notation,
l’UE, le FMI et les marchés financiers).
Le Portugal a aussi des transactions, des contrats à respecter: l’acteur étatique avec des acteurs
transnationaux. Le pays doit continuer à remplir ses obligations envers le FMI, la
Commission européenne et la BCE (appelé la troïka).
L’Islande connait également le système du jeu triangulaire. Les banques sont des acteurs
transnationaux, le gouvernement est un acteur étatique et finalement les acteurs identitaires
sont légion. Déjà les différentes couleurs politiques dans le parlement sont chacun des acteurs
identitaires: les rouges, les verts, les bleus, etc.
L’Islande a comme le Portugal emprunté de l’argent au FMI. En contrepartie l’Islande
s’engage à réaliser le contenu de l’accord avec cet acteur transnational qu’est le FMI. Ce qui
remplit le critère de transaction concernant l’Islande.
Au décompte final l’Islande et le Portugal remplissent bien les différents critères d’un état
post-souverainiste.
21
Exceptionnellement pour la fonctionnalité des 2 critères du concept de post-souveraineté on
procédera à l’énumération des acteurs du jeu triangulaire, et des transactions qu’il y a eu entre
ces acteurs du jeu triangulaire au niveau des gouvernants et des gouvernés des 2 pays.
Les gouvernants (les dirigeants)
La transaction avec le même acteur transnational, qui est commune au deux pays, est l’accord
d’un prêt du FMI au gouvernement (des acteurs étatiques) des pays respectifs. La différence
se situe au niveau de l’UE. Le Portugal fait partie de l’UE, et de la zone euro. Elle doit non
seulement composer avec le FMI (1/3 du prêt) mais aussi avec la BCE et la Commission
Européenne (2/3 du prêt). L’Islande de son côté ne fait pas partie de l’UE et de la zone euro.
De sorte elle ne doit seulement tenir compte que du FMI.
Le Portugal ainsi que l’Islande sont propriétaires de trois banques au total. Les banques sont
des acteurs transnationaux et les gouvernements des acteurs étatiques.
Ces deux acteurs se sont liés par une transaction de renflouement.
L’Islande a seulement renfloué une banque et le Portugal en a renfloué déjà au total cinq.
Les marchés financiers et les agences de notation sont des acteurs transnationaux qui ont
précipité la dévaluation de la dette publique des états islandais et portugais. Avec comme
conséquence qu’à un moment donné ils ont dû faire appel au FMI pour s’en sortir.
Les gouvernements se sont liés par des transactions avec ces acteurs transnationaux en
acceptant de faire évaluer leurs dettes publiques à travers des notations et la fluctuation des
taux d’intérêts.
Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont conclu une «transaction» avec l’Islande concernant le
remboursement des dépôts hollandais et anglais le 16 novembre 2008.
Trois acteurs étatiques ont conclu des accords entre eux pour régler un différend financier.
Les gouvernés (le peuple)
Aussi bien les citoyens portugais que les citoyens islandais ont fait des transactions
d’emprunts chez leurs banques, qui ont par la suite connu des problèmes. A tel point que
l’état a dû recapitaliser ses banques. La population portugaise n’a pas fait des transactions
avec son gouvernement puisque ce sont eux contre qui il manifestent.
Dans les 2 pays les acteurs étatiques (les gouvernements) et identitaires (la population) n’ont
fait que s’affronter au lieu de faire des transactions comme le jeu triangulaire l’impose
normalement. La grande similitude réside dans le mode de conflit entre ces deux acteurs et la
grande différence est que le peuple islandais (l’acteur s’identifiant à son pays l’Islande) a
gagné la partie contre l’acteur étatique. Au Portugal ça tourne pour l’instant à l’avantage de
l’acteur étatique qui ne fait qu’obéir aux acteurs transnationaux, appelé aussi la troïka (le
FMI, la CE et la BCE).
22
5. Conclusion
A travers l’étude des textes fondateurs de Jean-Jacques Rousseau et de Bertrand Badie il m’a
semblé que les concepts de souveraineté populaire et de post-souveraineté étaient très
pertinents. C’est le cas aussi pour le marché concurrentiel d’Adam Smith en ce qui concerne
les marchés financiers. Mais on ne sait pas l’appliquer au marché des biens et services, ni au
marché du travail !
Le concept de marché concurrentiel d’Adam Smith fonctionnerait dans une société où une
majeure partie du marché des biens et services seraient soumis à la loi du marché. Ce qui est
loin d’être le cas pour le Portugal et l’Islande. Puisque les dépenses étatiques représentent
respectivement 48,9% et 46,1% du PIB pour l’année 2011.76 La zone euro, dont fait partie le
Portugal, est à plus de 49% dans son ensemble77 en ce qui concerne les dépenses des états.
Et n’oublions pas les interventions différenciées des deux pays pour ses banques. Avec
comme conséquence que 3 banques restent toujours aux mains du public (1 en Islande et 2 au
Portugal). Non, le concept d’Adam Smith ne s’applique pas au marché des biens et services.
La même chose pour le marché du travail puisque le plein emploi n’existe pas : ni au Portugal
et ni en Islande. L’offre doit correspondre à la demande, et pour l’instant il n’y a pas assez
d’offre pour subvenir à la demande du marché du travail.
Pour l’économiste écossais le marché devrait être l’élément dominant d’une société, et
certainement pas l’état qui devrait seulement exercer un rôle limité dans la société.
Néanmoins, il faut nuancer puisque les marchés financiers de nos jours correspondent
parfaitement au concept de marché concurrentiel d’Adam Smith puisque toutes conditions
sont remplies (voir la partie III). En sachant que les marchés financiers ont joué un rôle
prépondérant dans les 2 pays, et ce jusqu’à aujourd’hui.
La souveraineté populaire de Monsieur Rousseau a au contraire rendu très actuelle le déficit
de démocratie dans l’Europe d’aujourd’hui. Le philosophe français mentionne souvent la
volonté générale et la volonté particulière. La volonté particulière a malheureusement prévalu
avec les marchés financiers qui ont mené le Portugal au bord du précipice. Et ce malgré les
manifestations du peuple: les politiciens, qui sont les exécutants de la volonté générale,
continuent à imposer l’un plan d’austérité après l’autre.
En se basant sur les écrits de Rousseau le peuple a clairement perdu sa souveraineté. Puisque
son souverain (le président Silva) ne consulte plus son peuple qui représente pour Rousseau la
souveraineté du pays, et qu’il est devenu de facto un maître. Et ce n’est pas en consultant la
cour constitutionnelle de son pays qu’on peut dire que le peuple a eu son mot à dire.
En Islande le peuple a pu s’exprimer à deux reprises puisque le souverain (le président
Grimsson) a consulté l’avis de sa population en organisant un référendum sur la question du
remboursement des dépôts étrangers de la défunte banque internet Ice-Save. Mais il a fallu
une réaction du peuple pour sauvegarder sa souveraineté en obligeant son souverain à
consulter ses citoyens.
76 Eurostat, European Commission, General government expenditures [en ligne],
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/General_government_expenditure_statistics (consulté le 7 avril 2013) 77 Eurostat, European Commission, General government expenditures [en ligne],
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/General_government_expenditure_statistics (consulté le 7 avril 2013)
23
La post-souveraineté de Bertrand Badie pourrait s’appliquer à la majorité des états dans le
monde actuel. Et en faisant l’exercice des critères sur le Portugal et l’Islande on peut en
déduire à juste titre qu’ils sont tous les deux des états post-souverains. Les agences de
notation, les marchés financiers, les Etats-Unis, le FMI, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne,
l’UE, la BCE, la Commission européenne, Internet, les Organisations internationales
(régissant les différents traités), le tribunal de l’AELE ont tous contribué à l’établissement des
états post-souverainistes portugais et islandais. Ne nous voilons plus la face nous nous
trouvons plus que jamais dans un monde interdépendant et post-souverainiste. L’Islande et le
Portugal ne sont pas des exceptions qui échappent à la théorie plus qu’actuelle de Badie.
24
6. Bibliographie
Livre (Kindle)
Pascal Riché, Comment l'Islande a vaincu la crise, éditions Versilio, 115 p.
Périodique
Truyens, J., « Ierland en Portugal Terugkeer op de financiële markten», Puilaetco Dewaay Analyses Monthly, n°16, Maart 2013, p. 5
Sources internet
NB, AFP, Dette/Finance: Crise : une aide temporaire de 11 milliard d’euros pour la banque Banif [en ligne],
http://www.news-banques.com/crise-une-aide-temporaire-de-11-milliard-deuros-pour-la-banque-banif/0121109481/ (Consulté le 2 avril 2013)
International Europe, Le Monde, Portugal : de la crise financière à la crise politique [en ligne], http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/03/24/portugal-de-la-crise-financiere-a-la-crise-politique_1497778_3214.html,
(consulté le 6 avril 2013)
Instituto Nacional de Estatistica, Statistics Portugal, Portal do Instituto Nacional de Estatistica [en ligne],
http://www.ine.pt (consulté le 7 avril 2013)
Guilhamet & Despax, Toute l’Islande, La chronologie de la crise économique en Islande [en ligne],
http://www.toutelislande.fr/ChronologieCriseIslandaise.html (consulté le 8 avril 2013)
Hagstofa Islands, Statistics Iceland, Statistics [en ligne], http://www.statice.is/ (consulté le 7 avril 2013)
BBC News Europe, BBC, Iceland profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17386859 (Consulté le 5 avril 2013)
BBC News Europe, BBC, Portugal profile [en ligne], http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17761153 (Consulté le 1ier avril 2013)
Challenges, SDV Plurimedia, La chronologie de la crise financière dans la zone euro [en ligne],
http://www.challenges.fr/monde/20110721.CHA2212/la-chronologie-de-la-crise-financiere-en-zone-euro.html (Consulté le 4 avril 2013)
NB, AFP, Dette/Finance: Le Portugal injectera 665 mds d’euros dans trois banques dont la CGD publique [en ligne],
http://www.news-banques.com/dette-finance-le-portugal-injectera-665-mds-deuros-dans-trois-banques-dont-la-cgd-publique/012197425/ (Consulté le 3 avril 2013)
The Irish Times, Reuters, Portugal court rejects some government austerity measures [en ligne], http://www.irishtimes.com/news/world/portugal-court-rejects-some-government-austerity-measures-1.1351536
(consulté le 8 avril 2013)
Eurostat, European Commission, General government expenditures [en ligne],
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/General_government_expenditure_statistics (consulté le 7 avril 2013)
Montagu-Pollock, Global Property Guide, House price falls continue in Portugal [en ligne],
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Portugal/Price-History (consulté le 9 avril 2013)
Enjalbert, BNP Paribas, Banques portugaises : bilan d’une année en transition [en ligne],
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=21824 (consulté le 7 avril 2013)
Bauer, Les Echos, L’Islande gagne en justice contre Bruxelles et Londres [en ligne],
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202530163189-l-islande-gagne-en-justice-contre-bruxelles-et-londres-
533093.php (consulté le 30 mars 2013)
The Portugal News Online, The Lusa News Agency, State nationalises troubled Portuguese bank [en ligne],
http://theportugalnews.com/news/state-nationalises-troubled-portuguese-bank/25480 (consulté le 22 avril 2013)
Business, The Portugal News Online, EU approves 450m loan to BPP [en ligne],
http://theportugalnews.com/news/eu-approves-450m-loan-to-bpp/91 (consulté le 22 avril 2013)
Syllabus Verdonck, M. (2013). Politique économique : Deuxième Baccalauréat en Sciences Politiques, ECPO720. Syllabus, Université Saint-Louis de Bruxelles, Diffusion Universitaire