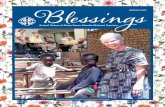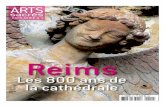« Significations et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine » avec...
Transcript of « Significations et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine » avec...
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
38
PIERRE-OLIVIER DITTMAR, JEAN-PIERRE RAVAUX
Signi fications et valeur d’usage des gargoui l les : le cas de Notre-Dame de l’Epine
L’étude des gargouilles, pour tentante qu’elle soit, se heurte à de nombreuses diffi-
cultés, au point que l’on se demande parfois si l’entreprise mérite raisonnablement d’être tentée. Au même titre que les nombreuses créatures monstrueuses représentées sur les cha-piteaux de l’art roman et dans les marges des manuscrits gothiques, la profusion des figu-res n’a d’égale que la pauvreté des sources s’y référant. L’absence de documentation trai-tant de ce patrimoine sculpté a fortement conditionné son historiographie, elle conduisit Emile Mâle (dont on sait à quel point son approche des images est dépendante de la culture écrite) à critiquer l’analyse savante et symboliste qui avait cours à la fin du XIXe siècle, et à conclure que ces images n’avaient simplement rien à dire1.
Le terme de « gargouille » lui-même tend à lui donner raison. Composé à partir du mot « goule » (gueule), le verbe gargouiller est parfois utilisé au Moyen Âge dans un sens proche de bredouiller, soit tenir un discours incompréhensible2.
Pour pallier la pauvreté des sources, la bibliographie ne nous aide guère. Peut-être parce que les gargouilles sont un motif de prédilection du romantisme (on considère géné-ralement que les quelques lignes qu’Hugo leur consacre dans Notre-Dame de Paris en 1831 font office de point de départ de cette tendance), on ne compte plus les ouvrages fantaisistes, de mauvaise poésie, près à flatter tous les a priori3. Ce n’est que dans les an-
1 « Avouons-le : les livres ici ne nous apprennent plus rien ; les textes et les monuments
ne concordent plus. En les rapprochant les uns des autres, on arrive à aucune conclusion cer-taine, à rien qui ressemble aux résultats exacts que nous avons obtenus plus haut ». E. Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1958 [1898], p. 46.
2 C’est le cas dans La farce de Maitre Pathelin : « Le drapier : Alas! pour Dieu, entendez y. /900/Il s'en va! Comme il gargoulle!/Mais que deable esse qu'il bar[b]oulle? », La farce de Maitre Pathelin, Genève, Bôle, 1993, (1ère éd. 1485), 1993, Tome VII, p. 276.
3 En dernier lieu : Dominique de Villepin, Le cri de la gargouille, Paris, Albin Michel, 2002.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
39
nées 1990, sous l’impulsion de Michel Camille, qu’une relecture globale des gargouilles a été entamée4.
A cette pauvreté de la littérature critique s’ajoute enfin la fragilité des objets eux-mêmes. Parce qu’elles ont justement pour fonction de recevoir les eaux de pluie, les gar-gouilles sont totalement soumises aux aléas du climat ; les gargouilles, plus peut-être que tout autre élément sculpté des bâtiments du Moyen Âge, nécessitent par la force des cho-ses un entretien voire des remplacements fréquents. Sans attendre la vague de restaurations que provoqua la réussite de Viollet-le-Duc au chantier de Notre-Dame de Paris, les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle ont créé une large part des gargouilles aujourd’hui visibles. Le talent indéniable de ces restaurateurs est un handicap car leur virtuosité rend souvent délicate la distinction entre une œuvre originale et une création plus récente. L’impact des restaurations est tel qu’il est, dans certains cas, plus raisonnable de mener l’analyse à partir des moulages faits au XIXe siècle ou des croquis faits par les architectes plutôt que des gar-gouilles aujourd’hui visibles sur le monument5.
Comme si cela ne suffisait pas, une dernière contrainte entrave la recherche sur les gargouilles : leur relative stabilité formelle, car il est bien dommage de constater, en effet, que le style et le sujet de ces sculptures ne varient pas au cours des siècles avec autant de fermeté que veulent bien le laisser croire les planches du Dictionnaire d’architecture de Viollet-le-Duc (fig. 1). On peut ainsi croire en toute bonne foi que le joueur de vielle de l’abside de Saint-Urbain de Troyes (a priori sculpté à la fin du XIIIe siècle)6 est un contemporain des gargouilles du chevet de Notre Dame de L’Epine (qui datent, elles, du premier XVIe siècle).
4 M. Camille, « Gargouilles : fantômes du patrimoine et avenir des monuments médié-
vaux » in Le musée de sculpture comparée. Naissance de l’histoire de l’art moderne, Paris, Edi-tions du patrimoine, 2001, p.88-98, Id. trad., Images dans les marges, Paris, 1997, p. 108-118. Nous n’avons pas pu consulter : Françoise Bellon, Les gargouilles sur les édifices religieux français des XIIIe et XIVe siècles, Montréal, Université de Montréal, 1988. On lira avec pru-dence, Janetta Rebold Benton, « Gargoyles. Animal Imagery and Artistic Individuality in Me-dieval Art » in Nona C. Flores, Animals in the Middle Ages. A Book of Essays, New York and London, Garland Publishing, 1996, p. 147-165.
5 C’est le parti pris de : L. Burbank Bridham, Gargoyles, Chimères and the Grotesque in French Gothic sculpture, Da Capo Press, New York, 1930, notamment pour les gargouilles de Troyes (p. 49). Ce ouvrage peut être considéré comme l’un des premier à s’intéresser sérieuse-ment à la statuaire marginale. voir à ce propos M. Camille, « Gargouilles : fantômes du patri-moine… » Op. cit. p.89, l’article qu’il préparait sur ce sujet The Gargoyles of Notre-Dame : Medivalism and the monster of modernity, est pour l’instant resté inédit.
6 Cf. Note 55.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
40
Figure 1. Evolution des gargouilles : planches du Diction-naire d'architecture de Viollet-le-
Duc.
Toutes ces contraintes sont
un peu écrasantes, et l’on com-prend sans peine que les études sérieuses consacrées aux gargouil-les ne soient pas légion. Rien ne nous oblige cependant à faire de ces contingences une fatalité ; peut-être le plus sage est il de
mener une étude strictement monographique, en prenant l’ensemble des gargouilles d’un édifice. Certains se prêtent remarquablement à ce type d’analyse, Notre-Dame de l’Epine en fait partie.
La basilique Notre-Dame de L’Epine offre trois avantages pour travailler les gar-gouilles au Moyen Âge. Tout d’abord, la date de construction de la basilique, des années 1405-1410 à 1527 limite la période pendant laquelle les gargouilles ont pu être sculptées ; ensuite l’ensemble le plus riche – les figures du chevet – est non seulement daté, mais aussi attribué (à l’atelier de Guichard Anthoine, entre 1515 et 1524)7 ; enfin, les archives per-mettent d’identifier et de dater précisément une large part des restaurations du XIXe siècle (cf. fig. 2, la numérotation des gargouilles renvoie à ce schéma et à la description en ap-pendice).
Nous essayerons de saisir la fonction, la signification et le mode de fonctionnement
de cet ensemble exceptionnel. Notre corpus est constitué des 124 gargouilles que nous avons dénombrées sur la basilique, ainsi que des culots et des pinacles du chevet, dont le registre participe, on le verra, du même discours.
7 L. Grigon, « L’achèvement de l’église Notre-Dame de l’Epine au XVIe siècle », Se-
maine Religieuse, 1er mai 1886, p. 494-496 ; L. Demaison, Documents inédits sur l’église No-tre-Dame de l’Epine, Reims, 1895. Nous suivons par ailleurs Jean-Marie Berland pour qui, sur la base d’observations stylistiques, les gargouilles de la façade seraient contemporaines de celles du chevet. Cf. Jean-Marie Berland, L’Epine en Champagne, SAEP, Colmar, 1989 [1972], p. 88. Cet ensemble particulièrement visible ayant été lourdement remanié lors des restaurations de la basilique au XIXe siècle, il nous semble impossible d’en proposer une interprétation sérieuse.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
41
Figure 2. Emplacement et restauration des gargouilles (dessin JP. Ravaux).
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
42
Le sexe et l ’ ef froi : l ’apotropaïsme On a beaucoup écrit au cours des deux derniers siècles sur le rôle de protection
qu’auraient joué les gargouilles du Moyen Âge8. Cette analyse n’a aucune raison d’être remise en cause, le caractère apotropaïque de ces sculptures est même un des rares ensei-gnements que l’on puisse tirer de l’analyse des quelques sources médiévales. C’est notam-ment le cas d’un exemplum, recueilli par Etienne de Boubon. Le dominicain relate l’histoire un usurier de Dijon qui allait se marier. Arrivé avec sa future épouse devant l’église Notre-Dame, un autre usurier, de pierre cette fois (alius usuraruis lapideus qui erat sculptus cum bursa supra portam), sculpté au dessus de porte, jeta sa bourse sur le marié qui mourut sur le coup9. De peur ou de colère, les autres usuriers de la ville firent détruire toutes les sculptures de la façade qui étaient au-dessus des portes. Peut-être ce récit n’était-il pas sans rapport avec un fait historique, puisque toutes les gargouilles de la façade (ache-vée en 1228) ont été détruites à une exception près (conservée aujourd’hui au musée de Dijon)10. Un autre récit du XIIIe siècle présente de nombreuses homologies structurales avec ce récit. Il s’intègre dans un roman anonyme des années 1260 consacré à la ville d’Amiens, le roman d’Abladane : Flocars, un nécromancien très réputé, fait installer sur les rempart de la ville trois sculptures. Il s’agit d’une image de la Vierge (en « or et argent et pierres ; et estoit l’image si propre, que ce sembloit une femme toute vive ») placée dans un caisson qui ne devait s’ouvrir que pour le seigneur de la ville, et de deux gargouilles de cuivre. Le passage mérite d’être cité :
« A celle même porte de le citée Flocars avoit fait faire deux gargoules de cuivre,
l’un d’une part de la porte et l’autre d’autre part, qui estoient de telle condition que, se aucun venist pour entrer en le citée ou s’en volsist faire sire par force, les gargoulles get-toient par mi leurs gueules un si horrible venin et le lanchoient si loings que ceulz étoient si envenimés de venin qu’elles jetoient qu’il les en convenoit mourir. Et le venin, Flocars l’avoit destrempé es tombeaux ; et par se maitrise le faisoit lancher as gargouil-les. Se estoit escrit desseure la porte que, quand le sire de la cité viendroit, l’une des gar-gouilles jetteroit or et l’autre argent. »11
8 C’est aussi le rôle que l’on prête généralement aux gargouilles et aux antéfixes antiques,
cf. H. Leclerq, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, Librairie Letouzey et Ané, T.6, 1924, p. 650-651.
9 Stephani de Borbone, Tractatus de diversis materiis predicabilibus, J. Berlioz et J.-L. Eichenlaub ed., Turnhout, Brepols, 2002 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis, 124), Livre I, VII, l. 285/295, p. 280, voir aussi la traduction d’une variante dans Albert Lecoy de la Marche, Le rire du prédicateur, Turnhout, Brepols, 1992, p. 100
10 id. p. 499. Les fausses gargouilles aujourd’hui observables sur la façade datent de 1881. 11 L.F. Flutre, « Le roman d’Abladane », Romania 92/4 (1971), p. 478.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
43
On notera dans ces deux textes que le rôle des gargouilles est double puisque celles-ci
peuvent assumer autant une rôle de protection (qui se matérialise par le venin mortel) que d’élection (qui est aussi la fonction de la statue de la Vierge). D’autre part, les deux récits insistent sur la proximité des gargouilles avec un lieu de passage, à chaque fois une porte, ce qui accentue leur position de gardien – nous pouvons en ça les rattacher aux lions sty-lophores qui montent la garde à l’entrée des églises. Cette disposition est importante, elle nous rappelle que dans l’architecture gothique, les gargouilles encadrent et protègent sou-vent les ouvertures du bâtiment (pour le dire autrement : il est rare de voir des gargouilles au milieu d’un pan de mur – à l’Epine le cas se présente une seule foi sur le bas coté sud), un rôle fondamental lorsque l’on sait avec quelle sensibilité le Moyen Âge a investi la no-tion de seuil12. Dans ce minuscule corpus textuel, les gargouilles ne repoussent pas le mal, mais en assurent le châtiment, on peut dire que ces textes ne mettent pas directement en scène une fonction apotropaïque de ces sculptures, mais qu’ils la fondent et en garantis-sent l’efficacité.
Dans les deux récits, les statues sont animées, vivantes ; cette caractéristique n’est pas
propre aux gargouilles, et on ne compte pas les récits médiévaux prêtant des actions mira-culeuses à des images de tout type. Il n’empêche que les dégorgeoirs des églises possèdent de par leur fonction d’évacuation une spécificité, puisqu’à chaque orage, l’eau anime véri-tablement ces images leur donnant ainsi un surcroît de présence indéniable13. On peut sans trop exagérer dire que l’eau matérialise à chaque pluie ce venin « destrempé es tom-beaux », la véritable arme que les gargouilles utilisent contre les visiteurs indésirables14. Un dessin d’architecte du XVe siècle, d’une chapelle absidiale de Notre-Dame de l’Epine va dans ce sens : les gargouilles sont représentées sous la forme d’animaux divers (principale-ment des dragons) crachant un liquide (fig. 3). L’homologie entre ces représentations et les images de dragons crachant leur venin dans les bestiaires est d’ailleurs frappante15.
12 Cf J.-Cl. Schmitt, Les revenants, Paris, Gallimard, 1994, p. 208. 13 Le caractère vivant ou animé de ces sculptures est un topos de la littérature consacrée
aux gargouilles, on trouvera parmi les motifs les plus fréquents le sifflement que le vent est sen-sé provoquer à leur contact, le gargouillis de l’eau en leur sein (souvent invoqué comme une ori-gine possible du mot). Voir par exemple E. Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle, op. cit., p. 58, pour l’Epine : G. Dévignes, « La faune de l’Epine », Annales de Notre Dame de l’Epine, 49 (1967), p. 16-20.
14 Notons que pour le liturgiste Guillaume Durand, la pluie qui tombe sur l’église repré-sente les attaques des païens, et les tuiles semblent jouer le même rôle protecteur que les gar-gouilles : « Tegule tecti que ymbrem a domo repellunt sunt milites qui ecclesiam a paganis et ab hostibus protegunt ». Guillelmi Duranti, Rationale divinorum officiorum, I,i,36 (Corpus Christianomrum CXL, vol. I-IV, 1995, p.23).
15 Comme par exemple dans : British Library, Harley ms. 3244, f. 59. Le bestiaire précise toutefois que le venin du dragon est inoffensif, sa force résidant dans sa queue.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
44
Figure 3 Dessin d’architecte d’une chapelle du chevet de Notre-Dame de l’Epine (détail). DEMAISON Louis, "Documents inédits sur l'église N.-D. de l’Épine", in Travaux de l'Académie de Reims, t. XCV, 1895, p. 105-125.
Pour qu’une image remplisse une fonction apo-
tropaïque, la simple présence d’un animal prédateur, montrant les attributs de sa puissance (la bouche ou-verte, les dents visibles)16 suffit. Il semble même que
l’image toute simple d’un chien puisse assurer une mission de protection. C’est en tout cas ce que porte à croire une série d’enseignes de plomb que l’on portait en broche à la fin du XIVe siècle. Sous l’animal, représenté de profil avec un collier, on peut lire la phrase sui-vante : « bien ai a qui me porte », une formule protection que l’on retrouve sur des ensei-gnes de pèlerinage beaucoup plus orthodoxes, comme par exemple des représentations de bustes reliquaires17. Il serait bien artificiel ici de séparer ses différentes images (le chien, le buste reliquaire), dans la mesure où elles étaient produites dans les mêmes lieux, et retrou-vées dans les mêmes endroits.18 Si un chien peut être un gage de protection sur une bro-che que l’on porte sur ses vêtements, pourquoi n’assumerait-il pas la même fonction sur les parois d’une église ?
De fait, cette fonction de protection semble bien correspondre à la majorité des gar-gouilles à l’Epine et sans doute ailleurs. Un rapide comptage permet d’une part de consta-ter que les ¾ des gargouilles ne sont pas « agissantes », et n’existent que par leur présence (fig. 9), d’autre part, que le type d’animal le plus fréquent est le chien, souvent bien iden-tifiable grâce au collier qu’il porte (comme sur la broche), ou plutôt, pour être plus pru-dent, un animal quadrupède visiblement carnivore (28%)19 (fig. 5).
16 M.Camille, « Mouth and Meanings :Towards an Anti-Iconography of Medieval Art” in
B. Cassidy (dir.), Iconography at the Crossroads, Princeton, Princeton Univ Pr, 1993, p. 43-58. 17 L’image est reproduite dans D. Bruna, Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes,
Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1996, p. 312. 18 Id. p. 15. 19 Nous avons regroupé ces animaux sous la catégorie médiévale « bête », telle que la
conçoit Isidore de Séville : « Le terme bestiae s’applique proprement aux lions, léopards, tigres, loups, renards, chiens, singes, etc. dont la gueule et les griffes sont cruelles, mais non aux repti-les. Bestiae vient de la violence [ius] de leur cruauté ». Cf., Etymologies, XII, 2, 1-5.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
45
Figure 4. Nature de gargouilles de Notre-Dame de l ’Epine.
Un autre élément, sûrement moins attendu ici, vient renforcer la vertu protectrice de ces images : il s’agit de leur dimension obscène. La chose est suffisamment problématique pour justifier que l’on s’y attarde un peu.
Le caractère scandaleux de nom-
breuses sculptures aux accents scatologiques, au sexe apparent et souvent surdimensionné, a retenu l’attention des différents érudits qui se sont penchés sur l’Epine. Effectivement, le caractère obscène ne laisse pas de questionner le regard contemporain. Comment l’institution ecclésiale a-t-elle pu s’accommoder de telles représentations sur les murs-mêmes du sanctuaire ? Que viennent faire sur les murs d’une église de pèlerinage : un homme qui se lèche l’anus (8-culot), un masturbateur (4), de nombreux chiens au sexe énorme (5 – fig. 5–…), une femme qui urine en compagnie d’un maure (17-18) ? La chose parait si incongrue que de nombreux historiens en sont venus à considérer que les contraintes étaient moins fortes dans le décor secondaire des bâtiments religieux, ce qui aurait permis aux sculpteurs des gargouilles de laisser libre cours à leur imagination « populaire »20. La position d’Emile Mâle est parfaitement significative de cette approche : « Quel est le sens de cette création parallèle à l’autre ? Que signifient les prodigieuses têtes qui émergent de la façade de Notre-Dame à Reims, et ces oiseaux funèbres voilés d’un linceul ? […] Les bestiaires restent muets. De pareilles créations sont toutes populaires. Ces gargouilles, qui ressemblent aux vampires des cimetières, aux dragons vaincus par les vieux évêques, ont vécu dans les profondeurs de l’âme du peuple : elles sont sorties d’anciens contes d’hiver »21.
20 C’est notamment l’hypothèse de Janetta Rebold Benton, « Gargoyles, Animal Imagery and Artistic Individuality in Medieval Art » in Nona C. Flores, Animals in the Middle Ages. A Book of Essays, New York and London, Garland Publishing, 1996, p. 147-165.
21 E. Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle… Op. cit., p. 58. M. Camille note avec raison que le rapprochement avec les dragons que combattent les évêques « fondateurs » est justifié
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
46
Figure 5. Chien apotropaïque (5).
Au titre des argu-
ments se trouve la hauteur des gargouilles qui aurait permis de sculpter des mo-tifs païens à l’insu des com-manditaires, à celui des excuses, la jeunesse suppo-sée des sculpteurs des en-sembles décoratifs22. Dans
le même ordre d’idée se rencontre la croyance partagée par de nombreux guides, que les sculpteurs des cathédrales aimaient à s’auto-portraiturer dans ces espaces de supposée li-berté23. Concernant l’Epine, l’hypothèse d’une iconographie « populaire » a fréquemment été avancée : église rurale, de marguilliers, ses gargouilles ne peuvent être pour de nom-breux visiteurs que symptomatiques d’un goût rustique pour l’obscène et le merveilleux ; Didron ne dit-il pas de l’Epine qu’elle constitue « le type de l’architecture grotesque, bourgeoise, plébéienne, satyrique, comme Notre-Dame de Reims est le type de l’architecture hiératique et royale ; elle est une sorte de Pantagruel en pierre »24.
De nombreux éléments amènent à récuser totalement le caractère populaire et sub-versif de cette iconographie.
Le fait que la localisation (haute, cachée etc.) ôterait ces images des regards inquisi-teurs de l’institution ne correspond pas à la réalité. Les sujets les plus choquants a priori, comme la femme urinant, l’homme masturbateur ou l’homme qui lèche son anus font partie des éléments parfaitement visibles depuis le sol. Avec un peu d’attention, on remar-
puisque le serpent de Rouen avait pour nom « gargoule ». De tels créatures étaient portées en processions lors des rogations, à ce propos voir : P. Collomb, « Le dragon chez les prédicateurs et dans les processions de l’occident médiéval », in Dragons entre sciences et fictions, J.-M. Privat dir. Paris, CNRS Editions, 2006, p. 61-71.
22 C’est ce que suppose Mâle, pour le XIIIe siècle il est vrai, Id. p. 60-61. 23 Aucune source ne vient corroborer cette pratique d’ailleurs anachronique pour le
Moyen Âge, celle-ci est en revanche bien attestée chez les restaurateurs du XXe siècle : on trouve ainsi sur la cathédrale de Laon, un culot représentant Eugène Viollet-le-Duc (reproduite dans M. Camille, « Gargouilles : fantômes du patrimoine… » Op. cit. p. 91) à l’Epine, la gar-gouille n°62, est un portrait de Raymond Nominé, vérificateur des monuments historiques.
24 Didron, « La Champagne et Notre-Dame de l'Epine », Annales archéologiques, t. 24, 1864 p. 293-318
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
47
que aussi que des personnages montrent fièrement leurs parties honteuses à la base du premier piédroit nord du portail nord de la façade occidentale (la scène est visible par un enfant), et jusqu’au cœur de l’édifice, soit un des chapiteaux séparant le chœur du déam-bulatoire (côté sud) (fig. 6). La situation effective va même à l’inverse de la croyance puisque les gargouilles peu visibles des parties hautes, notamment les tours, sont plutôt pudiques et représentent presque uniquement des animaux hiératiques.
Figure 6. Chapiteau du choeur (détail)
Il est un autre lieu dans l’horizon visuel du XVe siècle où l’on rencontre une telle
iconographie profane ou obscène, il ne se trouve pas dans l’architecture civile, mais au cœur même des édifices religieux : il s’agit des miséricordes. Ces revers des sièges des stal-les, sur lesquelles les chanoines s’appuient lorsqu’ils sont debout, fourmillent de scènes plus osées les unes que les autres, et l’on sait que le caractère parodique de ces ensembles faisait partie de contraintes que devaient suivre les sculpteurs25. Les miséricordes ne sont pas spécialement rurales ou populaires, on les rencontre dans tous les édifices y compris les plus prestigieux comme Reims, ou Amiens26. Tout se passe même comme si les chanoines tenaient à garder au plus près d’eux cette iconographie obscène, ne serait-ce que pour la condamner visuellement et physiquement à la fin de chaque chant en s’asseyant dessus27.
Le goût des puissants pour cette iconographie s’était affirmé aux XIIIe et XIVe siècles dans les marges des manuscrits, il ne se dément pas au XVe siècle : dans les années même
25 Le contrat passé entre les chanoines de Tréguier et deux sculpteurs, pour la confection
de nouvelles stalles, en 1508, précise que la décoration sera faite de « feillages et grimasses » (A. Barthélemy, Mélanges historiques et archéologiques sur la Bretagne, I, 1856. ; cité par Do-rothy et Henry Kraus, Le monde caché des miséricordes, Les éditions de l’Amateur, 1986, p. 123, n. 1 [La note est page 242].
26 Cf. E.C. Block, Corpus of medieval misericords, France, Turnhout, Brepols, 2003. 27 Autre indice de l’attention portée par l’Eglise à ces sculptures, Lillian Randall relate la
mésaventure d’un clerc d’Arras, blâmé par son évêque pour avoir posé une gargouille sur la fa-çade de sa maison sans en avoir été autorisé par celui-ci. Cf. L. Randall, Images in the margins of Gothic Manuscripts, Berkley, 1966, p. 5.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
48
de la construction de l’Epine, le puissant évêque de Narbonne fait embellir le plafond de la salle d’apparat de sa résidence à Capestang avec des motifs courtois et parfois obscènes qui prendraient place sans problème au milieux de nos gargouilles28.
On le voit, ce registre est fort éloigné d’une hypothétique « religion populaire », sub-versive, rurale ou cachée ; au point qu’il est même possible de renverser la proposition : pourquoi ne pas considérer que la quête de légitimité que l’on devine à l’Epine dans l’architecture, par la référence à Reims, par l’usage de formes anciennes et prestigieuses, ne se retrouverait pas aussi dans la sculpture ? pourquoi ne pas penser que ces gargouilles cherchent à s’inscrire dans une tradition attestée ? quelques éléments formels, nous le ver-rons, nous amènent à y songer.
Pour revenir à la question qui nous préoccupe, pourquoi rapprocher les sculptures
obscènes des gargouilles vraisemblablement apotropaïques dont nous parlions plus haut ? Tout d’abord parce que les enseignes de protection – comme celle qui représente un
chien – et les enseignes figurant des sexes, ont été retrouvées dans les mêmes lieux (no-tamment au fond de la Seine) ce qui laisse à penser que l’usage de ces différents types de broche ne différait pas sensiblement29 (fig. 7). Ensuite parce que le caractère protecteur de l’image du sexe est avérée par une suite ininterrompue de sources depuis la tradition anti-que de Priape30. Enfin parce que des images rendent directement compte de ce pouvoir, qu’il s’agisse de ce tableau conservé à Vienne ou des femmes lèvent leur jupes pour mettre en fuite des cavaliers31, ou plus directement de ce culot de gargouille à l’Epine, où un homme est obligé de se détourner pour fuir la vision (ou l’odeur…) du fondement d’un de ses contemporains (fig. 8)32.
28 On trouvera des reproductions dans L’imagier et les poètes au château de Capestang,
Portet sur Garonne, Editions Loubatières, 1991. 29 C’est aussi l’hypothèse de R. Mellinkoff, Averting Demons: The Protecting Power of
Medieval Visual Motifs and Themes, 2 Volumes, Los Angeles, Wipf & Stock Publishers, 2004. 30 On pense aux différentes survivances et variations du culte priapique : L. Baird, « Pria-
pus Gallinaceus : The Role of the Cock in Fertility and Eroticism in Classical Antiquity and The Middle Ages », Studies in Iconography, 7-8, 1981-1982, p. 81-111, sur des rituels de la fin du XIIIe siècle, p. 87-88, et n. 75-76 ; de façon générale on peut lire sur ces questions : C. Gaignebet et J.-D. Lajoux, Art profane et religion populaire au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985, p. 30 suiv. et 192-201.
31 Kunsthistorisches Museum Wien, Inv. Nr. GG 2668. Nous remercions Gil Bartholeyns pour nous avoir communiqué cette image, ainsi que pour son aide sur l’ensemble de ce dossier.
32 La gargouille qui surplombe le culot représente un taureau, c’est une création du XIXe siècle (devis de Granrut, 1843). Indiquons au passage que ces images obscènes ne sauraient té-moigner en aucun cas d’une pudeur moindre au quotidien pour le Moyen Âge. C’est justement parce que ces images sont « taboues », « obscènes » qu’elles repoussent, le diable pas plus qu’un autre ne devant les regarder. Sur le statut de ces images de sexes au Moyen Âge, nous nous permettons de renvoyer à G. Bartholeyns, P.O. Dittmar, V. Jolivet, Image et transgression
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
49
Figure 7. Enseigne
« profane », Phallus. Dor-drecht, vers 1400-1450, 33x15mm, Collection H. J. E. Beuningen, inv. 1901.
Figure 8. Culot apotropaïque (95).
Si on peut dire que les images obscènes semblent entretenir un lien avec des fonc-
tions de prophylaxie ou de protection, on ne peut se contenter d’un tel résultat, et toute une recherche est à reprendre pour déglobaliser l’approche de ce type d’image, en avoir une perception plus précise. Nous avons regroupé sous la même catégorie les images de sexe masculins et féminin avec les représentations d’hommes qui montrent leur fonde-ment, mais rien ne nous dit que ces différentes images étaient strictement équivalentes. Quelques pistes en guise de débroussaillage :
- 1. Le lieu varie. Les scènes « scatologiques » se retrouvent principalement sur les culots, qui sont la partie basse des gargouilles mais aussi de certains arcs, les bases de sta-tues etc. Peut-être cette dernière localisation n’est-elle pas innocente : on pourrait y voir la trace d’un jeu sur le langage comme ceux que le Moyen Âge aime tant, puisque le terme de « culot », comme son synonyme « cul-de-lampe », est bien attesté au Moyen Âge.
- 2. Contrairement aux édifices romans, on ne trouve pas à l’Epine de représenta-tions isolées de sexes, masculins ou féminins, représentés pour eux-mêmes. Les sexes mas-culins sont ici sur les animaux, et il y a, en quelque sorte, confusion entre les deux types d’images apotropaïques, les bêtes et les sexes. Cette assimilation correspond-elle à une mo-ralisation ? Les sexes sont sûrement plus acceptables sur des animaux que seuls, ils accen-tuent ce faisant le caractère édifiant des créatures représentées, leur « bestialité ». On va le
au Moyen Âge, PUF, 2008, Chap. 4. Nous remercions par ailleurs Mme. Albert-Llorca pour ses remarques sur ce sujet.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
50
voir, le caractère apotropaïque peut très bien coexister avec un discours moral tenu sur ces images. On peut même postuler que les deux fonctions se renforcent. Plus une image obs-cène est connotée négativement, plus elle est « interdite », « taboue », plus son pouvoir d’épouvante (donc de protection) est puissant. La répulsion des semblables (on doit se rappeler ici que dans l’exemplum d’Etienne de Bourbon, c’est une gargouille d’usurier qui tue l’usurier) étant par ailleurs un moyen connu de lutte contre le mal33.
Morale anthropologique L’explication apotropaïque, malgré son importance, ne permet pas d’englober
l’ensemble des gargouilles de l’Epine. Un minorité de sculptures, mais très visible et mar-quante, ne rentre pas dans les catégories que nous avons exposées jusqu'à présent. Il s’agit notamment des quatre gargouilles du chevet, où sont représentés des animaux musiciens, cette truie qui allaite ses pourceaux en jouant de la lyre (10), ce singe qui joue de la cor-nemuse (28), cet ours (22) jouant du tambourin. On ne voit pas non plus comment la représentation d’un ivrogne, d’acrobates, d’un fou pourrait apporter un surplus de protec-tion à la maison de Dieu. Alors que les images apotropaïques existent avant tout par leur simple présence, ces autres gargouilles sont plus complexes, plus « narratives » pourrait-on dire, et vont jusqu’à représenter parfois deux figures qui interagissent. Enfin, plus trou-blant encore, des gargouilles représentent des hommes nus et démunis pris entre les griffes de créatures effrayantes, des images qui sont bien peu à même de rassurer les fidèles qui posent leur regards sur elles.
La liberté de ton de ces sculptures a marqué les esprits, et comme leur caractère complexe et construit laisse supposer qu’elles possèdent un sens précis, elles ont suscité de nombreuses analyses passionnées. Devant tant de ferveur (et souvent d’imagination), nous préférons dans un premier temps, garder un regard le plus éloigné possible et de ne relever que le « sens générique » de ces sculptures. Pour ce faire, et compte tenu du nombre de gargouilles, l’analyse sérielle peut dégager quelques tendances.
1. Lorsque ces gargouilles sont des animaux, ceux-ci sont hybrides, carnivores ou
omnivores (le singe, le porc, l’ours…). Lorsque les animaux interagissent avec les hommes, c’est presque toujours dans une relation de combat ou de dévoration. Lorsque les animaux agissent seuls, ils ont une activité humaine : la musique. (cf. fig. 9 et tableau en appen-dice).
33 E. Bozoky, Charmes et prières apotropaïques, Turhout, Brepols, 2003 (Typologie des Sour-
ces du Moyen Âge occidental), R. Mellinkoff, Averting Demons : The Protective Power of Medieval Visual Motifs and Themes, Los Angeles, 2005.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
51
Figure 9. Action des gargouilles de Notre-Dame de l'Epine
Pour tirer un enseignement de ces résultats, il est indispensable de rappeler quelques
généralités sur la relation homme-animal telle qu’elle est perçue au Moyen Âge. Le rapport idéal entre l’homme et l’animal est donné par le récit de la Genèse. Le premier acte d’Adam est d’appeler (aux deux sens du terme) les animaux (Gn 2,19-20), et d’entamer par là une relation de domination sympathique34. L’animal en Eden est conçu comme une aide seulement affective de l’Homme, ce dernier étant végétarien. Cette situation idéale dégénère du fait que l’homme transgresse la loi divine à deux reprises et provoque deux sanctions du créateur : la Chute et le Déluge. A la suite de chacun de ces deux événe-ments, la relation entre l’homme et l’animal se trouve complètement bouleversée. Dieu fait de la faune une nourriture pour l’homme, et, de sympathique la relation devient ali-mentaire et violente (« Soyez la crainte et l’effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, […] Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture », Gn 9. 2-3). Si la majeure partie des animaux se soumet à ce nouvel ordre (le gibier et les animaux domestiques), une minorité conteste la domination de l’homme et tente d’inverser le rapport en mangeant ce dernier. Il s’agit des animaux sauvages, carnivores, de ceux que le Moyen Âge, à la suite d’Augustin et d’Isidore de Séville, a regroupé sous le terme de « bêtes ». Ces animaux sont devenus le symptôme de la condition humaine
34 E. Baratay, « L’anthropocentrisme du christianisme occidental » in Si les lions pou-
vaient parler. Essais sur la condition animale, B. Cyrulnik dir., Paris, Gallimard, 1998, p. 1429-1449.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
52
d’après la chute. L’homme a perdu par sa faute la domination qu’il exerçait sur la création, et doit désormais lutter pour survivre.
Le grand nombre d’images de dévoration ou de captation par des bêtes sauvages est à prendre à l’aune de ce récit des origines. Ces figures, qui inversent l’ordre édénique idéal, rappellent au passant la fragilité de la condition humaine et le peu de cas qu’Adam et ses descendant ont fait de la mission qui leur avait été confiée. Un élément accentue encore la portée édifiante de ces images : les bêtes sauvages, qui refusent l’autorité de l’homme, représentent dans l’exégèse et chez les prédicateurs, les pulsions, les élans incontrôlés qui, justement, font que l’homme se comporte comme un animal. Etre dominé par la bête, c’est être dominé par ses désirs bestiaux, c’est abandonner les critères qui fondent l’humanité35.
On peut penser que ces préoccupations exégétiques sont bien loin des soucis des marguilliers de l’Épine, et de fait, il est bien improbable qu’un paroissien ordinaire pense à la nomination des animaux par Adam en regardant les gargouilles du chevet. Mais ce mes-sage n’a pas besoin d’être connu dans son ensemble pour être performatif, de même qu’aujourd’hui, n’importe qui peut faire l’expérience qu’assimiler son prochain à un chien ou un porc est une insulte (ce qui n’est pas le cas avec un dauphin par exemple), sans avoir lu les travaux d’Edmund Leach qui en expliquent les raisons structurales36.
Au regard d’un modèle édénique aux catégories parfaites, où tous les animaux sont créés et nommés « selon leur espèce », où les créatures sont rangées et bien séparées dans les cellules de l’arche de Noé, au regard de ce modèle d’ordre, les gargouilles montrent une indéniable confusion des genres et, par là, la fragilité de l’ordo dans le monde d’après la Faute37. Les gargouilles mettent en scène des formes du devenir dans un monde qui ne rêve que d’essences38. Pour ce faire, elles usent de rhétoriques d’inversion (les animaux qui jouent des instruments de musique)39 et abusent des catégories intermédiaires et problé-matiques.
Que cela soit entre les espèces animales ou entre l’animal et l’homme, l’hybridité est partout présente dans les gargouilles. Il s’agit, de façon tout à fait littérale, des très nom-
35 Nous avons développé cet aspect dans : « Le propre de la bête et le sale de l’homme »
in Adam et l’Astragale. Conditions et pratiques de l’humain dans le temps, A paraître. 36 E. Leach, "Anthropological Aspects of Language:Animal Catégories and Verbal
Abuse" in E. H. Lenneberg (ed.), New directions in the study of language, Massachusetts Insti-tute of Technologie press, 1964, p.23-63.
37 C. Heck, « Respecter l’ordre du monde. L’animal-homme et l’homme-animal dans les enluminures du Ci nous dit », Micrologus, 8/2 (2000), p. 395-410
38 C’est la caractéristique du réalisme grotesque tel que le définit M. Baktine. Ce dernier y voit cependant une dimension fertilisante ou régénérante, bref positive, dont nous peinons à remarquer les signes à l’Epine… cf. L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970.
39 G. Cocchiara, Il mondo alla rivescia, Boringhieri, Turin, 1981.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
53
breuses gargouilles de l’Épine (21%) qui sont faites à partir de 2 ou 3 espèces différentes (notons qu’à part quelques griffons, ces hybrides ne correspondent pas à des animaux sup-posés réels au Moyen Âge comme la licorne ; ces êtres étaient aussi hybrides pour les médiévaux). De façon plus subtile, la majorité des animaux « réels » représentés sont ambigus au regard des catégories médiévales.
Figure 10. Statue sur culée (10)
Ces différents facteurs d’ambiguïté se concentrent et s’accumulent dans les statues-pinacles des animaux musiciens, au chevet de l’Epine. L’ambiguïté relève d’abord du ré-gime alimentaire : les animaux représentés sont omnivores (cochon, ours, singe…), un régime qui non seulement est le même que celui des hommes, mais qui est de plus perçu comme négatif car non-sélectif, ce qui rend problématique la consommation de la chair des ces animaux40. Le mode d’alimentation n’est pas le seul critère de confusion entre les catégories : ces animaux accumulent les éléments de proximité avec l’homme, qu’il s’agisse
40 Les recommandations d’Hildegarde de Bingen sont particulièrement significatives dans
la mesure ou elles vont contre la pratique ordinaire (où la consommation de porcs est impor-tante), pour la poétesse : « les animaux qui dévorent les autres, qui se nourrissent de nourritures corrompues et pullulent en faisant des petits, comme le loup, le chien, le cochon, sont, comme les herbes inutiles, impropres à l’alimentation », et plus loin : « Dans son avidité, [le porc] se conduit comme un loup, mettant en pièces les autres animaux ; il se conduit aussi comme les chiens en ce sens que, comme eux, il se plaît en compagnie des hommes ; mais c’est un animal impur, sa chair n’est pas bonne à manger ni pour les biens portants ni pour les malades », Hil-degarde de Bingen, Le livre des subtilités des créatures divines (physique), P. Monat trad, Je-rome Million, Grenoble, 1989, p. 183-184 et 211-212.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
54
de leur présence dans les maisons (le porc, le chien), de la station verticale (l’ours, le singe), ou de leur physiologie (les organes du porcs sont réputées être similaires à ceux des hommes)41. La statue de la truie qui joue de la lyre est sûrement le chef-d’œuvre de cet art de l’inversion (fig. 10) : en plus de tous les critères d’ambiguïté sus-cités, elle pousse l’ironie jusqu'à porter à son flanc droit… un couteau de boucher. Enfin cet animal impur s’il en est, ne joue pas, à l’inverse du singe, d’un vil instrument populaire comme la cor-nemuse, mais de la lyre, symbole des psaumes et du roi David42. Il est rare que les catégo-ries humaines et animales soient mêlées et contestées avec autant de violence et de réussite.
Cette « morale anthropologique », qui joue avec les frontières séparant l’humain et l’animal pour tenir un discours édifiant, se prolonge dans notre second constat qui concerne les figures humaines, soit environ 23% des gargouilles :
2. Lorsque la gargouille est composée uniquement d’êtres humains, ceux-ci émettent
des sécrétions (excréments, sperme,vomi, lait…) et/ou contreviennent visiblement à la morale en place (il sont acrobates, ivrognes…).
Si les gargouilles humaines émettent des sécrétions, c’est bien sûr avant tout parce
que la fonction (ainsi que le terme « gargouille ») s’y prête particulièrement. Les déversoirs de l’antiquité jouaient déjà des différentes possibilités qu’offre le corps humain en la ma-tière et n’hésitaient pas à faire sortir l’eau de ruissellement par les seins d’une jeune femme43. Reste que cette solution n’était pas la seule possible, on aurait très bien pu à l’Epine utiliser le motif du Verseau (c’est le cas pour une gargouille au chevet de Saint-Urbain de Troyes), où l’eau coule plus pudiquement d’une cruche. Le fait de faire passer le liquide par la bouche est donc un choix, que nous pensons ici moral.
La perméabilité des frontières de l’homme est renforcée par une mise en avant des orifices en tant qu’inquiétants lieux de passage. Le mesnagier de Paris, qui est loin d’être un ouvrage de théologie, donne une dimension morale à la bouche, véritable brèche de l’enveloppe corporelle :
« Le troisième point, c’est que la vertu de sobriété garde bien la porte du châ-
teau pour empêcher le diable d’entrer dans le corps de l’homme à travers le péché mortel : la bouche, c’est la porte par où le diable entre dans le château pour combat-tre les bonnes vertus […] C’est par la bouche que le Diable tente l’homme ; ainsi fit-
41 Cf. C.Fabre-Vassas, La bête singulière. Les Juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, Gal-
limard, Bibliothèque des sciences humaines, 1994. 42 Notons pour finir que la truie est, dans les bestiaires, une image du pécheur, il est alors
fréquent qu’elle soit représentée en train d’allaiter des pourceaux, ce qu’elle fait également à l’Epine. Un exemple dans R. Barber, Bestiary, Ms. Bodley 764, Woodbridge, The Bodley Press, 1999 p. 84-84
43 H. Leclerq. Dictionnaire… Op cit.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
55
il quand il invita Notre-Seigneur à transformer les pierres en pain et quand il poussa Adam à manger le fruit. Par rapport à toutes les autres créatures, l’homme a la bouche la plus petite en proportion du corps ; s’il a les autres parties du corps en double – deux oreilles, deux narines, et deux yeux – il n’a qu’une seule bouche. Cela nous in-dique que c’est avec sobriété qu’il doit manger et boire, et aussi parler44 ».
Ce texte s’inscrit en complète contradiction avec un verset célèbre de Matthieu :
« Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme »
(Math. 15, 10-11)
Cette parole du Christ est généralement interprétée comme le passage d’une concep-tion matérielle de la pureté (dans le judaïsme) à une interprétation plus spirituelle (il s’agit d’avoir un cœur pur, des intentions pures). Cette compréhension du couple souil-lure/pureté s’inscrit aussi dans une conception du corps qui considère l’intérieur, le ventre, les entrailles, de façon négative et que l’on retrouve chez les prédicateurs dans l’assimilation du corps à un « sac de merde »45. Elle est également à mettre en relation avec les très nombreux récits où le péché est expulsé du corps humain via la bouche, le vomis-sement faisant alors office d’action de purification46. Derrière leur apparente contradic-tion, ces différentes traditions font toutes de la bouche, et plus généralement des orifices, un lieu de circulation du péché. Par le biais des sécrétions, les gargouilles insistent une nouvelle fois, de façon originale, sur les limites fragiles et perméables de l’homme.
44 Le mesnagier de Paris, Paris, Le livre de poche, 1994, I,iii,114, p. 124-125. 45 cf. C. Gaignebet et M.-Cl. Périer, « L’Homme et l’excretum, de l’excrété à l’exécré ».
in Histoire des moeurs. I. Les coordonnées de l’homme et la culture matérielle, J. Poirier dir., Paris, 1990 p. 831-900. Les auteurs relèvent l’injonction de Rabelais aux prêtres de se « décharger » avant la messe, afin d’arriver « purs » devant l’autel, p. 836.
46 Un exemplum parmi mille : un homme autrefois droit, tombe dans le vice. Il devient languissant, maigrit, etc. Enfin, il se confesse à un prêtre. « Il se confessa donc avec des larmes à un saint prêtre et dès qu’il eut reçu le bénéfice de l’absolution, il vomit par la bouche sept pe-tits animaux noirs et affreux, ressemblant par-devant à des crapauds mais ayant des formes di-verses à l’arrière. Chose merveilleuse ! Peu après, une fois ces animaux tombés en pourriture, le corps et le visage de ce pénitent commencèrent à refleurir. Tout à fait sorti de danger dans son âme et dans son corps, il servit longtemps d’exemple à son entourage. » : Thomas de Cantimpré, Bonum universale de apibus, II, 50, 2 (éd. Douai, 1627). L’expulsion par vomissement est pro-pre aux guérisons miraculeuses de la possession démoniaque, cf. Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-XIIe siècle), Paris, Cerf, 1985, p. 238-239, voir aus-si : J. Berlioz, « Le crapaud animal diabolique » in L’animal exemplaire au Moyen Âge, Presses Universitaire de Rennes, Rennes, 1999, p. 267-288.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
56
Autre élément important des gargouilles « humaines », le corps des hommes et des femmes représentés est grimaçant, gesticulant (fig.12), tordu, maigre parfois (fig. 11)47. Toutes ces caractéristiques s’inscrivent dans un même discours qui tend à marquer la dif-férence maximale de l’homme vis-à-vis du corps idéal d’Adam, fait à l’image et à la res-semblance de Dieu. Cette gesticulatio, toujours négative au Moyen Âge, donne une image extraordinairement négative du siècle, véritable perversion ou déformation de son modèle édénique48. A cette déformation des corps, il faut ajouter la dérive des mœurs ; le jongleur, l’ivrogne, le païen, l’homme sauvage sont autant de possibles d’une humanité qui se trompe.
47 Notons que certains animaux sont également victimes de cette maigreur (79…, de
beaux exemples sur la façade de la cathédrale de Troyes). La représentation de la maigreur chez les bêtes, de même que l’allaitement (autant d’écarts par rapport à l’idéal-type présenté dans les bestiaires) n’est pas fréquente dans la représentation médiévale. Elle sa trouve principalement dans des représentations « marginales », comme par exemple, les bêtes qui font office d’accoudoir entre les miséricordes. Le jeu sur les limites physiologiques de l’humain fait parti selon Baktine, des caractéristiques du réalisme grotesque. Cf. L’œuvre de François Rabelais… Op. cit., p. 38
48 Cet écart entre le siècle et le modèle édénique à été théorisé au Moyen Âge sous le terme de « zone de dissemblance » (regio dissimilidutinis). Voir à ce propos la synthèse de G. Didi-Hubermann dans Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Paris, Flammarion, 1990, p. 51-53. Sur la gesticulatio : J.Cl. Schmitt, La raison des gestes. Op. cit. p. 261-273
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
57
Figure 11. Gargouille (82)
En substance, il semble bien que l’animalité et surtout l’humanité soient représentées
dans les gargouilles sous une forme largement négative et cela dans une visée moralisatrice. Le discours qu’elles tiennent via la pratique et les déformations de leurs corps participent d’un usage du contre-modèle très important au Moyen Âge. C’est probablement parce que cette vertu pédagogique du mauvais exemple a presque totalement disparue après le concile de Trente que nous avons tant de mal à comprendre la place des images outra-geantes au chevet d’un lieu sacré.
Une « démonstration » eschatologique ? Ces deux cadres interprétatifs, la fonction apotropaïque et la morale anthropologi-
que, ne sont pas spécifiques à l’Épine, et il y a toutes les chances pour qu’une étude typo-logique sur un autre édifice de la même époque aboutisse aux mêmes résultats. Ce type d’analyse, comme toutes celles consacrées aux gargouilles jusqu'à présent, est basé sur le présupposé critiquable que ces dernières ne fonctionnent qu’individuellement, ce qui im-plique entre autre que leurs positions respectives autour de l’édifice n’a pas de signification particulière. Un postulat qui apparaîtrait comme scandaleux dans une étude consacrée aux enluminures ou au patrimoine sculpté moins « marginal ». Sans doute, cette prise de posi-tion vient-elle du caractère répétitif des motifs, et peut être est-elle justifiée pour certains monuments, mais concernant l’Épine, l’hypothèse du hasard semble peu probable…
Une première division s’impose aux yeux du visiteur : celui-ci peut constater une dif-férence entre d’une part les gargouilles de la nef qui représentent des figures relativement simples (le plus souvent des animaux), et d’autre part les gargouilles et les pinacles du che-vet où se trouvent des sculptures plus complexes et plus célèbres, mettant notamment en
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
58
scène des hommes et des animaux musiciens49. Notons que les premières s’inscrivent plu-tôt dans un discours apotropaïque, les secondes dans un discours moral. La rupture entre les deux correspond exactement à la reprise du chantier en 1509 par Remy Goureau (les parties hautes, donc les gargouilles sont réalisées à partir de 1515 par Guichard Anthoine), une rupture bien visible dans l’appareillage des premières chapelles Nord et Sud du che-vet.
Essayons maintenant de voir quel parcours du regard les gargouilles impliquent. Les deux faces de l’église ne sont pas investies de la même charge figurative : la face sud située en bordure de la route qui mène de Châlons à Courtisols, est clairement survalorisée par la présence du portail Saint-Jean-Baptiste. Les gargouilles du chevet s’inscrivent dans cette orientation de l’édifice puisqu’elles sont presque toutes tournées vers le sud. Tant et si bien que l’homme qui passe par cette route se trouve le temps d’un instant observé, peut être interpellé par une dizaine de paires d’yeux tournées vers lui. Cette invitation marque le début de la démonstration, qui correspond à un parcours autour du chevet du sud vers le nord.
Ce parcours peut se décomposer en trois étapes. La première étape, qui correspond à la face sud (gargouilles 30 à 24), peut être lue
comme une description critique du siècle. Les différentes marges de la société sont repré-sentées (les acrobates, le fou, l’ivrogne) (fig. 12-14).
49 Notons que cette remarque et le développement qui suit ne concernent pas les gargouil-
les situées dans les angles du chevet. Ces dernières ont été fortement détériorées et/ou restau-rées, les rares exemplaires d’origines prolongent le discours apotropaïque présent sur le reste de l’édifice.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
59
Figure 12. Gargouille, acrobates (30)
Figure 13. Gargouille, Samson dominant le lion ? (27)
Figure 14. Gargouille. Ivrogne (25)
Figure 15. Corniche, Hybrides et rinceaux de vigne
Cet ensemble se lit naturellement comme une description critique des errances du
siècle. Ce constat mérite cependant d’être nuancé, car quelques éléments positifs s’y re-trouvent. Il faut tout d’abord citer cette gargouille représentant un homme qui domine physiquement un lion (fig.13). On pourrait identifier l’homme a Sanson ou encore au roi David, peu importe finalement puisque le sens générique est le même : il s’agit d’une image de puissance, de souveraineté de l’homme sur la bête.
Un autre élément vient conforter le discours nuancé mi-négatif/mi-positif de cette première étape. Une corniche ornée court tout autour de la basilique ; de chaque coté de la nef, un feuillage épanoui en constitue le motif. Cette corniche se modifie après la gar-gouille de Sanson et le lion (27), et de l’été on passe à l’automne. Ce ne sont plus des
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
60
feuillages mais des rinceaux de vigne chargés de raisins qui sont représentés. Au milieu de toute cette végétation, des petits êtres hybrides (dont une sirène) très semblables à ceux que l’on trouve dans les marginalia des XIIIe et XIVe siècle, semblent jouer et se cacher (fig.15). Cette image mêle le bien et le mal : ces hybrides sont connotés négativement, on peut globalement dire d’eux qu’il s’agit d’images de la tentation50, dans le même temps la vigne est un symbole indéniable d’abondance et de fertilité. Enfin des rinceaux aux motifs très proches ornent les chapiteaux du « saint des saints », le chœur de la basilique.
Continuons notre parcours. La deuxième étape (gargouilles 21 à 18) commence avec la représentation d’une femme dont on ne sait si elle crie ou vomit51, se tirant les cheveux, le visage visiblement souffrant (fig. 16), elle se prolonge sur la chapelle axiale, avec celles de la femme et du maure déféquant (fig. 17-18)52. Le discours est ici radicalisé puisque aucun élément positif ne vient nuancer ces images : les trois gargouilles produisent des sécrétions, la femme qui se tire les cheveux est la représentation d’un péché capital – la colère53 – et le maure est un ennemi de Dieu. Les motifs de la corniche suivent cette radi-calisation du discours, on cherchera en vain ici la plaisante ambiguïté qui régnait au sud. Les feuilles de chardon acérées et vides de toute présence ont remplacé les grappes de rai-sin : c’est l’hiver (fig. 19).
50 cf. La crise des frontières. Images et transgression. op cit. Chap. 1. Notons d’ailleurs
que cette corniche à feuilles de vigne « encadre » la gargouille représentant l’ivrogne… 51 Le culot qui supporte la gargouille (qui représente un visage dont la bouche ouverte
laisse s’échapper des rinceaux) ferait plutôt pencher pour la seconde hypothèse. 52 Nurith Kenaan-Kedar imagine que la femme ôte une bien anachronique ceinture de
chasteté. Cf. Marginal Sculpture in Medieval France. Towards the deciphering of an enigmatic pictoral language, Brookfield, Scolar Press, 1995, p. 146.
53 C’est aussi un geste de désespoir fait par les femmes lors de la mort d’un proche, cette connotation « funéraire » est, on le verra, sûrement signifiante. Sur ce geste voir : F. Garnier, Le langage de l’image au Moyen Age, Paris, Le léopard d’or, 1982, p. 137.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
61
Figure 16. Gargouille, femme vomissante
(21)
Figure 17. Gargouille, femme uri-
nant/déféquant ? (19)
Figure 18. Gargouille, maure uri-
nant/déféquant (18)
Figure 19. Corniche. Chardon
La partie nord du chevet (gargouilles 15 à 9) achève cette descente au enfer, dans un
sens peut-être littéral. La première gargouille représente une femme, vêtue du même habit que celle qui urine quelques mètres avant, entièrement dévorée par une bête mamelue et aux sabots fendus (fig. 20). La situation homme/animal est ici exactement à l’inverse de la représentation de l’homme dominant le lion au sud. La suite du parcours accentue encore le décalage, avec deux créatures prenant dans leurs griffes des petits hommes nus (fig. 21-22). Cette section se clôt avec la représentation d’Eve (fig. 23), le serpent de la tentation entre les mains. La corniche quant à elle continue de ne figurer qu’un triste houx. Après
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
62
cette dernière figure, les gargouilles redeviennent « simplement » apotropaïques et le feuil-lage retourne aux « feuilles de choux » que l’on trouve sur les bas cotés.
Cette aggravation du sud vers le nord invite à formuler une hypothèse. Il est en effet tout à fait possible de lire ce parcours comme une « démonstration » eschatologique qui désignerait visuellement (qui monstrerait) les effets de la tentation et du péché dans l’au-delà. Les figures du sud sont vêtues et celles du nord sont dénudées, ces dernières corres-pondent exactement aux représentations des âmes prises dans les affres du purgatoire et de l’enfer. La présence d’Êve dans ce lieu est logique, puisqu’elle est censée y séjourner dans l’attente du retour du Christ54. En filant cette hypothèse, la bête mamelue qui ingurgite dans sa gueule immense la femme qui urine, peut être rapprochée des nombreuses images de la porte de l’enfer sous la forme d’une bête la gueule ouverte, représentation dont un exemplaire est sculpté au tympan du portail central de l’Epine.
54 Notons à propos de la descente au enfers que ni l’Evangile de Nicodème (qui à l’origine
de cette iconographie), ni La légende dorée, ne mentionnent Êve parmi les justes sauvés des en-fers. De même, au tympan du portail central de l’Epine, c’est seulement Adam que le Christ vient libérer. La présence d’Eve est cependant très fréquente dans les images de l’anastase.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
63
Figure 20. Gargouille, hybride dévorant une femme, porte de l'enfer? (15)
Figure 21. Gargouille, bête torturant une âme? (13)
Figure 22. Gargouille, bête torturant une âme ? (12)
Figure 23. Gargouille, Eve et le serpent de la tentation. (9)
Si l’on se range à cette hypothèse, l’ensemble des gargouilles du chevet produit un
discours édifiant qui entre en écho avec l’inscription gravée sur le portail sud « + bones gens qui par cy passes, priez Dieu [pour les trépassés] ». Le passant ou le pèlerin, qui lit cette phrase depuis le cimetière, face à l’image de la résurrection des morts dans les gables du portail saint Jean-Baptiste, peut ensuite constater au chevet l’expression du péché, et le châtiment que ce dernier provoque dans l’au-delà ; il peut réaliser visuellement toute l’aide, toutes les prières, dont les défunts peuvent avoir besoin après leur trépas. Les gar-gouilles prolongeraient ainsi l’importante vocation funéraire et eschatologique de l’Epine, déjà manifeste par la présence d’une Passion et d’une Résurrection sur chacune des faça-
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
64
des55, par l’importance que jouent les reliques de la vraie croix dans le succès du pèleri-nage, enfin par la pratique avérée de rituels de « répits » au sein du sanctuaire56.
Si tel est le cas, Guichard Anthoine et son neveu auraient produit une œuvre d’une ambition peut-être unique dans le domaine des gargouilles. Une église prestigieuse proche de l’Epine présentait déjà un programme particulièrement innovateur dans ce domaine, il s’agit de Saint Urbain de Troyes. Une des premières églises selon Viollet-le-Duc, à utiliser à la fin du XIIIe siècle des formes humaines en tant que gargouilles57. Celles de son chevet sont particulièrement travaillées, elles représentent, entre autres, un musicien et une truie allaitant son pourceau58. Deux siècles plus tard, Guichard Anthoine relève le défi lancé par ce vieux monument, en reprend les figures marquantes, les développe, et intègre celles-ci au sein du contexte funéraire propre à la façade sud de l’Epine59.
Conclusion Les gargouilles, que l’on imaginait spontanément comme purement décoratives, vé-
hiculent plusieurs discours. Elles arment l’église contre les attaques du démon, et suivent l’injonction de Guillaume Durant, qui imagine les tours de l’Eglise « semblables à la tour de David, [qui] est élevée et garnie de machines de guerre et d’armes pour les combats »60. Elles usent pour cela de représentations d’animaux diverses et variées et de scènes obscè-nes, ces deux types se confondant partiellement puisque les chiens et les lions sont souvent
55 A l’ouest, Passion et Résurrection du christ ; au sud, Passion de Jean-Baptiste (et du Christ dans le gable ? c’est ce que suggèrent un blason – peu visible certes – portant les arma christi) et résurrection des morts.
56 Nous nous permettons de renvoyer à ce propos aux contributions de E. Hold (pour la fonction d’intercesseur de Jean-Baptiste), de C. Dragomirescu (pour les répits) et J.-P. Ravaux (pour le rôle qu’ont joué les reliques de la vraie croix) dans ce même volume.
57 Avec la cathédrale de Clermont cf. E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. 6. Paris, F. Nobele, 1967, p. 25-26
58 Ces deux gargouilles sont d’origine, seul le visage du musicien a été refait au XIXe siè-cle par Delagoule. Cf. M. Albert Babeau, Saint Urbain de Troyes, Troyes, 1891. Contient un in-ventaire des gargouilles du monument (p. 61-63) avec l’indication précise des restaurations du XIXe siècle.
59 La référence à Troyes serait une autre tentative, avec la référence à la façade de Reims, d’inscrire l’Epine dans la filiation de monuments prestigieux de la région. Notons par ailleurs que l’originalité et l’attachement de Guichard Anthoine aux formes « grotesques » se retrouve à quelques kilomètres de l’Epine, dans les chapiteaux de Saint Martin de Courtisols.
60 « Turres ecclesie predicatores sunt et prelati Ecclesie qui sunt munimen et defensio eius, unde sponsus ad sponsam in canticis amoris si loquitur: Collum tuum sicut turris David edificata com propugnaculis. Pinnaculum turris vitam uel mentem prelati que ad alta tendit re-presentat », Guillelmi Duranti, Rationale, Op. cit. I,I,21, p. 19.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
65
porteurs de sexes énormes. Les deux registres – sexe et effroi – étaient plus distingués dans la sculpture romane (ce registre se trouve alors plus fréquemment sur les modillons), et peut-être a-t-on représenté au XVIe siècle le sexe sur des animaux afin de rendre son image plus acceptable à une époque où elle commençait à poser problème61. Cette évolution par-ticipe d’une moralisation des gargouilles qui deviennent – sans pour autant perdre leur fonction première – des images édifiantes d’un siècle imparfait. Cette morale nouvelle est « anthropologique » dans le sens où elle met en scène les différents manquements vis-à-vis des critères médiévaux de l’humanité idéale.
Le chevet de l’Épine peut être vu comme un aboutissement de l’art de la gargouille. Ici la moralisation est poussée à son extrême puisque c’est un véritable récit eschatologique que les gargouilles proposent, en adéquation avec l’iconographie développée sur les deux grands portails de la basilique. Les gargouilles ne sont plus – loin s’en faut – des dégor-geoirs traités de façon figurative, mais un élément central de la pragmatique de l’édifice, qui articule autour de lui toutes une série d’images secondaires que sont les pinacles, les corniches et les culots62. Ce chevet est aussi un aboutissement de l’art de la gargouille dans le sens de « fin », puisqu’il s’agit d’un des derniers grands ensembles de ce type. En 1527, lorsque les gargouilles de l’Épine sont achevées, des gargouilles d’un tout autre genre, plus simples, antiquisantes, ornementales, sont sculptées au château de Fontainebleau. Exacte-ment 40 ans plus tard, lorsque le concile de Trente interdit toute représentation au sein de l’Église qui ne soit pas sacrée, sainte, digne, les gargouilles deviennent strictement décora-tives et fonctionnelles et abandonnent les diverses fonctions qu’elles avaient assumées jus-que là. Ce virage fondamental dans la réception des images marque la fin d’une façon de penser le monde qui opposait systématiquement les vices aux vertus, la marge au centre, la dérision au sérieux, le contre-modèle au modèle ; il pesa lourd sur le destin des gargouilles, car si celles-ci n’eurent pas à souffrir de la Révolution63, elles pâtirent énormément d’un XIXe siècle pudibond et volontaire qui ne comprenait plus leur raison d’être.
Concernant l’Epine, il est possible de distinguer deux phases parmi les campagnes de restauration. La première campagne est menée sous le mandat de l’abbé Brisson, soit entre 1825 et 183464. La visite de Étienne F.X. Povillon-Pierard témoigne de l’écart qui sépare
61 C’est ce que suggère J. Wirth, L’image médiévale. Naissance et développements (VIe-XVe siècle), Paris, Méridiens Klincksieck, 1989, p. 277.
62 L’opposition entre la nef et le chevet se retrouve également dans les motifs des culots qui supportent les gargouilles : ceux de la nef sont globalement ornementaux alors que ceux du chevet supportent des visages et divers motifs grotesques qui commentent et redoublent souvent le discours tenu par la gargouille (par exemple : sous le fou, un homme fait une galipette ; sous la femme « vomissant », un homme crache un feuillage, sous la gargouille d’Ève, un visage de femme…).
63 C’est ce que laisse supposer la lecture de : H. Stein, « Notre-Dame de l’Epine à l’époque révolutionnaire », Nouvelle Revue de Champagne et de Brie, 13 (1935), p. 212-218.
64 Sur la personnalité de l’abbé voir J. Garinet, Notice biographique de l’abbé Brisson, Mem. Soc. Agr. Com. Sc. et Art de la Marne, 1838.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
66
la réalisation des gargouilles et leur réception au début XIXe siècle : les scènes scatologi-ques ou obscènes sont décrites avec un mélange de dégoût et de voyeurisme65 et l’auteur se réjouit du « zèle ardent » de l’abbé qui « travaille avec beaucoup de soin à [la] restauration [de la basilique] et à son embellissement, en intéressant pour cela la générosité des princes français, des magistrats etc…»66. Réalisées après la Révolution dans un esprit de re-conquête des âmes avec une volonté quasi-positiviste de dépoussiérer la religion de ses su-perstitions et de ses horreurs passées, ces restaurations sont les plus pudibondes. Il s’agit souvent de la castrations des animaux (46, 47…) ou des hommes (c’est le cas de la fa-meuse statue du masturbateur, n°4), ou de retaille de certains motifs devenues incompré-hensibles ou gênants67.
La seconde phase de restauration court jusqu'à la première moitié du XXe siècle : peut être sous l’influence du goût romantique pour les gargouilles qui se développe à la suite de la publication de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, les restaurations, quand elles ne refont pas la gargouille à l’identique à l’aide surmoulages (1), suivent une veine pittoresque et fantastique (c’est notamment le cas des dragons sinisants, du portrait du vérificateur des monuments historiques).
Entre les motivations présidant à leur réalisation, celles des restaurateurs du XIXe siè-cle et les différentes analyses ésotériques qu’a pu produire le XXe siècle (comme des repré-sentations médiévales de dinosaures, d’hommes de Neandertal qui auraient survécu au Moyen Âge…), peu de motifs ont pu, comme les gargouilles, supporter autant de regards différents et divergents, devenir un réceptacle pour l’imaginaire de sociétés et de groupes aux valeurs si contradictoires68.
65 « La troisième figure gouttière est celle d’une femme, d’une malicieuse invention. Dans
l’attitude d’une personne qui fait de l’eau, cette femme a les épaules et la gorges nues, elle est vêtue d’une justaucorps, ses jupes sont relevées jusqu’au dessus des genoux ; cependant l’artiste à eu l’attention de ne point attaquer la pudeur, en ne laissant voir aux spectateurs que les jarre-tières, et en lui faisant adroitement tenir un voile qui cache ses parties naturelles, que, sans cet expédient, il serait facile de voir en semblable posture », Ét.-Fr.-X. Povillon-Pierard, Descrip-tion historique de Notre-Dame de l'Epine, près Châlons-sur-Marne, Châlons, 1825, p. 21-22.
66 Id. p. 47 67 La modification des deux gargouilles du gable du portail central (44, 45) rend impossi-
ble toute restitution fiable. Cette intervention est peut être l’une des plus rageante : si l’on pense, à la suite de Jean-Marie Berland, que ces gargouilles sont du même atelier que celles du chevet, on ne peut que regretter de ne pas voir quelles « horreurs » les restaurateurs du XIXe siècle ont occulté.
68 Au terme de cet article, il nous est agréable de remercier Jean-Baptiste Renault et Jean-Claude Bonne pour la richesse et la pertinence de leurs remarques sur ce travail.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
67
APPENDICES 1. TABLEAU 2. DESCRIPTION 3. RESTAURATIONS
1. TABLEAU
Bête (chien, loups, ani-mal carni-vore indé-terminé)
Hyb
ride
lion
drag
on
Ovi
ns, c
a-pr
ins
coch
on
bovi
ns
Vol
atile
Hom
me
Ange
ours
Autre
(don
t no
n id
enti-
fié)
Total
Non-narratifs 28 24 3 3 4 3 3 3 16 0 1 5 93
Manduca-tion Prise 7 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 16
Sécrétion 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 Musique 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
autre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 6 Total 35 26 6 3 4 6 3 3 30 1 1 6 124
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
68
2. DESCRIPTION Sont comptées toutes les gargouilles, vraies ou fausses, intactes ou mutilées (même
réduites à une trace). Nous y avons inclus, comme l’ont fait les autres auteurs, de Povil-lon-Piérard à Berland, les statues posées aux extrémités des culées des arcs-boutants de l’abside ; nous y avons ajouté le monstre en bas-relief, mais traité comme une gargouille, et les anges porteurs d’un blason, sur la face sud du bras sud.
BIBLIOGRAPHIE - Berland (1972 = dom J.-M. Berland, L'Epine en Champagne, S.A.E.P., Colmar-
Ingersheim, 1972. - Beuve (1919) = O. Beuve, Notre-Dame de l'Epine, nouveau guide du touriste et de
l’archéologue, Châlons, 1919 - Didron = Didron, « La Champagne et Notre-Dame de l'Epine », Annales archéo-
logiques, t. 24, 1864 p. 293-318 (rédigé en partie avec des notes prises vers 1840)
- Guilhermy = Baron Guilhermy, Visite à Notre-Dame de l'Epine en 1856, publiée et commentée par Jean-Pierre Ravaux, Les Annales de Notre-Dame de l'Epine, n° 81, janvier 1975 ; n° 82, avril 1975 ; n° 83, juillet 1975 ; n° 84, octobre 1975
- Maillet = Germaine Maillet, « Les mystères de l'Epine », Bulletin du comité du folklore champenois, 1973, pp. 4 à 22.
- Povillon (1825) = Povillon-Piérard, Description de l'église de Notre-Dame de l'Epine près de Châlons-sur-Marne, Châlons, 1825 [même texte, avec quelques additions, surtout pour signaler des travaux, par rapport à : « Description de l'église de Notre-Dame de l'Epine près de Châlons-sur-Marne », An-nuaire de la Marne, 1822.
- JPR = remarques de Jean-Pierre Ravaux.
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
69
N° 1 (BC N) - GARGOUILLE : Homme encapuchonné portant sa main à sa gorge (19e)
- inspirée du 4 et peut-être du 30
- Povillon (1825) n° 24 : Chien
- Berland (1972) n° 32 : un manant grotesque porte sa main à la gorge
- CULOT : Feuilles N° 2 (BC N) - GARGOUILLE : bête (19e) - presque identique à 3 - Povillon (1825) n° 23 : Chien
- Berland (1972) n° 31 : Ber-land regroupe 2 gargouilles sous un seul numéro : « autre chien avec collier et anneau, lion (?) »
- CULOT : Chien N° 3 (BC N) - GARGOUILLE : Chien avec collier et anneau sous le collier (19e)
- presque identique à 2 - Povillon (1825) n° 22: chien - Berland (1972) n° 31 : Ber-land regroupe 2 gargouilles sous un seul numéro : « autre chien avec collier et anneau, lion (?) »
- CULOT : Feuilles N° 4 (BC N) - GARGOUILLE : Homme à tête d'animal, sacoche, man-ches à boutons, scapulaire (19e)
- Povillon (1825) n° 21 : homme tenant son phallus
- Guilhermy : on l'a mutilée, le phallus a disparu. Ouvre sa bouche avec les mains ?
- Berland (1972) n° 30 : per-sonnage licencieux (mastur-bateur), mutilé en 1824
- CULOT : Feuilles N° 5 (Chapelle 1 = 1 N) - GARGOUILLE : Chien avec collier et anneau sous le collier, membre génital énorme
- Le traitement et la disposi-tion des feuilles est proche des 5, 31
- Povillon (1825) n° 20 : chien
- Guilhermy : Dogue avec un collier, membre génital énorme
- Beuve (1919), p. 22 [n° 9] : un dogue se fait menaçant [localisation imprécise dans Beuve]
- Berland (1972) n° 29 : do-gue avec collier et anneau [Berland le localise dans BC N, comme Povillon !]
- CULOT : Tête d'homme moustachu entre 2 feuilles
N° 6 (Chapelle 1 = 1 N) - GARGOUILLE : Cochon - Le sabot est celui d’un porc - Le traitement et la disposi-tion des feuilles est proche des 5, 31
- Guilhermy : Sanglier - Beuve (1919), p. 22 [n° 10] : une licorne se montre [locali-sation imprécise dans Beuve]
- Berland (1972) n° 28 : truie - CULOT : Feuilles N° 7 (Chapelle 2 = 2 N)
- GARGOUILLE : Animal - la tête semble être celle d’une biche. Sur son côté gauche, il y a deux objets : un sur le flanc, au-dessus de la patte avant (sa forme fait penser à une botte), l’autre sur la tête (entouré d’un bourrelet qui est peut-être une blessure) ; il s’agit peut-être d’un même objet en arc de cercle, cassé, dont il ne resterait que les deux extrémités
- Povillon (1825) n° 19 : pourceau
- Berland (1972) n° 27 : truie - CULOT : Tête qui baille ; oreilles décollées (une seule est visible, l’autre est cachée sous la coiffe)
N° 8 (Angle chapelle 2 N et culée 3 N)
- GARGOUILLE : Belette tenant son petit
La belette est semblable au n° 13. Le petit est un mâle et semble avoir un pendentif cylindrique suspendu à un collier autour du cou
- Berland (1972) n° 26 : chien sauvage étreignant un homme
- Maillet Pl. 23 - CULOT : Homme suçant son sexe (Même thème sur une miséricorde de stalle à Tréguier : Dorothy et Henry Kraus, Le monde caché des miséricordes, Les éditions de l’Amateur, 1986, p. 123 et fig. 149)
N° 9 (Culée 3 N) - GARGOUILLE : Eve tenant le serpent (Eve est assise et le serpent semble lui parler à
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
70
l’oreille ; le visage de la femme est partiellement dé-truit)
Femme assise, tenant un serpent
- Guilhermy : Homme tenant un serpent (comme si c'était) un instrument de musique
- Berland (1972) n° 25 : per-sonnage au masque hideux saisit un monstre à masque féminin et à queue enroulée
- Maillet Pl. 28 - JPR : cf. statue d’Eve des parties hautes du transept de la cathédrale de Reims
- CULOT : Tête humaine N° 10 (Statue sur culée) - GARGOUILLE : Truie jouant de la harpe et allaitant son petit
A sa ceinture (la boucle est à sa droite) sont accrochés trois objets, 2 à sa gauche (une bourse et un objet en forme de coeur renversé), et un à sa droite (un étui de dague ?)
- Povillon (1825) n° 18 : truie mamelue jouant de la harpe
- Guilhermy : Truie qui allaite ses petits et pince de la harpe
- Didron [n° 8] : truie qui joue de la harpe
- Beuve (1919), p. 22 [n° 8] : une truie pince de la harpe
- Berland (1972) n° 25 : sur-monté d'une truie qui joue de la harpe en allaitant ses co-chons
- Maillet Pl. 15 - CULOT : Aucun N° 11 (Angle culée et chapelle 3)
- GARGOUILLE : Griffon (aigle à corps de lion) (19e
s. ?) Le bec a été récemment cassé. JPR
- Povillon (1825) n° 17 : licorne
- Berland (1972) n° 24 : chien ailé
- CULOT : Tête d'homme N° 12 (Chapelle 3 N) - GARGOUILLE : Chat tenant un homme nu entre ses pattes
Le sexe de l’homme est bien visible.
- Povillon (1825) n° 16 : monstre vorace tenant une petite figure d'homme
- Guilhermy : Monstre tenant un petit personnage
- Berland (1972) n° 23 : monstre vorace qui tient dans ses pattes un petit personnage
- Maillet Pl. 25 - CULOT : Tête de niais, aux oreilles décollées
N° 13 (Chapelle 3 N) - GARGOUILLE : bête fe-melle tenant un être humain nu entre ses pattes
La bête est proche du n° 8 ; ses seins sont placés comme pour une femme. L’être hu-main est nu, assis, et une de ses jambes est repliée devant son sexe ; c’est peut-être une âme.
- Povillon (1825) n° 15 : chatte mamelue tenant un enfant dans ses griffes
- Guilhermy : Monstre tenant un petit personnage
- Berland (1972) n° 22 : chatte (?) aux mamelles très longues pose ses griffes sur les épaules d'un enfant
- Maillet Pl. 24 - CULOT : Tête d'homme
N° 14 (Angle chapelle 3 et culée)
- GARGOUILLE : brisée Il reste une patte griffue et un morceau de ce qui aurait pu être un petit animal
- CULOT : Tête de femme, à étudier)
N° 15 (Culée 3 N) - GARGOUILLE : hybride femelle engoulant une femme (cassée semblable au n° 19).
- Povillon (1825) n° 14 : chèvre mamelue vomissant une figure d'homme
- Guilhermy : Animal mons-trueux, à nombreuses mamel-les, qui vomit un homme
- Beuve (1919), p. 22 [n° 5] : une chèvre vomissant une petite figure d'homme
- Berland (1972) n° 21 : chè-vre vomissant un petit per-sonnage
- Maillet Pl. 26 - CULOT : Tête de femme N° 16 (Statue sur culée) - GARGOUILLE : Animal (tête et pattes brisées ; n’a donc plus d’objet ; décrit par Didron, mais omis par Beuve, ce qui indique proba-blement que cette statue a été brisée entre temps, puisque Beuve suit Didron)
- CULOT : Aucun - Guilhermy : ours (ou 22) - Didron [n° 9] : cochon jouant de la vielle
N° 17 (Angle culée et chapelle 4)
- GARGOUILLE : brisée - CULOT : Tête de vieille femme
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
71
N° 18 (Chapelle d’axe) - GARGOUILLE : Maure accroupi pour faire ses be-soins
Il tient son cimeterre de sa main gauche et relève sa robe de sa main droite, de sorte qu’on voit sa cuisse droite ; il est moustachu et barbu et a un chapeau
- Povillon (1825) n° 13 : guerrier avec un cimeterre
- Guilhermy : guerrier gogue-nard tenant un sabre et satis-faisant un besoin
- Didron [n° 5] : un mata-maure
- Beuve (1919), p. 22 [n° 4] : un guerrier à la barbe épaisse tenant à la main un long cimeterre
- Berland (1972) n° 20 : guer-rier avec son cimeterre
- Maillet Pl. 13 - CULOT : Tête de femme N° 19 (Chapelle d’axe) - GARGOUILLE : Femme accroupie pour faire ses be-soins
On voit bien ses bas de chaus-ses et sa culotte.
- Povillon (1825) n° 12 : Femme qui fait de l'eau
- Didron [n° 4] : la luxure - Guilhermy : Femme qui se trousse la cotte pour lâcher de l'eau
- Beuve (1919), p. 22 [n° 3] : une femme dans une posture indécente
- Berland (1972) n° 19 : une femme trousse sa robe
- Maillet Pl. 10 - CULOT : Tête d'homme barbu
N° 20 (Angle chapelle 4 et culée) (19e s.)
- GARGOUILLE : Chien ailé - Berland (1972) n° 18 : do-gue ailé
- CULOT : Mouluré N° 21 (Culée 3 S) - GARGOUILLE : La colère Homme (ou femme ?) grima-çant se tenant la tête
- Povillon (1825) n° 11 : homme tenant sa tête … horrible
- Didron [n° 3] : la colère - Berland (1972) n° 17 : per-sonnage grotesque se tenant la tête
- Maillet Pl. 11 - CULOT : Tête crachant des feuilles
N° 22 (Statue sur culée) - GARGOUILLE : Ours (tête cassée) jouant du tambourin
- Guilhermy : ours (ou 16) - Didron [n° 7] : singe jouant du tambour
- Beuve (1919), p. 22 [n° 7] : un autre [singe] frappe sur un tambour
- CULOT : Aucun N° 23 (Angle culée et chapelle 5)
- GARGOUILLE : Dragon ailé
- Berland (1972) n° 16 : dra-gon ailé
- CULOT : mouluré N° 24 (Chapelle 3 S) - GARGOUILLE : Fou et sa marotte
Il fait passer ses jambes par-dessus ses épaules
- Povillon (1825) n° 10 : homme tenant sa marotte
- Guilhermy : Fou avec sa marotte
- Beuve (1919), p. 22 [n° 2] : personnage serrant une ma-rotte sur sa poitrine et sym-bolisant peut-être la folie
- Berland (1972) n° 15 : un jongleur avec sa marotte
- Maillet Pl. 9 - CULOT : Acrobate N° 25 (Chapelle 3 S) - GARGOUILLE : Buveur tenant un pichet et une coupe (L’Ivrogne)
- Povillon (1825) n° 9 : Bac-chus tenant un broc et une tasse
- Guilhermy : Personnage grotesque tenant un pot et une écuelle
- Didron [n° 1] : l’ivrognerie - Beuve (1919), p. 22 [n° 1] : paysan tenant d’une main un broc et le l’autre une tasse et personnifiant peut-être l’ivrognerie
- Berland (1972) n° 14 : un buveur tenant pichet et coupe
- Maillet Pl. 8 - CULOT : Tête de fou - Didron [n° 2] : la folie N° 26 (Angle chapelle 5 et culée)
- GARGOUILLE : brisée On voit les morceaux de 3 pattes et son sexe
- CULOT : Tête d'homme N° 27 (Culée 2 S) - GARGOUILLE : Samson (homme à cheval sur un lion dont il ouvre la gueule avec les mains)
- Povillon (1825) n° 7 : homme à cheval sur un
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
72
monstre marin dont il ouvre la gueule
- Guilhermy : Homme qui ouvre la gueule d'un monstre
- Maillet Pl. 30 - CULOT : Tête de femme N° 28 (Statue sur culée) - GARGOUILLE : Singe jouant de la cornemuse
- Povillon (1825) n° 8 : singe - Guilhermy : singe - Didron [n° 6] : singe jouant de la musette
- Beuve (1919), p. 22 [n° 6] : un singe joue de la musette
- Berland (1972) n° 13 : au-dessus [du 13] un singe
- CULOT : Aucun N° 29 (Angle culée et chapelle 6)
- GARGOUILLE : Griffon posé sur un buste d'homme (19e ? ; Gargouille = n° 50)
- Berland (1972) n° 13 : homme à cheval sur un monstre marin
- Maillet Pl. 27 - CULOT : Aucun (ou plu-tôt : intégré dans la gar-gouille)
N° 30 (Chapelle 2 S) - GARGOUILLE : Homme portant un autre homme sur ses épaules
- Povillon (1825) n° 6 : homme qui en porte un autre sur ses épaules
- Guilhermy : Homme monté sur les épaules d'un autre
- Berland (1972) n° 12 : un bourgeois porte un homme à califourchon
- Maillet Pl. 6 - CULOT : Tête de femme
N° 31 (Chapelle 1 S) - GARGOUILLE : Cochon (tête partiellement brisée)
- Le traitement et la disposi-tion des feuilles est proche des 5, 6. Ce culot a servi de modèle pour le 32.
- Berland (1972) n° 11 : truie - CULOT : Tête d'homme barbu entre 2 feuilles
N° 32 (Chapelle 1 S) - GARGOUILLE : Chien avec collier et anneau sous le collier (19e)
- Berland (1972) n° 10 : chien - Gargouille = copie du 5 ; culot s'inspire du 14 et du 31
- CULOT : Tête de femme entre 2 feuilles
N° 33 (Portail bras sud) - GARGOUILLE : Animal (bœuf?) (1891-1894 ?)
- Berland (1972) n° 9 : un loup
- CULOT : Aucun N° 34 (Portail bras sud) - GARGOUILLE : Rapace à pattes avec sabots (tête du 19e = 1891-1894 ? visiblement collée (ou recollée ?) sur le corps)
- Berland (1972) n° 8 : une femme
- CULOT : Aucun N° 35 (Portail bras sud) - GARGOUILLE : Mouton - Berland (1972) n° 7 : lion - CULOT : Aucun N° 36 (Portail bras sud) - GARGOUILLE : Lion - Berland (1972) n° 6 : un chien
- CULOT : Aucun
N° 37 (BC S) - GARGOUILLE : Chien avec son petit entre les pattes arrière (19e : 1891 (devis Ge-nuys))
- CULOT : Aucun (ou plu-tôt : intégré dans la gar-gouille)
- Berland (1972) n° 5 : lion au sexe accentué
- Maillet Pl. 22 N° 38 (BC S) - GARGOUILLE : Vache - Povillon (1825) n° 5 : vache - Guilhermy : Bœuf - Berland (1972) n° 4 : tête de vache
- Maillet Pl. 3 - CULOT : Feuilles N° 39 (BC S) - GARGOUILLE : Homme sauvage velu, avec une capu-che ; un animal (chien?) serré contre lui
- Povillon (1825) n° 4 : espèce de satyre ou démon dont la tête est recouverte d'un capu-chon de moine
- Guilhermy : Singe coiffé d'un bonnet pointu et mordu par un chien
- Berland (1972) n° 3 : satyre couvert d'un capuchon
- Maillet Pl. 29 - CULOT : Aucun N° 40 (BC S) - GARGOUILLE : Chien La tête était cassée, elle est neuve en 2002 (postérieure à 1975). JPR
- Berland (1972) n° 1 : Chien mutilé
- CULOT : Aucun
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
73
N° 41 (BC S) - GARGOUILLE : Chien (19e = 1825 ? Watrinel)
- Povillon (1825) n° 3 : Figure de bête tellement mutilée qu'on ne peut la faire bien connaître
- Berland (1972) n° 2 : un autre chien humoristique
- CULOT : Aucun N° 42 (Façade O : portails) - GARGOUILLE : Quadru-pède ailé, tenant une gre-nouille ? (1825, Watrinel ?)
- Berland (1972) n° 94 : un chien
- Maillet Pl. 4 - CULOT : Feuilles N° 43 (Façade O : portails) - GARGOUILLE : Lion tenant un chien dans ses pat-tes (1825, Watrinel ?)
Le chien qu’il tient a un col-lier. Proche de 114.
- Guilhermy : Lion - Berland (1972) n° 95 : un porc
- Maillet Pl. 5 - CULOT : Tête d'homme et deux mains
N° 44 (Façade O : portails) - GARGOUILLE : Religieux barbu lisant (1825, Watri-nel ?)
- Povillon (1825) n° 1 : reli-gieux lisant (p. 13)
- Guilhermy : religieux barbu lisant
- Berland (1972) n° 96 : une femme entrouvrant son cor-sage
- CULOT : Aucun N° 45 (Façade O : portails)
- GARGOUILLE : Religieux barbu (1825, Watrinel ?)
- Povillon (1825) n° 2 : reli-gieuse priant (p. 13)
- Guilhermy : religieux barbu - Berland (1972) n° 97 : un moine chantant l'office
- CULOT : Aucun N° 46 (Façade O : portails) - GARGOUILLE : Lion (1825, Watrinel ?)
Le sexe a été mutilé - Guilhermy : Lion - Berland (1972) n° 98 : un animal burlesque
- CULOT : Aucun N° 47 (Façade O : portails) - GARGOUILLE : Chien (1825, Watrinel ?)
Le sexe a été mutilé. Quelque ressemblance avec le n° 7
- CULOT : Aucun - Guilhermy : Dogue - Berland (1972) n° 99 : do-gue ailé
- Maillet Pl. 2 N° 48 (Culée intermédiaire d'arc-boutant N)
- GARGOUILLE : Oiseau à tête d'homme encapuchon-née (19e)
- Berland (1972) n° 46 : ani-mal ailé à face humaine cou-verte d'un capuchon
- CULOT : Aucun N° 49 (Culée intermédiaire d'arc-boutant N)
- GARGOUILLE : Quadru-pède (cassé)
- Berland (1972) n° 47 : muti-lé
- CULOT : Aucun
N° 50 (Culée intermédiaire d'arc-boutant S)
- GARGOUILLE : Griffon (19e)
Proche du n° 29 - Berland (1972) n° 48 : monstre ailé à tête d'aigle
- Modèle du 29 - CULOT : Aucun N° 51 (Culée intermédiaire d'arc-boutant S)
- GARGOUILLE : Chien ailé (19e)
- Berland (1972) n° 49 : monstre ailé
- Id. n° 71, 116 - CULOT : Aucun N° 52 (Nef : N) - GARGOUILLE : Dragon (20e JPR)
- CULOT : Chien N° 53 (Nef : N) - GARGOUILLE : Chien (19e)
- Berland (1972) n° 40 : chien - CULOT : Intégrée à la corniche
N° 54 (Nef : N) - GARGOUILLE : hybride à tête d'homme et bonnet pointu (19e)
- Berland (1972) n° 41 : dra-gon couvert d'un capuchon
- CULOT : Intégrée à la corniche
N° 55 (Nef : N) - GARGOUILLE : Hybride ailé à tête d'homme et bonnet pointu (19e)
- Berland (1972) n° 42 : dra-gon ailé
- Maillet Pl. 18
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
74
- CULOT : Intégrée à la corniche
N° 56 (Nef : N) - GARGOUILLE : Hybride (quadrupède ailé, tête de dragon?, queue de reptile) (19e)
- Berland (1972) n° 43 : dra-gon à queue enroulée
- CULOT : Intégrée à la corniche
N° 57 (Bras N : O) - GARGOUILLE : Lion - Maillet Pl. 1 - CULOT : Intégrée à la corniche
N° 58 (Bras N : O) - GARGOUILLE : Chien - Berland (1972) n° 33 : vache - CULOT : mouluré N° 59 (Bras N : N) - GARGOUILLE : Bélier - Berland (1972) n° 34 : 34 = chèvre aux cornes enroulées
- CULOT : mouluré N° 59b : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 44 = bouc
N° 60 (Bras N : tourelle N-E) - GARGOUILLE : Crocodile ailé
- Berland (1972) n° 45 : cro-codile ailé
- CULOT : mouluré N° 61 (Bras N : tourelle N-E) - GARGOUILLE : Homme nu accroupi
- Berland (1972) n° 35 : singe accroupi
- CULOT : Aucun N° 62 (Bras N : tourelle N-E)
- GARGOUILLE : Homme (Raymond Nominé), mous-tachu, tenant une carafe ou une bourse (20e) JPR.
- Berland (1972) n° 36 : muti-lé
- 20e (la précédente était cassée) JPR
- CULOT : Aucun N° 63 (Bras N : tourelle N-E) - GARGOUILLE : Hybride (quadrupède ailé, tête d'oi-seau)
- Berland (1972) n° 37 : chien ailé
- CULOT : Aucun N° 64 (Bras N : tourelle N-E) - GARGOUILLE : Moine tenant un disque rayonnant
- Berland (1972) n° 38 : cha-noine ou moine tient en main un objet rond à spirale
- Maillet Pl. 14 - CULOT : Aucun N° 65 (Bras N : tourelle N-E) - GARGOUILLE : bête - Berland (1972) n° 39 : porc - CULOT : Aucun N° 66 (Bras N : E) - GARGOUILLE : hybride - CULOT : Aucun N° 67 (Chœur) - GARGOUILLE : Dragon ailé
- Maillet Pl. 20 - CULOT : Aucun N° 68 (Chœur) - GARGOUILLE : Bélier? - Maillet Pl. 12 - CULOT : Aucun N° 69 (Chœur)
- GARGOUILLE : Truie (19e)
- CULOT : Feuilles N° 70 (Chœur) - GARGOUILLE : Homme en prière, bonnet d'âne (19e)
- CULOT : Masque grima-çant
N° 71 (Chœur) - GARGOUILLE : Hybride ailé (19e)
- Maillet Pl. 16 - id. n° 50, 116 - CULOT : Feuilles N° 72 (Chœur) - GARGOUILLE : Hybride ailé (19e)
- CULOT : Tête humaine - Maillet Pl. 17 N° 73 (Chœur) - GARGOUILLE : Quadru-pède à cornes (19e)
- Maillet Pl. 19 - CULOT : Tête d'ange N° 74 (Chœur) - GARGOUILLE : bête - CULOT : Feuilles N° 75 (Chœur) - GARGOUILLE : bête - CULOT : Feuilles N° 76 (Bras S : E) - GARGOUILLE : bête - CULOT : Feuilles N° 77 (Bras S : E) - GARGOUILLE : hybride - CULOT : Feuilles N° 78 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : Homme barbu, tenant une écuelle
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
75
- Berland (1972) n° 50 : un chanoine fait l'aumône
- Maillet Pl. 7 - CULOT : Aucun N° 79 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : hybride ailé
- Berland (1972) n° 51 : chi-mère ailée
- CULOT : Aucun N° 80 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : Chien ; écu à 3 lys à ses pieds
- Berland (1972) n° 53 : chien - CULOT : Aucun N° 81 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : Homme barbu, assis, les mains sur les genoux
- Berland (1972) n° 52 : agneau
- CULOT : Aucun N° 82 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : Ange luttant contre un démon
- Berland (1972) n° 55 : deux personnages font une prise de “judo”
- CULOT : Aucun N° 83 (Bras S : tourelle S-E) - GARGOUILLE : illisible - Berland (1972) n° 56 : muti-lé
N° 83b (Bras S : tourelle S-E) : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 54 : chien vomissant sa langue
- CULOT : Aucun N° 84 (Bras S : S) - GARGOUILLE : Oiseau à queue de reptile mangeant une grappe
- Guilhermy : Aigle tenant une banderole
- CULOT : Aucun N° 85 (Bras S : S) - GARGOUILLE : Deux anges portant un écu avec instruments de la Passion
- Guilhermy : Deux anges portant un écu avec instru-ments de la Passion
- CULOT : Aucun N° 85b : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 85 : aigle
N° 86 (Bras S : tourelle S-O) - Berland (1972) n° 63 : chien à tête humaine
- CULOT : Aucun N° 87 (Bras S : tourelle S-O) - Berland (1972) n° 62 : per-sonnage bicéphale
- CULOT : Aucun N° 88 (Bras S : tourelle S-O) - CULOT : Aucun - Berland (1972) n° 60 : Aigle à tête fantaisiste
N° 88b : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 61 : Aigle à tête fantaisiste
N° 89 (Bras S : tourelle S-O) - GARGOUILLE : hybride (19e ?)
- Berland (1972) n° 59 : aigle - CULOT : Aucun N° 90 (Bras S : tourelle S-O) - GARGOUILLE : Clerc chantant (19e ?)
- Berland (1972) n° 58 : clerc chantant l'office
- CULOT : Aucun N° 91 (Bras S : tourelle S-O)
- GARGOUILLE : Griffon (19e)
- Berland (1972) n° 57 : aigle - CULOT : Aucun N° 92 (Bras S : O) - GARGOUILLE : bête (1894)
- CULOT : Aucun N° 93 (Bras S : O) - GARGOUILLE : Vache? (1894-1895 par Gérasime Bellois)
- CULOT : Feuilles N° 94 (Nef : S) - GARGOUILLE : griffon (devis de Granrut de 1843)
- En 1975, le modèle en plâtre existe au presbytère
- Berland (1972) n° 64 : muti-lée
- CULOT : Feuilles N° 95 (Nef : S) - GARGOUILLE : Taureau (devis de Granrut de 1843)
- Berland (1972) n° 65 : muti-lée
- CULOT (double) : Buste d'homme et homme défé-quant
N° 96 (Nef : S) - GARGOUILLE : Chien à collier de poils (devis de Granrut de 1843)
- Berland (1972) n° 66 : muti-lée
- CULOT : Tête entre deux feuilles
- Culot : Cf. n° 32 N° 97 (Nef : S) - GARGOUILLE : Chien à barbichette (devis de Granrut de 1843)
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
76
- Berland (1972) n° 67 : muti-lée
- CULOT : Feuilles N° 98 (Nef : S) - GARGOUILLE : Mouton ? (devis de Granrut de 1843)
- Berland (1972) n° 68 : muti-lée
- CULOT : Feuilles N° 99 (Nef : S) - GARGOUILLE : Chien (19e)
- Berland (1972) n° 69 : muti-lée
- CULOT : Feuilles N° 100 (Tourelle S de tour S) - GARGOUILLE : hybride ailé, à bec d’oiseau (19e ?)
- CULOT : gargouille est intégrée à la corniche
N° 101 (Façade O : sous les 3 pignons)
- GARGOUILLE : Homme (buste) (19e)
- Berland (1972) n° 93 : une femme
- CULOT : Aucun N° 102 (Façade O : sous les 3 pignons)
- GARGOUILLE : Hybride à pattes de lion (buste) (19e)
- Berland (1972) n° 92 : une vache
- Maillet Pl. 21 - CULOT : Aucun N° 103 (Façade O : sous les 3 pignons)
- GARGOUILLE : Femme (buste) (19e)
- Berland (1972) n° 91 : une femme noble
- CULOT : Aucun
N° 104 (Façade O : sous les 3 pignons)
- GARGOUILLE : Crapaud (buste) (19e)
- Berland (1972) n° 90 : vam-pire
- CULOT : Aucun N° 105 (Tour N) - GARGOUILLE : bête - Berland (1972) n° 80 : un petit chien
- CULOT : Aucun N° 106 (Tour N) - GARGOUILLE : bêtes à dents pointues
- CULOT : Aucun - Berland (1972) n° 85 : aigle N° 107 (Tour N) - GARGOUILLE : Chien - Berland (1972) n° 81 : truie ailée
- CULOT : Aucun N° 108 (Tour N : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Chauve-souris
- Id. à 115 - Berland (1972) n° 82 : chauve-souris
- CULOT : Aucun N° 109 (Tour N : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Chien (1868 ? par Libersac)
- Berland (1972) n° 83 : porc - CULOT : Intégrée à la corniche
N° 110 (Tour N : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Chien - Berland (1972) n° 84 : porc
- CULOT : Aucun N° 111 (Tour N : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : hybride ailé
- CULOT : Aucun - Berland (1972) n° 86 : vache ailée (?)
N° 112 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : hybride avec oreilles
- Berland (1972) n° 70 : aigle fantaisiste
- CULOT : Intégrée à la corniche
N° 112b : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 77 : aigle fantaisiste
N° 113 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : bête (tête cassée)
- Berland (1972) n° 71 : aigle - CULOT : Intégrée à la corniche
N° 114 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Lion tenant un chien dans ses pat-tes
- Berland (1972) n° 72 : vam-pire avec sa proie
- Proche ou id. à 43 - CULOT : Intégrée à la corniche
N° 115 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Chauve-souris
- Id. à 108 - Berland (1972) n° 73 : porc - CULOT : Aucun
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
77
N° 115b : DOUBLON DE BERLAND (1972) n° 79 : porc
N° 116 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Chien ailé - id. n° 50, 71 - CULOT : Aucun N° 117 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Bélier - Berland (1972) n° 74 : vache ailée
- CULOT : Aucun N° 118 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : bête - Berland (1972) n° 78 : chien - CULOT : Aucun N° 119 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Homme à tête grimaçante tenant un livre
- Berland (1972) n° 76 : bour-geois tête couverte
- CULOT : Aucun N° 120 (Tour S : sous balus-trade haute)
- GARGOUILLE : Homme tenant un phylactère
- Berland (1972) n° 75 : lutin avec banderole
- CULOT : Aucun N° 121 (Flèche N) - GARGOUILLE : Homme portant une main à sa tête (1868 par Libersac)
- Dessin Ouradou - CULOT : Aucun N° 122 (Flèche N) - GARGOUILLE : Truie jouant du tambour (1868 par Libersac)
- Dessin Ouradou ; Original au Musée de Châlons
- Berland (1972) n° 87 : porc avec collier
- CULOT : Aucun N° 123 (Flèche N) - GARGOUILLE : Fou ? Jouant de la cornemuse (1868 par Libersac)
- Dessin Ouradou ; Original au Musée de Châlons = homme barbu
- Berland (1972) n° 88 : clerc - CULOT : Aucun N° 124 (Flèche N) - GARGOUILLE : Moine avec un livre (1868 par Liber-sac)
- Dessin Ouradou ; Original dans le jardin du presbytère = cassée
- Berland (1972) n° 89 : clerc avec un livre d'Heures
- CULOT : Aucun
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
78
3. RESTAURATIONS N° 42 à 47 ? (22 avril 1825, plus-faits au devis de 1823 (Au portail principal) Traité de
gré à gré avec le sieur Watrinel, demeurant à Verdun, pour le restant de la sculpture des gargouilles et des ornements = 400 F (Archives de la Marne : V 188)
16 août 1845, TRAVAUX FAITS AVANT L’ARRIVÉE DE DE GRANRUT ; Façade ouest : dans la voussure, un dais et une statue au-dessus des trois gargouilles (Archi-ves de la Marne : 4 T 33)
N° 95 à 99 (20 août 1843, devis de de Granrut [devis général, non exécuté cette année là]
5 gargouilles au sud de la nef (Archives des Monuments Historiques (Marne 804) N° ? : s. d., note de de Granrut : travaux effectués en 1863 et 1864 : « réfection d’une gar-
gouille dont les fragments menaçaient la sécurité publique et qui a été restituée dans le type primitif » [non localisée] (Archives de la Marne : 4 T 33)
N° 122 à 125 et 109 ? ( 29 novembre 1867, détail estimatif par Maurice Ouradou pour la
reconstruction de la flèche nord : les sculpteurs : Libersac, de Paris : 3000 F (dont 4 gargouilles, les 8 aigles, gargouille à la tourelle de l’escalier) (Archives de la Marne, 2 O 1826)
N° ? : (1880, restauration du portail : Ouradou et Vagny architectes - gargouille à figure de bête de 0,55 de saillie (Archives de la Marne, 2 O 1826), 5 mars
1881, soumission par Charles Bréhon, sculpteur domicilié à Châlons - une gargouille à figure de bête (55 de saillie) sera payé 80 F (Archives des Monuments
Historiques (Marne 804) s. d., rapport de Barthélemy pour le Conseil général : - 1881, restauration du grand portail, restaurations des pyramidions et de gargouilles (Ar-
chives de la Marne : 4 T 33) N° 34 (tout) et 35 ? (tête) (25 juillet 1891, détail estimatif par Genuys : portail sud :
consolidation du linteau de la porte et restauration de 2 petites gargouilles (restaura-tion d’une tête et d’une petite gargouille d’angle) (Archives de la Marne, 2 O 1826)
N° 37 (25 juillet 1891, détail estimatif par Genuys contrefort après la tour : restauration d’une gargouille cassée : « bûchement à la masse et au poinçon du culot de la gar-gouille » ; restauration d’un pinacle (Archives de la Marne, 2 O 1826)
N° 94 (21 juillet 1894, devis Genuys : refaire une gargouille du comble près de la tourelle
sud-ouest (Archives des Monuments Historiques (Marne 804)
P.O. Dittmar et J.P. Ravaux, « Signification et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine », in J.-B. Renault (éd.), Notre-Dame de L'Epine 1406 - 2006. Actes du colloque international. L'Epine-Châlons 15 et 16
septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.
79
N° 34 et 35 ? (21 juillet 1894, devis Genuys : 2 têtes à rapporter à 2 gargouilles du portail du bras sud (Archives des Monuments Historiques (Marne 804)
N° 94 (9 avril 1895, devis de l’architecte Georges pour les réparations à faire en 1895 :
restauration d’une gargouille dans l’angle de la tourelle sud-ouest du transept sud (Archives de la Marne : 4 T 33)
N° 94 (31 décembre 1895, Mémoire des travaux exécutés par Gérasime Bellois :
« restauration de gargouille dans l’angle du transept sud près la tourelle sud-ouest » (elle a été seulement retouchée) (Archives des Monuments Historiques (Marne 804)
N° ? (31 décembre 1895, Mémoire des travaux exécutés par Gérasime Bellois : « restauration d’une gargouille de la tourelle sud-ouest du transept sud ... repose et réajustage de la tête » (Archives des Monuments Historiques (Marne 804)
N° 34 (31 décembre 1895, Mémoire des travaux exécutés par Gérasime Bellois : « restauration d’une gargouille au portail sud du transept » (Archives des Monu-ments Historiques (Marne 804)
27 mars 1896, le sculpteur Corbel a restauré une gargouille : « tête et partie du corps »,
pour 90 F ; il en a sculpté une autre pour 150 F. (Archives des Monuments Histori-ques (Marne 804)