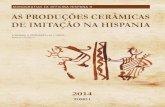CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Penser l'Autre: la philosophie africaine en quête d'identité
Transcript of Penser l'Autre: la philosophie africaine en quête d'identité
EX TRAIT
REVUE PHILOSOPHIQUE DELOUVAIN
FONDEE EN 1894 PAR D. MERCIER
PUBLIEE PAR UINSTITUT SUPERIEUR DE PIDLOSOPHIE
TOME96 Numero2
SOMMAIRE
ARTICLES
Donald lpperciel. La verite du mythe: une perspective hermeneutique-epistemo-logique ........................................................... .
Fabio Ciaramelli. L'originaire et l'immediat. Remarques sur Heidegger et le dernier Merleau-Ponty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Roland Breeur. Merleau-Ponty, un sujet desingularise .............. .
Jean-Michel Connet. Ontologie et itineraire spirituel chez maitre Eckhart
COURRIER DES LECTEURS
Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarriere. Apropos de Maitre Eckhart
ETUDES CRITIQUES
Philipp W. Rosemann. Penser l'Autre: la philosophie africaine en quete d'identite
COMPTES RENDUS
Philosophie du moyen age
Ouvrages divers . . . . . . . ..
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
CHRONIQUES
Jean-Pierre Deschepper. Chronique generale
MAl1998
175-197
198-231
232-253
254-280
281-284
285-303
304-331
331-366
367-381
382-390
REVUE TRIMESTRIELLE PUBLIEE AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE BELGE
LOUVAIN-LA-NEUVE EDITIONS DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE PHILOSOPHIE
La Revue philosophique de Louvain fondee en 1894 par D. Mercier, sous le titre de Revue Nio-Scolastique, est publiee par l'Institut superieur de Philosophie de l'Universite Catholique de Louvain.
La revue s'interesse au mouvement philosophique international dans toute son ampleur.
Organe de recherche et de discussion par ses articles; organe de documentation et de critique par ses bulletins, ses comptes rendus et ses notices bibliographiques; organe d'information par ses chroniques diverses, la Revue philosophique de Louvain veut etre un instrument de travail aussi silr et aussi complet que possible dans le domaine de la philosophie.
La publication d'un article n' engage pas la responsabilite de la Revue. Les droits de traduction et de reproduction sont reserves.
REDACTION Institut Superieur de Philosophie. - College Cardinal Mercier
Place du Cardinal Mercier, 14 B-1348 Louvain-la-Neuve
Directeur: THIERRY LUCAS
Directeur scientifique: MICHEL GHINS
Secretaire: JEAN-PIERRE DESCHEPPER
Comite de redaction: JACQUES ETIENNE, GHISLAINE FLORIVAL, GILBERT GERARD, MICHEL GRINS, JEAN LADRIERE,
JACQUES TAMINIAUX, CLAUDE TROISFONTAINES, GEORGES VAN RIET (t)
Les propositions d'articles sont a envoyer au secretariat de la redaction en trois exemplaires (dont deux sans mentions du nom de l'auteur) et fichier au format compatible Word 7.0 sur disquette de 1.44 MB, formatee PC.
Les textes publies dans la Revue sont soumis a divers lecteurs. -La liste de ces lecteurs est donnee dans le demier numero de l' annee en cours.
ETUDES CRITIQUES
Penser I' Autre: la philosophie africaine en quete d'identite*
A mes amis a !'Uganda Martyrs University
Introduction
Une pensee et une pratique authentiquement postmodemes ne peuvent se contenter d'etre simplement antimodemes. C'est ce que nous avons essaye de montrer dans le «Penser l'Autre» precedent1, qui portait sur les le~ons que le philosophe peut tirer de l' architecture et de la mode postmodemes. En effet, pour surmonter la «dictature» d'une rationalite identifiante et totalisante - ce qui est !'ambition du mouvement postmodeme -, il ne suffit pas de nier simplement cette rationalite pour y opposer un culte de la difference. Un tel culte risque, a la verite, de produire la consequence paradoxale qu'il ne servira qu'a renforcer encore la subjectivite maitrisante. Dans ce contexte, nous avons cite l 'exemple de Disneyland, quintessence d'une architecture post/antimodeme qui rend transparentes toutes les differences dans la langue universelle de l'apparence. Par contre, la tache du postmodemisme au sens strict consiste dans I' effort pour faire voir que l'identite n'est pas le simple oppose de la difference, parce que l'identite est elle-meme intrinsequement traversee de difference. C'est pourquoi, dans cette perspective, l'autre et le meme ne peuvent plus etre penses dans une opposition binaire. Dans le postmodernisme «authentique», il faut plutot arriver a comprendre (et a montrer) que ['autre est toujOUTS deja QU C<EUT meme du meme. Or, pour Ce faire, il est necessaire d' «inscrire et subvertir» l'identite en meme temps, comme nous l'avons dit en citant l'architecte Charles Jencks2 : il faut se
* Reflexions a partir de D.A. Masolo, African Philosophy in Search of Identity (coll. «African Systems of Thought»). Un vol. 21 x 15 de IX-301 pp. Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press; Edirnbourg, Edinburgh University Press, 1994; Nairobi, East African Educational Publishers, 1995.
1 Cfr «Penser l'Autre: De l'architectonique d'un systeme qui ne serait pas homogeneisant», in Revue philosophique de Louvain, 94 (1996), pp. 311-329.
2 Ibid., p. 320.
286 Philipp W. Rosemann
servir (par exemple) de la langue architecturale de telle maniere que, d'une part, les batiments nous «parlent» dans un discours qui tient et nous est comprehensible. Mais, d'autre part, il faut aussi que, dans un tel discours, il y ait des silences et des ruptures qui laissent entrevoir l' espace nu et informe que tout batiment nie et presuppose en meme temps. Nous avons trouve une pareille strategie de «defigurement subversif» dans la mode de Versace. Car, en depit de toutes ses qualites esthetiques, cette demiere n'affirme pas seulement le systeme vestimentaire, mais le «defigure» de maniere a nous montrer l'autre qu'il ( de)voile: le corps nu.
En resume, la strategie la plus efficace, voire la seule strategie, pour echapper a la logique de l'identite n'est pas sa negation, mais sa subversion. 11 ne convient pas que l'autre soit simplement oppose au meme pour defaire le primat de ce demier; dans ce but, il est necessaire de reinscrire l 'autre ( que le meme a rejete en dehors de son champ) dans le meme et de «transgresser» de la sorte la logique binaire du meme3•
C'est dans ce cadre de la tentative postmodeme pour «penser l' Autre» conformement aux exigences de la dialectique entre l'identite et la difference que nous voudrions, dans la presente etude, discuter le probleme de la philosophie africaine. Nul doute que l' Afrique, ses gens et ses cultures n'aient ete marginalises par !'Occident, nul doute que l' Afrique ( surtout l' Afrique Noire) ne ffit pendant longtemps con\:ue comme l'absolument «autre» de l'Ouest: un continent sans culture et civilisation, habite de sauvages sous-humains. La tragedie de l 'Afrique, c'est que cette conception ne lui est pas restee exterieure, mais l'a envahie avec les colonisateurs et esclavagistes blancs, non sans marquer profondement la population indigene elle-meme. Ainsi l'histoire a-t-elle force les Africains a tenter de se penser et de se comprendre a partir d'une situation de marginalisation et d'oppression, c'est-a-dire a partir d'une situation ou ils n'etaient que les «autres» des Blancs. Marginalisee et opprimee pendant plusieurs siecles, I' Afrique est des lors devenue un continent aliene qui se trouve oblige de se definir par, ou contre (ce qui revient au meme), des categories imposees par le centre. Or, dans de telles conditions, comment est-il encore possible pour les Africains de se penser? d'echapper a la logique alienante des Blancs? C'est fajustement le probleme de la «philosophie africaine en quete d'identite», titre d'un livre recent par D.A. Masolo que nous prendrons comme point de depart
3 Nous avons longuement analyse cette strategie de «reinscription transgressive» dans notre etude «Homosexuality and the Logic of Transgressive Reinscription», in International Journal of Philosophical Studies, 4 (1996), pp. 139-153. Cfr egalement nos remarques dans «Penser l' Autre: l'ethique de la theologie negative», in Revue philosophique de Louvain, 93 (1995), surtout pp. 418-420.
La philosophie africaine en quete d'identite 287
de notre discussion. L'ouvrage de M. Masolo constitue une excellente introduction a l'histoire de la philosophie africaine4, ecrite d'un point de vue critique qui permet a l' A. d'evaluer les differentes positions qu'il analyse en fonction de leurs contributions a surmonter l' aporie que nous venons d'evoquer.
L' «invention» de I' Afrique
La «deconstruction» du mouvement historique dans lequel l' Afrique a ete construite comme l' «autre» de l'Ouest a fait l'objet des travaux de V.Y. Mudimbe, surtout de son livre The Invention of Africa, publie en 19885, que Maso lo qualifie plusieurs fois de « brillant» - a bon droit, nous semble-t-il. Dans The Invention of Africa, Mudimbe part de la these foucaldienne selon laquelle le processus decreer une «identite» humaine implique toujours le rejet en dehors du champ de cette identite, d'un «autre» qui sera desormais con9u comme son oppose binaire. L'on connal:t les theories de Foucault sur l' «invention» de la maladie mentale et de l'homosexualite, ainsi que sur leur refoulement vers les marges de la culture, comme conditions de la constitution de la rationalite et de la sexualite modernes6. Mudimbe, pour sa part, reconstruit et de-construit minutieusement l' «invention» de l 'Afrique, c 'est-adire la genese de la representation occidentale de l' Afrique comme l' «autre», comme la «marge» de l'Ouest. Dans cette invention, une place importante est, en fait, occupee par Hegel. Pour ce dernier, on ne l'ignore pas, l'histoire est le processus teleologique dans lequel la sub-
4 Munie, ajoutons-le en passant, d'une bibliographie qui mettra le chercheur qui le souhaite a meme de trouver facilement toute la litterature essentielle dans le domaine de la philosophie africaine. Pour des renseignements bibliographiques plus complets, on consultera: A.J. Smet, Bibliographie de la pensee africaine. Repertoire et supplements!JV. Kinshasa-Limete, Faculte de Theologie catholique de Kinshasa, 1972-1975; idem, «Bibliographie de la pensee africaine/Bibliography on African Thought», in: Cahiers philosophiques africains/African Philosophical Journal 2 (1972), pp. 39-96 et 7/8 (1975), pp. 63-286; idem, «Bibliographie selective de la philosophie africaine. Repertoire chronologique», in: Melanges de philosophie africaine (coll. «Recherches philosophiques africaines», 3). Kinshasa-Limete, Faculte de Theologie catholique de Kinshasa, 1978, pp. 181-261. Le Pere Smet est d'ailleurs en train de preparer une bibliographie exhaustive de la litterature sur la philosophie africaine depuis 1729, qui paraitra en deux volumes sous le titre Bibliographie de la philosophie africaine.
5 Cfr V.Y. Mudimbe, The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge (African Systems of Thought). Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1988.
6 Ace sujet, on lira !'excellent ouvrage de J. Dollimore, Sexual Dissidence. Augustine to Wilde, Freud to Foucault. Oxford, Clarendon Press, 1991.
288 Philipp W. Rosemann
stance devient sujet, en acquerant la pleine conscience de soi. Autrement <lit, l'histoire du monde est l'histoire du plein devenir de l'Esprit, ou de la Raison. La culture et la civilisation des differents peuples, mais surtout leur esprit national, sont l'indice du degre de la conscience de soi que l'Esprit ya atteint. Or, Mlas! d'apres Hegel, l'Afrique Noire ne possede ni conscience de soi, ni raison, ni histoire, ni culture, ni civilisation. Tout ce que l'on y trouve sont des «evenements contingents et des surprises», mais aucun developpement teleologique qui temoignerait de la presence de !'Esprit (cfr Masolo, pp. 4 sq.). La Raison est au centre d'une histoire ou I' Afrique ne figure pas.
De telles idees, est-il besoin de le souligner, ont pu etre utilisees pour justifier tant la colonisation du continent africain que l'esclavage, qui a brutalise l'fu:ne africaine.
Deux reactions a la representation occidentale de l' Afrique: negation du logocentrisme ...
A la representation de I' Afrique comme I' «autre» du monde rationnel et, des lors, civilise, les premiers intellectuels noirs reagissaient par une radicale strategie de negation - a savoir une negation des valeurs du centre qui les avait marginalises, combinee avec une affirmation des valeurs de la «marge». C'est dans le contexte de cette strategie qu'il faut comprendre les auteurs de la Harlem Renaissance aux Etats-Unis d'Amerique, ainsi que l'ideologie de la «negritude» dans le milieu francophone. Des penseurs comme, par exemple, le Martiniquais Aime Cesaire ou le Senegalais Leopold Sedar Senghor acceptent, d'une part, la conceptualisation de l' Africain comme etant depourvu de «raison» au sens occidental. Mais d'autre part, ils insistent sur la valeur positive de cette «folie» 7• Car la raison occidentale n'a-t-elle pas invente la poudre
7 Parler de la pensee africaine comme «folie» se trouve dans le poeme suivant, extrait du Cahier d'un retour au pays natal d'Aime Cesaire (in idem, La poesie, ed. par D. Maximin et G. Carpentier. Paris, Seuil, 1994, p. 25):
«Des mots? Ah oui, des mots! Raison, je te sacre vent du soir. Bouche de I' ordre ton nom? II m' est corolle du fouet. Beaute je t' appelle petition de la pierre. Mais ah! la rauque contrebande demon rire Ah! mon tresor de salpetre ! Paree que nous vous haYssons vous et votre
La philosophie africaine en quete d'identite 289
et le compas, ces instruments de colonisation et d'asservissement? N'est-elle pas intrinsequement habitee d'une volonte de domination? Et si c'est comme cela, n'est-ce pas une bonne chose que les Africains ne soient pas «rationnels» au sens des Occidentaux, qu'ils soient plutot -d'apres ces belles lignes de la plume d'Aime Cesaire -
«ceux qui n'ont invente ni la poudre ni la boussole ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'electricite ceux qui n' ont explore ni les mers ni le ciel mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre gibbosite d'autant plus bienfaisante que la terre deserte davantage la terre silo ou se preserve et mfuit ce que la terre a de plus terre ma negritude n'est pas une pierre, sa surdite ruee contre la clameur du jour ma negritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'ceil mort de la terre ma negritude n' est ni une tour ni une cathedrale
elle plonge dans la chair rouge du sol elle plonge dans la chair ardente du ciel elle troue l' accablement opaque de sa droite patience.
Bia pour le Kai1cedrat royal! Bia pour ceux qui n' ont jamais rien invente pour ceux qui n 'ont jamais rien explore pour ceux qui n' ont jamais rien dompte mais ils s' abandonnent, saisis, a l' essence de toute chose ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde»s.
Ce qui caracterise alors l' esprit africain, d' apres Cesaire, Senghor et d'autres theoriciens de la negritude, c'est son «attitude emotive devant le reel» (Masolo, p. 14): «L'emotion est negre, affirme en effet Senghor, comme la raison hellene» (cite chez Masolo, p. 26). Ceci veut dire,
raison, nous nous reclamons de la demence precoce de la folie flamboyante du cannibalisme tenace
Tresor, comptons: la folie qui se souvient la folie qui hurle la folie qui voit la folie qui se dechaine». 8 Ibid., p. 42. Une explication et analyse litteraire de ces lignes se trouve chez D.
Combe, Aime Cesaire, Cahier d'un retour au pays natal (Etudes litteraires, 43). Paris, Presses universitaires de France, 1993, pp. 113-120.
290 Philipp W. Rosemann
comme le Senegalais 1' ecrit dans un commentaire des fameuses lignes qui viennent d'etre citees, que le Noir se rapporte a l' «autre» qui 1' entoure de fa<;on differente que le Blanc. Tandis que ce dernier aborde ses ob jets de connaissance par un effort actif et agressif pour s 'assimiler ces memes objets, 1' Africain au contraire s'assimile et s'identifie a l'autre:
«Et le voila [c.-a-d. le Negre] qui s'abandonne, docile a ce mouvement vivant, allant du sujet a l'objet, "jouant le jeu du monde". Qu'est-ce a dire, sinon que, pour le Negre, connfiltre c 'est vivre - de la vie de I' Autre -en s'identifiant a l'objet? Con-nfiltre, c'est naitre a l'Autre en mourant a soi: c 'est faire amour avec I' Autre, c 'est danser I' Autre. "Je sens, done je suis"»9.
Par consequent, la connaissance du Blanc reste a la surface des choses, alors que l'homme noir penetre, par intuition et participation, jusqu'a leur essence. C' est pourquoi Senghor estime que l'homme occidental est un etre «rationnel», alors que l'homme africain est plutot un etre «intellectuel», voire «mystique».
L'eloge de la «difference» de l'Africain par rapport a l'homme occidental, de sa «passivite» et de son «emotivite» pretendues n'est pas reste sans critiques. M. Masolo fait justement observer que les champions de la negritude avaient une tendance a rever d'un retour aux origines imaginaires de l'homme noir, a une epoque OU le sujet etait encore immerge dans sa communaute et dans la nature, se trouvant en parfaite harmonie avec elles (cfr Masolo, p. 13). Pour bien des penseurs africains, ce discours ne fait que prolonger et legitimer l'imperialisme de l'Ouest. Ce dont l' Afrique a besoin, selon le Martiniquais Frantz Fanon, ce ne sont pas des hommes passifs et mystiques, ce sont des sujets qui prennent leur destin dans leurs propres mains en luttant activement contre leurs oppresseurs (cfr Masolo, pp. 31-37). Un autre critique de la negritude, le philosophe camerounais Marcien Towa, a tres suggestivement intitule un de ses livres Leopold Sedar Senghor: negritude ou servitude? 10. Sans partager l'ideologie revolutionnaire de Fanon, Towa croit, comme lui, que les theories de la negritude ne sont pas favorables au developpement du continent africain. En effet, pour devenir «non colonisable» par l' autre, il faut que l' Africain devienne d' abord son
9 L.-S. Senghor, «L'apport de la poesie negre au demi-siecle», in idem, Liberte I. Negritude et humanisme. Paris, Seuil, 1964, p. 141. Ace sujet, cfr aussi !'article recent de E.M. Zuesse, «Perseverance and Transmutation in African Traditional Religions», in J.K. Olupona (ed.), African Traditional Religions in Contemporary Society. New York, Paragon House, 1991, pp. 167-184.
ID Cfr M. Towa, Leopold Sedar Senghor: negritude OU servitude? Yaounde, Cle, 1971.
La philosophie africaine en quete d'identite 291
egal. Dans cette perspective, le discours de la difference s' av ere evidemment peu opportun .
. . . et discours «en retour»
Par discours «en retour», nous comprenons, avec Michel Foucault11 ,
une maniere pour un groupe marginalise de s'inscrire au centre de la culture en s' appropriant les concepts et idees de ce dernier - concepts et idees que pourtant le centre avait toujours deployes pour affinner sa propre superiorite. Tandis que la strategie de negation se caracterise par un rejet des valeurs du centre, le discours «en retour» affirme ces memes valeurs, tout en s 'escrimant a demontrer que la marge les possede au meme titre, voire plus originairement, que le centre. Dans l'histoire de la philosophie africaine, cette strategie est exemplifiee par des auteurs comme cheikh Anta Diop ou Henry Olela, qui se sont efforces d'etablir que la rationalite occidentale, loin d'etre superieure a la culture africaine, a ses propres origines dans les anciennes civilisations de l'Afrique (cfr Masolo, pp. 15-24). Car la pensee grecque se serait nourrie de !'heritage de la civilisation egyptienne qui, quanta elle, remonterait a des cultures de l' Afrique Noire. Le Nigerien Innocent C. Onyewuenyi a encore tres recemment publie un livre sur «l'origine africaine de la philosophie grecque». Ces ouvrages sont souvent, il faut bien l'admettre, d'un caractere plutot apologetique et laissent beaucoup a desirer du point de vue strictement scientifique. Qu'il y ait neanmoins une part de verite dans la these sur les origines africaines de la civilisation grecque, c 'est ce qui ressort du travail tres fouille et bien documente de Martin Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization13, qui a ete accueilli assez positivement par la critique.
Quoi qu'il en soit, il est clair que, et la negation du logocentrisme, et le discours «en retour» restent prisonniers d'une definition occidentale de la raison. En effet, ni l'une ni l' autre ne tente de developper une conception authentiquement africaine de la rationalite; tout au contraire, la strategie de negation rejette simplement la rationalite des Blancs, au
11 Cfr M. Foucault, Histoire de la sexualite, vol. 1: La volonte de savoir (Bibliotheque des histoires). Paris, Gallimard, 1976, p. 134. Sur la notion de reverse discourse et sa signification chez Foucault, on pourra lire D.M. Halperin, Saint Foucault. Towards a Gay Hagiography. New York/Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 56-62.
12 Cfr LC. Onyewuenyi, The African Origin of Greek Philosophy: An Exercise in Afrocentrism. Nsukka (Nigeria), University of Nigeria Press, 1993.
13 Cfr M. Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, vol. 1: The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985; vol. 2: The Archeological and Documentary Evidence. New Brunswick, Rutgers University Press, 1987/1991.
292 Philipp W. Rosemann
lieu que le discours «en retour» s'en reclame. Dans le premier cas comme dans I' autre, I' Afrique continue a se definir en fonction de categories occidentales, ne parvenant done pas a se liberer de I' eurocentrisme.
L'ethnophilosophie: une issue aux apories de l'eurocentrisme?
Le projet de I' ethnophilosophie consiste dans la tentative pour retrouver une pensee authentiquement africaine, c'est-a-dire une pensee qui represente plus qu 'une simple reaction, negative OU positive, a !'invasion de I' Afrique par la culture et la pensee occidentales. Or, que cette tentative soit elle-meme accablee de difficultes, c 'est ce qui ressort des debuts memes du mouvement ethnophilosophique. Car la personne que l'on reconnaJ:t aujourd'hui comme le fondateur de l'ethnophilosophie etait. .. un missionnaire belge, le Pere Placide Frans Tempels. Il est vrai que, dans son celebre ouvrage sur La philosophie bantoue14, le P. Tempels essayait pour la premiere fois d'etaler un systeme philosophique africain, notamment l'ontologie, la psychologie et l'ethique sousjacentes aux comportements et au langage des Bantous - mais sous quelles auspices entreprit-il ce projet? De fait, La philosophie bantoue est ecrit dans un but pleinement missionnaire: l 'ouvrage veut faciliter l'evangelisation des Africains en exposant au grand jour les «theories» auxquelles meme les «evolues» parmi les Bantous restent souvent attaches, voire dans lesquelles ils retombent, apres leur christianisation. Autrement dit, la comprehension de la philosophie bantoue n'est pour Tempels qu'un moyen pour mieux la combattre: «Il aspire a comprendre le Bantou afin de le posseder», comme I' a formule Fabien Eboussi-Boulaga, un des critiques de l'approche de Tempels (cite chez Masolo, p. 148). Que la finalite de La philosophie bantoue ne soit pas la comprehension de la mentalite bantoue en elle-meme et pour elle-meme, on s'en apen;:oit egalement dans le fait que Tempels explique la pensee bantoue en la confrontant constamment a la philosophie aristotelico-thomiste des missionnaires: c'est le cas, par exemple, lorsqu'il compare la «force vitale» des Bantous au concept de l'etre dans la philosophie grecque.
Mais mettons de cote pour !'instant ces critiques de l'approche de Tempels, pour voir succinctement quel est I' essentiel de ses theses sur la «philosophie bantoue». Voici !'interpretation que nous en donne M. Masolo:
14 Cfr P. Tempels, La philosophie bantoue. Elisabethville (Lubumbashi), Lovania, 1945; 2e ed., Paris, Presence africaine, 1949; 3e ed., Paris, Presence africaine, 1965.
La philosophie africaine en quete d'identite 293
«Ceci est peut-etre la difference clef entre quelques aspects de la pensee africaine et de la metaphysique scolastique. Tandis que l'idee scolastique de la substantialite de l'etant («in se, non in alio») est fondee sur une conception statique de cet etant, quelques exemples de pensee africaine mettent l'accent sur quelque chose d'autre que ce «se-isme» de l'etant. En effet, ils se concentrent sur l'etre [au sens actif: "be-ing"] de !'existence, sur le mode ou la nature de cet «etre» ["to be"] des etants, sur leur categorie communautaire comme des choses qui existent «ensemble» et, des lors, manifestent d'autres aspects de ce rapport outre leurs «se-ismes» individuels. C'est ici que les exemples tires de la pensee bantoue et luo essayent de mettre l'accent sur la connexion intime entre des etants crees en tant que choses qui depassent leur existence individuelle «in se». Ils voient l'existence comme un phenomene dynamique et non statique. Pour eux, le monde est une communion et non pas une collection d'individus ou d'essences immobiles» (Masolo, p. 59)15•
Avec cette caracterisation de «quelques exemples de pensee africaine», nous rejoignons en fait la maniere senghorienne de depeindre la «negritude»: comme une attitude distinctive envers l' «autre», une attitude peut-etre plus respectueuse de l'alterite de l'autre que ne l'est la rationalite occidentale (cfr ci-dessus, p. 289). Pour le dire dans les termes d'un autre philosophe africain, John S. Mbiti (dont nous aurons encore a parler), l'homrne africain corn;oit sa propre existence comme etant intimement liee a celle de l'autre et enchevetree dans elle: «je suis parce que nous somrnes, et puisque nous sommes, je suis» 16•
L'ethnophilosophie: developpements apres Tempels
Nous avons vu que des critiques africains de Tempels comme, par exemple, Fabien Eboussi-Boulaga ont attire l'attention sur les tendances eurocentristes et meme colonialistes de La philosophie bantoue: le fait que Tempels y parle en tant que missionnaire et pour des missionnaires, qu'il compare la pensee bantoue avec la philosophie scolastique, etc. Cependant, cette critique est loin d'avoir ete partagee par tous les lecteurs africains de La philosophie bantoue. Bien au contraire, quelques philosophes de l' Afrique etaient d'avis que k celebre ouvrage de Tempels atteste une approche colonialiste, non point a cause de son orientation missionnaire et scolastique, mais parce qu'il insiste trop sur la «difference» de la mentalite des Bantous par rapport a la pensee occidentale
15 C'est nous qui traduisons toutes les citations de l'ouvrage de Masolo. 16 J.S. Mbiti, African Religions and Philosophy. Londres, Heinemann, 2e ed., 1990,
p. 106: «The individual can only say: "I am, because we are; and since we are, therefore I am". This is a cardinal point in the understanding of the African view of man.»
294 Philipp W. Rosemann
(cfr Masolo, p. 84). Des lors, ces critiques (souvent provenant, comme Tempels lui-meme, du milieu catholique) s'attelaient a la tache demontrer que les structures de la pensee africaine correspondent bel et bien a celles de la philosophia perennis d'Aristote et de S. Thomas d'Aquin, cette pensee ne pouvant, par consequent, nullement etre tenue pour inferieure aux systemes philosophiques occidentaux. L'ceuvre d'Alexis Kagame s'inscrit, en effet, dans le cadre de ce projet. Dans sa Philosophie bantu-rwandaise de l'etre17 et dans sa Philosophie bantu comparee18, Kagame procede a une analyse tres detaillee d'abord du kinyarwanda (la langue des Bantous du Rwanda) et ensuite de la langue bantoue en general, dans le but de mettre en relief la correspondance entre les categories bantoues de l'etre et les categories aristoteliciennes. Les analyses de Kagame sont basees sur le presuppose qu'il ya des categories universelles de l 'etre qui sont fidelement refletees dans les differentes langues, en depit de leurs differences superficielles - ce qui est, il faut le dire, fort discutable (cfr Masolo, pp. 95-102).
Le Fran9ais Marcel Griaule, autre representant du courant ethnophilosophique, s'est rendu celebre par son ouvrage Dieu d'eau: entretiens avec Ogotemmeli19• Ogotemmeli, un sage appartenant a la tribu des Dogan au Mali, fut interviewe par Griaule en 1933 pendant trente-trois jours, et Dieu d'eau est le resultat de !'exposition du systeme du monde dogon que Griaule a obtenue d'Ogotemmeli a l'occasion de ces entretiens. Ce n'est pas le lieu ici de resumer la Weltanschauung des Dogons, qui comporte une cosmogonie, une metaphysique et une religion tres complexes, centrees sur le principe du nommo. Indiquons seulement que le nommo, engendre par Dieu, est «a la fois parole et force, a la fois une enonciation et un principe primordial d'unite» (Masolo, p. 128). Il est actif en toute chose, surtout dans la vie et les activites humaines. Aussi le nommo est-il present dans les tambours, par exemple, qu'il a fa9onnes par sa parole. Et parce que le nommo est le principe qui anime toute la creation, «le battement des tambours est un acte de creation. La danse, qui est la reponse a cet acte de creation, est le symbole de la participation de l'homme dans l'acte de creation» (Masolo, p. 73)20. Le nommo
17 Cfr A. Kagame, La philosophie bantu-rwandaise de l'etre (Academie royale des Sciences coloniales, Classe des Sciences morales et politiques, Memoires in-8°, Nouvelle sene, XII, 1). Bruxelles, Academie royale des Sciences coloniales, 1956.
18 Cfr A. Kagame, La philosophie bantu comparee. Paris, Presence africaine, 1976. 19 Cfr M. Griaule, Dieu d'eau: entretiens avec Ogotemmeli. Paris, Chene, 1948;
Paris, Fayard, 1966. 20 Sur le role central que jouent les tambours dans la religion africaine, on lira G.
Niangoran-Bouah, Introduction a la drummologie. Sankofa Abidjan, Universite Nationale de Cote-d'Ivoire, Institut d'Ethno-Sociologie, 1981. Le meme auteur a egalement ecrit un bref article sur le sujet: «The Talking Drum. A Traditional African Instrument of Liturgy
La philosophie africaine en quete d'identite 295
est egalement actif dans le tissage et les tissus, raison pour laquelle une femme nue, sans vetements, ne saurait etre attirante: en effet, ce que l'homme desire en elle, c'est le nommo, qui est present dans ses vetements21.
Dieu d'eau a largement echappe a la critique d'etre eurocentrique. En revanche, on a objecte a Griaule qu'il aurait «griaule» Ogotemmeli, en d'autres termes, que la Weltanschauung dogonienne qu'il presente dans son ouvrage serait beaucoup trop systematique pour etre vraie ( cfr Masolo, p. 69). Cependant, dans le contexte de la discussion autour de l'ethnophilosophie, d'autres objections pesent plus. A la verite, elles ne s' adressent pas uniquement a Griaule, mais visent la totalite du mouvement ethnophilosophique.
Deux critiques fondamentales du projet ethnophilosophique
Une premiere critique fondamentale de l 'ethnophilosophie tient tout le projet de vouloir reconstruire une philosophie africaine pour vain et force - et ceci pour differentes raisons. Les uns, comme Fabien Eboussi-Boulaga ou Marden Towa, n'y voient qu'un effort pour satisfaire aux criteres de la culture occidentale. Etant donne que pour l'Ouest la possession d'une tradition philosophique fait partie d'une culture pleinement «civilisee», l' Afrique aussi doit en avoir une - et si elle n'existe pas, on se force a l'inventer. Or, selon EboussiBoulaga,
«Ce role de l'ethnophilosophe ( ... ) COnstitue la negation de la negation du soi. C'est une replique pour affirmer ce qui avait ete nie de lui par le maitre. Pourtant, ce qui est accompli par cette dialectique ( ... ) est l'interiorisation de la dependance» (Masolo, p. 159).
Bref, l'on reproche a l'ethnophilosophie que, malgre tout, elle n'ajamais su se liberer des structures d'un discours «en retour». Les autres - et
and Mediation with the Sacred», in J.K. Olupona (ed.), African Traditional Religions in Contemporary Society (voir note 9), pp. 81-92.
21 Au risque de paraitre superficiel, remarquons en passant que l'on trouve la meme idee dans la Grece ancienne. Pour les Grecs, une femme avait besoin de k6smos, c'est-a-dire d'«ordre» ou d'«omement», pour paraitre, pour devenir visible: «For the Greeks appearing was surface, with epiphaneia a word used for both. For them, when a woman kosmese (adorned) herself, she wrapped her chros in a second skin or body, in order to bring the living surface-body so clothed to light; to make it appear. If women, in ancient Greece, were essentially invisible, kosmos made them visible» (l.K. McEwen, Socrates' Ancestor. An Essay in Architectural Beginnings. Cambridge, Massachusetts/ Londres, The MIT Press, 1993, pp. 43 sq.).
296 Philipp W. Rosemann
on pourrait citer le Ghaneen K wasi22 Wiredu comme representant de ce deuxieme groupe - ne voient aucun sens dans la reconstruction d 'une pensee qui, liee au mode de vie d'une epoque lointaine, doit forcement etre consideree comme depassee, ne pouvant offrir aucune solution aux problemes d'a present. Wiredu ne dirait pas que la Weltanschauung traditionnelle serait «fausse», car, selon lui, elle representait sans aucun doute un point de vue valable dans les circonstances dans lesquelles elle fut originairement com;;ue. Seulement, ces circonstances ont change ( cfr Masolo, pp. 204-232).
Passons a la seconde critique fondamentale du projet ethnophilosophique, elaboree de la fa~on la plus circonstanciee dans le livre Sur la «philosophie africaine ». Critique de l' ethnophilosophie de Paulin Hountondji23 • D'apres celui-ci, l'ethnophilosophie commet une erreur elementaire: elle confond la philosophie au sens strict avec une simple Weltanschauung. Carles ethnophilosophes ne font que reconstruire ce que l'on appelle depuis Janheinz Jahn24 une pensee «deja la», c'est-adire une vue metaphysique du monde qui est virtuellement contenue dans les coutumes et traditions, dans la langue et les proverbes, dans les institutions etc. de certains peuples africains. Or, une telle pensee implicite, qui n'a jamais ete formellement exprimee par les Africains euxmemes, ne saurait etre qualifiee de «philosophie». Et meme Ia OU une Weltanschauung est explicitement articulee par un sage africain, comme dans le cas d'Ogotemmeli, un tel recit de mythes inchangeables representant une sorte de sagesse collective n'est pas encore une philosophie.
«Une pratique philosophique, ecrit ace sujet M. Masolo, ( ... )suppose surtout et de toute evidence une pensee responsable, un effort theorique d'un sujet individuel, et exclut, de ce fait, toute reduction de la philosophie a un systeme de pensee collective» (Masolo, p. 197).
Un tel systeme dogmatique, transmis sans critique de generation en generation, ne repond pas a la definition socratique de la philosophie comme une quete de sagesse. En outre, n'ayant jamais ete mis par ecrit, il manque de l 'objectivite qui est necessaire pour pouvoir etre soumis a une discussion methodique et scientifique.
22 Cfr K. Wiredu, Philosophy and an African Culture. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
23 Cfr P. Hountondji, Sur la «philosophie africaine». Critique de l'ethnophilosophie. Paris, Fram;:ois Maspero, 1977.
24 Cfr J. Jahn, Muntu: An Outline of the New African Culture. New York, Grove Press, 1961.
La philosophie africaine en quete d'identite 297
L'actualite d'une ethnophilosophie revisee
Hountondji s'aligne-t-il alors sur la position d'un Marcien Towa, selon laquelle l 'Africain, s' il veut devenir l' egal de l 'homme occidental, doit «Se nier et s'europeaniser fondamentalement» (cite chez Masolo, p. 167)? Pas exactement. Car Hountondji est tout a fait dispose a admettre que les travaux d'un Marcel Griaule, par exemple, pourraient devenir le point de depart d'une philosophie africaine au sens strict; car ils pourraient foumir la base - les «donnees crues», <lit Henry Odera Oruka25
- d'un discours philosophique critique et scientifique (cfr Masolo, p. 198). Autrement <lit, on peut fort bien concevoir que l'effort pour creer une philosophie africaine au sens strict commence par la mise par ecrit des discours et idees traditionnels, qui doivent ensuite etre reformules et repenses (Heidegger dirait: «repetes») par des philosophes professionnels. V.Y. Mudimbe, qui est, avec Hountondji lui-meme, l'une des figures dominantes dans le mouvement philosophique africain d'aujourd'hui, n'est pas tres loin de cette position, bien qu'il n'accepterait pas la definition etroite que Hountondji donne de la philosophie. En effet, l'auteur de The Invention of Africa considere que seule l'elaboration d'une episteme authentiquement africaine peut remedier a la funeste construction historique de l 'Afrique comme 1' « autre » de l' Ouest. A cet effet, il recommande une «deconstruction arcMologique du discours africain» (Masolo, pp. 189 sq.) s'inspirant de methodes levi-straussiennes et foucaldiennes. La position exemplifiee par Hountondji et Mudimbe represente, a en croire M. Masolo, l'etat actuel de la discussion autour de la philosophie africaine (cfr p. 240).
Critique de l' ethnophilosophie revisee
A premiere vue, sous la forme revisee que preconisent des auteurs comme Hountondji ou Mudimbe, l'ethnophilosophie semble tres bien reconcilier l'universalite du projet philosophique avec la specificite de la pensee africaine, ou l' «identite» avec la «difference». Elle evite avec succes, pourrait-on croire, les extremes, d'une part de la strategie de negation, qui met excessivement l'accent sur la «difference» des Africains, et d'autre part du discours «en retour», qui ne fait que revendiquer l'identite de l'Occident pour l' Afrique. En effet, l'ethnophilosophie revisee aborde la Weltanschauung africaine sous l'angle du projet philo-
25 Cfr H.O. Oruka (ed.), Sage Philosophy: Indigenous Thinkers and Modern Debate on African Philosophy. Leyde, E.J. Brill, 1990; Nairobi, Acts Press, 1991, p. XVII; cite chez Masolo, p. 244.
298 Philipp W. Rosemann
sophique de l'Ouest, combinant ainsi des apports provenant des mondes «blanc» et «noir».
Or, il nous semble que c'est precisement cet «angle» qui pose probleme. Car quelle garantie y a-t-il que la «lecture» de la pensee traditionnelle des Africains dans et par des categories puisees a la philosophie occidentale ne detruise pas l' originalite de cette pensee? Meme Mudimbe, qui est si conscient de ce danger, n'y echappe pas totalement, comme !'observe tres finement M. Masolo:
«Le projet de Mudimbe est sans aucun doute un projet noble - celui de recuperer l' authenticite. Cependant, ce desir n' est pas sans contradictions. L'autre doit se recouvrer soi-meme dans "la liberte de se penser comme le point de depart d'un discours absolu"' libre des codes epistemologiques de la philosophie occidentale. Or, dans le meme projet Mudimbe investit fortement dans les positions de Levi-Strauss et de Foucault en tant qu'ouvertures qui menent au bricolage [en franc;ais dans I' original], au cadre de la rationalite authentiquement africaine» (Masolo, p. 187).
Formulons ce reproche encore autrement. Le projet de Mudimbe est d'une «nature ambigue» (Masolo, p. 192). Car, d'une part The Invention of Africa se sert d'une maniere significative de la these foucaldienne selon laquelle toute identite humaine est constituee d'une fa9on dialectique, a savoir dans et par !'opposition a un «autre». Le «Centre» ne peut se definir que par rapport a la «marge» exclue, et la «marge» doit se referer au «centre» pour se comprendre. Mais d'autre part, Mudimbe semble etre a la recherche d'une identite africaine «pure» et «authentique» qui ne serait pas sujette a cette dialectique (c'est ce qu'il qualifie de «discours absolu» ). Ce projet est evidemment imaginaire.
La philosophie africaine: un reve impossible?
Tout ce que nous venons de dire dans la presente etude semble suggerer qu'en demiere analyse, la «philosophie africaine» s'avere n'etre qu'un reve impossible. C'est d'ailleurs aussi l'impression que, sans doute a son insu, M. Masolo cree dans son ouvrage, dans lequel aucun philosophe, aucune ecole et aucun courant appartenant a la discussion autour de la philosophie africaine n'echappe a une critique radicale. La «philosophie africaine» apparait des lors, soit comme une simple strategie de negation, soit comme un discours «en retour», soit comme une Weltanschauung pre-philosophique, soit comme une deformation occidentale de cette meme pensee «deja lh. A dire vrai, le lecteur d'African Philosophy in Search of Identity qui cherche une possibilite de sortir de cette aporie reste sur sa faim.
La philosophie africaine en quete d'identite 299
Or, si Foucault a raison de dire que toute «identite» est construite dans !'opposition a une «difference» correspondante, et si Mudimbe ne se trompe pas en croyant que l'identite actuelle de l'Afrique s'est historiquement constituee comme la negation de la civilisation occidentale, alors cette dependance mutuelle de l'identite et de la difference signifie que toute tentative pour repenser l'identite de l' Afrique est indissociable d'un effort pour repenser egalement son oppose, c'est-a-dire la civilisation de l'Occident. Autrement dit, la marge ne peut se penser, ne peut se liberer de sa domination par le centre, qu 'en repensant le centre aussi. Nous pensons des lors que, dans la quete d'une philosophie africaine, on s'abuse lorsqu'on tente decreer, ou de reconstruire, une pensee africaine qui serait independante de toute conceptualisation occidentale. Ne fautil pas plutot assumer cette dependance conceptuelle, c'est-a-dire accepter la necessite de «lire» la pensee africaine a l'aide de concepts occidentaux? Est-ce qu'une telle acceptation implique inevitablement la reduction non critique de la pensee africaine a ce qui paralt raisonnable ou recevable du point de vue occidental? Nous ne le croyons pas. L' approche que nous sommes en train d' esquisser n' exclut point la possibilite de soumettre les concepts de la philosophie occidentale a un examen critique, justement a la lumiere que la pensee africaine jette sur eux. Le resultat d'une telle approche ne serait pas, bien sfu, le retour a une africanite virginale; en revanche cette maniere de tourner les concepts de la philosophie occidentale contre eux-memes permettrait une deconstruction de presupposes que celle-ci accepte peut-etre na.lvement. Finalement, cette strategie renverserait la construction de l' Afrique comme «marge» de l'Occident.
Pour conclure, essayons d'expliquer plus concretement la strategie en question.
John S. Mbiti et la «reinscription transgressive» du concept africain du temps
Le Kenyan John S. Mbiti est un des auteurs les plus connus dans le domaine de la philosophie et de la religion africaines. Son livre African Religions and Philosophy26, d'abord publie en 1969, reimprime treize fois avant de paraitre en deuxieme edition, traduit en franc;ais, allemand, polonais, japonais et Coreen, peut reclamer le rang d'un classique. La these fondamentale d'African Religions and Philosophy, la these qui, d'apres Mbiti lui-meme, fournit «la clef pour parvenir a une compre-
26 Pour les donnees bibliographiques, voir note ci-dessus. M. Masolo discute les travaux de Mbiti au cinquieme chapitre de son livre, pp. 103-123.
300 Philipp W. Rosemann
hension des religions africaines et de la philosophie africaine» (Mbiti, p. 14), se resume tres simplement: l' Afrique traditionnelle ne connait «virtually no future», «pratiquement pas de futur» (Mbiti, p. 16). Cette these a fait l'objet de bien des attaques, on s'en doute; de fait, il faut conceder que la documentation que Mbiti offre pour la soutenir laisse a desirer, ce qui est peut-etre du au fait qu'African Religions and Philosophy est corn;;u plutot comme un ouvrage de haute vulgarisation. Mais ce qui nous interesse en premier lieu dans le present contexte est l'usage fort original que Mbiti fait de sa these principale. En effet, il utilise le concept africain du temps, tel qu'il le comprend, pour deconstruire certaines interpretations occidentales du Nouveau Testament, et ceci en affirmant que le temps «sans futur>> des Africains est beaucoup plus proche de l'enseignement authentique de la Bible. Ainsi opere-t-il une «reinscription transgressive» de l 'Afrique au centre de la chretiente qui touche aux fondements memes de la culture occidentale.
Le concept africain du temps se caracterise, selon Mbiti, par plusieurs traits, dont voici les plus importants. 1° Tout d'abord, pour l' Africain traditionnel, non encore touche par !'influence de la culture technologique de l'Ouest, le temps est toujours un temps vecu, reel, experimente, et non pas un temps abstrait. Pour citer un exemple de Mbiti, pour les Nkore, un peuple ougandais, ce que nous appellerions «6 heures» est akasheshe, c'est-a-dire l'heure quand on trait les vaches; ce que nous appellerions «13 heures» est baaza aha maziba, c'est-a-dire l'heure quand on tire de l'eau aux puits, etc. Tout cela est approximatif, bien entendu, selon des criteres occidentaux: il peut tres bien arriver qu' akasheshe soit 6 heures 30 ou 7 heures. Semblablement, pour les Latuka du Soudan, notre «octobre» porte le nom «le soleil», parce que c'est la partie de l'annee quand le soleil est le plus chaud; notre «decembre» est nomme «donne de l'eau a ton oncle», puisque c'est le temps des secheresses, etc. La aussi, il se peut tres bien que «le soleil» dure trente jours dans une annee donnee et trente-cinq dans une autre ... (cfr Mbiti, pp. 19 sq.)27• Beaucoup d' Africains ne connaissent pas la «date exacte» de leur naissance. C'est le cas, par exemple, du president actuel de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui sait seulement que pour ses parents, Sa naissance etait associee a deux evenements: une Campagne de vaccination contre la peste bovine, et la mart d'un roi28• 2° «Le
27 La difference entre notre «temps exact» et le «temps africain» pourrait etre comparee a la difference entre l'annee civile et l'annee ecclesiastique. Cette demiere est, elle aussi, structuree par des evenements lesquels ne tombent pas necessairement le meme jour chaque annee.
28 Cfr Y.K. Museveni, Sowing the Mustard Seed. The Struggle for Freedom and Democracy in Uganda. Londres/Basingstoke, Macmillan, 1997, p. 1.
La philosophie africaine en quete d'identite 301
concept lineaire du temps dans la pensee occidentale ( ... ) est pratiquement etranger a la pensee africaine» (Mbiti, pp. 16 sq.). Nous avons deja vu que le temps africain est structure par des cycles, surtout par les cycles de la vie humaine et de la nature. C'est pourquoi il est circulaire plutot que lineaire. 3° Or, si le temps africain possede une structure cyclique ou circulaire, alors tout ce qui n'appartient pas au cercle de la vie, ne filt-ce que sous une forme memorisee ou anticipee, n'existe pas. Il s'ensuit que, pour l'homme noir, «sasa [mot souaheli correspondant approximativement a «present»] est la periode qui a le plus de sens (most meaningful) pour l'individm> (Mbiti, p. 22). Ce qui distingue pourtant sasa de notre «present», c'est qu'il est pluridimensionnel: en effet, sasa possede «son propre bref futur, un present dynamique et un passe experimente» (ibid.), tandis que le «present» occidental ne represente, a vrai dire, que le «maintenant», c'est-a-dire un point unidimensionnel sur la «ligne» du temps. 4° De Ia, on comprend aisement la these principale de Mbiti, selon laquelle l' Afrique traditionnelle ne connaJ:t «pratiquement pas de futur» (Mbiti, p. 16) au sens occidental, ou le futur est associe a l'idee d'un developpement teleologique debouchant, selon les differentes ideologies, OU bien Sur Un age d'or, OU bien sur la fin du monde present, suivie d'un autre monde «a venir». Pour I' Africain, un tel futur lointain, sans lien avec la vie actuelle, n' a pas de sens. 5° Finalement, a la difference du temps occidental, qui est oriente vers le futur, le temps africain «fait un mouvement "en arriere"» (Mbiti, p. 17). Ainsi, la mort d'une personne n'est pas un evenement «futur», mais signifie sa disparition du sasa et son entree dans le «passe» (zamani en souaheli). En Afrique, une personne ne «meurt» pas au moment ou ses fonctions biologiques cessent. Elle continue a exister dans le sasa, comme un «mort vivant», jusqu'a ce qu'il n'y ait plus personne ayant une connaissance directe d' elle. A ce moment, elle passe dans le zamani, qui est la memoire des personnes dont les noms sont devenus «vides», comme c'est le cas des noms figurant dans de longues genealogies. Zamani est essentiellement un temps mythique.
Resumons la structure du temps africain dans le diagramme suivant:
sasa
zamani
PASSE FUTUR
302 Philipp W. Rosemann
Dans ce diagramme, le temps revet une structure circulaire, car elle est une fonction du cercle de la vie. Tout ce qui a un rapport a la vie appartient au sasa, et ce qui touche la vie le plus directement est au «present». Aux «tangentes» du cercle de la vie et, des lors, aux limites du sasa se trouvent le «passe» et le «futur», ou s'inscrivent des personnes et des evenements dont le lien avec la vie est plus faible. Ce qui n'a plus qu'un lien mythique avec la vie se trouve au zamani.
Dans son ouvrage New Testament Eschatology in an African Background29, Mbiti tache d'etablir que le concept africain du temps correspond beaucoup mieux au message authentique du Nouveau Testament que certaines representations occidentales. A son sens, celles-ci accentuent souvent par trop l'aspect «a venir» de la Redemption, c'est-a-dire la resurrection et la vie eternelle dans l'au-dela. Or, pour les Africains tout ce qui se situe dans un futur si lointain et si hypothetique qu'il n'y a plus aucun rapport avec le cercle de la vie reelle tombe en dehors du sasa, avec comme consequence qu'il n'existe simplement pas. D'apres Mbiti, ce conflit entre le concept traditionnel du temps et les interpretations «lineaires» de l'eschatologie chretienne n'a pas seulement prejudicie aux efforts missionnaires des chretiens en Afrique; plus gravement encore, il est l'indice d'une deformation de la verite chretienne selon laquelle le Christ est intervenu dans l 'histoire humaine pour y rester present: son royaume est deja une realite aujourd'hui. C'est uniquement cette «experience de la presence du Christ dans le sasa» (Masolo, p. 110) qui coillere du sens a l'espoir chretien d'un meilleur monde «a venir».
Voila la maniere dont Mbiti utilise la notion africaine du temps, exposee pour des Occidentaux, dans une langue occidentale et en partant de concepts occidentaux, pour questionner et meme corriger ces concepts.
Conclusion
L'approche exemplifiee par la «reinscription transgressive» du concept africain du temps nous para.ll constituer une perspective prometteuse pour le futur developpement de la philosophie africaine. Elle repond d'une fac;;on satisfaisante aux exigences de la dialectique qui relie historiquement l'identite de l' Afrique a celle de !'Occident, et l'identite de I' Occident a celle de l' Afrique. Elle combine la recherche d'une iden-
29 Cfr J.S. Mbiti, New Testament Eschatology in an African Background: A Study of the Encounter between New Testament Theology and African Traditional Concepts. Oxford, Oxford University Press, 1971.
La philosophie africaine en quete d'identite 303
tite non imaginaire de l 'Afrique avec la possibilite que le monde noir puisse fournir une contribution reelle aux problemes universaux d'une humanite qui devient de plus en plus occidentalisee. Et combien l 'humanite a besoin d'une telle contribution! Terminons done cette etude en citant les mots d'un philosophe sud-africain, Gerhard A. Rauche:
«Un tel ajustement mutuel entre la civilisation technologique de I' Occident et la culture traditionnelle de l' Afrique vaut la peine d, etre discute. Il pourrait mettre au jour les benefices d'etablir un sain equilibre entre la civilisation technologique de !'Occident et la culture africaine. Un tel equilibre pourrait, d'une part, sauver !'Occident des consequences destructrices d'un fonctionnalisme totalitaire et, d'autre part, pourvoir l'Africain du savoir-faire technologique necessaire, sans le deraciner de sa culture traditionnelle. 30» 31
Department of Philosophy University of Dallas 1845 East Northgate Drive Irving, TX 75062-4736 Etats-Unis d 'Amerique
Philipp W. ROSEMANN.
30 G.A. Rauche, «In what sense can there be talk of an African philosophy: a methodological hermeneutics», in South African Journal of Philosophy, 15 (1996), p. 21 (nous traduisons).
31 Un merci tout special au Pere Michel Lejeune, Recteur de l'Uganda Martyrs University, qui a bien voulu relire cette etude, et a !'Alliance franc;;aise de Kampala, dont nous avons pu utiliser la bibliotheque.
SERVICE DES ABONNEMENTS ET ADMINISTRATION E. Peeters, B.P. 41, B-3000 Louvain
Compte de cheques postaux n° 000-0425099-45: Editions Peeters, Louvain
Le prix de souscription a la Revue philosophique de Louvain, annee 1998, est de 2.000 F.B. (port en sus).
Le prix d'un numero isole simple de la Revue est de 600 F.B. (port en sus), le prix d'un numero isole double est de 1.000 F.B. (port en sus).
Comme complement a la Revue philosophique de Louvain, l'Institut supeneur de Philosophie publie egalement le Repertoire bibliographique de la philosophie. Le prix de l' abonnement a la Revue, conjointement avec le Repertoire, est de 3.200 F.B. (port en sus). Le prix de l'abonnement au Repertoire, sans la Revue, est de 1. 7 50 F.B. (port en sus).
REVUE TRIMESTRIELLE PUBLIBE AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE BELGE
BE ISSN 0035-3841