"Notice d’hagiographie africaine : à propos de la datation de la Passio Isaac et Maximiani" ,...
-
Upload
univ-montp3 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of "Notice d’hagiographie africaine : à propos de la datation de la Passio Isaac et Maximiani" ,...
Notice d’hagiographie africaiNe : À propos de la datatioN
de la Passio isaac et MaxiMiani (BHL 4473)1
sabine fialonDocteur en Histoire romaine
CRISES, Université de Montpellier III
Témoignage partial et partisan des déchirements confessionnels qui divisent l’Afrique proconsulaire à la fin du règne de l’empereur Constant, la Passio Isaac et Maximiani se présente sous la forme d’une lettre rédigée par un dénommé Macrobius et adressée à la population donatiste de Carthage2. Après une période d’apaisement des relations entre le pouvoir impérial et les communautés donatistes, l’élection sur le siège de Carthage en 345 de l’évêque catholique Gratus, à la mort de son prédécesseur Caecilianus, est contestée officiellement par Donat de Carthage auprès de Constant et marque le début d’une nouvelle crise. L’empereur envoie deux commissaires impériaux, Paul et Macaire, chargés d’examiner la situation3, auxquels, en Numidie, les partisans de Donat font un accueil si hostile, d’après Optat de Milève4, que Macaire en appelle à la force armée. La conclusion de ces deux personnages est sans appel. Prenant des mesures législatives qui nous sont assez mal connues (on ne sait s’il promulgue un édit ou s’il réactive la législation mise en vigueur par Constantin en 3175), Constant exige que les donatistes reconnaissent l’élection de Gratus et réclame ainsi l’unité des deux Églises.
1. Cet article est issu en grande partie d’une section de mon travail de thèse, Mens immobilis. Recherches sur le corpus latin des actes et passions d’Afrique romaine (iie-vie siècles), préparée sous la direction de Madame Christine Hamdoune, professeur émérite d’Histoire romaine et de Monsieur Jean Meyers, professeur de langue et de littérature latines et soutenue le 7 décembre 2012, à l’université Paul-Valéry, Montpellier III. Je tiens à les remercier tous deux d’avoir bien voulu relire ce texte.
2. C’est ce que l’on peut déduire de la fin du texte, P. Is. XVIII, 116 : Explicit epistola beatissimi martyris Macrobi ad plebem Karthaginis de passione martyrum Isaac et Maximiani (éd. Mastandrea 1995, p. 76-88).
3. Selon Optat de Milève, les commissaires avaient officiellement pour mission de distribuer des sommes d’argent pour la décoration des églises et l’assistance aux pauvres ; Opt., Parm. III, 2-3 : quis negare potest […] imperatorem Constantem Paulum et Macarium primitus non ad faciendam unitatem misisse sed cum eleemosynis quibus subleuata per ecclesias singulas posset respirare, uestiri, pasci, gaudere paupertas ? Qui cum ad Donatum, patrem tuum [Parmenianum] uenirent et quare uenerant indicarent, ille solito furore succensus in haec uerba prorupit : « Quid est imperatori cum ecclesia ? » Et de fonte leuitatis suae multa maledicta effudit (éd. Labrousse 1995). Voir Congar 1963, p. 715 ; Frend 1971, p. 177-178.
4. Voir notamment le rôle joué dans le soulèvement des donatistes numides par Donat de Bagaï d’après le long récit d’Opt., Parm. III, 4.
5. Le témoignage des sources sur cet épisode est assez vague car il n’y est jamais clairement fait mention d’un édit. Voir Conc. Carth. a. 348, praef. : qui imperauit religiosissimo Constantio imperatori ut uotum gereret
80 SABINe FIALON
Selon la procédure habituelle, le proconsul publie un édit de mise en application des décisions impériales, édit qui, d’après la passion, autorise l’utilisation de la torture et interdit de protéger des donatistes en leur donnant asile6. Maximianus est arrêté pour avoir détruit le document lors de son affichage sur le forum de la cité de Carthage7. Il comparaît devant le proconsul pour crime de contumacia. L’hagiographe ne mentionne pas le contenu de l’interroga-toire, préférant faire la part belle aux innombrables tortures que subit le chrétien. Au cours de cette audience publique, qui s’est peut-être déroulée sur le forum, Isaac, assistant à la scène, insulte les catholiques ; son attitude déchaîne la colère du proconsul, qui ordonne aussitôt aux membres de son officium de s’emparer de lui pour le soumettre ensuite à la torture8. Le proconsul condamne les deux hommes à l’exil9, mais Isaac meurt en prison10. Les circonstances de la mort de Maximianus sont plus troubles. D’après l’hagiographe, pour empêcher que les chrétiens n’inhument le corps d’Isaac, le proconsul décide de le jeter à la mer et commue la peine de Maximianus en noyade11, mais l’on suppose qu’en fait, Maximianus est décédé en prison peu de temps après Isaac12. L’hagiographe narre enfin la manière dont les corps, plongés dans les eaux avec au cou et aux pieds des jarres pleines de sable, sont ramenés au rivage par la mer pour qu’ils puissent être enterrés et devenir l’objet d’un culte.
Étroitement liée à la question de l’année de la promulgation de « l’édit » de Constant dont elle est la conséquence directe, la datation du martyre d’Isaac et de Maximianus a récemment suscité de nouveaux débats. en effet, l’éditeur de la passion, P. Mastandrea, s’opposant à la thèse
unitatis et mitteret ministros operis sancti, famulos Dei Paulum et Macarium. Ex Dei ergo nutu congregati <sumus> ad unitatem […] contemplantes unitatis tempus, id est de singulis definire quod nec Carthago uigorem legis infringat nec tamen tempore unitatis aliquid durissimum statuamus (éd. Munier 1974) ; Aug., Psalm. c. part. don. 151-152 : Modum si excessit Macharius / conscriptum in christiana lege / uel legem regis ferebat / cum pugnaret pro unitate (éd. Anastasi 1963) ; Ep. 105, 2 : Tunc Constantinus prior contra partem Donati seuerissimam legem dedit ; hunc imitati filii eius talia praeceperunt (éd. Daur 2009). Optat ne mentionne pas d’édit mais évoque l’intervention de l’armée en Numidie (Opt., Parm. III, 4, 1 : A nobis catholicis petitum militem esse dicitis ; III, 4, 6 : Tunc Taurinus ad eorum litteras ire militem iussit armatum per nundinas ubi circumcellionum furor uagari consueuerat). en faveur de la promulgation de l’édit, voir Monceaux 1912, p. 35 ; Congar 1963, p. 715 ; Frend 1971, p. 178-179 ; Pietri 1995, p. 241. Contre cette hypothèse, voir Martroye 1913 ; Crespin 1965, p. 32-33, n. 5.
6. P. Is. III, 18 : Sed nec segnior et proconsul desideriis eius parem se ipsum subiecit et feralis edicti proposito sacri-legae unitatis iterum foedus celebrari constitutis cruciatibus imperauit, legem scilicet addens insuper traditorum, ut peregrini, quos Christus pro se mandat recipi, ab omnibus pellerentur ne quasi contra unitatis foedera molirentur.
7. P. Is. V, 26 : Callidae mentis celeritate, non pedum, protinus forum certamen ultro prouocaturus ascendit et funestos apices, tamquam Diaboli ibi membra discerperet, manu rapida dissipauit.
8. P. Is. VI, 37-38 : Nam tunc illic illustris Isaac de luctamine sui socii non retinens gaudium, inter fraternos populos publica exsultatione sancti spiritus ferebatur, qui plenus caelesti constantia liberius proclamabat ad traditores : « Venite, satiate uestrae unitatis insaniam. » Cuius ad uocem proconsul furibundus auctorem clamoris instanter officium iubebat inquirere.
9. P. Is. VII, 53 : nulla protinus mora sententiam retardauit, sed ambos iudex paro sorte coniungens ad exilium relegauit.10. P. Is. VIII, 54 : Quibus in carcerem trusis, Isaac statim martyrii consummauit effectum : et (quod plus est) simul
omnes carceres, et corpus dimisit et mundum.11. P. Is. XII, 83-86 : expectabatur proconsul quid de corporis humatione iussisset. […] proconsul tunc coactus
populum a carcere iussit expelli, uniumque Maximianum pariter cum defuncto Isaac marinis fluctibus mergi
praecepit, ne quasi permitteret eos dignitate martyrum uenerari.12. Voir Maier 1987, p. 271, n. 51.
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 81
traditionnelle selon laquelle l’édit d’union aurait été émis en 34713, a proposé d’avancer cette date à 344 ou 34514, soit un ou deux ans après le concile de Sardique de 34315, qui, d’après Augustin, précède l’arrivée de Paul et Macaire sur le territoire africain16. S’appuyant sur cette hypothèse, le savant italien considère que les martyrs ont été jetés à la mer le 16 août 34617. Cependant, dans une publication récente, Br.D. Shaw remet en cause cette datation18. Son étude démontre de manière irréfutable, à mon sens, qu’il est impossible qu’Isaac et Maximianus soient morts en 346, car l’hagiographe souligne que le jour précédant la disparition de leur cadavre était un samedi19. Or, la seule année entre 344 et 349 (terminus ante quem puisque Constant décède en janvier 350) où le 15 août tombe un samedi est l’année 347. Ainsi, la datation traditionnelle doit être maintenue.
S’il semble que le problème de la datation du martyre de Maximianus et d’Isaac est désormais résolu, subsistent pourtant deux interrogations majeures : qui est l’auteur de la passion et, dans l’état où elle nous a été conservée, de quand date-t-elle ?
Comme je l’ai déjà mentionné, si l’on en croit l’explicit du texte, qui figure dans les deux manuscrits les plus anciens20, la passion est l’œuvre d’un évêque, dénommé Macrobius, qui se dit martyr. Jusqu’à présent, tous les spécialites du donatisme et de l’hagiographie africaine qui se sont penchés sur la question s’accordent à voir dans ce Macrobius le quatrième évêque donatiste de rome. Ce personnage a occupé le siège épiscopal en 366-367, terminus post quem de la première édition de l’Aduersus Parmenianum d’Optat de Milève, qui le mentionne21 ; lui ont succédé, toujours d’après Optat, Lucianus puis Claudianus, attesté en 37822. D’après le témoi-gnage de Gennadius, il serait l’auteur d’un traité intitulé Ad confessores et uirgines, rédigé peu avant son départ pour Rome23. G. Morin et A. harnack avaient identifié ce texte avec un apocryphe
13. Voir Monceaux 1912, p. 31-39 ; Brisson 1958, p. 265, n. 2 ; Grasmück 1964, p. 112-132 ; Frend 1971, p. 178-179 ; Maier 1987, p. 256-258, 275-276 ; Cecconi 1990, p. 42 ; Pietri 1995, p. 241-242 ; tilley 1996, p. 61.
14. Cette hypothèse avait déjà été formulée par Crespin 1965, p. 32-33, n. 5, et Folliet 1966, p. 202.15. Sur la datation du concile de Sardique, voir Barnes 1993, p. 71-81.16. Aug., Ep. 44, 3, 6 : Respondit [Fortunius] tam diu transmarinarum partium ecclesias mansisse innocentes, donec
consensissent in eorum sanguinem, quos macarianam persecutionem pertulisse dicebat. […] Tunc protulit quoddam uolumen, ubi uolebat ostendere serdicense concilium ad episcopos afros, qui erant communionis Donati, dedisse litteras (éd. Daur 2004).
17. Voir Mastandrea 1991 et Mastandrea 1995, p. 43-45. Scorza Barcellona 2002, p. 128, adopte aussi cette datation.18. Shaw 2011, p. 825-827, appendix e. en réalité, il faut rendre à César ce qui lui appartient : la démonstration avait
déjà été faite par Maier 1987, p. 270, n. 49, mais Br.D. Shaw n’y fait jamais allusion et ne mentionne pas l’ouvrage dans sa bibliographie.
19. P. Is. XII, 82 : Quale fuit, fratres, quod Dominus suis martyribus ad honorem dignatus est procurare, ut XVII kalen-darum septembrium, die sabbato, ad instar paschae permitteret populis uigilias celebrare !
20. Il s’agit des deux manuscrits suivants : Zürich, Zentralbibliothek, c. 10. i., du ixe siècle et Paris, Bibliothèque nationale, lat. 5643, du xe siècle, auxquels s’ajoute un légendier de Fulda que les bollandistes ont consulté mais qui a été détruit à la fin du xviiie siècle. Voir Mastandrea 1995, p. 48-49, 52.
21. Opt., Parm. II, 4, 1 : Denique si Macrobio dicatur ubi illic sedeat, numquid potest dicere in cathedra Petri ? ; II, 4, 2 : Ergo restat ut fateatur socius uester Macrobius se ibi sedere ubi aliquando sedit Encolpius. Sur la date de cet ouvrage, voir la démonstration classique de Monceaux 1913, ainsi que Labrousse 1995, p. 12-14.
22. Opt., Parm. II, 4, 5 : Igitur quia Claudianus Luciano, Lucianus Macrobio […] successisse uidentur. Sur Macrobius, voir Mandouze 1982a.
23. Gennad., Vir. 5 : Macrobius presbyter et ipse, ut ex scriptis Optati cognoui, donatianorum postea in urbe Roma occultus episcopus fuit. Scripsit, cum adhuc in ecclesia Dei presbyter esset, Ad confessores et uirgines librum moralis quidem sed ualde necessariae doctrinae et praecipue ad custodiendum castitatem aptissimis ualde sententiis
82 SABINe FIALON
de Cyprien, le De singularitate clericorum24, mais depuis lors, de nombreuses études ont contesté cette hypothèse25. Le traité de Macrobius est donc perdu. Bien que nos informations sur cet évêque restent fragmentaires, les spécialistes supposent qu’il aurait rédigé cette passion à rome durant la fin des années 360, soit une vingtaine d’années après les faits, afin d’exhorter la population carthaginoise à continuer la lutte26, son éloignement de Carthage justifiant la forme épistolaire du texte. Ils appuient pour cela leur raisonnement sur les deux passages suivants :
P. Is. III, 13-16 : Siluerat hic apud Karthaginem aliquamdiu saeuae persecutionis immanitas, ut longioris temporis cessatione nutriret peiores insidias, et ubique hoste grassante, hic solum tacebant formidines atque terrores, in tantum ut nihil iam molituras et ipsas saeculi diceres potestates, nulla iam poena terribilis aures et pectora quatiebat. Sola de uobis ac martyribus infinitis Numidiae opinionis consolatio fratrum animos erigebat. […] cum repente Diabolus, iterum fremens, sopitas furoris flammas in peius accendit, et insana suae grassationis arma commouit27.P. Is. XVIII, 114-115 : Eia agite, fratres, accelerate quantocius ut et de uobis non aliter gaudeamus. Inueniat apud uos reditus noster unde glorietur, sicut et de his secessio nostra sortita est gaudia gloriarum. Redeuntes ad tropea uestra ueniamus, ut sicut uobis horum uictorias nuntiauimus, sic postmodum uestras huc ad Karthaginem secuturis ceteris nuntiemus28.
Selon eux, ces quelques lignes prouvent que l’auteur du texte aurait vécu à Carthage (hic), qu’il aurait été témoin du déclenchement de la persécution de 347 et qu’il aurait alors quitté Carthage (secessio) sans doute pour échapper aux mesures impériales29. Il encouragerait la
communitum. Claruit inter nostros primum Africae et inter suos, id est donatianos siue montenses postea Romae (éd. richardson 1896, p. 57-97).
24. Voir Morin 1891, p. 236-237 ; harnack 1903, p. 46-51 et Morin 1912, p. 82-84. Frend 1971, p. 186-187, se prononce en faveur de cette attribution mais écrit, n. 5 : « It must, however, be admitted that the style employed by the writer of this work differs considerably from the violence of the Passio Maximiani et Isaaci (sic) ». récemment, tilley 1997, p. 82 l’attribue elle aussi à Macrobius de rome.
25. Von Blacha 1904, le prête à Novatien ; Schepens 1922, p. 321 et Koch 1926, p. 426-472 considèrent que son auteur devait être un Africain de la première moitié du iiie siècle. Voir aussi la mise au point bibliographique de Quasten 1956, p. 436-437, et celle de Solignac 1980, col. 56. Notons enfin que les travaux de h.J. Frede et r. Gryson sur les sources bibliques de ce traité tendent à montrer qu’il serait postérieur à la deuxième moitié du iiie siècle (Frede et Gryson 1999, p. 68 ; Gryson 2007, p. 438).
26. Voir Monceaux 1920, p. 90-91 ; Grasmück 1964, p. 131, n. 677 ; Fontaine 1993 ; tilley 1996, p. 61 ; Lancel 1999, p. 241 ; Scorza Barcellona 2002, p. 131.
27. « Ici, à Carthage, depuis un moment, la barbarie de la cruelle persécution s’était tue pour nourrir, pendant cette trop longue pause, des embûches encore pires et, alors que partout l’ennemi avançait, ici seulement s’étaient calmées les craintes et les épouvantes, à tel point qu’on aurait dit que les puissances du monde elles-mêmes n’allaient plus rien entreprendre ; plus aucune peine ne frappait de terreur les oreilles et les cœurs. Les sentiments envers vous et envers le nombre infini des martyrs de Numidie était la seule consolation qui tenait en éveil l’âme des frères. […] quand soudain le Diable, frémissant pour la deuxième fois, attisa encore plus violemment les flammes assoupies de sa fureur et leva les armes démentes de son brigandage » (trad. de l’auteur revue par J. Meyers).
28. « Allons, en avant, mes frères, précipitez-vous pour que nous nous réjouissions de la même manière à votre sujet. Qu’à notre retour, nous trouvions auprès de vous de quoi nous glorifier, comme eux, à notre départ, nous ont réjoui de leur gloire. en revenant puissions-nous aller voir vos trophées : ainsi, tout comme nous vous avons annoncé leurs victoires, nous annoncerons un jour les vôtres à tous vos successeurs à Carthage » (trad. de l’auteur revue par J. Meyers).
29. Mandouze 1982a écrit ainsi : « Il est très vraisemblable qu’il [Macrobius de rome] est à identifier avec l’auteur de la Passio Maximiani et Isaac, dont le titre complet est conservé dans l’explicit des manuscrits : Epistula beatissimi martyris Macrobi ad plebem Karthaginis de passione martyrum Isaac et Maximiani, ce qui en ferait effectivement
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 83
population carthaginoise à suivre l’exemple des deux martyrs en vue de faire face aux réactions suscitées par la politique conciliante de Julien l’Apostat30. L’auteur conclut en espérant à son retour (reditus, redeuntes) pouvoir annoncer le martyre de ses lecteurs à d’autres Carthaginois. S’il est vrai qu’en général, ces informations cadrent bien avec la carrière de l’évêque donatiste de Rome, il faut malgré tout supposer que lorsque l’auteur évoque son retour, il ne peut faire allusion qu’à un voyage occasionnel en Afrique et non à un retour définitif dans sa patrie, puisque l’évêque, sauf exception, exerce sa fonction jusqu’à sa mort31.
L’identification de l’auteur de la passion avec l’évêque donatiste de rome semble donc solide. Pourtant, une analyse systématique des réminiscences du texte, menée à l’aide de deux bases de données32, révèle qu’il est le seul, dans l’ensemble du corpus hagiographique donatiste africain, dans lequel les allusions aux œuvres d’Augustin sont plus nombreuses que celles à la production littéraire de Cyprien (dans une proportion de 11 pour 4, comme le montre le tableau infra)33. Certaines de ces allusions, sans doute, ne sont pas vraiment significatives : les expressions que l’on trouve dans la passion et sous la plume d’Augustin semblent trop courantes pour affirmer que ce dernier a véritablement influencé notre hagiographe34. Mais dans d’autres cas, on observe que celui-ci a puisé chez Augustin des tournures poétiques35 et plusieurs formules36, en reprenant
un Africain obligé lui-même (d’où le titre de « martyr ») de quitter l’Afrique par la persécution antidonatiste de 344/347 et témoin oculaire à ce moment-là des faits qu’il raconte et interprète quelque vingt ans plus tard pour l’édification de ses coreligionnaires carthaginois ».
30. L’empereur accorde le retour des exilés donatistes et la restitution de leurs basiliques et propriétés, comme le mentionnent Opt., Parm. II, 16 : ex famulo Dei factus est [Iulianus] minister inimici, apostatam se edictis suis testatus est. […] Nec difficultatem praebuit quem rogastis : ire praecipit pro toto uoto suo quos intellexerat ad disturbandam pacem cum furore esse uenturos. […] eadem uoce uobis libertas est reddita, qua uoce idolorum patefieri iussa sunt templa, et Aug., Petil. II, 97, 224 : Eas [basilicas] enim iubente inimico Christi accepistis […] dum ualidum et uerum uobis uidetur quod Iulianus constituit dicens : « hoc quoque supplicantibus Rogatiano, Pontio, Cassiano et ceteris episcopis, sed et clericis, accedit ad cumulum ut abolitis, quae aduersus eos sine rescripto perperam gesta sunt, in antiquum statum cuncta reuocentur » (éd. Petschenig 1909).
31. Pietri 1976, p. 424, affirme que les donatistes avaient réussi à constituer à rome « une sorte de succession épiscopale », ce qui suppose que l’on élit un nouvel évêque à la mort du précédent.
32. Mastandrea, tessarolo 2001 ; tombeur 2002.33. À titre de comparaison, dans la Passio sancti Donati (BHL 2303b), on compte 17 allusions à l’œuvre de Cyprien
et 3 à celle d’Augustin, dans la Passio Marculi (BHL 5271), le rapport est respectivement de 11 pour 1, et dans la Passio sanctorum Datiui, Saturnini presbyteri et aliorum (BHL 7492), de 16 pour 7.
34. P. Is. I, 1 : minus idoneus sum Domino praebere martyrium, qui fait penser à Aug., Serm. 165 : minus idoneus sum uel comprehendere uel proferre (éd. Migne 1841, col. 902-907) ; P. Is. VI, 35 : inter militem christi et milites Diaboli, à Aug., Psalm. 132, 6 : utinam ergo milites Christi essent, et non milites Diaboli (éd. Dekkers et Fraipont 1990) ; P. Is. IX, 64 : audiebat uocem desuper, à Aug., Psalm. 26, 2, 23 : audiamus et uocem Domini desuper ; 69, 3 : audita desuper uoce ; 130, 14 : audio uocem Dei desuper ; Serm. 169 : audiuit desuper uocem Domini nostri Iesu Christi (éd. Migne 1841, col. 915-926) ; 297 : audiuit uocem desuper ipsius Domini nostri Iesu Christi (éd. Migne 1841, col. 1359-1364).
35. P. Is. IV, 23 : dilectionis animo, ressemble à Aug., Psalm. 102, 14 : sed animo dilectionis fac, non animo ultionis ; P. Is. V, 25 : de tali securitate iam fretus, à Aug., Ciu. V, 21 : quando fretus securitate uictoriae naues, quibus uictus necessarius portabatur, incendit (éd. Dombart, Kalb 1955) ; P. Is. IX, 63 : uehementi dolore compulsus, à Aug., Ep. 108, 6 : magno sum dolore ac timore compulsus ; P. Is. IX, 64 : ad caelorum sublimia, à Aug., Trin. VIII, 7 : utquid imus et currimus in sublimia caelorum (éd. Mountain 1968).
36. P. Is. X, 69 : publice coronatus est, rappelle Aug., Iob. 31 : et coronatus publice legam super humeros meos leuans : et coronatus publice legam (éd. Zycha 1895, p. 509-628) ; P. Is. XIII, 92 : ut ipsa illis praebuisset obsequia
84 SABINe FIALON
exactement les mêmes termes. On trouve dans la passion un exemple à mon sens très éloquent : après avoir rappelé l’affichage de l’édit du proconsul, l’hagiographe explique que Maximianus se précipite sur le forum pour détruire le document : callidae mentis celeritate, non pedum, protinus forum […] ascendit (P. Is. V, 26). Cette expression, particulièrement curieuse (pourquoi dire en effet non pedum puisque, de fait, le martyr court vers le forum ?), ne prend à mon avis tout son sens que grâce à son hypotexte augustinien. Il s’agit d’une réécriture incontestable d’un passage des Enarrationes in psalmos, passage dans lequel Augustin affirme que, pour que l’âme s’approche chaque jour de Dieu, il ne lui sert à rien de courir ; elle doit s’attacher à rester pure et irréprochable (Psalm. 58, 2 : non gressu pedum, non subuectione uehiculorum, non celeritate animalium, non eleuatione pennarum, sed puritate affectuum, et probitate sanctorum morum). Ainsi, notre hagio-graphe a voulu souligner que la précipitation de son martyr est le reflet de la pureté de ses mœurs : c’est l’âme de Maximianus qui le guide et le fait courir, non ses pas.
S’il paraît clair que l’auteur de la passion connaissait une partie de l’œuvre d’Augustin, il s’est également inspiré plus ponctuellement d’autres auteurs chrétiens de la fin du ive et du début du ve siècle, tels qu’Ambroise37, l’Ambrosiaster38, Paulin de Nole39, Zénon de Vérone40, Végèce41 ou Prudence42. Certes, ces réminiscences, à l’exception peut-être de l’expression defixis obtutibus, ne sont pas toutes isolément significatives, mais c’est leur ensemble qui crée un faisceau d’indices que l’on ne peut ignorer.
À la lumière de ces éléments, il me paraît très peu probable que la passion, dans l’état où elle nous a été conservée, date des années 360 ; je placerais plutôt son terminus ante quem à l’époque d’Augustin. D’ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’alors qu’Augustin connaissait l’histoire de Marculus, il ne mentionne jamais explicitement, quoi qu’en disent ses
sua, Aug., Serm. 113 : et cum illi quaererent quando ei obsequia ista praebuissent (éd. Migne 1841, col. 648-652) ; P. Is. XVII, 104 : de inferis animas posse eruere, Aug., Serm. 336 : quis est qui dicere potuit, Domine, eruisti ab inferis animam meam ? (éd. Migne 1841, col. 1471-1475).
37. P. Is. III, 17 : ecclesiam Domini fortioribus cuneis cottidiana exercitatione uallari, qui rappelle Ambr., Ep. 75A, 4 : Circumfusi milites, armorum crepitus, quibus uallata est ecclesia (éd. Zelzer 1982, p. 82-107).
38. P. Is. III, 16 : Diabolus, iterum fremens, est proche de l’Ambrosiast., II Tim. 4, 18 : quia aduersarius noster diabolus circumit fremens sicut leo (éd. Vogels 1969, p. 295-320) ; Quaest. 102, 10 : quia aduersarius noster diabolus fremens sicut leo (éd. Souter 1908, p. 1-416). Pour une datation à la fin du ive siècle, voir Bussières 2007, p. 38-39.
39. P. Is. III, 13 : ubique hoste grassante, semble inspiré de Paul.-Nol., Carm. 16, 28-29 : Maximus, in solis qui saltibus ultima uitae / aeger anhelabat grassante fugatus ab hoste (éd. hartel 1894).
40. P. Is. V, 33 : sic totum corpus fecerant laniatum, ut unum uulnus fecissent tota laniamenta membrorum, dont l’image ressemble à celle évoquée par Zen., Tr. I, 15 : Namque summo capitis a uertice usque ad imos ungues pedum plaga inimici percussus populosis ulceribus non distinctus est, sed totus unum uulnus effectus (éd. Löfstedt 1971).
41. P. Is. VII, 50 : obtunderentur paene, si tantos comminuerent, bipennes aut falces, qui rappelle Veg., Mil. IV, 46, 2 : In eiusmodi certamine tria armamentorum genera plurimum ad uictoriam prodesse compertum est, asseres, falces, bipennes (éd. Önnerfors 1995).
42. P. Is. VII, 51 : iam truces ministri aegris ictibus uictae feritatis hiatus languidos anhelabant, rappelle Prud., Perist. X, 816-817 : Abiens at ille, cum foro abriperent uirum / truces ministri (éd. Cunningham 1966, p. 251-389) et Sym. II, 648 : grande aliquod cuius per hiatum crimen anhelet (éd. Lavarenne, Charlet 2002) ; P. Is. XVI, 100 : defixis obtutibus, vient probablement de Prud., Psych. 337 : defixis inhiant obtutibus (éd. Lavarenne, Charlet 2002).
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 85
éditeurs, Maximianus et Isaac43. Rien ne prouve donc que notre passion soit antérieure au début du ve siècle.
Si l’on accrédite les informations de l’explicit du texte, qui est donc ce donatiste du nom de Macrobius ? On pourrait évidemment supposer qu’il s’agit bien de l’évêque de rome, mais que son texte original a été profondément remanié à l’occasion d’une réécriture datant du début du ve siècle. Mais la langue et le style de la passion sont très uniformes et l’on n’y détecte aucun signe visible de remaniement. Il est donc plus simple et plus prudent de supposer un autre auteur. Or on connaît un autre donatiste du même nom, l’évêque d’hippone, successeur de Proculianus, mort entre 403 et 408, avec lequel Augustin a entretenu une correspondance44. On sait également qu’il a participé à la conférence de Carthage en 41145 et qu’il a refusé de se soumettre à l’édit d’union : dans l’une de ses lettres, Augustin le décrit parcourant la campagne, alors qu’il est interdit de séjour à hippone même, pour s’y faire ouvrir des églises46. Les deux rivaux Augustin et Macrobe devaient donc bien se connaître, ce qui permettrait d’expliquer les réminiscences augustiniennes de la passion, d’autant plus que, vivant à Hippone ou dans ses environs, Macrobius devait avoir très facilement accès à la production littéraire de son adver-saire47. Le choix du genre épistolaire, auquel les hagiographes africains n’ont plus recours depuis la Passio Montani, Lucii et comitum, datée de la fin du iiie siècle, pourrait faire écho à la corres-pondance entretenue avec l’évêque catholique d’hippone48. Il paraîtrait logique qu’ayant participé à la conférence de Carthage et assisté à la « défaite » officielle de sa communauté, Macrobius ait cherché à exhorter les donatistes carthaginois et à les encourager à continuer la lutte, comme il l’a fait lui-même.
Cette proposition n’est pas incompatible avec les données de la passion rappelées ci-dessus. en effet, d’après les rares éléments que l’on peut glaner chez Augustin, il semble que Macrobius
43. Aug., Cresc. III, 49, 54 : Nam de Marculo quod se ipse praecipitauerit audiui. Quod profecto est credibilius quam hoc aliquam potestatem Romanam iubere potuisse Romanis legibus nimis insolitum, cum hoc malum inter tot haereses sub christiano uocabulo errantes proprium sit haeresis uestrae. […] Dixi ergo, qui de Marculo audierim et unde hoc credibilius possit uideri, quid autem uerum sit Deus nouerit. De aliis autem tribus, quorum mortes pariter obiecisti, quid uel quomodo factum sit, ab eis quos nosse existimo, fateor, non quaesiui (éd. Petschenig 1909, p. 325-582). Sur l’identification de deux de ces trois autres martyrs avec Isaac et Maximianus, voir De Veer 1968, p. 384, n. 1.
44. Sur la date de l’entrée en charge de Macrobius d’hippone, voir De Veer 1968, p. 381, n. 3, qui mentionne que Proculianus figure dans une lettre d’Augustin datée de 403 (Aug., Ep. 88, 6 et 8, éd. Daur 2005) et que Macrobius est le destinataire de deux autres lettres, datées de 408 (Ep. 106 et 108).
45. Il est le 190e signataire du mandatum de son parti (Gest. coll. I, 138 : « Augustinus, episcopus ecclesiae Ipponensium Regiorum, Carthagini constitutus, praesente uiro clarissimo et notario Marcellino, hoc mandatum suscepi et subscripsi. » Quo recitato, idem dixit : « E diuerso habeo Macrobium. » Et accedente Macrobio episcopo, idem dixit : « Agnosco », et I, 201 : « Macrobius episcopus Ipponiensis » [éd. Lancel 1974]).
46. Aug., Ep. 139, 2 : modo Macrobius, episcopus eorum, stipatus cuneis perditorum utriusque sexus hac atque illac circuit, aperuit sibi basilicas, quas possessorum quantuluscumque timor clauserat. Sur ce personnage, voir Mandouze 1982b.
47. Plusieurs travaux récents ont mis l’accent sur la rapidité de diffusion de la production littéraire dans l’Antiquité tardive, en partie liée à la révolution du codex. Voir ainsi roberts, Skeat 1983 ; Blanchard 1989 ; Gamble 1995, p. 41-143 ; Zelzer 1995 ; Stroumsa 2005, p. 84.
48. La répression du donatisme est un thème clé de la correspondance d’Augustin ; voir à ce sujet rebillard 1998, p. 144-150.
86 SABINe FIALON
ne soit pas originaire d’hippone : le Père africain raconte que le donatiste est arrivé dans cette région (in hac patria), après son élection sur le siège épiscopal, escorté de troupes armées, avec l’aide de circoncellions49. L’emploi du démonstratif hac est significatif : Augustin désigne la région d’Hippone comme sa patrie, par opposition à celle de Macrobius50. De plus, Augustin ajoute que lorsque Macrobius veut communiquer avec ses troupes armées, il lui faut un inter-prète51, signe qu’il ne connaît pas le punique, alors très utilisé dans les larges zones rurales de la Numidie d’hippone. enfin, la présence de ce dernier à la conférence de Carthage peut expliquer, au même titre que celle d’une attribution à Macrobius de rome, pourquoi l’auteur de la passion parle de son départ de Carthage et envisage son retour dans la capitale : l’auteur compte se rendre à nouveau dans la ville afin de mobiliser les dissidents de sa communauté.
Cette tentative d’attribution n’est bien entendu qu’une hypothèse, que rien, en dehors de l’homonymie des deux personnages, ne peut vraiment confirmer. Pour autant, cette hypothèse est plus solide que celle de l’attribution à Macrobius de Rome dans la mesure où l’époque de rédaction du texte doit être située au début du ve siècle : J. Fontaine l’avait déjà pressenti lorsqu’il écrivait : « Il est surprenant qu’à une date encore relativement aussi haute [366], la codification topique des “Passions épiques” ait déjà atteint un tel niveau »52. Contrairement à ce que l’on a longtemps cru53, le donatisme ne s’est pas éteint peu après sa condamnation définitive par l’empereur en 412 ; il semble même que la conférence de Carthage marque le début d’une intense période de propagande religieuse et politique54, propagande dont le genre hagiogra-phique est l’un des media privilégiés. Comme l’ont récemment montré A. Dearn puis e. Zocca, la Passio sanctorum Datiui, Saturnini presbyteri et aliorum est elle aussi, dans l’état où elle nous est parvenue, postérieure à 41155. Or, il n’est pas indifférent de noter que les prologues des deux textes se ressemblent : dans le prologue de la Passio Datiui, le remanieur donatiste affirme que l’exemple des martyrs d’Abitina aidera les lecteurs et les auditeurs à se préparer à leur tour au martyre56, tout comme l’hagiographe d’Isaac et de Maximianus le dit à ses destinataires
49. Aug., Ep. 108, 5 : nos potius ista in tantis latrociniis circumcellionum clericorumque uestrorum experti sumus, qui corporibus humanis caede atrocissima laniatis tot loca nostrorum sanguine cruentarunt, quorum duces, quando te [Macrobium] ingredientem in hac patria cum suis cuneis deduxerunt, deo laudes inter cantica conclamantes quas uoces uelut tubas praeliorum in suis omnibus latrociniis habuerunt.
50. Sur la Numidie d’hippone à l’époque d’Augustin, voir la mise au point commode de Lancel 1984.51. Aug., Ep. 108, 5 : Alio tamen die concussi ac stimulati aculeis uerborum tuorum, quae in eos per punicum inter-
pretem honesta et ingenua libertatis indignatione iaculatus es factis eorum inritatus potius quam delectatus obsequiis. Sur la langue punique, voir les remarques de Lancel 1981, p. 270-273.
52. Fontaine 1993.53. tengström 1964, p. 112-120.54. Voir Lancel 1989 ; Duval 1991 ; Markus 1991 ; handley 2004. 55. Si le noyau central du texte (P. Dat. 2-18) avait peut-être été produit à la conférence de Carthage, comme l’indique
la mention de la date (Aug., Breu. coll. III, 17, 32 : nam gesta martyrum, quibus ostendebatur tempus persecutionis, consulibus facta sunt Diocletiano nouies et Maximiano octies pridie Februarias [éd. Lancel 1974, p. 261-306]), c’est sans doute sous une forme que l’on ne possède plus. Voir Dearn 2004 et surtout Zocca 2010.
56. P. Dat. 1 : aggredior, inquam, ex actis publicis scribere non tam ingenio praeditus quam ciuico illis amore coniunctus, consulto quidem hoc faciens duplici scilicet modo, ut et imitatoribus eorum ad martyrium animos praeparemus et, quos uiuere in perpetuum atque cum Domino Christo regnare confidimus, etiam confessiones ipsorum, pugnas atque uictorias, cum in litteras digerimus, aeternae memoriae conferamus (éd. Franchi de’ Cavalieri 1931).
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 87
carthaginois. Dans les deux cas, non seulement on se situe après la condamnation définitive de la communauté, mais les auteurs rapportent des faits qui ont plus d’un demi-siècle. Les deux textes nous renseignent ainsi sur la manière dont les donatistes percevaient l’histoire de leur communauté : une succession d’interventions du pouvoir politique, allié des catholiques, provo-quant une longue série de martyrs, au rang desquels Macrobius s’agrège logiquement, en se désignant à son tour comme un martyr dans l’explicit.
Si l’on ne peut tenir pour acquise ma proposition d’attribution, une étude minutieuse des réminiscences de la passion aide néanmoins à cerner, pour reprendre une expression du savant gantois M. Van Uytfanghe, la « personnalité littéraire57 » de l’hagiographe. elle fournit des informations intéressantes, comme le montre le tableau ci-dessous58 :
Passio Isaac et Maximiani
réminiscences païennes réminiscences chrétiennes
3 Ovide 11 AugustinPont. III, 9, 19-20 (II, 12) Serm. 165 (I, 1)H. XIX, 190 (VII, 41) Serm. 113 (XIII, 92)M. XI, 64-65 (XI, 77) Serm. 336 (XVII, 104)M. XV, 505-6 (XIV, 96)* Psalm. 58, 2 (V, 26) Psalm. 102, 14 (IV, 23)3 Virgile Psalm. 132, 6 (VI, 35)Aen. VII, 529-530 (XIV, 94) Ciu. V, 21 (IV, 25)Aen. II, 207-208 ; XI, 754-756 (XV, 98) Ep. 108, 6 (IX, 63)G. III, 514 (V, 33) Trin. 8, 7 (IX, 64)Aen. I, 105 (XIV, 96)* Iob. 31 (IX, 69) Psalm. 26, 2, 23 ; 69, 3 ; 130, 14 ;2 Cicéron Serm. 169 ; Serm. 297 (IX, 64)Sest. 86 (III, 20) Serm. 223I (III, 16)*Leg. I, 26 (V, 26) 4 Cyprien2 Lucrèce Fort. 11 (I, 1)Rer. V, 1079-1080 (XII, 86) Fort. 13 (XIII, 88)Rer. V, 1094-1095 (XIV, 94) Ep. LVIII, 6, 3 (XIII, 88) Ep. LXIII, 11, 3 (IV, 25)2 Stace Ep. LXXVI, 4, 2 (IV, 23)*Th. IV, 309 (XII, 80) Hab. 2 (XII, 81)*Th. X, 272-273 (V, 26)
57. Van Uytfanghe 1985, p. 609.58. Les expressions signalées à l’aide d’une étoile ne sont pas comptabilisées dans les calculs car elles sont trop
courantes pour être attribuées en toute certitude à l’auteur. entre parenthèses figurent les passages correspondant dans la passion.
88 SABINe FIALON
1 tite-Live 3 PrudenceVrb. XXXI, 42, 1 (II, 8) Perist. X, 816-817 (VII, 51)Vrb. XXII, 16, 7 (VII, 50)* Sym. II, 648 (VII, 51) Psych. 337 (XVI, 100)1 Germanicus Perist. III, 85 (III, 16)*Phen. Aratos, 286-287 (III, 16) 3 Pontius1 Lucain V. Cypr. II, 1 (II, 9)Bell. VI, 504 (XIV, 94) V. Cypr. VII, 2 (IV, 25) V. Cypr. XII, 6 (XII, 79)1 Térence Eun. 591 (I, 1) 2 tertullien Pat. 7, 8 (IX, 65)1 Manilius Marc. IV, 20, 1 (XV, 99)Astr. V, 324-325 (XIV, 96) 1 AmbroiseApulée Ep. 75A, 4 (III, 17)M. V, 12 (III, 16)* M. VIII, 2 (IV, 23)* 1 Paulin de NoleM. VII, 13 (XII, 81)* Carm. 16, 28-29 (III, 13) Plaute 1 AmbrosiasterEpid. 28 (VII, 50)* II Tim. 4, 18 ; Quaest. 102, 10 (III, 16) Sénèque 1 Zenon de VéroneThy. 260 (III, 16)* Tr. I, 15 (V, 33)Oed. 53 (XII, 81)* 1 Optat de MilèveValerius Flaccus Parm. IV, 2, 5 (XIII, 93)Arg. V, 310 (III, 16)* 1 CassiodoreTacite Psalm. 134 (XIV, 96)An. VI, 19, 2 (XII, 81)* 1 VégècePseudo Quintilien Mil. IV, 46, 2 (VII, 50)Decl. mai. 11, 10 (XII, 81)*
Mon propos n’est pas ici d’analyser ces réminiscences, qui mériteraient une étude en soi, mais plus simplement de donner un aperçu de la culture de l’auteur : elle touche à la poésie épique, didactique, élégiaque et tragique, à l’éloquence, à l’exégèse, à la philosophie, à l’histoire et à l’apologétique. Son érudition littéraire témoigne bien du fait que la communauté à laquelle il appartient ne se compose pas uniquement de paysans et de marginaux en lutte contre une classe dirigeante de propriétaires terriens « catholiques », comme l’ont soutenu longtemps certains historiens, en assimilant le donatisme au phénomène des circoncellions qui en seraient la base et/
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 89
ou l’aile agissante59. Cl. Lepelley a montré que le donatisme comptait aussi des fidèles dans les catégories les plus élevées de la société60. D’ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’Optat de Milève lui-même soulignait la culture littéraire païenne et chrétienne de l’un de ses principaux rivaux, Donat de Carthage61, et que l’évêque de Cirta Petilianus, appelé uir clarissimus par l’évêque catholique de Sicca Veneria, Fortunatianus (Gest. coll. I, 207), était, d’après Augustin, un avocat brillant et éloquent avant d’être converti « de force » au donatisme62. Notre auteur est donc sans conteste un fin lettré et l’étendue de son érudition invite naturellement à voir en lui un personnage important, qui a suivi une solide formation rhétorique63, ce qui semble bien corres-pondre au profil de l’évêque d’une communauté aussi importante que celle d’hippone, à la tête de laquelle il fallait un homme éloquent pour pouvoir tenir tête à Augustin. Ce dernier reconnaît même que son compétiteur donatiste avait un certain talent oratoire64.
Rédigée, dans la forme qu’on lui connaît, probablement au début du ve siècle, la Passio Isaac et Maximiani met donc en scène le martyre de deux donatistes carthaginois victimes, en août 347, des mesures de l’empereur Constant. Je ne crois pas que Macrobius de rome en soit l’auteur, tant les indices en ce sens sont faibles, à moins de considérer qu’il soit rentré en Afrique dans les années 370 et qu’il y ait vécu durant une quarantaine d’années, ce qui semble improbable en raison du silence total des sources sur ce personnage après 367. Bien que l’on ne puisse assurer avec certitude que Macrobius d’Hippone en est l’auteur, il partage avec notre hagio-graphe, d’après Augustin, une même ardeur à défendre sa cause, un même goût pour la violence et une même formation rhétorique. On pourrait évidemment objecter que ce sont là les principales caractéristiques de l’élite donatiste des ive et ve siècles, mais le cognomen Macrobius n’est alors pas très courant en Afrique. De plus, les données de la passion ne s’opposent pas à mon hypothèse :
59. Sur ce sujet, l’une des meilleures mises au points historiographiques est à mon sens celle de Mandouze 1976. Pour une lecture marxiste du donatisme, voir Martroye 1904 et Martroye 1905 ; Saumagne 1934 ; Diesner 1963, p. 53-78 ; tengström 1964, p. 66-70 et, pour une interprétation nationaliste, voir thümmel 1893 et, plus récemment, Brisson 1958, p. 325-410 et Frend 1971, p. 172-178.
60. Lepelley 1990 (= Lepelley 2001, p. 345-356).61. Opt., Parm. III, 3, 20 : Vbiquem mare saeculum legimus cum esset ipse [Donatus] non tantum in amore aliquorum
christianorum, sed propter scientiam mundanarum litterarum erat etiam in corde maris, id est in amore saeculi et de scientia sua sapiens sibi uisus est.
62. Sur la profession d’avocat de Petilianus, voir Aug., Petil. III, 16, 19 : immo non me sed ipsam dialecticam uelut mentiendi artificem in populare iudicium ream deuocet et in eam quamlibet fragosissimo strepitu aduocati forensis ora distendat. […] sibi propter aduocationem, in qua potentiam quondam suam iactat, et sur son éloquence, Aug., Petil. I, 1, 1 : ita miratus sum […] ut nollem credere illius hominis esse litteras, quem solet fama praedicare quod inter eos doctrina atque facundia maxime excellat ; II, 23, 55 : et dum timet uir disertus Petilianus ; II, 98, 226 : Ima non intellegis, uir diserte.
63. Sur l’histoire de l’éducation dans l’Antiquité, voir Marrou 1958, p. 3-124 ; Laistner 1967, p. 49-73 ; Marrou 1972 (= Marrou 1978, p. 49-104) ; Marrou 1982, p. 127-161 ; riché 1995, p. 13-15. Notons que, comme le rappelle Inglebert 2004, p. 336, la culture chrétienne se diffuse par d’autres voies que le système scolaire, comme la famille, le catéchuménat, la prédication ou l’exégèse. Voir aussi à ce sujet Pack 1989. Pour l’Afrique, la meilleure étude est, sans conteste, celle de Vössing 1997.
64. Aug., Ep. 108, 6 : uerum tu, frater, cum quo nunc ago et de quo in Christo, sicut ipse nouit, gaudere desidero, si partis Donati defensionem in hac Maximiani causa uelis pro ingenii tui et eloquii facultate suscipere nec mendaciter agere.
90 SABINe FIALON
rien n’indique que le texte ait été rédigé vingt ans après les faits et l’annonce d’un retour à Carthage peut désigner une simple visite à la population carthaginoise, par exemple dans le cadre d’un nouveau concile dans la capitale.
On mesure ainsi l’importance de l’étude des réminiscences de documents aussi riches que les textes hagiographiques ; loin de ne devoir être réservée qu’aux philologues et malgré la prudence d’analyse qu’elle demande, cette étude permet de mesurer l’étendue de la culture des élites africaines durant l’Antiquité tardive et, replacée dans l’histoire de la production littéraire de cette région, elle apporte de précieux indices pour la datation des textes. Dans ce cas précis, elle confirme l’intuition de J. Fontaine et ouvre une perspective sur l’importance, encore vivace après 411, du phénomène du martyre comme marqueur d’identité religieuse de la communauté donatiste et mémoire historique collective, perspective que seule une étude minutieuse des textes peut dévoiler.
BiBliographie
AnAstAsi R. (éd.), CongAr Y. M.-J. (intro.), FinAert G. (trad.) (1963), Œuvres de saint Augustin. Traités anti-donatistes, I : Psalmus contra partem Donati ; Contra epistulam Parmeniani libri tres ; epistula ad Catholicos de secta Donatistarum, Paris, Desclée de Brouwer, BA 28, 4e s., 1.
BArnes t.D. (1993), Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Constantinian Empire, Cambridge-Londres, harvard University Press.
BlAnChArd A. (éd.) (1989), Les débuts du codex. Actes de la journée d’étude organisée à Paris les 3 et 4 juillet 1985 par l’Institut de papyrologie de la Sorbonne et l’Institut de recherche et d’histoire des textes (Bibliologia, elementa ad librorum studia pertinentia 9), turnhout, Brepols.
Brisson J.-P. (1958), Autonomisme et christianisme dans l’Afrique romaine de Septime Sévère à l’invasion vandale, Paris, de Boccard.
Bussières M.-P. (2007), Ambrosiaster, Contre les païens et Sur le destin (Sources chrétiennes 512), Paris, Les Éditions du Cerf.
CAvAllo G., leonArdi Cl., Menestò e., (dir.) (1995), Lo Spazio letterario del Medioevo, I : Il Medioevo latino, 3 : La Ricezione del testo, Rome, Salerno Editrice.
CeCConi G.A. (1990), « elemosina e propaganda. Un’analisi della “Macariana persecutio” nel III libro di Ottato di Milevi », REAug, 36, p. 42-66.
CongAr Y. M.-J. (1963), « Le commissaire impérial Macaire », dans Anastasi, Congar, Finaert 1963, p. 715.
Crespin r. (1965), Ministère et sainteté : pastorale du clergé et solution de la crise donatiste dans la vie et la doctrine de saint Augustin, Paris, Institut des Études augustiniennes.
CunninghAM M.P. (éd.) (1966), Aurelii Prudentii Clementis carmina (CCSL 126), turnhout, Brepols.dAur Kl.D. (éd.) (2004), Sancti Aurelii Augustini epistulae. I-LV (CCSL 31), turnhout, Brepols.
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 91
dAur Kl.D. (éd.) (2005), Sancti Aurelii Augustini epistulae. LVI-C (CCSL 31A), turnhout, Brepols.
dAur Kl.D. (éd.) (2009), Sancti Aurelii Augustini epistulae. CI-CXXXIX (CCSL 31B), turnhout, Brepols.
deArn A. (2004), « the Abitinian Martyrs and the Outbreak of the Donatist Schism », JEH, 55, 1, p. 1-18.
deKKers E., FrAipont J. (éd.) (1990), Sancti Aurelii Augustini enarrationes in psalmos (CCSL 38-40), turnhout, Brepols.
de veer A.C. (éd.) et FinAert g., trad. (1968), Œuvres de saint Augustin. Traités anti-donatistes, IV : Contra Cresconium libri IV ; De Unico baptismo (BA 31, 4e s., 4), Paris, Desclée de Brouwer.
diesner h. (1963), Kirche und Staat im spätrömischen Reich : Aufsätze zur Spätantike und zur Geschichte der Alten Kirche, Berlin, evangelische Verlagsanstalt.
doMBArt B., KAlB A. (éd.) (1955), Sancti Aurelii Augustini De ciuitate Dei (CCSL 47-48), turnhout, Brepols.
duvAl Y. (1991), « Grégoire et l’Église d’Afrique. Les “hommes du pape” », dans Gregorio Magno e il suo tempo 1991, p. 129-158.
eCK W. (éd.) (1989), Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit: Kolloquium zu Ehren von Friedrich Vittinghoff (Kölner historische Abhandlungen 35), Cologne-Vienne, Bohlau.
Folliet G. (1966), « L’épiscopat africain et la crise arienne au ive siècle », REByz (Mélanges Venance Grumel), 24, p. 196-223.
FontAine J. (1993), « Passio sanctorum martyrum Isaac et Maximiani », dans herzog, Lebrecht Schmidt 1993, p. 591-592, § 598.4.
FontAine J., pietri Ch. (dir.) (1985), Le Monde latin antique et la Bible (Bible de tous les temps, 2), Paris, Beauchesne.
FrAnChi de’ CAvAlieri p. (1931), « La passio dei martiri Abitinensi », Note agiografiche (Studi e testi 65, 8), Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, p. 49-71.
Frede H.J., gryson R. (1999), Kirchenschriftsteller: Verzeichnis und Siegel. Aktualisierungsheft 1999, Fribourg, herder.
Frend W.h.C. (1971), The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford, Clarendon Press [1re éd. 1952].
gAMBle h.Y. (1995), Books and Readers in the Early Church. A History of Early Christian Texts, New haven-Londres, Yale University Press.
grAsMüCK e.L. (1964), Coercitio, Staat und Kirche im Donatistenstreit, Bonn, L. röhrscheid.Gregorio Magno e il suo tempo (1991) : Gregorio Magno e il suo tempo. XIX Incontro di
studiosi dell’antichità cristiana in collaborazione con l’École française de Rome, Roma, 9-12 maggio 1990, I : Studi storici (Studia ephemeredis augustinianum 33), rome, Institutum patristicum augustinianum.
gryson r. (2007), Répertoire général des auteurs ecclésiastiques latins de l’Antiquité et du haut Moyen Âge, I, Fribourg, herder.
hAndley M.A. (2004), « Disputing the end of African Christianity », dans Merrills 2004, p. 291-310.
92 SABINe FIALON
hArnACK A. (1903), Der pseudocyprianische Traktat de singularitate clericorum. Ein donatis-tischen... Bischofs Macrobius in Rom (text und Untersuchungen, 24, 3), Leipzig, J.C. hinrichs’sche Buchhandlung.
hArtel G. (éd.) (1894), Santi Pontii Meropii Paulini Nolani Carmina (CSeL 30), Prague-Vienne-Leipzig, tempsky-Freytag.
herzog R., leBreCht sChMidt P. (éd.) (1993), Nouvelle histoire de la littérature latine, V : Restauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après J.-C., turnhout, Brepols.
ingleBert h. (2004), « Éducation et culture chez les chrétiens de l’Antiquité tardive », dans Pailler, Payen 2004, p. 333-341.
KoCh h. (1926), Cyprianische Untersuchungen, Bonn, A. Marcus et e. Weber.lABrousse M. (éd., trad.) (1995), Optat de Milève, Traité contre les donatistes (SC 412-413),
Paris, Les Éditions du Cerf.lAistner M.L.W. (1967), Christianity and Pagan Culture in the Later Roman Empire, Ithaca-New
York, Cornell University Press.lAnCel S. (éd.) (1974), Gesta Conlationis Carthaginensis. Sancti Augustini breuiculus conlationis
cum donatistis anno 411 (CCSL 149A), turnhout, Brepols.lAnCel S. (1981), « La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. État des questions »,
RÉL, 59, p. 269-297.lAnCel S. (1984), « Études sur la Numidie d’hippone au temps de saint Augustin », MÉFRA, 96, 2,
p. 1085-1113.lAnCel S. (1989), « Le sort des évêques et des communautés donatistes après la conférence de
Carthage en 411 », dans Mayer, heinz Chelius 1989, p. 149-167.lAnCel S. (1999), Saint Augustin, Paris, Fayard.La Scuola (1972), La Scuola nell’Occidente latino dell’Alto Medioevo, 15-21 aprile 1971, I
(Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo XVII), Spolète, Presso la Sede del Centro.
lAvArenne M., ChArlet J.-L. (éd., trad.) (2002), Prudence, Œuvres, III : Psychomachie ; Contre Symmaque, Paris, Belles Lettres [1re éd. 1963].
lepelley Cl. (1990), « Les sénateurs donatistes », BSNAF, p. 45-56 (= Lepelley 2001, p. 345-356).lepelley Cl. (2001), Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme
(Studi storici sulla tarda Antichità 15), Bari, Munera.löFstedt B. (éd.) (1971), Zenonis Veronensis tractatus (CCSL 22), turnhout, Brepols.MAier J.-L. (1987), Le dossier du donatisme, I : Des origines à la mort de Constance II (303-361),
Berlin, Akademie-Verlag.MAndouze A. (1976), « Le donatisme représente-t-il la résistance à rome de l’Afrique tardive ? »,
dans Pippidi 1976, p. 357-366.MAndouze A. (dir.) (1982a), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, I. Prosopographie de
l’Afrique chrétienne (303-533), Paris, CNrS Éditions, s.u. Macrobius 1, p. 662.MAndouze A. (dir.) (1982b), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, I. Prosopographie de
l’Afrique chrétienne (303-533), Paris, CNrS Éditions, s.u. Macrobius 2, p. 662-663.MArin M., MoresChini Cl. (éd.) (2002), Africa cristiana. Storia, religione, letteratura, Brescia,
Morcelliana.
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 93
MArKus r.A. (1991), « the Problem of “Donatism” in the Sixth Century », dans Gregorio Magno e il suo tempo 1991, p. 159-166.
MArrou h.-I. (1958), Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris [1re éd. 1938].MArrou h.-I. (1972), « L’école de l’Antiquité tardive », dans La Scuola 1972, p. 127-143
(= Marrou 1978, p. 49-104).MArrou h.-I. (1978), Christiana tempora. Mélanges d’histoire, d’archéologie, d’épigraphie et
de patristique (CÉFr 35), rome, École française de rome.MArrou h.-I. (1982), Histoire de l’éducation dans l’Antiquité. II. Le monde romain, Paris, Seuil
[1re éd. 1948].MArtroye Fr. (1904), « Une tentative de révolution sociale en Afrique. Donatistes et circoncel-
lions », Revue des questions historiques, 32, p. 353-416.MArtroye Fr. (1905), « Une tentative de révolution sociale en Afrique. Donatistes et circoncel-
lions », Revue des questions historiques, 33, p. 5-53.MArtroye Fr. (1913), « La répression du donatisme », Mémoires de la société nationale des
Antiquaires de France, 73, p. 76-80.MAstAndreA p. (1991), « Per la cronologia dei Tempora Macariana », Koinonia, 15, p. 19-39.MAstAndreA P. (1995), « Passioni di martiri donatisti (BHL 4473, 5271) », AB, 113, p. 76-88.MAstAndreA P., tessArolo L. (2001), Poetria Noua. A CD-ROM of Latin Medieval Poetry
(650-1250 AD) with a gateway to Classical and Late Antiquity Texts (SISMeL), Florence, Edizioni del Galluzzo.
MAyer C., heinz Chelius K. (1989), Internationales Symposion über den Stand der Augustinus Forschung vom 12. bis 16. April 1987 im Schloß Ravischholzhausen der Justus-Liebig-Universität Gießen (Cassiciacum 39, 1), Würzburg, Augustinus-Verlag.
MAyeur J.-M. (dir.) (1995), Histoire du christianisme des origines à nos jours, II : Naissance d’une chrétienté (250-430), Pietri Ch. et L. (éd.), Paris, Desclée.
Merrills A.h. (éd.) (2004), Vandals, Romans and Berbers. New Perspectives on Late Antique North Africa, Aldershot, Ashgate.
Migne J.-P. (éd.) (1841), Sancti Aurelii Augustini hipponensis opera omnia... (PL 38), Paris, J.-P. Migne.
MonCeAux P. (1912), Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion vandale, IV. Le Donatisme, Paris, É. Leroux.
MonCeAux P. (1913), « La date du traité de saint Optat contre les donatistes », CRAI, 57, 6, p. 450-453.
MonCeAux P. (1920), Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’à l’invasion vandale, V. Saint Optat et les premiers écrivains donatistes, Paris, É. Leroux.
Morin G. (1891), « Une étude sur le “De Aleatoribus” par les membres du séminaire d’histoire ecclésiastique de Louvain », RBen, 8, p. 234-237.
Morin G. (1912), « Notes d’ancienne littérature chrétienne », RBen, 29, p. 82-90.MountAin W.J. (éd.) (1968), Sancti Aurelii Augustini De trinitate libri XV (Libri I-XIII)
(CCSL 50), turnhout, Brepols.Munier Ch. (1974), Concilia Africae A. 345-A. 525 (CCSL 149), turnhout, Brepols.önnerFors A. (éd.) (1995), P. Flauii Vegeti renati epitoma rei militaris, Stuttgart-Leipzig, teubner.
94 SABINe FIALON
pACK e. (1989), « Sozialsgeschichtliche Aspekte des Fehlen einer “christlichen” Schule in der römischen Kaiserzeit », dans eck 1989, p. 185-263.
pAiller J.-M., pAyen P. (éd.) (2004), Que reste-t-il de l’éducation classique ? Relire « le Marrou ». Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, toulouse, Presses universitaires du Mirail.
petsChenig M. (éd.) (1909), Sancti Aureli Augustini opera, VII, 2. Scripta contra Donatistas, II (CSeL 52), Prague-Vienne-Leipzig, tempsky-Freitag.
pietri Ch. (1976), Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440) (BÉFAr 224), rome, École française de rome.
pietri Ch. (1995), « L’échec de l’unité “impériale” en Afrique », dans Mayeur, Pietri et al. 1995, p. 229-248.
pippidi D.M. (éd.) (1976), Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe congrès international d’Études classiques (Madrid, Septembre 1974), Bucarest-Paris, editura Academiei-Les Belles Lettres.
QuAsten J. (1956), Initiation aux Pères de l’Église, II, trad. J. Laporte, Paris, Les Éditions du Cerf.reBillArd É. (1998), « Augustin et le rituel épistolaire de l’élite sociale et culturelle de son
temps. Éléments pour une analyse processuelle des relations de l’évêque et de la cité dans l’Antiquité tardive », dans rebillard, Sotinel 1998, p. 127-152.
reBillArd É., sotinel Cl. (éd.) (1998), L’évêque dans la cité du ive au ve siècle : image et autorité. Actes de la table ronde organisée par l’Istituto patristico Augustinianum et l’École française de Rome (Rome, 1er-2 décembre 1995) (CÉFr 248), rome, École française de rome.
riChArdson e.C. (éd.) (1896), Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Altchristlicher Literatur, 14, 1a, Leipzig, J.C. hinrichs’sche Buchhandlung.
riChé P. (1995), Éducation et culture dans l’Occident barbare, vie-viiie siècles, Paris, Seuil [1re éd. 1962].
roBerts C.H., sKeAt, t.C. (1983), The Birth of the Codex, Oxford, Oxford University Press.sAntieMMA A. (éd.) (2010), Scritti in honore de Gilberto Mazzoleni (Che siamo 45), Rome,
Bulzoni.sAuMAgne Ch. (1934), « Ouvriers agricoles ou rôdeurs de celliers ? Les circoncellions d’Afrique »,
Annales d’histoire économique et sociale, 6, p. 355-364.sChepens P. (1922), « L’épître “De singularitate clericorum” du Pseudo-Cyprien », RSR, 13,
p. 297-327.sCorzA BArCellonA Fr. (2002), « L’agiografia donatista », dans Marin, Moreschini 2002,
p. 125-151.shAw Br.d. (2011), Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of
Augustine, Cambridge, Cambridge University Press.solignAC A. (1980), Dictionnaire de spiritualité. Ascétique et mystique. Doctrine et histoire, X,
s.u. Macrobius, évêque donatiste, † après 365, col. 56.souter A. (éd.) (1908), Pseudo-Augustini Quaestiones ueteris et noui testamenti CXXVII
(CSeL 50), Vienne-Leipzig, Bibliopola academiae litterarum Caesareae Vindobonensis.strouMsA G. (2005), La fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Paris, O. Jacob.
NOtICe D’hAGIOGrAPhIe AFrICAINe... 95
tengströM e. (1964), Donatisten und Catholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung (Studia Graeca et Latina gothoburgensia 18), Göteborg, Acta uniuersitatis Gothoburgensis.
thüMMel W. (1893), Zur Beurteilung des Donatismus: Eine kirchengeschichtliche Untersuchung, halle, M. Niemeyer.
tilley M.A. (1996), Donatist Martyr Stories. The Church in Conflict in Roman North Africa, Liverpool, Liverpool University Press.
tilley M.A. (1997), The Bible in Christian North Africa. The Donatist World, Minneapolis, Fortress Press.
toMBeur P. (dir.) (2002), Library of Latin Texts (CLCLT-5) (Centre traditio Litterarum Occidentalium), turnhout, Brepols.
vAn uytFAnghe M. (1985), « L’empreinte biblique sur la plus ancienne hagiographie occidentale », dans Fontaine, Pietri 1985, p. 565-610.
vogels h.J. (éd.) (1969), Ambrosiastri qui dicitur Commentarius in epistulas paulinas, III. In epistulas ad Galatas, ad efesios, ad Filippenses, ad Colosenses, ad thessalonicenses, ad timotheum, ad titum, ad Filemonem (CSeL 81, 3), Vienne, hoelder-Pichler-tempsky.
von BlAChA F. (1904), « Der pseudocyprianische traktat “De singularitate clericorum” ein Werk Novatians », Kirchengeschichtliche Abhandlungen herausgegeben von M. Sdralecks, II, Breslau, Aderholz, p. 193-256.
vössing K. (1997), Schule und Bildung im Nordafrika der römischen Kaiserzeit (Latomus 238), Bruxelles, Latomus.
zelzer M. (éd.) (1982), Sancti Ambrosi opera X, 3. epistularum liber decimus ; epistulae extra collec-tionem ; Gesta concili aquileiensis (CSeL 82, 3), Prague-Vienne-Leipzig, tempsky-Freitag.
zelzer M. (1995), « La tarda antichità », dans Cavallo, Leonardi, Menestò 1995, p. 301-338.zoCCA e. (2010), « tra antropologia e filologia : il caso della Passio dei martiri di Abitene
(BHL 7492) », dans Santiemma 2010, p. 389-427.zyChA J. (éd) (1895), Sancti Aureli Augustini Opera III, 3. Quaestionum in heptateuchum
libri VII. Adnotatium in Iob liber unus (CSeL 28, 2), Prague-Vienne-Leipzig, tempsky-Freitag.





















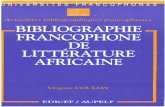

![Passio Christi. Passio hominis. Śladami Całunu Turyńskiego [Passio Christi. Passio hominis. Traces of the Shroud of Turin]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312dd3e5cba183dbf06d64f/passio-christi-passio-hominis-sladami-calunu-turynskiego-passio-christi-passio.jpg)














