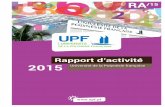2013 - GIRAF - Se définir par rapport à l'autre
-
Upload
univ-reims -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of 2013 - GIRAF - Se définir par rapport à l'autre
« Se définir par rapport à l’Autre. De la stratégie électoraliste à la confiscation des mandats par quelques familles sous la Troisième
République dans la Marne » Auteur : Alexandre Niess, agrégé, docteur en histoire contemporaine, membre du Comité d’Histoire Parlementaire et Politique (CHPP), chercheur associé au CERHIC (Reims), chercheur associé au POLEN-CEPOC (Orléans) Résumé
La démocratie représentative soumise au suffrage universel (du moins masculin pour la France
de la Troisième République) ouvre de fait la multiplicité des candidatures – et la multitude des possibles en termes de candidats – lors des élections locales ou nationales très nombreuses qui ont lieu au cours de ce long régime politique (70 ans).
Toutefois, il apparaît assez clairement, lors des campagnes électorales et à l’analyse des résultats électoraux que la démocratie représentative a, en effet, bien des difficultés à incarner la nation dans sa pluralité. Les discours développés dans les affiches électorales prouvent assez clairement que lors des élections locales, l’argument de l’altérité (et pas seulement celle de l’étiquette politique) est un levier essentiel d’affirmation de l’identité – de soi (du candidat), du corps électoral et par conséquent du corps politique et social.
Ensuite, ce rapport à l’autre – celui qui est différent par son origine géographique ou sociale plus que par son appartenance politique – conduit à la confiscation des sièges politiques locaux, départementaux et nationaux par quelques familles alliées qui constituent ainsi une élite politique locale très forte qui jouent lors de chaque élection sur les leviers de la culture politique dominante qu’elles incarnent dans le but de se maintenir au pouvoir. Tant et si bien que s’instaure, même en démocratie représentative, une forme d’hérédité en République.
Telles sont les principales pistes de réflexion abordées en s’appuyant sur l’analyse des discours et les méthodes d’analyse des réseaux sociaux.
Introduction
La démocratie représentative soumise au suffrage semi-universel masculin ouvre de fait la
multiplicité des candidatures et la multitude des possibles en termes de candidats, lors des élections locales ou nationales très nombreuses qui ont lieu au cours des soixante-dix ans de la Troisième République (1871-1940).
La campagne électorale est un moment paroxystique au cours duquel les différents candidats cherchent explicitement à se présenter et à se définir, pour ne pas écrire s’autodéfinir ; dès lors, les affiches électorales placardées pendant les campagnes des élections locales servent de support à cette définition vis-à-vis de l’autre. L’argument de l’altérité (et pas seulement celle de l’étiquette politique) est un levier essentiel d’affirmation de l’identité – de soi (du candidat), du corps électoral et par conséquent du corps politique et social.
Ce rapport à l’autre – celui qui est différent par son origine géographique ou sociale plus que par son appartenance politique – conduit à la confiscation des sièges politiques locaux, départementaux et nationaux par quelques familles alliées qui constituent ainsi une élite politique locale très forte qui jouent lors de chaque élection sur les leviers de la culture politique dominante qu’elles incarnent dans le but de se maintenir au pouvoir. Tant et si bien que s’instaure, même en démocratie représentative, une forme d’hérédité en République. Campagnes électorales et résultats électoraux prouvent que la démocratie représentative a, en effet, bien des difficultés à incarner la nation dans sa pluralité.
Telles sont les pistes de réflexion que nous aborderons successivement en analysant spécifiquement les élections des 493 conseillers d’arrondissement, conseillers généraux, députés et sénateurs de la Marne sous la Troisième République.
3
Figure 1. Le découpage administratif du département de la Marne
Pour aborder ces questions, nous nous appuierons en grande partie sur les principaux apports et résultats de recherche de notre thèse, publiée sous le titre L’Hérédité en République1.
1. L’altérité en campagne électorale : levier essentiel d’affirmation de l’identité du candidat
Lors des campagnes électorales cantonales et départementales de la Troisième République, les
candidats cherchent à développer les arguments nécessaires à leur élection. Ceux-ci sont souvent politiques mais ne le sont pas toujours. Assez fréquemment, les affiches électorales mettent en scène d’autres argumentaires qui permettent aux candidats de se définir par rapport aux autres. Le thème de l’altérité se décline alors dans plusieurs registres : l’appartenance géographique à la circonscription d’élection ; la grande proximité sociale entre le candidat et le corps électoral ; l’inscription du candidat dans les rouages administratifs, économiques, associatifs locaux.
a) L’endogénisme,2 thème de campagne et argument électoral récurrent
Les élus étudiés sont essentiellement issus du département d’élection, et naissent souvent dans leur circonscription électorale parce que les hommes nés et vivants dans les villes et villages du canton s’intéressent à la bonne gestion de celui-ci. Le candidat souhaite de manière naturelle représenter un canton qu’il connaît et aime. Au-delà de ces considérations sentimentales, le critère de l’appartenance à la circonscription est un atout électoral de poids puisqu’il constitue un thème de campagne récurrent. Quel intérêt auraient les candidats à l’aborder si ce thème n’était pas important aux yeux des électeurs ?
Les candidats aux élections locales ou nationales insistent dans leur programme politique sur leurs origines locales, à l’image d’Étienne Peignot qui fait placarder lors des élections législatives de 1899 : « Originaire de l’arrondissement d’Épernay, j’appartiens à une famille de souche Champenoise très ancienne qui a toujours habité et habite encore pendant toute l’année l’arrondissement. »3 Cet extrait signifie en contrepoint que les candidats non originaires de l’arrondissement n’ont aucune légitimité à se présenter et donc à être élus. Lors de cette élection, les deux candidats (Étienne Peignot et Paul Coutant) qualifiés pour le second tour du 5 février sont effectivement originaires de l’arrondissement.
Très généralement, et en dehors du cas particulier de l’élection de Jules Simon en 1871, les candidatures fantaisistes ou les tentatives de parachutage constituent des échecs par manque
4
d’implantation locale. En 1889, la candidature du général Boulanger dans la circonscription rémoise est mal reçue et perçue par le comité de l’Alliance républicaine qui fait placarder une affiche explicite : « À bas Boulanger ! À bas la Candidature étrangère ! Votons pour un candidat rémois ! Votons pour L. Mennesson ! Vive la République. »4
C’est pour cette raison que les candidats non natifs du canton estiment cette situation comme un handicap. Ils tentent d’y remédier avant que leur adversaire n’ait le temps de les accuser d’être étranger au canton. L’utilisation de subterfuges linguistiques n’est pas rare. Voici comment Édouard Jacob5 se présente aux électeurs du canton de Sézanne : « attaché à votre pays par ma famille et par mon affection personnelle depuis de longues années, je vous demande de me considérer comme un de ses enfants. »6 Cet argument, développé dans une affiche électorale de 1919, n’est pas tout à fait faux. Son père s’est installé à Mondement vraisemblablement dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle et a été élu maire dès 1878. Édouard a repris ce fauteuil en 1899. Sa sœur, a épousé Hippolyte de Peyronnet descendant d’une grande famille sézannaise, en 1903. Édouard Jacob développe cet argumentaire car les candidats étrangers au canton sont souvent très mal perçus, surtout lorsqu’ils ne sont pas préalablement et durablement installés dans le tissu politique, économique et/ou social du canton. Ainsi, Édouard Jacob est assez révélateur, lui qui hésite encore en 1919 à se qualifier comme un homme du crû alors qu’il dirige une commune, certes modeste, du canton depuis vingt ans. Malgré les années passées en ce lieu, le candidat Jacob n’ose se présenter sans rappeler qu’il est un étranger de souche, mais pas de cœur.
Être étranger au canton est un handicap généralement souligné et parfois, la campagne électorale menée contre l’étranger est véhémente ; comme le prouve celle faite par le baron d’Aubilly à l’encontre d’Auguste Luling, en 1910. Dans cette campagne électorale, le ton utilisé par le baron d’Aubilly est à la fois xénophobe et méprisant. Les arguments de Georges d’Aubilly visent durement son adversaire politique, mais finissent par se retourner contre lui tant les électeurs ont pu à leur tour se sentir méprisés, à défaut de se sentir maîtrisés par le candidat noble qui considère le canton comme son fief politique et les électeurs comme ses créatures politiques. Le candidat d’Aubilly fait ainsi placarder : « n’importe quelle candidature venant rompre dans le canton de Ville-en-Tardenois la vieille union familiale de l’élu et de ses électeurs, eut été une tristesse pour nos populations ; mais celle qu’on voudrait nous imposer blesse vraiment nos sentiments les plus intimes. (…) Nous ne lui contestons nullement le droit de vivre agréablement chez nous, mais qu’il ne prétende pas représenter notre population ! » 7 Dans cette affiche électorale, d’Aubilly présente le portrait du candidat idéal : un homme implanté dans le canton, natif du canton si possible, ayant une fortune personnelle et une ambition individuelle et politique évidente. Il montre alors aux électeurs pourquoi son adversaire Luling ne correspond pas au profil-type. Le plus choquant à ses yeux est l’outrecuidance du docteur Luling, lui qui est un étranger : « ce n’est pas une question de forme ; nous savons que M. Luling est très régulièrement naturalisé français ; nous savons qu’il est riche et ambitieux, et fait pour le moment de la politique radicale-socialiste. (…) M. Luling a eu depuis sa naissance quatre nationalités, trois depuis sa majorité ; c’est trop pour parler au nom des Champenois, qui sont assez indépendants pour lui préférer l’un d’entre eux. »8 L’argumentaire se fait extrêmement virulent voire belliqueux quand Georges Leleu d’Aubilly demande aux électeurs du canton de « [marcher] au scrutin pour défendre l’indépendance de notre Canton en criant : La France aux Français de race ! La Champagne à ses Enfants ! »9 Est-ce le ton guerrier, xénophobe et condescendant de cet argumentaire qui conduit en 1910 à la défaite du baron d’Aubilly alors qu’il détient le fauteuil de conseiller général depuis quarante-six ans ? Cette campagne électorale se déroule dans un climat délétère et cette affiche a sans doute fait du tort à un homme de soixante-et-onze ans dans lequel les électeurs ne semblent plus se reconnaître.
Par ailleurs, le qualificatif “étranger” utilisé dans certaines affiches revêt toujours un caractère négatif et souvent calomnieux. Certaines campagnes électorales se construisent presque exclusivement autour du thème de l’implantation locale préalable des candidats. Telle celle menée, en 1898, par Édouard Fleuricourt, maire d’Épernay depuis 1889 et conseiller général depuis 1896. Face à lui, se présente Adhémar Péchadre. Pourtant, non originaire d’Épernay, ni du canton, ni même du département,10 Édouard Fleuricourt fait glisser la bataille politique sur ce terrain de l’implantation puisque son adversaire corrézien11 vient tenter sa chance politique dans le canton. Pour Fleuricourt, la campagne commence ainsi : « Électeurs, en présence de l’envahissement, dans notre Ville, par d’audacieux étrangers, sans scrupules, chassés d’ailleurs, qui viennent semer la haine, ayant recours à d’infâmes grossièretés et d’impudents mensonges avec l’espoir de bouleverser la société, le devoir de
5
tous les honnêtes gens de tous les partis, quelle qu’en soit la nuance, est de repousser ce terrible et dangereux état de choses, en votant pour le candidat de l’Union et de l’Ordre. »12 Le décor est planté. Édouard Fleuricourt et ses partisans décident de mener le combat sur le thème de l’appartenance véritable au canton et ne reculeront devant aucun argument, aucune image pour parvenir à leurs fins. De son côté, le docteur Péchadre insiste dans ses affiches sur la lutte menée contre la réaction, représentée par l’avocat Fleuricourt, chef d’une majorité municipale qu’il combat avec le soutien des ouvriers, des républicains et des anticléricaux, mais vient rarement sur le terrain espéré par ses adversaires. Dans une seule affiche, les partisans de Péchadre répondent en disant que « ses ennemis politiques lui reprochent son éloignement. C’est là une piètre manœuvre, car ils savent bien que beaucoup de Conseillers Généraux n’habitent pas leur canton. Le Docteur Péchadre, du reste, est conseiller municipal d’Épernay ; il y paie des impôts et il y a sa famille ; c’est vous dire que ce n’est pas un étranger. Il vient à Épernay souvent plusieurs fois par semaine et se trouve bien placé pour remplir facilement et avec une entière indépendance le mandat que vous lui confierez. »13 Édouard Fleuricourt et ses soutiens politiques enfoncent le clou et estiment que « le vaniteux Péchadre, étranger à notre canton, et à notre département, essaye par tous les mensonges indignes d’un représentant d’obtenir vos voix pour se faire nommer Conseiller Général. »14 Et alors, qu’ils font les comparatifs des deux candidats en présence, les soutiens d’Édouard Fleuricourt n’y vont pas par quatre chemins, estimant que « l’un, ancien docteur sans clientèle, M. Péchadre, sans expérience, étranger à notre Canton, cherchant un titre pour vivre plus facilement à ne rien faire, nous fait les plus irréalisables promesses, et ne recule devant aucun mensonge pour nous duper – c’est facile à voir. L’autre, M. Fleuricourt, habitant Épernay depuis très longtemps, connu de tous, ayant une grande influence et de l’expérience en toutes choses par ses longs rapports dans le canton et dans les administrations, excellent et honnête homme, très obligeant ne demandant qu’à rendre service à tous dans la mesure du possible, incapable de mauvais moyens, de basse réclame et de mensonge, nous offre le plus de garanties. »15 Styles hagiographique pour l’un et véritablement calomnieux pour l’autre sont au cœur de la campagne électorale. Si l’adversaire n’est effectivement pas originaire du canton, Fleuricourt montre qu’il mérite d’être considéré comme un enfant du pays puisque ses qualités morales individuelles sont bien supérieures à celles de son adversaire, prêt à toutes les bassesses. Celles-ci sont explicitées dans une autre affiche qui, bien qu’elle contredise en partie l’affiche précédente,16 insiste sur l’image du canton qui viendrait à élire un étranger, incapable et assoiffé de pouvoir. Les électeurs doivent absolument percevoir le candidat de cette façon pour voter en faveur d’Édouard Fleuricourt. « Électeurs, vous répondrez, nous en sommes convaincus, en donnant un congé en règle à ces insolents, à ces menteurs, à ces étrangers qui courent Ville et Campagnes, pour obtenir des mandats et s’en servir de moyens d’existence. Vous ne laisserez pas infliger cette honte à Épernay, celle de croire qu’il faudrait confier la représentation du Canton à des agitateurs, à des incapables, à des étrangers du Canton n’y ayant aucun intérêt, capables des pires aventures. »17 En dehors de ces affiches virulentes, le candidat Fleuricourt essaie de montrer le bien-fondé de sa démarche qui consiste à dénigrer son adversaire parce qu’il n’est pas implanté dans le canton. « Vous avez à élire un Conseiller général. Deux Candidats sollicitent vos suffrages : M. Péchadre, autrefois Docteur à Épernay, et M. Fleuricourt, Maire d’Épernay. En examinant sagement et sans passion le mérite des deux Candidats, il est facile de savoir auquel doivent aller les suffrages de tous les électeurs, vrais républicains désirant l’ordre, le travail, le calme et les affaires. M. Péchadre n’a été que de passage à Épernay. Il n’y possède rien, ni dans le canton ni dans le département, c’est un étranger. Il paraît qu’il habite Paris, qu’il voyage, bientôt il sera à Toulouse, qui sait où on le trouvera ? On peut dire, sans être injuste, que c’est un voyageur. »18 Moteur de la campagne de l’un des candidats, le second refuse en grande partie ce jeu du thème de l’implantation locale. Malgré la violence des propos tenus dans les réunions publiques et dans les affiches, la grande « veste »19 promise au docteur Péchadre n’est pas puisqu’il sort vainqueur de cette lutte électorale. Il est probable que Fleuricourt ait perdu cette élection en focalisant son attention sur ce seul argument de la non-appartenance au canton et en dénigrant systématiquement son adversaire. Peut-être a-t-il accepté de mener la campagne électorale sur ce ton et ce terrain parce qu’il se savait en difficulté face à cet adversaire.
De manière générale, le thème est important aux yeux des électeurs, mais n’est pas le seul critère pour l’élection d’un conseiller général comme le prouve le dernier exemple. L’endogamie locale est forte et peu d’individus n’ont véritablement aucun lien avec le département, si ce n’est la circonscription ou le canton, avant leur élection. L’assise locale est un critère explicatif important du choix des électeurs
6
dans le cadre des élections cantonales, législatives et sénatoriales comme le prouvent les très nombreuses occurrences de ce thème dans les campagnes électorales. Néanmoins, l’implantation géographique, personnelle et/ou familiale, ne peut expliquer à elle seule l’élection ; elle n’est pas non plus le seul thème à faire appel à la notion d’altérité qui permet au candidat de se construire une identité politique ou non à présenter aux électeurs.
b) Correspondre au socio-type de l’électeur
Pour être élu, les candidats doivent être facilement assimilés à leurs électeurs ; ou tout au moins, les électeurs doivent pouvoir facilement s’identifier à leurs candidats ; aussi ceux-ci lors des campagnes électorales insistent sur leurs origines locales et sociales, à l’image d’Émile Bouilly qui fait placarder : « mes chers concitoyens, (…) notre canton est essentiellement agricole. Il semble donc naturel que vous choisissiez, parmi les agriculteurs de notre région, celui qui doit vous représenter à l’assemblée départementale. Si j’ai quelque titre à solliciter vos suffrages, c’est parce que je suis un des vôtres, né dans le canton, vivant au milieu de vous, partageant vos travaux, connaissant vos besoins et vos intérêts, dont vous cherchez un défenseur autorisé. Je ne crois pas utile de vous faire des promesses. »20 Selon cet extrait d’affiche électorale datant de 1922, cette correspondance entre l’activité et la position sociale du candidat prime même sur tout autre critère – même politique – puisque le candidat ne prend pas la peine de développer un véritable programme politique.
Cette correspondance sociale entre l’électorat et le candidat se retrouve dans de nombreuses campagnes électorales, comme celle effectuée par Paul Perroche lors des élections législatives de 1902, au cours de laquelle il fait placarder une affiche explicite : « Je ne suis pas un nouveau venu parmi vous. Depuis plus de vingt ans, j’appartiens à votre arrondissement ; depuis douze ans je suis Maire de la commune d’Outines ; et, depuis dix ans, je fais partie du Conseil général comme représentant du canton de Saint-Rémy-en-Bouzemont. Mon séjour prolongé à la campagne, mes relations permanentes avec les cultivateurs m’ont initié depuis longtemps à leurs besoins. La surveillance de mon exploitation m’a permis d’acquérir l’expérience des choses agricoles. (…) Paul Perroche, Docteur en Droit, Maire d’Outines, Conseiller général de la Marne. » 21 Fort de son ancrage dans la vie politique cantonale, de sa formation lui permettant d’intervenir efficacement dans les débats d’une assemblée parfois technocratique où s’utilise abondamment le vocabulaire spécifique du droit, de sa fine connaissance de la vie de ses concitoyens de l’arrondissement de Vitry-le-François dans lequel le vote rural des propriétaires, cultivateurs, éleveurs et vignerons pèse lourd dans la balance électorale, Paul Perroche présente une candidature, qu’il juge légitime, pour accéder au palais Bourbon. Dans cet extrait d’affiche électorale, les thèmes abordés sont loin d’être anodins ; l’attachement réel à la circonscription d’élection est un sujet majeur mais aussi et surtout la connaissance et les compétences à traiter les thèmes primordiaux qui peuvent intéresser au premier chef les électeurs de la circonscription.
Parfois, cette course à l’identification du candidat avec son électorat au point de vue du critère social finit par friser le ridicule, tant les arguments apparaissent pour le moins fallacieux. Il en est ainsi dans le cadre de la campagne électorale entre Louis Joppé et Julien Barbier Lalobe de Felcourt. Lors de celle-ci, nul besoin pour Julien de Felcourt22 de rappeler son ascendance illustre, les électeurs du canton la connaissent largement et ses adversaires politiques se chargent à toute occasion de la lui rappeler. Ainsi, nul mot sur son origine dans ses affiches électorales dans lesquelles il se déclare comme « enfant du pays, qu’ [il n’a] jamais quitté »23, comme un « candidat agricole »24 lui qui est « maire de Maisons, Président du comice agricole de Vitry-le-François, et de la Société Hippique de la Marne, etc. »25 et c’est sur son programme qu’il s’étend tandis que son adversaire pour le scrutin de ballottage, Louis Joppé, fait placarder une affiche entre les deux tours de scrutin dans laquelle il fait écrire :
« Électeurs ! Nous venons de faire un choix excellent pour le Conseil d’Arrondissement en y envoyant M. Prévost, un des nôtres, un travailleur.26 Il nous reste à nommer notre conseiller général. Deux candidats sont en présence, M. de Felcourt et M. Joppé. Le premier n’a eu que la peine de naître et a trouvé la fortune dans son berceau ; il n’a jamais été soldat et s’il est décoré c’est qu’il a plu au Saint-Père de lui envoyer une croix ; Jamais il n’a rien fait et il cache soigneusement son drapeau. M. Joppé est le fils de ses œuvres ; depuis de longues années il habite notre canton où chacun le connaît et l’apprécie ; on ne pouvait nous représenter plus dignement au Conseil d’arrondissement où il a bien défendu nos intérêts. Électeurs ! Notre choix ne saurait être douteux. Laissons à M. de Felcourt tout son temps pour aller déposer ses adulations aux pieds de Marie-Thérèse. Et votons tous pour notre ancien conseiller d’arrondissement, UN TRAVAILLEUR,27 l’honorable M. Joppé.
Un groupe d’électeurs. »28
7
Louis Joppé, ancien conseiller d’arrondissement du canton de Sompuis, ne s’est pas présenté à sa propre succession et cherche à devenir conseiller général. Les détracteurs de Julien Barbier Lalobe de Felcourt développent trois niveaux de reproches : l’appartenance familiale et les possessions de celle-ci dans l’arrondissement de Vitry-le-François,29 les convictions religieuses30 et les opinions politiques du candidat. Pour Louis Joppé, les soutiens insistent sur des aspects subjectifs ; lui qui est très apprécié depuis son installation dans le canton.31 À des arguments politiques s’opposent donc, en premier lieu, ceux liés à l’affect. Ensuite, les soutiens de Louis Joppé développent un argumentaire autour du terme « travailleur », employé pour qualifier Léandre Prévost et Louis Joppé ; la première fois en l’imprimant en gras, la seconde fois en lettres capitales. Certes, Julien Barbier de Felcourt jouit de ses rentes et est un très grand propriétaire terrien ; néanmoins, Louis Joppé est un ancien notaire,32 également propriétaire terrien et il ne cultive pas lui-même, faisant appel à des fermiers, des journaliers et des manouvriers. Il mène grand train et a à son service de la domesticité qu’il loge et entretient.33 Il est évident que l’acception même du mot travailleur peut poser question. Les auteurs de l’affiche considèrent-ils que le travailleur est l’« homme adonné au travail »34, ou la « personne qui exerce une activité manuelle ou intellectuelle utile, qu’elle soit ou non rétribuée »35, ou la « personne qui exerce un métier, une profession »36 ou enfin « un ouvrier, un homme de travail, par opposition au capitaliste. »37 Si l’acception considérée est la première ou la seconde, il est difficile d’opposer véritablement Louis Joppé et Julien Barbier Lalobe de Felcourt qui exercent dans leur vie quotidienne peu ou prou les mêmes activités, ces dernières ne relevant pas seulement de l’activité professionnelle. Ils ont reçu la même formation de juriste38 et ne pratiquent pas au moment de l’élection une activité professionnelle en relation avec cette dernière. Au registre des activités utiles, peuvent être évoquées les nombreuses présidences et vice-présidences dont Julien de Felcourt a la charge. Si les électeurs de Louis Joppé estiment que le mot travailleur revêt le sens décliné dans la troisième définition, alors quelle différence faire entre un grand propriétaire terrien et un autre grand propriétaire terrien, sachant pertinemment qu’aucun des deux ne se salit véritablement les mains ? Reste la dernière définition, avec laquelle la figure de Louis Joppé n’apparaît pas non plus en conformité. En effet, il est peu probable que ses soutiens considèrent cette définition comme celle étant la plus proche de la réalité politique représentée par Louis Joppé, candidat soutenu par les six députés de la Marne39 : Eugène Blandin,40 Hippolyte Faure,41 Paul Guyot,42 Camille Margaine,43 Félix Mennesson-Champagne,44 Félix Thomas-Derevoge.45 Ils siègent sur les bancs de la gauche républicaine et ne pourraient cautionner un discours aussi clairement anticapitaliste, à connotation communiste, marxiste voire blanquiste. Par ailleurs, en faisant imprimer qu’il « est le fils de ses œuvres »,46 Louis Joppé aurait-il oublié de préciser aux électeurs qu’il s’inscrivait lui aussi dans une notabilité politique locale de longue date, visible dans son canton d’origine ?47 En tout état de cause, les soutiens de Louis Joppé tentent de tromper et de duper les électeurs du canton de Sompuis, en leur faisant croire que leur candidat correspond davantage – et plus que l’autre candidat – à leur socio-type. Cette tentative de duperie ne semble pas avoir eu d’effets sur les électeurs puisque malgré les attaques, l’implantation de son concurrent direct et les idées défendues par celui-ci, Julien de Felcourt est élu ; peut-être grâce à l’aura familiale qui l’entoure et probablement grâce au poids de son nom dans l’univers mental et politique des électeurs de ce canton.
Malgré tous les artifices utilisés par les candidats lors des campagnes électorales, il s’avère qu’ils
appartiennent en fait aux élites, à la bourgeoisie – que ce soit par le fait de leur profession, de leur fortune personnelle, de la domesticité, de leur sociabilité, etc. En ce sens, Julien de Felcourt constitue le candidat type par excellence : il a une vraie assise locale, il possède des ascendants directs en politique depuis plusieurs décennies, il porte un titre de noblesse, il est un grand propriétaire terrien, il participe à ce « mode de vie bourgeois (...) [identique à celui] des décennies précédentes »48 caractérisé par cet « usage du temps libre [qui] établit des hiérarchies (…) entre ceux qui prétendront aimer la marche à pied parce qu’ils n’ont pas les moyens d’élever des chevaux et ceux qui vont courir à cheval parce que les autres, trop nombreux, marchent à pied, avec philosophie, ou montent à bicyclette… »49 ; tant et si bien qu’il est très bien intégré aux rouages économiques, associatifs locaux, comme le souligne l’extrait de l’affiche utilisé précédemment, quand il la soussigne : « Président du comice agricole de Vitry-le-François, et de la Société Hippique de la Marne, etc. »50
c) Plus que l’autre, intégré aux rouages économiques, associatifs, administratifs et politiques locaux
8
Au cours de la campagne électorale, les candidats cherchent à montrer qu’ils sont mieux et plus intégrés que leurs adversaires dans le tissu économique local, dans les rouages administratifs et associatifs locaux, mais également qu’ils possèdent de solides amitiés dans la circonscription – surtout avant la mise en place d’un système partidaire qui vient changer la donne électorale à compter de la première décennie du vingtième siècle.
Entre 1871 et 1905, les réseaux de soutien mis en œuvre lors des campagnes électorales sont
clairement assimilés à des réseaux d’amitié. Cette dernière est-elle réelle ou feinte, de façade et finalement construite pour les seules contingences électorales ? Est sûre l’importance revêtue par le réseau, qu’il soit qualifié de soutien ou d’amitié. Quand le soutien est considéré comme amical par l’un des deux membres de la relation, en changer correspond clairement à une trahison. C’est en tout cas ainsi, qu’Alfred Autier juge, lors des élections cantonales du 31 juillet 1904, l’attitude de Nicolas Lavison lors de celles de 1898 :
« Électeurs, Jugez si vous devez croire des hommes dont les convictions sont si légères, les amitiés si inconstantes
et qui ont pour guide, non pas les intérêts de la ville de Sainte-Menehould et du canton, mais leur intérêt personnel et une ambition exagérée. »51
Selon la symbolique traditionnelle du monde politique, Nicolas Lavison a retourné sa veste. Les reproches formulés à l’égard du candidat Lavison-Gouilly reviennent fréquemment dans les affiches électorales.
Parfois l’affichage de ces réseaux d’amitié constitue de véritables litanies qui viennent ponctuer la profession de foi placardée, visant ainsi à montrer aux électeurs que le candidat proposé par ce réseau d’amitié est mieux inscrit dans la circonscription que ses adversaires. Ainsi, en juin 1891, Henri Henrot, maire de Reims et candidat aux élections cantonales, fait afficher la liste impressionnante de ses soutiens52. Ces derniers sont au nombre de cent-vingt-neuf ! Certes au regard de la population du troisième canton de Reims,53 ce nombre n’est pas si important (à peine plus de 0,6 % de la population cantonale), mais un tiers de l’espace disponible sur l’affiche sert à indiquer les soutiens du candidat. Cependant, autant que le nombre des soutiens, la qualité de ceux-ci s’avère primordiale. Ainsi, le bureau du comité de soutien d’Henri Henrot compte trois conseillers municipaux de Reims, un professeur, un représentant de commerce, un teinturier, un journaliste, un propriétaire et un photographe, tandis que la composition socioprofessionnelle du comité complet laisse une place importante aux artisans et commerçants de proximité, tels les boulangers ou les épiciers. Ces catégories socioprofessionnelles correspondent à 40,74 % des membres. Les employés constituent 34,57 % des signataires. En dehors du maire-candidat, un seul individu exerce une profession libérale : le pharmacien Lartilleux. Dans une autre affiche, le docteur Henrot adopte la même stratégie, en affichant la liste des vingt-huit conseillers municipaux qui soutiennent sa candidature.54 Malgré tout, la stratégie d’Henri Henrot ne s’avère pas payante puisque son adversaire, le docteur Edmond Wiet, fils de l’ancien conseiller général remporte ces élections.
Le recours à ces groupes de soutien est très fréquent avant la création et le développement des structures partidaires. Celles-ci remplacent des affinités individuelles et personnelles par des affinités codifiées et institutionnalisées par le biais du parti politique, surtout entre 1910 et 1940. En période préélectorale, ce temps des partis est marqué par la disparition progressive des campagnes traditionnelles, faites d’homme à homme par le biais d’affiches électorales contextualisées, au profit de slogans généraux et de thèmes nationaux, où les oppositions se font de groupe à groupe. Il en est ainsi lors des élections législatives de 1932, au cours de laquelle plusieurs affiches nationales viennent fleurir les murs et panneaux électoraux. Ce changement d’échelle, où les questions locales sont progressivement supplantées par les thèmes nationaux, est surtout le reflet des tactiques socialistes et communistes.
Au-delà de cette inscription dans des réseaux d’amitiés et politiques, les candidats aux élections locales insistent fréquemment dans leurs affiches électorales sur leurs implications dans le tissu économique local. Cela passe par la mention des professions mais surtout par l’affichage de l’appartenance à des structures importantes dans la circonscription comme les comices et les associations agricoles (dans les circonscriptions rurales) et/ou les chambres et tribunaux de commerce (dans les circonscriptions urbaines). Ces aspects sont renforcés si la participation à ces rouages institutionnels est récompensée par les autorités par l’intermédiaire de décorations officielles. Dans le canton de Vitry-le-François, en 1892, Louis-Gustave Maurice, candidat élu au conseil général insiste sur
9
le fait qu’il est « Chevalier du Mérite agricole » et « Président de la Ligue agricole de la Marne. »55 Dans la même affiche, Gabriel Magloire Arbeaumont, candidat malheureux au conseil d’arrondissement, signale lui aussi qu’il est « Chevalier du Mérite agricole. »56 Il faut reconnaître que les trois candidats exercent effectivement des professions en rapport avec le monde agricole. Louis-Gustave Maurice est propriétaire terrien, Adolphe Poulet également, tandis que Gabriel Arbeaumont est horticulteur-pépiniériste à Vitry-le-François.
Ensuite, et de manière naturelle, ces affiches électorales montrent que l’élu est au service de ses concitoyens. Il inscrit donc noir sur blanc sa participation à la justice de paix, à la délégation cantonale, aux caisses d’épargne et de prévoyance, aux caisses du crédit agricole, à la société de secours mutuels, etc. Ainsi en 1892, Jules Bourgeois, conseiller général sortant, signe son affiche électorale de cette manière : « Jules Bourgeois, Conseiller général sortant, Avocat, Docteur en droit, Président de la Société de Secours Mutuels de Suippes. »57 La même année, Ernest Auguste Contant, quincaillier et épicier à Sermaize-les-Bains, époux de Louise Joséphine Wibert, candidat aux élections cantonales dans le canton de Thiéblemont fait placarder avec son colistier Léon Leroy une affiche électorale dans laquelle il se présente comme : « E. Contant-Wibert, Conseiller Municipal de Sermaize, Délégué cantonal. »58 Dans une autre affiche, le même candidat rajoute : « Président de la Société de Secours Mutuels de Sermaize. »59
Enfin, il existe des lieux de sociabilité importants qui ne sont pas forcément mentionnés dans les affiches électorales mais qui permettent aux candidats de se construire de véritable réseaux et parfois même une véritable visibilité dans la circonscription. Ces lieux sont divers et variés, mais les plus importants sont la loge maçonnique, les sociétés savantes locales, les sociétés de loisirs (patriotiques, gymnastiques et de tir, société hippique, société de chasse, etc.) et la participation des élus et de leurs épouses aux œuvres de charité et de bienfaisance. Les annuaires départementaux permettent de regarder de près les conseils d’administration des sociétés maternelles et protectrices de l’enfance qui constituent un lieu de sociabilité des familles bourgeoises. Ces sociétés sont dirigées par un bureau du conseil d’administration (généralement masculin), des dames administrantes (membres du conseil d’administration) et des dames agrégées (membres de la société). La participation des femmes dans ces sociétés est cependant souvent ou pratiquement considérée comme indirecte. Leur nom de jeune fille est rarement mentionné, quant à leur prénom il n’apparaît jamais. Zoé Legrand est dame agrégée de la Société de charité maternelle de Reims (dès 1860) et dame administrante (de 1871 à 1912) ; pourtant, dans les annuaires départementaux nulle trace de Zoé Legrand. Par contre, nous trouvons mention de madame S. Dauphinot. Ainsi, avec la publication des annuaires départementaux, l’activité charitable et de bienfaisance des femmes est immédiatement créditée en faveur de l’époux. À l’heure des choix électoraux, la présence dans l’annuaire départemental influence-t-il l’électeur ? Celle-ci serait-elle moindre pour le candidat si la mention était madame Zoé Legrand, épouse Dauphinot, plutôt que madame S. Dauphinot ? Autant de question auxquelles nous ne pouvons apporter de réponses définitives, par manque de sources sur l’opinion des électeurs ; mais il semble évident que la bienfaisance féminine participe de la construction de l’aura personnelle de l’époux et peut ainsi être considérée comme un facteur de l’élection ou de la réélection. Tout au moins, cette sociabilité de la bienfaisance confirme la place des membres du corpus et de leurs épouses au sein de la bourgeoisie de la cité. Ce crédit accordé au mari au détriment de son épouse pourrait amener à des confusions. Ainsi, pour la Société protectrice de l’enfance, où madame Bienfait est conseillère. Or entre 1882 et 1901, madame Bienfait n’est plus la même. Aimée Tassin, première épouse du docteur Bienfait, est décédée le 13 mars 1883. En 1901, la conseillère de la Société protectrice de l’enfance est la seconde épouse et veuve de Jules Bienfait : Cécile Ragot. Cet exemple montre bien que bienfaisance et charité sont, dans de nombreux cas, affaires de couple. La participation à telle ou telle structure de bienfaisance est un choix, une stratégie familiale afin d’intégrer des réseaux de sociabilité bourgeois et urbains, ou de confirmer son intégration. En 1901, Fanny Valser, sœur du pharmacien et professeur à l’École de médecine de Reims, est également une des dames patronnesses de la Société protectrice de l’enfance. Elle permet à son époux, Augustin Maillet, imprimeur à Reims originaire de Sommesous, de confirmer son intégration aux réseaux de sociabilité bourgeois de la cité des sacres.
10
d) Question d’identité face à l’altérité : sabot de bois, cuiller en argent et ors de la République
Au cours de ces soixante-dix ans de République, les élus revêtent finalement des caractéristiques communes qui favorisent leur accès aux sièges électifs. Dans la plupart des cas, l’électeur doit pouvoir se reconnaître dans son élu ; c’est pourquoi, celui-ci doit se constituer un costume à la taille de la circonscription et à l’image de ses électeurs. Dans ce costume qui doit être parfaitement ajusté, le candidat doit justifier d’une implantation locale préalable et bien venue ; elle passe tout particulièrement par la naissance dans la circonscription. Être ancré dans la terre d’élection est un argument de campagne primordial. Celui-ci est d’autant plus important et mis en avant quand le candidat peut justifier d’une attache locale ancienne. Le recours aux parents et aux aïeux n’est pas rare dans les campagnes électorales pour justifier la candidature et ainsi la légitimer. Dans les circonscriptions rurales, les candidats doivent démontrer leur attachement et leur appartenance à la terre ; même si ces racines paysannes et/ou cette dilection de la ruralité sont feintes ou surjouées. Que connaît véritablement Paul Perroche du travail de la terre quand il se présente aux électeurs du canton de Saint-Rémy-en-Bouzemont ? Si « [s]on séjour prolongé à la campagne, [s]es relations permanentes avec les cultivateurs [l]’ont initié depuis longtemps à leurs besoins. [Si] la surveillance de [s]on exploitation [lui] a permis d’acquérir l’expérience des choses agricoles. »60 Est-ce vraiment suffisant pour faire de cet avocat un élu dans lequel se reconnaissent les électeurs du canton ? Peu importe puisque ces quelques phrases soulignent l’importance que revêt ce thème aux yeux des candidats – et donc des électeurs. Dans ces espaces ruraux, le candidat doit alléguer de son appartenance au monde rural. Le temps d’une campagne électorale, le candidat doit donc symboliquement chausser les sabots de bois qui lui permettent de le rapprocher de ses électeurs ; quitte à reprendre à son compte ceux portés par ses aïeux, et tout particulièrement ceux de ses parents. Les parents permettent, en effet, de renforcer cet enracinement local quand ils sont eux-mêmes originaires de la circonscription.
Pourtant, si le candidat s’efforce de ressembler à ses électeurs, même ruraux, il n’en demeure pas moins vrai qu’il appartient bien souvent à une véritable bourgeoisie – même locale ou rurale. L’assise sociale établie par l’élu ou ses ascendants directs permet au candidat de se sentir à l’aise une fois qu’il prend place dans l’assemblée de notables dans laquelle il vient d’être envoyé par ses électeurs. Les candidats élus s’intègrent dans des familles bourgeoises anciennes ou des familles pleinement inscrites dans un processus d’embourgeoisement au cours du XIXe siècle. Plus que la profession, les indices de cet embourgeoisement ou de cette appartenance à la bourgeoisie sont les fortunes laissées au décès et la présence de domesticité au service de ces hommes. Les fortunes moyennes des élus et des membres de leur famille sont, dans la Marne, nettement supérieure à la moyenne départementale ; celle-ci étant supérieure à la moyenne nationale. Selon les divers critères de définition de la bourgeoisie définis par Adeline Daumard, Maurice Agulhon ou Christophe Charle, les élus de la Marne sous la Troisième République font, dans leur grande majorité, partie pleinement intégrante de ce groupe social. Faisant partie intégrante de la bourgeoisie, ces hommes développent des pratiques conformes à cette appartenance sociale. Les élus de la Troisième République affichent des sociabilités mondaines évidentes, reprenant à leur compte des pratiques bourgeoises anciennes ou participant à l’émergence de sociabilités bourgeoises nouvelles qui permettent de définir ce groupe social et qui favorisent la reconnaissance sociale de ces participants. Ainsi, pour maintenir leur prééminence sur le corps social local, ces hommes participent aux rouages économiques locaux par le biais des comices agricoles, des chambres et des tribunaux de commerce, développent des pratiques bourgeoises du loisir ; intègrent les sociétés savantes, les loges maçonniques, les sociétés patriotiques… ; siègent dans les justices de paix, dans la délégation cantonale, dans les caisses d’épargne et de prévoyance, dans les sociétés de secours mutuels ou font œuvre de charité et de bienfaisance. Il est donc possible d’affirmer, selon l’expression populaire consacrée, que ces hommes naissent généralement avec une cuiller en argent dans la bouche.
Ces deux éléments – les sabots de bois et la cuiller en argent – permettent aux candidats d’intégrer les ors de la République ; par le biais des chambres représentatives, qu’elles soient locales ou nationales, parfois même en prenant en charge des fonctions importantes au sein des ministères. Le “capital confiance” acquis auprès des électeurs est d’autant plus grand que cette implantation locale, que cette assise sociale et que le mode de vie associé à ce rang social sont en grande partie hérités ; il ne faut, en effet, pas oublier que l’élu est finalement le fruit de l’union de trois familles : celle de son père, celle
11
de sa mère et celle de son épouse. La mise en réseau de ces familles peut conduire à la confiscation de la démocratie représentative locale et départementale sur l’ensemble de la période. 2. Vers une confiscation de la démocratie représentative
L’altérité est un thème de campagne électoral relativement fondamental ; dès lors les candidats soutiennent consciemment – par leur rapport à l’autre (celui qui est différent par son origine géographique ou sociale plus que par son appartenance politique) et par le biais des influences exercées par quelques familles alliées qui constituent ainsi une élite politique locale très forte – et s’inscrivent volontairement dans les leviers de la culture politique dominante. Celle-ci est construite de manière à écarter du pouvoir politique, même local, tous les candidats qui n’appartiendraient pas au microcosme politico-social dominant. Ainsi, ces familles alliées incarnent véritablement cette culture politique dominante et la perpétuent dans le but de se maintenir au pouvoir. Tant et si bien que s’instaure, même en démocratie représentative, une forme d’hérédité en République. L’altérité rencontre donc bien des difficultés à s’imposer et à être représentée ; dès lors, les résultats électoraux prouvent que la démocratie représentative a finalement bien des difficultés à incarner la nation dans sa pluralité
Pour évoquer cette confiscation de la démocratie représentative et donc une certaine négation de l’altérité en politique par quelques familles alliées, nous procéderons par exemplification. Cet exemple a pour vocation de montrer comment à partir d’une relation de parenté mise en lumière assez facilement et assez rapidement grâce à la généalogie, deux hommes politiques entrent finalement en réseau de parenté avec plusieurs centaines d’autres constituant ainsi un groupe de parenté doublé d’un réseau politique et formant ainsi ce que nous pouvons dénommé sous le vocable de Sippe.
a) la famille proche contrôle la politique locale
Partons du couple formé de Nicolas Charles Amédée Arnould, né en 1827, et époux de Marie Eugénie Adeline Noël, née en 1839. En 1856, ils ont une fille prénommée Marie Louise Cécile. En 1857, naît Marie Eugénie. Adeline Noël décède le 26 mars 1860 à Sainte-Menehould alors que son mari meurt le 10 juillet 1869, à Jubécourt dans la Meuse. Les deux fillettes de 12 et 13 ans sont alors confiées à leur oncle maternel Jean Alfred Noël, propriétaire à Remicourt qui occupera les fonctions de maire de cette commune de 1871 à 1896. En 1876, à Sainte-Menehould et à l’âge de vingt ans, Cécile épouse l’avoué Paul Charles Alfred Bertrand, de neuf ans son aîné – membre du corpus. En 1879, la cadette épouse le notaire Adrien Charles Moulin, de trois ans son cadet – également membre du corpus.
Figure 2. Relation de parenté entre Paul Bertrand et Adrien Moulin.
À ce moment-là, le réseau d’alliance est extrêmement simpliste mais marque de son empreinte la politique locale puisque Paul Bertrand est maire de Sainte-Menehould de 1888 à 1892 et député de la Marne de 1889 à 1910 tandis qu’Adrien Moulin est maire de Sainte-Menehould de 1903 à 1912 puis de 1914 à 1915, il est aussi conseiller général du canton de Sainte-Menehould de 1904 à 1910. Hasard du calendrier électoral, les mandats importants des deux beaux-frères s’achèvent en 1910. Ils exercent tous
12
deux leurs fonctions politiques dans le cadre de l’arrondissement de Sainte-Menehould, situé au nord-est du département de la Marne.
Figure 3. Implantation des mandats d’Adrien Moulin et de Paul Bertrand.
b) de la famille proche au cousinage simple
En 1879, Paul Bertrand est témoin de l’épouse au cours du mariage avec Adrien Moulin. En 1876, le général Félix Appert est témoin de l’épouse en qualité d’ami. En réalité, s’il est ami de l’épouse ou de sa famille, il est aussi un cousin au cinquième degré de l’époux puisque Paul Bertrand est le fils du médecin Louis Christophe Bertrand (1815-1870), issu de Marie Louise Thérèse Grelet, originaire de Saint-Rémy-sur-Bussy tout comme sa mère Nicole Perchenet et sa grand-mère Marguerite Appert, elle-même fille de Jacques Appert (1681-1744), propriétaire à Courtisols. Marguerite Appert (1713-1791) est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants et son cadet le plus immédiat est Jacques Appert (1714-1790), père de Nicolas Appert (le septième enfant sur onze, 1750-1804), grand-père du cultivateur Augustin Appert (1790-1861) et arrière grand-père du général de brigade Félix Antoine Appert (1817-1891).
13
Figure 4. Relations de parenté entre Félix Appert et les deux maires de Sainte-Menehould.
Ce dernier est général après avoir participé à la conquête et au maintien de l’ordre en Algérie dans les années 1830-1840 puis à la guerre de Crimée (1853-1856) et avoir soutenu le siège de Paris dans le fort de Champigny en 1870 ; mais il a aussi été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg de 1882 à 1886. Durant ce laps de temps, il est également conseiller général du canton de Dommartin-sur-Yèvre de 1871 à 1891, date de son décès à Passy, faubourg occidental de Paris. Le réseau familial se densifie donc légèrement et renforce son emprise politique sur l’est du département de la Marne.
Figure 5. Les cantons concernés par le réseau de cousinage simple.
14
c) du cousinage simple aux cousinages complexes
Revenons à Jacques Appert, frère de Marguerite. Par la descendance de sa fille Pérette, Jacques Appert est l’aïeul direct d’Armand Justin Appert-Raulin (1864-1946). Quant à Marie Joséphine Appert (1829- ?), elle fait entrer ses branches collatérales dans le cousinage des Lorin et des Herbillon ; familles pourvoyeuses d’hommes politiques : Louis Julien Lorin (1879- ?), Louis Allyre Herbillon (1873- ?) et Paul Henri Roger Chamontin (1893-1944).
Figure 6. Sept élus entrent dans le cousinage complexe.
À partir de ce moment-là, et même si le réseau de cousinage n’est pas extrêmement complexe, l’utilisation de l’algorithme de Fruchterman-Reingold61 pour cartographier les réseaux familiaux montre de manière pertinente le rôle de pivot détenu par la famille Appert dans ce réseau à la fois familial et politique. Mais surtout, il montre que les alliances effectuées à partir du patronyme Appert vers le patronyme Chamontin, mettent en scène des familles qui envoient ou enverront sous la Troisième République des hommes dans les assemblées locales ou nationales.
Figure 7. Projection du réseau familial selon l’algorithme de Fruchterman-Reingold.
Par ces mariages, l’aire géographique concernée augmente également. La commune de La Cheppe et le canton de Suippes sont les lieux d’élection d’Allyre Herbillon et de son gendre Henri Chamontin. Justin Appert-Raulin est élu maire d’Oiry et conseiller d’arrondissement du canton d’Avize. Julien Lorin, de son côté, confirme l’implantation dans le canton de Dommartin-sur-Yèvre. Ensemble, ces hommes cumulent 87 ans de direction municipale, 29 ans au conseil d’arrondissement, 30 ans au conseil général et 21 ans de Parlement.
15
Figure 8. Les cantons concernés par les sept élus repérés.
Les relations de parenté entre élus de la Troisième République sont donc réelles, mais de là à dire qu’il existe une confiscation des sièges politiques, un véritable népotisme et un vrai impact des lignages sur le paysage politique local, il y a un pas. Ce pas commence, lorsque l’on regarde les collatéraux du côté des épouses Arnould. Par leur grand-père Nicolas Philogène Noël (1813-1875), les sœurs Arnould entrent en cousinage par les branches Gauchez, Caquot et Dommanget avec sept autres membres du corpus – sans prendre en considération les alliances faites du côté de Marie Eugénie Lambert (1812-1839), ni celles faites dans l’entourage de certains autres couples. Ces sept autres sont : Jean-Baptiste André Blot (1832- ?), Georges Charles de Chartongne (1855- ?), Louis Amédée Lambert (1860- ?), Paul Eugène Edmond Chevallier (1846- ?) et Paul Narcisse Fernand Chevallier (1875- ?), Charles Hippolyte Joly (1827- ?) et Louis Léon Maurice Fauquenot (1880-1957). Il est à mentionner que l’essentiel de ces hommes politiques intègrent le groupe familial à la faveur d’un mariage qu’ils effectuent avec une fille membre du réseau familial. L’importance des femmes dans la constitution des réseaux politiques est indéniable ; c’est par elle que peuvent se faire une grande partie des transferts de patrimoine ; qu’ils soient pécuniaires, fonciers ou politiques.
L’intégralité de l’arbre généalogique mixte (ascendant et descendant) ainsi obtenu devient désormais pratiquement impossible à commenter en l’état. Certes, il montre la réalité des cousinages et les degrés de cousinages, mais sachant qu’il est encore incomplet, il devient petit à petit impossible d’avoir une réelle vision d’ensemble. C’est aussi à partir de ce moment-là que l’algorithme Fruchterman-Reingold montre en partie ses limites. Certes, la représentation graphique du réseau met en lumière quelques éléments importants de la compréhension : le rôle pivot de quelques familles : Appert, Arnould, Gauchez, Dommanget et Caquot. Et l’on peut même dire que la colonne vertébrale de cet ensemble trouve un point d’ancrage essentiel auprès de la famille Caquot. Néanmoins, cet algorithme qui provoque la répulsion des nœuds et le rôle ressort des liens n’est sans doute pas le plus approprié dans le cadre de cette étude. C’est pour cette raison que nous lui avons préféré l’algorithme Kamada-Kawai62 qui met davantage en valeur les branches les unes par rapport aux autres.
16
En dehors de la représentation graphique, il est à noter que l’entrée de ces sept individus montre la concentration des mandats dans le nord-est du département de la Marne, dans les cantons de Suippes, Ville-sur-Tourbe, Sainte-Menehould et Dommartin-sur-Yèvre ; ces trois derniers cantons composant l’arrondissement de Sainte-Menehould. Dans cet arrondissement et entre 1871 et 1940, les cousins proches ou éloignés, directs ou par alliance des sœurs Arnould occupent au moins un fauteuil parmi les neuf du conseil d’arrondissement – sauf au cours de la période 1931-1936. Ils sont même trois (Hippolyte Joly, Jean-Baptiste Blot et Edmond Chevallier) à représenter deux cantons différents et la famille entre 1887 et 1892 ; ils occupent donc un tiers des sièges disponibles pendant ces six années.
Si nous revenons au couple Caquot-Musquin et développons les cousinages, cinq nouveaux hommes politiques entrent dans la parentèle : Pierre Dominique Lambert (1838- ?), Charles Arsène Tilloy (1822-1879), Antoine Eugène Tilloy (1850-1909), Paul Eugène Marcel Duhal (1884-1979) et Benjamin Maucourant (1843-1905). Il y a donc prolongement du réseau tel qu’il peut être dessiné selon l’algorithme Kamada-Kawai, faisant de la famille Musquin un nouveau nœud primordial.
Figure 9. Le réseau de cousinage représenté selon l'algorithme de Kamada-Kawai.
Au point de vue politique et géographique, ces cinq hommes renforcent encore le poids de la famille dans le cadre de l’arrondissement de Sainte-Menehould et tout particulièrement dans le canton de Ville-sur-Tourbe. La pérennité et la longévité du groupe à la tête des affaires cantonales et départementales sont véritablement importantes. Sachant que nous n’avons pas développé l’ensemble des parentèles et des cousinages. La présence est surtout très importante dans le conseil d’arrondissement et en premier lieu celui de l’arrondissement de Sainte-Menehould. (60 ans + 49 ans + 25 ans).
17
Figure 10. L'impact politique des hommes du réseau de parenté.
À partir du noyau familial initial, nous avons montré des relations de cousinages directes et indirectes (par mariage) entre un nombre limité d’hommes politiques, puis en regardant à partir d’une autre ascendance nous avons montré l’apport de la famille au paysage politique départemental, ensuite de nouvelles branches sont apparues donnant d’autres hommes politiques à l’arrondissement et au département.
d) du réseau de cousinage à la Sippe
Pourtant, ces hommes ne sont que quelques-uns parmi bien d’autres qui portent des patronymes différents mais qui intègrent tous le même groupe familial par l’intermédiaire de mariages redoublés. Entre ces familles pourvoyeuses d’hommes politiques, d’autres familles servent de relais. De nombreux liens existent entre ces familles patronymiques au point de donner naissance à une Sippe ; concept d’histoire médiévale défini par David Herlihy : « The Sippe came to be a cognatic, extended family unit. »63 La définition de la Sippe utilisée par Régine Le Jan et les médiévistes spécialistes du Haut Moyen-Âge et des noblesses mérovingienne et carolingienne64 se réfère à la constitution d’un groupe de parenté propre à l’aristocratie qui rassemble plusieurs familles liées entre elles par des liens du sang, d’alliance et d’amitié. Le groupe forme alors un réseau social, familial et d’intérêts communs. Transposé aux réalités sociales et politiques bien différentes du XIXème siècle, le recours à ce concept prouve la confiscation du pouvoir et des sièges électifs par des groupes de parentés élargies, nobles ou notables, jusqu’aux confins du XXème siècle.
Dans ce vaste réseau de parenté, que l’on appellera donc Sippe, existe un véritable centre à l’intérieur duquel les relations entre individus sont nombreuses, multiples et complexes (en jaune sur le graphique). Il est également possible de repérer une première frange périphérique (en vert sur le graphique) avec laquelle les familles du cœur de Sippe entretiennent des relations réelles mais plus lâches, plus distendues, moins redoublées ; enfin il existe une deuxième couronne périphérique (laissée en blanc sur le graphique). Les membres de cette deuxième couronne n’ont pratiquement pas de liens
18
familiaux directs avec des membres du corpus présents dans le cœur de Sippe mais seulement des liens avec quelques familles de la première couronne périphérique.
Figure 11. La Sippe (en vert : les familles d'élus déjà mentionnées ; en rouge : les familles d'élus rattachées au
groupe initial)
Pour ce qui concerne la seule période considérée comme notre cœur de cible : la Troisième République de 1871 à 1940, 274 hommes politiques du corpus appartiennent à cette Sippe. Ces membres siègent 120 ans au Sénat, 286 ans à la Chambre des Députés, 1.225 ans au conseil général et 2.178 ans au conseil d’arrondissement. Plus que les valeurs brutes, déjà impressionnantes pour elles-mêmes, il faut comparer cela avec l’ensemble du corpus : ces hommes correspondent à 55,58% des membres du corpus, occupent les fauteuils au Sénat et à la Chambre des Députés pendant 62,5% du temps environ, siègent au conseil général 53,44% du temps disponible et 66,56% du temps au conseil d’arrondissement. Au cours de la période jamais moins de treize membres de la famille sont présents sur les trente-deux ou trente-trois (à partir de 1889) sièges du conseil général. L’impact familial est considérable : jamais moins de 39% des sièges ne sont occupés, avec un maximum d’environ deux-tiers au début de la Troisième République. L’impact familial se fait sentir dans presque tout le département que ce soit au conseil général ou au conseil d’arrondissement. Si l’impact familial est énorme, il ne faut pas oublier que ces hommes et leurs ascendants sont en fait entrés en politique depuis fort longtemps, soit dans les institutions nationales, départementales ou communales. Mais aussi et surtout, comprendre que les critères de définition abordés lors de la première partie de cette réflexion agissent pleinement en
19
faveur de ces hommes inscrits en réseaux : familial, économique, associatif, endogène, etc. Ces hommes appartiennent à la même « famille », ils partagent les bancs des assemblées locales et départementale, les fauteuils des mêmes associations, de la délégation cantonale, de la justice de paix... Ils savent souvent qu’ils sont cousins ; par le truchement dont ne sait plus quelle grand-tante, ou petite-cousine, mais ils le savent.
e) une emprise politique qui débute au moins au début du XIXème siècle
En ne prenant comme exemple que les membres du réseau familial centré sur l’arrondissement de Sainte-Menehould ou dont les membres sont originaires du nord-est du département, il est possible de faire une partition du réseau qui regroupe alors cent-soixante-quatorze hommes politiques ayant détenu au moins une fonction entre 1800 et 1940. Ces hommes trustent les fauteuils de maire dans cinquante communes pour une durée totale de 2.386 ans. Trente-huit des cinquante communes se situent dans l’arrondissement de Sainte-Menehould, pour 1.917 ans. Les fonctions politiques départementales sont en partie monopolisées par les membres du groupe, que la nomination se fasse selon le bon vouloir des pouvoirs centraux, selon le vote par suffrage censitaire ou par suffrage universel. Le conseil d’arrondissement de Sainte-Menehould est extrêmement révélateur de ce quasi monopole. Sur la période considérée (1800-1940), le seul moment où ce réseau ménéhildien n’est pas présent au conseil d’arrondissement est la courte période comprise entre 1826 et 1830. Le reste du temps, au moins un membre est présent (dix-huit ans). Au maximum de son influence, ce réseau ménéhildien parvient à placer huit de ses membres sur les neuf fauteuils disponibles. Cette situation se rencontre de 1871 à 1882, alors que Jean Baptiste Alexis Barrois (Dommartin-sur-Yèvre), Louis Théophile Brouillon (Dommartin-sur-Yèvre), Charles Hippolyte Joly (Ville-sur-Tourbe), Adolphe Michel (Sainte-Menehould), Frédéric Joseph Nidart (Sainte-Menehould), Jean Hippolyte Nottret (Dommartin-sur-Yèvre), Pierre Louis Petit (Ville-sur-Tourbe) et Charles Arsène Tilloy (Ville-sur-Tourbe) siègent audit conseil. C’est dire si les intérêts du groupe peuvent être préservés, d’autant plus que les compétences sont multiples.
L’analyse des professions en atteste puisque se mélangent au sein de cette assemblée des spécialistes des questions juridiques et des questions agricoles (principale préoccupation dans cet arrondissement très rural et peu industrialisé). En 1871, quatre sont notaires, deux sont propriétaires et deux cultivateurs. La répartition par canton est même relativement équitable avec deux notaires et un cultivateur à Dommartin-sur-Yèvre, un notaire et un cultivateur à Sainte-Menehould, et un notaire et deux propriétaires à Ville-sur-Tourbe. Cette situation n’est pas surprenante puisque dans les espaces ruraux, tel que l’arrondissement de Sainte-Menehould, les réseaux familiaux regroupent la notabilité locale comprenant tant les propriétaires terriens, les médecins que les notaires.
Conclusion
Les campagnes électorales constituent des moments paroxystiques dans la vie politique
nationale, départementale et locale. C’est aussi un moment privilégié pour les candidats de se définir et par conséquent de se positionner vis-à-vis de l’altérité ; que celle-ci relève de la provenance géographique, sociale, confessionnelle, professionnelle... et politique. Une étude portée sur le temps long révèle que ces stratégies d’autodéfinition constituent un volet important des stratégies électoralistes qui visent à la confiscation des mandats et des sièges électifs au cours de la Troisième République par les membres de quelques familles alliées. Celles-ci constituent alors une sorte de Sippe moderne dans laquelle la pratique politique s’hérite autant que les biens meubles, immeubles et capitaux.
1 Alexandre Niess, L’Hérédité en République. Les élus et leurs familles dans la Marne (1871-1940), Lille, Septentrion, 2012. 2 Néologisme utilisé au cours des années 1990 dans le cadre d’études économiques et géographiques. « Les caractères de
l’économie nationale et internationale s’inscrivent dans les territoires, et les modèles de développement affectent et orientent l’organisation de la production agricole, au point qu’aujourd’hui, on puisse assurer que l’endogénisme, ce qui a trait aux lieux, est de plus en plus atténué sous le poids ou l’effet des encadrements. On assisterait à l’“élargissement” des territoires inscrits dans les enjeux économiques. » Odile Hoffmann, Marielle Pépin-Lehalleur, Jean-Yves Marchal, « Transformations de la vie rurale dans la plaine côtière du Golfe du Mexique (États du Tamaulipas et du Veracruz,
20
Mexique) : Évaluation du territoire sous l’effet des politiques agricoles », in Mondialisation de l’économie et développement des territoires, colloque de l’ASRDLF, Saint-Étienne, 1990, p. 434.
3 Archives départementales de la Marne – Aff. El V 472. 4 Archives départementales de la Marne – Aff. El V 314. 5 Il est né à Paris, y réside une grande partie de l’année au 166, rue du faubourg Saint-Honoré. 6 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 1168. 7 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 1021. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Édouard Fleuricourt est né à Doullens, dans la Somme, le premier juillet 1840 et est, par sa femme, intégré à une grande
famille de notaires et d’avocats d’Abbeville qui compte dans ses rangs plusieurs hommes politiques locaux abbevillois, mais aussi à un groupe familial bien implanté dans les milieux industriels rémois.
11 Adhémar Élie Hippolyte Péchadre est né à Juillac le 23 août 1862. 12 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 801. 13 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 810. 14 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 800. 15 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 802. 16 La première affiche dit du candidat Péchadre qu’il est sans expérience, alors que la seconde insiste davantage sur l’inaction
politique de l’élu municipal Péchadre. La différence est minime mais montre que les contradictions dans cette campagne électorale ne sont pas du seul fait du candidat Péchadre. Cette remarque pousse à se méfier, davantage encore, du style hagiographique des affiches placardées par Édouard Fleuricourt.
17 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 803. Le reste de l’affiche aborde un autre terrain tout aussi intéressant : « L’ancien docteur Péchadre a été nommé Conseiller municipal d’Épernay, il n’a assisté qu’à quatre séances sur quatorze depuis un an. Il a refusé d’être de toutes les Commissions, de tous les Bureaux. Il n’a jamais demandé, lui et ses amis, que de voter des dépenses nouvelles, ou des plaisanteries, singulière façon de réduire les impôts d’Octroi et les autres….. Farceur ! (…) Péchadre est un ambitieux dangereux pour tous les partis. (…) Tous vous donnerez le congé qu’il mérite à cet ambitieux sans scrupules. »
18 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 806. 19 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 800. 20 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 1241. 21 Archives départementales de la Marne – Aff. El V 530. 22 À Maisons-en-Champagne en 1870, Julien Barbier Lalobe de Felcourt succède à son père Théobald22 dans une commune
sous tutelle familiale depuis 1807. Étienne, père de Théobald, est maire avant lui de 1807 à 1831 ; la commune est donc dirigée par un membre de la famille sans discontinuité de 1807 à 1919, par le biais d’une dynastie politique locale. Le père (Théobald), membre de la noblesse champenoise, est également conseiller général avant les débuts de la Troisième République (il prend ses fonctions de conseiller général dès 1865). À la fin du mandat de Théobald, Célestin Lecomte prend le fauteuil de conseiller général et le conserve jusqu’à son décès le 20 mai 1886, alors que le renouvellement est initialement prévu en août. La préfecture n’effectue pas d’élections anticipées car aucune session du conseil général n’est prévue dans l’intervalle. Théobald Barbier Lalobe de Felcourt, décédé entre-temps (il décède le 5 janvier 1885, dans son château de Maisons-en-Champagne), son fils Julien décide alors de briguer le siège. Le poids du nom suffit-il à l’élection ?
23 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 218. 24 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 219. 25 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 218. 26 En gras dans le texte. Il s’agit de Léandre Prévost, cultivateur à Sommesous et maire de cette commune depuis 1876. Il le
reste jusqu’au 28 octobre 1900, date de son décès. 27 En majuscule dans le texte. 28 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 221. 29 Le candidat est en parenté avec les Haudos de Possesse, parmi lesquels il faut compter Justin, conseiller général de la
Marne de 1845 à 1864 et député de la Marne de 1856 à 1864. Il ne faut pas oublier que le candidat incriminé est aussi le petit-cousin de Gabriel Barbier de Felcourt, maire d’Orconte de 1848 à 1886 et conseiller général pour le canton de Thiéblemont de 1871 à 1880 et que ses cousins portent les noms illustres de Lefevre de Norrois, de Thionville, des Réaulx, etc.
30 Ses opposants lui reprochent le fait d’être commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire. 31 Né à Saint-Étienne-au-Temple, près de Châlons-sur-Marne, le 17 novembre 1823, Louis Joppé s’installe, en effet, dans le
canton comme notaire en 1853. Il se marie avec Adelina Chevreux (en 1857) et devient alors propriétaire terrien à Somsois, à compter de 1866.
32 Louis Joppé a cédé son étude en 1866 et est depuis lors exclusivement propriétaire terrien. 33 On trouve présence dans sa maison d’Elvina Détin, née à Brandonvillers en 1857. Archives départementales de la Marne
– 122 M. 34 Émile Littré, Dictionnaire, Paris, 1872 et Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 6e édition, 1832-1835, tome 2, p. 878. 35 Trésor de la Langue Française informatisé, www.atilf.atilf.fr. 36 Ibid. 37 Émile Littré, Dictionnaire, Paris, 1872.
21
38 Julien Barbier Lalobe de Felcourt soutient, le 17 juin 1863, une thèse de doctorat de droit sur Des exceptions de l’irrévocabilité
des donations entre vifs. 39 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 220. 40 Avoué puis associé dans une maison de négoce de vins de champagne, il s’inscrit dans les rangs de l’Union républicaine,
groupe d’anciens républicains radicaux qui se sont rapprochés du centre et dont le chef de file est Léon Gambetta. Il est d’ailleurs sous-secrétaire d’État à la Guerre (1881-1882) dans le gouvernement Gambetta.
41 Pharmacien et maire de Châlons-sur-Marne, il vote « pour l’invalidation de l’élection de Blanqui ». Adolphe Robert, Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, Bourloton, tome 2, p. 611.
42 Ancien receveur de l’Enregistrement qui vote « pour les ministères Gambetta et Ferry et contre la séparation des Églises et de l’État. » Ibid., tome 3, p. 299.
43 Ancien capitaine d’infanterie et questeur de la Chambre des Députés à partir de 1876, il siège au sein de la gauche républicaine mais se rapproche progressivement des gambettistes.
44 Notaire puis avocat à Reims, vice-président du comité républicain de Reims, élu sur un programme opportuniste, il s’oppose donc au radicalisme et s’inscrit à la suite de Jules Grévy, Léon Gambetta, etc.
45 Notaire à Pontfaverger. 46 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 221. 47 Il est, en effet, le petit-fils de Jean Joppé, maire de Saint-Étienne-au-Temple, nommé à l’aune de la Restauration. 48 Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, « Points – Histoire », 2001 (1991),
p. 248. 49 Catherine Durandin, « Entre tradition et aventure », in Guy Chaussinand-Nogaret (dir.), Histoire des élites en France du XVIe
au XXe siècle, Paris, Tallandier, « Pluriel », 1991, pp. 436-437. 50 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 218. 51 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 825. 52 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 367. 53 Le canton compte 21.135 habitants en 1882. 54 Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 368. 55
Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 450. 56 Ibidem. 57
Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 443. 58
Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 447. 59
Archives départementales de la Marne – Aff. El VI 448. 60 Archives départementales de la Marne – El. V 530. 61 Thomas M. J. Fruchterman, Edward M. Reingold, « Graph Drawing by Force-Directed Placement », Software : Practice and Experience, vol. 21, novembre 1991, pp. 1129-1164. 62 Tomihisa Kamada, Satoru Kawai, « An Algorithm for Drawing General Undirected Graphs », Information Processing Letters, n°31, 1988, pp. 7-15. 63 David Herlihy, Medieval Households, Cambridge, Harvard University Press, 1985, p.47. 64 Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècles). Essai d’anthropologie sociale, Paris, Presses de la Sorbonne,
1995, 571 pages.