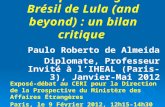La reconnaissance sociale et le Mouvement des Sans Terre du Brésil. En quête de dignité
Transcript of La reconnaissance sociale et le Mouvement des Sans Terre du Brésil. En quête de dignité
L A R E CO N N A I SSA N CE S O CI A L E E T L E M O U V E M E N T
D E S SA N S T E R R E D U B R É S I L
LA RECONNAISSANCE SOCIALE ET LE MOUVEMENT
DES SANS TERRE DU BRÉSILEn quête de dignité
ANTHROPOLOGIE PROSPECTIVE • No 14
Alexis MartigDéjà parus dans la même collection :
Chanson Philippe, La blessure du nom. Une anthropologie d’une séquelle de l’esclavage aux Antilles-Guyane, 2008.
Lazaro Christophe, La liberté logicielle. Une ethnographie des pratiques d’échange et de coopération au sein de la communauté Debian, 2008.
Olivier de Sardan Jean-Pierre, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique, 2008.
Vuillemenot Anne-Marie, La yourte et la mesure du monde. Avec les nomades au Kazakhstan, 2009.
Agier Michel, Esquisses d’une anthropologie de la ville. Lieux, situa-tions, mouvements, 2009.
Singleton Mike, Histoires d’eaux africaines. Essais d’anthropologie impliquée, 2010.
Laurent Pierre-Joseph, Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté, 2010.
Chanson Philippe, Variations métisses. Dix métaphores pour penser le métissage, 2011.
Piccoli Emmanuelle, Les Rondes paysannes. Vigilance, politique et justice dans les Andes péruviennes, 2011.
Jamoulle Pascale et Mazzocchetti Jacinthe, Adolescences en exil, 2011.
Boellstorff Tom (Trad. et révision scientifique par Grégory Dhen & Olivier Servais, avec la collaboration de Guy Monfort), Un anthropologue dans Second life. Une expérience de l’humanité vir-tuelle, 2012.
Meiers Bénédicte, Le Dieu de maman Olangi. Ethnographie d’un combat spirituel transnational, 2013.
Laplantine François, L’énergie discrète des lucioles. Anthropologie et images, 2013.
LA RECONNAISSANCE SOCIALE ET LE MOUVEMENT
DES SANS TERRE DU BRÉSILEn quête de dignité
ANTHROPOLOGIE PROSPECTIVE • No 14
Alexis Martig
Mise en page : CW Design
D/2014/4910/23 ISBN : 978-2-8061-0167-9
© Academia-L’Harmattan s.a.Grand’Place, 29B-1348 Louvain-la-neuve
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.
www.editions-academia.be
Je dédie cet ouvrageà tous ceux qui luttent pour l’amélioration de leurs conditions de vie,à mon épouse et à mes enfants, Juliana, Antoine et Joaquim,ainsi qu’à mes parents et à mes frères.
7
REM
ERC
IEM
ENTS
remerciements
Je tiens à remercier sincèrement et profondément toutes les personnes qui, en croisant mon chemin pendant la réalisation de la thèse à l’origine de cet ouvrage, l’ont rendue possible et l’ont influencée directement ou indirectement.
À tous les travailleurs ruraux, assentados, acampados et membres du Mouvement des Sans Terre rencontrés durant mes séjours au Brésil, qui luttent au quotidien pour transformer la société brésilienne et sont au cœur de ces travaux : merci !
À toutes les personnes qui m’ont fait découvrir le Brésil, lors de mes tout premiers voyages, et qui m’ont accueilli à bras ouverts comme si je faisais partie de leurs familles, en particulier à Jampa et Diogo : merci.
À François Laplantine et à Francine Saillant, qui tous deux ont accepté de m’accompagner dans mes recherches depuis la maî-trise jusqu’au postdoctorat et m’ont permis de construire la pen-sée développée dans ce livre.
Merci particulièrement au CÉLAT, de l’Université Laval, d’avoir accepté de m’accueillir pour réaliser cet ouvrage, et de m’avoir donné des conditions confortables pour le faire, mais aussi chaleureuses et sympathiques. Merci à Célia Forget pour ses conseils, à Isabelle Fleury pour les corrections, et bien sûr à Allison Bain, sa directrice.
À tous les collègues français et brésiliens qui ont permis de faire avancer cette recherche grâce aux nombreuses discussions formelles ou informelles : Youssef El Mamdouhi, Olivier Leservoisier, Romain Bragard, Xavier Vatin, Jorge Santiago,
8
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
Mohamed Amara, Martin Soares, Renato Athias, Denis Cerclet et à tous les membres du CREA qui ont pris le temps de discuter avec moi autour de ces recherches.
Je remercie particulièrement Sofiane Ailane pour nos nom-breuses discussions lors de la réalisation simultanée de nos tra-vaux respectifs, ainsi que Xavier Vatin et sa famille pour nous avoir accueillis ma famille et moi.
Merci au professeur Paulo Marcondes Soares, de l’Universi-dade Federal do Pernambuco, pour les nombreuses discussions autour des rapports entre les domaines de l’artistique et du poli-tique au Brésil, ses orientations et les opportunités qu’il m’a offert de présenter mes travaux au sein de l’UFPE.
Je remercie également Aïcha Hocine pour ses nombreux coups de main, ainsi que Julien Chambon, Monica Sessin et Aymeric Bôle-Richard pour leur aide. Enfin, un grand merci aux relecteurs pour leur disponibilité et le sérieux accordé aux premiers jets de cet ouvrage, qui sans eux n’aurait pas la même qualité.
Enfin, merci au CÉLAT et à la région Rhône-Alpes pour leur soutien financier, le dispositif Explora’Pro et une bourse de mobi-lité postdoctorale. Ils m’ont ainsi donné les conditions matérielles nécessaires pour mener à bien ce travail.
9
PR
ÉFA
CE
préface
Le Mouvement des Sans Terre n’est pas seulement l’un des mouvements sociaux les plus novateurs et complexes de la société brésilienne. Son activité concerne ce qu’il y a de plus révélateur pour comprendre cette société depuis la conquête portugaise jusqu’à nos jours : la question de la terre et la question de la foi.
La Conquista fut en effet indissociablement conquête de la terre et imposition de la foi. Or ce sont les deux questions perma-nentes au Brésil : à qui appartient la terre ? Qu’en est-il de la foi, non seulement en tant qu’expression religieuse mais aussi poli-tique du social ? Car il va être question ici de la foi en tant qu’es-pérance de justice sociale.
À partir d’une démarche d’observation, d’imprégnation et d’accompagnement des acteurs sociaux effectuée principalement dans l’État de Pernambuco, mais aussi dans d’autres États, Alexis Martig nous entraîne dans « le Brésil des inégalités sociales » et nous propose une perspective dans laquelle l’extrême pauvreté n’est pas seulement considérée comme économique mais est aussi liée à la notion de « déni de dignité ». Toute la recherche va alors consister à montrer comment des conditions de subordination, de discrimination et de stigmatisation sont susceptibles dans ce mouvement social et par lui de s’inverser en processus de subjec-tivation, c’est-à-dire de désasujetissement.
Pour comprendre la genèse et la dynamique du Mouvement des Sans Terre, Alexis Martig réinterroge avec minutie l’histoire rurale brésilienne en reconsidérant le rôle des partis politiques, des syndicats, des ligues paysannes, de l’Église catholique. Le MST
10
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
puise son énergie dans une histoire qui est celle des luttes sociales, des guerres (dont la plus célèbre est la guerre de Canudos dans le sertão que nous connaissons notamment à travers Os Sertões d’Euclides da Cunha), des révoltes et des rébellions célèbres des bandits d’honneur du Cangaço.
Nous ne pouvons qu’être étonnés par le caractère hétéroclite de l’héritage revendiqué : la théologie de la libération en tout pre-mier lieu mais aussi les quilombos (Zumbi), les personnages les plus marquants des combats historiques régionaux (Francisco Julião, Antônio Conselheiro, Chico Mendes) mais encore des figures mythiques de Russie, d’Inde, de Chine, de Cuba qui vont devenir des instances d’identification. La question des relations entre des mouvements messianiques locaux teintés de banditisme et l’accès à une conscience politique au sens marxiste est particu-lièrement éclairante et le lecteur comprend bien en lisant ce livre la difficulté qui fut celle des travailleurs ruraux à trouver une expression politique de leur lutte. Ce qui a en effet été historique-ment privilégié au Brésil est l’urbain (civilisateur) alors que l’abo-lition de l’esclavage, l’avènement de la République et l’histoire contemporaine n’ont pas modifié fondamentalement la nature des rapports de domination dans leurs triples dimensions sociale, culturelle et géographique.
Alexis Martig montre que nous sommes confrontés à une multitude d’acteurs sociaux qui ne se réduisent nullement à l’op-position des grands propriétaires et des travailleurs ruraux, car ces derniers ne forment pas un groupe homogène en raison de la diversité des régimes fonciers. Mais tous néanmoins sont l’objet d’une discrimination qui n’est pas seulement étudiée dans l’objec-tivité de la condition subalterne mais dans la subjectivation, c’est-à-dire l’intériorisation de normes discriminantes liées notamment à la dévalorisation du travail manuel au Brésil, ce qui renvoie aux conditions historiques de l’esclavage.
L’auteur de ce livre a été profondément marqué par de minus-cules interactions asymétriques dans lesquelles se rencontrent ceux qui ne possèdent rien et vivent dans la rue et tous les autres. Elles ponctuent littéralement la vie quotidienne. Ce sont des say-nètes qui se répètent chaque jour aux feux de signalisation ou aux tables de restaurant et provoquent l’humiliation des uns et un
11
PR
ÉFA
CE
zeste de culpabilité momentanée chez les autres. Elles sont telle-ment habituelles qu’elles finissent par être considérées comme normales.
Alexis Martig observe et analyse ces situations qui ne peuvent être comprises qu’en se déplaçant des villes vers les campagnes. Nous réalisons alors au fil des pages à quel point la classe sociale rurale nordestine dominante pratique l’art de maquiller l’injustice à travers le système du parrainage et du coronelismo qui repose sur des relations personnalisées. Le chercheur a remarquablement compris l’ambiguïté extrêmement complexe de ce qui perdure encore de nos jours dans la société brésilienne : la chaleur des relations personnelles dissimule la violence des rapports sociaux, et il s’agit bien dès lors d’articuler ce qui est culturel (la cordiali-dade) et ce qui est structurel (l’héritage du passé colonial), mais va être remis en question par ce qui est événementiel : les manifesta-tions sociopolitiques mais aussi artistiques inventées par le MST.
Ce tout dernier point – l’esthétique du Mouvement des Sans Terre et en particulier le phénomène appelé mística – est proba-blement l’aspect le plus méconnu du mouvement. Il va donner lieu aux pages les plus originales de ce livre qui tisse des liens inédits entre des domaines souvent considérés comme séparés : non seulement les rapports du politique et du religieux mais éga-lement de ces derniers avec l’éthique et l’esthétique.
Alexis Martig s’imprègne avec méthode (mais aussi avec plai-sir) de ce secteur artistique d’activité : le Setor da cultura mis au service de la libération contre l’oppression et plus particulière-ment du combat pour la réforme agraire. Il suit un cours de for-mation artistique du MST qui lui permet de mettre en évidence le lien étroit entre la dimension esthétique et la dimension pédago-gique (en référence notamment à Paulo Freire), il participe à des manifestations musicales et accompagne de nombreuses expériences théâtrales réactivant les apports des avant-gardes (Maïakovski), de Brecht et du « théâtre de l’opprimé » d’Augusto Boal. Les frontières entre les acteurs sur la scène publique et les acteurs sur la scène théâtrale se mettent alors à vaciller. La culture artistique du Mouvement des Sans Terre se construit comme une culture de résistance à la fois à la domination néocoloniale et à l’« industrie culturelle » de l’économie libérale. Elle poursuit, se
12
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
faisant, un double objectif : 1. acquérir ou plutôt conquérir une image de soi « gratifiante », restauratrice de la dignité déniée ; 2. revaloriser cette image pour l’extérieur, « montrer un autre Mouvement des Sans Terre » que celui de ses représentations habituelles misérabilistes, prolétarisantes et stigmatisantes.
Il convient à mon avis de se demander ici si la notion de « socialisation de l’art » mise au service d’une cause partisane n’est pas contradictoire dans les termes. Comment la mística, avec son vocabulaire militant, peut-elle éviter les écueils du réalisme socia-liste ? Mais Alexis Martig déjoue les réponses simplificatrices. Nous sommes dans cet ouvrage, qui ne surplombe pas son « objet » mais le construit avec les acteurs sociaux eux-mêmes, en présence d’un travail d’expérimentation. La question des relations entre l’esthé-tique et le politique (interrogées par le chercheur à partir d’au-teurs comme Gramsci et Alfredo Bosi mais nous pourrions aussi avoir recours à Adorno, Pasolini, Rancière) fait débat à l’intérieur même du Mouvement des Sans Terre et n’est nullement résolue.
C’est le propre d’un texte complexe et ouvert explorant les diverses facettes d’un mouvement social qui n’a rien d’homogène et regorge de significations multiples de susciter plusieurs lectures possibles. L’une d’elles me conduit à réinterroger ce que j’ai appelé il y a déjà longtemps les trois voix de l’imaginaire (que je désignerai plutôt aujourd’hui par le terme de voies au sens chinois de dao) : le messianisme, la possession et l’utopie qui constituent trois formes de réaction au temps et à l’histoire.
Il y a incontestablement du messianisme dans le MST qui se pense lui-même comme résolument évolutionniste et est animé par une « temporalité d’attente d’un horizon de justice ». Si le pro-jet de construction utopique d’un monde nouveau (mais pas exac-tement dans la forme fouriériste ou saint-simonienne) est à l’œuvre également, je me demande si tant d’énoncés performatifs (Quando ? Já ! Quando ? Já ! Quando ? Já)1 ne sont pas là pour induire une sortie de l’histoire dans le temps présent. Or il me semble qu’il y a là quelque chose qui entre en résonance avec la possession, non pas au sens des cultes du même nom (le Candomblé et l’Um-banda), mais au sens du théâtre d’Antonin Artaud.
1. « Quand ? Maintenant ! Quand ? Maintenant ! Quand ? Maintenant ! »
13
PR
ÉFA
CE
Cette hypothèse, bien sûr, mériterait une plus fine élaboration. Je me contenterai de la formuler par une série de questions. S’agit-il d’expérimenter sous forme d’événements performatifs un régime différent de celui de l’imposition de normes stigmati-santes ? Ce régime suspend-il dans le présent (já) les rapports de domination ? Cette suspension annonce-t-elle et préfigure-t-elle l’abolition de ces normes ?
Ce sont là autant d’interrogations que pose la lecture de cet ouvrage extrêmement stimulant. L’un de ses mérites est de contri-buer à ouvrir un horizon de connaissance et d’action qui rompt avec une anthropologie hégémonique. Pour Alexis Martig une anthropologie qui soit à la mesure des enjeux de notre époque est un acte, car, s’il n’y a pas d’acte, il n’y a pas de responsabilité et alors on peut dire et écrire n’importe quoi. C’est l’acte de co-construction du sens d’un sujet engagé qui doit contribuer à ce que ceux qui ont été ignorés ou traités comme objets deviennent ou redeviennent sujets, c’est-à-dire acteurs et auteurs et non sim-plement agents.
Cette question, qui n’est pas seulement celle de la reconnais-sance mais de l’estime de soi, c’est-à-dire de la subjectivité et de sa relation avec la citoyenneté, est au cœur des pages que nous allons découvrir. Mais, ne nous y trompons pas, jamais Alexis Martig ne cède à l’idéalisation complaisante du mouvement dont il montre les transformations et les contradictions en multipliant les média-tions théoriques et en fécondant son travail de terrain par la dis-cussion avec des chercheurs non seulement brésiliens et européens mais nord-américains parmi lesquels Nancy Fraser, Axel Honneth, Charles Taylor, Gayatri Chakravorty Spivak, Francine Saillant.
Bref, voici un ouvrage qui contribue à renouveler une anthro-pologie du politique et qui, à mon avis, fera date. Il constitue un apport original à la connaissance des mouvements sociaux paysans en Amérique latine. Mais il ouvre également à une perspective de confrontation avec d’autres mouvements sociaux sur d’autres continents comme la lutte des Dalits en Inde ou le « Mouvement des Indigènes de la République » en France.
François Laplantine
« Un droit à la différence-dans-l’égalité peut être articulé du point de vue des minorités nationales comme des migrants globaux ; et dans chaque cas, ce droit représente un désir de réviser les composants classiques de la citoyenneté – la citoyenneté politique, légale et sociale (Marshall) – en les étendant pour inclure le domaine de la « citoyenneté symbo-lique » (Avishai Margalit). L’aspect symbolique soulève des questions affectives et éthiques liées aux différences cultu-relles et à la discrimination sociale – problèmes d’inclusion et d’exclusion, de dignité et d’humiliation, de respect et de répudiation. (…) Les affiliations ou les solidarités minori-taires surgissent en réponse aux échecs et aux limites de la représentation démocratique, créant de nouveaux modes d’agent, de nouvelles stratégies de reconnaissance, de nou-velles formes de représentation politique et symbolique : ONG, groupes anti-mondialisation, Commissions Vérité, tribunaux internationaux, agences locales de justice transi-tionnelle (les tribunaux gacaca dans le Rwanda rural). »
(Bhabha H.K., 2007, p. 16-17)
17
INTR
OD
UC
TIO
N
introduction
En quête de dignité : sensible et inégalités sociales…
« Recife, le 6 juin 2004, Avenida Agamenon Magalhães.Nous sommes arrêtés à un feu le long du canal. Les vitres sont fer-mées et la climatisation activée afin de lutter contre la chaleur due au soleil et au fort taux d’humidité de la ville. Alors que nous discu-tons, la tête d’une jeune fille apparaît de l’autre côté de la vitre en nous fixant dans les yeux avec un regard désabusé. Elle frappe à la vitre et tend la main pour faire comprendre qu’elle nous demande de l’argent. Spontanément, le chauffeur secoue la tête pour exprimer son refus de lui donner de l’argent, esquisse avec sa bouche un sen-timent de désolation, et ponctue l’interaction d’un signe du pouce approuvant la situation par une sorte de « OK » ou « tout va bien » auquel la petite fille répond par le même geste et baisse les yeux. Elle repart pour demander de l’argent auprès des nombreuses autres voitures qui attendent comme nous que le feu passe au vert.
Cette scène a constitué un des événements qui ont marqué notre regard sur le Brésil et fortement déterminé à la fois le choix de l’objet d’étude et la méthodologie de la recherche présentée dans cet ouvrage. Véritable introduction au Brésil des inégalités sociales, elle renvoie à cet aspect de la société au sein de laquelle se côtoient quotidiennement une des franges les plus pauvres de la population et une autre partie de la population, moins pauvre, voire riche. Loin d’être un événement isolé et exceptionnel, elle est révélatrice de situations quotidiennes qui se répètent à de nombreux feux de signalisation, à des tables de restaurant ou des coins de rue… Ce qui peut choquer ici un regard habitué à des
18
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
sociétés possédant une majorité de classes moyennes, ce sont les proportions de populations pauvres, dont la pauvreté est percep-tible au quotidien par le biais d’interactions telles que celle précé-demment évoquée.
Mais ce qui s’est révélé profondément marquant, c’est la manière dont les protagonistes de cette scène l’ont vécue, c’est-à-dire dans une relative « normalité ». Malgré une hiérarchisation sociale basée sur une marginalisation massive de la population, les personnes cohabitent et interagissent quotidiennement autour d’« un pouce levé ». En effet, la réaction habituelle est un refus de donner de l’argent suivi d’une reprise de l’activité précédant la sollicitation, comme s’il s’agissait d’une pause pendant laquelle on répond à la personne, et que la vie reprenne ensuite son cours « normalement ». Plus ou moins bien vécu selon les personnes, le refus est souvent justifié par la difficulté de savoir à qui l’argent va être destiné – parents ou enfants –, et ceci recouvre une interro-gation sur l’efficacité du don d’argent dans une telle situation.
Si nous avons choisi cet exemple, c’est pour donner à voir la manière dont les personnes « pauvres », ou dans la position de demandeur, à l’image de la jeune fille évoquée, vivent cette inéga-lité sociale et surtout les refus auxquels elles sont exposées. Le comportement de la jeune fille qui baisse les yeux, ou du chauf-feur au sourire en coin, gêné, exprime une certaine résignation, voire dans le cas de la jeune fille, une possible honte de soi. Cette expérience, ainsi que d’autres nombreuses interactions similaires ont progressivement nourri une interrogation sur la nature des liens entre la hiérarchisation du social et le domaine du sensible, c’est-à-dire les sentiments qu’elle peut générer. D’où le choix de construire notre étude en interrogeant les manières dont se cons-truisent et se négocient les normes de la hiérarchie sociale à partir de l’étude du sensible : comment comprendre la résignation d’une population face à une situation profondément inégale ? Quels rôles jouent les sentiments d’infériorité et de supériorité dans l’affirma-tion, la négociation et la remise en cause de la hiérarchie sociale ? La hiérarchie sociale est-elle le résultat de sentiments d’infériorité, ou ces sentiments sont-ils la conséquence de rapports sociaux inégaux ?
19
INTR
OD
UC
TIO
N
Si cette première rencontre du Brésil s’est révélée marquante de par la découverte d’une situation sociale caractérisée par des inégalités fortes, mais pourtant relativement normalisées, il est important de ne pas occulter les réactions des populations con-frontées à ce genre de situation. En effet, face aux inégalités sociales, de nombreuses réactions peuvent aussi prendre la forme d’une lutte pour la remise en cause d’une situation, comme de nombreux mouvements sociaux, syndicaux ou religieux.
L’un de ces mouvements sociaux a retenu notre attention et nous a semblé particulièrement pertinent pour saisir notre objet : le Mouvement social des travailleurs ruraux Sans Terre du Brésil (MST). Ainsi, la lutte du MST nous est apparue comme un terrain privilégié pour comprendre comment se construisent, et se remet-tent en cause, les normes hiérarchiques au sein d’une société puisque cette lutte a pour objectif premier de faire évoluer, grâce à la réforme agraire, la situation de pauvreté dans laquelle se trou-vent les travailleurs ruraux brésiliens. L’intérêt de prendre la lutte du MST comme terrain pour répondre à notre questionnement est que les objectifs de cette lutte dépassent le strict cadre de l’éco-nomique et de la redistribution des richesses, ses revendications s’inscrivant également dans les domaines de la justice sociale, de la souveraineté populaire et surtout de la « dignité ».
Une étude approfondie de ces revendications d’accès à la dignité nous a semblé particulièrement pertinente pour analyser et comprendre à la fois l’aspect moral d’une lutte sociale, mais aussi la part et le rôle des sentiments dans la hiérarchisation du social. S’interroger sur l’aspect de la dignité dans la lutte du MST renvoie ainsi à tout un ensemble de questions permettant de saisir comment se construisent, se négocient et se remettent en cause les normes de la hiérarchie sociale. En effet, cela suppose que l’on s’interroge sur ce que signifie « la dignité », et que l’on se demande ce qu’est une situation caractérisée par l’absence de dignité et moti-vant sa revendication. Comment se conquiert la dignité ? Auprès de qui et par quels moyens ? Comment se perçoit-elle ? À quel(s) niveau(x) se jouent sa négociation et son obtention ? Se situe-t-on au niveau du sujet individuel ou du collectif ? De quel collectif ? De quelle nature sont leurs éventuelles relations ?
20
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
Loin d’être exclusif au MST, le registre de la dignité fait aujour d’hui partie des revendications des mouvements sociaux contemporains de diverses sociétés, et ce, qu’il s’agisse du terme de « dignité », ou plus largement des termes d’« indignation » ou d’« indignés » : on le retrouve bien sûr dans les discours du Mouvement des Sans Terre à travers le terme de « Dignidade », mais aussi dans les revendications du Mouvement des Indigènes de la République (MIR) en France, utilisé par les Dalits en Inde, ou encore mis en avant lors du Printemps Arabe à travers l’appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité dans le journal Le monde du 3 mars 2012 et sur la radio France Inter, revendiquant « une participation pleine et entière à une vie digne et respectueuse des droits humains », sans oublier pour autant les Indignados de la Praça del Sol à Madrid ou leur pendant l’Occupy Wall Street.
L’objectif de cette recherche sera donc de tenter de contribuer à la compréhension des revendications contemporaines de dignité, en pensant une anthropologie de la dignité appliquée aux contextes de lutte sociale.
Du terrain…
Les recherches présentées dans ce livre sont le résultat de réflexions élaborées dès le Master et approfondies dans le cadre de ma thèse de doctorat. En effet, dès le Master, mon intérêt s’est porté sur les actions du MST, et en particulier sur la mémoire qui constitue l’héritage que le MST revendique et qui est composé de références à des luttes de mouvements messianiques ou de ban-dits d’honneur du Nordeste1 brésilien.
Ce terrain consistait principalement à travailler avec une équipe du MST qui intervenait dans les assentamentos (commu-nautés de la Réforme Agraire) autour de la ville d’Escada à quatre-vingts kilomètres de Recife, capitale de l’État du Pernambuco
1. Nordeste est le terme couramment utilisé pour désigner la région située dans l’aire géographique du Nord-Est du Brésil et composée des États suivants : Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio grande do Norte, Ceará, Maranhão et Piauí.
21
INTR
OD
UC
TIO
N
dans le nord-est du Brésil. Ce premier séjour m’a permis de découvrir la réalité quotidienne des assentados (habitants des assentamentos) et acampados (habitants des campements reven-diquant des terres), et plus largement de la réforme agraire « en train de se faire » dans le Nordeste du Brésil. Pendant plusieurs semaines, je passai la majorité de mon temps avec une équipe du MST à visiter les assentamentos et les acampamentos (campe-ments revendiquant des terres) de la région. Nous nous dépla-cions principalement à pied, à moto ou partagions les transportes, ces vieilles camionnettes où s’entassent autant de personnes que possible, qui sur un marchepied, qui dans un coin du véhicule. Sans arrêt matériel précis, les transportes s’arrêtent où on le souhaite et permettent, à bas prix, de palier le peu de trajets des réseaux de bus. Ce n’est que bien plus tard, vers la fin de la thèse de doctorat, que je me rendis compte de la chance que j’avais eue d’être intro-duit au cœur de la réforme agraire, auprès de ses protagonistes, pouvant ainsi mieux comprendre à la fois le sens de la lutte pour la réforme agraire et pour ces personnes.
Casquette du MST sur la tête, crème solaire sur le visage et tongues havaianas aux pieds, je passais mes journées à visiter les parcelles des assentados et les acampamentos de la région, parfois au bord de la route et parfois après plusieurs heures de marche à l’intérieur de la cannaie. Lors de ces visites, j’accompagnais le plus souvent le technicien Camões. Certaines personnes nous invi-taient quelquefois à partager leur déjeuner et nous grignotions ce que nous trouvions sur les chemins ou que certains assentados nous offraient : araças, jacas, jambo (ensemble de fruits), pas-tèques, ou encore du jus de coco directement bu dans la noix… Indirectement ce premier terrain m’a aussi introduit à un autre aspect de la lutte du MST, à savoir le développement et le recours dans un but politique à des pratiques artistiques diverses pour exprimer et mettre en scène cette fameuse mémoire dans les acti-vités du Setor de Cultura (Secteur de la Culture).
Toutes périodes confondues, j’ai eu l’occasion de passer plus de deux ans au Brésil, suivant d’une manière générale les activités du MST, principalement du Pernambuco, lors de mes visites régulières à son bureau de Recife pour maintenir le contact et m’y entretenir des recherches en cours, mais aussi pour discuter de
22
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
projets d’actions sociales avec le mouvement. À ceci, se sont ajou-tées des visites régulières dans les assentamentos de la région d’Escada, ainsi que des séjours et des visites plus spécifiques dans des assentamentos d’autres États – Bahia et São Paulo – pour par-ticiper à la vie quotidienne, observer et réaliser des entretiens. En dehors des interactions directes avec le mouvement social, le ter-rain a aussi été constitué du « quotidien » à partir de l’observation du regard et de l’opinion que portaient les personnes autour de moi sur le MST, et de la façon dont il pouvait être présenté dans les médias.
Progressivement, j’ai pu ainsi me rendre compte que si le MST avait comme objectif premier la redistribution des terres, sa lutte et ses actions recouvraient aussi d’autres revendications, telle celle de la dignité, et s’inscrivaient dans un objectif beaucoup plus large de justice sociale et de désir de transformation de la société. Dès lors, mes réflexions se sont orientées vers la compréhension de ces aspects « non économiques » de la lutte du MST et sur les inégali-tés sociales que ces aspects recouvraient.
En ce qu’il s’inscrit dans le domaine du sensible et de l’affectif, le registre de la dignité m’a amené à me demander quels étaient les liens entre le domaine du sensible et les inégalités sociales et comment une analyse des manières de ressentir, de vivre, de se penser et de se percevoir des personnes engagées dans le MST permettrait de mieux saisir le sens de leur lutte.
Mes observations se sont ainsi portées sur le discours du MST relatif à la dignité, et sur les pratiques développées par le mouve-ment social pour « restaurer une dignité » aux travailleurs ruraux brésiliens à travers le Setor de Cultura. Suite aux contacts réalisés lors du premier terrain et des actions communément engagées avec le MST du Pernambuco, j’ai pu pendant le terrain suivant participer à des activités du Setor de Cultura de cet État, lors du second Fórum Social Brasileiro (FSB) à Recife en avril 2006, durant lequel se sont regroupés plus de mille assentados et acam-pados de tout le Brésil. Parmi ces activités, nous reviendrons sur une pièce de théâtre abordant l’impact d’organismes mondiaux comme l’OMC sur le quotidien des travailleurs – ruraux comme les ouvriers – ainsi que sur une mise en scène anniversaire du massacre d’Eldorado dos Carajás ayant eu lieu dix ans plus tôt, en
23
INTR
OD
UC
TIO
N
avril 1996, et au cours duquel dix-neuf militants Sans Terre sont morts lors d’une manifestation et du blocage d’une route dans l’État du Pará, au nord du Brésil. Suite au massacre d’Eldorado dos Carajás, la date du 17 avril est devenue la journée internatio-nale des luttes paysannes.
… à l’objet
La première difficulté rencontrée fut de comprendre comment aborder la dignité comme un objet de recherche anthropologique à proprement parler. Nous nous sommes alors rendu compte que les revendications de dignité ainsi que les pratiques qui lui sont liées s’inscrivent dans ce que l’on qualifie plus largement d’une lutte pour la reconnaissance. Le terme de dignité étant une des déclinaisons possibles de ces luttes, à l’instar du « respect » reven-diqué par exemple actuellement par les populations d’Indiens Guarani Kaiowá de l’État du Mato Grosso do Sul, eux aussi enga-gés dans une lutte pour la reconnaissance sociale.
La construction de l’objet de recherche s’est ainsi faite pro-gressivement, à partir de nombreuses lectures difficiles à articuler, car allant de la philosophie sociale, morale et politique à l’anthro-pologie en passant par la sociologie et l’histoire. Elle a été aussi sous-tendue par la préoccupation constante tout au long de la recherche, de me situer dans une démarche inductive, en m’ap-puyant sur le vécu des sujets et sur une définition émique de la dignité, et non pas sur une interprétation en termes de reconnais-sance sociale basée sur les impressions et les projections du cher-cheur (Chapitre I). D’une manière plus large, toute l’architecture de ce travail relève de cette préoccupation, ce qui nous a conduit à dédier une partie à la synthèse socio-historique de la constitu-tion des travailleurs ruraux dans la société brésilienne pour saisir jusqu’où il est possible, avant même de parler de dignité, de com-prendre ce qu’est le déni de dignité dans le contexte précis de cette recherche. Il m’est ainsi apparu nécessaire de mettre en lumière combien la subordination historique des travailleurs ruraux pauvres et libres s’est construite autour d’un lien affectif dans le
24
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
cadre de la « domination personnelle ». Cette sujétion a profondé-ment influencé leur manière de percevoir la réalité, et en particu-lier leur manière de percevoir leur infériorité dans la hiérarchie sociale, comme une situation inéluctable, voire naturelle. Cette partie de l’ouvrage est capitale pour saisir la portée de la lutte du MST dont l’enjeu réside justement dans une véritable remise en cause de cette « naturalisation des inégalités sociales ».
Comment en effet, parler d’une lutte ou d’une conquête pour la dignité sans parler de déni de dignité ? C’est pourquoi nous nous sommes attachés à mettre en lumière les critères socio-his-toriques précis permettant de déterminer dans quelle mesure il est possible, à partir d’une relecture de la formation historique de la société brésilienne, depuis l’établissement de la colonie portugaise jusqu’à la société brésilienne actuelle, de qualifier de déni de dignité la situation sociale des travailleurs ruraux brésiliens (Cha-pitres 2 et 3).
Toujours guidé par cette préoccupation, j’ai essayé de donner au maximum la parole aux sujets afin de faire apparaître leurs ressentis et de saisir les liens qui se tissent entre leurs sentiments et leur mobilisation politique. Le sentiment d’indignation s’est montré être particulièrement important dans la mobilisation des travailleurs ruraux au sein du MST, le mouvement social offrant une possibilité d’exprimer un certain refus de l’insupportable et plus largement de prendre conscience qu’un autre monde est possible. L’étude de l’usage politique des pratiques artistiques développé dans le Setor de Cultura du mouvement social a ainsi permis de montrer combien la lutte pour la reconnaissance sociale recouvre à la fois les domaines de l’estime de soi et des politiques publiques, de l’esthétique et du politique, du sentir-ensemble et du vivre-ensemble. La conscientisation des travailleurs ruraux et la transformation de leur subjectivité par leur participation à des activités artistiques se sont avérées être une partie clé de cette recherche permettant de saisir les enjeux de l’usage des pratiques artistiques au sein du mouvement social. Ainsi, les différentes ethnographies et entretiens ont mis en lumière la tension interne au MST entre dirigisme et émancipation, idéologie et utopie, poli-tisation de l’esthétique et esthétisation du politique. Basées sur une « esthétique Sans Terre » constituée des symboles propres au MST
25
INTR
OD
UC
TIO
N
– casquette, T-shirt, drapeaux, hymne, matériel de travail… – ainsi que de la mémoire revendiquée, ces activités artistiques visent à repenser la lutte présente à la lumière des luttes passées pour ensuite « amener le rêve futur au présent ». Expériences musicales, théâtrales (allant du théâtre épique à l’agitprop en pas-sant par le théâtre forum) ainsi que les fameuses místicas, ces sortes de mise en scène de la foi dans le projet révolutionnaire, héritées de l’Église catholique dans laquelle furent formés une grande partie des cadres du mouvement, participent ainsi des processus d’identification au statut de Sans Terre entre des mili-tants aux statuts sociaux variés et provenant de classes sociales distinctes (Chapitre 4 et 5).
En prenant la ville comme lieu principal de la mise en scène de ces activités et de son esthétique, le MST cherche aussi à transfor-mer la manière dont les « Sans Terre » sont perçus dans la société et à communiquer autour de la lutte pour la terre au Brésil. En marge des nombreuses manifestations et défilés, occupation d’es-paces publics, participation à des conférences ou des séminaires dans le cadre de partenariat avec des institutions publiques ou privées, les expériences théâtrales sont particulièrement illustra-tives de cette volonté de communication et de la politique de signification dans laquelle ils sont engagés.
C’est, en tout cas, ce que j’ai essayé de montrer à partir de l’expérience du groupe de théâtre Filhos da Mãe… Terra en don-nant à voir qu’elle permet, après avoir prouvé que des Sans Terre pouvaient faire du théâtre, à la fois d’inscrire les intégrants du groupe dans des processus de reconnaissance en termes de valo-risation et d’estime de soi et de présenter une autre image que celle d’occupations violentes fréquemment relayées et mises en scène par la majorité des médias. Le développement des activités théâtrales dans le cadre du MST et du Setor de Cultura s’inscrit plus largement dans une « politique du sensible » (Laplantine, 2005) en ce qu’il remet en cause la pratique académique du théâtre en tant qu’art du rejet établissant des distinctions entre ceux qui ont accès à sa compréhension et à sa pratique et ceux qui en sont exclus (Chapitre 7). Ce deuxième aspect des activités du Setor de Cultura permet de faire apparaître le deuxième niveau de la reconnaissance sociale : celui de la réalisation de politiques
26
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
publiques visant à subvertir les inégalités sociales et à garantir l’égalité à tous les citoyens. En effet, en s’inscrivant dans une lutte pour leur représentation dans la société brésilienne, l’enjeu des activités du MST est d’affirmer que les « Sans Terre » sont eux aussi des citoyens et ne sont pas des « autres » tels que les présen-tent les médias à grand tirage ou à grande audience…
En créant un sentiment d’appartenance autour d’une « culture militante » le MST arrive à mobiliser dans une lutte commune des travailleurs ruraux à l’origine isolés pour en faire des sujets poli-tiques. L’analyse des místicas permet en ce sens de réfléchir aux possibilités et aux conditions d’émancipation et de remise en cause des hiérarchies sociales dans le domaine du sensible (Cha-pitre 6).
Enfin, en ouverture de ces travaux, nous reviendrons sur les conclusions de cette étude et ses apports à une anthropologie de la reconnaissance sociale, et plus précisément à la lutte pour la dignité.
Cette recherche tente ainsi de penser les questions classiques de l’anthropologie politique à partir de l’angle du sensible, et plus précisément du rôle de la dimension du sensible dans la normali-sation des inégalités sociales, mais aussi et surtout dans la remise en cause de cette normalisation à travers le passage de la motiva-tion affective à une mobilisation collective. Elle vise aussi à montrer les activités « artistiques » comme des actes politiques et à repen-ser les enjeux des liens entre démocratie, citoyenneté et émanci-pation.
Québec, Juillet 2013
27
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
chapitre i
penser la dignité en anthropologie
I | Dignité et reconnaissance sociale
L’objectif de cet ouvrage est de s’interroger sur les conditions de réalisation d’une « anthropologie de la dignité », en se deman-dant comment appréhender les revendications sociales en faveur de la dignité, et les pratiques qui en découlent, comme un phéno-mène social et anthropologique.
Premièrement, il nous faut constater que les études sur la dignité sont plutôt rares en anthropologie, alors que celle-ci est par ailleurs objet de réflexion dans les domaines du droit, de la philosophie morale et politique, de la sociologie, de la psycholo-gie, de la psychanalyse… (Guégen/Malochet, 2012, p. 4). Et ceci, malgré un usage fréquent et significatif du registre de la dignité dans des mouvements sociaux divers. C’est pourquoi, pour mener à bien notre objectif, il nous faudra bien sûr éviter de partir d’une définition a priori de la dignité qui s’inscrirait dans une perspec-tive humanitariste visant à transposer les droits de l’Homme dans une réalité sociale spécifique, telle que dans notre cas la société brésilienne. Dans une démarche ethnographique, nous nous pro-poserons donc de partir d’une étude et d’une analyse de discours et de pratiques destinées à lutter pour conquérir la dignité, telles que le Mouvement social des Sans Terre, à l’instar d’autres déjà évoqués, les a développées. En effet, la production d’une connais-sance en anthropologie autour de l’objet « dignité » dans le cas d’une lutte sociale ne doit pas réfléchir à ce qu’est ou ce que peut
28
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
être la dignité, mais plutôt chercher à saisir la signification de la dignité pour les sujets, les raisons de la mobilisation de ce registre discursif et les manières dont il est mobilisé, ainsi que les pra-tiques qui découlent de la lutte pour la dignité.
Deuxièmement, il est important de remarquer pour penser les revendications de dignité en anthropologie que celles-ci s’inscri-vent dans ce que le philosophe Charles Taylor a qualifié de « lutte pour la reconnaissance sociale ». Or, la thématique de la recon-naissance sociale a déjà fait l’objet d’un certain nombre de travaux d’auteurs qui se sont attelés à interroger la capacité heuristique de ce concept issu de la philosophie face à des situations empiriques. Cependant, aucune étude systématique prenant pour objet la reconnaissance et ses processus n’a encore, à notre connaissance, été réalisée. C’est pourquoi nous chercherons ici à travailler dans la lignée de ces travaux en tentant d’appréhender la reconnais-sance sociale en soi, sous la forme de la dignité, et d’en faire l’objet premier de notre réflexion. À l’instar de Catherine Neveu au sujet de l’anthropologie de la citoyenneté (Neveu, 1997), nous n’avons pas la prétention d’ouvrir un nouveau champ en anthropologie ; cependant il nous semble que ce projet relève d’un certain intérêt scientifique en ce qu’il vise à produire une connaissance renouve-lée des questions classiques de l’anthropologie politique à partir de la dimension du sensible et des affects. Pour cela, nous nous attacherons à saisir quels sont les processus de la reconnaissance sociale : Comment se construit-elle ? Comment se conquiert « la dignité » ? Que signifie lutter pour « la dignité » ? Quels sont les conséquences et les enjeux sociaux d’une lutte pour la dignité pour le sujet, le groupe dans lequel celui-ci s’inscrit, mais aussi la société dans laquelle il évolue ?
Étant donné l’absence de réflexions anthropologiques systé-matiques sur la dignité, il est important – avant d’aborder à pro-prement parler la réalité brésilienne et le MST – de présenter brièvement les différentes études existant sur la reconnaissance sociale afin de préciser le cadre de notre réflexion et de donner quelques repères au lecteur. Afin que ce dernier dispose d’élé-ments lui permettant de mieux apprécier les présentations, ana-lyses et interprétations du terrain, nous reviendrons donc dans un premier temps sur les principales contributions théoriques philo-
29
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
sophiques portant sur la dignité et la reconnaissance sociale. Ensuite, après avoir montré comment celles-ci ont été mobilisées par les sciences sociales – principalement la sociologie –, nous présenterons quelques études particulièrement proches de notre recherche sur le plan théorique, la problématique étudiée ou rele-vant d’une certaine proximité en termes de terrain, ce qui devrait permettre de mieux saisir les enjeux des luttes sociales contempo-raines pour la dignité dans le contexte social brésilien.
Dignité et « politique de reconnaissance »
… notre identité est partiellement formée par la reconnaissance ou par son absence, ou encore par la mauvaise perception qu’en ont les autres : une personne ou un groupe de personnes peuvent subir un dommage ou une déformation réelle si les gens ou la société qui les entourent leur renvoient une image limitée, avilissante ou mépri-sable d’eux-mêmes (…) La non-reconnaissance ou la reconnais-sance non adéquate peuvent causer du tort et constituer une forme d’oppression, en emprisonnant certains dans une manière d’être fausse, déformée et réduite (Taylor, 994, p. 41).
Auteur incontournable au sujet de la dignité, Charles Taylor s’intéresse, à partir de ses observations à propos des revendi-cations de courants politiques actuels, à ce qu’il appelle dans Multiculturalisme : différence et démocratie : « la politique de la reconnaissance ».
Pour comprendre les « nouvelles » revendications de recon-naissance, il revient sur le contexte socio-historique qui a fait de l’identité et de la reconnaissance une « préoccupation moderne », à partir de la conjonction de deux changements importants : l’ef-fondrement des hiérarchies sociales fondées sur l’honneur face à la notion moderne de dignité et la conception de l’identité indivi-duelle qui apparaît à la fin du xviiie siècle en même temps que l’idéal de fidélité à soi-même qu’il nomme l’« authenticité » (Taylor, 1994, pp. 43-44). Étant donné que les revendications du MST ont directement recours au registre discursif de la dignité, c’est bien sûr plus particulièrement cet aspect qui retiendra notre attention.
30
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
À l’inverse de l’honneur qui distingue les sujets entre eux, la notion moderne de dignité s’inscrit dans une perspective univer-saliste et égalitaire du respect de la « dignité inhérente à tout être humain » (Taylor, 1994, p. 43). Le principe sous-jacent à cette notion est que chacun en est investi et donc mérite un traitement équitable en termes de droits et d’accès aux biens et services. Avec le passage de l’honneur à la dignité est ainsi apparue une politique d’universalisme mettant en valeur l’égale dignité de tous les citoyens, et le contenu de cette politique a été l’égalisation des droits et des attributions. Fondée sur l’idée que tous les êtres humains sont également dignes de respect, la politique d’égale dignité est donc avant tout égalitariste dans le sens où ce qui est établi est censé être universellement le même, c’est-à-dire un ensemble identique de droits et de privilèges.
En résumé, « ce qui est relevé comme étant digne de valeur, ici, est un potentiel humain universel, une capacité que tous les êtres humains partagent. Ce potentiel est ce qui assure que chaque être humain mérite le respect » (Taylor, 1994, p. 61). On retrouve ici bien sûr l’esprit du premier article de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Pour Taylor, ce concept de dignité est le seul compatible avec une société démocratique, l’ancien concept d’honneur étant aujourd’hui inéluctablement dépassé. La démocratie aurait ainsi inauguré dans l’histoire une politique de reconnaissance égalitaire qui a pris différentes formes à travers les années, avant de revenir sous forme d’exigence pour l’égalité des statuts des cultures et des sexes.
Les revendications sociales de dignité peuvent donc être consi-dérées comme l’expression d’exigences de reconnaissance, faisant ainsi de la lutte pour la dignité une forme de lutte pour la recon-naissance. En effet, Taylor va jusqu’à avancer qu’aujourd’hui l’exi-gence de reconnaissance est un principe d’égalité universelle, ce qui en fait une porte d’entrée pour une « politique de la dignité » (Taylor, 1994, p. 57). D’où la nécessité pour réaliser une anthropo-logie de la dignité, et comprendre les enjeux inhérents à une telle lutte, de définir ce qu’est une « lutte pour la reconnaissance ».
31
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
Analysant les exigences de reconnaissance de groupes minori-taires et subalternes que l’on retrouve dans certaines formes de féminisme ou dans des revendications multiculturalistes, le philo-sophe établit un lien entre la reconnaissance et l’identité. En effet, il définit l’identité comme « quelque chose qui ressemble à la per-ception que les gens ont d’eux-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les définissent comme des êtres humains » (Taylor, 1994, p. 41). Cette connexion entre identité et reconnais-sance sur laquelle reposent ces exigences est pensée comme inhé-rente à la condition humaine de par sa nature « dialogique », l’autodéfinition de notre moi dépendant de l’interaction avec les autres qui nous entourent. Pour donner plus de poids à ses pro-pos, l’auteur fait alors référence à George Herbert Mead, et à son expression « les autres donneurs de sens ». Dans cette approche, l’« identité » se définit toujours au cours d’un dialogue avec, et parfois d’une lutte contre, les choses que les « autres donneurs de sens » veulent voir en nous.
De la reconnaissance sociale…
Plutôt récente, la thématique de la reconnaissance sociale est apparue dans l’analyse et les réflexions portant sur les conflits sociaux depuis maintenant plus de vingt ans. Son apparition est liée à l’observation de revendications sociales qui ne sont plus simplement limitées à une égalité de revenus, mais qui expriment aussi l’attente d’une égalité d’estime concernant des particularités pouvant être l’objet du mépris public ou bien d’une dévalorisation sociale1.
Comme nous avons commencé à le voir, la production litté-raire portant sur la question de la dignité, et de la reconnaissance, est initialement apparue dans le domaine de la philosophie poli-tique et sociale, avec en figure de proue Charles Taylor. Cependant, parmi les auteurs célèbres abordant cette thématique, Axel Honneth, Nancy Fraser, Emmanuel Renault ou encore Avishai
1. À ce sujet lire Hénnaf M., 2009, « Anthropologie du don : genèse du politique et sphères de reconnaissance », in Caillé A. et Lazzeri C. (dir.), La reconnaissance aujourd’hui, Paris, CNRS Éditions.
32
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
Margalit ont quant à eux développé des travaux visant à com-prendre, à partir d’approches différentes nous le verrons, le phé-nomène des revendications sociales dites de « reconnaissance ». C’est pourquoi nous nous référerons dans la suite de ce chapitre à ces auteurs dans le but de comprendre les enjeux sociaux des « luttes pour la reconnaissance sociale ».
Les sphères de la reconnaissance : la lutte pour la reconnaissance sociale d’Axel Honneth
C’est à travers les luttes que les groupes sociaux se livrent en fonction de mobiles sociaux, c’est par leur tentative collective pour promouvoir sur le plan institutionnel et culturel des formes élargies de reconnaissance mutuelle que s’opère en pratique la transformation normative des sociétés (Honneth, 2008, p. 114).
Dans La lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth entre-prend de construire une « grammaire morale des luttes sociales » visant à saisir la logique morale des conflits sociaux, et à élaborer une théorie permettant de comprendre la part des motivations morales à l’origine de ces conflits. Pour cela, il s’appuie sur le modèle hégélien de la « lutte pour la reconnaissance »2 qu’il arti-cule avec les travaux de G.H. Mead pour construire une théorie sociale à teneur normative, tout en situant empiriquement et his-toriquement sa réflexion. Le but de cette théorie est d’« expliquer les processus de transformation sociale en fonction d’exigences nor-matives qui sont structurellement inscrites dans la relation de reconnaissance mutuelle » (Honneth, 2008, p. 113).
Honneth part du postulat que la reproduction sociale s’accom-plit sous l’impératif d’une reconnaissance réciproque des sujets qui ne peuvent parvenir à une relation pratique avec eux-mêmes que s’ils apprennent à se comprendre à partir de la perspective norma-tive de leurs partenaires d’interaction, et des exigences sociales
2. Cela correspond aux écrits d’Hegel dits de Iéna (1801-1807), où l’auteur s’intéresse à la relation conflictuelle des individus et aux manières de se construire, soit dans la reconnaissance d’une communauté soit dans la relation de l’esprit à lui-même, et qui culminent avec l’ouvrage La phé-nomènologie de l’Esprit en 1807.
33
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
qui leur sont adressées. Il prolonge ainsi les réflexions de G.H. Mead et Hegel qui voient dans la lutte sociale une force structu-rante dans le développement moral de la société.
À partir de là, il s’attache à construire une phénoménologie des formes de reconnaissance basée sur les distinctions faites par Hegel autour des domaines de « l’amour », du « droit » et de « l’éthicité ». Ceci en s’attachant à prouver que ces différentes formes peuvent effectivement être rapportées à différents degrés de la relation pratique de l’individu à lui-même. Il interroge ensuite les possibles correspondances entre différentes formes de reconnaissance et d’expériences de mépris social, en se deman-dant jusqu’à quel point les données socio-historiques permettent d’affirmer que de telles formes de mépris ont effectivement été à l’origine de confrontations sociales réelles.
Pour Honneth, il existe donc différentes sphères d’interaction qui se rapportent à différents modèles de reconnaissance mutuelle. À ces modèles correspondent différents potentiels de développe-ment moral, ainsi que différents modes de relation de l’individu à soi-même. S’appuyant sur les matériaux de G.H. Mead, Honneth reprend ainsi dans sa typologie trois formes de reconnaissance mutuelle, à savoir les liens affectifs (amour, amitiés), la reconnais-sance juridique et l’adhésion à un groupe solidaire. Ces trois formes font écho à celles de l’amour, du droit et de « l’éthicité » ou vie éthique que définit Hegel. Les deux penseurs localisent les différents modes de reconnaissance dans différentes sphères de la reproduction sociale : pour Hegel il s’agit de la famille, la société civile et l’État ; et pour Mead des relations primaires avec l’autre comme individu concret, ainsi que le droit et le travail pensés comme deux formes particulières de relation avec « autrui géné-ralisé ».
La première sphère, celle de l’amour, correspond à toutes les relations primaires qui impliquent des liens affectifs puissants entre un nombre restreint de personnes. La seconde sphère, celle du droit, correspond dans les travaux de Hegel et de Mead au fait que nous ne pouvons nous comprendre comme porteurs de droits que si nous avons en même temps connaissance des obligations nor-matives auxquelles nous sommes tenus à l’égard d’autrui. Il s’agit de l’intégration de la perspective normative d’un « autrui généra-
34
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
lisé », qui nous apprend à reconnaître les autres membres de la communauté en tant que porteurs de droits.
La troisième sphère, à laquelle correspond l’estime sociale, est celle qui permet de se rapporter aux qualités et aux capacités concrètes des sujets, et que Hegel avait caractérisée au départ du concept de « vie éthique » ou d’« éthicité ». Or, Honneth souligne qu’une telle relation de reconnaissance présuppose l’existence d’un horizon de valeurs commun aux sujets concernés. En effet, une estimation réciproque des sujets suppose qu’ils se rapportent aux mêmes valeurs et aux mêmes fins, en fonction desquelles chacun mesure l’importance de ses qualités personnelles pour la vie de l’autre ou ce qu’elles lui apportent.
Reconnaissance et lutte sociale
Pour Honneth, dans les sociétés modernes, ces rapports d’es-time sociale sont l’enjeu d’une lutte permanente dans laquelle les différents groupes s’efforcent sur le plan symbolique de valoriser les capacités liées à leur mode de vie particulier et de démontrer leur importance pour les fins communes (Honneth, 2008, p. 154). En effet, il décrit l’expérience de cette estime sociale comme se rapportant pour une grande part à l’identité collective de chaque groupe : c’est le groupe dans son ensemble qui, à travers le sujet, est le destinataire de l’estime et devient son objet de considération. L’individu se perçoit alors comme le membre d’un groupe qui est collectivement en mesure d’apporter à l’ensemble du corps social des contributions dont la valeur est reconnue par tous les autres membres de la société. Il peut alors s’établir dans le groupe une « solidarité » face à une oppression politique, c’est-à-dire des liens d’estime symétrique : l’expérience de la solidarité donnerait alors accès à l’estime de soi (Honneth, 2008, p. 156).
Ensuite, Honneth entreprend de définir les expériences de déni de reconnaissance, qualifiées de « mépris », en se demandant comment l’expérience du mépris peut envahir la vie affective des sujets au point de les engager dans la résistance et l’affrontement social, autrement dit dans une « lutte pour la reconnaissance ». C’est ainsi que l’humiliation correspondant à la troisième sphère,
35
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
et à l’estime sociale, est définie comme un jugement négatif sur la valeur sociale de certains individus ou groupes, leur mode de vie individuel ou collectif, constituant ainsi une « atteinte à la dignité » d’autrui. La « dignité » ou le « statut » d’une personne est la traduc-tion du degré d’« estime sociale » accordé à la manière dont elle se réalise dans l’horizon culturel d’une société. Dès lors, cette dépré-ciation a pour effet que les sujets ne peuvent reconnaître à leur existence aucune signification positive au sein de la communauté. Et Honneth de conclure : « pour l’individu, [que] l’expérience d’un tel déclassement social va donc de pair avec une perte de l’estime de soi » (Honneth, 2008, p. 165).
Interrogeant le rôle que peuvent jouer les émotions générées par de telles expériences dans la mobilisation des sujets au sein de luttes pour la reconnaissance, il formule l’hypothèse que « les émo-tions négatives qui accompagnent l’expérience du mépris pour-raient constituer la motivation affective dans laquelle s’enracine la lutte pour la reconnaissance » (Honneth, 2008, p. 166). Ainsi, pour lui, les réactions émotionnelles négatives telles que la honte, la colère ou l’indignation ressentie face à des expériences de mépris constituent les symptômes psychiques à partir desquels un sujet peut prendre conscience qu’il est légitimement privé de recon-naissance sociale.
En résumé, le concept de lutte sociale chez Honneth suggère que les motifs de résistance et de révolte sociale se constituent dans le cadre d’expériences morales qui découlent du non-respect d’attentes de reconnaissance profondément enracinées. En cela, il montre combien la compréhension des luttes pour la reconnais-sance suppose que l’on déplace l’attention des modèles théoriques qui analysent l’émergence et le déroulement des luttes sociales, des intérêts collectifs vers les sentiments collectifs d’injustice et que l’on se concentre sur les expériences morales que vivent certains groupes du fait de leur exclusion sociale ou juridique (Honneth, 2008, p. 197). Un déplacement qui permet de faire émerger la dimension morale d’un conflit social dont les revendications por-tent exclusivement sur des questions économiques, et ainsi de compléter une analyse basée uniquement sur des enjeux d’intérêts collectifs.
36
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
Reconnaissance et justice sociale
Dans une approche nettement différente, Nancy Fraser, dans Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, étudie la reconnaissance comme une des dimensions de la justice sociale, articulée à l’autre dimension qu’est la redistribution, pour examiner « de quelle manière l’inégalité économique et l’absence de respect culturel se chevauchent et forment système » (Fraser, 2005, p. 14). Alors qu’Honneth centrait sa réflexion sur le sujet, Fraser situe la réflexion plutôt au niveau institutionnel de la société, et plus précisément des politiques publiques. La distinc-tion que l’auteur effectue entre culture et économie politique dans sa théorie de la justice sociale bidimensionnelle est strictement analytique. Ainsi, pour la philosophe, dans la réalité, tous les axes d’oppression sont mixtes et ils impliquent tous, de fait, une distri-bution inique et un déni de reconnaissance : vaincre l’injustice requiert donc dans chaque cas une politique de redistribution et de reconnaissance (Fraser, 2005, p. 47).
À ces deux dimensions de la justice sociale, elle fait corres-pondre deux conceptions de l’injustice : une injustice socio-éco-nomique et une injustice de type culturel ou symbolique. La première est le produit de la structure économique de la société et peut prendre les formes de l’exploitation, de la marginalisation économique ou du dénuement, et la seconde est le produit des modèles sociaux de représentation, d’interprétation et de com-munication, et prend les formes de la domination culturelle, de la non-reconnaissance ou du mépris (Fraser, 2005, pp. 16-17). Et « toutes deux sont les produits de processus et de pratiques qui désavantagent systématiquement certains groupes de la popula-tion par rapport à d’autres (…) » (Fraser, 2005, p. 18). Dans cette théorie, la redistribution et la reconnaissance ne sont en fait que les remèdes aux deux conceptions de l’injustice, respectivement au moyen d’une forme de restructuration économique et d’un changement culturel ou symbolique.
Fraser réfléchit donc aux formes que peuvent prendre ces remèdes et en distingue deux : les remèdes transformateurs, et les remèdes correcteurs. Dans le cas d’une politique de la reconnais-sance, les remèdes transformateurs consistent à déconstruire les
37
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
identités et la différenciation existante. Alors que les remèdes cor-rectifs ont tendance à figer la différenciation, les remèdes trans-formateurs cherchent à la déstabiliser et ouvrent ainsi de nouvelles possibilités soit à travers une célébration des variations culturelles, soit à travers la déconstruction des oppositions hiérarchiques construites discursivement (Fraser, 2005, p. 32).
Pour appuyer ses propos, l’auteure met en perspective les luttes de mouvements identitaires gay qui insistent sur la différen-ciation entre les groupes sexuels, et le mouvement queer plutôt engagé à déstabiliser cette différenciation sur le long terme. Un des avantages soulevés par l’auteur dans l’appréhension de la reconnaissance comme une question de justice est de faire du déni de reconnaissance un tort relevant du statut, c’est-à-dire situé dans les relations sociales, et non dans la psychologie. En effet, se voir dénier la reconnaissance dans le point de vue de Fraser, ce n’est pas simplement être victime des attitudes, des croyances ou des représentations méprisantes, dépréciatives ou hostiles des autres :
« C’est être empêché d’exister en tant que pair dans la vie sociale, en conséquence de modèles institutionnalisés de valeurs culturelles qui constituent certaines personnes en êtres ne méritant pas le respect ou l’estime » (Fraser, 2005, p. 50).
La philosophe fait de la notion de « parité de participation » le pivot normatif de son cadre théorique. Ainsi, selon cette notion, la justice requiert des dispositions sociales telles que chaque membre (adulte) de la société puisse interagir en tant que pair avec les autres. Pour cela, l’établissement de normes formelles d’égalité juridique est nécessaire. Cependant, ceci n’est pas suffisant et Fraser souligne deux autres conditions additionnelles (Fraser, 2005, p. 53). La première, qu’elle qualifie d’objective, correspond à une distribution des ressources matérielles de manière à assurer aux participants l’indépendance et la possibilité de s’exprimer. La seconde, qu’elle qualifie d’« intersubjective », suppose que les modèles institutionnalisés d’interprétation et d’évaluation expri-ment un égal respect pour tous les participants et assurent l’égalité des chances dans la recherche de l’estime sociale. Fraser souligne qu’il est important que « cette condition banni[sse] les modèles
38
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
culturels qui déprécient systématiquement certaines catégories de personnes et les qualités qui leur sont associées (…). Ces deux conditions sont indispensables à la parité de participation » (Fraser, 2005, p. 53).
En axant la justice sociale sur la norme de parité de participa-tion, Fraser réussit à construire une théorie de la justice sociale bidimensionnelle qui englobe à la fois la redistribution et la reconnaissance sans réduire l’une à l’autre. Néanmoins, le prin-cipe de parité de participation ne peut être appliqué si l’on ne spécifie pas l’arène de participation sociale en cause, et l’ensemble des participants pouvant prétendre de plein droit à la parité en son sein, d’où le fait qu’« une telle approche doit en outre être historique » (Fraser, 2005, p. 57 ; p. 89).
Dignité et humiliation : La société décente
… la discrimination dans la distribution de biens et de services est une forme d’humiliation
Dans La société décente, le philosophe israélien Avishai Margalit s’intéresse aux manières dont les institutions sociales influencent les manifestations de la dignité humaine. Tout en se défendant de construire une théorie de la société décente, il interroge les condi-tions nécessaires pour construire une société décente dans le sens d’une société dont les institutions n’humilient pas les individus, et il étudie les manières dont celles-ci par leurs règlements, leurs lois ou leur application produisent une humiliation institutionnelle.
Pour cela, il part du postulat que « la dignité est l’expression du sentiment de respect qu’ont des individus à l’égard d’eux-mêmes en tant qu’êtres humains » (Margalit, 2007, pp. 56-57). Plus préci-sément, la dignité constitue l’aspect extérieur ou l’expression du respect de soi-même à travers le comportement. L’auteur décrit donc la dignité comme une tendance comportementale témoi-gnant d’une attitude de respect envers soi-même. À partir de là, il définit l’humiliation « comme les attitudes humiliantes qui violent la dignité de la victime » (Margalit, 2007, p. 57), c’est-à-dire les attitudes des autres à l’égard du sujet empêchant une expression du respect envers soi-même.
39
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
Précisant sa pensée en spécifiant qu’« humilier quelqu’un c’est souvent traiter un être humain comme un non-humain » (Margalit, 2007, p. 89), Margalit distingue quatre manières prin-cipales de traiter les humains comme des non-humains : les traiter comme des objets, comme des machines, comme des animaux et comme des sous-humains, notamment en traitant les adultes comme des enfants. Ce qui le conduit à formuler la thèse suivante : « l’humiliation présuppose habituellement l’humanité de celui qui est humilié. Le comportement humiliant rejette l’autre comme non humain, mais l’acte de rejet présuppose que c’est un individu qui est rejeté » (Margalit, 2007, p. 108).
L’auteur distingue aussi différents types d’humiliation, tels que l’« humiliation institutionnelle » qui est à distinguer de l’hu-miliation résultant de relations personnelles. Cette distinction est basée sur la nature du rejet, où dans le cas de l’« humiliation ins-titutionnelle » l’humiliation correspond au rejet de groupes d’in-clusion légitimes (Margalit, 2007, p. 133). Dès lors, l’humiliation est le rejet d’un groupe d’inclusion ou le rejet hors d’un tel groupe d’une personne qui a le droit légitime d’y appartenir, par exemple un groupement religieux, une minorité ethnique, une classe sociale… Considérant le cadre de l’État-nation comme remplis-sant la fonction de groupe d’inclusion de ses citoyens, et offrant ainsi un cadre « naturel » pour discuter de la société décente, celle-ci correspond alors selon Margalit à une société sans citoyens de deuxième classe (Margalit, 2007, p. 147).
La citoyenneté dans une société décente doit être égalitaire pour ne pas être humiliante. Le sentiment qui accompagne la citoyenneté de deuxième classe ne découle pas seulement du fait d’être un citoyen de deuxième classe, mais aussi de celui d’être considéré comme un être humain de deuxième ordre (Margalit, 2007, p. 150).
L’intérêt du concept de citoyenneté de deuxième classe pour penser la question de l’humiliation réside dans les sentiments qui l’accompagnent, c’est-à-dire selon l’auteur « d’être considéré comme un être humain de deuxième ordre » (Margalit, 2007, p. 150). La catégorie de citoyenneté de deuxième classe constitue un rejet des êtres humains en tant que citoyens bien sûr, mais
40
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
aussi en tant qu’« êtres pleinement développés » (Margalit, 2007, p. 150).
S’intéressant à l’aspect symbolique de la citoyenneté sociale, Margalit décrit la société décente comme « une société qui n’ex-clut aucun groupe de citoyens de la citoyenneté symbolique. Il n’existe pas de citoyens de deuxième classe au niveau symbo-lique » (Margalit, 2007, p. 153). Concrètement, pour l’auteur, la richesse symbolique d’une société incarnée par un État corres-pond aux symboles utilisés pour créer des sentiments d’identifica-tion des citoyens à l’État. Ces mêmes symboles résulteraient d’un processus historique organique, et on pourrait rajouter ici spéci-fique à chaque société, à chaque État. Margalit attire l’attention sur le fait que ces symboles unissant la majorité, et créant un senti-ment de profonde identification avec le pays, sont bien souvent dirigés contre un groupe minoritaire (voire plusieurs) au sein du même pays. Ces symboles sont ainsi susceptibles de provoquer chez les membres d’une minorité le sentiment d’être activement rejetés par la société. Il peut s’agir, par exemple, du droit d’un groupe minoritaire d’avoir son langage reconnu comme un langage offi-ciel de l’État3.
II | La reconnaissance à l’épreuve des sciences sociales…
Dans le prolongement des réflexions philosophiques sur la reconnaissance, une certaine effervescence s’est emparée du champ des sciences humaines et sociales pour s’approprier et confronter à des recherches empiriques des réflexions principalement éla-borées dans le champ de la philosophie politique, sociale et morale. L’objectif de ces travaux est de saisir la pleine mesure de
3. Si nous avons choisi de nous concentrer dans ce chapitre sur les auteurs originaux des théories de la reconnaissance, il est difficile ici de ne pas citer le philosophe français Emmanuel Renault. Dans Mépris social (2001) et L’expérience de l’injustice (2004), l’auteur s’attache à faire une radicalisation politique de l’œuvre d’Honneth, et à définir des formes de déni de reconnaissance en y incluant le rôle des institutions. Sans pour autant expliciter les détails de sa pensée, comme pour les autres auteurs, nous ne manquerons pas de nous y référer plus en avant dans le texte.
41
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
l’ampleur des bouleversements survenus depuis un quart de siècle dans les enjeux et les modalités des luttes sociales, à savoir le pas-sage du langage de l’avoir, la possession, la matérialité et l’ob-jecti vité au registre de l’être, de l’identité et de la subjectivité (Caillé, 2007, p. 5).
Ces ouvrages partent ainsi du constat de la récurrence et de la banalité du mot reconnaissance :
… il désigne tout un ensemble d’expériences a priori de natures assez différentes. Les travailleurs mal payés et qui se sentent même parfois exploités, les travailleurs dont le travail enrichirait d’autres qu’eux-mêmes (…) Les pompiers ne se sentent pas « reconnus » parce que leur régime de retraite ne « reconnaît » pas les risques du métier, les intermittents du spectacle ne sont pas reconnus comme artistes quand se négocient de nouvelles règles d’indemnisation du chômage, les ouvriers d’Alsthom ne sont pas reconnus quand leur est refusée une augmentation de salaire… et la liste de ces reconnais-sances est quasiment inépuisable (Dubet, 2007, pp. 18-19).
Nous chercherons justement ici à dépasser cette « banalité » pour saisir concrètement comment penser la reconnaissance, et plus précisément la dignité comme un phénomène social comme un autre, dans le cadre de la lutte sociale organisée du mouvement social des Sans Terre du Brésil.
Parmi les travaux réalisés, certains se distinguent, comme ceux du Mouvement Anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS) et du laboratoire du SOPHIAPOL, et plus particulièrement du sociologue français Alain Caillé. Celui-ci propose de repenser la sociologie économique, et la sociologie d’une manière générale, à partir de la théorie de la quête de reconnaissance (Caillé, 2007, pp. 185-208). Dans une perspective sociologique du don4, il pro-pose en effet d’appliquer la théorie du système de la triple obliga-tion du don « donner, recevoir et rendre » aux différentes sphères de la théorie de la reconnaissance d’Honneth. Cette approche est
4. Marcel Hennaf se livre à une entreprise similaire dans « Anthropo-logie du don : genèse du politique et sphères de reconnaissance » in Caillé A. et Lazzeri C. (dir.), La reconnaissance aujourd’hui, Paris, CNRS Éditions, 2009.
42
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
particulièrement pertinente car elle permet de saisir les enjeux de reconnaissance portant par exemple sur l’intégration dans la société de personnes au chômage et des interactions entre les assistantes sociales et les demandeurs d’emploi, comme certains travaux les ont étudiés5. Cependant, comme nous allons le voir, cette démarche a ses limites et n’est pas forcément la plus adaptée pour penser la spécificité de l’objet « lutte sociale » dans le contexte social brésilien.
En effet, dans sa description des sphères de reconnaissance, Caillé opère un glissement puisqu’il décrit la troisième sphère comme une « sphère de la coopération sociale » alors qu’Honneth la qualifie de « solidarité ». Ceci lui permet de l’assimiler à la divi-sion du travail6 et d’articuler les prémices de la théorie du don de Mauss en évoquant la question de l’estime comme un mérite lié au prorata de notre contribution productive et de notre efficacité (Caillé, 2007, p. 10). Si certes, le travail et la capacité des sujets à s’adapter au marché font partie des caractéristiques qui per-mettent d’exister en tant qu’individu dans la modernité comme l’a montré C. Taylor, ce glissement de Caillé nous oriente forte-ment vers des thématiques liées à la reconnaissance au travail, ou par le travail. Cependant, l’idée de solidarité d’Honneth inspirée de la question de la vie éthique ou « éthicité » d’Hegel ne limite à aucun moment de sa démonstration cette sphère à la thématique du travail. Comment comprendre dès lors la complexité des ques-tions liées au multiculturalisme ou aux luttes féministes autre-ment que par le biais du travail, alors qu’il s’agit de questions qui débordent largement ce domaine et portent justement sur les cultures, les valeurs en présence et les logiques du « vivre-ensemble »7.
Examinant l’humanitaire au regard des théories de la recon-naissance, Francine Saillant souligne elle aussi les limites des approches du don, sans pour autant nier la présence du don, en
5. À ce sujet lire Csupor I., Lambelet A. et Ossipow L., 2008, De l’aide à la reconnaissance. Ethnographie de l’action sociale, Genève, IES éditions.
6. Cette assimilation correspond en fait plus véritablement aux idées de Mead que d’Honneth par rapport à cette sphère.
7. Les auteurs précédemment étudiés (Honneth, Fraser, Taylor et Margalit) illustrent assez bien cette idée.
43
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
précisant que l’objet « humanitaire » est « trop complexe et multi-forme pour se laisser saisir par ce seul angle d’approche » (Saillant, 2007, p. 9). Si ces études ont l’avantage de prendre en compte le point de vue des acteurs des circuits humanitaires étudiés, elles ne permettent pas vraiment de saisir dans une même analyse l’en-semble des significations de l’action humanitaire (Saillant, 2007, p. 14).
En résumé, en se focalisant sur le travail, Caillé évacue ainsi l’importance du modèle de valeur culturelle comme critère d’éva-luation de l’estime des sujets. Sans pour autant dénier ou minimi-ser l’importance du travail, ni l’intérêt de cette approche, il nous semble plus pertinent de déplacer la réflexion sur le plan des valeurs culturelles partagées dans la société, parmi lesquelles le travail peut lui-même être un étalon de l’estime de soi.
Parmi les autres travaux significatifs de chercheurs en sciences sociales ayant « mis à l’épreuve » le concept de reconnaissance issu de la philosophie politique, figure l’ouvrage La reconnaissance à l’épreuve. Explorations socio-anthropologiques. Un grand nom bre de chercheurs – une trentaine – y confrontent à la réalité sociale, à partir d’une multiplicité de terrains posant des questions liées à la reconnaissance sociale, les réflexions philosophiques d’Hon-neth, Fraser et Margalit, mais aussi d’Emmanuel Renault8.
L’objectif de cet ouvrage n’est pas d’élaborer une théorie géné-rale de la reconnaissance ou de dresser un inventaire exhaustif de ses usages et de ses formes, mais d’éprouver le caractère opéra-toire de la notion en la soumettant à des analyses de situations concrètes par des chercheurs en sciences sociales, sociologues ou anthropologues. Le résultat est donc de l’ordre d’un état des lieux et, malgré un travail extrêmement riche, l’aspect pluriel et parti-culièrement varié de cette collaboration ne se révèle pas utile dans la recherche d’outils précis pour appréhender l’objet mouvement social et construire une méthodologie et une ethnographie adap-tées à cet objet. En effet, aucune contribution n’aborde spécifique-ment le cadre d’une lutte sociale organisée en mouvement social, aucune ne fournit d’outil précis, mais formule un ensemble de
8. Les écrits du philosophe Emmanuel Renault portent sur des questions de qualifications des expériences d’injustice.
44
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
questions à aborder pour mieux comprendre la reconnaissance dans sa complexité.
Certains points de ces études nous semblent cependant impor-tants à relever. Le premier, soulevé par un grand nombre d’au-teurs, concerne les limites et les difficultés d’application du modèle honnethien des sphères à la complexité de la réalité du terrain. Comment hiérarchiser l’importance des sphères ? Com-ment ethnographier les sphères concrètement ? Le deuxième point concerne l’opposition de Nancy Fraser et d’Axel Honneth. En effet, là aussi, la majorité des auteurs opèrent un choix entre l’un ou l’autre de ces auteurs, et la question qui se pose alors est celle de la possibilité de l’articulation des deux approches, et sinon du choix entre les deux : pourquoi ? comment ?
Afin de s’inscrire dans une démarche ethnographique, il nous semble qu’une recherche anthropologique se doit d’être réalisée dans une approche inductive et qu’il faut attendre que les réponses à ces questions proviennent du terrain. Enfin, étant donné la plu-ralité et la complexité qui ressort de ces études, il nous paraît véritablement nécessaire de définir, dans notre cas, le cadre socio-historique et la spécificité de la construction de la nation brési-lienne.
Avant de passer en revue quelques études permettant d’affiner l’approche de notre recherche, il est cependant important de citer ici la contribution de Francine Saillant dans La reconnaissance à l’épreuve. Explorations socio-anthropologiques, car elle fait appa-raître une nuance en soulevant la question de l’articulation des deux niveaux d’approche de la reconnaissance. En effet, l’auteure montre comment les pratiques de « témoignages » des organisa-tions humanitaires ont permis de développer une forme inédite de « reconnaissance délocalisée » pour des « victimes » mises en scènes, tout en soulevant dans le même temps la nécessité d’« ac -tions plus localisées » pour accomplir le « processus de reconnais-sance ». Cette remarque soulève assez bien la question de l’articulation de la reconnaissance au niveau des institutions, et au niveau des sujets concernés. Mais nous reviendrons sur les tra-vaux de Francine Saillant, dans la partie suivante de ce chapitre, et en particulier sur son ouvrage Identités et Handicaps. Circuits humanitaires et post-humanitaires. La dignité comme horizon.
45
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
Respect, dignité et reconnaissance au Brésil. Le discours du respect : expériences brésiliennes et réflexion sur la reconnaissance
Pour clore cette introduction au champ des travaux sur les questions de reconnaissance et de dignité, nous allons évoquer des études sur le discours du respect au Brésil, réfléchir sur l’ap-plicabilité des réflexions de la reconnaissance dans le contexte social brésilien, et enfin aborder les travaux de Francine Saillant avec Identités et Handicaps.
Dans son article A linguagem do Respeito. A Experiência Brasileira e o Sentido da Cidadania nas Democracias modernas, Dominique Vidal réalise une sociologie de la reconnaissance à partir d’un terrain brésilien. Il y dénonce la manière dont les sciences sociales se focalisent de façon quasi exclusive sur la ques-tion des inégalités économiques, occultant ainsi des dimensions essentielles de la citoyenneté démocratique. S’appuyant sur des recherches menées dans les villes de Recife et de Rio de Janeiro auprès de domestiques sollicitant la justice contre leurs patrons, l’auteur montre que derrière ces actions en justice le sentiment d’appartenir à l’humanité est beaucoup plus important que la réduction de l’inégalité sociale en termes strictement écono-miques (Vidal, 2003, p. 267). Sa réflexion se construit autour du terme respeito (respect) et de son utilisation par les domestiques comme mot-clef du discours sur l’injustice sociale pour exprimer des situations de la vie quotidienne dans lesquelles les comporte-ments des membres des classes supérieures amènent les domes-tiques à se sentir inférieurs.
En effet, pour l’auteur, l’étude des sentiments sociaux, comme le respect ou l’humiliation, constitue une dimension de l’expérience démocratique, et les revendications de reconnaissance s’inscri-vent dans le cadre de la réflexion contemporaine sur la citoyen-neté démocratique moderne. Il existerait ainsi deux terrains principaux de compréhension de la citoyenneté : les conditions effectives de la citoyenneté des groupes sociaux diversifiés, et la réflexion sur les sentiments sociaux comme le respect et l’humi-liation (Vidal, 2003, p. 282). Le terrain sur lequel s’appuie l’étude
46
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
de Vidal, et le terrain que constitue la lutte sociale du MST sont néanmoins à distinguer étant donné que les domestiques ne cons-tituent pas un mouvement social au sens formel, mais sont plutôt des individus revendiquant leurs droits de manière isolée.
Enfin, point important pour mieux saisir les enjeux des réflexions sur la reconnaissance, Dominique Vidal souligne que la rareté des études sur le respect – ce à quoi on pourrait ajouter les études sur la dignité – est due à une confusion fréquente entre l’exigence de respect, et la défense de l’honneur telle qu’elle est étudiée dans les sociétés méditerranéennes. Il explique ainsi que la différence réside dans le fait que l’identité n’est pas vérifiée par la structure sociale, mais se construit presque toujours à travers un processus d’affirmation de l’individu en relation avec les rôles institutionnels. L’étude du respect se situe donc dans un registre différent de celui de l’honneur et de la honte à la base de l’anthro-pologie de l’honneur qui s’est élaborée à partir d’observations des sociétés appelées méditerranéennes, le sentiment de respect de la société brésilienne n’étant pas le sentiment d’honneur de la Kabylie algérienne, des paysans andalous ou des villageois de l’Albanie (Vidal, 2003, pp. 268-269).
Dans une démarche similaire, le philosophe Emmanuel Renault montre, dans Le discours du respect, que l’intérêt de l’appro che en termes de reconnaissance est qu’elle permet de développer une analyse des interactions sociales où les enjeux normatifs dépassent la scène locale de ces interactions, sans pour autant relever de structures macrosociales surplombantes. En effet, « là où une ana-lyse interactionniste d’Erving Goffman conduirait à souligner la dimension située des attentes normatives des individus, la théorie de la reconnaissance explicite des structures institutionnelles générales qui encadrent les attentes de reconnaissance » (Renault, 2007, pp. 176-177), ce qui permet d’échapper aux logiques structu-rales de l’honneur ou à la structuration d’une culture par le prin-cipe du respect.
Et l’auteur de conclure qu’en :
… proposant une théorie des attentes normatives de reconnais-sance et des dynamiques qui surgissent des expériences du déni de reconnaissance, la théorie de la reconnaissance offre des instru-
47
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
ments permettant d’expliquer de manière compréhensive la ratio-nalité morale spécifique de pratiques et de discours marqués par la subalternité (Renault, 2007, p. 179).
Reconnaissance et modernité
Dans son article Nota sobre a controversia Fraser-Honneth informada pelo cenário brasileiro, la politiste Céli Regina Jardim Pinto interroge l’applicabilité des propositions théoriques d’Hon-neth et de Fraser à la société brésilienne. L’apport de sa réflexion se situe à deux niveaux : elle permet de dépasser l’opposition Honneth-Fraser, et pose la question de l’applicabilité de théories élaborées à partir de réflexions sur des sociétés « modernes » dans le contexte social brésilien.
Pour ce faire, elle revient sur la fameuse controverse mise en scène entre les deux théories et affirme qu’il existe une fausse antithèse entre Fraser et Honneth9. Elle soutient même qu’il peut être hautement positif, dans la perspective de la construction d’une théorie normative de la justice, de retenir les meilleurs élé-ments de chaque théorie en relation avec la situation brésilienne. Identifiant ainsi une liste de six points qui peuvent fonctionner comme des hypothèses contraires à l’incompatibilité des théories (Pinto, 2008, p. 36), parmi lesquels l’opposition liée à la différence de focale entre Honneth qui pense la reconnaissance comme « auto-reconnaissance » (estime de soi) et Fraser qui la construit comme une question de statut. En effet, pour Céli Pinto, ces deux formes de la reconnaissance ne s’excluent pas, mais constituent des moments distincts d’élaboration théorique et de lutte poli-tique qui dans certaines circonstances peuvent apparaître comme complémentaires. L’autre hypothèse abordée par la politiste qui permet de repenser les apports d’Honneth et de Fraser à la situa-tion brésilienne est la suivante : la reconnaissance comme poli-tique publique d’État ne dépend pas de l’auto-reconnaissance des sujets individuels, mais est limitée à une gamme spécifique de
9. Fraser et Honneth ont eux-mêmes mis en scène cette antithèse dans Fraser N. et Honneth A., 2003, Redistribution or recognition ? A political-philosophical exchange, Londres, Verso.
48
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
« remèdes » au sens de Fraser. Cette hypothèse est importante en ce qu’elle permet d’interroger l’articulation entre les deux types de reconnaissance et pointe les limites de la reconnaissance comme politique publique en montrant que celle-ci n’entraîne pas for-cément l’auto-reconnaissance. Un troisième point soulevé par l’auteure que nous souhaitons souligner ici est le fait que la recon-naissance comme « auto-reconnaissance » est essentielle pour la construction du sujet de l’action dans la lutte sociale, au sens où le dominé opposé à la domination n’existe que s’il se pense comme tel (Pinto, 2008, p. 36). Ce qui revient à dire que la « parité de participation » de Fraser n’est possible qu’après que le sujet se soit auto-reconnu comme égal. Il s’agit ainsi pour la politiste de penser la question de l’auto-reconnaissance du sujet et de la reconnaissance en termes de politique publique comme deux moments distincts de la reconnaissance.
Pour expliciter ses propos sur l’insuffisance d’une loi formelle et les limites de la théorie de Fraser sur la distribution juste et le respect des valeurs culturelles, Céli Pinto rappelle que chez la philosophe la participation paritaire est censée être l’accomplisse-ment des principes libéraux accordés dans les pactes constitution-nels des démocraties modernes. Cependant, la réalité résiste à cette théorie dans le cas des travailleurs ruraux, comme dans les cas des autres mouvements sociaux revendiquant une dignité – MIR, Dalit… dans le sens où les limites de leur participation paritaire effective ne résident pas dans la Constitution ou la loi, mais dans leur application.
La politiste interroge aussi les conditions d’application des théo-ries d’Honneth, Fraser et Taylor dans le contexte social brésilien en se demandant comment transposer des réflexions cons truites à partir de réalités de sociétés modernes occidentales à la société bré-silienne, définie par de nombreux travaux comme « hybride »10, c’est-à-dire possédant à la fois des composantes de la modernité et des composantes de ladite « pré-modernité ». En effet, Honneth et Fraser (et même Taylor) partent de la situation de bien-être social de l’Europe et des États-Unis pour débattre des notions de
10. À ce sujet lire les travaux de Roberto Da Matta Carnavais, malandros e heróis et Nestor Garcia Canclini, Culturas híbridas.
49
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
distribution et de reconnaissance, ce qui conditionne la forme dans laquelle les questions de distribution et de richesse vont être pen-sées. Dans le cas du Brésil, il y a pour Céli Pinto un sérieux déficit de bien-être social puisque de grandes parties de la population sont exclues de la possibilité de se constituer comme sujets de lutte pour la distribution et la reconnaissance, que ce soit en termes de statut ou d’auto-reconnaissance.
En effet, d’après l’auteure, la spécificité du Brésil est que l’iné-galité citoyenne est constitutive du capitalisme moderne au sens d’une non-reconnaissance de l’égalité devant la loi, tant des couches supérieures de la population que des couches les plus pauvres : tous s’auto-identifient comme inégaux, la grande majo-rité, et principalement les pauvres, ne se sentent pas citoyens porteurs de droits. Ceci pose donc un réel problème d’adéquation et de concrétisation du principe d’égalité rendu possible par la parité de participation, telle que pensée par Nancy Fraser (Pinto, 2008, p. 56). En effet, comment arriver à l’égalité participative si les citoyens ne se reconnaissent pas comme des égaux ?
En résumé, dans les scénarios de grande pauvreté et d’inégalité sociale, la polémique Fraser-Honneth prend donc un autre sens dans la mesure où la notion de reconnaissance reste plus limitée à une reconnaissance externe : celui qui reconnaît agit sans forcé-ment construire une relation avec le reconnu, c’est-à-dire sans le processus d’auto-reconnaissance de la théorie d’Honneth. La politiste prend ici pour exemple les grands programmes d’assis-tance de l’ONU… (Pinto, 2008, p. 48) et, dans le même esprit que l’auteure, on pourrait se demander ce qu’il en est dans le cas d’un mouvement social.
Enfin, l’auteure souligne combien abandonner une approche en faveur de l’autre appauvrirait les qualités heuristiques et nor-matives qui peuvent être trouvées dans la combinaison des deux. Une approche complémentaire dans le cas de la société brési-lienne est donc fondamentale, car elle ne réduit pas la distribution à la reconnaissance et, en même temps, elle ne limite pas la recon-naissance à l’auto-reconnaissance (estime de soi), ou à la politique de statut (Pinto, 2008, p. 57). C’est pourquoi nous ne privilégie-rons pas dans cette recherche une approche au détriment d’une autre, mais nous nous en remettrons simplement au terrain, et
50
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
aux différents aspects présents dans l’analyse du discours et des pratiques du MST.
Dignité, Droits Humains et Citoyenneté
… une citoyenneté [qui] passe à la fois par le droit, la justice redis-tributive, mais aussi par l’idée de dignité (Saillant, 2007, p. 22)pas de l’aide mais de la dignité, des droits et de la citoyenneté (Saillant, 2007, p. 362)
Dans Identités et handicaps, étudiant les enjeux de reconnais-sance liés aux circuits humanitaires à partir d’actions d’ONG internationales et locales brésiliennes, Francine Saillant fait appa-raître les liens existant entre dignité, droits humains et citoyen-neté. « […] s’il y a une forme de reconnaissance inscrite dans le droit… » (Saillant, 2007, p. 376) cette étude permet de saisir que son analyse ne peut se limiter au domaine du droit, car « des droits effectifs peuvent exister sans toutefois que ces droits soient appliqués, soit parce que l’État ferme les yeux sur ces derniers, soit parce que les personnes elles-mêmes ne connaissent pas ces mêmes droits » (Saillant, 2007, p. 150). À l’instar de Vidal dans son étude sur le respect au Brésil, basée sur les réflexions de Margalit autour de l’humiliation, l’anthropologue montre les liens existant entre le domaine du sensible et des enjeux de citoyenneté qu’elle décrit comme une « question incontournable dans le Brésil actuel » (Saillant, 2007, p. 38), et elle affirme que la « conquête de droits juridiques, [est] aussi une façon de trouver une meilleure image de soi ». Enfin, Francine Saillant énonce les conditions de la dignité, au sein desquelles on peut lire en filigrane les deux niveaux de réflexion d’Honneth et Fraser : « Être reconnu en tant que sujet distinct et porteur de différences irréductibles, et pouvoir en même temps accéder aux biens économiques tout en ayant un espace de parole sont également des conditions de la dignité » (Saillant, 2007, p. 368). L’auteure termine ainsi son ouvrage en soulignant la complexité d’une analyse de la reconnaissance sociale et en montrant qu’il est de fait nécessaire en anthropologie de ne pas se limiter à une seule approche, mais bien d’être attentif aux niveaux de la reconnaissance présents dans le terrain étudié.
51
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
Si la lutte du MST se construit aussi dans le domaine des droits humains – en particulier dans la dénonciation du « travail esclave » comme une atteinte à la dignité des travailleurs, nous nous foca-liserons dans cet ouvrage sur les pratiques développées pour res-taurer la dignité, afin de nous concentrer essentiellement sur les processus de la reconnaissance en soi et sur le domaine des senti-ments (collectifs), mettant de côté pour l’instant la question du « témoignage » comme « reconnaissance délocalisée » développée par Francine Saillant. Il ne s’agira donc pas ici de déconsidérer les pratiques de dénonciation de situations injustes et intolérables visant à rendre ces dernières visibles dans l’espace public, mais plutôt de les aborder à partir des pratiques spécifiques dévelop-pées par le MST. Notre étude de la dignité ne privilégiera donc pas forcément la lutte des droits humains de facto, cet « ensemble de moyens élaborés en Occident pour donner un cadre légal et pra-tique à [la] dignité » (Saillant, 2007, p. 350), mais concernera les modalités spécifiques pratiques de sa conquête et leurs consé-quences, au sein du MST.
III | De la recherche : dignité, revendication et « Cultura »
Si la question centrale et à l’origine du MST est bien la ques-tion du combat contre la pauvreté spécifique de la population des travailleurs ruraux brésiliens, avec pour solution la réforme agraire, la notion de dignité apparaît néanmoins elle aussi comme centrale dans le projet du mouvement social. Elle est successive-ment présentée comme la base du projet du mouvement et un des objets de sa lutte dont l’acquisition constituerait une révolution pour les travailleurs ruraux. Bien avant la parution du livre de Stéphane Hessel Indignez-vous ! et l’apparition des mouvements d’indignés en Europe ou aux États-Unis, la notion de dignité est progressivement apparue à différents niveaux du registre discursif du mouvement social. C’est ainsi que dès la première page du site internet du MST à la rubrique de présentation du mouvement « Quem somos (Qui sommes-nous) », on la retrouve explicite-ment comme étant à la base du projet du mouvement social :
52
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
Aujourd’hui, au bout de 22 ans d’existence, le MST pense que son rôle en tant que mouvement social est de continuer à organiser les pauvres dans la campagne, en leur faisant prendre conscience de leurs droits et en les mobilisant pour qu’ils luttent pour des change-ments. Dans les 23 états dans lesquels le MST agit, la lutte n’est pas uniquement pour la Réforme Agraire, mais aussi pour la construc-tion d’un projet populaire pour le Brésil, basé sur la justice sociale et la dignité humaine11.Le rôle du MST est ici présenté comme relevant de l’organisation des pauvres dans la campagne, de leur conscientisation quant à leurs droits et de leur mobilisation dans la lutte pour le changement. L’objectif de la lutte est un projet populaire qui dépasse la réforme agraire et se base sur la justice sociale et la « dignité humaine ».
De la même manière, dans la partie consacrée à la présentation de ses luttes et ses conquêtes – « Nossas lutas e conquistas (Nos luttes et nos conquêtes) » –, la dignité est présentée comme un des aspects que la lutte du MST vise à améliorer, au même titre que le travail, l’éducation et la santé :
Dans ce contexte, le MST cherche à contribuer à la lutte de ces familles pour leur morceau de terre. Pour cela, nous sommes atta-qués par des secteurs conservateurs et patrimonialistes de la société brésilienne, qui utilisent divers instruments pour combattre notre Mouvement et tous ceux qui luttent pour la Réforme Agraire. Ils poursuivent ceux qui luttent pour la pleine réalisation des droits sociaux garantis dans la Constitution et pour des mesures d’amélio-ration des conditions de vie du peuple brésilien, comme l’école, la santé, le travail et la dignité12.
En plus de ces références à la dignité dans le discours « virtuel » du mouvement, d’autres allusions sont aussi présentes dans les discours et slogans officiels « réels ». C’est le cas du discours de la cérémonie d’ouverture du 5e Congrès national du MST qui s’est déroulé dans la capitale de Brasilia le 11 juin 2007, qui a regroupé quinze mille personnes et au cours duquel la membre de la
11. Source site internet du MST, le 25/03/2013 : http://www.mst.org.br/node/1139.
12. Source site internet du MST, le 25/03/2013 : http://www.mst.org.br/node/8629
53
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
Direction Nationale Marina dos Santos a conclu son discours par la formule : « des personnes dignes ! Ça, c’est révolutionnaire ! »
Nous ne devons pas avoir peur d’être qualifiés de révolutionnaires, car grâce à notre lutte et notre organisation nous voyons des milliers de personnes qui avant avaient faim et aujourd’hui s’alimentent abondamment tous les jours. Nous voyons des centaines de per-sonnes qui avant étaient analphabètes, qui n’avaient jamais eu l’op-portunité de s’asseoir sur un banc de l’école, qui aujourd’hui lisent, écrivent et beaucoup d’entre nous, fréquentent l’université. Nous voyons des personnes qui avant étaient dans un état de profonde dégradation sociale, et qui aujourd’hui cultivent des valeurs essen-tielles à la vie de tout être humain, comme l’amour, la solidarité, la coopération, l’attention. Des gens dignes ! Ça c’est révolution-naire !!!!!!!!13
L’intérêt de saisir le discours du MST sur la dignité comme une entrée privilégiée est qu’elle permet justement de comprendre la problématique des inégalités sociales non pas exclusivement dans une perspective économique, mais dans une perspective morale ou affective en incluant les manières de vivre et de ressen-tir la hiérarchisation sociale.
L’expression explicite dans les revendications de la dignité du MST comme une des dimensions d’un projet global de société pour le Brésil, en association avec la justice sociale, soulève un certain nombre de questions : Comment conquérir ou acquérir de la « dignité » ? Que recouvre le terme de « dignité » dans le discours du MST ? À quelles situations réelles correspond l’absence de dignité qui motive ses revendications ? Comment comprendre la dignité en dehors d’une définition normative, c’est-à-dire en cohérence avec la réalité des personnes pour qui elle est revendi-quée, à savoir les travailleurs ruraux du Brésil ? Le MST a-t-il développé des pratiques spécifiques pour conquérir cette dignité ?
Un aperçu rapide des différents domaines d’action du mouve-ment social permet de faire émerger des éléments de réponse à ces
13. Discours d’ouverture de la dirigeante nacionale Marina Dos Santos accessible en ligne le 25/03/2013 au lien : http://www.mst.org.br/jornal/273/artigo
54
LA R
ECO
NN
AIS
SAN
CE
SOC
IALE
ET
LE M
OU
VEM
ENT
DES
SA
NS
TER
RE
DU
BR
ÉSIL
questions. En effet, parmi ses différents domaines d’action figure celui de la « Culture », au sein duquel la dignité, associée à la fierté, est présentée comme résultant de l’éducation, de l’accès à la culture, à la connaissance et aux savoirs populaires :
L’éducation et l’accès à la culture, à la connaissance, à la valorisation des savoirs populaires est la condition fondamentale pour la « réali-sation » des Brésiliens comme des êtres humains pleins, dignes et fiers. Nous voulons la démocratisation et la popularisation de la culture dans le pays. Fortifier les espaces d’échanges culturels pro-mouvant l’accès populaire au théâtre, cinéma, aux expositions, représentations musicales, représentations folkloriques et fêtes tra-ditionnelles qui célèbrent la vie, la lutte, la solidarité et la diversité du peuple brésilien14.
Objectif clair de la lutte du MST, la dignité participe donc au même titre que la fierté à la réalisation des Brésiliens comme des « êtres humains à part entière ». La dignité revendiquée par le MST pour rendre possible cette réalisation serait donc acquise par l’accès à l’éducation, à la culture, à la connaissance… Si le rôle et la place de la dignité dans la lutte du MST se précisent, la manière de l’observer et d’en réaliser une ethnographie concrète reste cepen-dant à définir. Y a-t-il des pratiques spécifiques réalisées dans le cadre du mouvement social visant explicitement à acquérir une dignité ? Ou alors, s’agit-il d’un ressenti des travailleurs ruraux résultant de l’accumulation des aspects cités plus haut ?
Les domaines d’action évoqués précédemment constituent autant de « fronts » (traduction littérale de frentes) du MST portés par des « Secteurs » constitués de membres responsables du déve-loppement des réflexions et des actions en relation avec le domaine d’action en question. Correspondant au domaine dédié à la Culture, le Setor de Cultura a pour objectif de développer des réflexions et des pratiques spécifiques afin de construire le projet politique du MST en mobilisant la culture. Le texte précédem-ment cité donne la trame du cadre général des actions réalisées dans le Setor de Cultura, à savoir une « démocratisation et popu-larisation de la culture dans le pays ». La culture, et surtout l’accès
14. Site internet du MST, le 25/03/2013 : http://www.mst.org.br/node/7676
55
PEN
SER
LA
DIG
NIT
É EN
AN
THR
OP
OLO
GIE
à cette dernière, y est présentée comme étant un élément clé de la « réalisation des Brésiliens en tant qu’êtres humains à part entière, dignes et fiers ».
Les activités réalisées au sein du Setor de Cultura constitueront donc le cœur de la recherche de terrain que nous présenterons dans cet ouvrage afin de mieux comprendre ce que recouvre le terme de « dignité » tel qu’il est utilisé spécifiquement par le MST : comment ces activités permettent-elles, ou non, de conquérir une « dignité » ? Pourquoi ? Quelles sont les spécificités de ces pra-tiques ? De quelle « culture » parle-t-on ? Mais aussi, comment une anthropologie de la lutte pour la dignité pourrait-elle nous per-mettre, ou non, de mieux comprendre les mécanismes, logiques et enjeux des processus de construction, de maintien et de négocia-tion d’une hiérarchie sociale ?
Cette étude sera donc basée sur nos recherches ethnogra-phiques et notre analyse du terrain, et s’attachera principalement à observer, étudier et analyser le discours et les pratiques liés à la dignité dans le cadre de la lutte du MST. Nous chercherons ainsi à comprendre les objectifs que recouvrent ces discours et ces pra-tiques, leur sens pour les travailleurs ruraux, comment ils se situent dans la lutte du MST pour une justice sociale et surtout dans la négociation de cette justice avec la société brésilienne.
Ceci en cherchant à nous concentrer sur les aspects moraux des pratiques développées par le MST, et sur les manières dont ses pratiques spécifiques sont pensées et vécues par les membres du mouvement social. Nous tenterons aussi de comprendre le sens de ses pratiques en les contextualisant dans les arènes publiques où elles s’expriment. De la même manière, dans le cas précis de la lutte pour la reconnaissance du MST, nous nous attacherons à saisir « comment reconnaître ? » et « qu’est-ce que la reconnais-sance ? », en fonction de la spécificité des expériences d’humilia-tion des travailleurs ruraux. Pour répondre à cette interrogation, nous nous en remettrons aux observations faites sur le terrain et aux entretiens réalisés avec les travailleurs ruraux impliqués dans les pratiques du Setor de Cultura.
Enfin, nous interrogerons les conditions de constitution du sujet de la lutte au sein des pratiques du MST, et nous nous demanderons ce que signifie être « Sans Terre ».