L’influence du Code de commerce français au Brésil (Quelques remarques sur la commémoration du...
Transcript of L’influence du Code de commerce français au Brésil (Quelques remarques sur la commémoration du...
R.I.D.C. 1-2007
L’INFLUENCE DU CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
(Quelques remarques sur la commémoration du bicentenaire du Code français de 1807)
Iacyr de AGUILAR VIEIRA∗ Gustavo VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA∗∗
« Partout enfin nous retrouvons et nous voyons s’exercer ce mouvement qui a pour but de mettre la science au niveau des faits, de régler leur action au moyen des lois, d’en fixer les principes et de leur donner une sanction légale. À une époque (…) où le commerce est une puissance qui tend toujours à s’accroître, et qui, embrassant à la fois les intérêts publics et privés, semble diriger toutes les autres, à une époque enfin où les communications rapides et nombreuses demandent sûreté et protection, cette révision de lois, de statuts, d’usages, de coutumes, n’était-elle donc pas impérieusement exigée et la codification ne doit-elle pas devenir une règle générale et absolue au milieu des relations nombreuses que la civilisation fait éclore ? »1.
L’influence du Code de commerce français de 1807 au Brésil, notamment sur
l’élaboration du Code de commerce brésilien de 1850, mérite d’être rappelée à l’occasion de son 200ème anniversaire. Même si le Code Napoléonien était au cœur de la codification
∗ Professeur à l’Universidade Federal de Viçosa, Brésil ; Docteur en droit, Université Robert
Schuman, Strasbourg III. ∗∗ Doctorant en droit, Université Robert Schuman, Strasbourg III /Universidade de São Paulo,
Brésil ; D.E.A. en droit international, Université Robert Schuman, Strasbourg III ; Diplômé de la Faculté Internationale de Droit Comparé de Strasbourg ; Avocat aux Barreaux de Porto Alegre et Vitória, Brésil. Les auteurs remercient vivement Mlles Sophie Huguenet et Bénédicte Harder pour leurs apports dans la révision finale du français.
1 A. de SAINT-JOSEPH, Concordances entre les Codes étrangers et le Code de commerce français, 2e éd., Videcoq, 1851, p. XVII.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
28
commerciale brésilienne, le législateur n’était pas insensible à d’autres influences, ce qui a permis l’élaboration d’un Code commercial présentant des traits qui le distinguent de son œuvre inspiratrice. Cette même ouverture d’esprit de la culture juridique brésilienne, alliée au processus de décodification du droit commercial vérifié dans les deux pays aux cours des années, a permis une évolution du droit commercial brésilien de manière assez indépendante des solutions proposées par le droit commercial français constamment réformé. À l’heure actuelle, l’influence du droit commercial français et de son code récemment renouvelé sur le droit commercial brésilien est moins expressive. On remarque que le droit commercial brésilien, marqué d’une forte originalité, est le fruit d’une multiplicité d’influences et, semble-t-il, pourrait être dépassé par le nouveau droit de l’entreprise mise en place par le Code Civil de 2002.
The influence of the French Commercial Code of 1807 upon Brazilian Law, in
particular on the drafting of the Brazilian Commercial Code of 1850, must be remembered at the time of its 200th Anniversary. Although the Napoleonic Code was in the heart of the Brazilian codification, the legislator was not insensitive to other influences, which allowed the development of a Commercial Code embracing many backgrounds, with features that distinguish it from its inspiring main reference. Such broadmindedness of the Brazilian legal culture, allied with the commercial law decodification trend, also present in both countries in recent years, allowed the evolution of the Brazilian commercial law in a way quite independent from the solutions suggested by the constantly reformed French commercial law. Nowadays, the influence of the French commercial law, and its recently renewed code, on the Brazilian commercial law is not so impressive. The Brazilian commercial law, characterised by its strong originality, is now the result of its multiple influences and, as it seems, has been moving towards the modern Enterprise Law set forth in its Civil Code of 2002.
INTRODUCTION
Le Code de commerce français fête ses deux cents ans. Son avènement le 15 septembre 1807 n’est pas passé inaperçu aux yeux des législateurs étrangers qui, grâce à l’influence culturelle exercée urbi et orbi par la France pendant les XVIIIe et XIXe siècles, l’ont pris comme référence pour l’élaboration de leurs propres codes et lois commerciaux2.
Parmi ces législateurs se trouvait le législateur brésilien, doté d’un esprit fort cosmopolite et européocentriste à la fois. En effet, au Brésil, comme dans tous les pays d’Amérique Latine, l’influence des droits
2 Ainsi, le Swod russe de 1826 (Partie commerciale, IIe volume), le Código comercial
espagnol de 1829, le Código comercial portugais (Código Ferreira Borges) de 1833, le Wetboek van Koophandel néerlandais de 1838. On n’oubliera pas que, comme il était proposé par ses rédacteurs, le Code de commerce français devait, dès son apparition, conquérir une influence universelle. Applicable à tout l’Empire français, il était encore appelé à régir des pays conquis, comme la Belgique. Par ailleurs, d’autres États souverains à l’époque, tels la Pologne, la Hollande, la Suisse et différents duchés de l’Allemagne, avaient accepté son application sur leur territoire, et leurs juristes se livraient à son étude. Cf. A. de SAINT-JOSEPH, op. cit., p. XII.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
29
européens se fait sentir d’une façon très remarquable3, et a contribué au développement d’une culture juridique dotée d’une très forte originalité4.
En premier lieu, cette influence européenne découle du processus de colonisation qui a suivi les Grandes découvertes des XVe et XVIe siècles. En effet, issu d’une colonisation basée sur le modèle mercantiliste d’échange5, le Brésil a été pendant toute la période coloniale sous l’empire du droit du Portugal. À cette époque, le droit portugais était essentiellement compilé dans les Ordonnances Philippines de 1603 et composé de quelques lois complémentaires, toutes assez lacunaires6. Subsidiairement mais assez largement, on appliquait le droit romain, le Corpus Juris Civilis, dans l’interprétation donnée par les Glossateurs et Postglossateurs, ainsi que le droit canonique. Dans une moindre mesure, le droit portugais était sous l’influence du droit germanique7. Le droit brésilien était donc soumis à une très grande influence du droit portugais8 et classé parmi les droits appartenant à la famille juridique romano-germanique9.
3 C. JAUFFRET-SPINOSI, « Rapport Introductif » in La Circulation du modèle juridique français: journées franco-italiennes, Travaux de l’Association Henri Capitant, vol. XV, Paris, Litec, 1994, pp. 109-120, spéc. p. 109. Consulter également les ouvrages collectifs l’ouvrage collectif : La Codificación : raíces y prospectiva, I – El código napoleón, Educa, Buenos Aires, 2003 ; et La codificación comercial em Iberoamérica in La Codificación : raíces y prospectiva, II – La codificación en América, Educa, Buenos Aires, 2004.
4 R. DAVID, « L’originalité des droits de l’Amérique latine », in R. DAVID, Le droit comparé : droits d’hier, droits de demain, Coll. « Etudes Juridiques Comparatives », A. TUNC (dir.), Paris, Economica, 1982, pp. 161-173.
5 En France, doctrine économique connue sous le nom de Colbertisme (dénomination due au grand homme politique, Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683), qui préconise que la richesse d’un État et par là sa puissance se mesure à la réserve des métaux précieux dont il dispose. Celle-ci à son tour doit être accrûe par un commerce intense et par un développement de l’industrie manufacturière dans un système marqué par un strict protectionnisme et par un interventionnisme de l’État dans tous les domaines.
6 Lors de la découverte du Brésil étaient en vigueur au Portugal les Ordonnances Alphonsines, publiées en 1446 et considérées comme le code le plus ancien de l’Europe moderne (Cf. A. CELSO, Revista de jurisprudência, vol. 9, p. 210). En 1521, celles-ci ont été substituées par les Ordonnances Manuélines, qui sont restées en vigueur jusqu’en 1603, date de la parution des Ordonnances Philippines. Ces dernières sont demeurées en vigueur au Portugal jusqu’en 1867, et au Brésil jusqu’en 1916 et constituaient le droit commun des deux pays. Ces Ordonnances ont eu comme sources le droit coutumier, le droit romain, le code wisigoth (Lex wisigothorum, issue du XIIe Concile de Tolède et confirmée en 693 par le XVIè Concile), les lois publiées par les monarques portugais, le droit canonique, les Partidas de Castella, ainsi que tout le droit justinien et les gloses des codes romains originaires des Universités de Bologne et de Paris. Cf. PONTES de MIRANDA, Fontes e evoluções do direito civil brasileiro, Coll. « Economica e juridica », vol. CCXIV, Rio de Janeiro, 1928, p. 61 et s.
7 G. BRAGA DA CRUZ, Formação Histórica do Moderno Direito Privado Português e Brasileiro, Scientia Iuridica, IV (1954-1955), pp. 32-77, spéc. 34-38(56).
8 Selon PONTES de MIRANDA (Fontes e evolução do direito brasileiro, op. cit., pp. 50-51) il s’agit plutôt d’un phénomène de transplantation que d’une influence. Pour M. RHEINSTEIN (Einführung in die Rechtsvergleichung, Munich, 1987, p. 125, § 16, apud C. LIMA MARQUES, «Das BGB und das brasilianische Zivilgesetzbuch von 1916 », in Auf dem Weg zu einem gemeineuropäischen Privatrecht - 100 Jahre BGB und die lusophonen Länder, Erik Jayme/Heinz-
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
30
En second lieu, les idées d’indépendance et de liberté qui régnaient en Europe, plus particulièrement en France, marquent l’inspiration européenne du droit brésilien. Ces idées ont donné la force intellectuelle nécessaire aux mouvements de libéralisation déclenchés au Brésil. L’indépendance du Brésil fut proclamée le 7 avril 1822 par Don Pedro Ier, fils de Don João VI, alors Roi de Portugal. Cette proclamation n’a pas été suivie de conflits armés, comme ce fut le cas pour les ex-colonies espagnoles. Il y a eu, au contraire, quelques manifestations anti-indépendantistes dans le Nord-Est du Pays, auxquelles les forces de l’ordre ont dû faire face.
Dans ce contexte historique, l’irradiation du droit français sur le droit brésilien a été inéluctable10. C’est d’abord l’idée de codification, signe caractéristique des droits de la famille romano-germanique qui a séduit le droit brésilien, inconsciemment en quête d’affirmation11. Ensuite, et par conséquent, ce sont la doctrine et la jurisprudence françaises qui ont été observées de près par les juristes et par la jurisprudence brésiliens12. Peter Mansel (Hrsg.), Baden-Baden, Nomos-Verl.-Ges., 1997, p. 75, note 11), il y a transplantation (Verpflanzung), lorsqu’un groupe d’émigrants emmène avec lui son droit d’origine dans le nouvel environnement (« Von Verpflanzung kann man sprechen, wenn eine Gruppe von Auswanderern ihr heimatliches Recht in eine neue Umwelt mitnimmt »).
9 R. DAVID et C. JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, 10e éd., Dalloz, pp. 16-18 et 26 s. L.-J. CONSTANTINESCO (Traité de droit comparé, Tome III - La science des droits comparés, Economica, 1983, p. 85) le classe dans le système juridique européen-continental, et plus précisément au sein de la famille latino-américaine, qui présente des caractéristiques communes secondaires dans la mesure où ses ordres juridiques connaissent le dualisme, ayant été influencés par les codes ibériques et européens, par la longue influence du droit, de la langue, de l’administration et de la domination de la métropole. Une autre classification a été proposée par K. ZWEIGERT et H. KÖTZ (An introduction to comparative law, vol. 1, The Framework, Oxford, North-Holland, 1977, p. 108), en ce sens que le droit brésilien appartient à la famille des droits romanistes.
10 Pour un panorama de ce rayonnement sur les diverses branches du droit brésilien, v. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, « L’influence du droit français sur le droit brésilien », in Le droit brésilien: hier, aujourd’hui et demain, A. WALD et C. JAUFFRET-SPINOSI (dir.), Paris, Société de législation comparée, 2005, pp. 456-479 ; sur l’influence du Code civil français, v. V. M. J. de FRADERA, « A circulação de modelos jurídicos europeus na América Latina, um entrave à integração econômica no Cone Sul ? », Rev. dos tribunais, vol. 736, 1997, pp. 20-39 ; A. WALD, « L’influence du Code civil en Amérique Latine », in 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, pp. 855-870.
11 La codification française fut le premier grand travail de réforme, d’unification et de systématisation moderne du droit privé (civil et commercial), raison pour laquelle les récentes États indépendants latino-américains se sont emparés de cette expérience pour organiser, eux aussi, juridiquement leur nouvelle structure sociale et économique, renforçant par ricochet leur nouvelle structure politique de pouvoir. Cette démarche du législateur latino-américain est d’ailleurs un héritage de la tradition juridique des pays sous l’empire desquels les ex-colonies étaient attachées : tant l’Espagne que le Portugal possédaient un droit formaliste, individualiste et codifié.
12 En effet, les juristes brésiliens étaient déjà familiarisés et à la doctrine et à la jurisprudence étrangères, puisque à cette époque la plupart d’entre eux avaient réalisé leurs études de droit à Coimbra ou même à Paris. Rappelons que ce ne fut qu’à partir de la loi impériale du 11 août 1827 que le Brésil se verra doté de ses premières facultés de droit (à Olinda et à São Paulo). Par ailleurs, les statuts adoptés dans ces facultés déterminait que l’enseignement devait se faire « avec l’étude de
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
31
Finalement, c’est la perspective de rapports économiques entre le Brésil et les pays européens qui a conduit la réception du modèle français13.
Les codifications françaises ont donc fortement inspiré les nouveaux États législateurs latino-américains. Si le Code civil de 1804 a servi de source à l’élaboration de plusieurs codes civils sud-américains14, le Code de commerce de 1807 a également trouvé sa place dans le contexte de la codification commerciale en Amérique du Sud, notamment au Brésil.
L’influence du droit commercial français sur le droit brésilien est néanmoins restée à la merci et des adaptations et de l’évolution naturelle tracées par les ordres juridiques respectifs. Suite à la codification commerciale de 1850, le Brésil a connu des changements d’orientation en la matière et s’est ouvert à l’influence d’autres systèmes juridiques, grâce à la manière tout à fait particulière de réception des modèles juridiques étrangers.
I. LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS ET LA FORMATION DU DROIT COMMERCIAL BRÉSILIEN
L’importance incontestable du Code de commerce français au moment
de l’élaboration du Code de commerce brésilien de 1850 semble être la conséquence d’une influence déjà considérable dans la période qui la précède.
la jurisprudence analogue à celle des nations civilisées », et exigeaient pour l’admission aux facultés la connaissance parfaite du français, car « c’est en cette langue que sont écrits les meilleurs livres de droit naturel public, de droit des gens, de droit maritime, et de droit commercial, qu’il convient de consulter, ces doctrines entrant surtout dans le plan d’étude du cours juridique, et la plupart des livres devant alors servir de précis étant écrits en français » (v. H. VALLADÃO, « Le droit comparé au Brésil : la vision de 1950 », in Le Droit brésilien…, op. cit., pp. 467-479, spéc. p. 469).
13 V. M. JACOB de FRADERA, « A circulação de modelos jurídicos europeus na América Latina…», précit., p. 23.
14 L’influence du Code civil français sera constatée dans tous les pays importants de l’Amérique latine. Au Brésil, cette influence est cependant restreinte, tant les projets de Code civil de Teixeira de Freitas (1860) et de Clóvis Beviláqua (1899) sont partis d’une perspective cosmopolite (non nationaliste, mais conservatrice en même temps), en se basant sur les Ordonnances philippines de 1603 et la tradition juridique portugaise, le pandectisme allemand, le droit italien, le droit suisse et les lois et coutumes brésiliens. L’influence française demeure en effet : dans l’idée d’avoir un code civil; dans l’adoption des principes généraux du droit pour combler les lacunes ; dans la notion de propriété ; dans le fondement de la responsabilité civile (sur la faute) ; dans le contrat comme source du droit entre les parties (pacta sunt servanda) ; et, d’une manière générale, en adoptant une posture propre du positivisme d’Auguste Comte. On n’oubliera pas que la devise du Pavillon national reproduit le postulat « Ordre et Progrès », v. V. M. JACOB DE FRADERA, « La partie générale du code civil », in Le droit brésilien …, op. cit., pp. 203-222.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
32
A. - L’influence française avant la promulgation du Code de commerce brésilien de 1850
On inaugure l’évolution historique du droit commercial brésilien en
1822, année de la proclamation de l’indépendance du Brésil. Les juristes fixent d’ailleurs la période de 1822 à 1850 comme étant la première phase de cette évolution, marquée essentiellement par son héritage colonial15.
Cependant l’influence du droit français sur le droit brésilien date de la période coloniale où l’on appliquait au Brésil les lois portugaises16. En effet, après la proclamation de l’indépendance en 1822, ces lois ont été maintenues en vigueur par l’Alvará du 20 octobre 1823, promulguée par l’Assembléia Constituinte Legislativa de l’Empire brésilien17. Selon cet Alvará, on applique au Brésil les lois du Portugal en vigueur au 25 avril 182118 et les lois promulguées par l’Empereur, en attendant la promulgation d’un Code19. Parmi ces lois portugaises se trouvait la Lei da boa razão (loi de la saine raison) du 18 août 1769 qui autorisait l’application subsidiaire, pour les affaires politiques, économiques, commerciales et maritimes, des lois des nations chrétiennes, éclairées et cultivées. En effet, cette loi a été édictée, entre autres, pour réprimer les excès et les abus commis par les tribunaux dans l’application contra legem du droit romain (alors même qu’il était déclaré source de droit subsidiaire par les Ordonnances Philippines de 160320) et de la communis opinio doctorum des postglossateurs. La Lei da boa razão disposait que le droit romain ne s’appliquerait que subsidiairement aux lois du Royaume, de façon complémentaire et seulement si en accord avec la recta ratio, celle-ci étant fondée sur le droit naturel et les usus modernus pandectarum que le droit des gens avait unanimement établi pour diriger et gouverner toutes les nations civilisées21.
15 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, vol. I, 2ª éd.,
Freitas Bastos, 1933, p. 75. 16 Sous les conditions et les modalités d’application du droit portugais au Brésil, droit
théoriquement en vigueur pendant la période coloniale, v. R. DAVID, « Le droit brésilien jusqu’en 1950 », in Le droit brésilien…, op. cit., pp. 25-182, spéc. pp. 49-58.
17 L’Empire brésilien durera 67 ans, jusqu’à la proclamation de la République par le Maréchal Deodoro da Fonseca en 1889. Au premier Empereur, D. Pedro I, fils du Roi du Portugal, D. João VI, succédera D. Pedro II.
18 V. supra note 6. 19 Car cette même loi ordonnait l’élaboration d’un code civil et d’un code de commerce. 20 En effet, les gloses de Accursius et les opinions de Bartolus ont été considérées sources
subsidiaires du droit portugais par la Carta Régia du 18 avr. 1426, envoyée par D. João I au Conseil de Lisbonne.
21 G. BRAGA DA CRUZ, Formação Histórica do Moderno Direito Privado Português e Brasileiro, op. cit., p. 43. La « Lei da boa razão » sera complétée par la loi du 28 août 1772 portant Statuts de l’Université de Coimbra, qui a introduit dans l’enseignement universitaire les idées du droit naturel et des usus modernus pandectarum, afin de créer chez les futurs juristes portugais une nouvelle mentalité, basée sur de nouvelles conceptions du droit et de la justice.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
33
La doctrine aurait même soutenu que la Lei da Boa Razão permettrait d’exclure, dans bien des cas, l’application du droit portugais en faveur de solutions, conformes à la raison, admises par les législations les plus modernes des nations civilisées22. À propos de cette loi, René David a observé que « cette référence, dans le monde du dix-neuvième siècle, constituait en fait une référence au droit français, lequel avec la codification napoléonienne, avait été le premier à se réformer, à se libérer des survivances routinières d’un ordre social et politique désuet, et à fonder sa structure et ses solutions nouvelles sur les exigences de la raison »23.
En procédant ainsi, la loi portugaise concédait indirectement aux juges brésiliens la possibilité d’utiliser le droit comparé pour justifier leurs décisions et assurait par conséquent l’influence de la vision européenne commune du droit de l’époque dans la formation du droit brésilien. Ainsi, en matière commerciale, les tribunaux de commerce du Brésil statuaient dans la plupart des affaires qui leur étaient soumises ex æquo et bono, en ayant pour source juridique les lois générales, parfois les dispositions spéciales énonçant les principes adoptés par les nations plus civilisées, et en se référant surtout aux dispositions du Code de commerce français de 180724. Grâce à la Lei da boa razão, ce dernier, puis les codes de commerce espagnol (1829) et portugais (1833) ont constitué la vraie législation commerciale brésilienne de l’époque25.
Cette situation ne devait toutefois pas durer. Des éléments historiques précédant l’indépendance du Brésil ont justifié en quelque sorte le besoin d’élaboration d’un Code de commerce brésilien. En effet, le transfert de la famille impériale du Portugal au Brésil en 1808, sur le conseil des Anglais, face à l’imminente invasion napoléonienne, a permis la mise en place d’un processus de développement économico-culturel original : Dom João VI, alors Régent du Portugal, y a amené une mission française dans le but de promouvoir le développement de la culture et des arts. Il a également lancé la Colonie vers le commerce extérieur avec la promulgation, en 1808, de la
22 A. DOS SANTOS JUSTO, « Direito Brasileiro: raízes históricas », Rev. Brasileira de
Direito Comparado, nº 2, pp. 1-14, spéc. p. 5. Cet auteur nous en apporte deux exemples : l’écartement de l’exigence de la bonne foi dans la prescription acquisitive par trente ans, car considérée anachronique et inexécutable (cf. Ordonnances Philippines IV, 79pr. et l’art. 2262 du Code Civil français) ; l’obligation imposée à l’acquéreur d’immeuble rural loué de maintenir le contrat de bail préexistant (cf. Ordonnances Philippines IV, 9pr. et l’art. 1743 du Code Civil français). Pour d’autres exemples, consulter G. BRAGA DA CRUZ, Formação Histórica do Moderno Direito Privado Português e Brasileiro, op. cit., pp. 60-64.
23 R. DAVID, « Structure et idéologie du droit brésilien », Cahiers de législation et de bibliographie juridique de l’Amérique Latine, nº 17-18, janv.-juin, 1954, pp. 5-20, spéc. p. 8.
24 A. de SAINT-JOSEPH, Concordances entre les Codes étrangers et le Code de commerce français, op. cit., p. 171 (notice fournie par Pinheiro-Ferreira à l’auteur).
25 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit., pp. 79-80.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
34
loi sur l’ouverture des ports26 et la création de la Banque du Brésil. Toutefois l’hypothèse d’un retour imminent de la famille royale au Portugal n’a pas laissé le temps à Don João VI d’édicter d’autres mesures importantes. Et si le commerce et l’économie ont pu connaître un véritable essor durant la présence du Monarque sur le sol brésilien, un vide juridique demeurait à combler27. La création d’une Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas e Navegação le 23 août 1808 avec, entre autres, une fonction juridictionnelle et de formation de professionnels du commerce, fut l’une de rares mesures juridiques prises par le Roi. Elle sera néanmoins supprimée lors de la promulgation du Code de commerce en 1850.
Toutes ces conditions, alliées au développement des transports et de la navigation à vapeur, à l’abandon de la condition coloniale en 180828 et à la consolidation du libéralisme du XIXe siècle au Brésil, transformèrent les conditions du commerce plus que n’avait été transformée la société civile. La rédaction d’un Code de commerce apparût, dès avant l’indépendance, comme une nécessité29. En juillet 1809, la Real Junta do Comércio a suggéré au Roi D. João VI de charger le juriste brésilien José da Silva Lisboa de la rédaction d’un projet de code de commerce pour le Royaume. Considéré comme le premier jurisconsulte commercial à écrire sur la matière en langue portugaise30, José da Silva Lisboa a accepté la charge de l’élaboration de ce projet mais ne l’a rendu que le 24 avril 1826, après l’indépendance du Brésil. Dans le rapport préliminaire à ce projet, l’auteur n’a pas hésité à affirmer que, parmi les législations étrangères consultées, la législation française fut celle qui lui a servi d’« étoile ». Ce projet n’a pas été accueilli par manque de réalisme. D’une part, la complexité de son plan31, mêlant des questions touchant aussi bien au droit public qu’au droit privé, dépassait la perspective d’un simple code de commerce qui consacrait la
26 Carta Régia du 28 janv. de 1808. Privilège que la plupart des pays latino-américains n’ont
pu obtenir qu’après de violents conflits armés avec les forces de l’ordre de la métropole. 27 Selon J. O. AVILA (Los códigos de comércio latinoamericanos, Santiago du Chili, Ed.
Jurídica Chile, 1961, p. 245) cette situation s’aggravait avec le fait que la loi portugaise elle-même était rétrograde et inadaptée aux nouvelles exigences économiques, le recours aux droits étrangers admis par la loi de la saine raison en étant l’exemple majeur ; à cela s’ajoute le manque de spécialistes en Droit commercial au Portugal.
28 Désormais le Royaume Uni du Portugal, du Brésil et d’Algarve, par la Carta Régia du 16 déc. 1815 et par celle du 13 mai 1816.
29 R. DAVID, « Le droit brésilien jusqu’en 1950 », op. cit. p. 97. 30 Princípios da economia política, en 1804, et Princípios de direito mercantil e leis de
marinha, de 1798 à 1804, qui, selon W. FERREIRA (As diretrizes do direito mercantil brasileiro, Lisbonne, 1933, pp. 37-73) ont consitué le « code de commerce » pour le Portugal jusqu’à la publication du Code de commerce portugais en 1833.
31 Ainsi : Livre I - De la liberté du commerce et des contrats commerciaux, terrestres et maritimes ; Livre II - Des navires, commerçants et navigateurs ; Livre III - Des tribunaux, consuls, agents, arbitres et faits faillite ; Livre IV - De la police des ports et mers ; Livre V - Règlements pour la protection de la marine, revenu, industrie et santé publique.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
35
dichotomie du droit privé prédominante à l’époque. D’autre part, le manque d’élément national au sein du projet le déqualifiait devant le contexte d’affirmation du nouvel Empire brésilien, alors que la codification devrait nécessairement impliquer une certaine nationalisation de la matière commerciale32.
B. - L’influence française sur l’élaboration du Code de commerce brésilien de 1850
La décision d’élaborer un Code de commerce du Brésil indépendant
date de 183233 et son avènement en 1850 marque la deuxième période d’évolution du droit commercial brésilien34. Pour l’élaboration de ce Code, les influences ont été multiples, notamment celles du Code de commerce français, mais des différences apparaissent entre ces deux textes légaux.
1. La diversité des influences
La nécessité a fait que le Brésil, ainsi que d’autres pays européens et d’Amérique latine, s’est doté d’un code de commerce avant même que n’ait lieu la codification civile, d’élaboration plus complexe et apparemment moins urgente35. Les vents de la codification commerciale en Europe36 ont soufflé vers l’Hémisphère sud, suivant les routes tracées par les navigateurs portugais et espagnols de l’époque des Grandes découvertes. Celle tracée par Pedro Álvares Cabral37 a été suivie par le Code de commerce français qui se plaça au cœur de l’élaboration du Code commercial brésilien de
32 W. FERREIRA, Tratado de direito comercial, vol. I, São Paulo, Saraiva, 1960, pp. 86-87. 33 Décret du 14 mars 1832, qui a nommé une commission initialement formée uniquement par
des commerçants. À cette époque, le pays se trouvait sous le règne de l’Empereur Don Pedro II. 34 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit., p. 71 s. 35 R. DAVID, « Le droit brésilien jusqu’en 1950 », op. cit., p. 97. 36 Pour un large aperçu de ce phénomène, consulter l’introduction des ouvrages d’A. de
SAINT-JOSEPH : Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon, 2e éd, Paris, Cotillon, 1856 ; et Concordances entre les Codes étrangers et le Code de commerce français, 2e éd., Paris, Videcoq, 1851, pp. XI-XVII. La codification commerciale ne s’est cependant pas faite sans soulever des critiques. Ainsi A. FREMERY (in Etudes de droit commercial ou le droit fondé sur la coutume universelle des commerçants, Paris, Gobelet, 1833, p 19) s’exprimait : « depuis deux cents ans, le véritable droit commercial, oeuvre lente et successive de l’unanimité des commerçants et dont les sources se retrouvent dans les monuments épars de leur coutume, a été divisé et mis en lambeaux par les législateurs de nations diverses et au lieu d’un droit commercial simple, grand, universel comme le commerce qui l’avait produit, on a eu le droit commercial français, le droit commercial anglais, le droit commercial espagnol ».
37 Navigateur portugais (1467-1520/1526), chargé par le roi du Portugal Manuel Ier de poursuivre l’œuvre de Vasco da Gama et d’aller aux Indes. Il est considéré comme « le découvreur du Brésil », en y étant arrivé le 22 avril 1500.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
36
185038. Mais il n’était pas le seul : si la commission présidée par José Clemente Pereira s’est nettement inspirée du modèle français, d’autres codes ont été également appelés à suivre la route de Cabral, tels ceux du Portugal, de l’Espagne et des Pays-Bas. Le recours à la doctrine plus remarquable de l’époque fut également utilisé par la Commission qui n’a pas hésité à puiser dans la littérature juridique anglaise (Marshall et Allan Park), par exemple, pour la rédaction de la partie relative aux assurances maritimes39.
En même temps, les conditions particulières dans lesquelles l’indépendance a vu le jour ont contribué fortement à la formation du droit brésilien. Celui-ci n’a pas rejeté l’influence portugaise, mais n’a pas immédiatement accepté certaines idées libérales venues de l’étranger, car le Pays demeurait tout de même une monarchie constitutionnelle, fondée sur une structure économique essentiellement agraire et esclavagiste. Cela semble avoir été, par exemple, l’une des raisons pour lesquelles le Code civil français n’a pas pu influencer d’emblée et dans son ensemble le droit civil brésilien, tel qu’il a pu influencer le droit civil d’autres pays latino-américains. Deux idées phares ont ainsi guidé les travaux de la Commission responsable de l’élaboration du projet de Code de commerce brésilien. D’une part, la Commission a souhaité que ce code soit « rédigé sur la base des principes adoptés par toutes les nations commerçantes, en harmonie avec les usages et les coutumes du commerce qui réunissent sous un même drapeau les peuples du nouveau et du vieux Monde » et d’autre part, qu’il soit « aménagé selon les circonstances spéciales du peuple pour lequel il est fait »40.
On voit ainsi que lorsqu’il s’agit du droit commercial, les obstacles à la circulation de modèles juridiques s’amoindrissent. Par nature, ce droit est fortement influencé par les droits étrangers et plus susceptible d’être
38 Loi n° 556, du 25 juin 1850. Ce Code fut traduit en langue allemande, française et anglaise.
Dans la collection Die Handelsgesetze des Erdballs, 3e éd., dirigée par BORCHARD, KHOLER et al. et publiée à Berlin en 1906, on trouve la traduction allemande ; la version française du Code de commerce brésilien se trouve dans l’édition française de cette même collection (Les lois commerciales de l’Univers) ainsi que dans l’Annuaire de législation étrangère, publiée par la Société de Législation Comparée, depuis 1872. La comparaison du Code de commerce brésilien avec d’autres codes, notamment le code français et les lois anglaises, peut être trouvée dans les travaux de E. G. HOECHSTER, A. SACRÉ et L. OUDIN, Manuel de droit commercial français et étranger, Paris, Marescq, 1874, et dans la collection LEVI, Commercial Law, its principles and administration; the mercantile law of Great Britain compared with the codes and laws of commerce of the following mercantile countries…, Londres, 1850. Dans l’ouvrage d’A. de SAINT-JOSEPH, Concordances entre les Codes étrangers et le Code de commerce français, op. cit., on ne trouvera qu’une très brève notice fournie par Pinheiro-Ferreira sur l’élaboration du Code de commerce brésilien (p. 171).
39 J. O. AVILA, Los códigos de comércio latinoamericanos, op. cit., pp. 245-246 ; W. FERREIRA, Tratado de direito comercial, vol. I, op. cit., p. 97.
40 Exposé des motifs du Projet, apud W. FERREIRA, Tratado de direito comercial, vol. I, op. cit., p. 93.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
37
uniformisé et de s’internationaliser que d’autres branches du droit41. Le Code de commerce français a été lui-même le fruit du droit comparé, ayant subi maintes influences étrangères, surtout italiennes, néerlandaises et anglaises42. À son tour, il a fortement inspiré le législateur espagnol de 1829 et dans une certaine mesure le législateur portugais de 1833, tandis que le Code de commerce brésilien a, quant à lui, influencé la rédaction de pas moins de cinq cent articles du Code de commerce argentin de 1859 (1862)43 et, par l’intermédiaire de ce dernier, il a aussi inspiré les codes commerciaux de l’Uruguay (1865) et du Paraguay (1902)44.
Ainsi à travers les modèles dont s’est servi le Code de commerce brésilien, notamment le modèle portugais, nous pouvons affirmer que le Code de commerce français a pu aussi bien directement qu’indirectement servir de source à la codification brésilienne. Le Code de commerce brésilien, comme l’a observé Carvalho de Mendonça45, n’a cependant pas été une copie exacte des codes qui l’ont influencé. Au contraire, il a été le fruit d’un travail original, le premier en fait qui est apparu avec un nouveau visage en Amérique46, au point d’être classé comme un « Monument » de la culture juridique brésilienne47.
Mais qu’en est-il de l’influence française ?
41 L’exemple le plus évident est la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale
des marchandises, actuellement en vigueur dans plus de soixante pays, ou encore les lois uniformes sur la formation du contrat de vente et sur la vente internationale précédant celle-ci, élaborées par l’UNIDROIT et signées à La Haye en 1964. Les Principes d’UNIDROIT 2004 doivent également être mentionnés, vu le rôle qu’ils jouent dans l’arbitrage international.
42 Pour une étude approfondie sur le commerce et le droit du commerce en France, consulter l’ouvrage récent de : E. RICHARD (dir.), Droit des affaires. Questions actuelles et perspectives historiques, Rennes, PUR, 2005, spéc. le Titre I, sur « Les sources et l’encadrement du droit des affaires » (Antiquité – XXIe siècle), pp. 21-125.
43 Sur la codification du droit commercial en Argentine et l’apport français à cette codification, qui nonobstant ses spécificités présente des forts parallélismes avec la codification commerciale brésilienne, consulter J. L. ANAYA, « El influjo del Código de comercio francés en la codificatión argentina », in La Codificación : raíces y prospectiva, I, op. cit., pp. 99-108.
44 J. L. ANAYA, « La codificación comercial em Iberoamérica », in La Codificación : raíces y prospectiva, II, op.cit., pp. 167-174, spéc. p. 167.
45 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit. , p. 80. 46 J. O. AVILA (Los códigos de comércio latinoamericanos, op. cit., p. 246) conteste cet
exclusivisme dont est fier la doctrine brésilienne : d’une part, la Bolivie avait connu auparavant une situation très similaire à celle vécue par le Brésil ; d’autre part, le législateur brésilien n’a su créer ou incorporer aucune institution nouvelle dans son corps, qui aurait perdu en homogénéité en raison de l’intervention de plusieurs personnes durant les 15 ans de discussion du projet.
47 R. REQUIÃO, Curso de direito comercial, vol. 1, 25 edição atual., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 27.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
38
2. Les apports du Code de commerce français
La prise en compte du Code de commerce français comme l’un des principaux textes de référence lors de l’élaboration du Code de commerce brésilien est dû, selon Carvalho de Mendonça48, à deux facteurs non négligeables. Tout d’abord, le législateur brésilien voyait dans le Code de commerce français l’aboutissement d’une longue, complète et universelle période de préparation de la codification, que représentaient les Ordonnances de Louis XIV de 1673 et 168149. Ensuite, c’est le notable progrès de la technique législative que traduit le Code français de 1807 qui a tiré l’attention du législateur brésilien, confronté aux lois chaotiques en vigueur dans les autres pays européens et dans les pays latino-américains.
Les apports du Code de commerce français concernent tant la forme que le fond.
a) Quant à la forme…
Le premier grand aspect concernant la forme se trouve dans la codification en elle-même. Le Code de commerce français constitue la première codification strictu sensu du droit commercial. Jusqu’alors on se trouvait devant de simples tentatives de coordonner et de compiler les règles régulatrices des rapports commerciaux, y compris le commerce maritime. La codification napoléonienne a donc imprimé une nouvelle forme à ce qui existait déjà, tout en conservant des éléments traditionnels50.
Le Code de commerce brésilien se présentait comme le Code de commerce français de 180751. Il comportait trois parties (livres) intitulés, à
48 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit., p. 66. 49 Promulguées par Louis XIV en raison et sous influence de la politique de Colbert,
l’Ordonnance de 1673 sur le commerce te terre (« code de Savary ») et l’Ordonnance de 1681 sur le commerce de mer vont à la fois réformer le droit commercial statutaire français d’alors, institué par l’édit de Charles IX en 1563, et lui offrir un cadre juridique plus scientifique et systématique, en raison de unification du droit commercial, de droit maritime et de la procédure. Le Code de 1807 aurait reproduit le même plan de l’Ordonnance de 1673, tandis que l’Ordonnance de 1681 aurait fondé le livre II sur le droit maritime, du moins en ce qui concerne les aspects privés, les aspects publics de ce droit ayant été oubliés, même si une petite nouveauté avec l’assurance maritime doit être reconnue. (E. RICHARD, « Les sources et l’encadrement du droit des affaires », op. cit., p. 102 ; J. MONÉGER, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 : réflexion sur l’aptitude du droit économique et commercial à la codification », Revue internationale de droit économique, 2004, pp. 171-196, spéc. p. 174 et 185). Notons par ailleurs qu’on trouve la traduction portugaise de l’Ordonnance de 1681 sur la Marine dans l’ouvrage de J. DA SILVA LISBOA (Visconde de Cayrú), titrée Princípios de direito mercantil e lei de marinha, vol. II, ed. Cândido Mendes, 1874.
50 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit., p. 66. 51 Pour une critique de la forme adoptée par le législateur français, v. G. RIPERT et R.
ROBLOT, Traité de droit commercial, 14e éd., Paris, LGDJ, 1991, n° 28, p. 1 ; J. MONÉGER, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 :… », précit., pp. 171-196.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
39
savoir : « du commerce en général » (art. 1er-456), « du commerce maritime » (art. 457-796), « des faillites » (art. 797-913). Il y avait en plus un « Titre unique » 52 portant sur l’« administration de la justice dans les affaires et causes commerciales »53. À l’inverse du Code civil brésilien de 1916, le Code de commerce brésilien de 1850 n’a pas adopté un plan bipartite, consistant en une partie générale et en une partie spéciale54. Il n’a pas non plus adopté une division trop détaillée et « hiérarchisée » des matières qu’il traitait, qui puisse permettre une meilleure reconnaissance et une rapide localisation de celles-ci dans l’ensemble codifié comme l’a fait le Code civil brésilien.
Le Code de commerce brésilien semble avoir particulièrement suivi le Code de commerce français dans la composition de sa première partie, également intitulée « du commerce en général ». Tel le premier livre du Code de commerce français, lequel à été traité de « bric-à-brac » ou de galimatias législatif avec ses 189 articles55, la première partie du code brésilien de 1850 était composée de 456 articles pour régir les commerçants, les livres de commerce et la comptabilité, les auxiliaires du commerce, les banquiers, les obligations et les divers contrats commerciaux, la lettre de change et le billet à ordre, les sociétés commerciales…De plus, l’intitulé des
52 Réglementé par le Regulamento n° 738, du 25 nov. 1850, et abrogé par le Décret-loi n°
1608, du 18 sept. 1939, instituant l’ancien Code de procédure civile. 53 Seule la réglementation de la juridiction commerciale manquait pour que le Code brésilien
soit équivalent à cet égard au Code français de 1807. Ce manquement n’a pas empêché ce que le Code brésilien d’une part prévoit le règlement de conflits au sein d’une justice commerciale spécialisée (arts. 124 et 125, par. ex .), et d’autre part, se présente à l’époque avec plus de dispositions normatives (913 articles) que le Code français (648 articles).
54 Plan proposé initialement par TEIXEIRA DE FREITAS dans la Consolidation des lois civiles de 1857 (infra note 98) et dans son Esboço (Projet) de Code civil de 1860 (Première partie), et qui semble avoir eu comme source d’inspiration majeure les auteurs de pandectisme allemand (XVIIe et XVIIIe siècles). Ces derniers ont été responsables pour la diffusion de l’idée d’une partie générale pour le droit privé, celle-ci étant certainement admise grâce aux influences que l’école du droit naturel a pu exercé sur cette doctrine. Si nous laissons de coté le Projet de code civil pour la Sache de 1852 (entré en vigueur 1863), dont Teixeira de Freitas n’a vraisemblablement pas eu connaissance, le plan bipartite semble avoir été adopté pour la première fois en tant que solution législative lors de la présentation de la Consolidation de lois civiles. Reprenant les idées de Teixeira de Freitas, C. Beviláqua a fondé la structure du Code civil de 1916 sur un plan bipartie et enrichie son contenu avec les contributions du système de la Pandektenwissenschaft. Le plan bipartite se répandra ultérieurement sur tous les codes et toutes lois brésiliennes de dimension importante. Sur l’influence du droit allemand dans l’élaboration du Code civil brésilien de 1916, consulter H. VALLADÃO, Einfluss des deutschen Rechts auf das brasilianische Zivilgesetzbuch (1857-1922), traduit par K. de MENDONÇA, Rio de Janeiro, s.n., 1973, 15 pages ; C. LIMA MARQUES, Das BGB und das brasilianische Zivilgesetzbuch von 1916, op. cit., pp. 73-97.
55 J. MONÉGER, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 : … », précit., p. 185.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
40
deux codes semblait suggérer que le reste du code serait consacré au commerce en particulier, ce qui n’a pas été le cas56.
Par manque de choix, le Code de commerce brésilien a suivi la manière dont sont présentés les articles dans les codes français, tant dans la façon de les rédiger que dans celle de les numéroter. En ce sens, les articles ne comportent aucun intitulé ni mentions marginales indiquant leur contenu57. Ils sont parfois très longs et leurs alinéas comportent plusieurs phrases et ne sont pas numérotés. Ils possèdent parfois un langage imprécis et polysémique58, à l’exemple de l’article 121 du Code de commerce brésilien qui établissait que les règles civiles applicables aux contrats en général l’étaient également aux contrats commerciaux, avec les modifications et restrictions établies par le Code lui-même. Dans cette disposition, comme l’avait observé Carvalho de Mendonça59, le mot contrats devait être compris comme obligations, car à l’occasion le législateur brésilien avait repris l’expression employée par l’article 1101 du Code civil français tout en voulant se référer à l’obligation, dont le contrat n’est qu’une des sources.
b) …quant au fond
La première grande influence de fond que nous pouvons évoquer est celle de l’étendue de la matière commerciale. En effet, le Code de commerce français a considérablement élargi la sphère du droit commercial, en incluant dans son champ d’application une série d’actes de la vie économique et juridique qui, en raison de leur nature exceptionnelle, exigeaient un traitement spécial. Ainsi, la facilitation de la preuve, des délais de prescription assez courts, une procédure plus rapide et une justice spécialisée60 sont devenues des éléments caractéristiques du droit
56 La similitude de forme du premier livre des deux codes ne révèle pas d’emblée les
différences existantes dans leurs contenus. Par exemple, alors que la réglementation des obligations et des contrats commerciaux est pratiquement inexistante dans le code français de 1807, elle tient une place prépondérante dans le Code de commerce brésilien de 1850 (v. infra).
57 Cf. R. DAVID, « Le droit brésilien jusqu’en 1950 », op. cit., pp. 99-100. 58 D’opinion contraire, W. FERREIRA (« O código comercial no século », Revista de direito
mercantil, vol. 1, 1951, pp. 7-20, spéc. p. 9) a affirmé que « celui qui se propose de justifier l’ancienneté du code commercial brésilien n’a pas à chercher en lui l’autorité classique de la langue, qui évidemment lui manque. Manifeste est son langage. Limpide sa phrase. Clairs leurs dispositifs, écrits par des opérateurs et par des juristes qui se sont efforcées pour que la grande loi du commerce était à la portée de tous ceux qui se consacraient à l’activité professionnelle, médiateur entre l’offre et la demande de marchandises, aussi bien dans les marchés internes comme dans les marchés internationaux ».
59 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. VI, Iª parte, n° 254 60 L’édit de Charle IX de 1563 avait déjà créé en France une sorte de tribunal du commerce,
composé par un juge et quatre consuls, et déterminait que « connoistrons les dits juges et consuls des marchandes de tous procès et différends qui seront ci-après mûs entre marchands pour fait de marchandise seulement ».
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
41
commercial61. L’édification d’un droit commercial comme exception au droit civil, tel a été également l’un des objectifs du législateur brésilien lors de l’élaboration Code de commerce de 185062.
Mais à la différence du Code de commerce français, le Code de commerce brésilien ne comportait aucune disposition relative aux juridictions commerciales. Ces juridictions ont toutefois existé au Brésil dès 1808, lors de l’ouverture de ses ports au commerce international63. Leur « rétablissement », peu après la promulgation du Code de commerce de 185064, exprime certainement l’influence française et semble être une conséquence même de la distinction du droit civil et du droit commercial faite par les deux ordres juridiques à cette époque.
Une autre forte influence française vient de la codification des pratiques commerciales65 et de la consécration des coutumes commerciales comme source subsidiaire du droit codifié66. Le Code de commerce brésilien a également consacré les pratiques commerciales comme droit subsidiaire en cas de lacunes législatives67 et comme critère général d’interprétation des contrats commerciaux (arts. 130 et 131, n. 4)68 et des conditions et des clauses du contrat d’assurance maritime (art. 673, n. 3). L’influence du droit français en ce domaine est d’autant plus remarquable que, jusqu’alors, le
61 J.-G. LOCRÉ, Esprit du code de commerce, vol. 4, 2e éd., Paris, Garnery, 1829, p. 4. 62 M. DE S. VICENTE, Direito público brasileiro, 1857, p. 13, apud CARVALHO DE
MENDONÇA, Tratado,vol. I, op. cit., p. 107 63 Real Junta do Comércio, Agricultura, Fabricas e Navegação, créée le 23 août 1808. 64 Le Régl. n° 738, du 25 nov. 1850 a supprimé la Real Junta do Comércio …, et donné leur
règlement aux tribunaux de commerce alors crées par le Régl. 737. Ces tribunaux ont été ultérieurement supprimés par le Déc. Impérial n° 2.662, du 9 oct. 1875. Une juridiction spéciale se trouve encore en vigueur : il s’agit du Tribunal Maritime Administratif, crée par le Déc. n° 204.829, du 21 déc. 1931 et réglementé par le Déc. n° 24.585, du 5 juill. 1934. Ce tribunal a des compétences disciplinaires et pénales en cas d’accidents de la navigation et constitue en même temps un organe de l’administration publique, chargé de tenir différents registres.
65 « Il est, disait-on dans l’exposé des motifs, d’une haute importance que le Code de commerce de l’Empire français soit rédigé dans des principes qui soient adoptés par toutes les nations commerçantes, dans des principes qui soient en harmonie avec les grandes habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes », apud A. de SAINT-JOSEPH, Concordances entre les Codes étrangers et le Code de commerce français, op. cit., 1844, p. XII.
66 La place accordée aux usages et pratiques du commerce par le droit français semble pouvoir être en partie justifiée par l’absence d’une réglementation de la matière contractuelle dans le code de commerce et par sa préexistence dans le code civil de 1804, dont le traitement n’était pas tout à fait adapté à une société basée sur le crédit, mais sur la production agricole. D’où l’efficacité donnée aux usages et pratiques du commerce, tout comme la déductibilité de la jurisprudence française en matière commerciale.
67 Art. 2° do Regulamento n° 737, du 25 nov. 1850. À titre d’exemple, on indiquera les dispositions suivantes, toutes du Code de commerce de 1850 : arts. 154 ; 168 ; 179 ; 186 ; 201 ; 207, n° 2 et 197.
68 Ces dispositifs ont jeté les bases d’une interprétation des contrats commerciaux selon les usages et les pratiques du commerce. Ces critères d’interprétation fonctionnent objectivement et sont supérieurs à l’intelligence qu’on prétend prêter aux mots.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
42
droit brésilien était fortement marqué par un centralisme juridique hérité du droit portugais, au sein duquel il n’y avait aucune place pour la discussion concernant la supériorité du droit coutumier ou local69 sur les règles codifiées.
Une conséquence de ces influences se trouve dans le fait que le Code de commerce brésilien soumettait les consommateurs aux usages et coutumes des commerçants, faute d’une définition de la matière typiquement commerciale comme étant celle circonscrite à certaines opérations entre commerçants70.
Quant au droit des obligations, René David a écrit : « dans la matière des obligations et dans celle du droit commercial, le droit brésilien, sans doute, possède une moindre originalité ; il s’agit là de matières hautement techniques, ou réputées telles, qui dans tous les pays sont largement uniformisées et échappent à l’effet des singularités nationales ». Le juriste français remarque cependant la présence d’une certaine originalité du droit brésilien dans ce domaine : « là aussi, néanmoins, dans le domaine de la technique, certaines expériences pourront avoir été tentées ou être en cours au Brésil, qui n’ont pas été faites dans notre pays »71. À titre d’exemple, citons le double régime auquel était soumise la « mise en demeure » dans l’ordre juridique brésilien selon qu’il s’agissait d’une obligation civile ou commerciale : alors que traditionnellement le droit brésilien est attaché à la règle dégagée par la doctrine romaine dies interpellat pro homine (la simple échéance du terme suffit pour que le débiteur soit de plein droit responsable pour le retard dans l’inexécution de l’obligation – consacré plus tard dans l’ancien art. 960 du C. civ. de 1916), l’avènement du Code de commerce a introduit la règle française (l’ancienne rédaction de l’art. 1139, C. civ. français) selon laquelle le créancier qui ne proteste pas solennellement à l’échéance est censé avoir consenti à son débiteur une prorogation tacite d’échéance (art. 205, C. com. 1850). La différence de régime persistera en droit brésilien jusqu’à l’avènement du Code civil de 2002 qui, unifiant les obligations civiles et commerciales, a réaffirmé l’attachement à l’ancienne règle déterminant la mise en demeure ex re lorsqu’on est en présence d’un
69 Sur le centralisme juridique et le droit brésilien, consulter C. D. COUTO e SILVA, « O
direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro », in V. M. J. de FRADERA (dir.) O direito privado na visão de Clóvis do Couto e Silva, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997, p. 12 s.
70 Ainsi, F. ULHOA COELHO, Curso de direito comercial, vol. 3, Saraiva, 2002, p. 166, qui nous relate l’innovation apportée par le Code de commerce portugais de 1888 en la matière, en établissant que la vente au consommateur ne rentrait pas dans le champ d’application des dispositions régissant la vente commerciale.
71 R. DAVID, « Structure et idéologie du droit brésilien », (suite) in Cahiers de législation et de bibliographie juridique de l’Amérique Latine, nº 19-20, juill.-déc., 1954, pp. 5-18, spéc. p. 11.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
43
délai imparti pour l’exécution de l’obligation et ex persona, si un terme, contractuel ou légal, n’est pas établi (art. 397, C. civ. 2002)72.
En matière de sociétés, on peut vérifier le remplacement du système de chartes individuelles73 par celui de la liberté de constitution. En France, cette transition s’est faite dans le cadre d’une réglementation générale de la matière au sein du Code de commerce74. La société anonyme, par exemple, fut attachée au seul domaine du droit privé, malgré l’exigence d’une autorisation administrative (art. 37, C. com. 1850)75 pour sa création dans un environnement libéral76. Sous l’influence française, ce passage du système de privilège à celui de l’autorisation77 s’est également opéré au Brésil en 1850 (art. 295, C. com. 1850). D’autres influences du Code de commerce français en la matière peuvent être mentionnées : d’abord, le Code de commerce brésilien n’a pas non plus attribué à la société anonyme le caractère commercial par sa forme, mais par son objet (art. 295, C. com. 1850)78 ; ensuite, ce code a introduit l’action nominative, dont la propriété
72 Il faut tout de même relativiser l’importance de la différence de régime existant auparavant, car dans la pratique les contractants dérogeaient aux règles codifiées assez régulièrement, étant donné leur caractère supplétif, et établissaient dans le contrat leur propre régime de mise en demeure. Il est à remarquer que, nonobstant les dérogations contractuelles, dans de nombreux cas le régime élaboré par les parties penchait vers la règle dies interpellat pro homine.
73 Ce fut dans le cadre d’une structure mercantiliste d’échange où le public et le privé étaient étroitement liés dans la réalisation des projets expansionnistes des grands Empires colonialistes européens, qu’ont surgit les premières sociétés modernes. À défaut d’une discipline générale sur la matière dans l’intérieur de l’ordre juridique des États nationaux alors en récente formation, chaque société (compagnie) portait un statut individuel, toujours révocable, dont le fondement se trouvait dans une charte ou une patente royale. Délivrée par l’autorité publique, cette charte définissait la constitution et la personnalité de ces compagnies, leurs obligations, leurs droits et leurs privilèges – vu qu’elles étaient constituées pour une entreprise déterminée, notamment colonialiste, à exemple de la Compagnie française des Indes Orientales (1964).
74 Cette liberté fut d’abord affirmée par la Convention de 1789, avant de souffrir un coup dur en 1791 avec l’édition de la Loi Le Chapelier qui interdisait les associations de toute espèce. Mais face aux dégâts économiques provoqués par cette interdiction, la liberté s’est de nouveau imposée aux compagnies interdites de fonctionner, quelques abus en découlant, faisant appel à un contrôle, qui n’allait pas tarder à s’instaurer.
75 Délivrée par le Conseil d’État. Selon G. RIPERT et R. ROBLOT (Traité de droit commercial, op. cit., n° 1003, p. 790), le système d’autorisation fait partie d’un contexte où « il parut impossible de permettre la libre création de sociétés anonymes dans lesquelles aucun associé n’était commerçant et personnellement responsable »
76 V. A. LEFEBVRE-THEILLARD, Histoire de la société anonyme au XIXe siècle, Paris, PUF, 1984 ; et B. OPPETIT, L’expérience française de codification en matière commerciale, D. 1990, chr. 1.
77 D’ailleurs toujours révocable, d’où le fort recours aux sociétés en commandites par action en France durant la première moitié du XIXe siècle, « fièvre des commandites », qui était de constitution libre et sans s’assujettir aux réglementations spécifiques aux sociétés par action (E. RICHARD, « Un pour tous, tous pour un : l’entreprise en société », op. cit., p. 336 et 355 s. ; pour les détails du régime d’autorisation en France, v. ibidem, n° 762, p. 354 et 355).
78 En droit français, la nature commerciale de société anonyme par sa forme sera reconnue par une loi de 1893, largement motivé par la crise déclenchée par l’échec de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
44
appartient à celui qui est inscrit sur les registres de la société (art. 297, C. com. 1850).
Le Code de commerce brésilien a également adopté la conception française de la lettre de change en vigueur jusqu’en 1848, selon laquelle celle-ci n’était qu’un simple moyen de paiement attaché à un contrat de vente (qui était la cause de son émission) et fondé sur la délégation (mandat), dont l’existence d’une provision constituait une condition d’affaire. Avec l’abrogation du Titre XVI (arts. 354 à 427) du Code de commerce brésilien par le Décret n° 2044 du 31 décembre 190879, le droit brésilien a abandonné la conception française pour adopter la conception italo-allemande de la lettre de change qui, en lui donnant un caractère abstrait, la dissociait de la cause de son émission et des questions liées à la provision de fonds80.
Le droit français a contribué de façon déterminante à l’élaboration de la partie du code brésilien concernant le droit maritime, nonobstant l’influence qu’a pu exercer la doctrine anglaise dans sa rédaction. Par ailleurs, la manière dont a été organisée la matière dans les deux codes ainsi que leurs énoncés sont fort semblables81.
En synthèse, le droit français a surtout servi de base, à côte des autres codes de commerce des pays européens, à l’élaboration de la première partie du Code de commerce brésilien. L’exposé des motifs l’a ainsi clairement annoncé, tout comme y ont été indiquées les raisons pour lesquelles il devait y avoir une sensible distance des législations étrangères en ce qui concerne les deux autres parties du code plus son « Titre unique »82.
79 Partiellement abrogé par le Décr. n° 57.663, du 24 janv. 1966, qui a promulgué la
Convention du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (avec annexes et protocoles).
80 La pratique allait cependant conserver dans une large mesure la conception française, au moins dans le commerce intérieur, la lettre de change étant émise dans tous les rapports entre commerçants brésiliens et accepté dans toute vente commerciale à crédit de marchandises (R. DAVID, « Le droit brésilien jusqu’en 1950 », op. cit., p. 180).
81 À ce propos, la Commission qui a élaboré le projet du Code de commerce s’est ainsi exprimée : « Depuis que Louis XIV a réduit à système le célèbre Ordonnance de 1681, celle-ci est devenue le Code universel de tous les opérateurs du commerce. Aucun rédacteur des codes commerciaux, après la publication de dite Ordonnance, a osé jusqu’aujourd’hui à lui modifier : ce aurait été donc un crime de la Commission si elle osait prendre l’initiative innover les principes ont en soi-même l’essence de l’immuabilité ; la Commission a copié fidèlement des articles que tous les codes ont copié de cette source aussi rare : c’était celui-ci son devoir, et elle l’a accompli » (apud W. FERREIRA, Tratado de direito comercial, vol. I, op. cit., p. 97). Sur la partie concernant le droit du commerce maritime, v. également Alvaro SOARES BRANDÃO, « A contribuição de um diplomata sueco à codificação comercial brasileira », Revista de direito mercantil (RDM), 1, 1951, pp. 22-31, où l’auteur apporte non seulement la contribution du diplomate suédois à la codification de 1850, mais aussi les critiques que celui-ci a émises sur la méthode de travail de la commission dont il faisait partie.
82 B. MIRAGEM, « Do direito comercial ao direito empresarial. Formação histórica e tendências do direito brasileiro », Revista de direito privado, vol. 17, p. 71-98, spéc. p. 79. En effet,
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
45
L’influence du Code de commerce français dans l’élaboration du Code de commerce brésilien ne s’est pas restreinte aux seules matières que le premier réglait de manière expresse, mais elle est allée au-delà…pour atteindre aussi les matières qui lui avaient échappé. Tout comme le code français, le code brésilien est resté silencieux sur toute une série de matières qui demandaient un traitement législatif immédiat, à savoir pour n’en citer que quelques exemples : les facteurs (affactureurs) et commis, les assurances terrestres ; le crédit ; le chèque ; le fonds de commerce ; les sociétés par actions83 ; les sociétés à responsabilité limitée ; les parts de fondateur et les obligations, la comptabilité ; l’organisation des bourses et des banques ; la propriété industrielle.
Bien que le Code du commerce français ait largement influencé l’élaboration du Code de commerce brésilien, des particularités existent dans l’expérience brésilienne.
3. Les différences entre les deux codes de commerce
Une différence essentielle semble éloigner les deux ensembles législatifs. Le Code français de 1807 semble avoir adopté un concept plutôt objectiviste du droit commercial84, structurant celui-ci sur l’acte de
tel que l’a souligné Alfredo RUSSELL (« O direito comercial e sua codificação », in Livro do centenário dos cursos jurídicos (1827-1927), vol. I - Evolução histórica do direito brasileiro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1928, pp. 125-156, spéc. p. 126), l’objectif était d’une part de doter le Code de commerce brésilien de règles et de principes adoptés par toutes las nations commerçantes et de faire une sorte que le code soit en harmonie avec les usages et coutumes du commerce également présents chez tous les peuples commerçants et d’autre part de l’accommoder aux circonstances spéciales du peuple brésilien. On pourrait justifier que la première partie concernait les aspects généraux du commerce, partant universels, et que pour cette raison il paraissait normal d’aller chercher dans les législations des nations plus développées les substrats juridiques nécessaires à l’édification de règles présentant le même niveau de sophistication. Il semblait également raisonnable que pour la partie concernant la faillite l’on soit plus attentif aux caractéristiques et aux pratiques du commerce local qu’aux pratiques d’ailleurs, afin de trouver les solutions plus adaptées à préservation de l’économie national. Par contre, pour la partie concernant le droit du commerce maritime, des bonnes solutions législatives ne sauraient être prises qu’en tenant compte du droit comparé, car les principes, les règles, les usages et les coutumes en la matière se répandent dans tout le monde civilisé de manière à lui donner un caractère très universel.
83 Le Code brésilien disposait de seulement cinq articles en matière de sociétés par actions (art. 295 à 299).
84 Conclusion à laquelle sont arrivés les auteurs classiques par le biais de la méthode exégétique, conjuguant l’art. 1er (définition de commerçant) avec l’art. 3 (qui parlait des faits de commerce), l’art. 631 (qui affirmait la compétence des tribunaux pour les contestations relatives aux actes de commerce) et les arts. 632 et 633 (qui donnaient une liste numerus clausus des actes de commerce). Selon G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op. cit., n° 8, p. 6), à cette méthode l’on pourrait opposer une autre lecture de ces mêmes dispositions pour défendre une conception subjective : « l’art. 1er décide que, pour être commerçant, il faut faire profession habituelle d’exercer des actes de commerce ; les arts. 631 et 632 déclarent la juridiction commerciale compétente pour toutes contestations entre négociants, (…) ».
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
46
commerce85 et non sur le commerçant - concept subjectiviste dominant en France jusqu’en 179186 ; le Code brésilien à son tour était muet sur la question des actes de commerce et semble ne pas avoir suivi l’orientation napoléonienne.
En effet, le Code de 1850 a essentiellement structuré le droit commercial brésilien sur la notion subjective et conservé l’orientation de l’époque qui voulait le droit commercial comme un droit de classe87. Contrairement au Code de commerce français, le Code de commerce brésilien ne possédait pas un titre dédié à l’acte de commerce et ouvrait la première partie avec un titre dédié aux commerçants. Dans celui-ci, après avoir établi les conditions subjectives à l’exercice du commerce (art. 1er) ainsi que les prohibitions (art. 2 et 3), le législateur a défini le commerçant comme la personne qui, immatriculée dans un tribunal de commerce, fait du commerce sa profession habituelle (art. 4)88. Cette définition est par ailleurs très proche de celle du Code de commerce français (actuel art. L. 121-1)89, à la différence qu’en France, l’inscription du commerçant auprès du registre de commerce n’est exigée qu’en vertu d’un texte spécial90.
Cette différence de conception est importante, car elle suppose un régime juridique différent. En partant d’une approche objectiviste, on applique les mêmes règles commerciales aux mêmes personnes, indépendamment de la qualité de ceux qui réalisent les actes de commerce ; alors qu’en partant d’une approche subjectiviste, on défend l’idée selon
85 Actuels arts L. 110-1 et L. 110-2 (anciens arts. 632 et 633) du Code de commerce français. En effet, le Code de Commerce ne donne pas de définition de l´acte de commerce, mais procède par énumération et distingue trois types d´actes de commerce, les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et enfin, les actes de commerce en vertu d’une présomption légale (dite « théorie de l’accessoire »).
86 Selon J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 1, op. cit., p. 67), ce changement de conception aurait contribué à la transformation du droit commercial et au renforcement de son autonomie. L’acte de commerce a donc été le fondement de l’évolution du droit professionnel.
87 On notera par ailleurs que le Handelsgesetzbuch allemand de 1897 ne partage pas non plus la perspective française et fonde son droit commercial également sur la notion de commerçant (§1). Il n’hésite cependant pas à consacrer tout un livre aux actes de commerces (Livre III), en adoptant une définition très générale selon laquelle sont réputés actes de commerce (Handelsgeschäfte) toutes les opérations effectuées par un commerçant dans l’exploitation de son commerce (§ 343), notamment celles énoncées dans le § 1, même si certains de ces actes ne rentrent pas dans la catégorie d’affaires qu’il traite ordinairement.
88 Notion reprise par l’art. 967 du nouveau Code civil brésilien de 2002, qui traite de l’inscription de l’entrepreneur (empresário), l’ancien commerçant, auprès du Registre public des entreprises mercantiles.
89 Art. L. 121-1 : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »
90 Dans la France de l’Ancien Régime, les normes commerciales ne s’appliquaient qu’aux commerçants inscrits auprès des corporations. Au non de la liberté d’entreprendre, le Déc. du 14 juin 1791 (la Loi Le Chapelier) a anéanti les corporations et par conséquent le besoin d’inscription du commerçant auprès de la corporation de sa profession. Le Code de 1807 a confirmé la rupture avec l’ancien droit et rejeté le droit commercial comme un droit de classe (v. note 111).
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
47
laquelle les hommes se livrant au commerce sont tenus par un ensemble d’obligations et de prérogatives spéciales, exposés aux rigueurs de la faillite et, le cas échéant, soumis à la juridiction des tribunaux d’exception91.
Quoi qu’il en soit, une liste d’actes de commerce, dont l’énumération n’est pas limitative, est néanmoins adoptée par le droit brésilien par le biais d’une législation complémentaire92, et ce afin de donner aux magistrats et aux praticiens les moyens d’établir la compétence des tribunaux de commerce93, ainsi que la loi applicable94. Le choix d’une orientation apparemment subjective n’a cependant pas empêché le Code de commerce brésilien de se servir de la notion d’acte de commerce pour régler certaines situations95. Ainsi, l’article 30 l’emploie pour l’application des dispositions du Code de commerce aux actes pratiqués par des étrangers ayant leur résidence au Brésil, et l’article 75 l’utilise pour déterminer la responsabilité des commerçants pour les actes réalisés par leurs préposés. En outre, les articles 441 à 456 s’en servent pour l’application des règles et des délais de prescription. Finalement, comme l’a remarqué R. Requião96, en fonction de l’ancienne dichotomie du droit privé brésilien, l’interprète était amené à diverses occasions à vérifier la commercialité de certains actes réalisés en nombre, afin de définir la nature commerciale des activités ou des sociétés et, par là l’attribution de certains droits ou privilèges dont la faillite et le concordat dit préventif ainsi que la protection du fonds de commerce par le biais du droit au bail commercial.
Malgré le silence du Code de commerce brésilien sur la définition de l’acte de commerce et l’absence d’une énumération d’actes rentrant dans cette catégorie, il a réglementé un grand nombre d’actes relatifs à l’activité commerciale. Ainsi, il a réglementé les grands contrats d’usage courant, notamment le mandat et la commission commerciale, la vente et l’échange commerciaux, ainsi que le louage, le prêt, l’hypothèque, le gage et le dépôt commerciaux.
Une autre différence assez remarquable procède du fait que le Code de commerce brésilien a réglementé de façon assez détaillée les obligations et les contrats commerciaux, notamment la vente commerciale (arts. 191-220),
91 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, op. cit., n° 5 et 7, pp. 3-5. 92 Art. 19 du Regulamento n° 737 de 1850. 93 Le problème de la détermination de la compétence juridictionnelle allait toutefois
disparaître en 1875, lorsqu’on a mis fin aux tribunaux de commerce (Déc. 2.662, du 9 oct. 1875) et établi définitivement l’unité procédurale du droit brésilien (Déc. n° 6.385, du 30 nov. 1876).
94 A. P. FERRONATTO, « A empresa no novo Código civil: elemento unificador do direito privado », RT 843.11, spéc. p. 12.
95 Ce qui renforce l’affirmation de Jean Escarra, selon laquelle il n’y a pas, dans le droit positif, un système objectif ou un système subjectif pur, apud R. REQUIÃO, op. cit., p. 41. Le Code brésilien lui-même ne semble avoir employé l’expression acte de commerce qu’une seule fois (art. 30), dans les autres cas c’est le terme acte qui fut utilisé (v. art. 75).
96 R. REQUIÃO, op. cit., pp. 35-36.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
48
tandis que le code français de 1807 ne lui a dédié qu’un seul article (l’ancien art. 109, concernant la preuve des actes de commerce). Le Code civil français ayant consacré 120 articles à la vente, parmi les 800 consacrés aux contrats, il a paru normal qu’en ce domaine le Code de commerce de 1807 se présente comme une exception au droit commun civil97. Le Code de commerce brésilien ayant fait son apparition avant la consolidation de lois civiles de 195898 et la codification civile de 1916, il a paru impératif de le doter de dispositions concernant les obligations et les contrats. Faute d’un droit civil codifié, les rédacteurs du Code de commerce brésilien ont dû « pénétrer dans le territoire du droit civil et amener au sein du code de commerce la matière qui, d’habitude, ne devrait pas y figurer, tels que la partie générale concernant les obligations et les contrats, le mandat, l’échange, le bail, l’hypothèque, la caution, le gage, le dépôt, le paiement, la novation, la compensation, etc… »99. On a parlé de l’envahissement de la sphère du droit civil par ce Code de commerce100. Mais outre l’absence d’un droit civil codifié, doté des règles générales sur les obligations et les contrats qui puissent servir de base aux opérations commerciales, le choix d’incorporer ces deux matières dans le Code de commerce brésilien semble également avoir été possible en raison de l’expérience espagnole (1829) et portugaise (1833) en la matière101.
En matière d’obligations, le Code de commerce brésilien présentait plus de points communs avec les Ordonnances Philippines de 1603 qu’avec le droit français. À titre d’exemple, le droit brésilien a conservé la nécessité de la tradition102 pour le transfert de la propriété (art. 199, C. com. 1850), avec la possibilité qu’elle soit réelle ou symbolique (arts. 199 et 200, C. com. 1850). En droit brésilien, on vérifie également l’absence d’une règle telle que celle prévue à l’article 2279 du Code civil français, selon laquelle « en fait de meubles la possession vaut titre ».
Une autre particularité que l’on peut souligner est celle de l’unification par entrelacement des obligations civiles et commerciales prévue par le Code de 1850. En effet, l’article 121 établissait que les règles civiles
97 E. RICHARD, op. cit., p. 103. 98 La Consolidation des lois civiles élaborée par Augusto Teixeira de Freitas constituait une
compilation de lois en vigueur au Brésil, en se substituant aux textes dont elle a reproduit les solutions. Elle a été approuvée par l’Empereur le 22 décembre 1858 et portait une telle autorité, que maintes fois elle a été utilisée par les juristes comme source du droit.
99 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. I, op. cit., p. 104. 100 A. TEIXEIRA DE FREITAS, Additamentos ao Código Comercial, vol. I, 1879, p. XI et
XLI. 101 Situation qui s’est reproduite dans la codification commerciale argentine de 1862, puisque
le second livre du code de commerce demeure toujours intitulé: « De los contratos de comercio ». Cf. J. L. ANAYA, « El influjo del Código de comercio francés en la codificatión argentina », op. cit., p. 101 et s.
102 Remise matérielle de la chose dont le transfert de propriété est dépendant.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
49
applicables aux contrats (obligations) en général l’étaient également aux contrats commerciaux, avec les modifications et restrictions établies par le Code de commerce103. De la même manière, le Règlement 737 de 1850 stipulait que les lois civiles constituaient la principale source des usages, exception faite des questions relatives aux sociétés et des cas expressément prévus (art. 2, al. 2).
Nonobstant l’importance de l’avènement de ces deux codes de commerce pour l’affirmation de l’autonomie et l’expansion du droit commercial en Europe et en Amérique latine respectivement, ainsi que l’influence de l’un sur l’autre, leur anachronisme était patent. Une large évolution mettra en valeur les originalités de chacune des codifications.
II. LES INNOVATIONS LÉGISLATIVES AU FIL DU TEMPS En raison de l’anachronisme de leurs codes de commerce, tant le droit
commercial français que le droit commercial brésilien ont connu diverses innovations au fil du temps.
En effet, des évolutions séparées peuvent être observées au travers d’un aperçu de ce qu’est devenu le droit commercial brésilien et la place occupée par le droit français.
A. - L’évolution des droits français et brésilien du commerce Dans l’histoire du droit français, on a pu dire que le code du commerce
s’est toujours placé dans l’ombre de son Grand frère, le Code civil104 Si toute grande codification représente à la fois une rupture avec le passé et son maintien105, le Code de commerce français a été une exception. Entré en vigueur le 1er janvier 1808, avec la mission de remplacer l’ancienne législation royale, le Code de commerce français devait d’une part « corriger les abus qu’un régime d’excessive liberté avait introduits dans les relations commerciales » et, d’autre part « obéir aux progrès qui s’étaient déjà accomplis dans l’économie publique »106. Il se serait cependant limité à la
103 Lorsque la loi civile ne s’accordait pas avec la nature commerciale du rapport juridique, le Code du commerce déterminait son écartement en faveur des usages et des coutumes commerciales, à l’exemple de l’ancien art. 921.
104 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, « Das neue französische Handelsgesetzbuch - ein kritischer Beitrag zur Methode der codification à droit constant », Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), 1/2004, pp. 132-152, spéc. pp. 133-134.
105 Ph. MALAURIE, « L’utopie et le bicentenaire du Code civil », in 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, op. cit., pp. 1-8, spéc. p. 6.
106 A. de SAINT-JOSEPH, op. cit., 1844, p. XII.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
50
simple mise à jour de la législation abrogée « code de Savary », avec une étonnante méconnaissance des changements sociaux et économique de l’époque : une codification manquée, selon l’expression employée par M. Richard107.
En effet, le XIXe siècle illustre bien une sorte de fracture entre le droit issu du code et l’économie108. Le Code de 1807, basé essentiellement sur les Ordonnances de Louis XIV de 1673 et de 1681, avait comme caractéristique un texte dissocié de la réalité économique109, même si on a reconnu qu’« le moment n’était pas encore venu où le commerce, sorti de ses anciennes limites, devait révéler tous les besoins de sa législation »110. Outre la démarche objectiviste111, il lui a été reproché diverses lacunes. Ces dernières ont été aussitôt comblées par de nombreuses lois spéciales112, par le Code civil113, par les usages du commerce114 et par la doctrine. La jurisprudence a joué un rôle assez restreint115, car l’arbitrage était souvent préféré en la
107 E. RICHARD, op. cit., p. 103. 108 E. RICHARD, op. cit., p. 102 et s. 109 Selon F.-X. LICARI et J. BAUERREIS (« Das neue französische Handelsgesetzbuch…»,
op. cit., p. 135), cela est d’autant plus étonnant lorsqu’on vérifie que les auteurs du Code étaient des commerçants ou banquiers expérimentés, qui, sur la base de leurs expériences internationales, connaissaient très bien les changements sociaux et économiques en Grande-Bretagne et auraient dû reconnaître les signes annonciateurs de la révolution industrielle en France.
110 HORSON, Questions sur le Code de commerce, Paris, 1829, t. 1, p. 29, apud P. DIDIER et Ph. DIDIER, Droit commercial, T. 1, Economica, 2005, p. 85.
111 En effet, le code du commerce est devenu celui du commerçant, doté d’une juridiction spéciale, en contradiction totale avec les paradigmes de la Révolution, notamment celui d’une seule loi et d’un seul tribunal pour tous. L’approche subjective fut une des séquelles héritées de la copie servile du « code Savary » ; l’approche objective fut à nouveau privilégiée par l’action de la jurisprudence du XIXe siècle. Cf. J. MONÉGER, précit., p. 180. Le choix pour un système objectif semble avoir été aussi une solution pour justifier une juridiction subjective, dont la manutention après la Révolution aurait motivé en large mesure l’édition du Code de commerce de 1807 (Julio C. OTAEGUI, « La codificación comercial en América Latina », in La Codificación : raíces y prospectiva II – La codificación en América, op. cit., pp. 175-181, p. 177.
112 À titre d’exemple : les lois de 1838, 1867 et 1889 sur les faillites et la liquidation judiciaire; les lois de 1903 et 1908, qui atténuaient la rigueur de la banqueroute ; les lois de 1856, 1853 et 1866 sur les sociétés par actions ; la loi de 1865 sur les chèques ; la loi de 1894 sur la lettre de change ; les lois de 1898 et 1913 sur le nantissement et le fonds de commerce ; les lois de 1844 et 1902 sur les brevets d’invention ; la loi de 1858 sur les magasins généraux et les warrants ; la loi de 1919 sur le registre du commerce ; la loi de 1925 sur les SARL, entre autres. Maintes de ces lois sont le fruit des influences étrangères, notamment anglaise (chèque, warrants, sociétés) et allemande (SARL, registre du commerce).
113 Selon E. RICHARD, op. cit. p. 103 : c’est bien la défaillance de la source que pouvait constituer le Code de commerce, qui va, par effet de balancier mettre en exergue les autres sources du droit commercial à cette époque, à savoir et en particulier le Code civil, qui imposait ses modèles, malgré son inadaptation au commerce.
114 Toujours prédominante, v. exemples donnés par E. RICHARD, op. cit. p. 105. 115 L’arrêt de la Cour de cass., du 11 mars 1914, Caisse rurale de la Commune de Manigod,
lequel fixe le but économique comme critère de la distinction entre la société et l’association, en étant un exemple.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
51
matière116. On pouvait également reprocher au Code français de 1807 d’être une loi qui n’encourageait guère la créativité des commerçants117, mais qui établissait un contrôle trop rigide des acteurs du commerce118, en les présentant comme suspects par le biais de sanctions trop lourdes (faillites, banqueroutes), de longs développements consacrés à la juridiction commerciale, de la rigueur par rapport aux livres commerciaux et de l’autorisation requise pour la constitution de sociétés anonymes, révocables ad nutum119.
À la fois paralysant et lacunaire120, le Code de commerce français est vite devenu sans utilité pour les hommes d’affaires et la cible de fortes critiques de la part de la doctrine121. Il était « un faux né », déjà inadapté, médiocre de sa structure et de son contenu et disproportionné, contenant 200 articles sur les faillites sur ces 648 articles122. Il n’a donc pas tardé à ce que l’immense majorité des articles issus de la rédaction napoléonienne soit retouchée, voire carrément transformée, des livres entiers ayant été remaniés, à commencer par le livre III sur les faillites et banqueroutes, remplacé par une loi spéciale de 1838123. Dès lors, une longue phase de décodification124 du droit commercial français s’est instaurée125 jusqu’à la mise en place d’un processus de recodification, démarré en 1948 selon une méthode de « codification à droit constant »126. Cette méthode française a
116 E. RICHARD, op. cit., p. 106. 117 MONÉGER, précit., p. 180. 118 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 134. 119 E. RICHARD, op. cit., pp. 102-103. 120 E. RICHARD, op. cit., p. 102 s. 121 Le titre de l’ouvrage de VINCES, édicté en 1821, est révélateur : Exposition raisonnée de
la législation commerciale et examen critique du code commerce, apud E. RICHARD, , op. cit., p. 101.
122 Cf. J. MONÉGER, précit. p. 179-184 et 184-185. 123 Il ne reste au sein du nouveau code que les anciens articles 1re, 632 et 633 (actuels articles
L 121-1, L110-1 et L. 110-2). Une permanence qui, selon E. RICHARD (ibidem, p. 101), « est lourde de portée, car ces articles évoquent la question de la qualité de commerçant, question aujourd’hui toujours aussi floue ».
124 Commencée en effet dès 1830, lorsqu’on voit succéder des lois sur les tribunaux de commerce (1830), sur les conditions de vente des marchandises (1837-1841), sur les transports maritimes (1835-1841). Pour MM. DIDIER (op. cit., p. 87), l’expression décodification est « sans doute malheureuse car elle traduit un sentiment de tristesse devant un phénomène qui est, en réalité, l’expression de la vitalité et de l’expansion de cette branche de notre droit ».
125 Consulter essentiellement B. OPPETIT, « La décodification du droit commercial français », in Mélanges Rodière, Paris, Dalloz, 1982, p. 1 et s ; « L’expérience française de la codification en matière commerciale », D. 1990, chr., I ; « De la décodification », D. 1996, chr. 33 ; R. CABRILLAC, Les codifications, coll. « Droit Fondamental », Paris, PUF, 2002.
126 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 135 et s. Cette méthode implique, selon ces auteurs, à codifier sans conduire au changement de la loi : “ Von dem klassischen Typ der rechtsfortbildenden, reformierenden Kodifizierung ist die so genannte codification à droit constant oder codification administrative zu unterscheiden, die zu keiner inhaltlichen Gesetzesänderung führt.“ Autrement dit, la codification « à droit constant » a comme seul souci « la mise en ordre du
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
52
conduit, à travers l’incorporation de plusieurs lois spéciales touchant à d’importants domaines du droit commercial127, à l’aboutissement d’un nouveau Code de commerce128. L’étendue de son contenu ainsi que la difficulté de son classement dans le système objectif ou dans le système subjectif, ont mené la doctrine à poser la question de l’existence d’un « système » dans le nouveau Code du commerce129.
Tout d’abord, codifier à nouveau le Code de commerce français aurait plus signifié la réunion des dispositions de droit commercial dans un Code de commerce que l’élaboration d’un Code pour le commerce130. En effet, ce nouveau code n’entendait pas changer les textes existants mais les rendre accessibles par une codification « à droit constant » qui ignore cependant la jurisprudence.131 Il n’a pas été question d’élaborer un code de droit de l’entreprise ou de droit des affaires ou encore moins d’un code des activités économiques132 mais d’élaborer « des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et d’harmoniser l’état du droit »133. Il ne s’agit donc pas d’un véritable nouveau Code de commerce, mais d’une compilation de lois jusqu’alors en vigueur134. droit positif existant » (Ph. MALAURIE, « L’utopie et le bicentenaire du Code civil », op. cit., p. 1-8, spéc. p. 3). Pour connaître les illusions et les effets provoqués par cette méthode dans la recodification du droit commercial français, consulter notamment CABRILLAC, Les codifications, op. cit. ; D. BUREAU et N. MOLFESSIS, « Le nouveau code de commerce : une mystification », D. 2001, chr., p. 366 ; J. MONÉGER, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de commerce français de septembre 2000 … », précit., p. 186 ; « De la ordenanza de Colbert de 1673 sobre el comercio al nuevo Código de comercio de 2000. Un ejemplo de la evolución de la codificación, in La Codificación : raíces y prospectiva I, op. cit., p. 79 et s ; F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, ibidem, pp. 147-152.
127 Telles les lois du 24 juill. 1966 sur les sociétés et du 25 janv. 1985 sur la faillite, l’Ordonnance sur le droit de la concurrence du 1er déc. 1986, et la loi du 25 juin 1991 sur la représentation commerciale.
128 Ordonnance n° 2000-912 du 18 sept. 2000 relative à la partie législative du code de commerce, JO n° 219 du 21 sept. 2000, p. 19042. L’art. 4 de cette ordonnance abroge, avec effet immédiat, les textes dont le contenu est repris dans l’annexe de l’ordonnance qui constitue désormais la partie législative du Code de commerce. Le même art. 4 prévoit en outre l’abrogation, au jour de l’entrée en vigueur de la future partie réglementaire du Code de commerce, des textes de forme législative mais de nature réglementaire, qui seront ultérieurement codifiés dans cette partie réglementaire. Cf. C. ARRIGHI de CASANOVA et O. DOUVRELEUR, « La codification par ordonnances. À propos du Code de commerce », JCP G, n° 2, 2001, I, p. 285.
129 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 146. 130 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 146. 131 MONÉGER, précit., p. 182 et s. 132 D. BUREAU et N. MOLFESSIS, précit., p. 366 ; F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit.,
p. 146, note 36. 133 Art. 1er de la loi d’habilitation du Gouvernement à proceder, par ordonnance, à l’adoption
de la partie législative de certains codes, dont le code de commerce (loi n° 99-1071 du 16 déc. 1999). Sur les principes appliqués pour la codification du Code de commerce français de 2000, v. C. ARRIGHI de CASANOVA et O. DOUVRELEUR, précit., p. 286 s.
134 Y. GUYON, Droit des affaires, T. 1, 12e éd., Economica, 2003, pp. 20-21.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
53
Ensuite, il paraît difficile d’affirmer le caractère objectiviste ou subjectiviste du nouveau Code français. En admettant l’application de certaines dispositions du nouveau Code aux non-commerçants, le législateur n’a pas privilégié le système subjectif135. En même temps, affirmer le choix pour le système objectif sur la base de l’article L-121-1, serait consacrer le caractère fort lacunaire du nouveau Code de commerce, car de nombreux domaines juridiques reste en dehors de son domaine d’application136. Un tel objectif serait également contradictoire en soi, puisque l’on pourrait à peine justifier le traitement, dans le Code de commerce, de beaucoup de domaines professionnels étrangers aux commerçants137. Ceci a permis à la doctrine d’affirmer que le nouveau Code de commerce n’est ni le code des commerçants, ni le code des actes de commerce, ni celui des activités commerciales, ni un code des principes essentiels du droit commercial, ni même celui des règles censées marquer le particularisme de la matière à défaut de comprendre en son sein les dispositions relatives à la compétence des tribunaux de commerce ou, par hypothèse, la présomption de solidarité en matière commerciale138. Malgré toutes les critiques virulentes que la doctrine ait pu faire à la nouvelle codification, dont la plupart sont liées plutôt à la méthode qu’au fond139, un auteur a souligné que le code de 2000 a apporté au « vieux code épuisé » un rajeunissement et une structure satisfaisante140.
Tout comme le Code de commerce français, le Code de commerce brésilien n’a pas résisté à la fracture entre ses règles et le bouleversement de l’économie du XIXe siècle. Comme le code français avant la recodification des lois commerciales en 2000, le Code brésilien a eu le même sort. Après sa promulgation en 1850, le législateur brésilien a renoncé à l’enrichir de
135 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 147. 136 Comme les opérations de banque, le transport par terre ou par eau. Cf. D. BUREAU et N.
MOLFESSIS,.précit., p. 367. 137 F.-X. LICARI et J. BAUERREIS, précit., p. 147. 138 D. BUREAU et N. MOLFESSIS, précit., p. 367. 139 Parmi de nombreux articles, v. notamment D. BUREAU et N. MOLFESSIS, précit. p. 366
et s ; Ph. REIGNÉ et T. DELORME, « Une codification à droit trop constant. À propos du code de commerce », JCP E 2001, act. n° 1, p. 2 ; N. MOLFESSIS, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTD Civ. 2000, p. 186 et s ; GUY, « La codification : une utopie », RFD const. 1996, p. 307 ; T. LE BARS, « Nouvelles observations sur la codification ‘à droit constant’ du code de commerce », JCP E 2000, p. 2164 ; A. LIENHARD et C RONDEY, « Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit constant », D. 2000, chr., p. 523 ; H. MOYSAN, « La codification à droit constant ne résiste pas à l’épreuve de la consolidation », JCP G 2002, p. 1231 ; GB, « Le code de commerce nouveau est arrivé ! ("Arrêter de recoder !") », Bull. Joly 2000, p 883. Maintes des réserves émises par la doctrine sont anciennes puisque F. TERRÉ et A. OUTIN-ADAM préconisaient déjà en 1994 de « renvoyer ce monstre à l’expéditeur », « Codifier est un art difficile (à propos d’un.... ’code de commerce’) », D. 1994, Chr. 99, spéc. p.100. Pour une attitude réservée, mais plutôt optimiste : v. C. ARRIGHI de CASANOVA et O. DOUVRELEUR, précit., p. 285.
140 MONÉGER, précit., p. 182 et s.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
54
nouvelles dispositions, préférant satisfaire les besoins nouveaux du commerce en dehors de ce cadre normatif141. Durant les quarante ans qui ont suivi la publication du Code de commerce brésilien, une série de lois et de décrets régissant les banques et les sociétés, le transfert de titres de la dette publique et d’actions des compagnies ainsi que le chèque ont fait ressortir, outre le caractère très incomplet de ce code, une nette intervention et un fort dirigisme étatique qui s’accentueront à partir de 1889142.
Avec l’édition en 1890 d’un décret portant sur la réforme du régime de la faillite143 démarre ce que la doctrine a qualifié de troisième phase du droit commercial brésilien144. Marquent cette période à partir de 1911145 plusieurs tentatives de réforme ou d’élaboration d’un nouveau code de commerce, et l’affirmation de l’autonomie du droit commercial brésilien. Durant les travaux de l’élaboration de l’Esboço du Code civil brésilien, l’unification du droit privé a été même proposée par Teixeira de Freitas dans une lettre au Ministre de la Justice en 1867, mais elle fût rejetée par le Gouvernement. L’idée d’unification, au moins en matière d’obligations, demeurait cependant vivante chez les juristes brésiliens. Ils ont envisagé dans le courant du XXe siècle un Code unique des obligations146, tout en conservant pour les matières spécifiques au commerce une série de lois distinctes, sans les réunir dans le cadre artificiel d’un code.
Entre-temps, une vaste réforme du droit brésilien visant à compléter la législation commerciale s’est mise en place147, au moins en ce qui concerne
141 A. RUSSELL, O direito comercial e sua codificação, op. cit., p. 131. 142 Sur cette période de création législative en matière commerciale au Brésil, v. J.X.
CARVALHO de MENDONÇA, op. cit., p. 100 et s.; W. FERREIRA, op. cit., p. 10 et s ; A. RUSSELL, op. cit., p. 130 et s.; et B. MIRAGEM, précit., pp. 80-87.
143 Décret n° 917, du 24 oct. 1890 sur les faillites qui a abrogé la troisième partie du Code de commerce.
144 J.X. CARVALHO de MENDONÇA, op. cit., p. 100. 145 Pour une description de ces initiatives, qui n’ont jamais abouti, v. Julio O. Avila, Los
códigos de comércio latinoamericanos, op. cit., p. 248-251; W. FERREIRA, op. cit., p. 19-20 ; O. GIL, « A reforma do código comercial », Revista de direito mercantil, vol. 9, pp. 31-33.
146 Nous songeons ici aux projets suivants : Projet de Code de droit privé, proposé par Herculano Marcos Inglez de Souza en substitution au projet d’un nouveau Code de commerce, dont il a été chargé d’élaboration par le gouvernement brésilien en 1911 ; Projet de Code des obligations de 1940, proposé par Hahnemann Guimarães, Philadelpho Azevedo et Orozimbo Nonato ; Projet de Code des obligations de 1962/1965, du Professeur Caio Mário da Silva Pereira et alli.
147 À titre d’exemple, lois et décrets portant sur : l’immatriculation du commerçant (1855), les faillites (1860, 1890, 1902, 1908, 1929 e 1945), les registres publics et commerciaux (1890, 1973 et 1994), la vente aux enchères, les titres au porteur et débentures (1893, 1938), les magasins généraux et warrants (1903), la marine marchande et la navigation de cabotage (1903, 1931, 1932, 1938), les lettres de change (1908), les chèques (1912, 1931, 1942), les banques (1921, 1945, 1964), la navigation aérienne (1922, 1938), les sociétés de capitalisation (1933), les assurances (1932), les opérations de change (1933, 1953), les intérêts et l’usure (1933), le bail commercial (1934), les sociétés d’économie collective (1934), marques de fabrique, les brevets d’invention, registre du nom commercial et répression de la concurrence déloyale (1934), les titres négociables (1936), la clause d’or (1938), l’émission d’obligations au porteur (1939), le commerce itinérant (1940), les assurances
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
55
le commerce de terre, rien de significatif concernant le droit maritime ayant été proposé jusqu’à la fin de la Première République (1889-1930). Après la révolution de 1930, l’interventionnisme d’état a remanié la législation commerciale et atteint pratiquement tous les secteurs de l’activité économique148. En effet, avant même l’abrogation de ses première149 et troisième parties, le Code de commerce brésilien avait déjà perdu une partie de sa substance lorsque tout le domaine de la société anonyme lui a été enlevé150. Et même si quelques dispositions du Code de commerce de 1850 relatives au commerce maritime demeurent en vigueur, le droit maritime lui-même ainsi que d’autres domaines actuels du droit commercial font l’objet de lois spéciales et de traités internationaux.
Cet éparpillement législatif de lois au Brésil reproduit ce qui s’est également passé en France après la promulgation du Code de commerce de 1807, et nous mène à y reconnaître l’un des deux phénomènes qui vont contribuer au déclin de l’influence du droit français sur le droit commercial brésilien. En effet, ce même phénomène en France aurait certainement contribué à ce que l’influence française perde du terrain au Brésil, car il était difficile à cette époque-là, de suivre en permanence tous les travaux législatifs d’un pays pour être à jour de ses innovations151. Par ailleurs, l’impact d’une loi spéciale à l’étranger n’est parfois pas comparable avec celui que peut provoquer l’avènement d’un Code152.
privées et leur fiscalisation (1940), la création de la bourse d’assurance (1942), la société coopérative (1943), les sociétés de crédit, financement et d’investissement (1945), le tribunal maritime (1945, 1946, 1954) la propriété industrielle (1945), la liquidation extrajudiciaire des banques (1946), cessation des paiements, le système de paiement brésilien et le fonctionnement des chambres de compensation et de liquidation. En second lieu, de nombreux décrets ont incorporé des conventions internationales, tels les décrets de 1966 promulguant les lois uniformes sur le chèque et sur la lettre de change et les billets à ordre (Conventions de Genève de 1930 et 1931).
148 W. FERREIRA (Tratado de direito mercantil brasileiro, T. 1, 5ª ed., São Paulo, São Paulo ed., 1956, p. 263) attribuera la multiplicité de lois et son abondance aux régimes dictatoriaux qu’a connu le Brésil jusqu’à 1945. Le même phénomène se passera à partir de 1964, avec la prise de pouvoir par les forces armées.
149 Art. 2.045, Loi n° 10.406, du 10 janv. 2002 (nouveau Code civil), en vigueur depuis le 11 janv. 2003.
150 Décret n° 434 du 4 juill. 1891, qui a consolidé les dispositions légales en la matière (notamment la Loi n° 1.803 de 1860 et le Décret n° 2.711 de 1860), restant en vigueur jusqu’à la promulgation du Décret-loi n° 2.627, du 26 sept. 1940, abrogé à son tour par l’actuelle loi n° 6.404, du 15 déc. 1976. La société à responsabilité limitée n’a fait son apparition dans le droit brésilien qu’en 1919. D’inspiration allemande, ce modèle sociétaire était régi par le Décret n° 3.708, du 10 janv. 1919, actuellement abrogé par le nouveau Code civil, qui régit désormais toutes les sociétés (arts. 981- 1141), sauf la société anonyme.
151 À l’instar de la loi française sur les sociétés de 1966, qui a subi de nombreuses interventions législatives, ou du droit des entreprises en difficulté, qui en 50 ans a connu quatre grandes réformes (1955, 1967, 1985 e 2005).
152 Ce même phénomène a été également connu en Argentine, dont la codification du droit commercial a largement gravité au tour du Code napoléonien de 1807, à partir des modifications
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
56
On constate toutefois que, durant cette phase, le droit français a largement influencé le droit brésilien en matière de sociétés. La loi française du 24 juillet 1867 sur les sociétés est devenue la principale source de l’évolution législative en la matière tant pour l’Europe continentale que pour les pays américains. Inspirée du libéralisme économique, cette loi a introduit une réglementation assez détaillée et complexe pour les sociétés par actions153 et consacré, comme d’autres l’ont fait auparavant154, la pleine liberté de constitution pour les sociétés anonymes. En jurisprudence, on vérifie également l’importance toujours si forte du droit français en tant que droit étranger d’application subsidiaire en cas de lacune ou d’insuffisance du droit commercial brésilien pour régler certains litiges155. Cette invocation du droit étranger même en présence des corpus législatifs commercial et civil assez conséquents est le reflet d’une tradition juridique qui s’est forgée au Brésil dès les premiers jours de son indépendance avec la Lei da Boa Razão.
La présence constante du droit étranger dans la formation et dans le développement du droit brésilien et le caractère fort comparatiste des juristes brésiliens156 vont également contribuer à ce que le droit brésilien se détache de plus en plus du droit français pour emprunter à d’autres sources d’inspiration, parmi lesquelles les droits italien157, allemand158 et américain. apportées au code de commerce de 1862 par la réforme de 1889. J. L. ANAYA, « El influjo del Código de comercio francés en la codificatión argentina », op. cit. , p. 105.
153 Outre la liberté de constitution (art. 21, L. 1867), on remarquera d’une part le libéralisme excessif de cette loi en matière d’apports en nature, alors soumis à aucun contrôle lorsque la société n’était formée que par ceux qui les avaient fait ; d’autre part l’encadrement rigide de la constitution de la société se fait sentir, aussi bien à propos de la responsabilité solidaire des fondateurs et des administrateurs envers les tiers des conséquences de la reconnaissance de la nullité de la société pour faute dans sa constitution, dans ses formalités de publicité, qu’à propos des sanctions pénales, susceptibles de frapper ce qui ne pouvait être que de simples négligences dans l’administration courante de la société ; par ailleurs, la valeur nominale trop élevée des actions n’attirait guère les petits investisseurs, qui allaient préférer les actions étrangères (E. RICHARD, « Un pour tous, tous pour un: l’entreprise en société », op. cit., p. 365-366).
154 Dans l’État de New York en 1811 et en Grande-Bretagne en 1844 et en 1856. Sous l’influence du droit français, la liberté de constitution sera introduite en Espagne en 1869 ; en Allemagne en 1870 ; en Belgique en 1873 ; en Hongrie en 1875 ; en Italie et au Brésil en 1882 (Loi n° 3.150, du 4 nov. 1882).
155 V. l’arrêt du Tribunal Suprême commenté par R. REQUIÃO à la Revista de direito Mercantil, 11 (1952), p. 302, dans lequel fut partiellement appliqué le statut du représentant de commerce en droit français, à l’époque l’un des plus moderne en la matière.
156 C. JAUFFRET-SPINOSI (La circulation diu modèle juridique français…, op. cit. p. 109) souligne que « l’apport espagnol ou portugais, puis l’apport français, nord-américain, et en même temps souvent aussi allemand et italien, ont contraint les juristes d’Amérique latine à s’intéresser à d’autres droits qu’au leur, puisque leur droit émanait d’une grande variété d’inspiration étrangère ». Cf. H. VALLADÃO, « Le droit comparé au Brésil : la vision de 1950 », et A. WALD, « Droit comparé au Brésil : la vision de 2000 », op. cit., pp. 467-479 et 481-518 respectivement.
157 Selon R. DAVID (Le droit brésilien jusqu’en 1950, op. cit., p. 162-164), l’attirance des brésiliens pour l’étude du droit italien se justifie par plusieurs raisons, parmi lesquelles : la proximité des deux langues ; la présence d’immigrants d’origine italienne dans la culture juridique du Pays ; l’édition en italien de certains ouvrages ; l’universalisme accentué de la doctrine italienne ; la
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
57
En effet, le Brésil s’est traditionnellement fondé sur l’expérience des pays de l’Europe continentale dans l’élaboration et dans le remaniement de son droit privé, alors que le droit américain a servi de repère et exercé une influence considérable dans la construction du droit public. Cependant et « puisque les choses bougent », un tournant dans le jeu d’influences va se vérifier dans les dernières décennies : les droits romano-germaniques tendront à exercer une influence accrue dans le domaine du droit public, tandis que le droit américain deviendra une source incontournable pour le droit privé159.
B. - L’état actuel du droit commercial brésilien Sous les multiples influences étrangères et du foisonnement des lois les
juristes, magistrats et praticiens brésiliens s’adaptent. Néanmoins, ces phénomènes ne semblent pas remettre en cause le caractère à la fois codifié et éparpillé du droit commercial brésilien, si on peut encore le qualifier comme tel. L’avènement du nouveau code civil en 2002 ne supprime pas l’éparpillement des sources et les influences.
1. L’avènement du Code civil de 2002
Contrairement au droit français, au sein duquel demeure en vigueur le principe de la dichotomie droit civil et droit commercial, le droit brésilien a récemment connu un tournant vers l’unification de ces deux branches par l’avènement d’un nouveau Code civil. Promulgué en janvier 2002, ce nouveau Code est en effet l’aboutissement d’un projet de loi, dont la première ébauche date de 1972 et la dernière de 1975. Son texte a été élaboré par une Commission composée de juristes renommés et présidée par
présence des juristes italiens au Brésil, où ils édictaient des travaux en portugais (Ascarelli, Liebmann, Carnelutti, ce dernier participant activement dans l’élaboration du Code de procédure civile de 1939) ; et la codification unificatrice de 1942 en Italie. L’influence du droit italien s’est notamment vérifiée en droit des sociétés, en droit des obligations, en matière de titres négociables et dans la procédure civile et pénale.
158 Encore selon R. DAVID (ibidem, pp. 164-165), l’attirance des brésiliens vers l’étude du droit allemand, malgré les difficultés imposées par la différence entre les deux langues, difficultés surmontées par le recours systématique aux traductions française et espagnoles de certains ouvrages, se justifie surtout par la force séductrice de la philosophie allemande (Savigny : Teixeira de Freitas) ; par la proximité des deux droits au niveau des principes issus des doctrines romaniste, possible grâce au retard pris dans leur codification ; par l’influence de la théorie évolutionniste de R. von Jhering sur C. Beviláqua, R. Barbosa et T. Barreto (ce dernier étant fondateur de l’École de Recife, responsable pour promouvoir les idées germanistes et évolutionnistes dans le domaine du droit) ; et enfin, par l’engouement manifesté par la doctrine brésilienne à l’égard de thèses nouvelles et par l’effort du législateur brésilien pour moderniser le droit et pour fournir à la vie et à la société un modèle. L’influence du droit allemand se vérifie partout en droit privé, ainsi qu’en droit pénal.
159 A. WALD, op. cit., p. 490 et s.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
58
Miguel Reale, qui envisageait de doter le nouveau Code de trois principes fondamentaux dont découleraient également tous les autres160.
Ces principes fondamentaux sont ceux que Miguel Reale appelle l’eticidade (les valeurs éthiques), la sociabilidade (sociabilité) et l’operacionalidade (opérationnalité)161. L’eticidade trouve dans les systèmes des clauses générales (Generalklauseln)162 son moyen d’expression par excellence, et devra être concrétisée et par les avocats et par les juges163 dans l’application de celles-ci. La sociabilidade s’impose face à l’individualisme excessif de l’ancien Code civil, édicté dans le cadre d’une société essentiellement rurale (de l’ordre de 80%). Avec une population aujourd’hui concentrée dans les villes, il est apparu important d’insérer un critère de sociabilité dans les rapports juridiques modernes, comme le démontrent, entre autres, la consécration de la fonction sociale du contrat (art. 421, C. civ. 2002) et la consécration de la fonction sociale de la propriété (art. 1228, C. civ. 2002)164. Enfin, l’opérationnalité se révèle à travers l’idée d’offrir au milieu juridique un Code accessible et compréhensible, dont l’interprétation et l’application devraient être rendues faciles. Pour cela, outre les clauses générales, comme celle de la bonne foi (art. 422, C. civ. 2002) et les concepts indéterminés (flous) distribués un peu
160 Tels la protection de la personne (art. 11 s.), les actes d’affaire (Rechtsgeschäft) comme
source de création du droit (art. 104 s), l’unification du droit des obligations (art. 233 s.), l’édification du droit de l’entreprise (art. 966 s.), entre autres.
161 V. M. REALE, « Visão Geral do novo Código Civil », in Novo Código Civil brasileiro, estudo comparativo com o Código de 1916, Constitutição Federal, legislação comparada e extravagante, 2ª ed., São Paulo, Rev. Trib. Ed., 2002, p. IX s.
162 Il faut noter qu’en droit français, selon C. JAUFFRET-SPINOSI (« Théorie et pratique de la clause générale en droit français et dans les autres systèmes juridiques romanistes, in S. GRUNDMANN et D. MAZEAUD (dir.), General Clauses and Standards in European Contract Law, The Hague, Kluwer Law International, 2006, pp. 23-39), les mots « clause générale » ne font pas partie du vocabulaire juridique et que la notion de clause générale, telle qu’elle a été découverte et telle qu’elle est conçue en Allemagne, n’existe pas en droit français ; elle peut néanmoins être rapprochée de certains concepts connus du droit français, tels les principes généraux du droit, la notion de standard et de la bonne foi, sans que pour autant on puisse connaître une équivalence entre ces différentes notions.
163 Sur les clauses générales dans le droit brésilien, v. RUI ROSADO de A. Jr., « O Poder Judiciário e a concretização das cláusulas gerais: limites e responsabilidade », Rev. da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 18, 2000 ; F. MENKE, « A interpretação das cláusulas gerais : a subsunção e a concreção dos conceitos », Rev. Direito do consumidor, n° 50, 2004, pp. 9-35 ; J. M. COSTA, « As cláusulas gerais como fatores de mobilidade do sistema », RIL, vol. 112, 1991 pp. 13-32 et « O direito privado como um sistema em construção: as cláusulas gerais no projeto de código civil brasileiro », Rev. da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, 2001, pp. 211-260 ; A. J. DE AZEVEDO, « Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código civil na questão da boa fé objetiva nos contratos », RT, fasc. civ., vol. 775, 2000, pp. 11-17 ; E. S. DOS SANTOS, « O Novo código civil e as cláusulas gerais : exame da função social », RDPriv. n° 10, pp. 9-37 ; A. G. JORGE JUNIOR, Cláusulas gerais no novo código civil, São Paulo, Saraiva, 2004.
164 M. REALE, op. cit., p. XIII-XIV.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
59
partout au code, on a établi dans la tradition brésilienne une Partie générale extrêmement didactique qui contient maintes définitions légales165.
La forte inspiration des modèles italien et suisse en matière d’unification des obligations civiles et commerciales n’a pas été un obstacle à ce que le nouveau Code civil brésilien conserve la structure bipartite du Code civil de 1916 et les influences diverses qui ont participé à l’élaboration de celui-ci, dont l’influence française. La nouvelle codification n’a cependant pas fait l’unanimité. Les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses. Elles concernent soit la codification en elle-même, soit la façon dont certaines questions y sont traitées166. Sans s’y arrêter, il faut remarquer que le nouveau Code est le fruit d’une dictature militaire dépassée et totalitaire où le collectif prévaut de manière interventionniste et nationaliste sur l’individu167.
Produit de l’adoption des principes fondamentaux ci-dessus nommés et de l’influence italienne et suisse, le nouveau Code civil de 2002 a procédé à l’unification du droit des obligations civiles et commerciales (a) et créé un nouveau livre (Livre II) dans sa Partie Spéciale, dénommé le droit de l’entreprise (b). Même si, contrairement au code civil italien, cette unification n’a pas touché tout le droit privé, le nouveau Code joue un rôle central au sein du droit privé brésilien168.
a) L’unification du droit des obligations civiles et commerciales
La question de l’unité des droits civil et commercial ou de l’absorption même du droit civil dans le droit commercial agite la doctrine depuis Cesare Vivante169.
165 Ainsi les règles relatives aux personnes, aux choses, aux actes d’affaire, à la prescription et
à la déchéance, etc. Les modifications apportées concernent toutefois plutôt les détails que la structure de la partie générale en elle-même.
166 Pour quelques critiques formulées par la doctrine, consulter Cl. LIMA MARQUES, « Das neue brasilianische Zivilgesetzbuch vom 2002: Bemerkung zum neuen Unternehmensrecht und der Quellendialog mit dem Verbraucherschutzbuch von 1990 », in Portugiesisch – Weltsprache des Rechts, E. JAYME et Ch. SCHINDLER (dir.) Aix-la-Chapelle, Shaker, 2004, pp. 127-153. V. également la bibliographie citée par l’auteur à propos des critiques à la nouvelle loi civile à la p. 129, note 12. Consulter également A. JAEGER Jr., « Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das Unternehmensrecht », in Portugiesisch – Weltsprache des Rechts, op. cit., pp. 217-235, pp. 221-225.
167 Critique rapportée par Cl. LIMA MARQUES, ibidem. 168 Cl. LIMA MARQUES, op. cit., p. 138. 169 Vivante, l’un des plus grands commercialistes italiens, condamnait à la fin du XIXe siècle
la dichotomie du droit privé. Selon le professeur de l’Université de Rome, l’autonomie du droit commercial se maintient nonobstant la grande uniformité de la vie moderne, plutôt par tradition que pour de bonnes raisons. Pour lui, l’autonomie mettrait en péril le progrès scientifique, en raison du particularisme qu’elle entraîne. Elle serait également responsable des injustices sociales et juridiques, dans la mesure où les non commerçants sont d’une part soumis à un ensemble normatif spécifique qui leur est étrange par le simple fait de contracter avec les commerçants, et d’autre part
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
60
En France, nonobstant les discussions proposées par certains auteurs170 chez lesquels l’idée de l’unification du droit civil et du droit commercial a eu écho171 et paraît tout à fait concevable172, l’unification codifiée n’a pas eu le même sort qu’au Brésil et ce malgré le fait que les deux branches « se parlent » déjà dans de nombreuses situations à l’unisson173. Deux obstacles se présenteraient à l’unification des obligations civiles et commerciales en France. D’abord, la différence d’esprit174 qui anime l’un et l’autre de ces droits : tandis que le droit civil ne voit dans les obligations et dans les
exposés à la solution d’une question préliminairement liée à la nature du litige. En outre, la dichotomie génère l’insécurité juridique en raison de la liberté donnée aux juges de classer tel ou tel acte atypique dans la catégorie des actes de commerce. L’auteur reviendra cependant sur ces idées à l’occasion de la rédaction du Progetto preliminar, anti-projet du Codice civile. Il justifiera la dichotomie en fonction de divers critères, savoir : la différence de méthode entre le droit civil (déductif) et le droit commercial (inductif) ; du caractère cosmopolite du droit commercial ; de nombreuses règles dérogatoires du droit commun qui s’appliquent aux contrats et la pratique du commerce ; de la spécialité irréductible du droit commercial; et finalement, de l’esprit qui les anime l’un et l’autre, le droit du commerce se souciant de régir la circulation à large échelle de la richesse, le droit civil s’occupant d’actes plus isolés. Cf. R. REQUIÃO, op. cit, vol. 1, p. 1 s.
170 L. MAZEAUD, « Vers la fusion du droit civil et du droit commercial français », in L’unité du droit des obligations, 1974, p. 333 et s ; D. TALLON, « Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit commercial », Mélanges Jauffret, p. 649 ; PLANIOL et THALLER, également à propos de l’octroi de la personnalité juridique aux sociétés civiles. Ouvrages cités par E. RICHARD, op. cit., p. 108.
171 Dans un article paru dans RTD com. 1948-3, ESCARRA pressentait déjà l’évolution et l’unification des institutions juridiques des acteurs économiques, peu importe qu’ils soient qualifiés ou non de commerçants. Cf. J. MONÉGER, précit., p. 181.
172 Ainsi MM. DIDIER, Droit commercial, T. 1, op. cit., p. 114-115, affirment que l’unification du droit privé « peut même apparaître comme inscrite dans le sens de l’histoire », tout en se demandant « qui en France est prêt à cette révolution ? ».
173 E. RICHARD (Ibidem, pp. 108-109) nous offre quelques exemples de la porosité existant entre ces deux branches : l’obligation de tenir un registre, applicable non seulement aux commerçants, mais également à certaines professions libérales; l’assujettissement de toutes les sociétés au droit commercial, sauf les sociétés civiles (doublon de la société en nom collectif); l’intervention de plusieurs dispositions du code civil sur les contrats créées par la pratique commerciale (chèque, lettre de change, carte de paiement…), même si d’autres restent peu réglementés (concession commerciale, affacturage, franchisage…) ; l’application à 99% de dispositions du Code civil à la vente ; l’admission, depuis la loi du 9 juillet 1971, de la mise en demeure par simple notification (à côté de l’acte d’huissier) en droit civil, comme l’était déjà en droit commercial ; l’extension des procédures collectives, avant réservées aux seuls commerçant, à tous les acteurs du commerce, y compris les ménages surendettés ; l’application du même taux d’intérêt dans les opérations civiles et commerciales depuis la loi du 13 juillet 1975 ; l’extension de la prescription décennale des obligations commerciales aux actes mixtes depuis la loi du 3 janvier 1977 ; les apports de la loi sur les sociétés de 1966 dans la rédaction de la loi du 4 janviers 1978 sur les sociétés civiles. Nonobstant cet entrelacement des règles, des différences demeurent entre le droit civil et droit commercial, tel que le règlement de la preuve (liberté en droit commercial), la forme cartulaire ou écrite dans de nombreux cas en droit commercial (lettre de change, contrat de société), ou encore la présomption de solidarité en droit commercial et pas en droit civil. Sur les influences diverses exercées entre les deux droits, v. également M. GERMAIN, « Le Code civil et le droit commercial », in 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, op. cit. pp. 639-655.
174 M. GERMAIN, « L’esprit des lois commerciales », in Le discours et le code, Portalis, deux siècles après le code de napoléon, Paris, Litec, 2004, pp. 313-322.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
61
contrats qu’un moyen d’acquérir la propriété immobilière, le droit commercial tend à subordonner la propriété aux échanges175. En ce sens, même si le droit commercial partage les mêmes principes que le droit civil : bonne foi, réciprocité et égalité (Portalis) ; loyauté, solidarité et fraternité (Denis Mazeaud), efficacité, souplesse et adaptation (Michel Germain), la spécificité des affaires du commerce apporte une distinction à l’identité structurelle de ces deux droits176. Ensuite, l’unification impliquerait la refonte du droit civil et la réduction du rôle, voire la suppression même, de la juridiction commerciale177. Enfin, les liaisons un peu trop étroites avec le droit public pourraient créer des malaises dans le droit civil après une telle union. On pourrait toutefois se demander si avec l’avènement d’un droit européen des contrats ces obstacles pouvaient subsister…du moins en de tels termes.
Au Brésil, l’unification récemment réalisée par le nouveau Code civil n’est pas sans conséquences sur le droit commercial. L’éminent juriste Arnoldo Wald remarque que l’unification a eu pour effet le dépassement de certains clivages qui existaient dans l’ordre juridique brésilien178, même si déjà auparavant on assistait à une relative « commercialisation du droit civil » de même qu’« un civilisme du droit commercial »179. En effet, la distinction traditionnelle entre les obligations civiles et commerciales avait déjà perdu sa raison d’être lors de l’unification de la compétence civile et commerciale au sein d’une seule et même justice. Les distinctions de base qui existaient entre certains biens, comme les meubles et les immeubles, ont perdu une partie de leur importance avec la titrisation des crédits immobiliers, la commercialisation de l’hypothèque, l’émission de lettres de change immobilières et la création de fonds d’investissements immobiliers dans le marché financier et l’adoption (toujours optionnelle - Wahlfreiheit
175 Pour une liste de manifestations de cette différence d’esprit entre les divers institutions
communes aux droits civil et commercial, v. Paul DIDIER et Ph. DIDIER, Droit commercial, T. 1, op. cit., pp. 114-115. Des événements récents en témoignent, telle la suppression de la limite de l’usure pour des prêts accordés à une personne morale dont l’activité est professionnelle. Pour d’autres exemples, consulter E. RICHARD, ibidem, p. 109.
176 M. GERMAIN, L’esprit des lois commerciales, op. cit., p. 313 et s. 177 Selon M. GERMAIN (Le Code civil et le droit commercial, op. cit., p. 642), « la question
des tribunaux de commerce ne répond plus qu’à des considérations de politique juridique », car si la présence du juge consulaire est à l’origine de la distinction entre le droit commercial et le droit civil, l’atténuation de sa singularité et la méfiance du législateur envers lui, lui interdisant de connaître de contentieux nouveaux, comme le statut des baux commerciaux ou l’essentiel du droit de la concurrence ou du droit boursier, a fait sorte que le droit commercial a décroché de la justice commerciale.
178 A. WALD, « L’entreprise et le Code civil brésilien », op. cit., p. 263. 179 Ainsi, le Code de commerce de 1850 autorisait le recours aux règles du droit civil des
contrats (art. 121), tandis que le Code civil de 1916 autorisait le recours au droit commercial, lorsqu’il s’agissait d’appliquer subsidiairement aux sociétés civiles les règles relatives aux sociétés anonymes, à condition que celles-ci ne rentraient pas en conflit avec la loi civile (art. 1364).
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
62
der Rechtsform) de la forme anonyme pour les sociétés de construction d’immeubles180.
La nouvelle codification brésilienne régit certains contrats commerciaux, parmi lesquels le transport, la commission, la représentation, la distribution et l’agence commerciales. Remarquons que pour certains de ces contrats, comme le courtage ou le transport, l’application des dispositions contenues dans les législations spéciales ou dans les conventions internationales aura toujours lieu, à condition que ces dispositions ne portent pas atteinte aux règles codifiées (arts. 729 et 732, C. civ. 2002). En revanche, en matière d’effets de commerce, les dispositions du Code civil ne sont applicables qu’à défaut de dispositions spéciales (art. 903, C. civ. 2002).
Dans le domaine contractuel, le législateur de 2002 a établi de nombreuses clauses générales selon le modèle allemand (Generalklauseln), à l’instar des articles 113 et 422, sur la bonne foi, de l’article 421, sur la fonction sociale du contrat, de l’article 478, sur le combat contre l’onérosité excessive (théorie de l’imprévision), de l’article 1228, §1°, sur la fonction économique et sociale de la propriété, et de l’article 187, sur l’abus de droit181. Toutes ces innovations, notamment la consécration de la bonne foi objective182 et l’introduction des principes de l’équilibre économique et de la fonction sociale du contrat, ont vocation à révolutionner les postulats classiques du droit des obligations et à imposer un traitement égalitaire des intérêts intégrant aussi bien la sphère du créancier que du débiteur183 184.
180 A. WALD, « L’entreprise et le Code civil brésilien », op. cit., p. 263. 181 Les arts. 421, 478 et 1228 trouvent leur origine dans le droit italien, alors que l’art. 187
peut être identifié dans la doctrine française et brésilienne. 182 Le nouveau Code civil a incorporé la règle de l’ancien art. 131, al. 1 du Code de commerce
de 1850, selon laquelle le contrat doit être interprété selon la bonne foi des parties. Cette incorporation n’est cependant que pro forme, car la jurisprudence et la doctrine avaient déjà comblé cette lacune existante dans le Code civil de 1916. C’est là un phénomène très connu en France. V. les décisions du STJ : REsp. n.º 52075/ES, Industrial Malvina S.A. v. Coopersanto Industrial S.A., DJ du 21.11.1994, p. 34352 ; REsp. n.º 72482/SP, Condomínio Edifício Orion v. Estrutura Incorporadora e Construtora Ltda, DJ du 08.04.96, p. 10474 ; et REsp. 406590/PR, Cerâmica Porto Ferreira Ltda v. Casagrande Pisos Cerâmicos Ltda, DJ du 16.09.2002, p. 00194. V. également Cl. V. D. COUTO e SILVA, A Obrigação como processo, São Paulo, Bushatsky, 1976 ; R. ROSADO DE AGUIAR Jr., Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, Rio de Janeiro, Aide Editora, 1991, et « A Convenção de Viena (1980) e a resolução dos contratos por incumprimento », Revista da Faculdade da UFRGS, vol. 10, spéc. p. 10 ; J. MARTINS-COSTA, O princípio da boa-fé, Ajuris, n° 50, p. 207 ; I. DE AGUILAR VIEIRA, « Deveres de Proteção e Contrato », RT 761 (1999), p. 68.
183 J. MARTINS-COSTA, A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações, JB 200, pp. 3-39, spéc. p. 20-21.
184 À maints égards l’avant projet de réforme du droit français des obligations préparé sous l’autorité du Professeur Pierre Catala s’inscrit dans ce mouvement. Cf. P. CATALA, Avant projet de réforme du droit français des obligations et de la prescription, La documentation française, 2006.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
63
La bonne foi objective (art. 422, C. civ. 2002) attribue à la bonne fides une valeur autonome, sans rapport avec la volonté des parties185. Elle dépasse le dogme de l’autonomie de la volonté lorsqu’elle reconnaît des nouvelles obligations entre les contractants186 qui s’ajoutent implicitement au contrat (telles les obligations d’information, de transparence, de loyauté et de coopération)187. Il en va de même lorsque la bonne foi établit des limites à l’exercice des droits subjectifs, en interdisant par exemple l’abus de droit (art. 187, C. civ. 2002). Le principe de l’équilibre du contrat bouleverse à son tour le principe de la force obligatoire des conventions en permettant l’application des instituts comme celui de la lésion (art. 157, C. civ. 2002) et de la révision et de la résolution des contrats lors de la « disparition du fondement contractuel » (Wegfall der Rechtsgeschäftgrundlage) (arts. 317, 478 et 479, C. civ. 2002). La fonction sociale188 permet enfin la relativisation du principe de l’effet relatif des contrats, en imposant des effets contractuels au-delà du convenu entre les parties. Par la fonction sociale, le respect au contrat devient opposable au tiers189, en même temps que les contractants doivent respecter les titulaires d’intérêts socialement valorisés, éventuellement touchés par le rapport contractuel190.
Selon Madame Lima Marques, un paradoxe existe désormais entre le renouveau du contrôle étatique des contrats et de la propriété rendu possible par le biais de ces clauses générales, et le fort caractère néolibéral qui imprègne le continent américain191. Ce paradoxe est d’autant plus remarquable, lorsqu’on constate qu’à côté de ces clauses générales, intervient une règle générale d’ordre public extrêmement contraignante, selon laquelle les conventions, même celles valablement constituées sous l’empire des lois abrogées, ne prévalent pas lorsqu’elles portent atteinte aux dispositions d’ordre public établies en vue d’assurer la fonction sociale du contrat et de la propriété (art. 2035, C. civ. 2002). Il est donc permis de s’interroger sur le sort des contrats, auparavant qualifiés de commerciaux, lorsque ceux-ci seront mis à l’épreuve des principes fondamentaux du
185 COUTO et SILVA, « O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português », in Estudos
de direito civil brasileiro e português (I Jornada Luso-Brasileira de Direito Civil), São Paulo, Ed. RT, 1980, p. 41, spéc. p. 54.
186 I. DE AGUILAR VIEIRA, précit., p. 68 et s. 187 G. TEPEDINO, « Novos princípios contratuais e teoria da confiança: a exegese da cláusula
‘to the best knowledge of the sellers’ », RF 377, 237, spéc. p. 243. 188 Consulter C. SALOMÃO FILHO, « A Função social do contrato: primeiras anotações »,
Revista de direito mercantil, 132, pp. 7-24. 189 B. MIRAGEM, « Diretrizes interpretativas da função social do contrato », RDC, 56, pp.
22-45, spéc. p. 26. 190 G. TEPEDINO, précit., p. 242. 191 Cl. LIMA MARQUES, op. cit., pp. 129-131.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
64
nouveau Code, notamment celui de la fonction sociale du contrat et celui de la fonction sociale de la propriété192.
La codification de 2002 n’a pas ignoré les contrats d’adhésion et établi un régime de protection à l’adhérant, dont les dispositifs portent normes de valeur sociale193. Le traitement n’est cependant pas exhaustif194. Parmi les trois modalités de contrôle du processus contractuel par adhésion (contrôle d’intégration, d’interprétation et du contenu des clauses du contrat), le code civil en réglemente deux. Il prévoit une règle d’interprétation contra preferentem des clauses ambiguës ou en contradiction (art. 423) et une règle frappant de nullité la clause qui implique renonciation préalable aux droits résultant de la nature de l’acte d’affaire (art. 424). Il n’y a aucune règle spécifique concernant la manifestation de la volonté afin de conditionner la validité de certaines clauses, comme celles d’exonération de la responsabilité, à certaines formalités nécessaires à leur intégration dans le contrat. D’autre part, le code civil ne définit pas le contrat d’adhésion195 ni n’offre des critères pour déterminer le caractère abusif196 que certaines clauses peuvent acquérir en raison du modus contractuel. Ainsi faisant, le nouveau code civil laisse à la fois une vaste lacune et de larges pouvoirs aux juges pour apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses insérées dans le contrat d’adhésion197. Le manque d’une réglementation spécifique sur les conditions générales d’affaire, ainsi que la timidité du législateur dans l’établissement de règles de contrôle du contenu des contrats ont donné lieu à de sévères critiques de la doctrine198, motivées également par le traitement beaucoup plus complet à la matière que dispense le Code de la
192 À ce propos, v. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, « Princípios do novo direito contratual e
desregulamentação do mercado. Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento. Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual », RT 750.113.
193 Cl. LIMA MARQUES, Contratos no código de defesa do consumidor, 4e éd., São Paulo, RT Ed., 2002, p. 65.
194 R. ROSADO DE AGUIAR Jr., « Projeto do Código Civil – As obrigações e os contratos », RT 775/23, p. 25.
195 Il semble que le code adopte la conception unitaire française qui consiste à traiter sous la même rubrique les contrats de adhésion et les conditions générales d’affaires. Cf. E. MESSIAS GONÇALVES DE LYRA Jr., « Contratos de adesão e condições gerais dos contratos », RT 828.11, spéc. p. 16.
196 Différemment du droit français, qui admet le caractère abusif d’une clause seulement dans les rapports de consommation, le droit brésilien conçoit ce caractère également aux clauses léonines figurant dans les contrats régis par le code civil.
197 Récemment, le Tribunal de Justice de Santa Catarina (Petrobras v. AF comercial S.A., Agravo de Instrumento n° 20006.016479/0000-00, jugé le 24.05.2006, DJSC 26.05.06, p. 50), a décidé sur la base de l’art. 424 du Code Civil que la clause d’exclusivité insérée dans un contrat de distribution de combustible automobilistique est nulle, car elle implique renonciation au préalable du droit constitutionnel de la libre concurrence dans la mesure où l’adhérant ne peut discuter ni les clauses, ni le prix du combustible acheté pour la commercialisation.
198 R. ROSADO DE AGUIAR Jr., précit., p. 27.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
65
consommation (arts. 51 à 54). Les nouveaux principes qui régissent les contrats joueront alors un rôle très important dans la recherche des solutions juridiques en matière de contrat d’adhésion.
En ce qui concerne la vente commerciale, on regrette que certains aspects les plus importants restent au Brésil sans une réglementation précise par dérogation à la partie générale du Code de 1850. En effet, toute une série de dispositions propres à la vente commerciale ou à d’autres obligations typiquement commerciales n’a pas été reprise par le nouveau Code199. En outre, les obligations du vendeur et de l’achteur obéissent au système élaboré par les codes européens du XIXe siècle. Ce système d’obligations n’est pas en adéquation avec la complexité de la vente moderne200. Cette complexité se reflète notamment dans les effets de l’inéxecution201, comme le démontre la consécration, en tant qu’obligation principale202, de la notion unitaire de conformité de la prestation (Vertragsgemäßheit der Leistung)203 par les principaux instruments internationaux et par certains codes nationaux régissant la matière204. Sous l’empire du Code Civil de 1916, la
199 Dans le Code de commerce de 1850, les règles générales sur les contrats étaient complétées par des dispositions, supplétives certes, mais indicatives des obligations subsidiaires et accessoires à la prestation principale ou caractéristiques de l’affaire, en accord avec la pratique commerciale. Le nouveau Code est silencieux par exemple quant au délai, à la forme et à qui doit être livrée la chose achetée. Le Code civil de 1916 était également silencieux quant à toutes ces questions, mais le Code du commerce à son tour, bien que légèrement et timidement, stipulait que la marchandise devait être livrée dès le contrat conclu, dans le délai et selon la manière déterminés dans celui-ci (art. 197), et au lieu où elle se trouvait au moment de la vente, si les parties n’en avaient pas décidé autrement (art. 199).
200 COUTO e SILVA (A obrigação como processo, op. cit., p. 39) signalait déjà que le système des obligations du code civil a été constitué sur la base des obligations principales. Celles-ci ont été fixées par la loi selon les modèles classiques du droit roman et sont aujourd’hui insuffisantes pour garantir le bon déroulement de l’exécution des obligations contractuelles, surtout si on considère que les obligations secondaires, qui devaient renforcer la principale, n’ont pas été positivées de façon étendue ni par le législateur de 1916, ni par celui de 2002.
201 La tendance de la vente moderne est celle du pluralisme d’obligations, de plus en plus étendues et complexes soit en raison du contract, soit en raison du droit (loi, jurisprudence, usages) : à l’obligation de livrasion d’un bien conforme s’ajoutent les obligations de remise de documents, d’information, de collaboration, de conseil, de sécurité (avertissement des risques) ; certaines obligations subsitent même après le transfert de la propriété et des risques.
202 GRUNDMANN, in BIANCA, GRUNDMANN, STIJNS, La Directive communautaire sur la vente, Bruylant, 2004, spéc. pp. 144-146.
203 Le mot conformité est ici utilisé dans un sens plus large que celui que lui attribue le droit interne de la vente français, qui distingue les défauts de la chose selon leur caractère apparent (non-conformité attachée à l’obligation de délivrance) ou caché (effet de l’obligation de délivrance) En revanche, pour les contrats de vente conclus par les consommateurs (C. Consom, L. 211-4) ou pour les contrats de vente internationale soumis à la Convention de Vienne de 1980 (art. 35), la notion de conformité présente un caractère unitaire, recouvrant les notions traditionnelles de vice caché et de non-conformité. Cf. Ph. Le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2006.
204 Comme prévu dans la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (art 35); dans la directive européeene 44/1999 sur certains aspects de la vente aux consommateurs (art. 2) ; dans la notion d’exécution défectueuse des Principes d’UNIDROIT 2004
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
66
jurisprudence205 et la doctrine206 ont pu dégager cette notion de la formule générale de l’article 1.056207, alors que ce Code, à l’instar du Code de commerce de 1850, avait gardé les règles spécifiques propres aux vices cachés (art. 210, C. com. 1850 ; art. 1101, C. civ. 1916), à la mise en demeure (art. 202, C. com. 1850 ; art. 955 C. civ. 1916) ; à l’éviction (arts. 214 et 216, Cod. com. 1850 ; art. 1107, C. civ. 1916). Le nouveau Code civil a conservé les garanties légales antérieurement prévues et a consacré un dispositif aux garanties contractuelles (art. 456), mais est resté silencieux aussi bien à propos de la formule générale de l’ancien article 1.056 du Code civil de 1916 (actuel art. 389208) que des obligations subsidiaires ou accessoires à l’obligation principale209. On attend toujours de voir comment la jurisprudence réagira à cet égard210.
Finalement, durant les travaux législatifs, l’unification du droit des obligations a suscité la méfiance, voire l’opposition, d’une partie de la doctrine. D’une part, on y voyait le danger que la réglementation de certains types de contrats dans le cadre de l’unification pouvait susciter ; d’autre part, on craignait la mise en cause de l’autonomie du droit commercial et, par là même, sa disparition. Malgré l’unification, celui-ci n’a cependant pas
(art. 7.1.1) ; ou encore dans le droit comparé sous la notion de breach of contract du droit anglais ou de Pflichtverletzung (§ 280 du BGB après la réforme de 2002). Au Brésil la notion unitaire de conformité est adoptée par l’art. 18 du C. Consomm.
205 STJ: Resp. n.º 52075/ES, Industrial Malvina S.A. v. Coopersanto Industrial S.A., DJ 21.11.1994, p. 34352 ; Resp. n.º 72482/SP, Condomínio Edifício Orion v. Estrutura Incorporadora e Construtora Ltda, DJ 08.04.96, p. 10474; et Resp. 406590/PR, Cerâmica Porto Ferreira Ltda v. Casagrande Pisos Cerâmicos Ltda, DJ 16.09.2002, p. 00194.
206 R. ROSADO de AGUIAR Jr., Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, Rio de Janeiro, Aide Ed., 1991.
207 Art. 1056, C. civ. 1916 : « Le débiteur sera condamné au paiement de dommages-intérêts lorsqu’il n’exécute pas l’obligation ou lorsqu’il ne l’exécute pas de la manière et dans le délai prévus ».
208 Art. 389, C. civ. 2002 : « En raison de l’inexécution de l’obligation, le débiteur sera condamné au paiement de dommages-intérêts, actualisé aux taux d’intérêt légaux et aux honoraires d’avocat ».
209 Le juriste se servira alors des règles générales du droit des obligations applicables aux obligations de donner, notamment celles concernant l’exécution et l’extinction des obligations (art. 304 et s). Sur ce sujet, v. G. V. da COSTA CERQUEIRA, « Garantias e exclusão da responsabilidade no novo direito brasileiro da compra e venda », in S. GRUNDMANN et Ch. BALDUS (dir.), Schutzinteressen und Freiheitsrechte – Tagungsband der Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung, à paraître, 2007 ; « O Cumprimento Defeituoso nos Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uma análise comparativa entre o Direito brasileiro e a Convenção de Viena de 1980 », Mélanges Erik Jayme, Cl. LIMA MARQUES, N. de ARAUJO (dir.), Renovar, 2005, pp. 497-548.
210 Certes, outres les nouveaux principes qui régissent la matière, le juge se servira également des règles générales du droit des obligations applicables aux obligations de donner, notamment celles concernant l’exécution et l’extinction des obligations (art. 304 et s.). L’arbitrage pourra également apporter quelques contributions en ce domaine dans un futur proche.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
67
disparu…Il semble même avoir conservé son autonomie, cette fois-ci sous une nouvelle dénomination211.
b) Le droit de l’entreprise
L’unification réalisée au Brésil a contribué au dépassement de la notion de droit commercial. Désormais, sous la rubrique Direito da empresa (droit de l’entreprise), le Livre II de la Partie spéciale du Code civil de 2002 (arts. 966 à 1.195)212 réglemente le droit de l’entrepreneur (direito do empresário), le droit des sociétés, le droit d’établissement et quelques institutions complémentaires du commerce213.
Avant d’observer quelques aspects de cette nouvelle réglementation, il faut noter qu’en France, le débat sur l’unification a également conduit au dépassement même de la notion de droit commercial. Selon Édouard Richard, le débat à propos de l’unification se calque, tout en le dépassant, sur le débat droit commercial/droit des affaires. Ce dernier, dont la difficulté de définition « s’explique par la diversité des courants, parfois contraires, qui agitent sa vie », marquerait en effet un « retour aux sources » plus qu’une innovation. Selon l’auteur, le droit commercial serait un cadre dépassé, la codification un épiphénomène et la doctrine se rallierait à la pratique qui en a donné un horizon beaucoup plus élargi en y intégrant par exemple des considérations de droit public214.
Le « retour aux sources » évoqué par M. Richard se fonde sur la façon dont on concevait déjà le droit commercial pendant les XIIIe-XIXe siècles : la codification de 1673 ne serait qu’un élément parmi d’autres concernant le commerce215, lequel était inclus pour certains216 dans la rubrique Droit public et soumis au gouvernement économique de l’État, assujetti à des règles et à une police qui lui sont particulières217. La notion de droit
211 A. JAEGER Jr., « Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das
Unternehmensrecht », op. cit.. pp. 220-221. 212 D’autres dispositions du nouveau Code sont également applicables en la matière, à l’instar
des arts. 45, 48, 50, 51 (dispositions générales concernant les personnes morales); des arts. 83, III, 89, 90, 91 (sur les biens) ; des arts. 927, § unique, 932, III, 933 (sur la responsabilité civile); et des arts. 2.031, 2.033, 2.035, 2.037 et 2.045 (concernant les dispositions transitoires).
213 Sur cette nouvelle réglementation v. A. WALD, « Le droit de l’entreprise au XXIe siècle et le Code civil brésilien », op. cit., p. 249 et s. ; Cl. LIMA MARQUES, op. cit., pp. 127-153. A. JAEGER Jr., Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das Unternehmensrecht, op. cit., pp. 217-235 ; M. MALLMANN LIPPERT, A empresa no Código Civil, elemento de unificação no direito privado, São Paulo, Rev. dos Trib. Ed., 2003 ; A. P. FERRONATTO, « A empresa no novo Código civil : elemento unificador do direito privado », précit., pp. 11-37.
214 E. RICHARD, Ibidem, p. 110 s. 215 J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986, p. 131, apud,
E. RICHARD, Ibidem, p. 110. 216 GUYOT, cité par E. RICHARD, Ibidem, p. 110. 217 MERLIN, cité par E. RICHARD, Ibidem, p. 110.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
68
commercial a été d’assimilation difficile même après la codification de 1807, très particulariste, assez restrictive et pénalisante. Tant il est vrai que la doctrine n’a pas tardé à la stigmatisation de « code ghetto » des commerçants, d’« isolat juridique », cause de la véritable « mort » d’un droit commercial salutairement remplacé à l’heure actuelle par le droit des affaires218. Il en va de même dans la codification de 2000, qui est restée victime de l’impossibilité de définir la matière même qui est censée lui donner la substance219.
Le droit des affaires correspondrait donc à un « retour aux sources » dans la mesure où l’on ne conçoit plus le droit du commerce comme un droit d’exception. Dans un contexte d’intervention étatique constante220, le droit des affaires prend en considération pour ainsi dire aussi bien les aspects privatistes que les aspects publicistes de l’activité économique. Dans la recherche d’une base théorique moderne, la doctrine française a soutenu l’avènement d’un droit de l’entreprise, comme base objective d’une nouvelle théorie se substituant même au droit des affaires221. Telle est la solution actuellement adoptée par le droit brésilien.
Sous l’égide de la notion d’entreprise qui n’est d’ailleurs pas définie dans le nouveau Code civil222, la figure du commerçant a été remplacée par celle de l’entrepreneur. La doctrine affirme que la notion subjectiviste adoptée par le Code de 1850 ne saurait subsister. Selon Arnoldo Wald, l’idée de la préservation d’un « droit corporatif, particulier d’une classe, composé de droit et d’obligations différentes de ceux attribués aux autres »,
218 C. CHAMPAUD, Le droit des affaires, Paris, PUF, 1984, p. 12. Sur un droit des affaires beaucoup plus pluridisciplinaire que le droit commercial, v. Y. GUYON, Droit des affaires, T. 1, op. cit., p. 1 et s. et bibliographie citée par l’auteur.
219 D. BUREAU et N. MOLFESSIS, Le nouveau code de commerce : une mystification, op. cit., p. 367.
220 Parfois déterminée par la forte activité législative de l’Union européenne en ce domaine. 221 HAMEL et LAGARDE, Traité de droit commercial, t. 1, Paris, 1954, p. 50, apud, E.
RICHARD, Ibidem, p. 110. Pour approfondir sur la notion d’entreprise reçue par le droit français, consulter : G. BLANC, « Les frontières de l’entreprise en droit commercial (Brève contribution…), D. 1999, chr., pp. 415-418 ; P. DIDIER, « Une définition de l’entreprise », Mélanges P. Catala, Litec, 2001, pp. 849-857 ; G. DRAGO, « De quelques apports du droit constitutionnel à une définition de l’entreprise », Mélanges C. Champaud, Paris, Dalloz, 1997, pp. 299-315 ; G. FRIEDEL, « À propos de la notion d’entreprise… », Mélanges R. Roblot, LGDJ, 1984, pp. 97-114 ; L. IDOT, « La notion d’entreprise », Revue des sociétés, 2001, pp. 191-209 ; B. MERCADAL, « La notion d’entreprise », Mélanges J. Derruppé, Litec/Joly, 1991, pp. 9-16 ; J. PAILLUSSEAU, « Les apports du droit de l’entreprise au concept de droit », D. 1997, Chr. pp. 97-106.
222 Concept que la doctrine brésilienne formule d’une façon double, l’entreprise se présentant à la fois comme objet et comme sujet de droit. Cette tendance de la doctrine a été perçue par C. V. D COUTO e SILVA (« O conceito de empresa no direito brasileiro », Rev. da Ajuris, 37, 1986, pp. 42-59) : la notion d’entreprise comme objet du droit accentue l’aspect subjectif des titulaires du capital et l’aspect objectif de la tutelle de la administration, ce qui constitue le substrat de la conception de l’entreprise en tant que sujet de droit. La notion objectiviste écarte la distinction traditionnelle entre sociétés civiles et commerciales, fondée dans la réalisation de certains actes (actes de commerce), et non dans la structure mise en place pour la consécution de certains buts.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
69
ne se justifiait plus depuis longtemps en raison du cercle vicieux qu’il engendre : si d’un côté le commerçant est caractérisé par la pratique professionnelle du commerce (mutatis mutandis, acte de commerce), de l’autre côté, le commerce ou la nature des actes qu’il comprend dépend toujours de celui qui le pratique223. Toujours selon Arnoldo Wald, cette situation devenait insoutenable à cause d’une part de l’expansion en droit brésilien du concept d’acte de commerce224 et d’autre part des doutes soulevés quant au régime aussi bien des actes mixtes, pratiqués par un commerçant avec un non commerçant, que des actes pratiqués entre non-commerçants.
Il semble toutefois que le nouveau Code civil conserve dans une large mesure le critère subjectiviste225 adopté jadis par le Code de 1850, dans la mesure où l’empresário demeure au centre de l’activité « entrepreneuriale », tel que l’était le commerçant vis-à-vis de la loi commerciale abrogée226. La définition actuelle d’empresário (art. 966, C. civ. 2002)227, comme étant celui qui exerce une activité économique organisée en vue de la production ou de l’échange des biens et des services, n’est d’ailleurs pas suivie d’une spécification quelconque des actes qui caractérisent objectivement une telle activité économique228. En outre, on ne conçoit pas un droit qui serait appliqué à l’activité économique organisée en vue de la production ou de l’échange des biens et de service, indépendamment de la profession de ceux qui les accomplissent229. Par ailleurs, tout comme auparavant, l’empresário doit être inscrit dans le Registro público de empresas mercantis avant de démarrer ses activités (art. 967 C. civ. 2002). Cette démarche ne semble
223 En ce sens, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, op. cit., n°
6, 7 et 8, pp. 3-6. 224 Qui a permis l’incorporation d’une série d’opérations et de biens qui n’étaient pas régis par
le droit commercial ainsi que des activités réalisées par les sociétés anonymes ayant pour objet une activité civile.
225 Une doctrine autorisée parle d’un concept subjectif moderne (R. REQUIÃO, Curso de direito comercial, op. cit., 2003, p. 14).
226 Dans un article publié en 2001, un auteur a même parlé d’un retour au critère subjectif à travers la théorie de l’entreprise : S. A. ROCHA GOMES DA SILVA, « Teoria da empresa – um retorno ao critério subjetivo », RT 783.16.
227 Inspirée ipsis litteris de l’art. 2082 du Codice civile italien 228 M. Wald est même contraint de donner une interprétation étendue de ce texte en ce sens
qu’il ne se limite pas au seul domaine de la circulation, mais comprend aussi l’industrie, sous toutes ses formes. A. WALD, L’entreprise et le Code civil brésilien, op. cit., p. 265. Sur l’activité de l’entrepreneur, v. le chapitre VII du Corso di diritto commerciale de T. ASCARELLI (3 éd., Milan, Giufrè, 1962, pp. 161-185).
229 Tant il est vrai que même le nouveau Code civil se préoccupe, d’une part de ne pas qualifier d’empresário celui qui exerce une profession intellectuelle, de nature scientifique, littéraire ou artistique, même avec la concurrence d’assistants ou de collaborateurs, sauf si l’exercice de la profession constitue un élément de l’entreprise (art. 966, §1), ainsi que la société dite simple (art. 982); et d’autre part de prêter cette qualification à l’entrepreneur, dont l’activité agricole constitue sa profession principale (art 971).
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
70
donc pas différente de celle envisagée par l’article 4 du Code de 1850230. La même logique se présente d’ailleurs pour l’entreprise (société, non plus commerciale mais « entrepreneuriale »), car la définition de celle-ci se base sur celle de l’empresário et son inscription a lieu auprès du même registre prévu pour l’inscription de celui-ci (art. 982, C. civ. 2002)231.
Cette subjectivité serait néanmoins tempérée par une certaine objectivité que l’idée d’entreprise suggère en elle-même232. Sur ce point, Arnoldo Wald affirme que les difficultés survenues au fil du temps auraient contribué à ce que l’on dépassait le concept subjectif du Code de 1850, pour finalement adopter l’activité de l’entreprise comme la base objective du droit commercial brésilien233. Une chose est certaine, la théorie de l’entreprise a pour effet non seulement d’établir une nouvelle façon de comprendre l’activité économique, mais aussi et principalement d’exercer une attraction sur l’ensemble de l’ordre juridique qui ne distinguera plus les matières qui auparavant étaient exclues du champ d’application de la législation commerciale. Autrement dit, l’entreprise devient le centre d’application de multiples branches du droit, s’émancipant ainsi du droit commercial234.
La réglementation de l’entreprise au sein du Code civil a créé une nouvelle configuration de la matière. L’entreprise surgit comme un élément unificateur235. Elle semble apporter au concept de société un nouvel
230 La définition actuelle se base sur l’ancienne définition d’activité commerciale (art. 4 du C.
com., combiné avec l’art. 19 Reg. n° 737, de 1850), dans la mesure où elle distingue les activités d’entrepreneurs et celles qui ne les sont pas (art. 966 et 1044, p. ex.), en qualifiant les premières d’activités économiques exercées de façon professionnelle. Les définitions sont tellement proches que le nouveau Code civil détermine dans son article 2.037 que « sauf disposition contraire, s’appliquent aux entrepreneurs et aux sociétés d’entrepreneurs les dispositions de loi non abrogées par ce code, afférents aux commerçants, ou aux sociétés commerciales, ainsi qu’aux activités commerciales ».
231 Il faut considérer que le problème du cercle vicieux dont a parlé G. Ripert (précit.) est relativement restreint au droit français, qui établit les actes de commerce de manière limitative, tandis que le droit brésilien n’a jamais imposée une telle limitation. L’expansion du concept d’acte de commerce au sein de ce dernier en est un exemple majeur. Tantôt dans la réglementation antérieure (art. 4, C. com.), tantôt dans le nouveau Code civil (art. 966), le commerçant/entrepreneur doit toujours être caractérisé en fonction de l’activité qu’il développe, celle-ci n’étant cependant ni auparavant ni actuellement définie de manière objective et limitative par la loi.
232 Tel que cela a été, avec la conjugaison des arts. 4 du C. com., et 19 du Reg. n° 737 de 1850. 233 A. WALD, « Le droit de l’entreprise au XXIe et le Code civil brésilien », op. cit., pp. 263-
268. 234 M. GERMAIN, Le Code civil et le droit commercial, op. cit., p. 643. 235 En ce sens, M. M. LIPPERT, A empresa no Código Civil, elemento de unificação no
direito privado, op. cit. Pour C. V. D. COUTO e SILVA (O conceito de empresa no direito brasileiro, op. cit., pp. 42-59): la distinction entre entreprises objet et sujet de droit suppose néanmoins une nette séparation entre commerçants et non commerçants, ce qui est une façon de qualifier fortement subjectiviste. Si le point important est l’entreprise, qu’elle soit commerciale ou non, les règles juridiques devraient être les mêmes, raison pour laquelle on a préféré, dans de nombreux pays, l’expression empresário (entrepreneur) ou industriel à celle correspondant au
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
71
éclairage qui, sans en modifier la structure, ouvre à ce dernier un champ d’application nouveau. En ce sens, l’entreprise est désormais soumise au principe fondamental de la sociabilité, étant à la fois attachée à la fonction sociale du contrat et à la fonction sociale de la propriété. On ne distingue plus les sociétés civiles et commerciales, mais désormais les sociétés simples et les sociétés « entrepreneuriales ». On a également introduit dans le Code civil une réglementation ferme sur la responsabilité du chef d’entreprise ainsi que la doctrine américaine du disregard of legal entity (Durchgriff bei Juristischen Personen) (art. 50, C. civ. 2002)236, celle-ci déjà admise en matière de protection du consommateur (art. 28, C. consomm. 1990) et reconnue par la jurisprudence en matière de protection du travailleur237. En outre, le nouveau Code règle désormais la phase précédant l’acquisition de la personnalité morale de la société sous la dénomination de société en commun, au côté de la société en participation, faisant en sorte que les sociétés de fait quittent le cadre du droit commun238. La nouvelle loi couvre également le groupe, la liquidation, la transformation, l’incorporation, la fusion et la scission des sociétés, ainsi que, de façon originale, l’autorisation, la nationalité et la liberté d’établissement liée à la société étrangère (arts. 1097-1141, C. civ. 2002)239.
L’incorporation dans le Code civil brésilien du droit de l’entreprise a suscité d’autre part la critique d’une certaine doctrine pour qui un tel droit est comme un « corps étranger », sans aucune relation interne impérative avec les autres parties du Code240. Le droit de l’entreprise aurait dû faire l’objet en effet d’une réglementation spécifique, propre à ce domaine particulier du droit241. Par ailleurs, les lacunes ne sauraient être négligées, ou encore sur la possibilité de constitution d’une société unipersonnelle, à
simple commerçant. Par conséquent, la notion d’entreprise doit mener au dépassement de la distinction entre le droit de obligations civiles et le droit des obligations commerciales, en constituant ainsi un facteur important d’unification des ces deux branches du droit.
236 Doctrine selon laquelle on admet la responsabilité personnelle illimitée des associés et dirigeants des sociétés dans les cas de violation de la loi ou des statuts, quand il a abus ou confusion patrimoniale, ou encore dans le cas d’usage frauduleux de la société comme écran. Il s’agit de la « teoria da desconsideração da pessoa jurídica » ("piercing the veil").
237 À titre d’exemple, v. Acórdão: 19990432158, 8ª T du TRT/SP, jugé le 05.08.99. 238 N. da COSTA CARUSO MAC-DONALD, O Projeto de Código civil e o direito
comercial, op. cit., p. 154. 239 Sur les problèmes et les conséquences en droit international privé découlant de la
réglementation actuelle des sociétés nationales et étrangères par le Code civil, v. C. LIMA MARQUES, « Das neue brasilianische Zivilgesetzbuch vom 2002: Bemerkung zum neuen Unternehmensrecht und der Quellendialog mit dem Verbraucherschutzbuch von 1990 », op. cit., p. 138-142.
240 F. KONDER COMPARATO, « Atualidades », p. 177, apud A. JAEGER Jr., « Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das Unternehmensrecht », op. cit., p. 222.
241 W. BULGARELLI, « Tratado de direito empresarial », p. 191, apud A. JAEGER Jr., « Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das Unternehmensrecht », op. cit., p. 223.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
72
l’instar du droit italien dont le nouveau Code s’inspire, ou du droit français. L’absence de normes générales en matière de droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle, des faillites, ainsi qu’en droit maritime ou du transport aérien, constitue d’avantage un facteur de critique au nouveau Codex242.
Sans entrer dans les détails, le nouveau Code civil brésilien régit également l’établissement (arts. 1142-1149) et quelques institutions complémentaires du commerce (arts. 1150-1195). Défini comme « tout complexe de biens organisé, pour l’exercice de l’entreprise, par l’entrepreneur, ou par la société ‘entrepreneuriale’ » (art. 1142), l’établissement intègre le concept même d’entreprise243 et surgit comme une nouvelle manière de voir le fonds de commerce, de dimension objective. Les institutions complémentaires régies par le Code civil, non sans faire appel aux lois spéciales, sont le registre (arts. 1150-1154), le nom « entrepreneurial » (arts. 1155-1168), les préposés (arts. 1169-1178) et les livres (arts. 1179-1195).
Enfin, si on a pu dire « que le droit commercial français ne peut se dire qu’avec la langue du Code civil »244, il faut reconnaître qu’au Brésil le nouveau Code civil s’exprime, non sans quelques difficultés, dans la langue parlée par le droit commercial, désormais droit de l’entreprise. Mais la codification et le commerce semblent former un couple éphémère, car l’une fige le droit, tandis que l’autre est en mouvement permanent245.
2. L’éparpillement demeure…les influences changent Nonobstant l’unification réalisée par le nouveau Code civil brésilien de
2002, certains nouveaux types de contrats commerciaux n’ont pas fait à l’heure actuelle l’objet de réglementation. Ceci compromet l’unité et la systématisation qu’on attend d’un code246, même en tenant compte tant des limites de la codification que de l’apparition constante de nouvelles formules contractuelles, destinées à vivre comme contrats atypiques tant que
242 A. JAEGER Jr., « Das neue brasilianische Bürgerliche Gesetzbuch und das
Unternehmensrecht », op. cit., p. 223. 243 M. M. LIPPERT, A empresa no Código Civil…, op. cit., p. 122, pour qui le concept
d’entreprise s’obtient par la déduction de la somme des concepts d’entrepreneur et d’établissement ; de sorte que d’un tel syllogisme on conclut que l’entreprise est tout ce que l’entrepreneur ou la société « entrepreneuriale » fait par le biais de l’établissement.
244 M. GERMAIN, Le Code civil et le droit commercial, op. cit, p. 640. 245 MONÉGER, « De l’Ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au code de
commerce français de septembre 2000 : … », précit., p. 177. 246 F. KONDER COMPARATO, « Projeto de Código civil », RDM n° 17, nova série, 1975, p.
173-175.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
73
la loi ne les régule pas247. En outre, une grande partie des matières que l’on peut ranger dans le domaine du droit commercial (droit de l’entreprise…) est à présent réglementée par des lois spéciales. Le droit du commerce brésilien s’est complètement renouvelé depuis 1850 et ce, pour des raisons qui sont connues de tous. Plusieurs lois figurant déjà dans l’arsenal législatif spécial de l’ordre juridique brésilien ont fait l’objet de récentes réformes. La loi de 1976 sur les sociétés par actions248 ou celle de 1945 sur la faillite249 en sont des exemples majeurs250.
Les tendances actuelles se présentent donc au niveau de lois spéciales et, pour ce qui concerne le commerce international, au niveau des conventions internationales et des lois-types251. Au Brésil, le nombre de lois spéciales augmente, mais les ratifications de conventions internationales sur le droit du commerce international sont encore assez rares252. Un changement de posture à cet égard s’annonce néanmoins. L’adhésion du Brésil en 2002 à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution de décisions arbitrales étrangères ainsi que la signature de la
247 N. da COSTA CARUSO MAC-DONALD, « O Projeto de Código civil e o direito
comercial », Rev. de Faculdade de Direito da UFRGS, v. 16, 1999, p.139-160, spéc. p. 144. 248 Loi n° 1.303 du 31 oct. 2001, qui a apporté une plus grande protection aux actionnaires
minoritaires et renforcé la responsabilité des administrateurs et des actionnaires qui détiennent le contrôle de la société
249 Loi actuelle n° 11.101, du 9 février 2005 qui a créé un système plus souple pour l’entreprise en difficulté, en permettant son redressement plus facilement.
250 On citera également les lois sur la représentation commerciale, sur la réforme des baux commerciaux, sur le marché financier (marchés de capitaux), sur les registres publics et le registre du commerce.
251 Sur les tendances actuelles du droit de l’entreprise au Brésil, un jeune auteur brésilien affirme avec intelligence que ce droit est marqué par quatre phénomènes: la flexibilisation (dont l’arbitrage est un fort exemple), l’internationalisation, la dématérialisation (dont l’augmentation des transactions par voie électronique est un bon exemple), et le renforcement de la confiance juridique, à travers la consécration de la bonne fois objective dans le nouveau code civil (art. 422). Cf. B. MIRAGEM, « Do direito comercial ao direito empresarial...», précit., pp. 91-98.
252 À l’instar de la Convention de Vienne 1980 sur la vente internationale, à laquelle le Brésil n’a toujours pas adhéré, malgré l’appel régulier de la doctrine et les possibilités de son application au Brésil, soit en vertu de la règle de conflit brésilienne (art. 9, LICC de 1942 combiné avec l’art. 1, al. 1, b de la Convention), soit en vertu d’une clause d’arbitrage (art. 2, loi n° 9307 de 1996 ; art. 10 du Protocole de Buenos Aires sur l’arbitrage dans le cadre du Mercosur). Sur ce sujet, consulter I. de AGUILAR VIEIRA, La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et son applicabilité au Brésil, Thèse, Strasbourg III (2003), 605 pages ; « O interesse na utilização de um Direito Uniforme sobre a venda internacional, como é o caso da "Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias": o equilíbrio das suas regras, a sua compreensão e seu caráter incompleto », in L. F. FRANCESCHINI et M. WACHOWICZ (dir.), Direito internacional privado, Curitiba, Juruá, 2001, p. 187 et s. Sobre a importância da Convenção de Viena para o Mercosur, consulter C. ESPLUGUES MOTA, I. de AGUILAR VIEIRA et J. A. MORENO RODRÍGUES, « Compraventa internacional de Mercaderías : La convention de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías », in C. ESPLUGUES MOTA et D. HARGAIN (dir.), Derecho del comercio internacional – Mercosur et Unión Europea, Buenos Aires, Reus/IBdeF, 2005, pp. 345-397.
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
74
Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux de 1994 (CIDIP V, 1994)253 en sont de forts indices. L’adhésion du Brésil à l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) en 1993254, ainsi que son retour au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé en 2001255 sont également des initiatives à saluer. Les divers Accords conclus et Protocoles signés dans le cadre du Mercosur256 depuis 1991 contribuent également à renforcer cette tendance. Enfin, le recours aux pratiques commerciales uniformisées par la CCI dans les INCOTERMS est de plus en plus vérifié dans les contrats de vente aussi bien interne qu’internationale257.
Quant aux influences, on peut sans aucun doute affirmer que le droit brésilien se place au carrefour de deux systèmes juridiques assez distincts entre eux, ce qui fait de lui un « droit mixte »258. D’une part, les droits romanistes inspirent dans une large mesure le droit privé, d’autre part, le système de la common law nord-américaine exerce son influence sur le droit public, notamment constitutionnel, dont les principes et institutions et quelques techniques lui ont été empruntées259. Néanmoins, une influence
253 Toujours pas ratifiée par le Brésil. 254 Les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international de 2004
peuvent avoir un fort impact sur le droit brésilien, dans la mesure où ces principes peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit national ainsi que servir de modèle aux législateurs nationaux (préambule). Pour les innovations des Principes 2004 et l’analyse de l’impact des ces principes en tant que source directe ou indirecte du droit, consulter l’ouvrage collective résultant de la Journée d’études organisée par Institut suisse de droit comparé (ISDC) en coopération avec l’UNIDROIT en juin 2006 à Lausanne : The UNIDROIT Principles 2004 – Their impact on contractual practice, jurisprudence and codification, Publications of the SICL, Schulthess, 2007.
255 Le Brésil a adhéré aux Statuts de la Conférence de La Haye de droit international privé en 1972 et les a dénoncé en 1978, dû certainement à l’endurcissement du régime militaire qui gouvernait alors le Pays. À ce propos, consulter G. V. da C. CERQUEIRA, « A Conferência de Haia de direito internacional privado », Rev. da Faculdade de Direito da UFRGS, vol. 20, 2001, pp. 171-192.
256 Crée par le Traité d’Asunción en 1991, le Marché commun du sud (Mercosur) a pour but la création à terme d’un marché commun entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et plus récemment le Venezuela. On ajoute la présence de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur du Pérou et du Chili dans le cadre du Mercosur à titre de Pays associés. Le Mercosur demeure une Organisation internationale intergouvernemental, dont les normes n’ont point de caractère supranational.
257 Cf. C. ESPLUGUES MOTA et I. de AGUILAR VIEIRA, « Compraventa internacional de Mercaderías : Los Incoterms 2000 », in C. ESPLUGUES MOTA et D. HARGAIN (dir.), Derecho del comercio internacional – Mercosur et Unión Europea, op. cit., p. 399-435.
258 C. JAUFFRET-SPINOSI et A. WALD, « Le Droit brésilien, cet inconnu », in Le droit brésilien: hier, aujourd’hui et demain, op. cit., p. 19.
259 Le Brésil est un État fédéral, républicain et présidentialiste depuis 1889. Ces caractéristiques le rapprochent beaucoup des États-Unis, qui présentent, mutatis mutandis, une même configuration politique. En matière constitutionnelle, l’influence nord-américaine date de la première constitution républicaine brésilienne de 1891, et est due à la forte contribution du juriste brésilien Rui Barbosa. Au niveau infra-constitutionnel, le droit brésilien se présente néanmoins beaucoup plus unifié que le droit nord-américain. L’expérience nord-américaine a servi, et sert
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
75
croissante du droit nord-américain dans le domaine du droit commercial se vérifie aujourd’hui dans le droit brésilien260, alors qu’une présence de plus en plus marquante des droits romano-germaniques dans le domaine du droit public se fait également sentir261. L’unification promue par le nouveau Code civil et l’institution d’un droit de l’entreprise sont le fruit de l’influence du droit suisse et plus fortement du droit italien.
De plus, l’activité législative du Mercosur contribue également à renforcer l’influence du droit étranger sur l’actuelle évolution du droit des affaires au Brésil, à travers les apports inéluctables des conventions internationales au droit interne. L’effort d’harmonisation des législations ainsi que les mesures législatives prises ou à prendre en matière commerciale dans le cadre du Mercosur tiennent toujours compte de l’expérience européenne, qui est pionnière dans le projet d’intégration économique moderne. Cette prise en compte du droit communautaire est aujourd’hui une source importante d’influence des droits européens, car il dépasse les empreintes nationales pour acquérir une certaine autonomie et autorité de jus commune.
La perspective de création des sociétés (commerciales) du Mercosur en est un exemple262. Certes, les solutions devant être adoptées à cet égard encore aujourd’hui de source d’inspiration aux juristes publicistes et hommes politiques brésiliens dans l’élaboration de notre actuel droit public, au centre duquel la constitution et le caractère fédératif de la nation jouent un rôle central. L’influence nord-américaine se trouve notamment dans le droit constitutionnel et dans le domaine de l’organisation de l’administration économique (agências de regulação, présentes dans presque tous les secteurs de l’économie), alors que cette dernière était originairement orientée selon le modèle interventionniste de type « colbertiste ».
260 Cette influence est notamment remarquable en matière contractuelle et sociétaire, les institutions comme le leasing, factoring, know-how, shopping center, warranties, confort-letters, voting trust, holdings, joint ventures, bid bonds, insider, trading, stock actions, corporate governance, entre autres ne sont pas méconnues des juristes brésiliens et sont présentes au quotidien de la pratique, mais n’en va pas sans poser quelques problèmes lors de leur transposition…à ce propos, v. A. WALD, op. cit., p. 496-497 ; Sur la « circulation de modèles extra-romanistes dans les pays romanistes », consulter R. SACCO, La comparaison au service de la connaissance du droit, Paris, Economica, 1991, p. 159 et s.
261 Si l’influence du droit nord-américain est indiscutable en matière d’agences régulatrices ou d’organes de l’administration économique, le droit matériel appliqué concernant la concurrence s’est fortement inspiré du droit européen. L’influence du droit administratif français dans le droit administratif brésilien est prépondérante, comme en témoignent la technique de la concession de services publics et l’adoption du principe du droit à l’équilibre économique et financier du cocontractant de l’administration. On remarque également la présence prédominante du droit italien en droit brésilien de la procédure civile, dont l’influence s’élargit jusqu’à l’arbitrage. Sur ce sujet, consulter A. WALD, op. cit., pp. 498-499.
262 La Décision MERCOSUR/CMC n.° 26/03, instituant officiellement un Programme de Travail pour les années 2004-2006, a chargé le Groupe Marché Commun (GMC) d’identifier « les instruments nécessaires pour faciliter de développement des activités entrepreneuses dans le MERCOSUR, en matière d’établissement de sociétés, de visas pour les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises, d’harmonisation des exigences aux investisseurs et de la constitution de sociétés MERCOSUL, entre autres, avec l’objectif de mettre en place de tels instruments dans le premier semestre de l’année 2005 » (Point 1.16).
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-2007
76
prendront en considération l’expérience européenne en ce domaine263, y compris celle du choix pour une pluralité de rattachements de ces sociétés ou pour un régime juridique unique, soustrait à l’emprise de toute loi nationale, et qui exprime l’essence du droit des sociétés des États membres. D’autres exemples peuvent démontrer également la présence du droit communautaire comme une nouvelle source d’inspiration directe pour le législateur brésilien : la codification du droit de la consommation au Brésil en 1990264 a été influencée, entre autres, par les directives européennes265, le droit matériel appliqué dans les domaines de la concurrence s’est fortement inspiré du droit européen, qui a, entre autres, établit le besoin d’une analyse économique des conséquences de la conduite sur le marché pour déterminer l’abus de la position dominante de la part d’un acteur du commerce266.
Quoi qu’il en soit, l’influence du droit commercial français est toujours présente. Le législateur brésilien semble être non seulement attentif, mais également sensible aux développements du droit et de la culture juridique français en ce domaine. Les récentes lois brésiliennes sur le redressement de la société267, fortement inspirées par les lois qui constituent le nouveau droit français des procédures collectives268, et sur les partenariats public-privé269 en témoignent. La culture juridique commercialiste française ayant
263 Au sein de la Communauté européenne, des instruments visant à faciliter les conditions d’établissement des relations de coopération et de concentration entre les sociétés relevant de différents États membres ont été adoptés. Ces instruments, fondés sur le droit communautaire, offrent aux sociétés qui le souhaitent la possibilité de constituer une structure de coopération limitée dans son objet au prolongement de l’activité de ses membres, au travers d’un Groupement Européen d’Intérêt Économique (GEIE - Règlement (CE) 2137/85 du Conseil, du 25 juill. 1985), d’une part, et de se concentrer dans le cadre d’une Société Européenne (SE - Règlement (CE) n.° 2157/2001 du Conseil, du 8 oct. 2001), ou d’une Société Coopérative Européenne (SCE - Règlement (CE) n.° 1435/2003 du Conseil, du 22 juill. 2003), d’autre part.
264 Loi n° 8.078, du 11 sept. 1990. 265 Cl. LIMA MARQUES, « L’expérience de la codification et de la réforme du droit de la
consommation au Brésil », in Pour une réforme du droit de la consommation au Québec, F. MANIET et Y. BLAIS (dir.), Fondation Claude Masse, 2005, p. 7.
266 Loi n° 8.884, du 11 juin 1994 (art. 54). 267 Loi n° 11.101, du 9 février 2005, précit. 268 Déc. 85-1388 du 27 déc. 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, qui forme la partie la plus considérable du Livre VI du Code de Com. – art. L. 620-1– 628-3. Loi 2005-845 du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d’application (Déc. n° 2005-1677 du 28 déc. 2005) viennent compléter ce système, en instituant une procédure de prévention des difficultés des entreprises (art. L. 611-1 – 612-5, C. com.).
269 Loi n° 11079, du 30 déc. 2004. Cette loi sur les PPP a en effet également subi l’influence du droit anglais, car c’est en Grande Bretagne qu’a émergé dans les années 1990 cette forme moderne de collaboration entre l’État et le privé. A. WALD (« Le droit brésilien des concessions de services publics et des partenariats public-privés », in Le Droit brésilien…, op. cit., p. 379-403, spéc. pp. 384-385) nous dira pourtant que les PPP ont pour le Brésil une importance et une fonction différentes de celles qui les caractérisent en droit français et anglais, dans la mesure où les PPP assument plus que la simple gestion de services ou la réalisation des grands travaux publics, mais la fonction de construire des pans entiers d’infrastructures sur l’ensemble du grand et demandeur territoire brésilien.
I. DE AGUILAR VIEIRA & al. : CODE DE COMMERCE FRANÇAIS AU BRÉSIL
77
largement participé à la formation de la culture juridique commercialiste au Brésil, demeure profondément ancrée dans la pensée juridique brésilienne, tant au sein de la doctrine270, qu’au sein de la jurisprudence271, nonobstant la mise en place d’un droit de l’entreprise au Brésil avec vocation à élargir la notion classique du droit commercial.
Enfin, malgré les diverses critiques qui ont été adressées au Code de commerce français de 1807, il faut lui rendre l’hommage d’avoir été un code qui a ouvert maintes possibilités d’expansion de la matière commerciale272. Il ne faut pas oublier que ce code a essayé d’embrasser une matière qui, par sa nature, est très réfractaire à la codification et que ce code, comme d’ailleurs tous les autres, a joué un rôle très important dans la promotion et dans la construction de la spécificité du droit commercial au cours du XIXe siècle, en instiguant la construction de la pensée juridique commercialiste au sein de la famille juridique romano-germanique.
270Pour s’en rendre compte, nous invitons les juristes français à ouvrir n’importe quel manuel
ou monographie juridique élaboré par un juriste brésilien, pour constater la place non négligeable qu’il réserve au droit étranger lors de ses analyses. Il faut également remarquer que dans leur pratique journalière, les avocats et les juristes brésiliens se servent du droit étranger pour fonder leur prétention en justice ou pour conseiller leur clientèle.
271 Pour quelques exemples de la jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice (STJ), tribunal uniformisateur majeur au sein de l’organisation judiciaire brésilienne, v. : Paris, REsp 1.294-RO, REsp 3001-MG ; REsp 6263-MG et REsp 9005-PR : mention au droit civil français et à M. PLANIOL, G. RIPERT et A. ESMEIN en matière de contrats/agence, à travers l’œuvre de J. P. CAVALCANTI, Rio, Freitas Bastos, 1956, pp. 32-35 ; REsp 123.645-BA : mention au droit français des contrats ; REsp 13.416-0-RJ, mention à G. RIPERT ; REsp 2122-MS : mention à G. RIPERT et son œuvre, La règle morale dans les obligations civiles, dans sa version portugaise : A Regra Moral nas Obrigações Civis, Saraiva, 1937, p. 7 ; REsp 279.273-SP : mention au droit français des sociétés ; REsp 303.209-RJ : mention à G. MARTY (La distinction du fait et du droit, Paris, Recueil Sirey, 1929, pp. 204-205) sur la méthode de la loi ; REsp 434.341-PB et REsp 444.590-MG : mention à L. JOSSERAND en matière de droit civil (Derecho Civil, vol. I, n° 558, p. 449, Buenos Aires, Ed. Bosch,) (mentions extraites du REsp 11.342-SP). L’influence du droit français dépasse, bien entendu, la frontière du droit privé, pour atteindre d’autres domaines. À cet égard, on peut citer la décision du STJ, REsp 550.095-SC, qui fait mention au droit français de la procédure civile, alors que notre droit souffre d’une forte influence du droit et de la doctrine italiens en ce domaine.
272 J. L. ANAYA, « El influjo del Código de comercio francés en la codificatión argentina », op. cit., p. 106. À l’instar de la réglementation générale sur la société anonyme en substitution au système de chartes individuelles, délivrée par le Conseil d’État sur la base d’un régime de privilèges politiques et commerciaux qui permettaient à la compagnie d’échapper à la réglementation des corporations, ce qui n’était point surprenant si l’on considère le caractère d’utilité publique des compagnies coloniales pendant l’ère du mercantilisme.

































































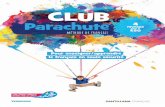


![Les socialistes français vers la société du Care CITE 043 0067[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f36cc32ab5e46f0d1ba5/les-socialistes-francais-vers-la-societe-du-care-cite-043-00671.jpg)



