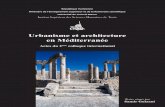Siege, Storm & Slaughter: The Archaeology of 17th Century Sieges in Ireland
Le Saint-Siege et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement....
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Le Saint-Siege et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement....
Martin DUMONT
LE SAINT-SIÈGE ET L’ORGANISATION POLITIQUE DES CATHOLIQUES FRANÇAIS
AUX LENDEMAINS DU RALLIEMENT
1890-1902
PARISHONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2012
www.honorechampion.com
bemc_1_titres_rm_000_titres.qxd 21.10.11 08:45 Page5
INTRODUCTION
La résolution de nommer Mgr Ferrata à la nonciature de Paris marque leferme dessein de Sa Sainteté de ne rien négliger pour gagner la confiancede notre Démocratie. […] [Il] a eu […] un rôle actif à jouer, sous lesordres du Cardinal Rampolla, dans la mise en œuvre […] des idées deprudence prévoyante au nom desquelles la Chancellerie Pontificale1 s’at-tache à persuader aux catholiques de France qu’ils ne doivent pascompromettre la religion dans les controverses des partis2.
En écrivant ces lignes à Alexandre Ribot3, ministre des Affaires étran-gères, le comte Edouard Lefebvre de Béhaine4, ambassadeur de France
1 En employant l’expression de «Chancellerie pontificale», Béhaine fait allusion nonseulement à la Secrétairerie d’État, mais aussi notamment à ce conseil rapproché du papequ’est la Sacrée Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, ainsi que,probablement, à certains ecclésiastiques français se trouvant à Rome, faisant office detransmission de consignes pour la France, tels Eugène Bœglin ou Charles Mourey, l’au-diteur de Rote pour la France.
2 Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), Correspondance Politique(CP) : Rome, vol. 1105, p. 161, Ambassade de Rome, direction politique, midi, n° 93, «LePape et la République. La mission de Mgr Ferrata en France», Edouard Lefebvre deBéhaine à Alexandre Ribot, 20 mai 1891.
3 Républicain de centre-gauche, Alexandre-Félix-Joseph Ribot (1842-1923) est avocatau barreau de Paris au début des années 1870 et député de la 2e circonscription de Boulogne-sur-Mer de 1878 à 1885, puis de 1887 à 1909. A la Chambre, il se fait le défenseur d’uneRépublique libérale. Personnage écouté et influent, il devait être ministre des affaires étran-gères du 17 mars 1890 au 27 février 1892. Durant notre période d’étude, il est Président duConseil et ministre des affaires étrangères du 6 décembre 1892 au 11 janvier 1893, puisPrésident du Conseil et ministre de l’Intérieur du 11 janvier au 4 avril 1893. Il est égalementPrésident du Conseil et ministre des finances du 26 janvier 1895 au 1er novembre suivant.
4 «Chargé d’affaires de France en septembre 1870, il fournit au Saint-Siège et auxFrançais armés pour le défendre des preuves certaines de son dévouement. Ambassadeur deFrance de 1882 à 1895. Pendant une mission unique en ce siècle par sa durée et son éclat ilput, français et catholique, servir utilement et fidèlement ses deux patries» indique la plaquecommémorative érigée en son honneur à Rome, dans l’église nationale de Saint-Louis desFrançais. Rappelé en France en 1895, il meurt deux ans plus tard. Il était par ailleurs lecousin d’Edmond de Goncourt. Georges Goyau devait lui rendre un vibrant hommage peude temps après son décès : «[A]jouter un anneau à la chaîne dont Pépin le Bref et ses succes-seurs forgèrent les premiers morceaux, c’est là ce que souhaitait notre ambassadeur près leSaint-Siège, et il ne souhaitait rien de plus; mais l’avenir découvrira sans doute qu’il y ajoutaplusieurs anneaux, et qu’ils eurent un bon aloi, du poids, et du prix», Le comte E. Lefebvrede Béhaine (1829-1897). Notice biographique (Paris, Lethielleux, 1898), p. 89.
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 7
près le Saint-Siège, exprime parfaitement la situation politico-religieuseexistant en France à partir du début des années 1890 : le pape Léon XIII,par l’intermédiaire de son Secrétaire d’État, le cardinal MarianoRampolla del Tindaro1, et du nouveau nonce à Paris, MonseigneurDomenico Ferrata2, cherche à pousser les catholiques français vers laRépublique en les détachant des anciens partis monarchistes.De fait, la question majeure qui se pose aux catholiques français dans
la dernière décennie du XIXe siècle est celle de leur positionnement parrapport au régime politique. Avant le Toast d’Alger, qui « lance la poli-tique dite du ralliement»3, le doute n’avait pas lieu d’être pour une partie4des catholiques français5 : on était monarchiste, sans états d’âme souvent,
1 Sur le cardinal Rampolla, on lira avec intérêt les articles de Jean-Marc Ticchi («Lecardinal Rampolla dans les archives françaises»,Mélanges de l’Ecole française de Rome,t. 110/2, 1998, p. 525-531) et de François-Charles Uginet, «Les secrétaires d’État deLéon XIII à Jean XXIII. Les problèmes d’une histoire institutionnelle », MEFRIM,t. 110/2, 1998, p. 495-500. Ils font partie d’un important dossier consacré aux secrétairesd’État du Saint-Siège, de 1814 à 1979.
2 En 1879, Domenico Ferrata avait travaillé à la nonciature de France, en qualité d’au-diteur, sous la nonciature de Mgr Czacki, liant des amitiés avec certains républicains, dontAlexandre Ribot. En 1885, il est sacré évêque (diocèse in partibus de Salonique) et estnommé nonce à Bruxelles. Quatre ans plus tard, il entre à la Sacrée Congrégation desAffaires Ecclésiastiques, en tant que Secrétaire. Avec l’agrément du gouvernement, enjuin 1891, il remplace à Paris le nonce Luigi Rotelli.
3 «Un toast humoristique, celui de Paul Bert, l’anticlérical, à Auxerre, sur le phyl-loxéra, avait marqué la bataille des congrégations : un toast, assez différent d’esprit et deton, non seulement marque mais lance la politique dite du Ralliement». Jean-JacquesChevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France, de 1789 à1958, 9e édition (Paris, Armand Colin, 2001), p. 408.
4 Il faut en réalité procéder, à la suite d’Emile Littré, à une distinction entre les catho-liques «selon le suffrage universel» et les catholiques «selon le Syllabus». Pour sa part,Pierre Levêque distingue entre les «pratiquants saisonniers » et les «pratiquants régu-liers». Entre ces deux formes de pratique de la religion, les sentiments politiques sont toutà fait différents : «Les Français des années 1880 et 1890 étaient bien entendus catholiquesdans leur immense majorité, si l’on entend ce terme au sens de “pratiquants saisonniers”,faisant baptiser et communier leurs enfants, se mariant à l’église et souhaitant desobsèques religieuses. En ce sens, il est certain que dès 1876, les Français catholiquesdevaient être déjà presque aussi nombreux à voter pour les républicains plutôt que pourles conservateurs. Il n’en serait déjà plus de même pour les “pratiquants réguliers”,communiant à Pâques et assistant chaque dimanche à la messe : si le parti républicain étaitsolidement implanté dans certaines régions de chrétienté (comme la Lorraine, la Franche-Comté ou la Savoie), il était en général minoritaire dans la plupart d’entre elles : Ouestarmoricain ou Sud-Est du Massif Central par exemple. » Pierre Levêque, Histoire desforces politiques en France, t. 2, 1880-1940 (Paris, Armand Colin, 1994), p. 32.
5 Pierre Levêque définit très nettement le « type» de catholique qui concerne notresujet, ceux qui sont les plus engagés dans les œuvres, et dont il faut tâcher de modifier lessentiments politiques : «Si par “catholiques”, on entend désormais les clercs, les “hommes
8 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 8
par tradition familiale ou par conviction. Les monarchistes qui défen-daient l’Église pouvaient compter sur des forces disciplinées, avec unvote plus ou moins régulier en leur faveur, et sur une organisation terri-toriale bien implantée. Il faut toutefois noter que de fortes nuancespeuvent exister dans certaines régions. C’est ainsi que Michel Denis, parexemple, a pu montrer que le sentiment monarchique perd très tôt duterrain dans le département de la Mayenne – la monarchie n’ayant, selonlui, jamais réussi à se réimplanter durablement dans les esprits – et que lesroyalistes ont à faire face à une rude concurrence de la part des républi-cains1. Il est probable qu’il en soit de même dans d’autres régions.Avec le Ralliement, tout est à reprendre, les nouvelles directions
pontificales désorganisant les groupements locaux et démoralisant lesesprits de bon nombre de militants dévoués à la cause catholique2. Il fautdonc non seulement mettre sur pied une organisation de catholiques néo-républicains, mais l’on doit même d’abord convaincre les catholiquesqu’en adoptant une attitude nouvelle, ils ont fait le bon choix. Le rôle desnéo-républicains – les ralliés –, voire des anciens républicains – notam-ment Etienne Lamy, l’un des 3633 –, consiste précisément à convaincreces catholiques du bien-fondé de leur action, et qu’ils doivent rompreavec leurs anciens modes de pensée. Rôle d’autant plus difficile que leursopposants – les réfractaires – mènent un travail exactement inverse – ou,si l’on préfère, identique, mais dans un but totalement opposé, d’autant
d’œuvres”, les hommes politiques qui affirmaient leur fidélité à l’Église, et tous ceux desélecteurs qui leur faisaient confiance, l’incompatibilité entre “catholicisme” et adhésionà la République semble presque totale». Ibid.
1 Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne. XIXe-XXe siècles,Rennes, Librairie C. Klincksiek, 1977. On se reportera en particulier à la troisième partiede l’ouvrage («Religion ou politique d’abord?») et notamment les chapitres «Le papesupplante le roi» et «Le royaliste de la fin du siècle», p. 380-440 et p. 441-508.
2 Daniel Moulinet a bien montré combien les paroles tant de Lavigerie que deLéon XIII déstabilisent profondément ceux qui jusqu’à présent se dévouaient totalementà la cause de l’Église. Par les consignes de ralliement, ils se sentent désavoués et l’idéed’accepter officiellement la République leur paraît être une trahison de leur passé. Cf.notamment D. Moulinet, Laïcat catholique et société française. Les Comités Catholiques,1870-1905 (Paris, Cerf, 2007), p. 163-179, ce qui concerne l’Union de la France chré-tienne et les déchirements dans les consciences que provoquent les nouvelles directionspontificales.
3 Suite à la démission, le 16 mai 1877, de Jules Simon, désavoué par Mac Mahon, etla nomination par celui-ci du duc Albert de Broglie comme Président du Conseil, chefd’un gouvernement d’Ordre moral, 363 députés, menés par Léon Gambetta, signent unmanifeste qui a été rédigé par Eugène Spuller, et qui est publié dans les journaux le 20 mai1877, appelant les électeurs à rejeter «une politique de réaction et d’aventure».
INTRODUCTION 9
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 9
plus qu’un dilemme se pose de manière très nette : faut-il choisir ladéfense religieuse, au risque de passer sous silence la question constitu-tionnelle, ou privilégier le ralliement à la République, à la forme consti-tutionnelle, quitte à faire passer au second plan la question religieuse ?Il faut en fait observer que le terme de «République» suscite toujours
de très vives répulsions : «La République n’a chez nous que des sympa-thies négatives», écrit ainsi l’évêque de Rodez, Joseph Bourret1, dans unrapport adressé à Léon XIII2. Pour nombre de catholiques, la Républiquene peut être le gouvernement légitime de la France, en raison des discri-minations dont ils sont victimes, les lois laïques en étant la manifestationla plus visible. Les débats qui ont eu lieu lors du Centenaire de 1789 sontlà pour rappeler que les blessures sont vives, et que les esprits sont profon-dément hostiles à tout rapprochement avec la République. En réalité, lasignification de la République n’est pas, dans l’esprit des catholiques– mais aussi, incontestablement, dans celui de nombre de républicains –,d’être une forme de gouvernement, mais une idéologie qui se dresse contrele catholicisme3. Il faut que l’un ou l’autre disparaisse, tel est le choix quis’offre aux catholiques français, et les principaux défenseurs de la reli-gion, en France, sont dès lors des opposants farouches à la République4.
1 Joseph-Christian-Ernest Bourret (1827-1896), ordonné prêtre en 1851, devient en1857 secrétaire de Mgr Guibert, alors archevêque de Tours et futur archevêque de Paris.Nommé évêque de Rodez en 1871, il est élevé à la dignité cardinalice le 12 juin 1893 (titu-laire de l’église Santa-Maria Nuova). « Il est favorable au ralliement. Malgré des étudessupérieures poussées, Bourret n’a jamais fait figure de penseur ou de théologien au seinde l’épiscopat français». Jacques-Olivier Boudon, «Bourret Joseph Christian Ernest», inFrançois Laplanche (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contempo-raine, t. 9, Les sciences religieuses (Paris, Beauchesne, 1996), p. 95.
2 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Affari Ecclesiastici Straordinari (A. E. S.),Francia, II, Pos. 815, fasc. 425, f. 37, mémoire de Mgr Bourret à Léon XIII, p. 13-14,19 novembre 1891. Les différences de pagination tiennent au fait que le mémoire estinséré dans un ensemble de documents, et qu’il est lui-même paginé.
3 Selon Mgr Baunard, le premier biographe de Lavigerie, « la République, telle que lasecte [la Franc-Maçonnerie] l’entend, ce n’est pas simplement l’antiroyalisme, l’anti-impérialisme ; c’est traditionnellement et essentiellement l’antichristianisme. Elle n’estpas un parti, elle est une doctrine». C’est nous qui soulignons. Louis Baunard, Un sièclede l’Église de France. 1800-1900, 3e édition (Paris, Poussielgue, 1902), p. 355-356.
4 Déjà, en 1880, l’abbé Joseph Guthlin (1850-1918) écrivait à Léon XIII pour luisignaler cet aspect de la question de la défense des intérêts religieux. Implicitement, ce quiest posé ici, c’est la nécessité d’opérer une distinction entre constitution et législation àpropos de la République : «Et puis le malheur est en France que ces sortes de questions[défense religieuse, Séparation] sont forcément mal posées. Les intérêts religieux onttrouvé leurs plus zélés partisans et défenseurs parmi les hommes politiques hostiles àl’idée républicaine : quelques uns même sont enchantés de la faute commise par les répu-blicains et abritent leurs arrière-pensées politiques sous le couvert de la défense de ces
10 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 10
Il faut avoir à l’esprit cet aspect de la question qui domine les prises deposition refusant le ralliement. C’est aussi ce qui provoque les incompré-hensions et les hésitations, ainsi que les refus et les attaques contre lecardinal Lavigerie1 et Léon XIII, en particulier après le Toast d’Alger.La préparation et le déroulement de cet événement majeur2 qu’est le
Toast sont maintenant bien connus, notamment grâce aux travaux de XavierdeMontclos3. Rappelons que le 12 novembre 1890, dans le palais archiépis-copal d’Alger, lors d’une cérémonie en l’honneur de la marine française4,
intérêts religieux. C’est ainsi que les républicains accusent sans cesse le parti catholiquemilitant de mêler la politique à la religion et de chercher avant tout un but purement poli-tique». ASV, Segreteria di Stato (SdS), Spoglio Leone XIII, busta 7, Joseph Guthlin àLéon XIII, 20 août 1880. Joseph Guthlin, «professeur au séminaire de Strasbourg de 1873à 1878, séjourne à Rome après son expulsion d’Allemagne. Canoniste de l’ambassadefrançaise, puis supérieur de Saint-Louis-des-Français, il est l’informateur romain descatholiques libéraux». Francesco Beretta,Monseigneur d’Hulst et la science chrétienne.Portrait d’un intellectuel (Paris, Beauchesne, 1996), p. 52, n. 2.
1 Charles-Martial Allemand-Lavigerie (1825-1892), ordonné prêtre en 1849, devientévêque de Nancy en 1863, puis archevêque d’Alger en 1867 (auquel s’ajoute, en 1884,l’archevêché de Carthage nouvellement rétabli). Il fonde la Société des missionnairesd’Afrique (Pères Blancs) l’année suivante, destinée à l’évangélisation des populationsd’Algérie. Léon XIII l’élève à la dignité cardinalice (titulaire de l’église Sainte-Agnès)lors du consistoire du 27 mars 1882. Il s’engage par ailleurs avec fermeté dans la luttecontre l’esclavage. Sur la personne du cardinal, nous ne pouvons que renvoyer à l’ouvragede François Renault, Le cardinal Lavigerie, 1825-1892. L’Église, l’Afrique et la France(Paris, Fayard, 1992).
2 «Cet acte du cardinal de Carthage fut certainement, par le retentissement qu’il eutd’abord, par la portée qu’il eut ensuite, un des événements les plus importants de l’histoirede France. Brusquement, il coupait le câble qui rattachait l’Église à la remorque desanciens pouvoirs, pour la faire naviguer, de pair et dans les mêmes eaux, avec lesmodernes institutions du pays». Louis Baunard, Un siècle de l’Église de France…,op. cit., p. 351. Il semble ici que Baunard se laisse entraîner par son enthousiasme. Certes,le retentissement qu’a eu cet acte fut immense, mais il fait partie – bien entendu, à uneplace éminente – d’une suite d’événements dont le couronnement n’intervient que prèsd’un an et demi après, le 16 février 1892, avec l’encyclique Au milieu des Sollicitudes.
3 Xavier de Montclos, Le Toast d’Alger. Documents, 1890-1891, Paris, éd. deBoccard, 1966.
4 Peu de temps auparavant, le cardinal avait annoncé l’événement à Alexandre Ribot,dans une lettre envoyée de Rome: «Je ne crois pas devoir repartir pour Alger, sans vousfaire connaître que j’ai trouvé ici, tant auprès du Saint Père, qu’auprès de ses principauxconseillers, l’accueil le plus empressé et le plus bienveillant. Les avantages et la nécessitéd’une adhésion explicite de l’épiscopat français, à la forme républicaine, sont désormaisreconnus par le Saint Siège. Il ne s’agit plus que de trouver une occasion et un mode favo-rables pour rendre ces sentiments publics.» AN, fonds Alexandre Ribot, 563AP/12, dossierVIII, Relations avec le Saint-Siège, Affaires religieuses, pochette «diverses correspon-dances et notes concernant questions religieuses», Lavigerie à Ribot, Confidentielle,18 octobre 1890.
INTRODUCTION 11
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 11
le cardinal Lavigerie1, archevêque d’Alger et Carthage, représentant laplus haute autorité de l’État en l’absence du gouverneur – se plaçant parle fait même sur le terrain des institutions républicaines –, prononce uncourt discours en portant un Toast à la Marine, appelant les catholiquesfrançais à la trêve dans la lutte contre la forme de gouvernement existanten France, afin de sauvegarder les intérêts de la religion :
Lorsqu’il faut, pour tenter d’arracher enfin son pays aux abîmes qui lemenacent l’adhésion, sans arrière-pensée, à cette forme de gouvernement,le moment vient de déclarer, enfin, l’épreuve faite et de sacrifier tout ceque la conscience et l’honneur permettent, ordonnent à chacun de nousde sacrifier pour le salut de la religion et de la patrie2.
Malgré tout, en dépit de la puissance des mots prononcés, il est àremarquer que l’archevêque d’Alger emploie des termes qui laissentpenser qu’il ne fait que se résigner devant un fait accompli, espérant endes jours meilleurs, et nulle part ne prononce le mot de «République»3.Cependant, l’accueil réservé au cardinal par les officiers présents – monar-chistes pour la plupart – est glacial, ceux-ci croyant à une excentricité. Demême, en métropole, tout particulièrement dans la presse, l’accueilhostile aux propos tenus par Lavigerie est quasi unanime4. L’ambiguïtédes termes employés est à la base d’une série d’interprétations contradic-toires chez les catholiques : le cardinal a-t-il vraiment parlé en son nom
1 «Un prélat intrigant et ami du bruit » note férocement Albert Houtin, Histoire dumodernisme catholique (Paris, chez l’auteur, 1913), p. 17. Quelques années auparavant,dans le discours de réception à l’Académie française prononcé le 7 février 1907, le cardi-nal Matthieu, qui connaissait bien la question, avait exprimé une opinion assez similaire,même s’il l’avait naturellement formulée avec plus de tact : «Sur la plus grave et la plusdélicate des questions de politique religieuse, Lavigerie eut le tort d’asséner sa manièrede voir au lieu de l’insinuer. Ce triomphateur ne savait point parler bas et avait toujoursraison bruyamment». Edmond Renard, Le cardinal Matthieu. 1839-1908 (Paris, J. deGigord, 1925), p. 326.
2 Texte officiel communiqué par Lavigerie à son clergé, in X. de Montclos, Le Toastd’Alger…, op. cit., appendice.
3 «Toute sa harangue témoignait d’un manque absolu d’enthousiasme ; il n’étaitquestion que de résignation, de sacrifice pour éviter un pire ; ni le mot de ralliement, nimême celui de République n’était prononcé, comme s’il eût dû écorcher, sinon la bouchede l’orateur, du moins les oreilles de son auditoire». Fabrice Bouthillon, L’illégitimité dela République. Considérations de l’histoire politique de la France au XIXe siècle, 1851-1914 (Paris, Plon, 2005), p. 175.
4 «Ces propos, appelés “Toast d’Alger”, sont mal accueillis par les monarchistes.Certains invectivent le prélat tandis que l’épiscopat français s’en tient uniquement à ladéfense religieuse». Bruno Dumons, Catholiques en politique. Un siècle de Ralliement(Paris, DDB, 1993), p. 15-16.
12 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 12
propre ou est-ce le pape qui le lui a demandé? Quelle position faut-ildésormais adopter face à la République?De plus, les réactions de certains évêques au Toast sont particulière-
ment significatives. Pris entre le rejet de la position exprimée par l’ar-chevêque d’Alger et le doute entretenu autour d’une possible missionpontificale, certains ne savent quelle attitude adopter. Ainsi, par exemple,l’évêque d’Angoulême, Léopold Sebaux1, écrit au cardinal Rampollaqu’il est prêt à suivre les instructions du pape, mais qu’il lui sembleimpossible d’approuver les propos de Lavigerie :
Suivre les avis du Saint-Père est un devoir que la conscience nousimpose et que nous remplirons religieusement. Adhérer à la Républiquesans arrière-pensée2, ainsi que le demande Son Eminence le Cardinald’Alger, paraîtrait à tous, pour les raisons susdites, une regrettabledéfaillance ; il n’en faudrait pas davantage pour diviser le clergé et lesmeilleurs fidèles, nous aliéner leur appui et diminuer notre influencepour le bien3.
De même, François-Marie-Benjamin Baduel d’Oustrac (1818-1891)4,l’évêque de Saint-Flour, demande des éclaircissements au cardinalSecrétaire d’État. Pour lui, l’acceptation sans conditions de la République
1 Alexandre-Léopold Sebaux (1820-1891), évêque d’Angoulême depuis 1872.«Légitimiste en politique et intransigeant en religion, Mgr Sebaux s’est trouvé plusieursfois en situation délicate avec les autorités civiles […]. Pour Mgr Sebaux, la rechristiani-sation du pays passe par l’idée d’une société chrétienne dans toutes ses composantessociales et politiques, et nécessairement la monarchie ne peut qu’en être le seul et véri-table soutien». Jacques Baudet, «Les retombées de l’encyclique Rerum novarum enCharente», inMarc Agostino (textes recueillis par), Tempéraments aquitains et nouveau-tés religieuses. Rerum novarum et l’enseignement de l’Église dans le Sud-Ouest de laFrance (Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1993), p. 68-69.
2 C’est précisément la demande qu’exprime Léon XIII, quelques mois plus tard, danssa lettre-encyclique du 16 février 1892.
3 ASV, A. E. S., Francia, II, Pos. 804, fasc. 423, ff. 14-15, Sebaux à Rampolla,6 décembre 1890.
4 Originaire d’une des plus importantes familles de l’Aveyron, « [s]a fortune estestimée à un million de francs». Ordonné prêtre en décembre 1844, il exerce différentsministères à Paris, avant d’être nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Villefranchede Rouergue. Il devient évêque en 1877, au moment de la crise du 16-Mai, grâce à uncertain nombre de réseaux, locaux, politiques et familiaux : «Baduel est l’homme du particonservateur, soutenu à la fois par les parlementaires et les évêques de la région favo-rables à Mac-Mahon. Indépendamment du contexte politique, cette nomination révèle lapersistance de stratégies familiales dans la conquête du pouvoir, y compris ecclésiastiques[…].» Pour les deux citations, Jacques-Olivier Boudon, L’épiscopat français à l’époqueconcordataire (1802-1905). Origines, formation, nomination (Paris, Cerf, 1996), p. 49-50, p. 431. Il devait fonder la Semaine catholique de son diocèse, en 1878.
INTRODUCTION 13
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 13
est impossible, mais l’obéissance passant avant tout, si le Pape l’ordonne,alors il ne peut que s’incliner, la mort dans l’âme :
L’acte d’adhésion de Son Eminence le Cardinal Lavigerie a éclatécomme un coup de foudre. […]Il nous semble si difficile de pouvoir, en conscience, adhérer, sans condi-tions déterminées et sans réserves expresses, au régime républicain telque l’ont fait les francs-maçons qui sont au pouvoir, qu’en vérité il n’yaurait qu’un désir formel de Sa Sainteté qui pût nous amener à cet acte derésignation douloureuse et surtout filiale1.
Le doute et la division s’instaurent donc dans les esprits, d’autant plusque les questions épineuses s’ajoutent, et notamment celle-ci, particuliè-rement cruciale pour l’organisation politique des catholiques en France :faut-il accepter la République, en abandonnant tout espoir de restaurationmonarchique, ou peut-on conserver ses sentiments personnels et adopterune attitude de ralliement tactique à la République pour mieux la détruire?Les questions sont d’autant plus complexes à résoudre que Léon XIII,
par plusieurs encycliques2, avait nettement condamné, dans la même ligneintransigeante que son prédécesseur Pie IX3, les principes philosophiquesservant de base à la République en France4. Pour maints catholiques fran-çais, accepter la République comme un gouvernement convenable repré-sente donc, en quelque sorte, une trahison de la foi, suscitant ainsi deterribles problèmes de conscience. De plus, il ne peut y avoir qu’untiraillement terrible entre la conservation et la défense des principes reli-gieux – par essence intransigeante –, et la pratique sur le terrain, beau-coup plus libérale5, car elle nécessite, si l’on reconnaît la République, de
1 ASV, A. E. S., Francia, II, Pos. 804, fasc. 423, f. 4, Baduel d’Oustrac à Rampolla,19 novembre 1890.
2 Notamment Libertas praestantissimum (1888), sur la liberté, et Immortale Dei(1885), sur la constitution des États. Ces deux encycliques s’opposent fermement aumonde moderne, dans la droite ligne de l’encyclique Quanta Cura et du Syllabus (1864),de Pie IX.
3 « Il ne faut pas croire que Léon XIII veuille adapter l’Église au monde moderne :plus exactement, il veut, par l’action des catholiques, adapter le monde moderne àl’Église. La visée de long terme ne change pas de Pie IX à Léon XIII, mais la stratégie esttrès différente». Jérôme Grondeux, La France entre en République. 1870-1893 (Paris,Librairie Générale Française, 2000), p. 174.
4 Notamment la neutralité de l’État en matière confessionnelle, avec un traitementégal pour toutes les religions.
5 Emile Zola, dans Rome, prête à son héros, l’abbé Pierre, des pensées sur Léon XIIIqui vont dans le sens de la différence entre principes et pratique, et ce, au plus haut niveaude la hiérarchie : «Dès que Léon XIII est pape, dans la difficile situation laissée par Pie IX,se révèle la dualité de sa nature, le gardien inébranlable du dogme, le politique souple,
14 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 14
s’allier avec des hommes qui, bien souvent, professent des principes toutopposés.De fait, il s’agissait d’autant d’interrogations, entraînant des mises au
point successives du Saint-Siège, soit indirectement, par des lettres à telévêque ou tel ecclésiastique, ou à une personnalité politique française1,voire par des entretiens accordés à la presse. On voit ainsi des groupe-ments de catholiques se former, se réclamant tous de la pensée pontifi-cale et exprimant leur fidélité au Saint-Siège et à la ligne politique quel’on pense défendue par celui-ci, chacun interprétant en réalité à sa guiseles propos tenus par le Secrétaire d’État ou ceux rapportés comme ayantété prononcés par le pape. Il faut donc attendre le mois de février 1892 etl’intervention directe de Léon XIII dans les affaires de France par l’en-cyclique Au milieu des Sollicitudes, pour que la position adoptée par leSaint-Siège devienne plus claire2, texte lui-même suivi d’une nouvelleprécision, sous la forme de la Lettre aux cardinaux français (Notre conso-lation), le 3 mai suivant3.
résolu à pousser la conciliation aussi loin qu’il le pourra. […] [L]e dogme mis de la sorteà l’abri, il vit d’équilibre, donne des gages à toutes les puissances, s’efforce d’utiliser toutesles occasions.» E. Zola, Les trois villes. Rome, Paris, G. Charpentier & E. Fasquelle, 1896,p. 33.
1 Y compris des diplomates. Les archives duministère des affaires étrangères montrentclairement la cordialité des relations existant entre Rampolla et Béhaine. Ainsi, ce dernierpeut-il écrire au ministre des affaires étrangères, Alexandre Ribot, qu’il ne peut que luidonner pleine confirmation du rapprochement du Saint-Siège vers la République : «Un faitme frappe, c’est la confiance absolue et cordiale avec laquelle le Cardinal Rampolla meparle maintenant de son espoir de voir disparaître toute difficulté entre le Gouvernementde la République et le Saint-Siège. Cette confiance était loin d’exister au même degré il ya six semaines. J’incline à y voir la preuve que toute idée de modifier à notre détrimentl’orientation de la politique pontificale est aujourd’hui écartée, si nous restons fidèles auprogramme que vous avez exposé au nonce […].» AMAE, CP: Rome, vol. 1108, p. 198,dépêche télégraphique, duplicata n° 12, Béhaine à Ribot, Rome, 5h50, 9 février 1892.
2 «En d’autres termes, dans toute hypothèse, le pouvoir civil, considéré comme tel, estde Dieu et toujours de Dieu […]. Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements quireprésentent cet immuable pouvoir sont constitués, les accepter n’est pas seulement permis,mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les main-tient. […] Une telle attitude est la plus sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tousles Français, dans leurs relations civiles avec la république, qui est le gouvernement actuelde leur nation. Loin d’eux ces dissentiments politiques qui les divisent ; tous leurs effortsdoivent se combiner pour conserver ou relever la grandeur morale de leur patrie».
3 «Or, ces efforts deviendraient radicalement stériles, s’il manquait aux forcesconservatrices l’unité et la concorde dans la poursuite du but final, c’est-à-dire la conser-vation de la religion, puisque là doit tendre tout homme honnête, tout ami sincère de lasociété. Notre Encyclique l’a amplement démontré. Mais, le but une fois précisé, le besoind’union pour l’atteindre une fois admis, quels seront les moyens d’assurer cette union?Nous l’avons également expliqué et Nous tenons à le redire, pour que personne ne se
INTRODUCTION 15
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 15
En réalité, si la position officielle du Saint-Siège par rapport à laRépublique en France devient plus nette, elle n’en est pas moins toujoursaussi troublée dans son application. Car si l’encyclique du 16 février 1892est très claire quant à l’acceptation de la République par la papauté, iln’est rien dit de ce que recouvre la stratégie voulue par le Pontife. Eneffet, « si Pie IX refusait en bloc la société moderne dans laquelle il vivait,Léon XIII, lui, en accepte quelques composantes, comme la République,mais dans le but essentiel d’en faire une République chrétienne»1. Lesdivisions qui se sont formées entre les catholiques français y trouventsans doute leur origine, faute d’un discours cohérent sur la question.Paradoxalement, le Saint-Siège, en laissant chacun à sa conscience, endemandant une obéissance intégrale aux volontés pontificales d’accepterla République, mais sans indiquer pour autant clairement quels devaienten être les moyens pratiques et le but poursuivi, créait lui-même lesinstruments d’un échec à terme.De plus, la question de l’alliance avec les monarchistes ne peut que se
poser, étant également défenseurs fidèles du catholicisme. En vertu dequel principe est-il possible de les exclure du combat commun, la sauve-garde des intérêts de la religion et notamment du Concordat ? C’est ainsiqu’à l’occasion des élections législatives de 1898, un soutien est accordéà certains monarchistes par les comités Justice-Egalité, dirigés par lesAugustins de l’Assomption – pourtant officiellement ralliés – au nom dela défense de la religion.Nous étudierons donc tout particulièrement la signification que prenait
pour certains ralliés le terme même de «Ralliement ». Signifiait-il unetactique de pénétration de la République, pour certains de ces « républi-cains du pape»? Ou revêtait-il un autre sens : défense du catholicisme,union derrière les prêtres et les évêques dans le but de restaurer le pouvoirtemporel du pape? A contrario, y a-t-il intégration d’un certain type dediscours sur le ralliement, avec notamment une républicanisation descatholiques français ?
méprenne sur Notre enseignement : un de ces moyens est d’accepter sans arrière-pensée,avec cette loyauté parfaite qui convient au chrétien, le pouvoir civil dans la forme où, defait, il existe. […] Lors donc que, dans une société, il existe un pouvoir constitué et mis àl’œuvre, l’intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir, et l’on doit, pour cette raison, l’ac-cepter tel qu’il est. C’est pour ces motifs et dans ce sens que Nous avons dit aux catho-liques français : Acceptez la République, c’est-à-dire le pouvoir constitué et existant parmivous ; respectez-la ; soyez-lui soumis comme représentant le pouvoir venu de Dieu».
1 Bruno Dumons, Catholiques en politique…, op. cit., p. 21-22.
16 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 16
Dans les faits, la nouvelle stratégie catholique échoue, et ce, dès sespremiers pas, les députés ralliés perdant un tiers des leurs lors des élec-tions législatives de 1893. Cependant, les années 1893-1894 sont unepériode de répit, notamment avec l’élection à la présidence du Conseil deJean Casimir-Périer1, et l’instauration de l’esprit nouveau, suite audiscours prononcé par le ministre des cultes Eugène Spuller2, à la Chambredes députés, le 3 mars 18943. Par ailleurs, la réorganisation des forces
1 « [H]éritier de la plus célèbre dynastie de la grande bourgeoisie libérale» (JeanGarrigues, La république des hommes d’affaires. 1890-1900, Paris, Aubier, 1997, p. 313),Jean-Paul-Pierre Casimir-Périer (1847-1907) est petit-fils d’un président du Conseil deLouis-Philippe, fils aîné de celui qui fut ministre d’Adolphe Thiers. Décoré de la Légiond’Honneur pour sa conduite durant la guerre de 1870, il se présente pour la première foisaux élections législatives, à Nogent-sur-Seine, en 1876, et est élu, sans concurrent. Aucentre gauche, il fait partie des «363». Réélu en 1877, il vote en faveur de l’article 7, maisse prononce contre l’abrogation du Concordat durant la législature suivante. En 1883, ildémissionne pour n’avoir pas à cautionner la mesure qui dépossédait de leurs fonctionsmilitaires les membres des familles ayant régné sur la France. Réélu un mois plus tard, ilvote durant cette législature pour le maintien de l’ambassade près le Saint-Siège. Elu deuxfois Président de la Chambre, en janvier, puis en novembre 1893, il devient Président duConseil le 3 décembre 1893, s’attribuant le portefeuille des Affaires étrangères. Son minis-tère dure six mois, jusqu’au 23 mai 1894. Un mois plus tard, le président de la RépubliqueSadi Carnot est assassiné à Lyon par l’anarchiste d’origine italienne Caserio. Trois joursaprès ce tragique événement, le 27 juin, Jean Casimir-Périer est élu à la Présidence de laRépublique, en dépit de ses réticences. Cependant, cet hommemodéré et habitué à la modé-ration, en butte à l’hostilité du cabinet Dupuy, démissionne par surprise le 15 janvier 1895.
2 Séraphin-Jacques-Eugène Spuller (1835-1896), avocat au barreau de Paris, proche deLéon Gambetta et de Jules Ferry. Aux élections législatives de 1876, il est élu député du 3earrondissement de Paris, s’inscrivant au groupe de l’Union républicaine, puis est réélu l’annéesuivante. C’est durant cette législature qu’il se fait le rapporteur de l’article 7 de la loi Ferrysur l’enseignement, pour lequel il vote. En 1887, sous le cabinet Rouvier, il est nomméministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, fonction qu’il occupe ànouveau du 3 décembre 1893 au 23 mai 1894, sous le cabinet Casimir-Périer. C’est donc entant que ministre des cultes qu’en réponse à une question de Denys Cochin, député monar-chiste de la Seine, il prononce, le 3 mars 1894, un discours où il se déclare favorable à unerépublique ouverte à tous: «[I]l est temps […] de faire prévaloir, en matière religieuse, unvéritable esprit de tolérance […] qui a son principe non seulement dans la liberté de l’esprit,mais aussi dans la charité du cœur. […] Je dis qu’il est temps de lutter contre tous les fana-tismes […], contre tous les sectaires […] [S]ur ce point, vous pouvez compter à la fois et surla vigilance du Gouvernement pour maintenir les droits de l’État, et sur l’esprit nouveau quil’anime.» In LéonMuel,Gouvernements, ministères et constitutions de la France de 1789 à1895. Supplément (1890-1895), Paris, Librairie Guillaumin et Cie, 1895, p. 62.
3 Nathalie Bayon considère que le discours du ministre est en réalité profondémentenraciné dans l’idée républicaine, et qu’il cherche à modérer les excès possibles des répu-blicains afin de mieux faire accepter la République : «C’est donc dans une volonté depréservation des institutions en vigueur qu’il souhaite la réalisation de la politique d’apai-sement. Accueillir les ralliés sincères n’est pas pour lui un changement de programme.C’est seulement continuer la politique de républicanisation de la nation. […] En déclarant
INTRODUCTION 17
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 17
catholiques leur permet de tenter de peser sur la gestion politique de lanation, comme en témoigne le ministère Méline, et les relations cordialesétablies avec le nonce à Paris, Domenico Ferrata, puis Eugenio Clari.L’Affaire Dreyfus, le développement de l’antisémitisme et d’un certain
antirépublicanisme de la part de congrégations religieuses, changent ladonne1. Désormais, l’«esprit nouveau» est mort, et toute alliance avec lesdéputés ralliés est dénoncée, tout particulièrement après l’affaire desmissidominici, ces religieux envoyés par le pape pour préparer les électionslégislatives de 1898. Les différentes organisations qui ont été mises surpied entre-temps, que ce soit la Fédération électorale ou les ComitésJustice-Egalité, sont des échecs, à plus ou moins brève échéance.Peu auparavant, en 1897, une élection avait eu lieu à Brest, fonda-
mentale. De locale qu’elle devait être, elle était devenue nationale – etmême au-delà, le Saint-Siège espérant le succès de l’élection – car,s’agissant de remplacer Mgr d’Hulst, décédé en novembre 1896, uncombat d’une rare intensité se déroulait. Le parti clérical prend ouverte-ment parti pour l’abbé Gayraud, ancien dominicain de la province deToulouse, contre le comte Louis de Blois, catholique et monarchisteconvaincu. Durant quelques semaines, les prêtres, profitant de leuremprise morale sur les fidèles, martèlent que voter pour le candidatmonarchiste est un péché, qu’ils n’ont pas d’autre choix que Gayraud. Laméthode, dénoncée après l’élection, réussit, et celui-ci est élu, symboli-sant alors « la victoire des curés sur les nobles». Invalidé, HippolyteGayraud se voit confirmé par les électeurs. Ce sera un des premierssuccès du «parti rallié», et l’un de ses derniers, le parti clérical s’étanttrop dévoilé. En montrant un visage du ralliement non encore pleinementmis en lumière, celui du cléricalisme le plus marqué2, l’élection de Brestparticipe au réveil des anticléricaux et à leur union, à l’approche des élec-tions législatives de 1898.
l’esprit nouveau, Spuller renvoie dos-à-dos cléricaux et anticléricaux, en un mot, tousceux qui ne veulent pas de la République libérale et conservatrice mise en place par lesrépublicains de gouvernement.» Eugène Spuller (1835-1896). Itinéraire d’un républicainentre Gambetta et le Ralliement (Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires duSeptentrion, 2006), p. 240-241.
1 «Avant que l’Affaire Dreyfus n’intervînt véritablement dans la vie politique, lesélections de 1898 ramenaient l’opposition des deux blocs», note Jean-Marie Mayeur,«Droites et ralliés à la Chambre des Députés au début de 1894», Revue d’histoiremoderne et contemporaine, t. 13, 1966, p. 135.
2 «La politique de ralliement prend, par suite de cette lutte, un caractère clérical quila dénature». ASV, SdS, anno 1900, rubrica (rub.) 248, fasc. 10, prot. 37922, f. 64, deMun à Rampolla, lettre sans date, écrite aux alentours du 20 avril 1897.
18 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 18
Malgré un engagement sans précédent de la part du Saint-Siège pourorganiser les divers groupements catholiques et tenter de les unifier, cesdernières sont un échec, mettant à mal l’union péniblement obtenue, enraison des divergences concernant les candidats à soutenir – candidats catho-liques, ou républicains modérés –, malgré les négociations menées avec leministère Méline durant l’entre-deux tours. Dès lors, le mouvement accu-mule les échecs. L’arrivée au pouvoir de Pierre Waldeck-Rousseau estaccompagnée d’unemontée de l’anticléricalisme et d’une accentuation de lalutte contre les congrégations, notamment les Assomptionnistes qui se sontengagés à visage découvert dans la campagne des élections et ont agacé legouvernement avec leurs critiques permanentes et la violence de leurspropos. De plus, les outrances des tenants de la culpabilité du capitaineDreyfus offrent un terrain d’entente aux opposants à la pacification politiqueet religieuse en raison desmenaces qui pèsent de nouveau sur la République.Quatre ans plus tard, en 1902, malgré un nouvel effort de préparation
– en dépit de la disparition de la Fédération électorale au cours de l’année1900 – et la formation de l’Action libérale, les élections législatives sontà nouveau un échec, ouvrant ainsi la voie à une chambre de tendance radi-cale. Désormais, «“l’esprit nouveau” n’est plus qu’un souvenir»1.
* * *
Cet ouvrage s’est ainsi donné pour but d’analyser d’une part l’organi-sation des catholiques français en politique et leur positionnementcomplexe par rapport à la République, et, d’autre part, le rôle joué par leSaint-Siège – c’est-à-dire le pape, la Secrétairerie d’État et le nonce à Paris– dans l’organisation même des catholiques français aux lendemains duRalliement. Il aborde une période chronologique déterminée, de la légis-lature qui s’ouvre en 1889 jusqu’aux élections législatives de 1902, sansse limiter à un diocèse ou un département particulier, ni à un groupementde catholiques spécifique. Ce n’est que ponctuellement que nous abordonsplus avant l’organisation locale d’un mouvement à visée politique.Ce qui nous a conduit à adopter cette démarche est, en premier lieu,
un manque d’archives disponibles. D’autre part, ce que nous avonssouhaité réaliser à travers cet ouvrage, c’est une histoire des idées, parl’intermédiaire de l’analyse des discours prononcés et des attitudes adop-tées face à la République. Enfin, nous avons voulu nous centrer plus
1 Emile Poulat, «Socialisme et anticléricalisme. Une enquête socialiste internatio-nale, 1902-1903», Archives de Sciences Sociales des religions, t. 10, 1960, p. 109.
INTRODUCTION 19
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 19
particulièrement sur les relations entre le Saint-Siège et les catholiquesfrançais, dépassant par essence l’échelle locale.L’année 1890 a ainsi été adoptée comme première borne chronologique
eu égard à la richesse des événements qui s’y sont déroulés. Certes, nousaurions également pu choisir 1889, par le caractère crucial que revêtent lesélections. En raison de la campagne boulangiste, il s’agit des premières élec-tions depuis l’instauration de la République où les conservateurs et lesmonarchistes – à de rares exceptions près – se présentent sans faire état deleurs sentiments monarchiques et de leur volonté d’abattre la République,suscitant ainsi le trouble dans les esprits quant à leur choix politique1. A cetteoccasion, le comte Albert de Mun2, dans un journal anglais, The Pall MallGazette, devait annoncer la fin de ses espérances monarchiques3.Malgré tout, ce qui nous détermine à opter pour l’année 1890 est la
faiblesse des changements dans les mentalités des catholiques par rapportà la République et leur mode d’organisation politique en 1889. En 1890,le temps ayant déjà commencé à faire son œuvre, les événements, petits ougrands, se succèdent, créant un climat favorable à une évolution des espritsvers la République. Tandis que l’orléaniste Jacques Piou cherche à formerla Droite constitutionnelle, indépendante des monarchistes4, en prenantcontact avec certains de ses collègues députés, les premières idées d’uni-fication des différents groupements catholiques se font jour. De plus, la fin
1 Sur cette question : Philippe Levillain, Boulanger fossoyeur de la monarchie, Paris,Flammarion, 1982. Sur l’aventure boulangiste elle-même, ses tenants et aboutissants, lameilleure synthèse est sans doute celle de Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire. Lesorigines françaises du fascisme. 1885-1914, Paris, Seuil, coll. «Points», 1978.
2 Adrien-Albert-Marie, comte de Mun (1841-1914), député du Morbihan de 1876 à1878 puis de 1881 à 1893, avant d’être député du Finistère de 1894 à 1914. Officier, prison-nier à Aix-la-Chapelle en 1870 où il fait la connaissance de René de La Tour du Pin (1834-1924), il s’intéresse aux idées sociales de Mgr von Ketteler, l’évêque de Mayence. Par lasuite, après avoir contribué à la répression de la Commune, il participe, avec La Tour duPin, Maurice Maignen (1822-1890) et quelques autres, à la fondation de l’Œuvre descercles catholiques d’ouvriers en décembre 1871. Doté d’un indéniable talent oratoire, ildevait se faire connaître par ses innombrables discours, pour certains très vigoureusementopposés aux principes de 1789 : «Nous sommes la Contre-Révolution irréductible»déclare-t-il à Chartres en 1878. Sur la personne d’Albert de Mun et l’Œuvre des cercles,on se reportera à la thèse de Philippe Levillain, Albert de Mun. Catholicisme français etcatholicisme romain, du Syllabus au Ralliement, Rome, Ecole Française de Rome, 1983.
3 The Pall Mall Gazette, 10 octobre 1889.4 «Les anticléricaux accusaient leurs adversaires de se servir de la religion pour
combattre la République en vue d’une restauration monarchique; catholiques et conserva-teurs durent briser dans leurs mains cette arme empoisonnée en préconisant le ralliement. Delà, la politique constitutionnelle, inaugurée en 1889 à la Chambre après cinq consultationsnationales également désastreuses». Piou, Le ralliement. Son histoire, Paris, Spes, 1928, p. 8.
20 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 20
de l’année 1890 voit éclater, dans le ciel politico-religieux, un coup detonnerre, sous la forme du toast prononcé à Alger par le cardinal Lavigerie,invitant les catholiques à accepter le gouvernement établi en France.L’autre borne chronologique est l’année 1902, et ce, pour deux
raisons. En premier lieu, il s’agit de la clôture d’une législature, celle quis’est ouverte en 1898, et qui s’est révélée dramatique pour les forcescatholiques : procès contre les Augustins de l’Assomption, montée del’anticléricalisme et du risque de Séparation, loi de 1901, notamment. Lesélections de 1902 ont donc valeur de nouveau test pour la politique ponti-ficale. En second lieu, l’année 1902 voit la naissance officielle d’unnouveau groupement, à visée politique, défendant les droits des croyantstout en étant non confessionnel, l’Action Libérale Populaire, fondéenotamment par Jacques Piou et recrutant très largement au sein desanciennes élites déjà présentes dans les Comités Catholiques. Cettenouvelle association représente également un essai de stratégie renouve-lée d’alliances et de rapprochement avec les républicains, entretenant desrelations complexes avec le Saint-Siège, engendrant ainsi de nouvellesmodalités dans l’organisation politique des catholiques français.Il est bien évident que notre thème de recherche est loin d’avoir été
inexploité ; le terrain est pour ainsi dire préparé, encadré, par avance. Ilserait naturellement trop long de citer tous les travaux – publiés ou encoreinédits à ce jour – portant sur notre période d’étude, voire sur des théma-tiques proches. Nous nous limiterons donc à n’évoquer que les essentiels.Parmi eux, nous pensons notamment à l’étude de Xavier de Montclosautour du Toast d’Alger1 – qui s’arrête toutefois au mois de juin 1891 –,complétée par les travaux de François Renault sur Charles-MartialLavigerie2. Evoquons aussi, naturellement, les nombreuses recherches deJean-Marie Mayeur – qu’il s’agisse de son étude sur l’abbé Lemire3, ouses ouvrages sur la démocratie chrétienne4 et la Troisième République5 –
1 Xavier de Montclos, Le Toast d’Alger. Documents, 1890-1891, Paris, éd. deBoccard, 1966.
2 François Renault, Le cardinal Lavigerie, 1825-1892. L’Église, l’Afrique et laFrance, Paris, Fayard, 1992.
3 Jean-Marie Mayeur, L’abbé Lemire, 1853-1928. Un prêtre démocrate, Paris,Casterman, 1968.
4 J.-M. Mayeur, Des Partis catholiques à la Démocratie chrétienne. XIXe-XXe siècles,Paris, Armand Colin, 1980 ; Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principesromains et expériences françaises, Paris, Cerf, 1986.
5 J.-M. Mayeur, Les débuts de la Troisième République. 1871-1898, Paris, Seuil,1973 ; La vie politique sous la troisième République. 1870-1940, Paris, Seuil, 1984.
INTRODUCTION 21
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 21
ou de Bertrand Joly, sur le nationalisme ainsi que sur Paul Déroulède1, lathèse de Philippe Levillain sur Albert deMun2, celle de Jérôme Grondeuxsur Georges Goyau3, l’ouvrage de René Rémond – déjà ancien maisjamais remplacé – sur les congrès ecclésiastiques de Reims4, et celui,classique et plus philosophique, de Maurice Montuclard, sur les déve-loppements du mouvement démocrate chrétien en France5. Des étudesportant sur des républicains de gouvernement ont également été réalisées,limitant d’autant notre aire de recherches, qu’il s’agisse de Pierre Sorlinsur Waldeck-Rousseau6 ou Nathalie Bayon sur Eugène Spuller7.Plus récemment, à l’occasion du Centenaire de la loi de 1905,
plusieurs ouvrages ont remis sur le devant de la scène historique lapériode que nous étudions. D’une part, la traduction de l’étude classiquede l’historien anglais Maurice Larkin8, qui aborde la question duRalliement en se penchant sur les signes avant-coureurs de la Séparation.Pour sa part, Fabrice Bouthillon – qui se penche sur la question du proces-sus de légitimation du pouvoir en France de la deuxième moitié duXIXe siècle à 19149 – s’interroge, dans un chapitre consacré au Ralliement,sur les justifications apportées par Léon XIII à la légitimation de laRépublique. Pour les catholiques français, le gouvernement républicainest illégitime par la doctrine qu’il développe – la laïcité –, jusqu’aumoment où, en 1892, le pape déclare, suivant l’habitude prise au coursdes siècles de reconnaître les pouvoirs établis, qu’il est temps de se
1 Bertrand Joly, Déroulède, l’inventeur du nationalisme français, Paris, Le grandlivre du mois, 1998. Il a ensuite dirigé un importantDictionnaire biographique et géogra-phique du nationalisme français, 1880-1900 (Paris, Honoré Champion, 2005).
2 Philippe Levillain, Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain,du Syllabus au Ralliement, Rome, Ecole Française de Rome, 1983.
3 Jérôme Grondeux, Georges Goyau, 1869-1939. Un intellectuel catholique sous laIIIe République, Rome, Ecole française de Rome, 2007.
4 René Rémond, Les deux Congrès ecclésiastiques de Reims. 1896, 1900, un témoi-gnage sur l’Église de France, Paris, Sirey, 1964.
5 Maurice Montuclard, Conscience religieuse et démocratie. La deuxième démocra-tie chrétienne en France, 1891-1902, Paris, Seuil, 1965.
6 Pierre Sorlin,Waldeck-Rousseau, Paris, Armand Colin, 1966.7 Nathalie Bayon, Eugène Spuller (1835-1896). Itinéraire d’un républicain entre
Gambetta et le Ralliement, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,2006.
8 Maurice Larkin, L’Église et l’État en France. 1905, la crise de la Séparation,Toulouse, Privat, 2004. Préfacé par Jean-Marie Mayeur, il s’agit d’une réédition, revue etaugmentée, d’un ouvrage paru en anglais, Church and State after the Dreyfus Affair. TheSeparation Issue in France (Londres, Macmillan, 1974).
9 Fabrice Bouthillon, L’illégitimité de la République. Considérations de l’histoirepolitique de la France au XIXe siècle (1851-1914), Paris, Plon, coll. Commentaire, 2005.
22 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 22
soumettre à la République, tout en condamnant l’idée de la souverainetépopulaire : le problème crucial est que, comme l’écrit Paul Airiau, danstoute relation dialectique, il faut être deux1, et la République n’a que fairede la reconnaissance de l’Église, elle ne tire sa légitimation que du peupleet non d’un quelconque pouvoir spirituel2.Nous n’ignorons pas non plus qu’il existe nombre de travaux univer-
sitaires sur des questions connexes à notre étude, encore inédits3. On selimitera ici à évoquer seulement deux mémoires de DEA ou de find’études (IEP)4 et une thèse portant sur le baron de Mackau5. En étudiantla Conférence Olivaint, une association étudiante parisienne, DavidColon pose la question du recrutement et des groupes sociaux qui sontvisés par les nouveaux groupements politiques ou les comités électorauxcatholiques. Alexandre Fournier, de son côté, montre la parfaite adapta-tion de certaines notabilités lyonnaises au changement de situation poli-tique et sociale, notamment au moment de Rerum novarum et duRalliement. A partir des exemples développés par ces deux auteurs, ilparaît nécessaire d’approfondir plusieurs points : ces adaptations ont-ellesété partout identiques en France? les notables ont-ils toujours et partoutrefusé les changements? Comment s’exerce le recrutement des nouvellesélites, tout au moins des nouveaux soutiens de la politique pontificale? Laquestion mérite d’être éclairée.Il nous a donc semblé qu’un axe de recherche était susceptible de
s’ouvrir à nous : celui de l’organisation des catholiques français en tantque telle, et notamment comment le Saint-Siège a tenté de participer
1 Paul Airiau, «L’Église catholique et l’État au XIXe siècle : entre contre-révolution etralliement », intervention à l’Académie des Sciences morales et politiques, colloque«Sources et origines de la Séparation», Centenaire officiel de la loi de 1905, 22 février2005, p. 14.
2 A cet égard, particulièrement révélatrice est cette phrase du sénateur radicalMaxime Lecomte : «La République n’a pas besoin d’être reconnue par le Pape, et lesrépublicains ne conserveront d’action sur les masses qu’en exécutant leur ancienprogramme.» Maxime Lecomte, Les ralliés. Histoire d’un parti, 1886-1898 (Paris,Flammarion, 1898), p. 270.
3 Nous pensons notamment à la thèse de Gersende Le Jariel des Chatelets sur LucienBrun, et à celle de Sylvie Aprile sur Auguste Scheurer-Kestner.
4 David Colon, Un cercle d’étudiants catholiques sous la IIIe République. LaConférence Olivaint, 1875-1940, mémoire de DEA sous la direction de Jean-PierreAzéma, IEP Paris, 1996 ; Alexandre Fournier, Les réseaux conservateurs à Lyon à la findu XIXe siècle. 1880-1900, Mémoire de fin d’études sous la direction de Bruno Benoît, IEPLyon, 2000.
5 Eric Phélippeau, L’Invention de l’homme politique moderne. Mackau, l’Orne et laRépublique, coll. Socio-histoire, Paris, Belin, 2002.
INTRODUCTION 23
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 23
directement à ce lent processus de structuration politique. De plus, cettequestion pose plus largement le problème de l’organisation politique engénéral, pratiquement inexistante avant 1901. Raymond Huard, notam-ment, a bien montré combien le travail d’organisation politique a pu êtrelong durant la fin du XIXe siècle, aboutissant, au terme d’un long proces-sus de maturation, à la naissance, entre 1901 et 1903, de six partis poli-tiques, et notamment de l’Action libérale populaire1.
* * *
Au fil de la recherche, nombre de questions se sont posées, notammenten ce qui concerne l’organisation des catholiques français en politique etdes stratégies mises en œuvre. Mais, parmi celles-ci, une plus qued’autres en constitue au final le fil directeur : y a-t-il une véritable orga-nisation des catholiques français en politique? Cette organisation n’est-elle qu’embryonnaire ou bien existe-t-il une structure hiérarchisée, avecun organe décisionnel central englobant des organismes locaux? Ou àl’inverse s’agit-il d’un mode de fonctionnement multiforme, voire anar-chique, de nombreux groupes se créant et s’ajoutant les uns aux autres,s’asphyxiant mutuellement?De même, quelle est l’attitude du Saint-Siège dans l’organisation poli-
tique des catholiques français ? Sont-ils libres de leur choix quant auterrain sur lequel ils doivent se placer, ou, au contraire, ont-ils des direc-tives claires pour les guider ?Une découverte s’est par ailleurs progressivement affirmée, celle du
rôle tenu dans le processus de structuration politique par certaines indi-vidualités. La question des personnalités mises en scène est devenue dece fait une question majeure. Ainsi, au lendemain du Ralliement, y a-t-ildes hommes nouveaux, exempts de tout passé compromettant, ou ne voit-on que des monarchistes qui cachent temporairement leurs sentimentscontre la République ? Quelles sont les relations entretenues entre cescatholiques et la hiérarchie ecclésiastique, voire même avec Rome?
1 «Entre 1901 et 1903, six partis français voient le jour. Trois se partagent la clien-tèle républicaine, le Parti républicain radical et radical-socialiste (juin 1901), l’Alliancerépublicaine démocratique (octobre 1901), la Fédération républicaine (novembre 1903).L’Action libérale populaire donne aux catholiques français un instrument politique effi-cace au sein des institutions républicaines». Raymond Huard, «Aboutissements préparéset cristallisations imprévues : la formation des partis », in Pierre Birnbaum (dir.), LaFrance de l’affaire Dreyfus (Paris, Gallimard, 1994), p. 87-88.
24 INTRODUCTION
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 24
Enfin, quelle est réellement la pensée des « ralliés » par rapport à laRépublique ? Quelle République veulent-ils, une République républi-caine, acceptant les lois contre les congrégations, les lois scolaires et mili-taires, même temporairement, ou une République catholique, ouverte ettolérante, union des républicains libéraux – modérés – et des « ralliés»,les nouveaux républicains? Autant de questions sur lesquelles nous avonscherché à apporter des éclaircissements, à frais nouveaux, en nousappuyant pour une grande part sur les archives secrètes du Vatican etcelles des congrégations religieuses présentes à Rome, ainsi que sur lesarchives diplomatiques du ministère des affaires étrangères, encore trèslargement inexploitées.
INTRODUCTION 25
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 17.12.2011 0:15 Page 25
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ire PARTIE
1890-1893. PREMIÈRES ORGANISATIONS,PREMIÈRES DÉFAITES
CHAPITRE 1L’UNION DE LA FRANCE CHRÉTIENNE,OU LA TENTATION DE LA NEUTRALITÉ . . . . . . . . . . . . . . . 29LES HOMMES ET LE PROJET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
LA FORMATION DU COMITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36LES OPPOSITIONS À L’UNION DE LA FRANCE CHRÉTIENNE . . . . . . 51LA FIN DES AMBIGUÏTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
CHAPITRE 2ENTRE PARTI CATHOLIQUE ET TERRAINCONSTITUTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81LA LIGUE POPULAIRE POUR LA REVENDICATION DES LIBERTÉSPUBLIQUES : UNE ADHÉSION LOYALE À LA RÉPUBLIQUE . . . . . . . . . 81LE PREMIER GROUPEMENT POLITIQUE:LA DROITE CONSTITUTIONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
LA TENTATION DE LA MODÉRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101UN PARTI CATHOLIQUE EST-IL POSSIBLE EN FRANCE? . . . . . . . . . 115
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 13.2.2012 8:44 Page 551
CHAPITRE 3LES CONGRÉGATIONS ET LE RALLIEMENT . . . . . . . . . . . . 129JÉSUITES ET DOMINICAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
LA COMPAGNIE DE JÉSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131LES DOMINICAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
LA CONGRÉGATION DES FRÈRES DE SAINT VINCENT DE PAUL . . . 144
CHAPITRE 4L’UNIVERS ET LA VÉRITÉ, ENTRE FIDÉLITÉ AU PASSÉET DIRECTIONS PONTIFICALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155L’UNIVERS, L’ULTRAMONTAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155LA VÉRITÉ, UNE SCISSION PAR FIDÉLITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
LA SCISSION ET LA FONDATION DU JOURNAL LA VÉRITÉ . . . . . . . . 170
CHAPITRE 5ÉTIENNE LAMY, L’HOMME PROVIDENTIEL . . . . . . . . . . . . . 183UN VRAI RÉPUBLICAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183L’APPEL AUX CONSERVATEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186LAMY, L’HOMME DE LA SITUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
CHAPITRE 6LES ÉLECTIONS DE 1893, ÉCHEC OU SUCCÈSDE LA POLITIQUE PONTIFICALE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207DES FORCES DIVISÉES ET DÉSORGANISÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
LES RÉPUBLICAINS, ENTRE ACCEPTATION ET REJETDES RALLIÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,TEST POUR LA POLITIQUE PONTIFICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220UN BILAN DES ÉLECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227UN SUCCÈS POUR LES DIRECTIONS PONTIFICALES? . . . . . . . . . . . . 230
552 TABLE DES MATIÈRES
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 13.2.2012 8:44 Page 552
IIe PARTIE1894-1898, VERS UNE UNIFICATION DES FORCES
CATHOLIQUES?
CHAPITRE 7À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE FORMED’ORGANISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239UN ÉPISODE DE CRISE DU RALLIEMENT: LA LOI D’ABONNEMENT . 239TERRAIN CONSTITUTIONNEL OU DÉFENSE RELIGIEUSE? . . . . . . . . 248
LES COMITÉS JUSTICE-ÉGALITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE À LA FÉDÉRATION ÉLECTORALE . . . . 258
CHAPITRE 8LES CONGRÈS NATIONAUX CATHOLIQUES ET LANAISSANCE DE LA FÉDÉRATION ÉLECTORALE . . . . . . . . 267REIMS 1896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
LE CONGRÈS NATIONAL CATHOLIQUE DE REIMS :VERS L’UNION? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
VERS LA RÉUNION DE TOUS LES GROUPEMENTS CATHOLIQUES . . . 278PARIS, DÉCEMBRE 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
LES RELAIS DE L’OPPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290LE CONGRÈS NATIONAL CATHOLIQUE DE PARIS . . . . . . . . . . . . . . 295
CHAPITRE 9LES MISSI DOMINICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305LES PRÉLIMINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305L’ENVOI EN MISSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311LES MISSI DOMINICI : MISSION SECRÈTE ET CONTESTATIONS . . . . . 317
LES RAPPORTS AU NONCE, TABLEAU D’UNE SITUATIONCOMPLEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322CONTESTATIONS ET MISES AU POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333LE RAPPORT REMIS AU PAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
TABLE DES MATIÈRES 553
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 13.2.2012 8:44 Page 553
IIIe PARTIEL’ÉPREUVE DES ÉLECTIONS
1898-1902
CHAPITRE 10BREST 1897, UN TEST NATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355LA SUCCESSION DE MAURICE D’HULST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355CURÉS CONTRE NOBLES : UNE CAMPAGNE CLÉRICALE . . . . . . . . . . 367
LA GUERRE DES DEUX FRANCE : HIPPOLYTE GAYRAUDCONTRE LOUIS DE BLOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
ENQUÊTE, INVALIDATION, RÉÉLECTION: CLÉRICALISMEET INGÉRENCE VATICANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
FAUT-IL MAINTENIR LA CANDIDATURE GAYRAUD? . . . . . . . . . . . 387
CHAPITRE 11LES LÉGISLATIVES DE 1898, UN SEDAN ÉLECTORALDES CATHOLIQUES? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393CLÉRICALISME ET RÉPUBLIQUE, UNE UNION DIFFICILE . . . . . . . . . 393
UN DISCOURS D’ETIENNE LAMY À LA SALLE WAGRAM . . . . . . . . 399LE CLERGÉ DESCEND DANS L’ARÈNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
PLUS DURE SERA LA CHUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
CHAPITRE 12LA FIN DE LA FÉDÉRATION ÉLECTORALE . . . . . . . . . . . . . 421LES LENDEMAINS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :RIEN NE VA PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
LA RÉUNION DU 16 JUIN 1898, OU LE CONSTATDE L’IMPUISSANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
L’INTERVENTION PONTIFICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432UNE VICTOIRE SANS LENDEMAIN POUR LES ASSOMPTIONNISTES . . 439
554 TABLE DES MATIÈRES
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 13.2.2012 8:44 Page 554
CHAPITRE 13L’ÉCHEC DES ÉLECTIONS DE 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE TROUBLÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451L’ÉPISODE GAYRAUD, UN RÉVÉLATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464LES ÉLECTIONS DE 1902, L’ÉCHEC FATAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489LA PARTICIPATION DU SAINT-SIÈGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491UNE DIFFICILE APPLICATION DES PRINCIPES . . . . . . . . . . . . . . . . . 492UNE ŒUVRE CLÉRICALE AUX RÉSULTATS AMBIVALENTS . . . . . . . 494
ARCHIVES CONSULTÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
SOURCES IMPRIMÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
INDEX DES NOMS CITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
TABLE DES MATIÈRES 555
BEMC_1_saint-siege_dumont.qxd:RM-000-02-Texte.qxd 13.2.2012 8:44 Page 555


























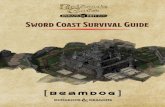
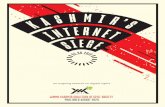










![L'organisation territoriale dans le nord-ouest de la péninsule ibérique (VIIIe-Xe siècle): vocabulaire et interprétations, exemples et suggestions [2009]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631fe5ebfdf36d7df603732f/lorganisation-territoriale-dans-le-nord-ouest-de-la-peninsule-iberique-viiie-xe.jpg)