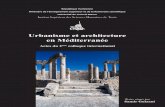L'organisation des écosystèmes
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'organisation des écosystèmes
L'organisation des écosystèmes
Victor Lefèvre
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Séminaire Lagon – 6 novembre 2013
Qu’est-ce que l’écologie ?
L’écologie est la science étudiant les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement.
On distingue généralement deux branches au sein de l’écologie :– l’écologie des écosystèmes– l’écologie des populations
Le concept d’écosystème est ainsi un concept central de l’écologie.
Définition d'un écosystème
« L’ensemble des espèces présentes dans un lieu donné, l’ensemble des interactions qu’elles entretiennent entre elles
et avec le milieu physique, et l’ensemble des flux de matière et d’énergie qui parcourent les espèces et leur
environnement, constitue ce qu’il est convenu d’appeler un écosystème. » (Abbadie & Latetlin, 2004)
L’analogie entre écosystèmes et organismes
Une des caractéristiques majeurs du concept d’écosystème est d’avoir été forgé par analogie avec le concept
d’organisme.
« Toute biocénose stable repose sur un réseau d’interactions entre ses divers constituants d’une part et le milieu
inorganique d’autre part. […] C’est aussi ce qui lui impose une certaine structure, et partant, une physiologie
particulière. A ce titre, une biocénose constitue une sorte de super-organisme, en grande partie indépendant des
autres communautés biologiques qui peuvent occuper un des milieux géographiques voisins » (Bourlière & Lamotte, 1967)
(nous soulignons)
Les questions du philosophe
L'analogie écosystèmes- organismes pose au moins deux problèmes philosophiques distincts :
- Philosophie des sciences : Comment un modèle explicatif peut-il être transféré d’un domaine du réel à un autre tout
en conservant sa valeur explicative ?
- Éthique de l'environnement : Cette analogie peut-elle fonder une valeur intrinsèque des écosystèmes, i.e la ou les propriétés communes aux écosystèmes et aux organismes
ont-elles une valeur normative ?
Table des matières
I/ Histoire de l’analogie entre écosystèmes et organismes
II / Qu'est-ce qu'un organisme ?
III / Les écosystèmes comme quasi-organismes
IV/ Jalons vers un concept objectif de santé écosystémique
Genèse du concept d'écosystème
1) L’équilibre de la nature - “balance of nature” (Linné) 2) Le concept de climax / super-organisme de Clements3) Le concept d’écosystème de Tansley
L'économie de la nature chez Linné
« La nature veut que, lorsque les animaux meurent, ils soient transformés en humus et l’humus en plantes. Celles-ci sont mangées par les animaux, formant ainsi leurs membres, en sorte que la terre, transformée en semence, pénètre dans le corps humain et là, de par la nature de l’être humain, est changée en chairs, os, nerfs, etc : et lorsque, après la mort, le corps se décompose, les forces naturelles le muent en pourriture, et l’homme redevient cette terre dont il est issu.
Ainsi, lorsque par hasard des plantes viennent à germer dans cet humus, elles poussent avec luxuriance, transformant la terre humaine à leur image, en sorte que de jolies joues de jeune fille peuvent devenir une vilaine jusquiame, et le bras de l’Hercule le plus vigoureux un frêle Potamot. Celui-ci est mangé par un cimex puant [une punaise des lits] et devient animal. Ce cimex es alors mangé par les oiseaux, il devient oiseau ; l’oiseau est mangé par l’homme dont il devient ainsi une partie... » Linné in Watsgöte-Resa (1747) Traduction par Blunt (1986) p.214
L’organicisme de Clements
« L'unité de végétation, la formation climacique, est une entité organique. Comme un organisme, la formation naît, grandit, mûrit, et meurt. […] En outre, chaque formation climacique est en mesure de se reproduire, en répétant avec une totale fidélité les phases de son développement. » (Clements, 1916)
L'invention du concept d’écosystème par Tansley
« La valeur méthodologique supposée des idées de communauté biotique et d’organisme complexe est illusoire. » (Tansley,
1935)
Et pourtant Tansley reconnaît dans le même texte le statut de « quasi-organisme » aux écosystèmes
Table des matières
I/ Histoire de l’analogie entre écosystèmes et organismes
II / Qu'est-ce qu'un organisme ?
III / Les écosystèmes comme quasi-organismes
IV/ Jalons vers un concept objectif de santé écosystémique
● La conception kantienne de l'organisme
« D’un corps […] il est exigé que ses parties se produisent réciproquement dans leur ensemble […] et qu’elles
produisent ainsi par causalité propre un tout dont le concept […] pourrait à son tour être jugé inversement
comme la cause de ce tout selon un principe et dont, par conséquent, la liaison des causes efficientes pourraient
être tenue en même temps pour un effet pour des causes finales. Dans un tel produit de la nature, chaque partie, de même qu’elle n’existe que par l’intermédiaire de toutes les autres, est pensée également comme existant pour les autres et pour le tout, c’est-à-dire comme instrument (organe) […] elle doit être en fait considérée comme un
organe produisant les autres parties (chaque partie produisant les autres, et réciproquement). » (Kant, 1790)
Formalisation du schéma kantien : La clôture opérationnelle (Varela et Maturana)
« Un système autonome est opérationnellement clos si son organisation est caractérisée par des processus : a) dépendant récursivement les uns des autres pour la
génération et la réalisation des processus eux-mêmes et, b) constituant le système comme une unité
reconnaissable (le domaine) où les processus existent » (Varela, 1989)
L'approche organisationnelle des fonctions
Formellement, un trait T est fonctionnel pour le système S si et seulement si :
« C1 : T contribue au maintien de l’organisation O de S ;C2 : T est produit et maintenu sous quelques contraintes
exercées par O ;C3 : S est organisationnellement clos. » (Mossio et al., 2011)
La clôture organisationnelle est une norme objective pour l’attribution d’une fonction à un trait au sens où sa
description ne dépend pas de l’observateur.
Nous proposons que l’analogie entre écosystèmes et organismes est correcte pour expliquer « l’économie de la nature » en raison de ce que les écosystèmes et les organismes partagent la propriété commune d'être organisationnellement clos.
En quoi les écosystèmes sont-ils des quasi-organismes ?
Organismes Écosystèmes
* Clôture opérationnelle
* mécanismes régulateurs
* Agentivité
(* Capacité d’évolution par sélection naturelle)
* Clôture opérationnelle
* mécanismes régulateurs ?
(* Capacité d’évolution par sélection naturelle ?)
Table des matières
I/ Histoire de l’analogie entre écosystèmes et organismes
II / Qu'est-ce qu'un organisme ?
III / Les écosystèmes comme quasi-organismes
IV/ Jalons vers un concept objectif de santé écosystémique
Structure fonctionnelle des écosystèmes
Cycle de recyclage de la matière
Producteur primaire
Décomposeurs
Consommateur primaire
Consommateursecondaire
Matière organiqueNutriments minéraux
Table des matières
I/ Histoire de l’analogie entre écosystèmes et organismes
II / Qu'est-ce qu'un organisme ?
III / Les écosystèmes comme quasi-organismes
IV/ Jalons vers un concept objectif de santé écosystémique
Un problème central avec le concept de santé écosystémique est :
D'où provient sa normativité ?
Une méthode pour répondre :Importer le débat en philosophie de la médecine à propos de la définition de la santé.
Notre position : il est possible d’émettre des jugements de santé écosystémique dont le cœur de la normativité serait des normes objectives issues du fonctionnement même des écosystèmes.
“x’s health consists in those functions of the structure of x such that are prima facie good for x ; they contribute to
the well being of X” (Mc Shane, 2004)
Cf Boorse (1977)
La santé est généralement un état de bien-être. → OK
La santé est une condition nécessaire ou suffisante au bien-être.→ NOT OK
Boorse (1977) :
« La santé est l’absence de pathologie. »
« Une pathologie est un type d’état interne qui réduit une ou plusieurs des capacités
fonctionnelles en dessous du niveau d’efficacité typique. »
Le niveau d’efficacité typique d’une capacité fonctionnelle est le niveau d’efficacité moyen de cette
capacité fonctionnelle dans une classe de référence.
Nous proposons que la classe de référence pour un écosystème donné soit la classe des écosystèmes ayant le
même régime d’auto-maintien
Sous l’hypothèse que l'on puisse bâtir une typologie des écosystèmes comme types naturels de régimes d'auto-
maintien
Serait pathologique pour un écosystème de type T la déviation d’un état fonctionnel de cet écosystème sous
l’efficacité moyenne de cet état pour les écosystèmes de type T.
Formulé positivement :Un écosystème en bonne santé est un écosystème dont toutes les fonctions (organisationnelles) sont efficientes au moins au-dessus de l'efficacité typique de son régime
d'auto-maintien.
Critiques de cette solution boorsienne
1) il n’est pas évident qu’il existe des types naturels d’écosystèmes.
2) les normes statistiques de bon fonctionnement sont certes objectives mais extrinsèques.
3) Les normes statistiques sont partiellement conventionnelles.
Alternative : une approche néo-canguilhemienne
Définir la santé écosystémique à partir de normes objectives et intrinsèques de bon fonctionnement,
fournies par les éventuels mécanismes régulateurs des écosystèmes.
Conclusions
1) L'approche organisationelle des fonctions peut fonder un concept objectif de santé écosystémique, contre une approche subjectiviste à « à la Mac Shea »
2) L’approche organisationnelle constitue un outil précieux pour clarifier l’analogie entre écosystèmes et organismes bien au-delà du seul concept de santé écosystémique.
Travail en cours
- Appliquer complètement OAF : distinction entre processus et contraintes
- Appliquer OAF pour toutes les attributions fonctionnelles en écologie, spécialement les fonctions d’ordre supérieur à l’écosystème (fonctions des écosystèmes au sein de la biosphère, hypothèse Gaïa de Lovelock)
- Articuler concept théorique et concept pratique de santé des écosystèmes, en montrant que les critères classiques de santé des écosystèmes des écologues mènent à l’identification de déviation par rapport à l’auto-maintien ou des échecs de régulation.