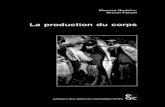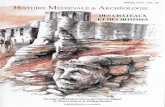Des amphores et des hommes 1997
Transcript of Des amphores et des hommes 1997
Fanette Laubenheimer
Des amphores et des hommes. ChroniqueIn: Dialogues d'histoire ancienne, vol. 23, n°2, 1997. pp. 279-295.
Citer ce document / Cite this document :
Laubenheimer Fanette. Des amphores et des hommes. Chronique. In: Dialogues d'histoire ancienne, vol. 23, n°2, 1997. pp.279-295.
doi : 10.3406/dha.1997.2361
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/dha_0755-7256_1997_num_23_2_2361
Dialogues d'Histoire Ancienne 23 /2, 1997, 279-295
DES AMPHORES ET DES HOMMES*
Chronique 1997
*Abrégé en DADH
Les lecteurs de cette chronique (non exhaustive) sont invités à l'enrichir en signalant articles et publications à Fanette Laubenheimer, 3 rue Brézin 75014 Paris.
On ne saurait étudier les amphores et leur rapport avec les hommes sans avoir un regard global sur le conditionnement des denrées pour le transport, par exemple dans des tonneaux ou dans des dolia. Il est important, par ailleurs, d'examiner aussi les boissons traditionnelles comme la bière ou l'hydromel, consommées en parallèle à celles que l'on importe comme le vin.
GÉNÉRALITÉS
1, J.-Y. Empereur et Y. Garlan publient leur troisième chronique bibliographique, Amphores et timbres amphoriques, dans Revue des Etudes grecques, tome 110, 1997, p. 161- 209, dont les 243 numéros sont consacrés essentiellement à la Méditerranée orientale.
2, Sous la direction de Patrice Pomey, paraît La Navigation dans l'Antiquité, Edisud, Aix-en-Provence 1997, un ouvrage grand public, remarquablement illustré, riche en indications synthétiques sur de nombreux domaines concernant les amphores comme le tonnage des navires, la composition des chargements ou les navires à dolia.
3, F. Sigaut, La diversité des bières. Questions sur l'identification, l'histoire et la géographie récentes d'un produit, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance,
280 Chronique. Des amphores et des hommes
1997, p. 82-87, donnant un aperçu très général sur les bières à la période moderne, laisse dans l'ombre, et on le regrette, une analyse plus précise des bières dans l'Antiquité.
Du nouveau sur le vin antique : diverses contributions sur 4, The Origins and Ancient History of wine, P.E. Mcgovern, S.T. Fleming, S.H. Ktaz éd., The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Philadelphia, Amsterdam 1996, font le point sur les nouvelles découvertes archéoœnologiques, le rôle culturel et social du vin, et l'identification de vins anciens dans les sociétés anciennes du Proche et Moyen-Orient.
Le remploi des amphores comme récipients de stockage à l'intérieur des maisons, est à prendre en compte, notamment pour les céréales au 1er s. avant notre ère, 5, D. Garcia, Les structures de conservation des céréales en Méditerranée nord-occidentale au 1er millénaire avant J.-C. : innovation technique et rôle économique, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance, 1997, p.88-95.
LES AMPHORES JUSQU'AU 2E S. AV. NOTRE ÈRE
En Méditerranée orientale
6, A. Avram, Les timbres amphoriques, 1 Thasos, Histria, Les résultats des fouilles, VIII, Bucarest 1996, Corpus International des timbres amphoriques, fascicule 1 : encouragé par l'Académie Roumaine et l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, ce premier volume du corpus histrien sera suivi par trois autres consacrés à Sinope, Rhodes et Varia. Il est traité ici de 946 timbres thasiens découverts à Histria et dans son territoire, dont plus de la moitié sont inédits.
Le XXème colloque international du CRA et du CRMMO de Lille 3, L'artisanat en Grèce ancienne: Les artisans, les ateliers, 11 et 12 décembre 1997, a donné lieu à deux communications sur les amphores grecques : 7 Y. Garlan, Les fabricants d'amphores en Grèce ; 8, M. Debidour, La tutelle de la cité sur la production des amphores thasiennes : l'exemple du groupe au rhyton.
En Méditerranée occidentale - En Italie
9, R.M. Albanese Procelli, Échanges dans la Sicile archaïque : amphores commerciales, intermédiaires et redistribution en milieu indigène, dans Revue Archéologique 1977,1, p. 3-25, donne un bilan
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 281
encore provisoire de la répartition dans l'île des amphores archaïques, corinthiennes, attiques ou marseillaises notamment, et analyse l'impact des importations de denrées alimentaires (huile et vin) en milieu indigène.
-Dans la Péninsule ibérique
10, M. Del Mar Castellanos Roca, Les importacions étrusques del segle V A.C. al Nord-Est Peninsular i el comerç mediterrani, dans Pyrenae, 27, 1996, p. 83-102, note l'arrivée dans le Nord-Est de la Péninsule de bucchero-nero, de céramiques étrusco-corinthiennes et d'amphores étrusques au Vie s., ce qui n'est plus le cas au Ve s. L'auteur propose une mise à jour des diverses importations étrusques du Ve s. et de leur contexte, et examine les influences, étrusques, puniques et grecques sur la société ibérique.
11, D. Asendo i Vilaro, X. Cela Espin, C. Ferrer i Alvarez, Els materials ceramics del poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa). Col.lecció Salvador Vilaseca de Reus, dans Pyrenae, 27, 1996, p. 163-191, s'attachent à étudier la céramique des fouilles menées entre 1942 et 1943 par Vilaseca sur le site de Castellet de Banyoles, contribution capitale pour l'étude l'Illercavonie ibérique, au Ille s. av. J.-C. On compte, parmi les amphores, une gréco- italique, une amphore punique Mana C2 et une amphore de Chios.
12, J. Ramon, Puig des Molins (Eivissa). La limite NW de la necropolis fenico-púnica, dans Pyrenae 27, 1996, p. 53-82, étudie la zone N-O de la nécropole phénico-punique de l'ancienne Ibiza. Plusieurs tombes contiennent une amphore d'Ibiza, on notera, en particulier, la sépulture d'un enfant déposée dans une amphore Ramon РЕ 15, presque complète, placée verticalement dans une fosse taillée à cet effet et calée par des pierres.
Faisant suite à son livre paru en 1991, Las ánforas púnicas de Ibiza, J. Ramon Torres élargit le sujet et livre une somme considérable de près de 700 pages très largement illustrées sur 13, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental, col.lecció Instrumenta 2, Universitat de Barcelona 1995. Le sujet est large, il couvre la Méditerrranée centrale et occidentale du Ville s. au Ile s. avant notre ère. Basée sur un inventaire des amphores connues dans toute cette zone, l'étude propose une typologie organisée sur des groupes morphologiques et leur évolution. Quelque 350 estampilles semblent peu nombreuses au regard de celles des amphores grecques archaïques, elles sont surtout symboliques mais parfois épigra- phiques, utilisant les alphabets phénico-punique, grec ou latin.
DHA 23/2, 1997
282 Chronique. Des amphores et des hommes
Les traces de résine, quelques vestiges de contenu et de très rares marques peintes indiquent peut-être quelques conserves de viande, mais surtout du poisson. Des centres de production on sait peu de choses, l'auteur identifie des groupes de pâtes rattachés à des lieux. De très abondantes cartes de répartition illustrent la distribution des amphores par groupes morphologiques.
14, 1. Pereira, Santa Olaia et le commerce atlantique, dans Itinéraires lusitaniens, trente années de collaboration archéologique luso -française, éd. R. Etienne, F. Mayet, Paris 1997, p. 209-253, publie cette factorerie phénicienne liée au cercle commercial de Cadix, dans laquelle se trouvent nombre d'amphores phénico-occi- dentales des Ville- Vile s.
AMPHORES RÉPUBLICAINES ET IMPÉRIALES
Généralités
L'usage du tonneau à l'époque romaine suscite à nouveau plusieurs analyses. 15, G. Baratta, Le botti : dati e questioni, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance, 1997, p.109-112, insiste sur l'emploi des tonneaux qui d'après les textes et les représentations figurées servent surtout au vin, mais sont aussi utilisés pour des céréales, des fruits et du sel. 16, A. Desbat, La place du tonneau dans l'économie gallo-romaine sous le Haut-Empire, dans Boire et manger en Bourgogne, Cahiers Archéologiques de Bourgogne, n°5, 1994, p. 87-95, reprenant les diverses sources sur les tonneaux insiste sur leur origine gauloise et leur usage pour le vin. On reste sceptique, devant l'absence de données quantitatives, sur l'importance supposée de leur rôle dès le Haut-Empire, surtout en Gaule, où l'on ne comprend pas bien pourquoi les vins de Narbonnaise étaient alors si largement exportés en amphores. L'auteur poursuit sa réflexion 17, A. Desbat, Le tonneau antique : questions techniques et problème d'origine, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance, 1997, p. 113-120, en penchant pour une création étrusque du tonneau ; il donne, au reste, les caractéristiques ou plutôt "des" caractéristiques des fûts antiques sans prendre en compte ni leur morphologie, ni leurs capacités. Par ailleurs, il exclut, à tort me semble-t-il, la possiblité d'un cerclage métallique des tonneaux sous prétexte que celui-ci n'était connu dans l'Antiquité que pour des objets de petites dimensions comme des seaux. C'est bien mal connaître les récipients de bois de grandes dimensions comme les baquets,
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 283
je citerai, par exemple, celui de la tombe augustéenne de Fléré-la- Rivière qui mesure quelque 1,65 m de long pour 0,70 m de large et dont les bandages métalliques ont été retrouvés ! Toujours sur la question des tonneaux, 18, A. Tchernia, Le tonneau, de la bière au vin, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance, 1997, p.121-129, dans une démonstration brillante et bien documentée, penche pour une origine celte et un usage premier lié à la bière, il pense qu'un nouvel usage de cet emballage pour le vin est à mettre en relation avec la livraison de vins en vrac par des bateaux chargés de dolia, notamment à Lyon. L'hypothèse est intéressante mais appelle quelques remarques : A. Tchernia insiste sur la signification de la forme des amphores vinaires lyonnaises : l'une disant clairement "je suis du vin de Falerne", l'autre "je suis du vin de Cos", on peut se demander que dira alors celle du tonneau de vin : je transporte de la bière ? Par ailleurs, l'auteur prend argument de l'absence d'ateliers d'amphores reconnus chez les Allobroges pour suggérer que leur vin est transporté en tonneaux, je ne jurerai pas que l'absence d'officines n'est pas liée aux manques de prospections archéologiques, on connaît déjà, au nord de celui de Ste-Cécile (Vaucluse), celui d'Aoste (Isère), par ailleurs les tonneaux sont aussi utilisés sur la Durance (Cabrières d'Aiguës) dans une zone où les ateliers d'amphores sont nombreux. La situation n'est sans doute pas si simple. Enfin, si l'on compare les deux types d'emballages, amphores et tonneaux, il sera utile de s'interroger sur leur prix, sans doute bien différent, et sur leur capacité. Bref, il est urgent de faire une typologie des tonneaux, d'estimer leurs volumes si largement variables et leurs prix, pour mieux comprendre comment, à une même période, on a utilisé les uns et les autres en parallèle.
Sur la question des livraisons de vin en vrac à Marseille, 19, A. Hesnard, Entrepôts et navires à dolia: l'invention du transport en vrac, dans Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l'innovation, Colloque d'Aix-en-Provence mai 1996, Ed. Errance, 1997, p. 130-131, apporte des données nouvelles grâce aux timbres de leurs couvercles, qui font référence aux lieux d'embarquement : Rome, Ostie, Porto et l'Étrurie septentrionale. Au reste, la datation des horrea et celle des couvercles des dolia élargit celle proposée antérieurement : de l'époque augustéenne jusque vers le milieu du Ile s. de notre ère.
Au large du cap Bénat, par 48 mètres de fond, un petit bateau de 8 m de long contenait trois dolia de taille modeste, 800
DHA 23/2, 1997
284 Chronique. Des amphores et des hommes
à 900 litres, l'un est résiné, un autre contient des restes de boucherie. La présence de quelques amphores Dressel 1С et de céramique campanienne datent le naufrage du 1er s. avant notre ère, 20, J.-P. Joncheray, Bénat 2, une épave à dolia du 1er s. avant J.-C, dans Cahiers d'Archéologie Subaquatique XIII, 1997, p. 97-119.
Une courte et intéressante synthèse sur les amphores mono- ansées de type Agora F65/66, fabriquées dans la vallée du Ménandre et à Éphèse et diffusées notamment en Gaule du 1er au 3e s. avec un contenu encore incertain, est présentée par 21, S. Lemaître, L'amphore de type Agora F 65/66, dite "monoansée". Essai de synthèse à partir d'exemplaires lyonnais, dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 311-319.
L'étude environnementale des ateliers sucite de plus en plus d'intérêt, 22, L. Chabal, Forêts et sociétés en Languedoc (Néolithique final, Antiquité tardive,) L'anthracologie, méthode et paléoécologie, DAF 63, Paris 1997, brosse une large sythèse languedocienne dans laquelle elle utilise notamment l'identification de quelque 5300 charbons des fours de Sallèles d'Aude qui montrent comment, sur une durée de trois siècles, l'alimentation en bois a évolué et suggère un traitement spécifique de la forêt par les potiers.
En Méditerranée occidentale - En Italie
À signaler l'arrivée du Monte Testaccio sur Internet ! À l'occasion d'une exposition sur le Monte Testaccio à l'Université La Spienza à Rome, en janvier 1997, faisant le point des fouilles de l'Université de Barcelone dirigées par J. Remesal sur le site, le groupe du Ceipac du département d'Histoire Antique de l'Université de Barcelone et La Sapienza ont créé un site internet de grande qualité qui permet de visiter l'exposition. Un exemple à suivre 23, rendez-vous WWW:http://www.ub.es/CEIPAC/MOSTRA/expo.htm.
24, L. Passi Pitcher, Cremona, Via Massarotti Banco di anfore, dans Soprintendenza Archeologica délia Lombardia, Notiziario 1994, p. 149, signale un remarquable vide sanitaire Via Massarotti, de 21 x 6 m. Les amphores par centaines, sont placées tête en bas, côte à côte. Il s'agit surtout de D.6A et B, mais on compte aussi des Lamboglia 2, des amphores de Brindes, quelques D.2/4 et D.7/11. Sept autres vides sanitaires sont déjà connus dans la ville à la même époque, ils pourraient correspondre au projet urbain entrepris par Vespasien après la destruction de la cité en 69.
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 285
- Dans la Péninsule ibérique
25, M. Christol, R. Plana Mallart, Els negociatores de Narbona i el vi català, dans Faventia, Universitat Autonoma de Barcelona, 19/2, 1997, p. 75-95, mettent en relation l'épigraphie lapidaire de Narbonne et l'épigraphie amphorique de Tarraconaise, montrant que le timbre sur Pascual 1 P.VSVL. VEIENT de Llafranc correspond, comme le timbre L. VOLTEIL, au nom d'une famille bien connue à Narbonne et dans le Narbonnais. Tout se passe comme si de riches Narbonnais contrôlaient une part de l'activité économique de la Tarraconaise.
26, M. Del Vilar Vila, Amfora amb inscripció llatina i grafit ibèric, dans Pyrenae 27, 1996, p. 295-299, présente une Léétanienne 1 trouvée en mer sur la Costa Brava qui porte le timbre bien connu MEVI et un graffite ibérique sur le col, comme il arrive parfois pour les amphores républicaines ou du Haut-Empire.
27, J. Tremoleda i Trilla, Producció d'àmfores romanes al Baix Empordà. Els tallers de Palamós, Platja d'Aro i Sagaró, dans fornades d'homenatge a Lîius Esteva i Cruanas, Sant Felix de Guíxols 1996, p. 41-46, fait le point sur cinq ateliers d'amphores de l'Empurdan dont certains sont inédits. Il s'agit de Llafranc qui produit des Tarraconaise 1, Pascual 1, Dressel 2/4, Dressel 7/11 et Gauloise 4 ; Palamos et ses trois variantes de Dressel 2/4 ; Platja d'Aro : Dressel 2/4, Dressel 7/11 et Gauloise 4 ; Sagaró : Pascual 1, Dressel 2/4 ; San Feliu de Guíxols : Pascual 1. Le même auteur donne 28 dans Les Annals de l'Institut d'Estuis Epordanes, 29, 1996, p. 475- 482, un résumé de la thèse qu'il a soutenue à l'Université de Gérone en juin 1996 sur le thème Céramiques romanes de producció local al N.-E. de Catalunya (Època augustal i alto-imperial), dans laquelle les amphores sont à l'honneur.
29, P. Berni Millet, Instrumentum Domesticum romà del Museu episcopal de Vic. La col.lecció de segells en àmfora, tegula i morter, dans Pyrenae 27, 1996, p. 311-326, livre des estampilles sur amphores de Brindes, Dressel IB, Léétaniennes 1, Dressel 2/4 de Tarraconaise, et Dressel 20, les plus nombreuses.
30, R. Albiach Descals, M. Fernandez Aragon, J. Ramón Sanchis Alfonso, Un depósito de ánforas en el yacimiento romano del Mas del Jutge de Torrent (Valencia), dans Torrens, Estudis i investi- gacions de Torrent i Comarca, 10, 1996, p.9-62, publient dans ce site occupé du 1er au 3e s. et fouillé sur 29 m2 en 1986, 23 amphores quasi complètes des 1er et 2e s. déposées horizontalement les unes à côté des autres sur deux niveaux (Dressel 2/4, Beltran IIB, Dressel 17,
DHA 23/2, 1997
286 Chronique. Des amphores et des hommes
Agora M54 Africaine 1, Rhodienne). Les auteurs ne voient pas d'interprétation claire à ce type de dépôt qui n'est pas sans rappeler les vides sanitaires bien connus en Gaule et en Italie.
31, J.P. Ballester, La actividad comercia y el registro arqueo- logico en la Carthago Nova republicana. Los hallazgos del area del anfiteatro, dans Verdolay n°7, Murcia, p. 339-349, montre clairement l'importance des importations d'amphores gréco-italiques, plus nombreuses que les amphores puniques de la fin du - 3e s. au 3e quart du - 2e s. et la masse des amphores Dressel 1 de la fin du - 2e s. et du - 1er s.
Organisées par l'Université de Valence, 32, Les III Jornadas de Arqueología subacuática, "Puertos antiguos y comercio marítimo" du 13 au 15 novembre 1997, sont l'occasion de faire le point sur de nombreuses découvertes de la côte orientale de la Péninsule ibérique. La publication est à venir.
33, D. Bernai Casasola, La producción anfórica en La Bahia de Algeciras en época romana : nuevos datos procedentes de los talleres de La Venta del Carmen (Los Barrios), dans IV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, 8-10 Novembre 1996, Almoraima, Revista de estudios Campogibraltarenos, n°17, 1997, p. 65-73, donne les résultats de la fouille d'urgence menée à la Venta del Carmen : deux fours, une habitation, des productions de matériaux, de céramiques communes et d'amphores : de multiples variantes des Beltran II, et, ce qui tout à fait nouveau, des Haltern 70 et des Dressel 28.
À propos des amphores à huile de Bétique : 34, P.P. A. Funari, Avanços récentes no estudo da epigrafia latina das anforas olearias béticas, dans Classica, Sâo Paulo, 7/8, 1994/1995, p. 363-368, suivant le courant des revues bibliographiques sur les amphores comme celle que nous publions, propose un aperçu des travaux récents en ce domaine précis. 35, J. Remesal Rodriguez, Mummius Secindinus. El Kalendárium Vegetianum y las confiscaciones de Severo en la Bética (HA Severus 12-13), dans Gerión 14, 1996, p. 195-221, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Madrid, à partir de l'analyse du nom de Mummius Secundinus sur une marque d'amphore Dressel 20 considère des aspects concrets de l'administration de la Bétique sous les Sévères. 36, R. B. Millet, Amphora Epigraphy : proposals for the study of stamps contents, dans Archeologia e Calculatori, 7, 1996, p. 751-770, à partir d'un large corpus de Dressel 20 se propose d'analyser de façon informatique les timbres qui sont classés d'après leur structure et les divers éléments présents en familles suivant, par exemple, les noms individuels, les ateliers ou
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 287
la région de production. Un tel modèle se veut utilisable pour n'importe quel type d'amphores.
Les travaux sur la Lusitanie connaissent de nouveaux développements. Signalons la Ille table-ronde internationale sur la Lusitanie romaine, à la Casa de Velazquez à Madrid qui s'est tenue les 1er et 2 décembre 1997, avec pour thème : Économie et productions de la Lusitanie romaine. Nous notons en particulier, à propos de la production du vin, les communications suivantes : 37, A.M. Gonçalves de Carvalho, Evidências arqueológicas da producâo de vinho nas villae romanas do território português : alfaias vitícolas e lagares de vinho ; 38, F.G. Rodriguez et J.-G. Gorges, Pressoir à huile et pressoir à vin dans une villa de la moyenne vallée du Guadiana : "Torre Águila-Barbaňo" (Badajoz), et à propos des amphores, 39, C. Fabiâo, Sobre as ánforas de fabrico lusitano : geografia da producâo, cronologias, conteúdos e destinos.
40, F. Teichener, Die rômischen villen von Milreu (Algrave/ Portugal) dans Madrider Mitteilungen, 38, 1997, p. 106-162, présente une des villas les mieux conservées du Sud du Portugal qui a connu divers aménagements entre le 1er et le 4e s. On trouve notamment des amphores Almagro 54/Keay LIV et des Almagro 5 1С.
Avec Itinéraires lusitaniens, Trente années de collaboration archéologique luso-française, Paris 1997, les actes de la table-ronde tenue à Bordeaux en 1995 et édités par R. Etienne et F. Mayet, apportent de nouvelles contributions sur l'économie et les amphores. 41, F. Mayet et A. Schmitt, Les amphores de Sâo Cucufate, p. 71-109, reprennent dans le détail un matériel déjà présenté globalement pour son contenu, qui manifestait des importations majoritaires de garum, le vin étant surtout local et l'huile de Bétique rare. Parmi les amphores à poisson, à 90% lusitaniennes, dominent les Almagro 51c et les Dressel 14. Une étude pétrographique montre combien il reste difficile de déterminer la part des productions du Tage, du Sado et celle de l'Algarve. 42, 1. Vaz Pinto, Doha, de Sâo Cucufate et jarres modernes de l'Altentejo : essai d'ethnoarchéologie, p. 111-156, donne une analyse remarquable des dolia en général, à partir des textes, montrant la diversité de leur utilisation et la diversité des mots équivalents. Les dolia de la villa semblent fabriqués à l'extérieur et d'origines diverses. Ils contiennent de l'ordre de 80 à 350/400 litres. Leur usage est essentiellement pour le vin. Mettant à profit l'usage encore actuel de dolia pour fabriquer le vin dans la région, une confrontation tout à fait passionnante est établie entre le matériel moderne et le matériel antique. 43, R. Etienne, F. Mayet, La place de
DHA 23/2, 1997
288 Chronique. Des amphores et des hommes
Troia dans l'industrie romaine des salaisons de poisson, p. 195-208, mettent en évidence les trois phases de fonctionnement de ce vaste complexe, un parmi d'autre sur les rives du Sado, dont la fouille n'est pas complète. À la première phase, du milieu du 1er s. à la fin du second ou au début du 3e, correspond la production d'amphores Dressel 14 sur la rive opposée du fleuve ; la seconde phase s'accorde à la production d'amphores Almagro 51 et 51C. La troisième phase s'achève vers le milieu du 5e s. comme l'industrie des amphores. On peut estimer, que, si les bassins, dont on a calculé le volume, étaient remplis cinq fois par an, il fallait, au cours de la première phase, quelque 100 000 Dressel 14 annuelles. Deux remarques sont particulièrement intéressantes : 1 - le changement complet de la forme des contenants avec le passage de récipents à col large, les Dressel 14, à celui d'amphores à col étroit, Almagro 51, pourrait révéler un changement de contenu, le passage de salaisons de poisson en morceaux à celui de sauce de poisson ; 2 - l'uniformité de la forme des centaines de milliers de Dressel 14, quelle que soit leur origine, a sans doute été imposée par les negociatores pour des raisons bien précises de chargement et reconnaissance sur les marchés. Une observation équivalente a déjà été faite pour les Gauloise 4 de Narbonnaise.
- Dans les Gaules
k\, Danielle et Yves Roman, Histoire de la Gaule (VI e s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.), Une confrontation culturelle, Paris 1997, offrent une nouvelle synthèse sur l'histoire de la Gaule. Les auteurs prennent d'entrée un recul intéressant par rapport à leur sujet, en consacrant une première partie historiographique fort documentée sur les historiens de la Gaule , leur rôle et leurs méthodes. Sont ensuite posés les problèmes de romanisation et d'hellénisation, dans un ouvrage d'une grande richesse documentaire, s'adressant à un public averti. La part de la Gaule du Sud est-elle trop belle ? Les découvertes archéologiques sont-elles suffisamment mises au service de l'Histoire ? Je vous laisse juge des remarques consignées par Olivier Buchsenschutz dans le journal Le Monde du 29 août 1977.
45, M. Poux, Les amphores de Bâle-Gasfabrick, dans Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie 80, 1997, p. 147- 172 : l'étude minutieuse des amphores italiques du site laténien de l'Usine à Gaz à Bâle trahit, pour les fosses étudiées, une sélection du matériel amphorique, des bris volontaires, des décolletages, des passage au feu et un dépôt en cercle qui ouvrent l'hypothèse de dépôts à caractère votif ou funéraire.
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 289
46, M. Chossenot, Recherches sur la Tène moyenne et finale en Champagne, Étude des processus de changement, Société Archéologique Champenoise, Mémoire n° 12, Reims 1997 : dans une région jusque-là très méconnue pour ce qui nous concerne, l'auteur souligne la relative fréquence des vins italiques dans la Champagne crayeuse, et indique une certaine abondance des amphores Dressel 1 A à La Cheppe Camp de Mourmelon où l'on en compte une soixantaine (présence du timbre L SEX).
47, J.-L. Brunaux, P. Méniel, La résidence aristocratique de Montmartin (Oise) du IHe au Ile s. av. J.-C, DAF 64, 1997, notent dans l'habitat une très faible quantité d'amphores vinaires italiques, réduites à une dizaine de tessons de gréco-italiques ou Dressel 1A.
48, M.-O. Lavendhomme, V. Guichard, Rodumna (Roanne, Loire), le village gaulois, DAF 62, Paris 1997 : les tessons d'amphores représentent une part très importante du mobilier des couches d'occupation des Ile et 1er s. av. notre ère, les amphores vinaires italiques comptent pour près de 80% de l'ensemble. V. Guichard, auteur du chapitre sur les amphores, se heurte avec courage au problème de la typologie des Dressel 1. Avec bon sens, il constate, encore une fois, les limites d'un raisonnement basé sur les épaves dont la publication du matériel est loin d'être exhaustive. Il s'en tient aux définitions traditionnelles, sachant pertinemment que les limites de la typologie des Dressel 1A sont floues et incertaines. Le lecteur sera soulagé de constater que les gréco-italiques apparaissent les premières, puis les Dressel 1A, puis les Dressel IB ! Suit un catalogue des 80 timbres sur Dressel 1, une collection appréciable. Au reste, on notera les premières importations de Dressel 7/11 et de Pascual 1 dès le milieu du - 1er s, tandis que les premières importations italiques se situeraient en plein - II ème s.
À Lyon, la découverte de nouvelles marques C.L.SEX sur amphores Dressel 1A est l'occasion d'une étude sur leur origine : les analyses de pâte par fluorescence X excluent une provenance étrusque des ateliers d'Albinia ou de Cosa et donc un rapprochement avec les timbres de Sestius, en revanche, elles indiquent un rapprochement possible avec les ateliers de Campanie, ce qui reste encore une hypothèse de travail, 49, A. Desbat, G. Maza, coll. M. Picon, La marque C. L. SEX sur amphores Dressel 1A, SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 511-516.
À Angers, le site du Château, éperon rocheux à la confluence de plusieurs rivières, a pu faire l'objet, pour la première fois, d'une
DHA 23/2, 1997
290 Chronique. Des amphores et des hommes
fouille à l'occasion du réaménagement du complexe de présentation de la Galerie de l'Apocalypse. Des données tout à fait nouvelles ont été fournies sur les premières occupations du site : 50, M. Mortreau, coll. J.-P. Bouvet et J. Siraudeau, Les ensembles céramiques précoces d'Angers (Maine-et-Loire) : "Le jardin du quadrilatère", dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 37-66. Il apparaît, notamment, que les importations des premiers vins de Tarraconaise sont à situer dès les années - 50. On trouvera des données complémentaires sur Angers avec le site plus récent de la Gaumont St-Martin : 51, M. Mortreau, coll. J. Siraudeau, Les ensembles céramiques précoces d'Angers (Maine-et-Loire) : le site de la Gaumont-St- Martin, dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 67-84.
Toujours pour la période augustéenne, les premières données sur Vannes indiquent des importations marquées de vin de Tarraconaise : 52, L. Simon, A. Triste, Les ensembles précoces de Vannes (Morbihan) à travers l'exemple du site de la ZAC de l'Etang, dansSFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 85-98. Même phénomène à Corseul où les amphores Pascual 1 représentent plus de la moitié des importations amphoriques : 53, H. Kerebel, R. Ferrette, Trois ensembles précoces du site de Monterfil II à Corseul (Côtes d'Armor), dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 99-120, ou encore à Rennes : 54, F. Labaune, G. Le Cloirec, L. Simon, Quatre ensembles d'époque augustéenne à Condate /Rennes (Ille-et-Vilaine) SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 121-146, ou à Locmaria-en- Quimper : 55, J.-Y. Robic, J.-P. Le Bihan, Les ensembles augustéens et tibériens de Locmaria-en-Quimper (Finistère) dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 147-177.
Dans la Sarthe, l'officine de La Bosse, bien connue pour ses productions de Gauloise 12 (B. Misonne, A. Bocquet, D. Laduron, F. Laubenheimer, Les amphores Gauloise 12 du bassin de la Seine, caractérisation minéralogique, pétrographique et chimique, à paraître dans Les amphores en Gaule, Production et circulation, Annales Littéraires de l'Université de Besançon, Série amphores vol. 4) fait l'objet d'une présentation générale : 56, G. Guillier, La production céramique du Haut-Empire de l'officine rurale de La Bosse (Sarthe), dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 239-251.
En Vendée, les fouilles de sauvetage menées par le SRA sur le site du Langon ont conduit à la découverte de deux amphores Dressel 2/4 timbrées, l'une SVMENVCOS, l'autre IIICVMNS(?). Il s'agit vraisemblabement d'amphores régionales comme, au reste, quelques
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 291
amphores aquitaines, mais les analyses physico-chimiques engagées ne sont pas convaincantes, sans relation avec celles déjà entreprises pour la région de Bordeaux : 57, F. Berthault, Production d'amphores vinaires dans la région du Langon (Vendée), dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 209-216.
Dans le bordelais, 58, F. Berthault donne une contribution sur Les amphores dans Les fouilles de la place des Grands Hommes à Bordeaux, Pages d'Archéologie et d'Histoire Girondine 3, Bordeaux 1997, p. 75-83 : les 126 amphores (NMI site) sont pour plus de la moitié constituées d'importations vinaires de Tarraconaise, des Pascual 1 essentiellement (à noter une DIB tarraconaise), les amphores d'Aquitaine ne représentent que 6% de l'ensemble. À signaler du même auteur une courte note sur 59, Une amphore Dressel 12 timbrée SEX DOMITI au Musée du Périgord, dans Aquitania 13, 1995, p. 269-272, qui estime que la pâte de cette amphore est typique de la Bétique alors que le timbre est bien connu dans l'atelier catalan de Tivissa. Des analyses physico-chimiques s'imposent.
L'analyse des importations d'amphores dans la vallée de l'Hérault, à l'époque augustéenne, met en évidence la part importante du vin de Tarraconaise dans des Pascual 1, au cours des trente années avant notre ère 60, S. Mauné, Un lot de céramiques d'époque augustéenne à Sept-Fonts (Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault), dans SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 457-479.
Basé sur les publications, mais sans accès direct au matériel du Sud de la Narbonnaise, 61, E. Garrote Sayo, L'oli bètic de la Gallia Narbonnensis a très departaments de l'Estat Frances : als Pyrénées Orientales, Aude et Hérault, dans Pyrenae 27, 1997, p. 193-213, réunit quelque 300 timbres sur Dressel 20 dont il déduit que Narbonne a été un grand centre d'arrivée des produits de la Bétique durant les deux premiers siècles de notre ère et que les importations les plus nombreuses se sont faites entre Claude et Trajan. La recession des importations au 2e s. ne signifie pas leur arrêt puisqu'elles arrivent encore, dans une moindre mesure, au 3e s. et même au Bas-Empire.
Sur la côte méditerranéenne française, un bilan des épaves sur le rivage instable de la Camargue est présenté par 62, L. Long, Inventaire des épaves de Camargue, de l'Espiguette au grand Rhône. Des cargaisons de fer antiques aux gisements du XIXe s. Leur contribution à l'étude du paléorivage, dans Crau, Alpilles, Camargue. Histoire et Archéologie Actes du colloque des 18 et 19 novembre 1995, textes réunis par M. Baudat, Groupe Archéologique Arlésien, 1997, p. 59-115. L'auteur reprend l'ensemble impressionnant des épaves
DHA 23/2, 1997
292 Chronique. Des amphores et des hommes
dont plusieurs sont découvertes très récemment. Celle dite Ouest- Stes-Maries-de-la-Mer, est connue pour le bouchon estampillé L.POMPON./ /ML sur col Dressel IB auquel il faut ajouter un col Dressel 1A dont le bouchon est timbré CN.Q.POMP. L'épave Stes-Marie-de-la-Mer 2, chargée de barres de fer et de lingots (une centaine), contenait quelques amphores : Dressel 2/4 de Tarraconaise (une vingtaine), Dressel 20 et Haltern 70. Parmi les épaves antiques profondes, signalons celles de Stes-Marie-de-la-Mer 14 chargée d'amphores Dressel IB, Stes-Marie-de-le-Mer 15 de Dressel 7/11, Stes-Marie-de-la-Mer 16 avec Dressel 10 et Dressel 7/11, celle dite plage d'Arles 4, dont on estime le chargement à 2000 amphores Dressel 28, 7, 8 et 9, Dressel 20, Haltern 70, Dressel 12, PE 25 d'Ibiza, pots à garum et lingots de cuivre, du milieu du 1er s. de notre ère, et l'épave plage d'Arles 8, chargée d'amphores Dressel 9 et Dressel 12.
Au large de Marseille, le gisement Pointe Debie 1, contenant des amphores Dressel 7/11 de la première moitié du 1er s. et des amphores Beltran HB de la fin du 1er s. au milieu du 2e s. ne correspond en aucun cas à une épave comme l'ont prouvé les investigations récentes menées par 63, B. Dangréaux, Amphores Dressel 7/11 et Beltran IIB ; à propos du gisement de la pointe Debie 1 (île de Pomègues, Marseille, Bouches du Rhône) dans Cahiers d'Archéologie Subaquatique XIII, 1997, p. 5-11.
En Corse, au large des îles Sanguinaires, un gisement sans trace de coque semble bien correspondre à une épave de 3e s. avant notre ère, chargée, entre autres, de lingots de cuivre, de verre et d'amphores géco-italiques (40 ex., un timbre BAPI connu dans une tombe d'Aléria datée de 300/280), rhodiennes (50) et puniques (une dizaine), 64, H. Alfonsi, P. Gandolfo, L'épave Sanguinaires A, dans Cahiers d'Archéologie Subaquatique XIII, 1997, p. 35-74.
- En Bretagne
65, P.P. Funari, Dressel 20 stamps found at the Annetwell Street Excavations in Carlisle, U.K., dans Rev. do Museu Arqueologia e Etnologia, Sào Paulo, 6, 1996, p. 387-388, publie huit nouveaux timbres.
- Vers le limes germanique
66, U. Ehmig, Garum fur den Statthalter. Eine Saucenamphore mit Besitzeraufschrift aus Main, dans Mainzer Archaologische Zeitschrift 3, 1996, p. 25-56, publie une amphore Dressel 7 découverte dans la vallée du Main. La marque peinte qu'elle porte indique une conserve de Garum Scombri de deux ans.
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 293
67, J. van der Werff, H. Thoen, R. van Dierendonck, Amphora production in the lower valley (Belgium) ? The Valekenburg- Marktveld evidence, dans Rei Cretariae Romanae F autorům Acta 35, 1997, p. 63-71, découvrent une production d'amphores à fond plat dite "amphores rouges" qui se distribue entre le nord-ouest de la Germanie inférieure et la Gaule Belgique, amphores à bière suggèrent les auteurs !
En Méditerranée orientale et au-delà
- En Asie Mineure
Saluons la publication du catalogue de la richissime collection d'amphores du Musée de Bodrum : 68, T. O. Olpôzen, A. H. Ózdas, B. Berkaya, Commercial Amphoras of the Bodrum Museum of underwater archaeology, Maritime Trade of the Mediterranean in Ancient Times, Bodrum 1995.
La publication des fouilles d'Éphèse livre une série d'amphores diverses, rares Dressel 1 ou Dressel 2/4, quelques Kapitán II et surtout une grande quantité de LR3, 69, C. Lang,-Auinger, U. Outschar, Aspects zur chronologie, dans Forschungen in Ephesos, VIII, 3, 1996, p. 26-77.
- En Afrique
70, J. Martinez Maganto, R. Garcia Giménez, El conjunto de ánforas altoimperiales de salazón de Ceuta. Estudio arqueológico y geoquimico aplicado al materiál cerámico romano, dans Ánforas del Museo de Ceuta, Ceuta 1997, p. 7-59, publient la collection inédite des amphores à salaison de Ceuta et proposent des analyses géochimiques.
- En Inde
71, E. Lyding Will, Mediterranean Shipping Amphoras from the 1941-50 Excavations, dans V. Begley, The Ancient Port of Arikamedu, New Excavations and Researches 1989-1992, École Française d'Extrême-Orient, Pondichéry 1996, p. 317-349 : dans ce premier volume, E. Lyding-Will ne publie que du matériel des fouilles anciennes, auquel elle n'a pas eu accès en totalité. Il s'agit essentiellement des fouilles françaises de 1940, qu'elle évalue à moins de la moitié (42%) de l'ensemble de la collection ancienne. Parmi ces 82 fragments dont plusieurs sont réutilisés (ils portent des traces d'enduit), les deux tiers sont identifiés comme des amphores à vin : 22 amphores de Cos, 5 de Cnide, 12 rhodiennes tardives,
DHA 23/2, 1997
294 Chronique. Des amphores et des hommes
16 "pseudo-Cos" de fabrication italienne, que l'on peut, à mon sens, assimiler à des Dressel 2/4 italiennes (j'ai eu l'occasion de voir le matériel du musée de Pondichéry). Il y a quelques amphores à huile, 5 Dressel 6 et deux Dressel 20 (dont une lèvre typique de la forme ancienne), et quelques amphores à poisson (2 Dressel 7/11). Je reste sceptique sur l'identification des amphores Dressel 22, l'une au moins (fig. 6.63) m'a paru clairement être une Dressel 1.
D'autres amphores sont plus récentes, une spathéia et une amphore de Gaza. Ces passionnants témoins des échanges avec l'Occident seront bientôt complétés par la publication des fouilles récentes qui comportent des types plus nombreux et, notamment, quelques amphores Gauloise 4.
AMPHORES TARDIVES
En Méditerranée occidentale - En Italie
72, R.J.A. Wilson, Archaeology in Sicily, dans Archaeological Reports, 1995-1996, British School at Athens, 1996, p. 80, signale une découverte importante, celle d'un atelier d'amphores Keay LU à Naxos, en Sicile, des amphores à vin qui ont eu une large distribution en Méditerranée.
- Dans la Péninsule ibérique
73, D.B. Casasola, Las ánforas del tipo Beltrán 68 en Hispania : problemática y estado de la cuestión, dans Adas del XXIII Congresso Nacionál de Arqueología, Elche, 1995, p. 251-269 : différente des amphores lusitaniennes, cette amphore vinaire tardive aurait pour origine la Bétique.
74, D.B. Cassola, Las producciones anfóricas del bajo imperio y de la Antigùedad tardia en Malaga : estado actual de la investiga- ción e hipótesis de trabajo, dans Figlinae Malacitanae, Malaga, 1997, p. 233-259 : durant la période du Ve au Ville s., il n'y a aucune évidence de production de vin local à Malaga. En revanche, les importations de vins égéens et de la Méditerranée orientale faisaient partie des importations habituelles.
- Dans les Gaules
75, C. Santamaria, L'épave de Drammont E à St-Raphaël (Ves. ар. J.-C), Archaeonautica 13, 1995, dresse un bilan de cette petite épave de 16 m de long, fouillée entre 1981 et 1991 et largement
DHA 23/2, 1997
Chronique. Des amphores et des hommes 295
pillée. Elle contenait des amphores cylindriques de grand diamètre Keay XXXV (7 variantes, poids moyen 20 kg, contenance 78 litres) et de diamètre moyen (4 variantes, poids moyen 16,5 kg, contenance 56,5 litres), des spathéia de petite et grande taille avec plusieurs variantes et des amphores diverses (Almagro 51C...). Des amphores cylindriques de grand diamètre, poissées, contenaient des ossements de porc finement découpés, certaines spathéia et Keay XXV des olives ! Le contenu des Keay XXXV A ou B, suivant qu'elles sont ou non poissées, n'est pas clair. Le chargement comportait, outre de la céramique commune, de la sigillée claire, quelques lampes et monnaies du 5e s. et, chose inhabituelle, des tubuli de voûtes.
76, J.-P. Joncheray, C. Brandon, Deux épaves du Bas-Empire romain : l'épave Chrétienne D, l'épave d'Héliopolis, dans Cahiers d'Archéologie Subaquatique, XIII, 1997, p. 123-164 : elles sont situées au large de St-Raphaël, le premier chargement estimé à 500 amphores se répartit en Almagro 51 С surtout, Dressel 23 et autres amphores cylindriques ; la seconde contient uniquement des amphores cylindriques africaines de plusieurs variantes avec des estampilles circulaires.
- Afrique
77, D.B. Casasola, Las ánforas romanas bajoimperiales y tardoromanas del Museo Municipal de Ceuta, dans Ánforas del Museo de Ceuta, Museo de Ceuta 1997, p. 61-129, présente le catalogue de cette riche collection et des analyses de pâte par diffraction X.
Que soient remerciés tous ceux qui ont bien voulu contribuer à cette chronique en m' adressant des publications.
Fanette Laubenheimer
DHA 23/2, 1997