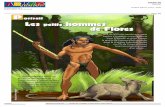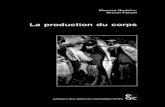Violence des hommes, violence de Dieu. Regard sur quelques textes du Nouveau Testament
Les atours feminins des hommes - Cairn
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les atours feminins des hommes - Cairn
LES ATOURS FÉMININS DES HOMMES : QUELQUES REPRÉSENTATIONSDU MASCULIN-FÉMININ DANS LE MONDE GREC ANTIQUE.
Entre initiation, ruse, séduction et grotesque, surpuissance et déchéance
Florence Gherchanoc
Presses Universitaires de France | « Revue historique »
2003/4 n° 628 | pages 739 à 791 ISSN 0035-3264ISBN 9782130534938DOI 10.3917/rhis.034.0739
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-historique-2003-4-page-739.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Les atours féminins des hommes :quelques représentationsdu masculin-féminindans le monde grec antique.Entre initiation, ruse, séductionet grotesque, surpuissanceet déchéance*1
Florence GHERCHANOC
Ainsi que l’a montré Nicole Loraux, pour les Grecs, depuisHésiode, la femme est formée d’ « un corps, réduit essentiellementau ventre, une parure, qui est souvent un voile. Le ventre est“chiennerie interne”, qui sert à dire la lubricité dans le langage del’appétit alimentaire, mais il est aussi ce qui met au monde lesenfants des hommes. La parure est, dans la Théogonie, ce qui cons-titue la femme comme un beau dehors »2.
Pour l’heure, je ne retiendrai que le second élément de cetteproposition ; la femme est parure, semblant (ekelon ; eidoV), appa-
Revue historique, CCCV/4
* Je remercie tout particulièrement Jean-Baptiste Bonnard et Valérie Huet pour leurs remar-ques et leurs suggestions. Sont remerciées également Pauline Schmitt-Pantel et l’équipe Phéacie.
1. Pour la méthode et l’approche épistémologique : Sylvie Steinberg, La confusion des sexes. Letravestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard, 2001 ; Femmes travesties : un « mauvais »genre, Clio. Histoire, Femmes et sociétés, 10, 1999, et, dans une moindre mesure : Cross Dressing andGender Confusion, dans Greece & Gender, Brit Berggreen et Nanno Marinatos éd., Bergren, PaulÅströms Förlag, 1995, p. 123-177.
2. Nicole Loraux, Les expériences de Tirésias. Le féminin et l’homme grec, Paris, NRF-Gallimard,« Essais », 1989, p. 150.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
rence trompeuse (dploV) à l’instar de Pandora, première de cetteespèce (qRlu g@noV ou g@noV gunaik²n), « un être tout pareil à unechaste déesse », modelée par Héphaïstos et habillée par Athéna qui« lui noua sa ceinture, après l’avoir parée d’une robe blanche, tandisque de son front ses mains faisaient tomber un voile aux mille bro-deries, merveille pour les yeux. Autour de sa tête elle posa un dia-dème d’or forgé par l’illustre Boiteux lui-même, de ses mains adroi-tes, pour plaire à Zeus son père »3.
Ainsi, dans la Théogonie, « la première femme est sa parure, ellen’a pas de corps »4. Or, si la femme est avant tout parure, ce qui faitla femme dans l’homme, n’est-ce pas tout d’abord des atours fémi-nins trompeurs ?
Partant de là, je m’interrogerai sur la perception du masculin etdu féminin, sur des signes apparents, visibles, éventuellement trom-peurs, qui répondent à des critères sociaux normés, mais quandceux-ci sont détournés et pervertis par des hommes qui volontaire-ment intervertissent les codes sexués. Aussi, après l’étude précise duvocabulaire et des signes (traits du visage et du corps, vêtements,objets, comportements) pour dire l’effémination, la fausse féminitéou le semblant de féminité, l’objectif est-il de se demander à quoirépondent et renvoient les différentes formes de travestissement dansune société qui met en exergue les valeurs masculines.
Pour esquisser une réponse à cette question, la tragédie d’Eu-ripide intitulée les Bacchantes m’a semblé être un point de départintéressant5.
740 Florence Gherchanoc
3. Hésiode, Théogonie, v. 572 et Travaux et Jours, v. 71 ; T. J., v. 63 ; Théog., v. 589 et T. J.,v. 83 ; Théog., v. 590-591 ; Ibid., v. 571-572. Cf. également, T. J., v. 60-63 ; Théog., v. 573-580.Même idée au vers 587 : « superbement paré ». Cf. également, T. J., v. 63-68. Pour un commen-taire complet : Nicole Loraux, Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus, Aréthusa, 11,1-2, 1978, p. 43-87, repris dans Les enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division dessexes, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 75-117 ; Jean-Pierre Vernant, Le mythe hésiodique desraces. Sur un essai de mise au point, dans Mythe et pensée chez les Grecs, I, Paris, FM/Petite collectionMaspero, 1965, p. 51-55.
4. Nicole Loraux, Ibid., p. 86.5. Cette tragédie a donné lieu à de nombreux commentaires, notamment ceux de Jean
Labarbe, Le personnage de Penthée dans les Bacchantes, dans Mélanges J. Gessler, Louvain, 1948,p. 686-692 ; Reginal Pepys Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus. An Interpretation of theBacchae, Cambridge, Bristol Classical Press, 1997 (1948) ; Éric Robertson Dodds, Euripides Bacchae,Oxford, Clarendon Press, 1960 ; Clara Gallini, Il travestismo rituale di Penteo, Studi e materiali distoria delle religioni, 34, 1963, p. 211-228 ; Jeanne Roux, Les Bacchantes, II. Commentaire, Paris, LesBelles Lettres, 1972 ; Maurice Lacroix, Les Bacchantes d’Euripide, Paris, Les Belles Lettres, 1976 ;Étienne Coche de La Ferté, Penthée et Dionysos. Nouvel essai d’interprétation des Bacchantesd’Euripide, dans Recherches sur les religions de l’Antiquité classique, Raymond Bloch éd., Paris-Genève,Librairie Champion - Droz, 1980, p. 105-257 ; Charles Segal, Dionysiae Poetics and Euripides’Bacchae, Princeton-Guildford, Princeton University Press, 1982 ; Jean-Pierre Vernant, Le Dionysosmasqué des Bacchantes d’Euripide, L’Homme, 93, janvier-mars 1985, XXV (I), p. 31-58 repris dansJean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, II, Paris, La Décou-verte, 1986, p. 237-269.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
La pièce a été composée en 408 avant notre ère et représentéepour la première fois en 405 à Athènes. Le mythe des Bacchantes,encore appelé mythe de Penthée, forme le sujet de la pièce : troisfemmes de Thèbes, et non des moindres, Agavé, Ino et Autonoé,filles de Cadmos, le fondateur de la cité, refusent d’accepter Diony-sos comme dieu. Celui-ci les rend folles et elles quittent leur métierà tisser pour s’en aller sur la montagne du Cithéron, suivies par lesautres femmes de Thèbes. Le fils d’Agavé, Penthée, qui est le roi deThèbes, décide de punir, en le jetant en prison, cet étranger auxallures efféminées qu’il ne reconnaît point comme dieu. Dionysos sevenge en convainquant Penthée de se rendre sur la montagne, tra-vesti en femme, pour espionner les Bacchantes. Mais Penthée estdémasqué et écartelé par ces femmes furieuses, parmi lesquelles setrouvent sa mère, Agavé, qui ne reconnaît plus son propre fils.
Le thème majeur de la pièce n’est vraisemblablement pas le tra-vestissement des deux protagonistes que sont Dionysos et Penthée,mais plutôt le dionysisme. Néanmoins, le travestissement n’est passans rapport avec Dionysos qui est un dieu ambivalent, un dieu quibrouille les catégories6. De plus, l’analyse des atours féminins deDionysos et de Penthée, tels qu’ils sont décrits dans la tragédied’Euripide, constitue la première étape d’une réflexion sur les mar-queurs de l’identité sexuée, de ce qui, a priori, relèverait du fémininet de ce qui relèverait du masculin dans les sociétés grecques desépoques classique et hellénistique.
J’examinerai donc, dans un premier temps, de quelle façon lesdiscours (tragique puis comique) s’emparent des figures de l’efféminéet du travesti. Ensuite, j’analyserai les pratiques sociales (mythe etrites) assorties de travestissements, en particulier autour des adoles-cents, et montrerai, enfin, comment s’opère le passage de la trans-gression normée à la truphé (luxe excessif).
Les atours féminins des hommes 741
6. Sur Dionysos et le dionysisme : Walter F. Otto, Dionysos, le mythe et le culte (traduit del’allemand par Patrick Levy), Paris, Gallimard, 1992 (1933) ; Henri Jeanmaire, Dionysos. Histoire duculte de Bacchus, Paris, Payot, 1951 ; Dario Sabbatucci, Essai sur le mysticisme grec (traduit de l’italienpar Jean-Pierre Darmon), Paris, Flammarion, 1982 (1965) ; Karl Kerényi, Dionysos. Archetypal Imageof Indestructible Life (Traduction de l’allemand par Ralph Manheim), Londres, Routledge & KeganPaul, 1976 ; Marcel Detienne, Dionysos mis à mort, Paris, Gallimard, 1977 ; Id., Dionysos à ciel ouvert,Paris, Hachette, 1986 ; L’association dionysiaque dans les sociétés anciennes. Actes de la table ronde organiséepar l’École française de Rome (24-25 mai 1984), CEFR 89, 1986 ; Walter Burkert, Ancient Mystery Cults,Cambridge-Londres, Harvard University Press, 1987 ; Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion en Grèceancienne, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 96-104 ; Maria Daraki, Dionysos et la déesse Terre, Paris,Flammarion, 1994.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
DIONYSOS ET PENTHÉE, DES HOMMES AU FÉMININ
Comment dire l’effémination ?
À Thèbes, Dionysos a deux objectifs : faire accepter le culte bac-chique et se manifester aux hommes comme fils de Zeus, « nédieu » (qeqV geg:V)7. Pour cela, au lieu de se présenter aux Thébainsen sa qualité de dieu, il use d’un premier subterfuge : « À cette finj’ai pris l’apparence mortelle (eidoV qnhtqn), et changé mon aspectdivin au corps d’un homme (ecV 3ndrqV fAsin) », dit-il. Dionysosprend une forme mortelle (morfQ brotPsia), se dote d’un corps mas-culin aux attributs masculins, mais il a l’apparence d’une femme ;Penthée le qualifie ou plutôt le traite de « qhlAmorfoV x@noV »,d’étranger efféminé8. Cette expression, qui a une connotation claire-ment péjorative, est précisée ailleurs. Cet étranger venu de la Lydiea, en effet, « les cheveux parfumés épars en boucles blondes, le teintvermeil et les yeux remplis du charme d’Aphrodite »9.
Les signes extérieurs de la féminité du dieu sont sa chevelure, unteint clair, des joues couleur vermeil. Sa chevelure (tanapV) longue etblonde flotte au vent ; ses boucles d’or sont délicates. De fait, ses« longs cheveux ondoyant sur [sa] joue ne sont point d’un lutteur,mais respirent l’amour ». Comme une femme, son teint est clair :« Blanche (leukQ) est ta peau, tu l’as soigneusement, sans doute,tenue au frais sans l’exposer au plein soleil, captant, par ta beauté,les faveurs d’Aphrodite. » Sa carnation est vermeille (ocnwppVg @nuV).À cela s’ajoutent un visage souriant (gel²n) et une certaine beauté :« Il n’est pas laid, au goût des femmes. »10
Ces caractéristiques correspondent à des critères socio-culturelsbien définis. En dehors du thyrse et, sans doute, de la robe asia-tique, l’apparence physique du fils de Sémélé constitue l’élément cléde son effémination. Au Ve siècle, en effet, les citoyens portent géné-ralement les cheveux courts. Seuls les jeunes aristocrates, cavalierssurtout, désireux d’imiter les Spartiates qu’ils admirent et de se dis-tinguer du citoyen athénien ordinaire, gardent les cheveux longs à
742 Florence Gherchanoc
7. Euripide, Bacchantes, v. 39-42 et 47.8. Ibid., v. 53-54 ; v. 4 ; v. 353. Sur l’ « étrange étranger » qu’est Dionysos : Marcel
Détienne, Dionysos à ciel ouvert, op. cit., p. 21-26.9. Euripide, Bacch., v. 235-236.
10. Ibid., v. 240-241 ; v. 493 et 553 ; v. 455-456 ; v. 457-459 ; v. 438. Dans Sophocle, Œdipe-Roi, v. 211, Dionysos est également oinoy, le teint empourpré et porte une mitre d’or (v. 209) ;Euripide, Bacch., v. 439 ; Ibid., v. 453-454.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
la mode ancienne11. Aussi, lorsqu’elle est longue, la chevelure deshommes est-elle, en principe, tressée et remontée autour de la tête,celle des femmes dénouée. En fait, à l’époque classique, l’oppositionentre cheveux courts et cheveux longs ressortit à un topos bien connuqui vise à différencier par des valeurs et des comportements précisles démocrates des oligarques, mais aussi la Grèce de l’Orient12.Dans tous les cas, se féminiser ou encore s’orientaliser revient sou-vent au même ; c’est se faire autre. Ainsi, pour un homme, porterdes cheveux longs, dénoués et flottants à la façon des couroi archaï-ques et des Ioniens « délicats » est un signe de truphé13. De plus, leshommes qui, à l’instar de Penthée, vivent dehors et s’exercent dansles gymnases ont le teint hâlé, tandis que les femmes ont la peauclaire. D’ailleurs, au théâtre, les masques disent ainsi la différencedes sexes : ils sont normalement clairs pour les femmes et sombrespour les hommes14 ; les codes iconographiques également : dans lacéramique à figures noires, les peintres adjoignent du blanc pourfigurer les chairs féminines15. Aussi, signe de délicatesse et de beautépour la femme, un teint blanc, chez un homme, est-il souvent lamarque d’un manque de virilité. De même, le terme « ocnwppV »(vermeil) qualifie le visage au teint délicat et fragile des femmes oudes adolescents encore imberbes dont les joues gardent une fraî-cheur féminine. Il évoque tout le contraire d’une idée de virilité16.Celui qui ne répond pas à ces codes du masculin et du féminin est
Les atours féminins des hommes 743
11. Voir Jeanne Roux, Les Bacchantes, II, op. cit., v. 455-456. Cf. Lysias, Discours XVI PourMantitheos, 18 : « Mais parce qu’on porte les cheveux longs, ce n’est pas une raison pour être malvu » ; Aristophane, Cavaliers, v. 580 et Nuées, v. 14. Sur le luxe de l’élite : Leslie Kurke, The Politicsof 4brosAnh in Archaic Greece, Classical Antiquity, 11, 1992, p. 91-120 ; à propos des traditions del’élite et des conflits de valeurs aux époques archaïque et classique : Jan Morris, The Strong Prin-ciple of Equally and the Archaic Origins of Greek Democracy, dans Demokratia. A Conversation onDemocracies, Ancient and Modern, Josiah Ober et Charles Hedrick ed., Princeton University Press,1996, p. 31-42.
12. Voir Ian Morris, Ibid., p. 33 sq. ; Cecil Maurice Bowra, Asius and the Old-FashionedSamians, Hermes, 85, 1957, p. 391-401.
13. Voir Jeanne Roux, Les Bacchantes, II, op. cit., v. 455-456.14. Voir Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane, Cahiers
du Gita, 3, octobre 1987, p. 219. Selon Pollux, VI, 133, le jeune homme modèle (p0gcrhstoVneanBaV) porte au théâtre un masque « au teint bronzé » (melainpmenoV).
15. Voir John Boardman, Aux origines de la peinture sur vase en Grèce (traduit de l’anglais parChristian-Martin Diedold), Paris, Thames & Hudson (L’univers de l’art), 1999, p. 183. Surl’association entre blancheur de peau et féminité : Bridget M. Thomas, Constraints and Contra-dictions : Whiteness and Feminity in Ancient Greece, dans Women’s Dress in the Ancient Greek World,Lloyd Llewellyn-Jones éd., Londres, Duckworth and the Classical Press of Wales, 2002, p. 1-16.Sur des signes qui dénotent le masculin et le féminin en céramique attique et sur l’ambiguïtésexuelle de personnages représentés : Françoise Frontisi-Ducroux et François Lissarrague, Del’ambiguïté à l’ambivalence : un parcours dionysiaque, Annale del seminario di studi del mondo classico.Archeologia e storia antica, V, 1983, p. 11-32 ; Tyler Jo Smith, Travestism or Travesty ? Dance, Dressand Gender in Greek Vase-painting, dans Women’s Dress in the Ancient Greek World, op. cit., p. 33-52.
16. Voir Georges Roux, Commentaires sur Théocrite, Apollonios et quelques épigrammesde l’Anthologie, Revue de philologie, 3e série, 37, 1963, p. 82-83.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
un homme efféminé (qhlAmorfoV, gAnniV), semblable à une femme(gunaik:dhV) et donc diminué, lâche (deBloV) et faible (5nalkiV). AussiPenthée ne se méfie-t-il pas de son adversaire : « Vous pouvez lelâcher ; car, pris dans mes filets, si leste qu’il puisse être, il ne peutm’échapper. »17
D’autres auteurs ont fait de Dionysos un dieu efféminé. Dans lesEdonoi d’Eschyle, Lycurgue, roi de Thrace, hostile comme Penthée àl’introduction du culte bachique dans son royaume, s’enquiert ainside l’identité de Dionysos : « D’où vient cet individu efféminé(gAnniV) ? Quelle est sa patrie ? Quel est ce vêtement (stolP) ? »18 Cedernier est également appelé cloAnhV (efféminé, châtré)19. Le dieuapparaît aussi sous les traits d’une jeune fille (eckasqeaV kprÃ) auxMinyades qui négligent son culte20. On le dit donc « de nature effé-minée » (qhlAmorfoV, qhlAthV)21, gAnniV ou encore « à la doublefigure » (dBmorfoV). Diodore de Sicile, qui présente un répertoire desdifférentes traditions relatives à Dionysos, justifie cette dernière épi-thète donnée au dieu par le fait qu’il y ait deux Dionysos :« L’ancien qui porte une longue barbe (katap:gwn)..., le plusrécent, un adolescent (n@oV) efféminé (truferpV) et dans la fleur del’âge, charmant (´raboV)22. » On dit de ce dernier, né de Sémélé,qu’ « il possède un corps efféminé (tÈ s:mati gen@sqai truferpn) etparfaitement délicat (4palpV) ; par sa beauté (e£prepeBa), il surpasseles autres hommes et est très enclin aux plaisirs de l’amour... »23
Ainsi, Dionysos est à la fois homme et femme. Sa nature est celled’un homme, peut-être d’un jeune homme, un adolescent ; ses
744 Florence Gherchanoc
17. Hésychius, s.v. gAnniV ; Pseudo-Aristote, Physiognomica, 812 a, 12 : « od dA leukoi 5gan deiloBò3naf@retai Cpa t1V gunabkaV » (Ceux qui ont le teint blanc sont tout à fait lâches, comme on le voitpour les femmes) ; Dans les Theores d’Eschyle, Silène traite Dionysos d’ « efféminé faible » (gAnniV5nalkiV) : cf. Hans Joachim Mette, Die Fragmente der Tragödien des Aeschylos, Berlin, Akademie-Verlag,1959, 17, v. 58 et 68 ; Euripide, Bacch., v. 451-452.
18. TGF, vol. 3, fgt. 61, éd. Radt. Sur le motif de résistance à Dionysos : William KeithChambers Guthrie, The Resistance Motif in Dionysiac Mythology, Proceedings of the Cambridge Philo-logical Society, 179, 1946-1947, p. 14-15 ; Isabelle Tassignon, Le héros face à Dionysos : étude desmodalités du conflit, Kernos, suppl. 10, 2000, p. 125-136.
19. TGF, vol. 3, fgt 62 : « MakroskelQV m@n. FAra mQ cloAnhV tiV Yn » ([Le messager] : « Il ade longues jambes. » [Lycurgue] : « Comment non ? N’était-il pas un efféminé eunuchoïde ? »).Voir Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1999,s.v. cloAnhV ; Georges Devereux, Le fragment d’Eschyle 62 Nauck. Ce que signifie CLO NHS,Revue des Études grecques, LXXXVI, 1973, 2, p. 277-284, montre que, dans le fragment d’Eschyle,Dionysos est comparé à un eunuque dont la castration a développé une aptitude physique (à lacourse).
20. Antoninus Liberalis, X, 1-2. Voir Ken Dowden, Death and the Maiden. Girl’s Initiation Ritesin Greek Mythology, Londres-New York, Routledge, 1989, p. 82-84.
21. Philochore d’Athènes, FGrH 328 F7 ; Lucien, Dialogues des dieux, 22 (18), 1.22. Diodore de Sicile, IV, 5, 2. Sur ce point : Robert Turcan, Dionysos dimorphos. Une illus-
tration de la théologie de Bacchus dans l’art funéraire, Mélanges d’archéologie et d’histoire, 70, 1958,p. 243-293.
23. Diodore de Sicile, IV, 4, 2.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
atours ceux d’une femme24. Certains ont mis en avant la proximitéphysique qui peut exister entre le corps de l’adolescent imparfait,inachevé, et celui d’une jeune femme. Néanmoins, dans la tragédie,le dieu est « un mage, un enchanteur » (gphV CpÅdpV)25. Le mage(gphV) se donne pour autre qu’il est. Par conséquent, il est suscep-tible de brouiller les catégories, les normes sociales, capable de jouersur des oppositions et des ambiguïtés. De fait, dualité, contraste,inversion sont des marqueurs de l’identité de Dionysos26. Ce dernierest précisément celui qui « fusionne toutes les catégories tranchées,toutes les oppositions nettes qui donnent à notre vision du monde sacohérence »27 Dieu « aux mille formes » (muripmorfoV), il revêt demultiples apparences, soit animales28, soit humaines. Sa capacité demaître des illusions relève de la ruse (apatè). Cela fait aussi de lui uncorrupteur de foyers et un séducteur, mais également un fauve quipeut se montrer docile (prßoV)29.
Par contraste, pendant la première partie de la tragédie, Penthéeincarne pleinement les qualités, valeurs et vertus masculines. Il a leteint hâlé. Sa force et son autorité de roi inspirent la peur ; il se faitcraindre30. Jusqu’au vers 820, il est habillé en homme et porte uneépée. Il se conduit en chef d’État, soucieux du renom de sa cité31, eten soldat : il envoie des gardes à la poursuite de l’étranger lydien,s’apprête à partir en expédition contre les Bacchantes et se faitapporter ses armes sur scène32.
Puis, à partir du vers 821, efféminé lui aussi, il apparaîtcomme un doublon de Dionysos, mais dans une certaine mesurequ’il conviendra de préciser. En effet, par vengeance, ce dernierle persuade d’espionner les femmes « en prenant un vêtement
Les atours féminins des hommes 745
24. Comme le remarque Jan Bremmer, Dionysos travesti, dans L’initiation. Les rites d’adolescenceet les mystères. Actes du Colloque international de Montpellier, 11-14 avril 1991, Études rassemblées parAlain Moreau, Publications de la Recherche, Université Paul-Valéry, Montpellier III, t. I, 1992,p. 193, son teint de rose et la mitre qu’il porte le suggèrent. En effet, la mitre est la coiffuretypique des jeunes filles proches du mariage : Hugo Brandenburg, Studien zur Mitra. Beiträge zurWaffen und Trachgeschichte der Antike, Münster, Verlag Aschendorff, 1966, p. 92-94, et ClaudeCalame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, I, Rome, Edizioni dell’atenao & bizzarri, 1977,p. 99-101. Sur la personnalité et les identités de Dionysos : Albert Henrichs, Changing DionysiacIdentities, dans Jewish and Christian Self-Definition, III. Self-Definition in the Graeco-Roman World, BenF. Meyer et E. Parish Sanders ed., Londres, SCM Press Ltd, 1982, p. 137-160.
25. Euripide, Bacch., v. 233-234.26. Albert Henrichs, Changing Dionysiac Identities, op. cit., p. 158, considère la nature effé-
minée du dieu comme faisant partie d’une suite d’oppositions (jeune/vieux, guerre/paix,vie/mort) qui sont caractéristiques de Dionysos.
27. Jean-Pierre Vernant, Le Dionysos masqué des Bacchantes d’Euripide, op. cit., p. 255.28. Euripide, Bacch., v. 100, 921-922 et 1017. Cf. aussi Hymne homérique à Dionysos, I, 44.29. Euripide, ibid., v. 352-353 ; v. 233 sq. ; v. 436.30. Ibid., v. 671, 775, 856 et 1310.31. Ibid., v. 778-779.32. Ibid., v. 228-232, 352-354, 780-785 et 809.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
féminin (gunaikqV CsqRta) ». Ainsi, d’homme, Penthée devientfemme33.
Dionysos se charge de faire la toilette du jeune roi, de le parercomme le ferait une femme, de le « travestir d’une robe de femme »(An gunaikomBmÅ stolß)34.
Seul le costume (stolP) peut le faire ressembler à une femme(qRlun)35. Pour transformer son apparence, il met sur sa tête unelongue perruque36 et, sur son front, porte un bandeau (mBtra)37,accessoire typiquement féminin. La seconde pièce du travestisse-ment (scRma to¢ kpsmou) est une robe aux longs plis (p@ploipodPreiV) : il revêt son corps de tuniques de laine ou de lin (bussBnoip@ploi) tombant jusqu’aux pieds et porte une ceinture38. À tout cela,il ajoute le thyrse à la main, une peau de faon tachetée39, des attri-buts de ménades.
Ainsi vêtu, il a l’allure d’une femme (gunaikpmorfoV)40. À la diffé-rence de Dionysos, ce ne sont pas les traits physiques de Penthée,mais son déguisement, une parure (kpsmoV), des vêtements reconnuscomme féminins (skeuQ gunaikqV), qui rendent possible le subterfuge.Désormais, il a l’air d’une femme, d’une ménade, d’une bacchante41.On peut dès lors le prendre pour une fille de Cadmos42, l’habit fai-sant le sexe. Son allure le conduit à s’interroger en ces termes : « Àquoi donc ressemblé-je ? Ai-je l’air d’être Inô ? Ou bien ai-je le portde ma mère Agavé ? »43 Le regard d’autrui, la perception qu’ont lesautres de lui à travers ses vêtements et sa coiffure le consacrentcomme « femme ». Dionysos peut ainsi le rassurer : « En te voyant,je crois les [ta tante et ta mère] avoir sous les yeux ! »44 D’ailleurs,alors que les femmes se déchaînent contre lui, il arrache sa mitre
746 Florence Gherchanoc
33. Ibid., l. 15 de l’Argument ; v. 822.34. Ibid., v. 827 ; v. 932 sq. ; v. 980.35. Ibid., v. 828 et 830.36. Ibid., v. 831. Je pense plutôt, comme le proposent Jeanne Roux, Les Bacchantes, II op. cit.,
et Maurice Lacroix, Les Bacchantes d’Euripide, op. cit., qu’il dénoue les tresses des cheveux dePenthée pour que ceux-ci flottent au vent.
37. Euripide, Bacch., v. 833, 929 et 1115.38. Ibid., v. 833 ; v. 821 ; v. 935 sq. La ceinture est l’un des attributs de la féminité destinés
au mariage conféré par Athéna à Pandora (Hésiode, Théog., v. 72 ; T. J., v. 573). À Trézène, lesjeunes vierges la consacrent avant le mariage à Athéna Apatouria (Pausanias, II, 33, 1). Sur laceinture comme élément décisif du changement de statut de la femme qui se fait dans la sphère del’apatè : Pauline Schmitt-Pantel, Athéna Apatouria et la ceinture : les aspects féminins des Apatou-ries à Athènes, Annales ESC, 6, novembre-décembre 1977, p. 1062-1064.
39. Euripide, Bacch., v. 835.40. Ibid., v. 855.41. Ibid., v. 857 ; v. 915.42. Ibid., v. 917.43. Ibid., v. 925-926.44. Ibid., v. 927.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
pour qu’Agavé puisse le reconnaître (gnwrBsasa)45. Aussi le vêtementa-t-il une fonction essentielle dans l’identification des différences. Ilest précisément une marque indispensable de l’identité sexuée.« Qu’il soit costume ou habit, [il] est le premier des langages etinforme (donne forme et révèle) toutes les relations sociales. »46 Ilcache et, précisément, il révèle le sexe qu’il masque.
Mais une fois cette transformation opérée, Penthée change aussid’attitude. Se recoiffant, mettant en ordre sa tenue, s’inquiétant de lafaçon de porter le thyrse, « il se conduit en femme soucieuse de sonallure »47. « Ton esprit est bien changé, bravo ! », remarque ironique-ment Dionysos, après cette démonstration de coquetterie48. Néan-moins, l’image de la femme que présente Penthée est maladroite (sarobe pend, sa ceinture est trop lâche49) et surtout pathétique50.
A contrario, à cette effémination du roi de Thèbes répond la mas-culinisation des femmes. De fait, la lyssa (état de fureur) les caracté-rise dès le vers 731. Elles agissent comme « des hordes hostiles(pol@mioi) »51. Elles font « fuir les hommes devant elles, preuve qu’undieu les assistait »52. Parmi elles, les filles de Cadmos chassent etabattent un fauve (Penthée) de leurs mains blanches et, rapportantleur trophée, deviennent ainsi 5ristai, les meilleures53, d’autant qu’àce moment de la tragédie il n’y a plus d’homme digne de ce nom àla tête de la cité. Penthée est mort. Mais, mort ou vivant et parécomme une femme, cela ne revient-il pas au même ?
Pour un homme, se travestir, c’est se déguiser en portant desatours de femme (traits du visage, coiffure et habits féminins),pour être semblable à une femme, qhlAmorfoV, gunaikpmorfoV,gunaik:dhV. La parure, signe extérieur visible, semble être le pre-mier élément de la différence des sexes. La perception est un élé-
Les atours féminins des hommes 747
45. Ibid., v. 1155 sq.46. Nicole Pellegrin, Le genre et l’habit, Clio. Histoire, Femmes et sociétés, 10, 1999, p. 23. Voir
aussi Roland Barthes, Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations méthodologiques,Annales ESC, 3, 1957, p. 430-441 ; Yves Delaporte, Le signe vestimentaire, L’Homme, XX, 3, juil-let 1980, p. 109-142 ; Id., Perspectives méthodologiques et théoriques dans l’étude du vêtement,L’Ethnographie, numéro spécial : Vêtement et sociétés, 2, LXXX, 1984, p. 33-57 ; Nicole Pellegrin, Levêtement comme fait social total, dans Histoire sociale, histoire globale ?, Christophe Charle éd., Paris,EHESS, 1993, p. 81-94.
47. Euripide, Bacch., v. 934 sq. ; Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédiesd’Aristophane, op. cit., p. 222.
48. Euripide, ibid., v. 944.49. « Dénouer sa ceinture » est synonyme d’accomplir l’acte sexuel : Pauline Schmitt-Pantel,
Athéna Apatouria et la ceinture, op. cit., p. 1063. Est-ce à dire que Penthée, travesti, se présentecomme une femme, voire une jeune fille nubile à la sexualité débridée ?
50. Danièle Auger, Le jeu de Dionysos : déguisements et métamorphoses dans les Bacchantesd’Euripide, Nouvelle Revue d’ethnopsychiatrie, 1, 1983, p. 72-73.
51. Euripide, Bacch., v. 752.52. Ibid., v. 763-766.53. Ibid., v. 1200-1215 et 1235-1243.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
ment important de la différenciation sexuée. Dionysos et Penthéeont l’apparence de femmes, le premier par ses traits, le second parles vêtements qu’il porte. Néanmoins, un autre élément renforcel’aspect efféminé des deux protagonistes des Bacchantes : leur âge. Eneffet, ils sont jeunes. Penthée est qualifié de jeune homme (neanBaV),d’enfant ou jeune garçon (pabV), de jeune (n@oV)54. Il n’a pas encorede barbe, seul un fin duvet recouvre depuis peu ses joues : « Un poilencore très doux fleurit à foison sur sa tête. »55 Aussi la métamor-phose de l’apparence joue-t-elle d’autant plus sur la confusion dessexes56. Ainsi, se travestir, c’est également se masquer, cacher savéritable nature, de dieu pour Dionysos, de mâle pour Penthée.C’est, enfin, altérer son comportement, déroger à la perfectionreconnue de son sexe et changer d’identité, au moins pour Penthée.En changeant de costume, ce dernier change de nature. L’hommeefféminé (gAnniV) est, en effet, un homme diminué : lâche (deBloV),dépourvu de virilité (5nandroV) et mou, sans vigueur (malakpV)57.
L’effémination de Dionysos et de Penthée et les rituels d’initiation
Dans nombre de mythes et dans certains rites, l’adolescent avantde devenir un homme au sens plein du terme passe par une étapeféminine ou féminisée58. « Le principe féminin est affirmé chez lecandidat à l’initiation au moment où il va le dépouiller. »59 Ainsi,dans les Bacchantes, Charles Segal suggère que « Dionysos est unadolescent, très attaché aux femmes, soucieux d’accomplir sonpropre “rite de passage” » en prouvant son identité de fils de Zeuslibre de responsabilités60. À Thèbes, Dionysos est seulement le fils deSémélé, fille de Cadmos ; Penthée, lui, doit son pouvoir à songrand-père maternel61. Pour les deux adolescents, le travestissement
748 Florence Gherchanoc
54. Ibid., v. 274, 974 et 1254 ; v. 213, 330, 507, 1030, 1118, 1121, 1226 et 1252 ; v. 1174 et1185. Comme le remarque Charles Segal, Dionysiac Poetics, op. cit., p. 194, Penthée est qualifiéd’ « homme accompli » (3nPr), une fois travesti (v. 848 et 962) – ce qui est ironique – puis quand ilest mort (v. 1316-1317).
55. Euripide, Bacch., v. 1186-1187.56. Voir Sylvie Steinberg, La confusion des sexes, op. cit., p. VII-VIII.57. Hésychius, s.v. gAnniV.58. Voir Pierre Vidal-Naquet, Bêtes, hommes et dieux chez les Grecs, dans Jean-Pierre Ver-
nant et Pierre Vidal-Naquet, La Grèce ancienne 3. Rites de passage et transgressions, Paris, Éditions duSeuil, 1992, p. 24.
59. Henri Jeanmaire, Couroi et courètes. Essai sur l’éducation spartiate et sur les rites d’adolescence dansl’Antiquité hellénique, Lille, 1939, p. 321-322.
60. Charles Segal, Dionysiac Poetics, op. cit., p. 168 ; thèse suivie par Jan Bremmer, Dionysostravesti, op. cit., p. 189-198.
61. Sur la nature du pouvoir de Penthée (comparable à celui d’un vice-roi) et sa faible légiti-mité : Francis Vian, Les origines de Thèbes. Cadmos et les Spartes, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1963,p. 180-182.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
serait une étape décisive pour définir pleinement leur identité en seséparant du lien maternel, pour l’un de fils de Zeus, pour l’autre deroi légitime de Thèbes capable de défendre l’autorité et le prestigede la classe masculine des guerriers.
L’épreuve se passe dans un no man’s land (montagnes sauvages :v. 811 et chemins déserts : v. 841) où les identités se dissolvent pour,normalement, se reconstruire. À cette occasion, curieusement, lesdeux protagonistes du drame échangent, intervertissent, leur rôle62.Progressivement, l’efféminé devient vigoureux, fort comme un tau-reau, énergique et puissant, contrôlant la situation tel un chasseur,tandis que Penthée devient efféminé, docile et vulnérable tel un ani-mal traqué63. Néanmoins, de ces travestissements, seul celui dujeune roi entraîne un changement de personnalité64.
Le pouvoir a changé de mains. Le dieu manifeste son emprisesur son adversaire en posant sa main sur lui, comme on le fait pourune victime consacrée65.
La mort de Penthée consacre l’échec de son rite de passage66 etla victoire, le succès de Dionysos, ainsi reconnu dans la totalité de sapuissance et comme fils de Zeus67. Ce dernier, déguisé en fille,« s’établit comme un dieu qui va montrer sa puissance, comme undieu “adulte” pour ainsi dire », en voie d’accomplir un exploitimpressionnant68. À la différence du jeune roi qui n’a pas su démon-trer et affirmer sa masculinité, Dionysos a fait preuve de virilité.Mais, la féminité du dieu ne précède pas sa masculinité et/ou sesexploits comme le suggère Jan Bremmer – ce qui marque un écartavec ce qu’on sait de ces rites initiatiques d’inversion qui permettentl’épanouissement d’une totale virilité au détriment de l’élémentféminin. Dionysos, au contraire, garde sa double nature.
Les atours féminins des hommes 749
62. Euripide, Bacch., v. 848-861 : Dionysos veut faire rire de Penthée qui, jusque-là, inspiraitla crainte (deinpV) (v. 856) et « se révéler le dieu le plus redoutable (deinptatoV) » (v. 861).
63. Voir Anne Pippin Burnett, Pentheus and Dionysos : Host and Guest, Classical Philology,65, 1970, p. 23 ; Charles Segal, Dionysiac Poetics, op. cit., p. 168.
64. Voir Albert Henrichs, Changing Dionysiac Identities, op. cit., p. 159.65. Euripide, Bacch., v. 934 : « Car je suis en tes mains (3nakeBmesqa) ». Sur l’arrière-plan
rituel de la scène : Étienne Coche de La Ferté, Penthée et Dionysos, op. cit., p. 105-247 ; DanièleAuger, Le jeu de Dionysos, op. cit., p. 69-70. Sur la prise de possession de la victime par le dieu :Clara Gallini, Il travestismo rituale di Penteo, op. cit., et Jan Bremmer, Dionysos travesti, op. cit.,p. 191, qui voit dans le travestissement de Penthée une invention d’Euripide destinée à conserverl’identification traditionnelle entre le dieu et sa victime.
66. Voir Charles Segal, Dionysiac Poetics, op. cit., p. 161. Pour une autre interprétation :A. G. Bather, Journal of Hellenic Studies, XIV, 1894, p. 244-263, voit dans l’histoire de Penthée« une transcription mythique d’une fête populaire marquant la fin de l’hiver. Penthée ne seraitautre que la vieille année rituellement expulsée et mise en pièces sous les traits d’un jeune pin cos-tumé ou d’une victime mâle travestie en femme et hissée sur un arbre ». Ainsi, Penthée serait unevictime expiatoire.
67. Euripide, Bacch., y. 1340-1342 et 1349.68. Jan Bremmer, Dionysos travesti, op. cit., p. 198.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
L’effémination : ruse, séduction et grotesque,surpuissance et déchéance
L’effémination de Dionysos relève de la ruse. Il se présente mas-qué et sous le masque de son prophète, « déguisant » sa divinité enapparence humaine. Dieu masque, ses fidèles ne savent jamais sousquelle forme il se présentera69. Il y a, souligne Henni Jeanmaire,« dans ce perpétuel déguisement une des manifestations essentiellesde la confusion du réel et de l’irréel qui est le propre du délire dio-nysiaque et des hallucinations qu’il cultive »70. Néanmoins, celui quisait voir saura discerner sa véritable nature. Ainsi, la tragédie donneà voir l’épiphanie de Dionysos, sa reconnaissance en tant que dieupar les Thébains, mais aussi par les spectateurs que la représenta-tion du drame fait assister, comme s’ils y étaient, à la révélation dudieu. De plus, Dionysos exige qu’on le « voie ». « Il veut se fairevoir comme dieu aux mortels, se faire connaître lui-même, se révé-ler, être connu, reconnu, compris. »71 Son travestissement n’est pasqu’un masque, il est aussi un révélateur de sa véritable personnalité.L’initié, l’homme pieux, précisément, peut discerner la divinité72.Dionysos se révèle en se cachant. Son travestissement est un moyende se faire voir, reconnaître. Il est là pour dire sa vraie nature73, tan-dis que celui de Penthée doit dissimuler son identité.
Si ruse il y a, celle-ci est liée par certains aspects à la séduction.Dionysos efféminé est présenté comme un séducteur, un corrupteurde jeunes filles et de femmes qui agit le jour comme la nuit74. Il s’estdoté d’attributs féminins, d’artifices pour séduire. Il fait étalage deses belles boucles d’or pour susciter le désir (ppqou pl@wV)75. Enoutre, la mitre qu’il porte n’est pas sans rapport, aussi, avec son
750 Florence Gherchanoc
69. Sur le dieu masque, voir Henri Jeanmaire, Dionysos, op. cit., p. 140 ; Jean-Pierre Vernant,Le Dionysos masqué des Bacchantes d’Euripide, op. cit., p. 237-269 ; Helene P. Foley, Mask of Dio-nysus, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 110, 1980, p. 107-135 ; Fran-çoise Frontisi-Ducroux, Au miroir du masque, dans La cité des Images : religion et société en Grèceantique, Paris, Lausanne, F. Nathan-LEP, 1984, p. 147-161 ; Id., Le dieu masque. Une figure de Dionysosd’Athènes, Paris-Rome, La Découverte, EFR, 1991 ; et Id., Du masque au visage : aspects de l’identité enGrèce ancienne, Paris, Flammarion, 1995.
70. Henri Jeanmaire, Dionysos, op. cit., p. 140.71. Euripide, Bacch., v. 47 et 50 : deBknumi ; v. 42, 182, 528, 646 et 1031 : faBnomai ; v. 859 et
1088 : gign:skw ; v. 1113, 1296 et 1345 : manq0nw ; Jean-Pierre Vernant, Le Dionysos masqué desBacchantes d’Euripide, op. cit., p. 247.
72. Euripide, ibid., v. 501-502.73. Voir Jean-Pierre Vernant, Le Dionysos masqué des Bacchantes d’Euripide, op. cit., p. 248.74. Euripide, Bacch., v. 237-238, 354, 455-456, 469 et 485-488. D’après Albert Henrichs,
Changing Dionysiac Identities, op. cit., p. 147 sq., c’est un argument majeur pour s’opposer àl’introduction du culte de Dionysos.
75. Euripide, ibid., v. 455-456.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
aspect féminin et séducteur. En effet, « la mitre apparaît [...] commele symbole non seulement de la beauté féminine, mais plus précisé-ment comme celui de la grâce qui marque pour les jeunes fillesl’achèvement de la puberté et l’accession au statut de femme adulte,bientôt mariée. L’adolescente qui porte une mitre porte donc lesigne d’une sexualité parvenue à maturité, elle est par conséquentplacée sous le signe d’Aphrodite »76. Les attributs du dieu, chevelured’or et mitre, ont une connotation clairement érotique77. Ainsi, saparure met sous le charme. Sa charis (grâce) fait perdre la raison78.
Comme pour Dionysos, le travestissement de Penthée est uneruse : le jeune roi est qualifié d’espion (kat0skopoV) de sa mère et desa compagne79. Néanmoins, il comporte un risque clairementénoncé par Dionysos : « Crains la mort, si jamais on reconnaît tonsexe ! »80 En effet, le travestissement du fils d’Agavé correspond àune transgression religieuse. À la différence des deux vieillards, Cad-mos et Tirésias, qui revêtent la tenue des bacchantes pour honorerDionysos, Penthée refuse d’entrer dans le mystère, de reconnaître ledieu et est poussé par celui-ci à s’habiller en femme, en bacchantepour épier des cérémonies interdites aux hommes.
Outre les ménades, Penthée craint en premier lieu le regard desThébains si ces derniers le démasquent. De fait, affublé en femme, ilse sent grotesque. Le jugement susceptible d’être porté sur lui parautrui lui donne un sentiment de honte (acd:V)81. Au vers 836, ils’exclame : « Je ne puis me résoudre à m’habiller en femme. » Alorsqu’il est dissimulé par des habits féminins, il a peur d’être reconnu,souhaite prendre des chemins détournés, déserts82. Il redoute de sus-citer le rire83 – rire des Thébains et, avec eux, des spectateurs queveut faire éclater Dionysos. Finalement, seule une douce folie peutlui faire prendre une robe de femme84.
Mais il doit surtout s’inquiéter du danger que font peser sur luiles ménades si elles l’identifient85. Comme le rappelle le chœur, alorsqu’il est mort : « Ah ! Dansons pour Bakkhios, célébrons, célébronsà grands cris la défaite, le malheur de Penthée, rejeton de serpent,
Les atours féminins des hommes 751
76. Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, I, op. cit., p. 100.77. Ibid., p. 98-103.78. Sur la séduction, voir Claude Calame, L’Éros dans la Grèce antique, Paris, Belin, 1996,
p. 58-63 notamment. Euripide, Bacch., v. 850 sq.79. Euripide, ibid., v. 916.80. Ibid., v. 823.81. Ibid., v. 828.82. Ibid., v. 840-841.83. Ibid., v. 842.84. Ibid., v. 848 sq.85. Ibid., v. 977 sq.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
qui, vêtu d’une robe de femme (qhlugenR stolP), prit en mains, enfait de beau thyrse, la baguette infaillible d’Hadès, précédé du tau-reau qui le mène au supplice. »86
Dionysos est double : homme et femme, le même et l’autre, tan-dis que Penthée est un homme travesti en femme. Froma Zeitlin87 abien souligné l’opposition entre la féminisation de Penthée, qui estl’emblème de sa défaite, et la féminité de Dionysos qui est le signedu pouvoir caché. De plus, on ne peut renoncer au modèle « par-fait » qu’on incarne, celui de l’individu mâle, sans risquer un non-retour, une dégradation inévitable de son statut et de sa qualitéd’homme. Le travestissement masculin comporte un danger. Néan-moins, ce danger n’existe pas pour Dionysos : homme et femme,successivement ou simultanément, il est de ce fait surpuissant. Lesmétamorphoses dont il joue n’altèrent en rien sa nature et sa per-sonnalité, mais au contraire en sont une manifestation.
En revanche, Penthée perd une part de lui-même. En effet,quand le jeune roi choisit des vêtements féminins, il renonce à saqualité d’homme, à être celui qui combat par les armes, celui donttous naguère redoutaient les menaces88. Son travestissementconsacre la fin de son autorité qui est, entre autres, fondée sur laforce. Déguiser un homme en femme est bien sûr aussi un procédéefficace de la comédie89. Ainsi, Penthée, vêtu en femme, ne peut queprovoquer le rire90. Mais il se rend également coupable de ne pasrespecter l’ordre social et religieux et la différence des sexes tellequ’elle est construite et définie par la société. On ne peut impuné-ment se jouer des lois reconnues par tous. Théomachos (en luttecontre un dieu)91, le fils d’Agavé a manqué de piété à l’égard deDionysos92. En outre, il a épié les ménades et vu ce qu’il ne devait
752 Florence Gherchanoc
86. Ibid., v. 1153-1159.87. Froma Zeitlin, Playing the Other : Theatre, Theatricality, and the Feminine in Greek
Drama, Representations, 11, summer 1985, p. 63-94 repris dans Playing the Other : Gender and Society inClassical Greek Literature, Londres, Chicago, University of Chicago Press, 1996, p. 341-374 (ici :p. 342).
88. Euripide, Bacch., v. 845-846 et 856.89. Sur la distance entre la scène de travestissement de Penthée et les scènes comiques du
même ordre, voir Bernd Seidensticker, Comic Element in Euripide’s Bacchae, American Journal of Phi-lology, 99, 1978, p. 303-322 ; Frances Muecke, Costume and Design, Antichton, 16, 1982, p. 32-33.
90. Néanmoins, nous sommes dans le cadre d’une tragédie. Et rien n’indique que le publicait ri à la représentation des Bacchantes.
91. Euripide, Bacch., v. 45, 325, 635-636 et 1255. Penthée est également dit « en lutte contreles dieux » (3ntBpaloV qeobV) solidaires de Dionysos. Sur la revanche de Dionysos et la punitiondivine : Anne Pippin Burnett, Pentheus and Dionysos : Host and Guest, op. cit., p. 15-29.
92. Euripide, ibid., v. 263, 490 et 502. Cf. Pausanias, IX, 5, 4 : « Penthée, le fils d’Echion,était puissant lui aussi en raison de la noblesse de sa naissance et de l’amitié du roi ; mais, commed’autre part, il était impétueux et impie à l’égard de Dionysos, il fut puni par le dieu (µn ¤bristPVkaa 3sebQV DionAsou, dBkhn Escen Ck to¢ qeo¢) ».
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
voir93. De surcroît, il a défié la norme en ne respectant pas la justerépartition des rôles sexués, en négligeant sa qualité d’homme et sonstatut de roi. Cela justifie précisément la mort infâme de cet 5dikoV,de ce « coupable artisan de manœuvres coupables » dit le chœur94.Ainsi, en se travestissant, Penthée procède en réalité à sa toilettefunèbre95.
Les différents aspects, contradictoires parfois, de l’effémination etdu travestissement masculin mis en évidence par l’analyse des Bac-chantes d’Euripide se retrouvent dans d’autres récits : initiation, ruse,séduction, grotesque, risque de mort. Il conviendra d’y releverd’éventuels écarts. Ainsi, j’étudierai les différentes représentations del’efféminé et du travesti dans le discours comique puis dans desrécits ayant trait aux adolescents et, dans une moindre mesure, auxadultes.
LE GROTESQUE CHEZ ARISTOPHANE :EFFÉMINÉS ET TRAVESTIS
96
Suzanne Saïd a montré qu’il existe « sur la scène comique dessignes conventionnels de la virilité et de la féminité »97. Aristophane,qui met en scène des personnages efféminés et des hommes travestis
Les atours féminins des hommes 753
93. Euripide, ibid., v. 912 sq. Pour un parallèle romain, voir le scandale causé par Clodiussurpris déguisé en femme au milieu des matrones lors de la fête civique et exclusivement fémininede Bona Dea, alors qu’il cherchait à séduire la femme de César. Sur ce sacrilège suivi d’un procèspour impiété (Cicéron, Sur la réponse des haruspices, 17 ; Plutarque, César, IX-X) : John Percy VyvianDacre Baldson, Fabula Clodiana, Historia, 15, 1966, p. 65-73 ; Philippe Moreau, Clodiana religio. Unprocès politique en 61 av. J.-C., Paris, Les Belles Lettres, 1982 ; Ariadne Staples, From Good Goddess toVestal Virgins. Sex and Category in Roman Religion, Londres-New York, Routledge, 1998, p. 13-43.
94. Euripide, ibid., v. 1042.95. Ibid., v. 827 et 857-858.96. Sur le féminin et le masculin et l’inversion des rôles sexués chez Aristophane : Edmond
Lévy, Les femmes chez Aristophane, Ktéma, 1, 1976, p. 99-l12 ; Michelle Rossellini, Suzanne Saïdet Danièle Auger, Les Cahiers de Fontenay (Aristophane : Les femmes et la cité), 17, décembre 1979, p. 11-32, 33-70 et 71-102 ; Froma I. Zeitlin, Travesties of Gender and Genre in Aristophanes’ Thesmo-phoriazouae, dans Reflections of Women in Antiquity, Helene P. Foley éd., New York, London, Paris,Gordon and Breach Science Publishers, 1981, p. 169-217 ; Helene P. Foley, The Female IntruderReconsidered : Women in Aristophanes’ Lysistrata and Ecclesiazouae, Classical Philology, 77, 1982,p. 1-21 ; Nicole Loraux, L’acropole comique, dans Les enfants d’Athéna, op. cit., p. 157-196 (n. 3) ;Id., Aristophane et les femmes d’Athènes : réalité, fiction, théâtre, Metis, VI, 1-2, 1991, p. 119-130 ; Id., Aristophane, les femmes d’Athènes et le théâtre, dans Entretiens sur l’Antiquité classique,t. XXXVIII, Vandœuvres-Genève, 19-24 août 1991, p. 203-243 ; Anne-Britt Høibye, A Joke withthe Inevitable : Men as Women and Women as Men in Aristophanes’ Thesmophoriazousai andEkklesiazousai, dans Greece & Gender, op. cit., p. 43-54 (n. 1).
97. Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane, op. cit.,p. 229 (n. 14).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
en femmes, ainsi que des femmes travesties en hommes, joue de cessignes en les détournant. Ainsi, apparaissent sur la scène comiquenombre de personnages sexuellement ambigus.
Les efféminés d’Aristophane
Agathon, Clisthène et Dionysos sont trois des principaux person-nages efféminés d’Aristophane.
Le poète tragique Agathon, dans les Thesmophories, est le typemême de l’efféminé. Il n’a pas l’air d’un homme (3nPr) et se pré-sente sur la scène avec les atours de la courtisane Cyrène98. À la vuede ce jeune homme (neanBskoV), le Parent Mnésiochos s’exclame :« D’où sors-tu, toi l’efféminé (gAnniV) ? Quelle est ta patrie ? Quel estce costume (stolP)99 ? Qu’est-ce que ce méli-mélo ? Pourquoi ce dia-logue entre une lyre et une tunique safranée (krokwtpV) ? Une peaude faon et une résille (kekrAfaloV) ? Une fiole à huile et un bandeau(strpfion) ? Tout cela ne s’accorde guère. Qu’est-ce que viennentfaire ensemble un miroir (katpptron) et une épée ? Toi-même, monenfant, qui es-tu ? Es-tu un homme ? Alors où est ta verge ? Où estton pardessus (clabna) ? Où sont tes chaussures à la spartiate (lakw-nikaB) ? Es-tu une femme ? Alors où sont tes seins ? »100 Personnagepour le moins équivoque, Agathon, quoique dépourvu de seins,porte des habits et objets spécifiquement féminins. Le crocote estune tunique safranée et constitue l’arme majeure de la séductionféminine101. Dans les Thesmophories, dans les Grenouilles et l’Assembléedes femmes102, il est porté soit par des efféminés soit par des hommesdéguisés en femmes. La résille qui orne la chevelure et le bandeauqui sert à retenir la robe et tient lieu tout à la fois de ceinture et desoutien-gorge sont des accessoires féminins par excellence, de mêmeque le miroir103. En revanche, Agathon ne revêt ni vêtements, nichaussures typiquement masculins. Il le justifie de la façon suivante :« Moi je porte un costume en rapport avec mon esprit. Car il sied,quand on est poète, d’avoir égard aux pièces que l’on compose et
754 Florence Gherchanoc
98. Aristophane, Thesmophories, v. 97-98.99. Réplique exacte tirée d’Eschyle, Edoniens, fr. 61 Radt (voir note 18).
100. Aristophane, Thesm., v. 136-143.101. Voir Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane,
op. cit., p. 226.102. Aristophane, Thesm., v. 138, 253, 941 et 945 ; Grenouilles, v. 46 ; Assemblée des femmes,
v. 332.103. Voir Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane,
op. cit., p. 226. À Athènes, au Ve siècle avant notre ère, le miroir est un accessoire et un emblèmeféminin essentiel. Aussi féminise-t-il l’homme qui le porte : Françoise Frontisi-Ducroux et Jean-Pierre Vernant, Dans l’œil du miroir, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 55-60.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
d’y conformer ses façons. »104 Protéiforme, il s’habille selon les rôlesdramatiques qu’il crée105. En outre, il affirme se rapprocher de latenue des poètes lyriques Ibycos, Anacréon et Alcée qui portaientdes bandeaux et avaient des vêtements d’une somptuosité touteionienne106. Enfin, précise-t-il, chacun doit composer en accord avecsa propre nature (fAsiV)107. Comme le remarque, Froma I. Zeitlin,« la clef de cette apparente confusion entre mimêsis comme imitation,comme endossement d’habits, et mimêsis qui harmonise le corps,l’esprit et la poésie, réside dans le fait qu’Agathon est effectivementpar nature un homme efféminé, exactement le genre d’homme dontAristophane aime se moquer. C’est pourquoi, ce qu’il imite(l’apparence féminine) est, en effet, en harmonie avec sa nature etses manières »108 Outre ses vêtements et les objets typiquement fémi-nins qu’il porte, ses traits, sa physionomie disent aussi son effémina-tion. Il a une jolie figure (e£prpswpoV), il est pâle (leukpV) rasé(Cxurhm@noV) et délicat (4palpV), agréable à regarder (e£prepQV cdebn).Enfin, il est doué d’une voix de femme (gunaikpfwnoV)109. Par opposi-tion à Euripide qui est chenu et barbu (polipV kaa p:gwn), il n’est nibrun (m@laV) ni vigoureux (karterpV) et est glabre (o£k dasup:gwn)110.L’un est un adulte accompli, l’autre est encore un jeune homme.Mais un jeune homme qui volontairement renforce, accentue saféminité. À son nom, les spectateurs attendent un homme et voientun mâle à l’allure de femme111. De même, quand le coryphée voitaccourir Clisthène, il annonce la venue d’une femme112. Et, c’estbien cet écart qui prête à rire. Sur la scène comique, Agathon al’identité de l’efféminé et de la femme – mais d’une femme ina-chevée –, par sa tenue, ses traits, son attitude sans doute et sa voix.Euripide songe à le travestir en femme (´V dok²n einai gunP) en lerevêtant d’un costume de femme (stolQ gunaikqV) pour qu’ils’introduise incognito (l0qrÄ)113 parmi elles, alors qu’elles célèbrent les
Les atours féminins des hommes 755
104. Aristophane, Thesm., v. 148-150.105. C’est une première démonstration de la théorie mimétique de l’art, même si elle est
absurde : Froma I. Zeitlin, Travesties of Gender and Genre in Aristophanes’ Thesmophoriazouae,op. cit., p. 177.
106. Aristophane, Thesm., v. 160 sq. Sur les liens entre tenue ionienne et tenue féminine ausujet des mœurs de l’élite athénienne : Jane MacIntosh Snyder, Aristophanes’ Agathon as Ana-creon, Hermes, 102, 1974, p. 244-246.
107. Aristophane, Thesm., v. 159-172.108. Froma I. Zeitlin, Travesties of Gender and Genre in Aristophanes’ Thesmophoriazouae,
op. cit., p. 177-178.109. Aristophane, Thesm., v. 191-192.110. Ibid., v. 190 ; v. 30 sq. ; v. 33. Littéralement : il n’a pas « la barbe touffue ».111. Voir Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane,
op. cit., p. 230.112. Aristophane, Thesm., v. 571-572.113. Ibid., v. 185 ; v. 92 et 184.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Thesmophories, et parle en sa faveur. La part de féminité du poètetragique justifie ce choix. Il est déjà efféminé, ce qui rendrait laméprise plus facile et la ruse d’Euripide aurait toutes les chancesd’aboutir. Mais, le rôle lui convenant trop bien, l’inverti refusen’osant pas « ravir aux femmes leurs œuvres nocturnes et dérober laCypris féminine »114.
Dans cette comédie, le travestissement paraît une autre fois duressort de la ruse. Pour délivrer son vieux Parent attaché à unpoteau, Euripide se déguise en vieille femme (gr×dion) et prétends’appeler Artémisia115.
Clisthène, souvent associé à un dénommé Straton, est un autreefféminé type dans les pièces d’Aristophane. Il est résolument ducôté des femmes. Il en est semblable par ses joues sans barbe (gn0qoiyilaa), au mieux il a l’air d’un jeune garçon (pabV)116. Dans les Nuées,Socrate prétend qu’à sa vue, en imitatrices, les nuées deviennentfemmes117. Fou des femmes (gunaikomanPV)118, il appartient à leurfamille. Il en est l’ami (fBloV), la « parente par les mœurs(trppoV) »119. Dans les Acharniens, il est, avec Straton, comparé à uneunuque au « derrière rasé »120. Femme ou eunuque, son comporte-ment n’est pas conforme à son sexe. Cela justifie précisément laplaisanterie de Pisthétairos : « Et comment pourrait être bienordonnée une cité où une divinité femme se dresse armée de toutespièces, et Clisthène... d’une navette ? »121
Dionysos, dieu efféminé, entreprend, dans les Grenouilles, de des-cendre aux Enfers et, à cette fin, imite l’apparence extérieured’Héraclès, ce héros hyperviril, modèle du surmâle122, dont la des-
756 Florence Gherchanoc
114. Ibid., v. 204-205.115. Ibid., v. 1194, 1199, 1210 et 1216 ; v. 1200. Voir le commentaire de Nicole Loraux,
Aristophane et les femmes d’Athènes : réalité, fiction, théâtre, op. cit., p. 128 : « Peut-être cherche-t-il à se donner du courage, par ce recours au nom d’une femme plus courageuse que beaucoupd’hommes ; mais le courage d’Artémise était féminin en ce qu’il recourait à la ruse et, inventeurpatenté de ruses en tous genres, Euripide peut, grâce à cet embrayeur du monde à l’envers, se dis-penser de manifester la moindre andreia. Ce que le Scythe, sans doute obtus mais en la circons-tance inspiré, traduit en barbarisant définitivement le nom : Artamouxia (v. 1201) n’a plus grand-chose à voir avec Artémise. Et le rire de se relancer lui-même. »
116. Aristophane, Thesm., v. 575 et 582-583. Dans les Acharniens, v. 120-121, Clisthènedéguisé en eunuque porte une barbe postiche, ce qui rappelle qu’il est imberbe. Il est encore qua-lifié d’3g@neioV dans les Cavaliers, v. 1373-1374, tout comme Straton.
117. Aristophane, Nuées, v. 355. Il explique, ainsi, à Strepsiade pourquoi les nuées, une fois« dissipée la brume pluvieuse qui voile [leurs] formes immortelles » (v. 288-289), ressemblent à desfemmes et non, comme les nuées d’en haut, à des flocons de laine (v. 340-344).
118. Aristophane, Thesm., v. 576.119. Ibid., v. 574.120. Aristophane, Acharn., v. 117-122.121. Aristophane, Oiseaux, v. 829-831.122. Héraclès incarne certes un modèle de virilité ; mais, pour autant, ce héros n’est pas
dénué de féminité : Nicole Loraux, Héraklès : le surmâle et le féminin, Revue française de psychana-lyse, IV, 1982, p. 697-729 repris dans Les expériences de Tirésias, op. cit., p. 142-170 (n. 2) ; Héraclès, les
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
cente aux Enfers est célèbre123. Il apparaît, dès lors, vêtu d’unetunique safranée et d’une peau de lion, portant aussi cothurnes etmassue124. Ce dieu double, ainsi paré, devrait se conduire commeHéraclès : « Ne perds point de temps, mais tâte de cette portecomme ferait Héraclès avec son costume (scRma), aie son courage(lRma) », s’écrie Xanthias, son esclave porte-bagages125. Néanmoins,son comportement contredit son apparence. Ni belliqueux (m0cimoV),ni fier (ga¢roV), il reste « le plus lâche (deilptate) des hommes et desdieux »126. Sa couardise est telle que, de peur, il souille sa robe127. Ledéguisement de Dionysos ne lui confère aucune virilité. Aussi lecomique naît-il de cet écart qui subsiste entre le costume et lecaractère du dieu128. L’efféminé n’est pas comique déguisé enfemme ; il est drôle quand il joue un rôle d’homme. Ainsi, Héraclèss’exclame, à propos de Dionysos : « Non, pas moyen de chasserle rire, quand je vois une peau de lion par-dessus une crocotte !Que veut dire cela ? Que vient faire un cothurne avec unemassue ? »129 L’association de vêtements et objets, pour les uns fémi-nins (crocotte, cothurne), pour les autres propres au viril Héraclès(peau de lion, massue), provoque l’effet comique. Pour les mêmesraisons, on peut penser qu’Aristophane, dans les Thesmophories,préfère travestir un acteur viril en femme plutôt qu’Agathon déjàefféminé.
Non seulement les habits et l’apparence physique de l’efféminéprêtent à rire mais aussi ses manières d’être. L’homme efféminémanque de virilité et se conduit comme une femme : « Le fils deClisthène, ai-je ouï dire, parmi les tombeaux s’épilait le derrière etse déchirait les joues. Il se frappait la poitrine, l’échine courbée,gémissait et appelait en gémissant Sébinos, quelqu’un qui estd’Anaphlyste. On dit aussi que Callias, celui que vous savez, le filsd’Hipponicos, s’est mis une vulve en guise de peau de lion pour
Les atours féminins des hommes 757
femmes et le féminin. Actes du Colloque de Grenoble (22-23 octobre 1992), Colette Jourdain-Annequin etCorinne Bonnet éd., Bruxelles, Rome, Institut historique belge de Rome, 1996 et particulièrementl’article de Fernando Wulff Alonso, L’histoire d’Omphalè et d’Héraklès, p. 103-120, et celui deCorinne Bonnet, Héraclès travesti, p. 121-131.
123. Aristophane, Grenouilles, v. 108-111. La féminité de Dionysos est aussi liée à sa gour-mandise : au vers 200, il est qualifié de « ventru » (g0strwn). Comme le souligne Nicole Loraux,Héraklès : le surmâle et le féminin, op. cit., p. 151, chez Aristophane, cette appellation dénote clai-rement ailleurs la féminité du riche trop gras.
124. Aristophane, Grenouilles, v. 45-47.125. Ibid., v. 462.126. Ibid., v. 486 et 500 ; aussi v. 278-308 et 465-491. La lâcheté proverbiale de Dionysos est
déjà mentionnée dans Homère, Iliade, VI, 135 sq.127. Aristophane, Grenouilles, v. 307-308.128. Voir Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane,
op. cit., p. 232.129. Aristophane, Grenouilles, v. 45-47.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
livrer un combat naval. »130 Ainsi, le fils de Clisthène a hérité desmœurs de son père. D’abord, comme une femme, il s’épile. Enoutre, il manque de retenue et affiche son chagrin. Cette expressionféminine ou efféminée du deuil est contraire à l’image de l’idéalathénien de l’époque classique qui promeut des funérailles sobres etviriles131. Enfin, ses mœurs sont celles d’un inverti. Sebinos, le com-pagnon qu’il pleure, porte un nom à forte connotation sexuelle. Leverbe « binebn » désigne, en effet, « le fait d’avoir des rapportssexuels ». De plus, il appartient au dème d’Anaphlyste, littéralement« de l’attouchement »132. Attitude de femme lors d’un deuil et homo-sexualité sont du ressort du rire comme de la critique. D’unemanière générale, sous cette forme, la féminité des hommes estsource de réprobation. L’adulte efféminé est un lâche, taxé de sur-croît d’homosexuel passif. Aussi l’effémination de Clisthène est-elleliée à l’homosexualité et à la passivité133. Quant à Agathon, c’est un« enculé » (katapAgon) et un « large-cul » (e£rAprwktoV), « non pas
758 Florence Gherchanoc
130. Ibid., v. 422-430.131. Voir Florence Gherchanoc, Processions familiales dans l’espace civique. Le cortège
funèbre un exemple particulier de face à face entre famille et cité, Sources. Travaux historiques, 51-52,1997, p. 9 tout particulièrement. En fait, l’expression féminine du deuil est réprouvée dès l’époquearchaïque : cf. Archiloque de Paros, Fragment, 1 (traduction CUF modifiée) : « Les funérailles gémis-santes (KPdea stonpenta), Périclès, pas un de nos concitoyens ne songe à les blâmer : plus de joiedans nos banquets, ni dans les fêtes de la cité. – Mais rapidement, supportez vos souffrances (pre-nez courage) et repoussez le deuil féminin (gunaikebon p@ntoV). » Voir également les commentairesde Plutarque relatifs à la loi de Solon sur les funérailles à propos des démonstrations de douleurlors d’un deuil : « La plupart de ces interdictions subsistent encore dans nos lois : on y a mêmeajouté que les hommes qui se livreraient à de telles pratiques seraient punis par les “censeurs desfemmes”, puisqu’ils s’abandonnaient, dans le deuil, à des débordements et des égarements effémi-nés (gunaik²deiV), sans aucune virilité (3n0ndroi) » (Solon, XXI, 7). De l’époque archaïque àl’époque hellénistique, les excès dans le deuil sont jugés indignes d’un homme grec ; ils sont hon-teux car propres aux femmes et aux barbares. C’est encore ce qui ressort d’une loi lycienne sur ledeuil rapportée et commentée par Plutarque, Consolation d’Apollonios, 113 a : « Le législateur desLyciens... avait prescrit à ses concitoyens, lorsqu’ils mèneraient le deuil, de s’envelopper dans desvêtements de femme pour le faire : il voulait montrer par là que les marques de tristesse sontl’affaire des femmes et ne conviennent point à des êtres virils dont la vie est bien réglée et qui pré-tendent avoir reçu une éducation d’homme libre. C’est vraiment le signe d’un caractère efféminé,faible et sans noblesse, que de s’abandonner au deuil (qRlu g1r untwV kaa 3sqenAV kaa 3gennAV tqpenqebn) ; les femmes y sont plus portées que les hommes, les barbares plus que les Grecs, les hom-mes vulgaires plus que les hommes supérieurs... », et par Valère Maxime, Faits et dits mémorables,II. 6, 13 : « C’est pour cela que les Lyciens ont raison, quand ils se trouvent en deuil, de se mettredes vêtements de femmes, pour que l’indignité de cette tenue les pousse à vouloir se débarrasserplus vite d’une tristesse stupide. » Sur la législation relative au deuil des femmes, voir NicoleLoraux, Des mesures contre l’excès féminin, dans Les mères en deuil, Paris, Éditions du Seuil, 1990,p. 19-47.
132. Voir le commentaire d’Hilaire Van Daele, traducteur des Grenouilles, Paris, Les BellesLettres, 1991, n. 2, p. 106 ; Jeffrey Henderson, The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy,New Haven - Londres, Yale University Press, 1975, p. 210 et 220 (no 488) ; Anna M. Komor-wincka, Sur le langage érotique de l’ancienne comédie attique, Quaderni Urbinati di Cultura Classisa,38, 1981, p. 69-70.
133. Aristophane, Grenouilles, v. 49 et 56. Héraclès se demande si Euripide n’est pas animéd’une passion pour un homme adulte, tel Clisthène.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
verbalement, mais passivement ! (o£ tobV lpgoisin, 3ll1 tobVpaqPmasin) »134. La cible de ces persiflages indécents est l’homosexueladulte, efféminé et, qui plus est, passif135. Cette forme d’homo-sexualité est condamnée par les Grecs parce qu’ils la jugent infa-mante et contre nature136 ou, plus exactement, « contre genre ».L’efféminé contredit le caractère actif, la virilité de son sexe137. Dece fait, dans les comédies d’Aristophane, quand il n’y a plusd’hommes dignes de ce nom138, ceux-ci sont qualifiés de prostitués etd’enculés (laikastaB te kaa katapAgonai)139. Tels sont les orateurs etles hommes politiques comme Clisthène, comme Nicias qui a leteint pâle, comme Cléon qui se « fait passer pour un homme »,comme Agyrrhios l’efféminé et Antimachos140. Les noms de ceshommes indignes sont aussi parfois déclinés au féminin141. En défini-tive, tous les chefs du peuple sont féminisés et dénoncés comme deshomosexuels passifs. « Inversement, en leur virilité, les chefs dupassé méritent l’appellation de “culs noirs” »142. Ces derniers, lesmel0mpugoi, sont des hommes vaillants, aux « fesses noires » de poils(dasAprwktoi), par opposition aux efféminés qui s’épilent le der-rière143. Ainsi, « Aristophane retrouve une très ancienne traditiond’invective où l’on déprécie au féminin »144.
Les atours féminins des hommes 759
134. Aristophane, Thesm., v. 200-201. Pour d’autres allusions sexuelles : v. 35, 50, 59 sq., 133et 157 sq.
135. Voir Claude Calame, L’Éros dans la Grèce antique, op. cit., p. 153 sq. (n. 78) ; Jeffrey Hen-derson, The Maculate Muse, op. cit., p. 210 et 219-220.
136. Voir Claude Calame, ibid., p. 157 sq. ; David Cohen, Law, Society and Homosexualityin Classical Athens, Past and Present, 117, novembre 1987, p. 3-21.
137. Voir Eva Cantarella, Selon la nature, l’usage et la loi : la bisexualité dans l’Antiquité (traduit del’italien par Marie-Domitille Porcheron), Paris, La Découverte, 1991, p. 73-78.
138. Aristophane, Lysistrata, v. 524.139. Aristophane, Acharn., v. 79. Sur les « enculés » (katapAgonai) et les « débauchés » (kBnai-
doi) : James N. Davidson, Courtesans and Fishcakes. The Consuming Passions of Classical Athens, Londres,Harper Collins Publishers, 1997, p. 167-182.
140. Aristophane, Oiseaux, v. 829-831 ; A. F, v. 428 ; Cav., v. 392 ; A. F., v. 102-104 ; Nuées,v. 1015-1023.
141. Tels Smicythé pour l’efféminé Smicythos (Cav., v. 969), Cléonymè pour Cléonymos(Nuées, v. 680), Amynias pour Amynios qui n’a pas fait le service militaire (Nuées, v. 690-692). Voirle commentaire de Nicole Loraux, Aristophane, les femmes d’Athènes et le théâtre, op. cit.,p. 219 sq.
142. Nicole Loraux, ibid., p. 221.143. Voir Jean Taillardat, Les images d’Aristophane. Étude de langue et de style, Paris, Les Belles
Lettres, 1965, no 314, p. 166.144. Nicole Loraux, Aristophane, les femmes d’Athènes et le théâtre, op. cit., p. 221. Les arti-
sans, comparables par la blancheur de leur peau à des efféminés, sont également la cible desmoqueries d’Aristophane : « Il y avait une foule énorme de gens, comme jamais il n’en vint à laPnyx. Et vraiment ils nous faisaient tous l’effet de cordonniers, à les regarder. Non, mais c’étaitmerveille de voir comme l’Assemblée était pleine de visages blancs » (A. F., v. 384-387). Eschine,I, 131, use aussi d’arguments similaires pour déprécier son adversaire Démosthène : « De même,pour ce qui est du surnom donné à Démosthène, la renommée ne s’est pas trompée en l’appelantBatalos. Car c’est elle, et non pas sa nourrice, qui lui a donné ce nom, qu’il doit à ses mœurs effé-minées et corrompues (Cx 3nandrBaV caa ciadBV Cnegk0menoV to¥noma). Je ne doute pas, Démosthène,
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Les figures aristophanéennes de travestis
Dans ses comédies, Aristophane joue sur quatre ou cinq thèmes,qu’il superpose éventuellement les uns aux autres, le physique, latenue, les attributs (miroir, navette), la voix, le comportement, pourdire la féminité des hommes, pour susciter le rire et railler. Qu’ils’agisse d’un homme efféminé ou d’un homme travesti en femme,ces thèmes demeurent à peu près les mêmes.
Dans les Thesmophories, en désespoir de cause et pour aider Euri-pide, le Parent accepte d’être travesti en femme. Sous les yeux desspectateurs, Euripide « l’a flambé et épilé, et pour tout le reste il l’adéguisé en femme (·sper gunabk’ CskeAasen) »145. Tout d’abord, pourmodifier son corps, il le rase146. Sans barbe (yilqV), il aura l’air gra-cieux (e£prepQV) comme les femmes et les efféminés tels Agathon etClisthène147. Puis, il lui épile le sexe comme le font les femmes et lesefféminés148. Pour parachever la transformation, il le pare de vête-ments féminins (gunaikeBa stolP) : une robe safran (krokwtqV), unsoutien-gorge (strpfion) et, à la place de la résille (kekruf0loV) et dubandeau (mBtra), un tour de tête (kefalQ perBqetoV), un encycle(Egkuklpn) et des chaussures (klinBV)149. Ainsi dissimulé, il a l’appa-rence (eidoV) d’une femme150. Il lui reste à se comporter comme unefemme, à parler comme une femme (gunaikBzein)151, ce qui sembleêtre le plus difficile. En effet, de même que les femmes se sont trom-pées sur l’identité de Clisthène pris, de loin, pour une des leurs152,elles n’identifient pas l’imposture du parent d’Euripide. Ainsi, ni letravestissement visuel ni le déguisement de la voix ne sont percepti-bles aux femmes153. En revanche, Mnésilochos se trahit par un dis-cours misogyne et par son ignorance des pratiques religieuses fémi-nines154. Puis, déshabillé, son corps robuste et vigoureux (stibar0 kaa
760 Florence Gherchanoc
que, si quelqu’un s’avisait de t’enlever cet élégant petit manteau de laine fine (t1 komy1 ta¢taclanBskia), ces tuniques efféminées que tu portes (to¡V malako¡V citwnBskouV) pour écrire tes dis-cours contre tes amis, et de les faire passer sans avertissement entre les mains des juges, ces magis-trats en seraient à se demander s’ils touchent des vêtements d’homme ou de femme (eete 3ndrqVeete gunaikqV eclPfasin CsqRta).
145. Aristophane, Thesm., v. 590-591.146. Ibid., v. 220-235.147. Ibid., v. 234-235.148. Ibid., v. 236-248. Pour les femmes : Lys., v. 89 et 151 ; Grenouilles, v. 516 ; A. F., v. 13.
Pour les efféminés : Acharn., v. 119 ; Grenouilles, v. 424.149. Aristophane, Thesm., v. 851 ; v. 255 ; v. 251, 254 et 638 ; v. 257-258 ; v. 261.150. Ibid., v. 266.151. Ibid., v. 268.152. Ibid., v. 571-572.153. Voir Nicole Loraux, Aristophane, les femmes d’Athènes et le théâtre, op. cit., p. 243.154. Aristophane, Thesm., v. 466-518 et 544-565 ; v. 626-633.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
karter0), l’absence de seins et son phallus qu’il tente de cacher envain l’identifient comme homme155. Néanmoins, bien qu’identifié etcondamné au carcan pour cela, il se fait passer pour la nouvelleHélène puis devient Andromède. Il revêt la robe de la première etles liens de la seconde156.
Comme le souligne Suzanne Saïd, dans les scènes de travestisse-ment, le comique naît de l’écart qui existe entre le costume et celuiqui le porte. Il disparaît à partir du moment où il y a adéquationparfaite entre le personnage et son déguisement157. Tout commel’efféminé qui cherche à être viril, l’homme déguisé en femme estsujet de raillerie, mais aussi objet de réprobation, de condamnation.Ainsi, comme il le fait avec Euripide qui se trouve affublé de vête-ments féminins158, Aristophane « dévirilise » ceux qu’il méprise,bafoue et expose à l’agression violente159. En outre, dans les Thes-mophories, le Parent travesti est sacrilège (3npsioV)160. Ses actes sontinjustes, ses manières impies161. Son travestissement en femme(gunaBkisiV)162 fait de lui un fourbe (pano¢rgoV)163. Cela vaut parcequ’il a perturbé le déroulement des Thesmophories, mais aussiparce qu’il a contrevenu aux exigences de son sexe. C’est pourquoi,pour montrer la vilenie de son imposture, le Conseil décide de lelaisser au pilori en habit féminin164. Dans la comédie, même si letravestissement est le ressort du rire, celui-ci représente, commedans la tragédie des Bacchantes, un danger. En effet, comme le rap-pelle Mnésilochos aux vers 941-942, le travestissement engendre lerire : « Je crains qu’avec ma robe safran et mon bandeau, vieuxcomme je suis, je ne prête à rire aux corbeaux que je vais régaler »– puisque le travesti se joue des normes sociales. Il engendre égale-ment la honte pour celui qui porte une tenue féminine alors qu’il estidentifié comme homme. Pour Mnésilochos, cet accoutrement infa-
Les atours féminins des hommes 761
155. Ibid., v. 639-640 et 643-648.156. Ibid., v. 849-851 ; v. 1010-1013. Sur le passage de la fiction comique à la fiction tra-
gique : Suzanne Saïd, Travestis et travestissement dans les comédies d’Aristophane, op. cit., p. 233.Sur le dialogue entre comédie et tragédie dans les Thesmophories : Froma I. Zeitlin, Travesties ofGender and Genre in Aristophanes’ Thesmophoriazouae, op. cit., p. 181 sq., qui attire aussi l’attentionsur la problématique de l’imitation et de la représentation qui associe le travestissement à laparodie mimétique des textes, le travestissement opérant au niveau visuel, la parodie au niveauverbal (p. 171 sq.).
157. Voir Suzanne Saïd, ibid., p. 231.158. Aristophane, Thesm., v. 1194, 1199, 1200, 1210 et 1216.159. Froma I. Zeitlin, Travesties of Geoder and Genre in Aristophanes’ Thesmophoriazouae,
op. cit., p. 180.160. Aristophane, Thesm., v. 668.161. Ibid., v. 668 sq. et 718 sq.162. Ibid., v. 863-864.163. Ibid., v. 858, 893 et 944.164. Ibid., v. 943-944.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
mant ajoute une humiliation supplémentaire à celle d’être attachéau poteau. Le travestissement d’un homme en femme est ainsiperçu comme une dégradation : « Quel est l’homme assez sot(SlBqioV) pour s’être laissé épiler ? »165 Cette perception négative dutravesti est également évidente dans l’Assemblée des femmes. Dans cettecomédie, les femmes ayant emporté les vêtements de leurs maris,Blépyros, l’époux de Praxagora, est contraint de revêtir « la petitetunique safranée (krokwtBdion) de sa femme » et de porter des chaus-sures de femmes (des persiques ou des cothurnes)166. Comme lerelève son voisin Chrémios, sa tenue ne s’accorde pas avec son sexeet prête donc au rire167. Mais pire, déguisé en femme, il est commemort : « Mais tu emportes mes vêtements, tu me jettes ton encycle,et tu pars en me laissant là comme un cadavre exposé ; il ne t’amanqué que de me couronner et de placer près de moi unlécythe », dit-il à son épouse168. Comme l’a montré Michelle Rossel-lini, dans la comédie, être transformé en femme ou être transforméen cadavre forment un tout169. L’homme travesti perd, pour ainsidire, son identité. Cette mort symbolique est en premier lieuassociée au silence, « parure des femmes ». C’est ce que souligneprécisément le dialogue qui s’engage entre Lysistrata et le commis-saire du peuple dans Lysistrata170. En effet, dans ce combat quioppose hommes et femmes, l’héroïne suggère que les femmes pren-nent désormais la parole à la place des hommes. Ce projet est« conçu comme un échange des rôles »171. Ainsi, Lysistrata invite lecommissaire à se taire172. Ce à quoi il rétorque : « Me taire pour toi,maudite ? pour toi qui portes un voile sur la tête ? Plutôt cesser devivre. »173 Se taire, c’est se travestir pour un homme et donc cesserd’être, mourir. Pour permettre cette transformation, Lysistratapropose au commissaire de changer de costume. Ce dernier sevoit offrir successivement un voile, un fuseau et une petite corbeillesymbolisant le tissage qui est l’occupation féminine par excellence.On lui ordonne aussi de rassembler les plis de sa ceinture et defiler en croquant des fèves174. Dès lors, « la guerre sera affaire des
762 Florence Gherchanoc
165. Ibid., v. 593.166. Aristophane, A. F., v. 331-332. Ce vêtement est aussi appelé TmidiploBdion au vers 318
et cit:nion au vers 374 ; v. 319 ; v. 346.167. Ibid., v. 328-334 et 374-375.168. Ibid., v. 536-538.169. Voir Michelle Rossellini, Lysistrata : une mise en scène de la féminité, op. cit., p. 17-18.170. Sur l’ensemble de la scène, voir le commentaire de Suzanne Saïd, Travestis et travestis-
sement dans les comédies d’Aristophane, op. cit., p. 234.171. Michelle Rossellini, Lysistrata : une mise en scène de la féminité, op. cit., p. 17.172. Aristophane, Lys., v. 527-528.173. Ibid., v. 530-531.174. Ibid., v. 537.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
femmes »175. « La logique de renversement induite par le travestisse-ment a amené les femmes à s’identifier psychologiquement auxmodèles virils. »176 Puis, pour mettre fin aux protestations du com-missaire du peuple, les femmes entreprennent de le changer encadavre et d’accomplir pour lui les rites funéraires177. Cette mortsymbolique est, enfin, associée à une perte de puissance. En effet,alors que Lysistrata déplore l’injustice sociale qui fait vieillir les fem-mes sans amour mais permet aux hommes déjà vieux d’épouser desjeunes filles, le commissaire s’identifie aux seconds et les excuse ens’écriant : « Mais tout homme encore capable d’érection (st¢saidunatqV)... »178 Lysistrata l’invite dès lors à mourir. On peut y voir unrapport d’équivalence entre la perte de puissance et la mort.L’homme travesti perd sa virilité ce qui fait de lui un impuissant.
Le travestissement comporte un risque évident : la mort, fût-ellesymbolique, ou encore une condamnation infamante. Ainsi, Mné-silochos, démasqué par les femmes et accusé d’impiété, estcondamné au carcan179, supplice déshonorant réservé aux seulsmalfaiteurs180. Pour un homme, s’affubler des attributs de la condi-tion féminine conduit à une négation de son identité et, par consé-quent, à la mort.
Effémination et travestissement travaillent sur un registre essen-tiellement visuel. Ambiguïté de l’apparence, aspect trompeur par leport d’emblèmes féminins, par l’attitude, et parfois le déguisementde la voix sont les registres sur lesquels joue Aristophane pour amu-ser. Néanmoins, le discours comique n’est pas neutre. Il suscite, cer-tes, le rire par la moquerie et la dérision. Mais il n’est pas non plusdépourvu de critiques féroces à l’encontre de tous ceux qui ont descomportements contraires aux normes sociales, politiques et reli-gieuses. L’efféminé est une femme inachevée, au mieux un adoles-cent ; c’est un inverti sexuellement passif. Le travesti est un fourbe,un sacrilège. Tous deux disent la déviance, qu’il s’agisse ou non devilipender les hommes politiques, les orateurs et les auteurs tra-
Les atours féminins des hommes 763
175. Ibid., v. 532-538. C’est un retournement de la formule homérique, « La guerre seral’affaire des hommes », dans l’Iliade, VI, 492.
176. Michelle Rossellini, Lysistrata : une mise en scène de la féminité, op. cit., p. 18. Cf. Aris-tophane, Lys., v. 541-547 : « Je suis prête à tout entreprendre avec ces femmes pour l’amour dumérite (3retP) ; elles ont le génie, elles ont la grâce (c0riV), elles ont l’audace (qr0soV), elles ont lasagesse (sofpn), elles ont le patriotisme uni à la prudence (filppoliV 3retQ frpnimoV). »
177. Aristophane, Lys., v. 599-613.178. Ibid., v. 591-598.179. Aristophane, Thesm., v. 930-932.180. Voir Louis Gernet, Sur l’exécution capitale : à propos d’un ouvrage récent, Revue des
Études grecques, 37, 1924, p. 261-293 repris dans Droit et institutions en Grèce antique, Paris, Flamma-rion, « Champs », 1982, p. 175-211 ; Éva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines etfonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Paris, Albin Michel, 2000, p. 32-33.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
giques181. Pourtant, même la comédie établit une hiérarchie entrel’efféminé et le travesti. Apparemment, le comble de l’horreur pourun homme est de se déposséder volontairement des signes de sa viri-lité. Perdre ainsi son identité de mâle est comparable à la mort.
Le vêtement révèle autant qu’il cache. Néanmoins, plus que lestraits du visage et la physionomie générale du corps, il semble êtrele signe et la garantie de la distinction des corps sexués. Langage, il« est, au sens plein, un “modèle social”, une image plus ou moinsstandardisée de conduites collectives attendues, et c’est essentielle-ment à ce niveau qu’il est signifiant »182. Ainsi, l’adoption du vête-ment de l’autre sexe est de l’ordre de la transgression : transgressionde l’identité sexuelle et surtout détournement de l’identité socialequi a pour corollaire la pente d’un pouvoir reconnu habituellementaux hommes.
Dans ces conditions, on comprend mieux que le danger inhérentau travestissement soit mis en avant aussi bien par le discours tra-gique que par le discours comique. Ce qui est au centre, c’est laperte d’identité par la mimêsis183. Cette idée est également développéepar Platon à propos du genre mimétique184. Ce dernier, en effet,réfléchit au rapport entre le modèle et la copie. La question ouver-tement posée est celle de la nature du « ressembler », de l’essence dela « semblance »185. Le philosophe voit, ainsi, dans l’imitation unemenace. Le risque encouru est de « prendre dans cette imitation
764 Florence Gherchanoc
181. Dans les Nuées, pour décrier les jeunes qui délaissent l’ancienne éducation aristocratiqueau profit de la nouvelle, Aristophane use des mêmes ressorts en les qualifiant d’efféminés :« Aucun, avec de molles inflexions de voix (o£d’ 5n malakQn furas0menoV tQn fwnPn...),n’approchait son amant en se prostituant lui-même par les yeux... » (v. 979-980), dit le Raisonne-ment Juste et s’adressant à Phidippide, un adolescent : « Si tu fais ce que je te dis et y appliqueston esprit, tu auras toujours la poitrine robuste, le teint clair, les épaules larges, la langue courte,la fesse grosse, la verge petite. Mais si tu pratiques les mœurs du jour, d’abord tu auras le teintpâle, les épaules étroites, la poitrine resserrée, la langue longue, la fesse grêle, la verge grande, la...proposition de décret longue ; il te fera tenir pour honnête tout ce qui est honteux, et pour hon-teux tout ce qui est honnête, et par surcroît il te souillera du vice immonde d’Antimachos »(v. 1009-1023). Dans le même ordre d’idée, Xénophon, République des Lacédémoniens, II, 1-4, compa-rant l’éducation athénienne à l’éducation spartiate, prétend que la première fait des jeunes desefféminés tandis que la seconde fait d’eux des hommes virils : « De plus, ils amollissent(4palAnousi) les pieds des enfants par l’usage des chaussures, ils efféminent (diaqrAptousi) leurcorps par des changements de vêtements ; pour la nourriture, ils la mesurent à la capacité de leurestomac... [À Sparte], au lieu d’amollir les pieds des enfants par l’usage des chaussures, Lycurguea prescrit de les affermir en les faisant aller nu-pieds ; ... Au lieu de les efféminer (diaqrAptesqai)par la façon de les vêtir, il a établi l’usage de les accoutumer à un seul vêtement pour toutel’année, pensant ainsi qu’ils seraient mieux prémunis à la fois contre le froid et la chaleur. »
182. Roland Barthes, Histoire et sociologie du vêtement, op. cit., p. 435.183. Sur la mimêsis : Froma I. Zeitlin, Travesties of Gender and Genre in Aristophanes’ Thes-
mophoriazouae, op. cit., p. 169-217.184. Voir Jean-Pierre Vernant, Image et apparence dans la théorie platonicienne de la mimê-
sis, Journal de psychologie, 2, avril-juin 1975, p. 133-160.185. Ibid., p. 135.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
quelque chose de la réalité » et cette imitation « tourne à l’habitudeet devient une seconde nature, qui change le corps, la voix,l’esprit »186. C’est pourquoi il ne faut pas permettre à « ceux qui sontdes hommes d’imiter une femme (gunabka mimebsqai) »187. Finalement,un homme qui revêt des atours féminins change de nature. Les dis-tinctions entre l’artifice et la nature sont abolies.
Néanmoins, quand l’effémination et le travestissement relèventde pratiques sociales, la question se pose peut-être différemment, enparticulier pour les adolescents.
PRATIQUES SOCIALES : RITES DE PASSAGE VESTIMENTAIRESET EXPÉRIMENTATION « NORMÉES » DE L’AUTRE
Se dissimuler
Se travestir, c’est se déguiser pour dissimuler sa véritable nature.L’artifice est là pour tromper. À cet égard, il n’est pas inutile derappeler certains épisodes narratifs des enfances de Dionysos etd’Achille.
Dans une des versions de l’enfance de Dionysos, le jeune dieu estporté en Eubée, chez Athamas et Ino, pour être élevé comme unefille : « Quand Dionysos est à terme, Zeus le met au monde, endéfaisant les sutures, et il le donne à Hermès. Celui-ci l’apporte àIno et à Athamas et les persuade de l’élever comme une fille (´Vkqrhn). Mais Héra, irritée, frappa le couple de folie. »188 Aussi traves-tir Dionysos est-il conçu comme un moyen efficace de le préserverdu courroux d’Héra.
Ce thème de l’enfance cachée de Dionysos est repris par d’autresauteurs qui, d’ailleurs, ne manquent pas de donner des descriptionsprécises de l’accoutrement féminin du dieu : « Alors que Bacchosgardait encore l’odeur de la couture génitrice, ils [la race velue desPhères] servirent et protégèrent l’enfance cachée de Dionysos(3qhPtoV DionAsoV)... Tantôt revêtant la forme mensongère d’unefemme, il ressemblait, dans ses vêtements de safran, à une jeune filleen fleur (gunaikeBhn for@wn yeudPmona morfPn mimhlQ kokrppeploV Cn
Les atours féminins des hommes 765
186. Platon, République, 395 d : « gna mQ Ck tRV mimPsewV to¢ einai 3polaAswsin... ecV Eqh te kaafAsin kaqBstantai kaa kat1 s²ma kaa fwn1V kaa kat1 tQn di0noian. »
187. Ibid., 396 a.188. Apollodore, III, 28. Voir Albert Henrichs, Changing Dionysiac Identities, op. cit., n. 62
de la p. 141 (n. 24).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
egmasi faBneto koArh 3rtiqalPV) ; cherchant à égarer l’esprit de lajalouse Héra, il faisait sortir de ses lèvres imitatrices une voix fémi-nine (qPluV cwP), il serrait ses boucles sous un voile parfumé (e¥odmoVkalAptra) et portait des habits féminins (qPlea p@pla) richementouvragés ; sur le milieu de sa poitrine, il mettait une écharpe et[... recouvrait] la ferme rondeur d’un sein avec un bandeau virginal(parqenBoV zwstPr) ; et, comme pour protéger sa virginité, il entou-rait ses reins d’une ceinture de pourpre (porfur@a mBtra). »189 Seshabits et sa voix le dissimulent. De plus, ainsi paré, le jeune dieu estclairement comparé à une jeune fille en âge de se marier : « Maisles rouges bottines de Bacchos le couard, ses robes efféminées teintesde pourpre, la ceinture de femme dont il entoure ses reins, nous lesgarderons pour ta sœur et épouse, pour Aphrogénie : ces fémininsprésents sont bien pour elle. »190
Achille, comme Dionysos, prend un aspect mensonger. En effet,parmi les épisodes connus de l’enfance d’Achille, il est celui de sonséjour à Scyros191. Dans cette version du mythe, le jeune Achille estconfié par sa mère à Lycomède, son grand-père maternel, pour qu’ilne participe pas à l’expédition contre Troie et évite ainsi une mortprématurée. Aussi, à partir de l’âge de neuf ans est-il élevé à Scyroscomme une fille : « Quand Achille eut neuf ans, Calchas annonçaque Troie ne pourrait être prise sans lui. Mais Thétis, qui savaitd’avance que, s’il participait à l’expédition, il devait fatalement ymourir, le cacha sous des vêtements de femme et, déguisé en fille, leconfia à Lycomède. » Pour se cacher (l0nqanein), il revêt ainsi uneforme mensongère (CyeAsato morf0n)192.
Le travestissement est une feinte193. Il s’agit de cacher Dionysoset le jeune Achille et ainsi de leur assurer la vie sauve.
766 Florence Gherchanoc
189. Nonnos de Panopolis, Dionysiaques, XIV, 143-167 ; Sénèque, Œdipe, 418-423 : « Tugrandis en déguisant tes formes et en imitant les vierges (simulata virgo) dont tu avais pris les blondscheveux et adopté, pour retenir ta robe, la ceinture jaune ; tu te plais depuis dans ces vêtementsefféminés et dans cette robe lâche à la traîne flottante. » Sur l’assimilation de Dionysos à unejeune fille nubile : voir supra, n. 24 et p. 750-751.
190. Nonnos de Panopolis, Dion., XX, 229-232.191. Cf. Apollodore, III, 174 ; Polygnote apud Pausanias, I, 22, 6 : « vécut à Scyros au milieu
des jeunes filles » ; mais aussi Suétone, Tibère, LXX, 5 ; Hygin, Fable, XCVI ; Stace, Achilléide, 1,v. 283 sq.
192. Apollodore, III, 174 : krAyasa CsqRti gunaikeBo ´V parq@non ; [Bion], Epithalame d’Achilleet de Deidamie, v. 15 ; v. 7.
193. Dans le même ordre d’idée, Achille Tatius, Le roman de Leucippé et Clitophon, VI, 1, 1, meten scène un jeune héros qui se voit offrir le peplos de la femme de Thersandre pour y dissimulerson visage (kl@pte tq prpswpon tÅ p@plÑ) et ainsi s’échapper de la prison où le mari, se croyanttrompé, l’a enfermé. En VI, 1, 3, Mélité, après l’avoir habillé comme elle (CskeAas@ me ´V Dauthn),commente : « Comme tu es encore plus beau (ìWV e£morfpteroV), dit-elle, avec cette robe C’estainsi que j’ai vu un jour Achille, sur un tableau... » (la beauté d’Achille et d’autres jeunes hommesest évoquée dans Chariton, Le roman de Chairéas et Callirhoé, I, 1, 3). Puis, après avoir été pris pourMélité par le gardien Pasiôn (VI, 2) et comparé à une bacchante par Sosthénès (VI, 5, 1), Clito-
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Néanmoins, ces épisodes de la vie de Dionysos et d’Achille serattachent également à la pratique du fosterage194. Envoyés au loin,ces jeunes gens sont nourris et élevés par d’autres que leurs parents– des pères de substitution qui font ainsi figure de nourriciers etd’éducateurs. Ils acquièrent auprès de ces derniers des qualités cons-titutives de leur identité et des pouvoirs importants, souvent sousla forme d’une initiation et à la faveur d’une période de retraiteet d’isolement dans la familiarité des divinités courotrophes195.Cette phase de leur vie les prépare à leur retour dans la maisonpaternelle, à leur accès à l’âge adulte comme à l’héritage et à lasuccession.
Mettre en valeur la virilité
Pour les adolescents, l’élément féminin sert également à définirleur masculinité. Ce thème majeur de la littérature est un topos.Nombre de récits mettent en scène, en effet, un jeune adolescentpris pour une jeune fille, mais qui fait montre de virilité, de force.
Par exemple, Achille, caché parmi les filles de Lycomède, a desactivités typiquement féminines : « Au lieu du maniement desarmes, il apprenait le travail de la laine ; avec une main blanche, ilaccomplissait les tâches qui conviennent aux vierges. » En outre, « ilavait l’apparence d’une jeune fille ; son air n’était pas moins fémininque l’air de ses compagnes ; une pareille fleur rosissait sur ses jouesblanches comme neige, sa démarche était celle d’une vierge, unvoile couvrait ses cheveux. Mais il avait le cœur d’un homme, etd’un homme il avait les désirs amoureux »196. Ses occupations, sonapparence (traits du visage, teint), sa démarche et ses habits sontféminins et contredisent, pour qui sait voir, sa masculinité signifiéeici par des pulsions érotiques viriles. Dans d’autres récits, sa virilité
Les atours féminins des hommes 767
phon est reconnu et emprisonné en attendant une action pour adultère (VI, 5, 1). Le vêtementféminin de Clitophon renforce sa beauté « toute féminine », mentionnée, néanmoins, précédem-ment par Mélité comme trait négatif (V, 25, 8) : la jeune femme, amoureuse de Clitophon, dont ledésir est frustré, l’accuse d’être un eunuque et un homme efféminé (e£no¢coV kaa 3ndrpgunoV). Sasupercherie est découverte. Mais, à la différence d’Achille, le jeune homme ne met pas ainsi envaleur sa virilité. Bien au contraire, comme le suggère Sophie Couraud-Lalanne, Héros et héroïnes duroman grec ancien. Étude d’une paideia aristocratique à l’époque impériale, thèse de doctorat, Paris I, 1999,en particulier Clitophon : anti-héros ou « chasseur noir », p. 297-308, Clitophon est une figured’anti-héros. C’est un héros médiocre, voyeur, le seul à être infidèle et échouant à peu près danstoutes les épreuves de son initiation.
194. Sur le fosterage : Mireille Corbier (dir.), Adoption et fosterage, Paris, De Boccard, 1999 etsurtout l’article célèbre de Louis Gernet, Fosterage et légende, dans Mélanges Gustave Glotz, t. 1, Paris,PUF, 1932, p. 385-395, repris dans Droit et société, Paris, Recueil Sirey, 1955, p. 19-28.
195. Voir Henri Jeanmaire, Chiron, dans Mélanges Henri Grégoire, Bruxelles, 1949, p. 261.196. [Bion], Épithalame d’Achille et de Deidamie, v. 15-20.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
se révèle par le fait qu’il ne résiste pas à la vue d’une arme197 oudans une autre variante : « Ulysse, qui cherchait Achille chez Lyco-mède, où sa présence lui avait été signalée, le découvrit en faisantsonner la trompette. Et c’est ainsi qu’Achille alla à Troie. »198 Ainsi,bien qu’élevé et déguisé comme une fille, la nature du jeune hommereprend le dessus. En fait, l’ensemble des textes joue sur l’antinomieentre la physionomie de l’adolescent, éventuellement son comporte-ment, et son être.
Tel est aussi Parthénopée l’Arcadien, l’un des chefs argiensqui a l’air d’une jeune fille. On lui prête un « gracieux visage(kallBprÅroV), [d’]homme-enfant (3ndrppaiV 3nPr), dont le duvet del’adolescence commence à percer les joues et à croître en touffesépaisses »199. Mais précise le messager : « Son cœur n’a rien des vier-ges dont il porte le nom et c’est avec un œil farouche qu’ils’approche. »200 Cet adolescent sur le point de devenir adulte est unguerrier féminin mais vaillant201.
Deux épisodes de la vie de Thésée conduisent à la même conclu-sion. Avant d’aller en Crète combattre le Minotaure, Thésée, dit-on,substitue à deux jeunes filles désignées par le sort, « deux adoles-cents de ses amis, qui étaient d’apparence féminine et délicate (qhlu-fanebV sfqRnai kaa nearoAV), mais dont le cœur était viril et ardent(3ndr:deiV dA tabV yucabV kaa proqAmouV) »202. Plus tard, le jeunehéros, de retour à Athènes, « vêtu d’un vêtement long (cit:npodPrh), ses cheveux (kpmh)... tressés avec élégance (CV e£prep@V) »,passe devant le Deiphinion en construction et se fait taquiner par lesouvriers. Ces derniers lui demandent pourquoi une jeune fille nubile(parq@noV An ·rÄ g0mou) se promène toute seule. En guise deréponse, Thésée lance un chariot qui se trouvait là plus haut que letoit du temple qu’ils construisaient203. Une fois encore, l’accent porte
768 Florence Gherchanoc
197. Stace, Achilléïde, I, v. 852 sq. Voir Bruno Bettelheim, Les blessures symboliques. Essaid’interprétation des rites d’initiation (traduction de l’anglais par Claude Monod), Paris, Gallimard,« Tel », 1972 (1954), p. 132-148.
198. Apollodore, III, 174.199. Eschyle, Les sept contre Thèbes, v. 532 sq.200. Ibid., v. 535 sq. : « x d’;mpn, o¥ti parq@nwn Cp:numon frpnhma, gorgqn d’ um_ Ecwn,
prosBstatai. »201. Voir Jan Bremmer, Dionysos travesti, op. cit., p. 197 (n. 24).202. Plutarque, Thésée, XXIII, 3.203. Pausanias, I, 19. 1. Voir Fritz Graf, Apollon Delphinios, Museum Helveticum, 36, 1979,
p. 2-22 ; Claude Calame, Thésée et l’imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce ancienne, Lausanne,Payot, 1990, p. 229 sq. et 319-322. D’après Claude Calame, ibid., n. 105, p. 277, il est aisé de liredans la version tardive du bœuf projeté par Thésée un transfert dans la légende du rite de« l’élévation du bœuf » accompli par les éphèbes athéniens avant plusieurs sacrifices officiels (voirChrysis Pelekidis, Histoire de l’éphébie attique, des origines à 31 av. J.-C., Paris, De Boccard, 1962,p. 223). Dans le même ordre d’idée, Plutarque, De gloria Atheniensium, 346 a, rapporte à proposd’un tableau peint par Parrhosios que Thésée semblait avoir été nourri de pétales de roses.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
sur la contradiction entre l’apparence trompeuse et la nature pro-fonde des adolescents.
Aussi, dans les Idylles de Théocrite, le jeune Pollux au teint ver-meil (ocnwppV) et au physique efféminé (gAnniV) corrige-t-il l’arrogantet colossal boxeur Amycos qui méprise sa frêle apparence204. Deséléments comparables se retrouvent dans l’histoire du boxeursamien Pythagore rapportée par Diogène Laerce : « Erathostène...nous apprend que notre philosophe était le premier Pythagore, celuiqui, au cours de la quarante-huitième Olympiade participa au pugi-lat cheveux longs (komPthV) vêtu d’une robe de pourpre (4lourgBV),fut exclu des combats de jeunes gens (pabdeV) et ridiculisé(cleuasqeBV), et qui alla alors combattre contre des hommes (5ndreV)et fut vainqueur. On en a pour preuve cette épigramme de Théé-tète : si tu entends, étranger, parler de Pythagore aux cheveux longs(komPthV), de Pythagore, le célèbre lutteur samien. »205
L’effémination est avant tout visuelle. Le costume, mais surtoutles traits du visage (visage gracieux, agréable, joues roses de Polluxet de Parthénopée), parfois la chevelure sont des marqueurs de laféminité. Néanmoins, l’ambiguïté physique de l’adolescent, sesatours féminins n’apparaissent jamais comme un trait négatif. Bienau contraire, cela le valorise et joue comme un révélateur de sonidentité, de sa personnalité à venir. Sa beauté toute féminine estgénéralement louée. Ses actes disent sa virilité. L’apparence phy-sique et éventuellement vestimentaire est trompeuse. Le comporte-ment de l’adolescent est conforme à ce qu’attend de lui une sociétéqui fait l’éloge de l’aristeia.
D’autres textes sont encore plus explicites et lient clairement letravestissement d’adolescents à une prouesse associée à la ruse. Eneffet, pour un adolescent, porter des atours féminins n’est pas sansrapport avec la ruse. Ainsi, le travestissement légendaire de deuxjeunes gens (neanBskoi), déjà efféminés, en jeunes filles avant ledépart de Thésée pour la Crète relève de la ruse. « Par des bainschauds, une vie à l’ombre, des lotions et des parures appliquées àleurs cheveux, à leur peau lisse, à leur teint, il [Thésée] les trans-forma autant qu’il put, il leur apprit aussi à imiter la voix, le main-tien, la démarche des jeunes filles, de manière à les rendre le pluspossible semblables à elles sans en différer en rien, puis il les glissaau nombre des jeunes filles, et personne ne s’en aperçut. »206 Il s’agitde gommer des traits et des comportements qui, pour les Grecs,
Les atours féminins des hommes 769
204. Théocrite, Idylles, XXII, v. 34 ; v. 69 ; v. 44-136.205. Diogène Laerce, VIII, 47-48. Voir Cecil Maurice Bowra, Asius and the Old-Fashioned
Samians, op. cit., p. 391-401 (n. 12).206. Plutarque, Thésée, XXIII, 3.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
sont masculins et de faire ressortir des éléments caractéristiques dela féminité : la physionomie (texture de peau lisse, teint clair, cheve-lure parfumée et parée), la voix et l’attitude (maintien et démarche),autant de signes extérieurs visibles et trompeurs, des artifices. Or,par définition, la femme n’est que ruse. Aussi, ces adolescents quiusent d’artifices ne se comportent-ils pas par ce simple fait commedes femmes ? De plus, la tromperie (apatè) souvent associée à unprincipe d’inversion (institutionnelle, sexuelle, etc.) est caractéris-tique de la période de passage de l’âge adolescent à l’état d’adulte,comme l’a montré Pierre Vidal-Naquet207. Dans ce cadre, le traves-tissement est un opérateur de virilité.
Le mythe d’Aspalis raconte, ainsi, les exploits d’un jeune adoles-cent déguisé en fille208. Il relate l’histoire d’Astygitès qui, encoreenfant (antBpaiV, µn), veut venger la mort de sa sœur, suicidée parpendaison de peur que le tyran de la ville ne l’enlève et ne la violecomme il avait l’habitude de le faire avec ses sujettes en âge de semarier. À cette fin, le jeune homme revêt les habits de sa sœur et,armé d’une épée qu’il a glissé le long de son flanc gauche,s’introduit dans la maison du tyran qu’il tue. Tous les citoyens célè-brent ce haut fait ; une statue est élevée en l’honneur d’Aspalis,désormais honorée sous l’épiclèse de Aspalis Ameilité Hécaergé 209.
D’une tradition relative au conflit opposant Athènes et Mégareau sujet de la possession de Salamine ressort un stratagème compa-rable qui conduit des adolescents à se déguiser en femmes :« Comme, avec Pisistrate, il [Solon] faisait voile vers Colias, il ytrouva toutes les Athéniennes en train d’offrir à Déméter le sacrificerituel. Il envoya alors à Salamine un homme de confiance, qui fei-gnit d’être un déserteur et proposa aux Mégariens, s’ils voulaients’emparer des premières femmes d’Athènes, d’embarquer avec lui,au plus vite, pour le Colias. Les Mégariens le crurent ; ils envoyè-rent des hommes en armes. Dès que Solon vit leur navire partir del’île, il demanda aux femmes de se retirer ; il ordonna aux jeuneshommes encore imberbes d’enfiler les vêtements, les coiffures et leschaussures de ces femmes (t²n dA newt@rwn to¡V mhd@pw genei²ntaVCndAmasi kaa mBtraiV kaa ¤podPmasi tobV CkeBnwn skeuasam@nouV), decacher sur eux des poignards, et d’aller jouer et danser devant lamer jusqu’au moment où les ennemis auraient débarqué et où le
770 Florence Gherchanoc
207. Voir Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir et l’origine de l’éphébie athénienne, Anna-les ESC, 23, 1968, p. 947-964, repris dans Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Formes de pensée etformes de société dans le monde grec, Paris, LD/Fondations, 1983, p. 151-174.
208. Antoninus Liberalis, Les Métamorphoses, XIII, avec le commentaire de Manolis Papatho-mopoulos, Ant. Lib., p. 102.
209. Ibid., 4-7.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
navire serait en leur pouvoir. Ainsi, fut fait. Les Mégariens se laissè-rent tromper par le spectacle. Ils approchèrent, et se jetèrent à l’envisur ce qu’ils prenaient pour des femmes (´V Cpa gunabkaV), tant et sibien que nul n’en réchappa ; ils furent tous tués. Quant aux Athé-niens, ils embarquèrent aussitôt, et s’emparèrent de l’île. »210
On trouve des éléments narratifs similaires dans la version mes-sénienne de la première guerre de Messénie rapportée par Pausa-nias211. Après avoir été violées par des Messéniens, alors qu’ellesfêtaient Artémis Limnatis, de honte, les jeunes Lacédémoniennes sedonnent la mort. Mais les Messéniens racontent que Téléchos, le roide Sparte, avait formé un complot pour renverser l’aristocratierégnante à Messène et pour conquérir le pays. Profitant de la réu-nion au sanctuaire d’Artémis Limnatis des seigneurs messéniens, leroi de Sparte choisit des jeunes hommes encore sans barbe (3g@neioineanBskoi) qu’il fit armer déguisés en jeunes filles (´V parq@nouV).Envoyés au temple d’Artémis, les jeunes gens s’introduisent auprèsdes Messéniens pendant leur sommeil pour les assassiner, mais sontdécouverts par leurs adversaires qui les tuent ainsi que Téléchos212.
Tous ces récits insistent sur le choix de jeunes hommes imberbes,encore porteurs de féminité et pour lesquels il est plus aisé d’inverserles signes extérieurs de la sexualité. Les armes constituent le seul élé-ment de leur virilité, mais demeurent cachées. Elles connotent ainsi laruse213. Les deux derniers textes montrent en outre que le travestisse-ment des adolescents a pour cadre une fête de femmes et est associé à
Les atours féminins des hommes 771
210. Plutarque, Solon, VIII, 4-6.211. Pausanias, IV, 4, 2 sq. Voir les commentaires de Claude Calame, Les chœurs de jeunes fil-
les en Grèce archaïque, I, op. cit., p. 254 sq. (n. 24).212. Angelo Brelich, Paides e Parthenoi, Rome, Edizioni dell’ Atenao, 1969, p. 164, no 156, a
rapproché le récit messénien et les scènes rituelles de travestissement.213. Une anecdote comparable est rapportée par Hérodote, VI, 18-20 : Alexandre, fils du
roi macédonien Amyntas, propose, par ruse, aux sept ambassadeurs Perses dépêchés par Darius,après son expédition en Scythie, de faire l’amour avec des femmes macédoniennes. Il « revêtit devêtements féminins (tv t²n gunaik²n CsqRti) des jeunes hommes imberbes (5ndraV leiogeneBouV) ennombre gal à celui des femmes, leur donna des poignards... Il fit asseoir à côté de chaque Perse unjeune Macédonien, donné pour une femme ; et les jeunes gens, lorsque les Perses tentèrent de lestoucher, les massacrèrent ». Tout féminins qu’ils semblent, exception faite des poignards qu’ilsportent, ces jeunes macédoniens font montre de virilité. Un récit de Polyen, 2, 3, 1, relatif àl’élimination des oligarques thébains et à l’expulsion de la garnison lacédémonienne de la Cadméepar des conjurés démocrates en 379/378, conduit à des conclusions comparables : lors d’un ban-quet organisé par le Spartiate Phoibidas, aux femmes sont substitués de jeunes hommes imberbes(3g@neioi neanBskoi) travestis en femmes (t1V t²n gunaik²n CsqRtaV 3llax0menoi), qui tuent Phoibidaset ses amis. Sur cet épisode, à propos du retour des Thébains exilés, cf. Xénophon, Helléniques, V,4, 4-6, qui raconte comment Phillidas élimine les polémarques enivrés en leur envoyant des jeunesgens déguisés en femmes. Voir les commentaires de Walter Burkert, Homo Necans. The Anthropologyof Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth (traduit de l’allemand par Peter Bing), Berkeley, Los Ange-les, Londres, University of California Press, 1983, p. 160-161 avec la note 118 ; Miltiade B. Hat-zopoulos, Imberbe et travesti, dans Cultes et rites de passage en Macédoine (Meletêmata 19, Athènes,1994), Paris, De Boccard, 1994, p. 81-82.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
une performance. Proche de certaines pratiques rituelles, le travestis-sement s’inscrit dans le long processus éducatif qui assure le passagedes futurs membres de la cité de l’enfance à l’âge adulte. En effet,« rituellement, le fait d’assumer pour une période limitée les caractè-res du sexe opposé est typique d’une phase de passage ; il signifie lerenversement de l’ordre caractéristique de la période qui, dans lesrites de passage, se situe entre le moment de la ségrégation et celui dela réintégration dans un ordre nouveau. Dans les mythes et les ritesde puberté, le travesti prend, au-delà de la fonction de renversementqu’il assume, une valeur particulière puisqu’il correspond àl’ambiguïté sexuelle que connotent souvent, aux yeux des Grecs, lespremières années de la puberté »214.
Ainsi, des travestissements festifs s’intègrent à des rites de pas-sage et manquent l’accession des adolescents à l’âge adulte215. ÀAthènes, par exemple, lors des Oschophories216, fête du début del’automne (le 7 du mois Pyanepsion) consacrée à Dionysos, deuxadolescents, les porteurs de rameaux de vigne chargés de grappespris parmi le genos des Salaminiens et travestis en femmes (kat1gunabkaV), mènent dans une procession un groupe choral composédes représentants des tribus athéniennes. Cette procession reprodui-rait celle que conduisit Thésée à son retour de Crète. La fête com-prend, en effet, une procession (parapompè) qui dirige ses membresdu sanctuaire de Dionysos au sanctuaire d’Athéna Skyras à Phalère.Elle est composée de jeunes gens (neanBai ou pabdeV avec à leur têtedeux garçons déguisés en filles (kat1 gunabkaV Cstolism@noi), deuxpaides amphithaleis (porteurs de rameaux)217 et portant les oschoi (jeunes
772 Florence Gherchanoc
214. Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, I, op. cit., p. 259.215. Miltiade B. Hatzopoulos, Imberbe et travesti, op. cit., p. 73-85, analyse quelques mythes
et rites assortis de travestissements à propos d’un culte en l’honneur de Dionysos Pseudanor enMacédoine. Voir aussi Voulia Lambropoulou, Reversal of Gender Roles in Ancient Greece andVenezuela, dans Greece & Gender, op. cit., p. 149-154 (n. 1).
216. Sur les Oschophories : Plutarque, Thésée, XXII, 4 ; 23, 2-4 ; Proclus, Chrestomathie apudPhotius, Bibliothèque, 321 b - 322 a ; Felix Jacoby, FGrHist, 328 F 14-16 (III b I (1954), p. 285-304 ;III b II, p. 193-222) ; Harpocration, s.v. sscofpria = FGrHist 334 F8 (II, p. 227, 5 sq., Dindorf) ;Souda, s.v. sscofpria ; Hésychius, s.v. sscofproi ; Bekker, Anecdota Graeca, I, p. 318, 22 sq. ;Athénée, XI, 495 F ; August Mommsen, Feste der Stadt Athens im Altertum : geordnet nach attischemKalender, Leipzig, Teubner, 1898, p. 36 et 278-282 ; A. R. Van der Loeff, De Oschophoriis, Mne-mosyne, 1915, p. 404-415 ; Ludwig Deubner, Attische Feste, Berlin, H. Keller, 1932, p. 142-146 ;Albert Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, II, Paris, Librairie E. Droz, 1938, p. 243-254 ; Henri Jeanmaire, Couroi et courètes, op. cit., p. 346-347, 524 et 588 (n. 59) ; Marie Delcourt,Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité dans l’Antiquité classique, Paris, PUF, 1958, p. 13-14 et 16-17 ; Paul Faure, Fonctions des cavernes crétoises, Paris, De Boccard, 1964, p. 170-172 ; Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir et l’origine de l’éphébie athénienne, op. cit., p. 164-168 et 276 ; HerbertWilliam Parke, Festivals of the Athenians, Londres, Thames and Hudson, 1986, p. 77-80 ; ClaudeCalame, Thésée et l’imaginaire athénien, op. cit., p. 128-129, 143-148 et 324-337.
217. Sur l’évolution du sens d’ « amphithalês » : Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir etl’origine de l’éphébie athénienne, op. cit., n. 57, p. 165.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
pousses). Plutarque explique la présence de deux travestis par le faitque Thésée emmena en Crète parmi les sept jeunes filles deux gar-çons déguisés en filles218. Elle comporte également une coursed’éphèbes qui part du temple de Dionysos pour aller jusqu’à Pha-lère. Le vainqueur boit la Pentaploa, un mélange d’huile, de vin, demiel, de fromage et de farine. Après les cérémonies du Phalère quicombinent des rites de réclusion et de deipnophorie (procession pouroffrir un repas), un kômos (cortège joyeux) de retour, précédé de liba-tions, revient vers Athènes ; le héraut, dit Plutarque, n’y est pas cou-ronné, c’est son caducée qui l’est : les cris de joie alternent avec lescris de deuil en commémoration de la mort d’Égée219. Cette fêteoppose clairement féminité et virilité. D’une part, le cortège associedeux travestis à des jeunes hommes qui ne le sont pas. D’autre part,à la procession « féminisée » répond la course des éphèbes – lacourse étant une activité virile par excellence220. Aussi Pierre Vidal-Naquet comprend-il le travestissement féminin comme un moyen dedramatiser l’accès du jeune homme à la virilité et à l’âge dumariage. Ce qui est important ce n’est pas la nature du travesti maisl’antithèse qu’il met en œuvre221. La même interprétation est pro-posée par Jan Bremmer : il y voit une pratique initiatique qui, pour-tant, n’a pas pour cadre une période de marge en un lieu sauvage.Néanmoins, les jeunes gens présents participeraient au changementde statut sexuel des deux adolescents habillés en filles222. Enrevanche, pour Claude Calame, ce rite est un exemple du boulever-sement des catégories sociales de Dionysos223. Mais, pourquoi ne pasconcilier ces deux explications ? En effet, s’il s’agit bien d’une initia-tion – même si cette interprétation n’est pas immédiate –, celle-ciserait le fait de deux adolescents qui, pour l’ensemble de leur classed’âge, ritualiseraient l’accès au groupe nubile. Il est vrai que le sanc-tuaire d’Athéna Skiras ne se trouve pas aux marges de la cité.Néanmoins, celui-ci est situé à la périphérie d’Athènes. De plus,cette fête dédiée à Dionysos pourrait, aussi, être mise en relationavec les domaines d’intervention de ce dieu de l’altérité. Les jeunesgens feraient l’expérience de l’autre, ce qui correspond à un « boule-
Les atours féminins des hommes 773
218. Plutarque, Thésée, XXIII, 2-4 ; Proclus, Chrestomathie apud Photius, Bibliothèque, 322 a, 88-91.219. Plutarque, ibid., XXII, 4.220. Sur l’opposition entre féminité et virilité lors des Oschophories : Pierre Vidal-Naquet,
Le chasseur noir et l’origine de l’éphébie athénienne, op. cit., p. 166.221. Ibid., p. 167-168 ; Henri Jeanmaire, Couroi et courètes, op. cit., p. 344 sq., pour lequel ces
rites symbolisent la fin des retraites estivales des jeunes gens.222. Voir Jan Bremmer, Dionysos travesti, op. cit., p. 195.223. Voir Claude Calame, Thésée et l’imaginaire athénien, op. cit., p. 335. Néanmoins, dans Les
chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, I, op. cit., p. 228-232 et 245, il intègre cette fête dans le cycledes initiations à Athènes.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
versement des catégories sociales », avant d’intégrer pleinement leuridentité de mâle. À cet égard, Pierre Vidal-Naquet a signalé le liend’Athéna Skiras avec la coutume du travesti. En effet, dans l’Assem-blée des femmes d’Aristophane, c’est aux Skira que Praxagora et sesamies décident de se déguiser en hommes224.
Ainsi, la prise symboliquement d’un habit féminin par un ouplusieurs jeunes gens à l’imitation d’un personnage légendaire signi-fierait non seulement la rupture avec un groupe et l’agrégation à unautre, mais aussi un passage durant lequel les adolescents fontl’expérience de l’autre pour mieux s’en séparer. Enfin, peut-être,comme le suggère Marie Delcourt, elle évoquerait la durée et lafécondité225, en particulier à l’approche du mariage.
Ces travestissements initiatiques sont transgressifs mais ils neremettent pas en cause l’ordre social, politique et religieux. Les ritesde passage vestimentaires, bien au contraire, sont là pour dire lanorme – norme que retrouve, en principe, le jeune homme aprèsune période d’inversion sexuelle par l’abandon des marques exté-rieures de sa féminité que sont les habits de femme226.
Se travestir et mourir
Dans la version messénienne de la première guerre de Messénie,le travestissement est lié à un acte de ruse puis de mort. Mais, faut-ilvoir dans la mort des jeunes Spartiates, à l’instar de Claude
774 Florence Gherchanoc
224. Voir Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir et l’origine de l’éphébie athénienne, op. cit.,p. 166.
225. Voir Marie Delcourt, Hermaphrodite, op. cit., p. 16-17 et 24. Les grappes sont un symbolesexuel ; µsch signifie grappe et sscP scrotum. Elles symboliseraient donc la durée et la fécondité.
226. Une fête spartiate conduit au même type d’analyse : des danseurs (sans doute des jeuneshommes qui exécutent des danses guerrières (polemikoa srchstai) portent des masques féminins ethonteux, grotesques (acscr1 proswpeba gunaikeba) et revêtent des vêtements féminins (gunaikebadm0tia), tout en chantant des hymnes. Cf. Hésychius, s.v. brualBktai, brullicistai, brudalBca ; voirSteven H. Lonsdale, Preparations for Manhood : Zeus, Athena and the Weapon Dance, dansDance and Ritual Play in Greek Religion, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press,1993, p. 137-168. En revanche, en accord avec Paul M. C. Forbes Irving, Metamorphosis in GreekMyths, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 153, les Ekdysia (fêtes de dépouillement) crétois et lesEndymata (prises d’habits) argiens ne semblent pas assorties de travestissements sexuels commecertains savants l’ont pensé, notamment Henri Jeanmaire, Couroi et courètes, op. cit., p. 442, MarieDelcourt, Hermaphrodite, op. cit., 4-5, Angelo Brelich, Paides e Parthenoi, op. cit., p. 202, Ken Dowden,Death and the Maiden, op. cit., p. 64 (n. 20) et David D. Leitao, The Perils of Leukippos : InitiatoryTravestism and Male Gender. Ideology in the Ekdysia at Phaistos, Classical Antiquity, 14, 1995,p. 130-163. En effet, les textes (Antoninus Liberalis, Métamorphoses, 17 ; Ephore, FGH, 70 F 149apud Strabon, X, 4, 21 (483) ; Inscr. Cret., I, XIX, l. 17-18 pour Malla et Lyttos ; Inscr. Cret., I, IX,l. 99-100 pour Dreros ; Inscr. Cret., II, v. 24, l. 7-9 pour Axos ; Ps. Plutarque, De mus., 9, 1134 C)ne le suggèrent pas. Ces deux fêtes comprennent certes un changement de vêtement, mais qui,dans les deux cas, substitue un habit d’adulte à celui de l’adolescent et marque ainsi la transitionde l’adolescence à l’âge adulte.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Calame, une mort initiatique avant leur renaissance comme hopliteparticipant à l’ordre du monde adulte ? Pour celui-ci, en effet, « lesMesséniens en eux ne tuent pas des hommes mais des femmes.Autrement dit, ils anéantissent l’aspect de jeune fille en ces adoles-cents qui quittent l’état d’indifférenciation sexuelle marquantl’enfance pour se préparer à leur insertion parmi les adultes »227.Cette thèse est séduisante. Néanmoins, ne peut-on pas rappelerqu’un acte de travestissement n’est pas sans danger et qu’il peutconsacrer l’échec de ce rite de passage si le subterfuge est découvert,comme dans le cas de Penthée et dans celui des Lacédémoniens.
Ce danger inhérent au travestissement masculin est également misen scène par le mythe de Leucippos, fils d’Œnomaos. Ce dernier, eneffet, pour approcher la nymphe Daphné qui fuit les hommes, et pours’introduire dans son cercle de compagnes, se déguise en jeune fille :« [Il] laissait pousser sa chevelure pour l’Alphée ; cette chevelure, il latressa comme une fille, mit un vêtement féminin (taAthn oja dQparq@noV plex0menoV tPn kpmhn kaa CsqRta CnduV gunaikeBan) et arrivaainsi jusqu’à Daphné. » Mais les jeunes adolescentes, découvrant laruse, tuent le héros travesti228. D’après Marie Delcourt, la fin tragiquede Leucippos semble transposer les dangers que courent les époux aumoment de leur première union et la crainte ancestrale devant l’actede défloration229. Mais l’échec de ce rite de passage, au moment del’entrée dans le groupe nubile, pourrait aussi renvoyer aux menacesqui pèsent sur celui qui, par ruse, se travestit volontairement.
Mieux accepté que celui des adultes, le travestissement de jeuneshommes en femmes comporte néanmoins un risque. Même pourdes adolescents, hommes inachevés, il semble dangereux de jouerdes ambiguïtés de son sexe.
Séduire et/ou s’unir
Comme l’a noté Marie Delcourt230, l’échange de vêtements estsouvent associé à un exploit et à une conquête de femmes. Entémoignent, entre autres, l’histoire d’Achille et celle de Leucippos.
Achille, bien qu’élevé comme une fille, laisse éclater ses pulsionsérotiques : « Élevé chez Lycomède, [il] a des rapports avec sa fille,Deidameia, et il lui naît un fils, Pyrrhos, celui qui fut appelé plus
Les atours féminins des hommes 775
227. Claude Calame, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, I, op. cit., p. 260.228. Pausanias, VIII, 20, 24 ; cf. aussi Parthenios, Erotica, 15. Voir Henri Jeanmaire, Couroi et
courètes, op. cit., p. 442.229. Voir Marie Delcourt, Hermaphrodite, op. cit., p. 9-11.230. Ibid., p. 18 sq.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
tard Néoptolème. »231 Ainsi, il use de ses artifices féminins pour laconquérir : « Parmi les filles de Lycomédès qui n’y prenaient pasgarde (o£k 3legoBsaiV), Deidamie dans son lit s’est unie à Achille »et, mentant, ce dernier met « tout en œuvre pour parvenir à parta-ger sa couche (p0nta d’ CpoBei speAdwn koinqn CV §pnon) »232. Sous destraits féminins, le jeune héros séduit la jeune fille. De même, maissans aller jusqu’à des rapports sexuels, Leucippos, déguisé en fille,met sous le charme Daphné par son aristeia censée être toute fémi-nine : « Il l’emportait sur les autres filles aussi bien par la noblessede sa naissance que par son adresse à la chasse » et « parce qu’ilusait envers elle d’une prévenance extrême. »233
La féminité est un opérateur de virilité. Néanmoins, pour lesadolescents, elle n’est pas sans rapport avec la séduction et la ruse. Ilsemble qu’il leur est plus facile d’approcher de jeunes vierges quandeux-mêmes se présentent sous des atours féminins. Est-ce à dire quepour un homme la séduction comme stratagème est du côté duféminin ? Est-ce à dire encore que les adolescentes en âge de semarier redoutent le mariage et l’enfantement ?
En outre, des fêtes, parce qu’elles intègrent un échange rituel devêtements, favorisent, pour chaque sexe, la participation momen-tanée à la nature de l’autre sexe dont il va devenir, en se séparant delui, le complément234. Ainsi en est-il de certaines fêtes de mariageassorties de travestissements rituels. En effet, le mariage marque,pour la jeune fille et pour le jeune homme (même si pour ce dernier,cela est moins évident), l’ « accomplissement » de leur nature respec-tive au sortir d’un état où chacun participe encore de l’autre235. Aussila mimêsis joue-t-elle un rôle considérable lors de ces mascarades occa-sionnelles. Ces travestissements rituels concernent les jeunes filles, parexemple, à Sparte où on leur coupe les cheveux ras et où on lesaffuble d’un habit et de chaussures d’homme le jour du mariage236.En revanche, à Cos, ce sont les futurs mariés qui revêtent un vête-ment de femme pour recevoir leurs fiancées. L’aition de cette pratiquesingulière est le suivant : de retour de Troie, Héra fit échouerHéraclès au cap Lakètèr. Le héros y affronte les Méropes. Mais, sub-mergé par leur nombre, il se réfugie chez une femme thrace, où il
776 Florence Gherchanoc
231. Apollodore, III, 174.232. [Bion], Épithalame d’Achille et de Deidamie, v. 8-9, 22 sq. et 25-26.233. Pausanias, VIII, 20, 3.234. Voir Jean-Pierre Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, La Découverte, 1988,
p. 39 ; Marie Delcourt, Hermaphrodite, op. cit., p. 37.235. Voir Jean-Pierre Vernant, ibid., p. 38.236. Cf. Plutarque, Lycurgue, XV, 5. Voir Georges Devereux, Greek Pseudo-Homosexuality
and the « Greek-Miracle », Symbolae Osloenses, 42, 1967, p. 76 et 84 ; Paul Cartledge, SpartanWives : Liberation or Licence ?, Classical Quarterly, n.s. 31, 1981, p. 84-105.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
échappe aux regards en se dissimulant sous un vêtement féminin.Plus tard, victorieux des Méropes et purifié, il épouse Kalkhiopè etrevêt un manteau brodé de fleurs. Le rituel du mariage à Cos com-mémorerait cet événement237, un stratagème lié à une union. La fuited’Héraclès chez une femme thrace et son déguisement féminin res-sortent de la ruse associée à une action d’éclat. Ils peuvent aussi rap-peler l’épisode de son séjour chez Omphale, reine de Lydie238. Deplus, les interférences du héros avec la sphère du féminin, en particu-lier par le port de vêtements de femmes, sont maintes fois attestées239.Enfin, cette histoire souligne que le mariage, dans un contexte initia-tique, est un des domaines particuliers d’intervention du héros240.
Ces récits lient clairement travestissement sexuel, action d’éclatet mariage241. Ils montrent aussi les risques inhérents à un travestis-sement. À cet égard, l’épisode du séjour d’Héraclès chez Omphale242
fait assez bien la synthèse de ces deux aspects du travestissement liéà des pratiques initiatiques. En effet, parce qu’il a tué de façondéloyale Iphitos, son hôte, Héraclès est condamné à être venducomme esclave à une femme, la reine de Lydie. Il endosse deshabits féminins, tandis qu’Omphale se pare de sa peau de lion etporte ses armes. Durant sa servitude, il accomplit néanmoins diversexploits qui conduisent la reine à reconnaître en lui le héros virilqu’il est. Dès lors, Omphale le libère, l’épouse et lui donne un fils.Cette histoire revêt, d’une part, une dimension initiatique243.
Les atours féminins des hommes 777
237. Cf. Plutarque, Questions grecques, 58.238. Sur le séjour d’Héraclès chez Omphale : Fernando Wulff Alonso, L’histoire d’Omphalè
et d’Héraklès, op. cit., p. 103-120 (n. 122) et Corinne Bonnet, Héraclès travesti, op. cit., p. 121-131(n. 122).
239. Voir Nicole Loraux, Héraklès : le surmâle et le féminin, op. cit., p. 49-53 et 142-170(n. 122).
240. C’est tout particulièrement vrai à Cos. Dans une inscription connue et datée duIIIe siècle avant notre ère « Le testament de Diomédon » (Rodolphe Dareste, Bernard Haussoulier,Théodore Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, II, Rome, L’Erma di Bretschneider,1965, XXIV, B, p. 94-102 : § 14 ; Rudolf Herzog, Heilige Gesetze von Kos, Berlin, Verlag der Aka-demie der Wissenschaften in Kommission bei W. De Gruyter U. Co, no 10, p. 28-32 ; SusanM. Sherwin-White, Inscriptions from Cos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 24, 1977, p. 210-213 et Ancient Cos. An Historical Study from the Dorian Settlement to the Imperial Period, Göttingen, Van-denhoeck & Ruprecht, 1978, p. 363-366), Diomédon institue un culte d’Héraclès et prévoit queses descendants pourront célébrer leur mariage dans l’enceinte sacrée.
241. Dans d’autres cas, les récits expliquent ces travestissements d’adolescents par le faitque quelqu’un porte atteinte à la chasteté de jeunes filles ou de femmes (épisode de Thésée enCrète, mythe d’Aspalis, version messénienne de la première guerre de Messénie, la rused’Alexandre de Macédoine, mentionnés plus haut) ; ils donnent aussi parfois l’étiologie de ritesqui se concluent par des mariages collectifs. Voir Miltiade B. Hatzopoulos, Imberbe et travesti,op. cit., p. 77-85.
242. Cf. Apollodore, II, 127-134 ; Diodore de Sicile, IV, 31 ; Plutarque, 785 E.243. Sur les liens entre Héraclès, la dimension initiatique et le féminin : Marie Delcourt, Her-
maphrodite, op. cit., p. 5-27 et 33-39 ; Angelo Brelich, Paides e Parthenoi, op. cit. ; Nicole Loraux, Héra-klès : le surmâle et le féminin, op. cit. ; Colette Jourdain-Annequin, Héraclès aux portes du soir. Mytheet histoire, Besançon-Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 379 sq. et 457.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Comme le rappelle Corinne Bonnet244, Héraclès est le paradigmemythique de l’initié, celui qui patronne les rites d’initiation des jeu-nes gens. Ces performances (son action contre les Cércopes, lemeurtre de Sylée, l’enterrement d’Icare, etc.)245 le réintègrent dansson rôle social et dans son identité sexuelle ; elles se concluent parun mariage. Mais, les épisodes qui entourent le séjour du héros chezla reine de Lydie symbolisent, d’autre part, la peur masculine de laféminisation. Sa soumission à Omphale l’avilit à tel point qu’elledétruit son identité héroïque246. En fait, dans ce lieu lointain et auxmarges qu’est l’Orient pour les Grecs247, Héraclès, travesti et soumisà Omphale, subit avec succès une initiation. En effet, au terme deson séjour dans ce lieu de perdition et de déchéance – puisque c’estle lieu du renversement des valeurs où hommes et femmes échan-gent leurs rôles –, victorieux, il épouse cette femme puissante etfonde une dynastie.
Faire l’expérience ritualisée de l’autre248
Henri Jeanmaire249 donne à l’échange de vêtements lié à desrituels matrimoniaux une valeur négative, qui est accessoirement detromper les puissances malfaisantes dont l’hostilité est à redouterdans une période critique et, essentiellement, au terme du rite depassage, de dépouiller le garçon de toute essence féminine aumoment de l’agréger à une vie nouvelle.
Ainsi, les garçons font l’apprentissage de leur identité sociale aucours du mariage. Mais le travestissement semble aussi avoir une
778 Florence Gherchanoc
244. Voir Corinne Bonnet, Héraclès travesti, op. cit., p. 123.245. Pour les références à ces exploits, voir Fernando Wulff Alonso, L’histoire d’Omphalè et
d’Héraklès, op. cit., p. 108 sq. Héraclès capture les Cércopes et les emmène après les avoir accro-chés, la tête en bas, sur un bâton et après les avoir mis sur son épaule. Dans cette drôle de posi-tion, ils se mettent à rire et en donnent l’explication suivante à Héraclès étonné : leur mère leuravait dit de se méfier d’un melamp¢goV, littéralement, d’un « postérieur noir ». D’après FernandoWulff Alonso, ibid., p. 109 : « La plaisanterie obscène repose sur la vue du postérieur d’Héraclèsqui ferait penser à des organes génitaux féminins. » Néanmoins, il me semble que melamp¢goV estutilisé ici pour signifier la virilité d’Héraclès et non sa féminité et souligner la contradiction entredes habits féminins et justement un derrière viril, non épilé. Voir les remarques sur les « culsnoirs » d’Aristophane, p. 759.
246. Cette thèse est notamment développée par Fernando Wulff Alonso, ibid., p. 103-120.Voir aussi Elmer G. Suhr, Herakles and Omphale, American Journal of Archaeology, 57, 4,octobre 1953, p. 251-263.
247. Sur ce point : Corinne Bonnet, Héraclès travesti, op. cit., p. 127.248. Comme le remarque François Lissarrague, Femmes au figuré, dans Histoire des femmes, I,
Pauline Schmitt-Pantel (dir.), Paris, Plon, 1991, p. 241 : « Un des termes de cette expérimentationde l’Autre semble bien être le monde féminin ; en se travestissant, l’homme se fait momentané-ment femme, par plaisanterie. Preuve supplémentaire que la femme constitue bien aux yeux del’homme athénien une des variantes de l’altérité. »
249. Voir Henri Jeanmaire, Couroi et courètes, op. cit., p. 352.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
valeur positive : il dit la norme, définit cette indispensable différencedes sexes qui sert à penser la répartition des rôles sexués en mêmetemps qu’il permet de s’approprier les vertus de l’autre sexe.
À cet égard, une fête chypriote indique encore le rôle importantde la mimêsis lors de ces initiations de jeunes hommes. Il s’agit d’unefête en l’honneur d’Ariane durant laquelle un jeune homme imite unenfantement. Plutarque en fournit l’étiologie250. Après que Thésée aabandonné Ariane enceinte sur l’île de Chypre, celle-ci meurt sansavoir pu accoucher et est ensevelie par les femmes du pays quil’avaient recueillie et avaient pris soin d’elle. De retour, « il éprouvaun violent chagrin et laissa aux gens du pays une somme d’argent, enleur demandant d’offrir un sacrifice à Ariane ; il érigea égalementdeux petites statues, l’une d’argent, l’autre de bronze. Durant cesacrifice, qui se déroule le deux du mois Gorpiaios, un jeune hommecouché pousse des cris et imite les mouvements des femmes en cou-ches (kataklinpmenpn tina t²n neanBskwn fq@ggesqai kaa poiebn 7per;dBnousai gunabkeV). Les habitants d’Amathonte nomment “boisd’Ariane Aphrodite” le bois sacré où ils montrent son tombeau...C’est dans la joie et les amusements qu’on fête la première (tË mAng1r Tdom@nouV kaB paBzontaV Dort0zein)... ». Lors de cette joyeuse mas-carade, un jeune homme est choisi par la communauté pour mimerun accouchement. Fête de fécondité pour sûr, elle est aussi un moyenpour le jeune homme de faire l’expérience de l’autre, du féminin,tout en s’appropriant de façon grotesque le processus d’enfantement,de la grossesse à l’accouchement. Tout en intégrant en lui le principede fécondité, le jeune homme est initié aux fonctions qu’il aura àassumer dans le mariage et dans l’ensemble de la société. Mais cettefête est aussi un moyen de valoriser la paternité, moins évidente, audétriment du lien maternel qui, lui, est manifeste. De plus, cettemanière d’enseigner les rôles sexués aux garçons est également àmettre en relation avec ce rêve d’une procréation masculine où lesfemmes n’auraient plus leur place251.
Comme le remarque Stéphane Breton à propos d’autres sociétés,« d’un côté, par des artifices culturels, par un surcodage rigoureux,on renforce l’appartenance génitale et ses signes éthologiques afind’en faire un modèle d’identité, tandis que de l’autre, par des procé-dures et des manigances déguisées, on s’efforce d’incorporer des ver-tus de l’autre sexe que, pour le salut du sien propre, on se doitd’imiter dans l’outrage et la dissimulation. Il revient au rituel de
Les atours féminins des hommes 779
250. Plutarque, Thésée, XX, 3-7.251. Sur cette question : Jean-Baptiste Bonnard, La représentation du père dans la cité, thèse de
doctorat, Paris I, décembre 1998, à paraître aux Publications de la Sorbonne.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
défendre tour à tour chacune de ces exigences, non seulement de lesillustrer mais aussi de les accomplir »252.
Cette observation s’applique aussi bien, semble-t-il, aux adoles-cents qu’à des adultes accomplis. Quelques fêtes autorisent, en effet,les adultes à se parer des atours du sexe opposé. Ainsi, à Athènes,en l’honneur de Dionysos, « ceux qui exécutaient la danse nomméeIthyphalloi et ceux qui escortaient le phallus (Ithyphalloi) portent deshabits féminins (gunaikeBan stolPn EconteV) »253. Dans d’autres fêtes, letravestissement s’étend aux deux sexes. Ainsi, décrivant Cômos, Phi-lostrate, au IIe siècle de notre ère, dans La Galerie de tableaux, parle deceux qui le célèbrent : « N’entends-tu pas les crotales, les sons de laflûte, un murmure confus ? Des flambeaux, épars çà et là, permet-tent à nos joyeux compagnons de voir devant eux et à nous de lesvoir. C’est une foule variée et remuante d’hommes et de femmes,chaussés sans distinction de sexe, vêtus d’une façon extraordinaire,car Cômos permet à la femme de se donner les airs d’un homme età l’homme de revêtir la robe des femmes, de prendre une démarcheféminine (sugcwreb dA t k²moV kaa gunaika 3ndrBzesqai kaa 3ndra qRlunCnd¢nai stolQn kaa qRlu baBnein)... »254 Néanmoins, alors que l’habitféminin et la démarche font de l’homme une femme, « rien ne pré-cise le contenu du verbe andrBzesqai »255. Ces fêtes d’inversion desnormes sociales sont autant d’occasions de débridements, de défou-lements. Mais elles disent et rappellent en même temps ce qu’estcette norme sociale que chacun doit réintégrer une fois la fêteécoulée. En effet, l’ordre pour être affirmé et conforté a besoind’être périodiquement contesté, bouleversé pendant quelques jours.Les carnavals où règnent l’inversion, par exemple l’inversion des
780 Florence Gherchanoc
252. Stéphane Breton, La mascarade des sexes : fétichisme, inversions et travestissements rituels, préfacede Marc Augé, Paris, Calmann-Lévy, 1989, p. 144.
253. Hésychius, s.v. BIqAfalloi ; Souda, s.v. BIqAfalloi ; Semos de Delos apud Athénée, XIV,614 : « Ceux qu’on appelle Ithyphalloi portent des masques d’hommes ivres et des couronnes...Leur chiton est mêlé de rayures blanches et est entouré d’un voile tarentin qui les couvre jusqu’auxchevilles. » Voir Eric Csapo, Riding the Phallus for Dionysos : Iconography, Ritual and Gender-Role De/construction, Phoenix, 51, 1997, p. 253-295 ; Margaret C. Miller, Reexamining Traves-tism in Archaic and Classical Athens : The Zewadski Stammos, American Journal of Archaeology, 103,2, avril 1999, p. 223-253. En revanche à Tlos, le fragment d’un règlement sacré du IIe siècle denotre ère (Franciszek Sokolowski, Lois sacrées d’Asie Mineure, Paris, De Boccard, 1955, no 77, p. 176)contient une prescription relative à la pratique de collectes et une interdiction aux hommes departiciper au culte sous un déguisement féminin ([-mhdea]V toAtwn Cg gunaikeBai stolRi). Cette pres-cription a trait à un culte en l’honneur de Dionysos d’après Frank Kolb, Zu einem « HeiligenGesetz » von Tlos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 22, 1976, p. 230 et à un culte enl’honneur de Cybèle d’après Albert Henrichs, Changing Dionysiac Identities, op. cit., p. 224, n. 97.Quoi qu’il en soit, cette fête est-elle exclusivement féminine ou bien la loi renouvelle-t-elle uneinterdiction qui n’est pas respectée par des hommes ?
254. Philostrate, La galerie de tableaux, I, 2, 5.255. Remarque pertinente de Françoise Frontisi-Ducroux et François Lissarrague, De
l’ambiguïté à l’ambivalence : un parcours dionysiaque, op. cit., n. 102, p. 28 (n. 15).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
rôles sexués, en sont l’occasion. Les valeurs établies sont niées et parlà même reconnues. À l’issue des festivités, hommes et femmes peu-vent, dès lors, rejoindre les normes sans risque de retour256. C’estpourquoi, sans doute, Artémidore, l’onirocrite, dit que, pour unhomme, « dans les fêtes et les panégyries ni une robe bigarrée niune robe de femme ne cause de dommage »257 – seules périodespendant lesquelles ces transgressions sont admises.
En outre, l’une de ces fêtes commémore une aristeia féminine. Plu-tarque raconte, en effet, que les Argiens célèbrent au mois Hermaiosla fête des Hybristika, « pendant laquelle ils font revêtir aux femmesdes tuniques et des casaques d’hommes et aux hommes des robes etdes voiles de femmes »258. Cette fête magnifierait l’héroïsme de lapoétesse Télésilla, laquelle, dans les premières années du Ve siècle, àla tête d’un bataillon de femmes, défend la cité d’Argos assiégée parCléomène, roi de Sparte259. Le nom de la fête suggère un carnavaldéchaîné, plein de démesure (hybris). L’une des expressions de cettedémesure est précisément l’échange réciproque de vêtements. Letemps de la célébration est un interlude où, par un renversementtotal de toutes les habitudes, l’on rompt momentanément avec la viede tous les jours par l’inversion des signes extérieurs de la différencedes sexes260. Mais cette fête célèbre également l’aristeia des Argiennes,à un moment où il n’y a plus d’hommes dans la cité261. En effet, cetépisode correspond, d’après Hérodote, à une situation dramatiqueannoncée par un oracle delphique : « Mais quand la femelle l’auraemporté sur le mâle et acquerra gloire chez les Argiens, alors elle seracause que beaucoup d’Argiennes se déchireront le visage », d’autant
Les atours féminins des hommes 781
256. Sur les fêtes de travestissements rituels et à propos des carnavals et charivari : Emma-nuel Le Roy Ladurie, Le carnaval de Romans, Paris, Gallimard, 1979 ; Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt (éd.), Le charivari. Actes de la Table ronde (Paris) les 25-27 avril 1977, Paris, Mouton,1981 ; Stéphane Breton, La mascarade des sexes, op. cit.
257. Artémidore, II, 3, 84.258. Plutarque, Conduites méritoires de femmes, 4 (245 E) : « gunabkaV mAn 3ndreBoiV cit²si kaa
clamAsin, 5ndraV dA p@ploiV gunaik²n kaa kalAptraiV 3mfiennAteV. » Sur cette fête : William Regi-nald Halliday, A Note on Herodotos, VI, 83, and The Hybristika, Annual of the British School atAthens, 16, 1909-1910, p. 212 ; Jane Ellen Harrison, Themis. A Study of the Social Origins of Greek Reli-gion, Londres, Merlin Press, 1977 (2e éd.), p. 505-508 ; Clara Gallini, Il travestismo rituale di Pen-teo, op. cit., p. 215 et 220 (n. 5).
259. Plutarque, Conduites méritoires de femmes, 4 (245 C-E).260. D’après Fritz Graf, Women, War and Warlike Divinities, Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, 55, 1984, p. 249-250, ce renversement de l’ordre illustré par des mythes et des rites serapporte aux moments de l’année placés sous le signe de la transition. Il correspond au jour de lanouvelle lune pour les Hybristika.
261. En fait, cet épisode se rattache à un fait historique : la déroute de l’armée argiennedevant l’armée lacédémonienne à la bataille de Sépeia. Voir P. A. Seymour, The Servile Interre-gnum at Argos, Journal of Hellenic Studies, 42, 1922, p. 24-30 ; S. Luria, Frauenpatriotismus undSklavenemanzipation in Argos, Klio, 8, 1932, p. 211-228 ; Ronald Frederik Willetts, The ServileInterregnum at Argos, Hermes, 87, 1959, p. 495-506, et surtout Pierre Vidal-Naquet, Esclavage etgynécocratie dans la tradition, le mythe, l’utopie, dans Le chasseur noir, op. cit., p. 273 sq.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
plus que, parallèlement à cela, « les esclaves s’emparèrent de toutel’administration publique, occupèrent les magistratures et exercèrentle gouvernement ; jusqu’au jour où les fils des citoyens tués atteigni-rent l’âge viril »262. Chez Hérodote, cette situation inédite est celled’un monde renversé. Cet événement est présenté légèrement modi-fié par Plutarque : « Quand ils cherchèrent à remédier au manqued’hommes, ce n’est pas aux esclaves, comme le rapporte Hérodote,qu’ils donnèrent les femmes en mariage, mais aux plus nobles despérièques, après leur avoir accordé le droit de cité. »263 Quoi qu’il ensoit, la fête des Hybristika célèbre une situation exceptionnelle : lavictoire et la valeur de celles qui, habituellement, sont exclues de lacité combattante264 et, précisément, une inversion des rôles sociauxsignifiée par un rituel. Serait-ce à dire que, parfois, les hommes, enfaisant l’expérience ritualisée du féminin, reçoivent des femmesquelque chose de positif, de valorisant ? De plus, on aurait là une tra-dition curieuse relative à un pouvoir des femmes associé également àun pouvoir servile. En outre, il en ressort que le seul moment où lesfemmes peuvent être aristai est précisément celui où il n’y a plusd’hommes à la tête de la cité ou encore quand le pouvoir est contrenature (aux mains des esclaves ou encore aux mains d’un tyran)265.
D’un côté, le travestissement associé à une transgression reli-gieuse représente apparemment un danger qu’illustrent aussi bien lafin de Penthée et la condamnation de Mnésilochos que le sortréservé aux adolescents envoyés au sanctuaire d’Artémis Limnatis.De l’autre, quelques fêtes normées, codifiées, organisées pan les citésautorisent les hommes, adolescents et adultes à se travestir en fem-mes. Néanmoins, les adultes qui s’y prêtent s’exposent, quoi qu’il ensoit, à l’opprobre.
DE LA TRANSGRESSION NORMÉE À LA TRUPHÉ
Des fêtes normées
Périodiquement, des fêtes organisées et réglementées par la citésanctionnent des travestissements ritualisés. Néanmoins, cela n’em-
782 Florence Gherchanoc
262. Hérodote, VI, 77 : « BAll’ wtan T qPleia tqn 9rsena nikPsasa Cxel0sà kaa k¢doV CnBArgeBoisin 9rhtai... » ; VI, 83.
263. Plutarque, Conduites méritoires de femmes, 4 (245 F).264. Pausanias, II, 20, 8-9, présente une version différente, mais qui va dans le même sens,
celui d’une inversion des rôles sociaux : « Télesilla utilisa tous ceux qui pouvaient concourir à ladéfense : femmes, jeunes, vieillards, esclaves. »
265. Voir p. 787-788.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
pêche pas la construction de discours hostiles à ces pratiques, fus-sent-elles institutionnalisées. En effet, ceux qui s’y prêtent sont sou-vent décriés du fait d’un comportement jugé indigne de leur sexe.Le sont, entre autres, les fidèles de Dionysos.
Ainsi, à propos des Dionysies, Philostrate rapporte qu’Apolloniosde Tyane réprimanda les Athéniens qui les célébraient au moisd’Anthestérion. En effet, ce dernier « pensait qu’ils se réunissaient authéâtre pour entendre des monodies, des mélopées, des chœurs et dela musique comme il s’en trouve dans les tragédies et dans les comé-dies ; mais, apprenant qu’on y exécutait, au son de la flûte, des dan-ses efféminées (lugismoB), et qu’en s’accompagnant de rythmes consa-crés par la haute poésie et les hymnes sacrés d’Orphée, on jouait lerôle d’Heures, de Nymphes, de Bacchantes, il ne put s’empêcher deleur adresser des reproches. “Cessez, leur dit-il, d’insulter aux hérosde Salamine et à beaucoup d’autres hommes de cœur qui sont mortspour la patrie. Si vos danses ressemblaient à celles de Lacédémone, àla bonne heure, soldats ! vous dirais-je. Vous vous exercez à laguerre, je suis prêt à prendre part à vos danses. Mais comme c’estune danse molle et efféminée (ea dA 4palQ kaa AV tq qRlu speAdousa),que deviennent vos trophées ? Ce n’est pas contre les Perses et lesMèdes qu’ils se dresseront désormais, c’est contre vous-mêmes, sivous dégénérez de ceux qui les ont érigés. D’où vous viennent cesvêtements de pourpre et de safran ? Est-ce ainsi qu’étaient autrefoiséquipés les Acharniens et les chevaliers de Colone ? Que dis-je ? Unefemme de Carie est venue avec Xerxès, à la tête d’un vaisseau qu’ellea conduit contre nous ; elle n’avait rien d’une femme, elle était vêtueet armée comme un homme ; et vous, plus mous que les femmes deXerxès, vous vous tournez contre vous-mêmes tous tant que vousêtes, vieillards, jeunes gens, éphèbes. Ces éphèbes, qui viennent jurerdans le temple d’Agraule de combattre et de mourir pour la patrie,vont-ils maintenant prêter serment de prendre le thyrse, d’exécuterdes danses bachiques pour la patrie, et, au lieu de porter le casque,de se parer honteusement (acscr²V), comme dit Euripide, d’une coif-fure de femme (gunaikomBmÅ morf´mati) ?...” »266 Au Ier siècle de notreère, Apollonios de Tyane aurait interprété ces travestissements festifscomme une insulte faite aux anciens héros des guerres Médiques. Lepassage oppose, en effet, clairement Athènes à Sparte, les dansesefféminées aux danses guerrières, les vêtements de safran et depourpre, le thyrse au casque hoplitique, les femmes à la guerre et laGrèce à l’Asie présentée comme le lieu du renversement des valeurs.Ce développement est ouvertement hostile aux hommes qui partici-
Les atours féminins des hommes 783
266. Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, IV, 21.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
pent aux Dionysies. Ceux-ci contredisent les valeurs de leur sexeen ne faisant pas montre de virilité. Comme dans les Bacchantesd’Euripide, où l’opposition se cristallise autour de Dionysos efféminéet d’un jeune homme, Penthée, représentant le groupe des guerriers,ici, le discours oppose ces Athéniens efféminés comme l’est Dionysosqu’ils célèbrent aux vainqueurs des Perses. Serait-ce l’expressiond’une dégradation des mœurs et d’une pente de prestige d’Athènes àl’époque où vécut le philosophe de Cappadoce ou bien une critiquede Philostrate à l’encontre de pratiques qui existent encore à sonépoque267 ?
Toujours à propos des Dionysies, Lucien rapporte qu’à la courde Ptolémée XIII Aulète, surnommé Dionysos (85-58 avant notreère), un courtisan jaloux accusa Démétrios, philosophe platonicien,« au motif qu’il buvait de l’eau et qu’il était le seul à ne pas s’êtrehabillé en femme (gunaikeba o£k CnedAsato) aux Dionysies : invité dèsle matin suivant, s’il n’avait pas bu en présence de tous, s’il n’avaitrevêtu une robe tarentine et joué des cymbales en dansant, c’étaitun homme mort pour ne point goûter le genre de vie du roi et pours’affirmer contre les mœurs dissolues (trufP) de Ptolémée comme unsage et un rival »268. Ce qui est mis en avant, c’est la truphé de Pto-lémée. Cet homme adulte ose se comparer à ce dieu à la naturedouble qu’est Dionysos. De plus, son genre de vie n’est pasconforme à ce que devrait être celui d’un bon gouvernant269.
Mêmes institutionnalisées, de telles pratiques, parce qu’elles met-tent en œuvre une inversion des rôles sexués, restent souvent per-çues comme dégradantes. Aussi les critiques visent-elles les fidèles dudieu qui pervertissent et nient ponctuellement les valeurs reconnuesà leur sexe270, mais aussi et surtout des dirigeants politiques. Les
784 Florence Gherchanoc
267. Sur Philostrate : Alain Billault, L’univers de Philostrate, Bruxelles, coll. « Latomus », 252,2000 ; sur la vie d’Apollonios de Tyane et le bios comme genre littéraire et comme discours : Phi-lippe Hanus, La Vie d’Apollonios de Tyane. Recherches sur la tradition du « theios aner », thèse de doctorat,Grenoble II, 1998, et L’ombre du sage. Un processus de mythification à partir de la Vied’Apollonios de Tyane, dans Biographie des hommes, biographie des dieux, Marie-Laurence Desclos(dir.), Recherches sur la philosophie et le langage, 21, 2000, p. 215-258.
268. Lucien, Calomnie, 16.269. Pour un parallèle éclairant et à propos de Cyrus, sur la grâce féminine de sa parure et
le bon usage de la charis en politique entre trufP extérieure et Cgkr0teia (maîtrise de soi) inté-rieure : Vincent Azoulay, Les grâces du pouvoir. La charis dans l’œuvre de Xénophon, thèse de doctorat,Paris I, 2002, p. 423-428.
270. Athénée mentionne également une fête samienne au cours de laquelle les hommes por-tent des atours féminins = Douris apud Athénée, XII, 525 : « Les hommes portaient des braceletsautour de leurs bras et aux grandes fêtes en l’honneur d’Héra, ils marchaient les cheveux bien pei-gnés et flottants sur le dos et les épaules. Témoigne aussi de cette coutume ce proverbe : “Mar-cher vers l’Héraion cheveux tressés.” » D’après Douris, c’est un signe de trufP (Pera dA tRVSamBwn trufRV... Cfproun clid²naV pera bracBosin kaa tQn DortQn 5gonteV t²n ìhraBwn Cb0dizonkatektenism@noi t1V kpmaV Cpa tq met0frenon kaa to¡V µmouV. Tq dA npmimon to¢to marturebsqai kaa¤pq paroimBaV tRsde « badBzein ecV ìhrabn Cmpeplegm@non »).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
mœurs de ces derniers sont l’expression de leur pouvoir : un pouvoir« efféminé », « travesti », autant dire aux marges et donc nonconforme.
Des comportements contraires à la norme civiqueou comment la cité définit ses marges271
Chez un homme adulte, des atours féminins sont généralementrévélateurs de comportements contraires à la norme civique. J’aidéjà évoqué la façon dont le discours tragique et le discourscomique, au Ve siècle avant notre ère, lient l’effémination à unenégation de la virilité et le travestissement à une perte d’identité.Quelques siècles plus tard, à la charnière des Ier et IIe siècles de notreère, Plutarque est encore tributaire de ces normes sociales relatives àla différence des sexes. À cet égard, le personnage d’Alcibiade, telqu’il le dépeint, en est un exemple significatif. De plus, le portraitqu’il brosse de cet homme politique athénien du Ve siècle montrebien les liens établis entre féminité et séduction et ceux qui existententre féminité, force et ruse.
Pour Plutarque, Alcibiade est le type même de l’homme pleinde truphé 272. Ses mœurs sont indignes d’un homme politique :« Avec cette activité politique et oratoire, qui montrait la grandeurde ses vues et son habileté, faisaient contraste le profond relâche-ment de ses mœurs, ses excès de boisson, ses impudentes débau-ches. Il portait, comme une femme, des robes de pourpre qu’il lais-sait traîner sur l’agora (qhlAthtaV CsqPtwn 3lourg²n Dlkom@nwn di’3gor2V), déployait un faste insolent, faisait entailler le pont des triè-res, pour y dormir plus confortablement en mettant son lit sur dessangles au lieu de le poser sur les planches. Il s’était fait faire unbouclier doré, qui ne portait aucun emblème traditionnel maisun Amour porte-foudre. »273 Les manières d’être multiples d’Alci-biade situent le personnage et s’affichent comme éléments de diffé-
Les atours féminins des hommes 785
271. Pour reprendre une partie du titre d’un article de Pauline Schmitt-Pantel, Histoire detyran ou comment la cité grecque construit ses marges, dans Les marginaux et les exclus dansl’histoire, Cahiers Jussieu, V, 1979, p. 217-227. Pour un parallèle romain : Florence Dupont etThierry Éloi, L’érotisme masculin dans la Rome antique, Paris, Belin, 2001, en particulier Le contrôlesocial sur le corps des citoyens, p. 85-95, Vestis muliebris : le vêtement efféminé. Marc Antoinetravesti ?, p. 115-137, et Flaminius, Sylla, César. Quelques grandes figures molles de la Répu-blique, p. 271-292.
272. Pauline Schmitt-Pantel, La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques,Rome, CEFR 157, 1992, p. 196-201, et Le luxe et la classe politique athénienne, dans Construction,reproduction et représentation des patriciats urbains de l’Antiquité au XX
e siècle, textes réunis et présentés parClaude Petitfrère, Tours, 1999, p. 382-383 en particulier.
273. Plutarque, Alcibiade, XVI, 1.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
renciation. En effet, « le discours grec sur les mœurs se construitcomme un discours sur le politique, un discours qui ne fait pas dedistinction [...] entre comportement d’un individu et [...] sonaction politique »274.
Le genre de vie de l’homme politique athénien n’est que truphé.Parmi tous ces éléments (excès de boisson et de sexe, extravagancesvestimentaires, etc.) qui servent à montrer qu’Alcibiade est totale-ment à l’écart des normes civiques, on compte son excès de fémi-nité. Il est, en effet, vêtu comme une femme et douillet. En outre,ces atours féminins ne sont peut-être pas sans rapport avec la séduc-tion que déploie l’homme politique, avec sa charis et sa force de per-suasion275. Il séduit le peuple par les plaisirs et les bienfaits qu’il luiprocure, par ses discours éloquents et sans doute aussi par sa fémi-nité – autant de moyens de se démarquer comme aristocrate et chefdu demos. Comme le remarque Pauline Schmitt-Pantel, séductionpolitique et séduction érotique se conjoignent. Et cette séduction augrand jour suscite un discours réprobateur : une critique de l’usagefait de la charis en politique276. Pour Alcibiade, la féminité est un deséléments de la séduction politique qu’il exerce. Mais, elle révèleaussi une attitude anti-démocratique signifiée par l’outrage ducorps277. En effet, le corps du citoyen est soumis au regard public desautres et est donc l’objet de toutes les attentions. De ce point devue, « l’identification des genres exige... le respect de la culture desapparences sexuées » ; toute forme de dévirilisation du corps chezun orateur est condamnable278. Aussi le manque de masculinitéd’Alcibiade est-il social et politique, non sexuel. L’outrage de soncorps lié aux vêtements qu’il porte et son manque de décencemasculine signalent précisément un outrage social et politique qui lesingularise et le qualifie comme tyran279. Ainsi, son effémination àl’âge adulte et, même plus jeune, son comportement féminin sont
786 Florence Gherchanoc
274. Pauline Schmitt-Pantel, Le luxe et la classe politique athénienne, op. cit., p. 376.275. Sur charis et politique : Vincent Azoulay, Les grâces du pouvoir, op. cit., en particulier Les
grâces de l’amour, p. 371-428, La charis dans la démocratie, p. 77-90, et, sur la séductiond’Alcibiade et l’exercice du pouvoir, p. 393-394.
276. Voir Pauline Schmitt-Pantel, Le luxe et la classe politique athénienne, op. cit.,p. 382.383.
277. Voir David Gribble, Alcibiades and Athens. A Study in Literary Presentation, Oxford, Claren-don Press, 1999, p. 4-6 et 69-82.
278. Florence Dupont et Thierry Éloi, L’érotisme masculin dans la Rome antique, op. cit., p. 115et 129.
279. Cette idée sous-tend la présentation de Plutarque. Cf. Plutarque, Alcibiade, XVI, 2-3 :« Les notables voyaient ces excès avec dégoût et indignation ; ils redoutaient sa désinvolture et sonmépris des lois, comme dénotant un esprit bizarre et tyrannique. Quant aux dispositions dupeuple à son égard, Aristophane ne les a pas mal décrites quand il a dit : “Il l’aime, il le déteste etpourtant veut l’avoir.” Il est plus sévère encore dans cette allusion : “Surtout, ne pas nourrir unlion dans la ville, mais si on le nourrit, se prêter à ses mœurs.” »
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
un révélateur de sa personnalité. En effet, « un jour qu’il s’exerçait àla lutte, pressé par son adversaire et craignant d’être renversé, ilamena jusqu’à sa bouche les bras qui l’étreignaient, et fit mine deles dévorer. L’autre lâcha prise, en s’écriant : “Tu mords commeles femmes, Alcibiade. – Non, dit-il, mais comme les lions” »280.Ainsi, tout petit, il s’écarte déjà du combat réglé, de la lutte loyale.Sa part de féminité caractérise, entre autres, sa force, celle d’unhomme rusé comme une femme ou comme un lion à savoir unindividu qui se comporte déjà comme un tyran281. Sa féminité estprésentée comme un atout politique même si elle est du ressort de lacritique.
Tandis que certains jouent, à titre individuel, d’ambiguïtéssexuelles pour se singulariser et asseoir ainsi leur prestige et leurpouvoir, d’autres s’attachent à pervertir la juste répartition du fémi-nin et du masculin quand ils exercent le pouvoir. En effet, des textesdécrivent de quelle façon le tyran instaure un dérèglement généra-lisé et font ainsi de lui le symbole d’un pouvoir contre nature282.L’histoire d’Aristodème de Cumes l’illustre précisément. Ce dernierinstaure la tyrannie vers 505/504. Il tue ou exile les aristocrates etdistribue leurs biens, leurs femmes et leurs filles aux esclaves meur-triers de leurs maîtres. De plus, il envoie les enfants mâles auxchamps mener une vie servile de travail agricole. Le monde est ren-versé puisque les jeunes aristocrates prennent la place des esclavesqu’ils servent. Il l’est d’autant plus que ces jeunes esclaves sont éle-vés comme des filles : cheveux longs, bouclés et protégés par unerésille, robes brodées, vie à l’ombre des parasols, avec force bains etparfums. Enfin, les fils, comme dans l’épisode d’Argos mentionnéplus haut, se révoltent et renversent le tyran avec les exilés283. Faut-ilrapprocher ce récit de ce qu’on sait des fêtes d’inversion des rôlessexués, comme les Hybristika ? Ce discours n’est-il pas destiné à for-ger une image négative du pouvoir tyrannique, à en faire un pou-voir contre nature où le tyran ne peut qu’inverser les signes de ladifférence des sexes et empêcher ainsi la reproduction du corps
Les atours féminins des hommes 787
280. Plutarque, ibid., II, 2-3.281. Sur le lion comme figure emblématique du tyran : David Gribble, Alcibiades and Athens,
op. cit., p. 2.282. Sur les discours que tient la cité classique sur le tyran : Pauline Schmitt-Pantel, Histoire
de tyran ou comment la cité grecque construit ses marges, op. cit.283. Cf. Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VII, 8 ; VII, 9, 2-3 ; VII, 9, 3-5 : kom2n te
g1r to¡V 5rrenaV ¸sper t1V parq@nouV Ck@leusen Cxanqizom@nouV kaa bostrucizom@nouV kaakekruf0loiV t1V plokamBdaV 3nado¢ntaV CnduesqaB te poikBlouV kaa podPreiV citwnBskouV kaa cla-nidBoiV 3mp@cesqai leptobV kaa malakobV kaa dBaitan Ecein ¤pq skiabV. Sur cet épisode et le parallèleprécis avec les Hybristika d’Argos : Pierre Vidal-Naquet, Esclavage et gynécocratie dans la tradi-tion, le mythe, l’utopie, op. cit., p. 275-276 (n. 261).
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
civique284 ? Plutarque donne la version gynécocratique de cet épi-sode285. Il raconte comment le tyran de Cumes, Aristodème, prit lepouvoir, l’exerça et fut défait grâce aux mérites de deux femmes.Tout d’abord, il explique que le tyran est surnommé l’ « efféminé(malakpV) » ce qui est justifié par ses faits d’armes : « Les barbareslui avaient en effet donné le surnom de “Malakos”, qui précisémentsignifie jeune adolescent, parce que c’est en n’étant qu’un tout jeunehomme, qu’en compagnie de ceux de son âge, aux cheveuxlongs [...], dans les guerres contre les barbares non seulement ils’était distingué et illustré par l’audace des exploits de son bras, maisqu’il avait manifesté une intelligence et une prévoyance exception-nelles. » Sa féminité est donc un opérateur de virilité. Plus tard,devenu tyran, Aristodème « surpassa lui-même en perversité dansses outrages à l’égard des femmes et des enfants de condition libre.On raconte en effet qu’il habituait les garçons à porter les cheveuxlongs et des parures d’or, tandis qu’il forçait les filles à se couper enrond les cheveux et à porter la casaque des éphèbes sur la trèscourte petite tunique de ces derniers ». Enfin, Xénocrité, sa com-pagne, et une autre femme, dont le nom est inconnu, contribuent àlibérer Cumes et mettent fin à une situation où « Aristodème est leseul à être un homme à Cumes ». Cet épisode semble s’inscrire dansla tradition des discours relatifs aux mœurs des tyrans et correspondbien aux critiques formulées à l’encontre d’un tel pouvoir. Les actesdu tyran, en effet, sont significatifs de la nature de son pouvoir.Aussi, inverser les signes culturels les plus évidents de la différencedes sexes est-ce caractéristique d’un pouvoir contre nature et d’undérèglement généralisé. « Tout à la fois ou parfois tour à tour êtreefféminé ou super-mâle, le tyran échoue à garder avec la sexualitéla bonne distance qui ferait de lui un citoyen possible. [Ce récit]s’inscrit dans l’image d’un tyran radicalement hostile au monde desandres, des citoyens, qu’il cherche à détruire comme êtres politiqueset comme mâles tout à la fois. »286 En outre, dans cette cité ren-versée, deux femmes et non des hommes concourent à la destitutiondu tyran. Cette aristeia féminine ne s’explique que dans la mesure oùla cité est dépourvue d’hommes, de citoyens.
788 Florence Gherchanoc
284. Voir Pauline Schmitt-Pantel, Histoire de tyran ou comment la cité grecque construit sesmarges, op. cit., p. 228 à propos de Périandre de Corinthe (Hérodote, III, 48) ; David Asheri,Tyrannie et mariage forcé. Essai d’histoire sociale grecque, Annales ESC, 32, 1977, 1, p. 21-48.
285. Cf. Plutarque, Conduites méritoires de femmes, 26 (261 D-262 D).286. Citation tirée de Pauline Schmitt-Pantel, Histoire de tyran ou comment la cité grecque
construit ses marges, op. cit., p. 229 à propos de Périandre, tyran de Corinthe (Hérodote, III, 48),qui s’applique parfaitement à Aristodème. Sur les outrages sexuels imposés par les tyrans : Aris-tote, Politique, V, 10, 16-18 = 1311 a 35 - b 23.
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
Conclusion
L’effémination et le travestissement répondent à des critèresvisuels – traits du visage, vêtements, objets, comportements – quisont le reflet de normes culturelles. Ce que laisse voir un homme,ce qu’on voit de lui, est précisément ce qu’il est. Le regard del’autre constitue et dit sa nature profonde. Ainsi, cette réciprocitédu voir et de l’être vu287 justifie l’analogie entre l’apparence etl’être, entre l’apparence et la véritable nature, exception faite desadolescents.
Pour un homme, le féminin est ce qui est autre, étranger commel’est Dionysos, cet étranger efféminé, quand il arrive à Thèbes. Deplus, l’action de ce dieu permet justement de devenir autre en bas-culant dans son regard ou en s’assimilant à lui par contagion mimé-tique. « Tel est le but du dionysisme qui met l’homme en contactimmédiat avec l’altérité du divin. »288 Dionysos permet de fairel’expérience de l’autre, du féminin, quitte, comme Penthée, à s’yperdre et en mourir. Le féminin est altérité. Mais cette altérité estsoit dégradante soit valorisante. Dégradante car le féminin confèreune sorte de monstruosité à l’homme qui s’en pare289 et est, dès lors,le signe d’une transgression, voire d’une déchéance sociale et d’uneperte d’identité. Mais valorisante comme signe de beauté et commeopérateur de virilité chez des adolescents. Valorisante, aussi, dans lamesure où il faut en faire l’expérience par mimêsis, lors d’initiations,lors de fêtes de renversement des rôles sociaux, pour mieux s’enséparer. Valorisante, également, car le féminin dit, en négatif, lanorme et contribue à définir des éléments constitutifs de l’identitédu mâle et la place que ce dernier occupe dans la société. Le fémi-nin est aussi ruse associée éventuellement à la séduction, notammentpour les adolescents.
Finalement, pour un Grec, l’homme civilisé, c’est-à-dire accom-pli, semble être celui qui a su faire le deuil de sa féminité. En effet,
Les atours féminins des hommes 789
287. Sur la « réciprocité du voir et de l’être vu » pour les Grecs : Françoise Frontisi-Ducroux, L’œil et le regard en Grèce ancienne, dans L’œil fertile, Iris, hors-série, 1997, p. 21-29 (eten particulier les pages 24-25).
288. Françoise Frontisi et Jean-Pierre Vernant, Figures du masque en Grèce ancienne, Jour-nal de psychologie, 1-2, 1983, p. 66-67.
289. D’ailleurs, pour Aristote, Génération des animaux, IV, 3, 767 B, la femme est par nature unêtre monstrueux (t@raV) : « Celui qui ne ressemble pas aux parents est déjà, à certains égards, unmonstre : car dans ce cas, la nature s’est, dans une centaine mesure, écartée du type générique. Letout premier écart est la naissance d’une femelle au lieu d’un mâle (BArcQ dA pr:th tq qRlu g@nes-qai kaa mQ 5rr@no). Mais elle est nécessitée pan la nature, car il faut sauvegarder le genre (g@noV)des animaux où mâles et femelles sont indistincts. »
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
chez l’homme adulte, féminité et, pire, travestissement sont synony-mes de dégénérescence, vilenie et surtout truphé et signalent la mar-ginalité et la monstruosité. En outre, cette transgression en produitune autre. En effet, un monde renversé laisse de la place àl’épanouissement d’une aristeia féminine.
Florence Gherchanoc est maître de conférences en histoire grecque àl’Université Paris VII - Denis Diderot et directrice du laboratoire Phéacie. Prati-ques culturelles des sociétés grecque et romaine. Elle a soutenu en 1998 une thèse, àl’EHESS, intitulée Sociabilité et famille dans les cités grecques, dirigée par PaulineSchmitt-Pantel. Ses recherches portent sur les pratiques sociales et les condui-tes ritualisées familiales dans leurs expressions festives et, plus largement, sur lelien social dans les cités grecques aux époques archaïque et classique. Elle tra-vaille également sur la question des identités et s’intéresse, en particulier, àl’histoire du genre. Elle entreprend actuellement la rédaction d’un livre sur« la famille en fête ».
RÉSUMÉ
L’analyse des atours féminins des hommes dans le monde grec antique permetde réfléchir aux marqueurs de l’identité sexuée et de se demander à quoi répondentet renvoient les différentes formes de travestissement dans une société qui met enexergue les valeurs masculines.
L’effémination et le travestissement travaillent essentiellement sur un registrevisuel, reflet de normes culturelles.
Pour un homme, le féminin est autre, aussi étranger que l’est Dionysos à Thèbes.Aussi, l’adoption d’habits de l’autre sexe est-elle de l’ordre de la transgression :transgression de l’identité sexuée et surtout détournement de l’identité sociale etpolitique qui présente un danger. Néanmoins, le travestissement d’adolescents dansun contexte initiatique est un opérateur de virilité ; leur beauté féminine (associée àla metis et à la séduction) est constitutive de leur identité. En revanche, le travestisse-ment des adultes, même s’il est institutionnalisé, est critiqué, en particulier celui deshommes politiques. Ces derniers incarnent alors un pouvoir efféminé, travesti, auxmarges et non conforme aux normes civiques.
Mots clés : Grèce antique Ve-IVe siècles avant J.-C., genre, rites, norme civique,Dionysos.
ABSTRACT
To analize feminine finery of men in the ancient Greek world allows us to think ofthe sexual identity markers and to ask about to what answer and reflect the diverseforms of disguising in a society that highly ranks male values.
Effiminacy and disguise work mostly on a visual register that reflects culturalnorms.
790 Florence Gherchanoc
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)
To a man, the feminine is other, as foreign as is Dionysos in Thebes. So, to adoptclothes from the other sex means transgressing : transgressing the sexual identityand transforming the social and political identity ; it is potentially dangerous. Howe-ver teenagers’ disguise in an initiatic context operates as revealing virility ; theirfeminine beauty (associated with metis and seduction) is constituent of their identity.But adult disguise, even if it is institutionalized, is criticized, specifically for politicalmen. These latter embody then an effeminate power, a disguised, marginal powerwhich does not conform to the civic norms.
Key words : Ancient Greek world V-IV centuries BC, gender, rites, civic norm,Dionysos.
Les atours féminins des hommes 791
© P
ress
es U
nive
rsita
ires
de F
ranc
e | T
éléc
harg
é le
28/
06/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
Presses U
niversitaires de France | T
éléchargé le 28/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.229.84)