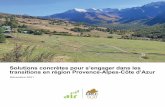Approche prédictive de l'efficacité énergétique dans les ...
Arcà Andrea 2011. Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre du Second Âge du Fer dans...
Transcript of Arcà Andrea 2011. Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre du Second Âge du Fer dans...
69
L’art rupestre peut être défini comme
des archives de pierre dont les pages
offrent souvent des témoignages icono-
graphiques uniques et irremplaçables sur les
cultures et les peuples qui se sont succédés dans
les vallées alpines au cours des millénaires. Deux
capitales sont bien connues pour ce patrimoine
qui, grâce aux conditions favorables des sur-
faces rocheuses, recèle la grande majorité des
signes figuratifs des Alpes : le Mont Bego dans les
Alpes Maritimes et le Valcamonica dans les Alpes
italiennes. Dès le Néolithique, on y trouve des
images évoquant la naissance de l’agriculture.
À partir du IVe millénaire av. J.-C., sont gravés sur
les rochers des champs cultivés à la houe, puis
labourés, et enfin des scènes détaillées d’atte-
lages du Chalcolithique, datant du IIIe millénaire
av. J.-C. À ce stade, que l’on peut nommer celui
des « signes de la terre », suit une autre étape
thématique importante, celle des « signes de
la guerre » qui rassemble, à partir du IIIe millé-
naire av J.-C. et jusqu’au début de la romanisa-
tion, figures et compositions d’armes, de haches,
de poignards et de hallebardes, scènes de duels
et de démonstration de la force et de la prouesse
masculines.
Au-delà de ces deux pôles d’art rupestre, il
existe d’autres zones importantes, parmi les-
quelles les vallées dites du Mont Cenis jouent
un rôle majeur. La Maurienne en France, la Val-
cenischia et la basse Vallée de Suse en Italie sont
réparties au pied du haut plateau qui flanque
le Mont Cenis, une véritable porte reliant les
deux côtés des Alpes par deux cols principaux,
le Mont Cenis à 2083 m. et le Petit Mont Cenis à
2182 m. De nombreuses dalles de calcschistes,
polies et transportées par les glaciers du Pléisto-
cène, sont répandues dans ces vallées. Ces zones
sont idéales pour recueillir les traces laissées par
l’homme.
Cet espace doit être envisagé comme l’un
des plus pertinents pour la localisation de la
route empruntée par Hannibal et son armée
lors du franchissement des Alpes, grâce à sa
proximité avec le col du Clapier (2482 m) et le
col de Savine-Coche (2500 m), seuls passages,
avec le col de la Traversette, à véritablement
offrir une vue panoramique directe sur la plaine
du Pô, telle que la décrit Tite-Live lorsque Han-
nibal harangue ses troupes et leur montre les
plaines d’Italie (« Italiam ostentat subiectosque
alpinis montibus circumpadanos campos » Tite-
Live, 21, 35).
Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre du Second Âge du Fer dans le Val de Suse et la Valcenischia
Andrea Arcà
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
70
Hannibal et les Alpes
Vue générale de la roche n° 4 de Dos Sottolajolo, Paspardo, Valcamonica (ci-dessus) et figure d’éléphant d’époque moderne (détail de la roche n° 4, à droite). © Photographie L. Jaffe - Orme dell’Uomo
À la recherche de références iconographiques sur le passage d’Hannibal
Il semble approprié d’étudier les archives
rupestres pour déterminer l’existence de réfé-
rences iconographiques liées à l’entreprise du
général carthaginois. D’un point de vue stric-
tement historique, la réponse semble néga-
tive : aucune image provenant de l’art rupestre
alpin ne peut être liée au passage de l’armée
carthaginoise. L’élément principal, qui proba-
blement aurait été capable de stimuler l’imagi-
nation populaire et la réalisation de gravures,
est incontestablement l’éléphant, dont l’ab-
sence est manifeste sur les roches gravées des
Alpes. Il existe cependant une exception pro-
venant de la zone de Paspardo, en Val Camo-
nica, où une figure probable d’éléphant a été
gravée sur la roche n° 4 du site de Dos Sotto-
lajolo. Il s’agit d’un unicum qui, autant pour le
sujet que pour le style, a été exécuté au cours
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
71
Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre
Figure d’éléphant probablement paléolithique peinte dans la Grotte de l’Éléphant dans les gorges du Toulourenc, groupe du Mont Ventoux. © Photographie P. Bellin
de la période historique, peut-être au début du
XVIe siècle, lorsque le roi du Portugal a offert au
pape Léon X un éléphant blanc provenant de
Ceylan. Le pachyderme, nommé Hanno en l’hon-
neur de l’un des généraux d’Hannibal, est arrivé
à Rome le 12 mars 1514. La seule autre référence
possible a été donnée en 1821 par le docteur
François-Emmanuel Fodéré dans son Voyage
aux Alpes Maritimes. Il a alors cru reconnaître
dans le chaos de rochers de la Vallée des Mer-
veilles, au Mont Bego (massif du Mercantour,
Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence)
un monument d’origine carthaginoise : « Nous
avons le témoignage d’historiens dignes de foi
et des monuments qui attestent le passage des
Carthaginois par les Alpes Maritimes, non par
Annibal mais par des généraux qui sont venus
après lui » (Fodéré, 1821, p. 19).
L’origine carthaginoise a également été
invoquée pour des éléments inexpliqués,
comme le confirme le botaniste anglais. John
Moggridge, qui s’est occupé, avant même Cla-
rence Bicknell, de documenter certaines figures
gravées du Mont Bego. En effet, selon ses écrits
de 1868, cités par Clarence Bicknell en 1913 :
« d’après la tradition de la région, ces gravures
sont l’œuvre des soldats d’Hannibal, mais je suis
obligé de dire qu’Hannibal, dans cette région,
joue le même rôle que César, Oliver Cromwell
et sa majesté satanique en Angleterre, aux-
quels est populairement attribuée la paternité
d’événements qui ne peuvent être expliqués
autrement ».
Concernant le domaine périalpin, il convient
de mentionner le cas de la Grotte de l’Éléphant,
qui s’ouvre dans les gorges du Toulourenc
(Drôme). Il s’agit d’une galerie fossile creusée
dans la roche calcaire, profonde de 38 mètres.
À 19 mètres de l’entrée, l’on peut apercevoir le
contour noir d’une figure d’éléphant peinte,
d’environ 30 cm2 : on reconnaît les pattes anté-
rieures, les grandes oreilles et une partie de la
trompe, enroulée à l’extrémité. La figure n’est
pas récente, puisqu’elle est recouverte par un
voile de calcite. Paul Bellin y reconnaît la repré-
sentation d’un éléphant africain, en excluant
l’Elephas antiquus, peut-être à tort car il ne
disparaît que vers 11 500 avant notre ère. Cette
reproduction aurait pu remonter au Second Âge
du Fer et témoigner du passage des éléphants
d’Hannibal dans le territoire des Baronnies, si le
style n’avait pas été pleinement animalier, favo-
risant une datation beaucoup plus ancienne,
remontant au Paléolithique.
S’il est impossible de trouver des références
spécifiques qui permettraient de fournir des
preuves sur le parcours suivi par le général car-
thaginois, nous pouvons néanmoins étudier les
données iconographiques de la même époque
(fin du IIIe siècle av. J.-C.) qui peuvent devenir
des éléments utiles pour clarifier le cadre (his-
torique, archéologique, géographique…) dans
lequel Hannibal s’est déplacé.
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
72
Hannibal et les Alpes
Scène de duel avec lance et bouclier, roche n° 20 de Redondo, Capo di Ponte, Valcamonica. Phase naturaliste de l’art rupestre camunnien de l’Âge du Fer, Ve-IVe siècles av. J.-C. © Photographie A. Arcà - Orme dell’Uomo
Le Valcamonica, une comparaison indispensable
Avant d’entrer dans les détails du complexe ico-
nographique rupestre de la Valcenischia et de
la basse Vallée de Suse, il convient de propo-
ser un aperçu concis de l’art rupestre du Valca-
monica à l’Âge du Fer, référence indispensable
pour toute la période et pour l’ensemble de la
région alpine. L’art rupestre du Ier millénaire
av. J.-C., en raison des sujets représentés, est
essentiellement masculin, favorisant l’image
du guerrier, toujours montré armé, aussi bien
dans les duels que dans des scènes d’ostenta-
tion d’armes. Debout, le guerrier parvient dans
certains cas à exhiber une véritable panoplie, en
s’armant dans le même temps d’une lance, par-
fois double, d’une épée et d’un poignard, tout en
se protégeant à l’aide d’un bouclier, d’un casque
et de protège-tibias. En ce qui concerne les com-
paraisons archéologiques, ce sont justement
ces figures d’armes qui permettent un ancrage
chronologique fiable, notamment grâce à la pré-
sence de figures de casques à crête de type vil-
lanovien (VIIIe siècle av. J.-C.), de haches à lame
carrée ou sub-trapézoïdale de type San Fran-
cesco (Bologne) ou de Borgo San Pietro (Val-
sugana-Trentin, VIIe-VIe siècles av. J.-C.), d’épées
à antennes ou de type hallstattien occiden-
tal (VIIe-VIe siècles av. J.-C.), de haches à lame
en demi-lune ou hellebardenaxt (IIIe siècle
av. J.-C - Ier siècle après. J.-C.), de couteaux de type
Benvenuti (VIe siècle av. J.-C.), Introbio (Ier siècle
av. J.-C.) ou Lovere (Ier siècle après. J.-C.). En s’ap-
puyant sur l’identification de ces éléments, sur
l’étude des superpositions et des évidentes
influences stylistiques de l’art schématique
hallstattien et de l’art naturaliste étrusque, on
peut établir un découpage en cinq phases de
l’art rupestre camunnien à l’Âge du Fer. Le qua-
trième style débute aux VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.
par une phase schématique pour atteindre un
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
73
Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre
Hommes armés à corps plein qui brandissent une hache à lame lunée et un bouclier rectangulaire, à gauche sur la roche n° 4 de Paspardo in Valle et à droite sur la roche n°1 du site de Dos Sottolajolo, Valcamonica. Phase tardive de l’art rupestre camunnien de l’Âge du Fer, IIIe-Ier siècles av. J.-C. © Photographie A. Arcà - Orme dell’Uomo
naturalisme descriptif puis finalement un style
décadent, contemporain de la romanisation aux
Ier siècle av. - Ier siècle apr. J.-C. La période com-
prenant la Deuxième Guerre punique, qui est
déjà une période historique pour Rome, mais
encore protohistorique pour les Alpes, corres-
pond chronologiquement au style IV4 qui suit
immédiatement la phase naturaliste.
Val de Suse et Valcenischia, armes et hommes armés
Grâce à cette évolution stylistique, il est éga-
lement possible de proposer une chronologie
fiable concernant les figures des Alpes occiden-
tales, en particulier pour les complexes d’art
rupestre de la Maurienne (Aussois, Sollières,
Lanslevillard, Roche des Bouquetins) et du Val
de Suse-Valcenischia (Mompantero et Carolei),
les seuls qui conservent des figures compa-
rables à celles du Valcamonica au cours du Ier
millénaire av. J.-C.
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
74
Hannibal et les Alpes
d’autres sites rupestres de la Haute Maurienne
(Vallon de la Rocheure), et confirment leur exé-
cution protohistorique. Cependant, la donnée
qui nous interpelle n’est pas seulement archéo-
logique, mais aussi ethnographique : aujourd’hui
encore, dans les villages de Venaus et Giaglione,
situés au pied du versant gravé, la tradition de la
danse armée des Spadonari est encore respectée
et représentée lors de la fête du patron de Gia-
glione le 22 janvier et celle du patron de Venaus
le 3 février, c’est-à-dire à la fin de la période la plus
froide de l’hiver et précédant le carnaval. L’un des
éléments marquant est l’utilisation virtuose de
l’épée, avec des duels figurés, des lancements et
des échanges en l’air d’armes, des sauts, des mou-
vements de haut en bas, comme pour imiter le
geste de la récolte. C’est dans ce domaine, com-
prenant l’ensemble du Val de Suse, le Val Chisone
et la région de Briançon, que l’on trouve la plus
forte concentration de danses armées à l’épée de
toute l’Europe. La comparaison avec les figures
gravées permet de reconnaître certains éléments
chorégraphiques et ethnographiques typiques de
la danse traditionnelle, tels que le saut, le genou
plié, la représentation des rubans qui pendent du
couvre-chef, et favorise l’hypothèse d’une genèse
de la danse des Spadonari bien plus ancienne que
Le complexe Val de Suse-Valcenischia pré-
sente un remarquable ensemble de figures de
guerriers et d’armes. Il faut exclure, pour leur
datation trop ancienne (VIe-Ve siècles av. J.-C.), la
scène gravée sur la Roche des Bouquetins et les
peintures rupestres de Costa Seppa, qui montrent
des figures armées de lances, des archers, par-
fois à cheval, des figures aux « grandes mains » et
ornithomorphes. Il s’agit probablement de scènes
mythologiques comme le suggère Filippo Maria
Gambari. De même, doivent être exclues, en rai-
son de leur trop récente datation, les figures
d’hommes armés au corps carré avec décoration
sur la poitrine de l’Alpe Carolei en Valcenischia,
sans doute des gladiateurs dont la représenta-
tion est probablement liée aux jeux présentés
dans l’arène de Suse à l’époque romaine.
En revanche, il est possible d’envisager une
exécution autour des IVe-IIe siècles av. J.-C. pour
d’autres figures d’hommes armés à l’épée prove-
nant du site de l’Alpe Carolei. Elles sont gravées
à 2550 m d’altitude, au-dessus d’une grande dalle
de calcschiste polie par l’action glaciaire, qui
domine tout le côté italien du Mont Cenis et du
col du Clapier. Les épées, soit droites, soit légère-
ment incurvées, sont plus courtes et différentes
par rapport à celles du Moyen Âge, gravées dans
Figures armées à corps carré avec des décorations de poitrail. À gauche, à l’Alpe Carolei, Valcenischia. À droite, roche n° 1 à Dos Sottolajolo, Paspardo, Valcamonica. Phase décadente de l’art rupestre camunnien de l’Âge du Fer, Ier siècle av.-Ier siècle apr. J.-C. © Photographie A. Arcà - Orme dell’Uomo)
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre
Roche gravée CEN-CRL13, Valcenischia et panorama sur les versants italiens du Mont Cenis et du col du Clapier. © Photographie A. Arcà - Orme dell’Uomo
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
76
Hannibal et les Alpes
Figures d’hommes armés avec épées sur la roche CEN-CRL13, IVe-IIe siècles av. J.-C, Valcenischia (à gauche et au milieu) et figure d’homme armé avec épée sur la roche CEN-CRL8, VIe-Ve siècles av. J.-C, Valcenischia (à droite). © Photographies GRCM, relevés Orme dell’Uomo
Les archéologues relèvent sur des feuilles de plastique (PVC) transparentes les figures de la roche CEN-CRL8, Valcenischia (en bas à droite). © Photographie GRCM
(Naquane, roche 44, Paspardo In Valle, roche 4
entre autres), à présenter des figures de haches
au tranchant luné ou hellebardenaxt, pour les-
quelles il a été proposé une chronologie allant
du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle apr. J.-C. Il n’est
donc pas à exclure, compte tenu de la datation
la plus ancienne, que de telles figures puissent
coïncider avec l’époque de la Deuxième Guerre
punique. Il est intéressant de notifier que ces
haches se divisent clairement en deux groupes,
l’un à manche plus long et tranchant droit,
l’autre à manche court et tranchant luné, ce qui
correspond pour le premier groupe à une arme
tranchante que l’on empoigne à deux mains, et
pour le second groupe à une arme de jet apte à
blesser, par exemple en vol après une série de
tours imprévisibles. Il s’agit de haches de guerre
probablement utilisées par des populations qui
ont intégré à l’époque romaine le royaume de
Cottius (13 av. J.-C.-13 apr. J.-C.), sorte de protec-
torat. Ces différentes nations alpines (civitates
pour les Romains), au nombre de quatorze, ins-
tallées sur les deux versants des Alpes, ont été
inscrites sur l’arc de Suse, comme celles des
ce qu’attestent les sources historiques que l’on
ne connaît pour l’instant pas avant les XVIe-XVIIe
siècles de notre ère. Cette danse regroupe pro-
bablement de manière syncrétique une origine
guerrière, celle des tribus celtes installées dans
la région, et des éléments liés à la renaissance de
la végétation et de la vie.
Au-delà des figures de guerriers, on peut
également citer les représentations de haches
provenant du complexe iconographique de
Mompantero, pour lesquelles, sur la base des
comparaisons archéologiques et stylistiques, il
est possible de proposer une attribution chro-
nologique qui couvre tout le dernier quart du
Ier millénaire av. J.-C. Une telle comparaison est
pertinente en particulier pour les lames pro-
venant des nécropoles de San Bernardo et de
In Persona, à Ornavasso (province de Verbano-
Cusio-Ossola, Piémont, Italie), où elles sont pré-
sentes soit sous la forme de « haches à tranchant
luné » soit sous la forme de « haches avec l’œil à
maillet », comme l’a défini en 1895 le découvreur
Enrico Bianchetti. Mompantero est le seul site
de toutes les Alpes, à l’exception du Valcamonica
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
Un instant de la danse tra-ditionnelle des Spadonari, Venaus, Valcenischia (ci-dessus). © Photographie A. Arcà - Orme dell’Uomo. Comparaison avec une figure gravée à l’Alpe Caro-lei, qui, comme les Spadonari, saute avec l’épée en main et porte un couvre-chef avec des rubans qui pendent (à gauche). © Relevé Orme dell’Uomo
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
78
Hannibal et les Alpes
Figures de haches à lame lunée gravées sur les roches SUS-CHM2 et SUS-CHM3, IIIe siècle av.-Ier siècle apr. J.-C, Mompantero, Val de Suse. © Photographie GRCM.
Segusini, des Belaci ou des Medulli. Selon l’his-
torien romain Pline ( Histoire naturelle, 3, 136-
138), ces peuples sont considérés alors comme
non ennemis. Ils ne sont d’ailleurs pas men-
tionnés sur le trophée de La Turbie (Tropaeum
Alpium, Alpes maritimes) qui consacrait la sou-
mission d’un certain nombre de peuples alpins
à Rome en 7 av. J.-C. L’attribution la plus logique
de ces représentations de haches reviendrait à
ces Segusini, ou tout du moins à leurs ancêtres
du IIIe siècle av. J.-C., puisque leur ville centre,
Segusio (Suse) est située au pied du complexe
des pétroglyphes de Mompantero.
Conclusions
En considérant dans son ensemble le matériel
représenté, les figures d’épées et de lances sont
trop génériques pour fournir des informations
détaillées ; au contraire des figures de haches,
dont la forme particulière permet de proposer
de solides ancrages archéologiques et de vrai-
semblables hypothèses d’utilisation. Au-delà des
détails fonctionnels, il est important de souligner
la façon dont, au Second Âge du Fer, la thématique
des hommes armés et de la guerre est au cœur de
la représentation iconographique rupestre. Cette
donnée s’accorde bien avec les sources archéolo-
giques et historiques, en particulier avec ce que
nous connaissons de la spécialisation militaire
et mercenaire des tribus celtiques de la région.
Ce n’est sans doute pas un hasard si ce n’est qu’à
la fin du Ier siècle av. J.-C. que ces régions alpines
ont été placées dans la sphère de Rome en vertu
d’un accord et non suite à une conquête. Pour l’in-
terprétation de ces gravures, la représentation
de Spadonari sur les roches de l’Alpe Carolei est
fondamentale pour témoigner de l’origine pro-
tohistorique des danses armées traditionnelles,
coïncidence unique dans toutes les Alpes entre
donnée iconographique rupestre et tradition
ethnographique. Les figures de haches de Mom-
pantero peuvent également représenter un sym-
bole communautaire de la tribu qui les a gravées,
un avertissement probable et une signalisation,
peut-être à la façon de bornes frontalières de
défense territoriale.
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
79
Les hommes en armes et les armes dans l’art rupestre
Curiosités contemporaines
À titre de curiosité, voici quelques témoignages
« rupestres » contemporains, inspirés par le pas-
sage d’Hannibal, un événement qui, plus de
vingt-deux siècles après, stimule continuelle-
ment l’intérêt des médias et l’imagination du
grand public.
Le lundi 21 août 1959, après une étude
topographique où il a répertorié quelques
passages dangereux, le dompteur Darix Togni
a réussi sa tentative de passer le col du Clapier.
Il l’a franchi avec trois éléphants de son fameux
cirque, les deux femelles Monia et Cora et le
Table synoptique des figures de haches de type A, B, et C du complexe pétroglyphique de Mompantero. © Relevés Orme dell’Uomo
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.
80
Hannibal et les Alpes
BIBLIOGRAPHIE· A. Arcà, (éd.), La Spada sulla Roccia. Danze e duelli tra arte rupestre e tradizioni popolari della Valcenischia e delle valli del Moncenisio, Torino, 2009.· A. Arcà, F. M. Gambari, G. Mennella La roccia degli stambecchi : un’iscrizione latina reinterpreta incisioni dell’età del Ferro ?, Secondo convegno internazionale di archeologia rupestre. Archeologia e arte rupestre : l’Europa-le Alpi-la Valcamonica. Atti del convegno di studi, 2-5 ottobre 1997, Darfo Boario Terme, Milano, 2001, p. 83-90.· P. Bellin, Cavités ornées de Toulourenc et de l’Ouvèze, Bulletin d’Etudes Préhistoriques Alpines Aosta, XI, 1979, p. 99-106.· C. Bicknell, A Guide to the prehistoric Engravings in the Italian Maritime Alps, Bordighera, 1913. · M. Centini, Sulle orme di Annibale, indagine storica, Torino, 1987.· R.C. De Marinis, Le popolazioni alpine di stirpe retica, Italia omnium terrarum alumna : la civiltà dei veneti, reti, liguri, celti, piceni, umbri, latini, campani e iapigi, Chieco Buanchi, A M. [et al.], Milano, 1988, p. 101-155.· A. Fossati, L’età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica, Immagini di una aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte rupestre camuna : contributi in occasione della mostra, Castello Sforzesco, aprile 1991-marzo 1992, La Guardia R. (dir.), Milano, 1991, p. 11-71.· F. M. Gambari, L’arte rupestre preistorica in Piemonte alla luce delle ultime scoperte, Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques alpines, XIV, 2003, p. 235-250.· P. Grimaldi (dir.), Le spade della vita e della morte. Danze armate in Piemonte, Torino, 2001.
mâle Ton, accompagnés de deux lamas et de
deux chameaux affectés au transport des ravi-
taillements. Au cours de cette expédition tran-
salpine, Darix Togni a fait le parcours inverse de
celui supposé d’Hannibal, en partant de Suse
et en affrontant la partie la plus raide en mon-
tée, pour rejoindre en huit heures la Vallée de la
Clarée où il a passé la nuit. Il lui a ensuite fallu
douze heures pour atteindre le col du Clapier
avant de redescendre par le Mont Cenis à Suse,
où il a fait passer les éléphants sous l’arc d’Au-
guste. Un film d’environ une demi-heure, en 8
mm, provenant des archives de la famille Togni,
montre Darix gravant sur une dalle de roche
une grande silhouette d’éléphant, peinte par
la suite, ainsi que la date du passage.
De même en 1985, l’expédition Annibale 85,
parrainée par le professeur Edoardo Garello et
l’écrivain Massimo Centini, a traversé plusieurs
cols entre le Val Argentiera et le Val de Suse,
à la recherche de « l’Itinéraire ». À cette occa-
sion, a été inauguré un parcours de randonnée
archéologique allant du col du Clapier au col
Mayt, signalé par dix plaques métalliques por-
tant l’inscription « En souvenir de l’expédition
Annibale 85 ». Des petites figures d’éléphants
ont également été gravées en bas-reliefs sur les
roches par le sculpteur Frans Fersini de Turin,
notamment au col de Savine-Coche et au col
Mayt.
Petites figures d’éléphants gravées ou sculptées en bas-relief sur la roche par le sculpteur Frans Ferzini au cours de l’expédition Annibale 85 : au col de Savine-Coche (à gauche), et au col d’Ambin (à droite), 1985. © Photothèque F. Ferzini.
Extrait de : Jospin Jean-Pascal et Dalaine Laura (coord.). Hannibal et les Alpes : une traversée, un mythe. Gollion, In Folio, 2011, p. 69-80.