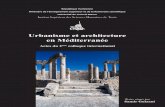Technologie et objets usuels dans l'organisation temporelle du foyer
Transcript of Technologie et objets usuels dans l'organisation temporelle du foyer
1
TECHNOLOGIE ET OBJETS USUELS DANS L’ORGANISATION TEMPORELLE DU FOYER
Natalia La Valle
"The design, enactment, and fulfilment of a project largely consists in a struggle to align assemblages of
(contingent) temporalities, from a day to the next".M. Lynch, 1991, Ordinary and scientific measurement
as ethnomethodological phenomena, p. 102.
"And much of what is involved in being a member of a culture is doing what the ‘things’ around you require". J. Bruner, 1996, The Culture of Education, p. 151.
INTRODUCTION
Depuis une quinzaine d'années, les activités ayant lieu dans l'espace domestique sont étudiées dans les champs anthropologique ou sociologique (mais aussi par des équipes mixtes de chercheurs en informatique et en sciences sociales) à partir d'enregistrements audio-vidéo d'activités ordinaires (Crabtree & Rodden, 2004 ; Korvela, 2006 ; Mondada & Balthasar, 2005 ; Nomura & al., 2005 ; Ochs & al., 2006 ; Relieu & Olszewska, 2004; Taylor & Swan, 2005 ; Tolmie & al., 2002 ; Traverso & Galatolo, 2008, entre autres). L'approche praxéologique commune à l'ensemble de ces travaux traite les phénomènes de la vie domestique à travers l'analyse des pratiques observables, leur dynamique temporelle, leur ancrage spatial et matériel et l'imbrication des modalités d'interaction entre participants. Dans cette optique, les objets ne sont pas traités comme ayant une existence autonome mais en tant
2
qu'éléments de l'outillage matériel indispensable à l'action : manipulée, spatialement distribuée, la matérialité s’ajuste à l’activité, tout en la contraignant et en la planifiant (Conein & Jacopin, 1993). Tel que le proposent depuis plus de vingt ans les auteurs des approches pragmatistes (sociologie de la traduction dans la lignée de B. Latour, ethnométhodologie, action située, cognition distribuée, etc.) la préparation, l'accomplissement et la signification de l'action sont doncrépartis entre objet, acteur et environnement [1].
Par le truchement des outils conceptuels et méthodologiquesde la linguistique interactionnelle[2], de l’Analyse Conversationnelle[3], de l’ethnométhodologie[4] et de la vidéo-ethnographie[5], ma recherche doctorale se propose d'identifier les procédés pratiques mis en œuvre et les ressources utilisées par les habitants de quelques foyers français, aux fins de l'organisation temporelle de leurs activités ordinaires. Cette recherche s’inscrit dans la contribution collective -avec Moustafa Zouinar, Marc Relieu et Laurence Pasqualetti- à unprojet pluridisciplinaire mené entre 2004 et 2007 à la division R&D de France Télécom, dont l'objectif était de développer de nouvelles technologies et services en Informatique Ambiante pour la sphère domestique. Avec les collègues cités, nous avons réalisé des enregistrements et des observations vidéo-ethnographiques auprès de quatre foyers parisiens et franciliens, pour une durée d'une semaine dans chacun d’entre eux[6]. Ainsi, un 'observatoire empirique' a été mis en place par l’équipe de recherche afin de dégager des patterns et des procédés récurrents caractéristiques d'activités domestiques réelles[7].Dans ce contexte, j’ai sélectionné et transcrit des extraits vidéo (les conventions de ce type de transcription multimodale se trouvent en fin de texte), et procédé ensuite à des analyses interactionnelles de corpus.
Cette enquête qualitative a mis en lumière un phénomène majeur, névralgique pourrait-on dire, pour la vie domestique et familiale : l’imbrication de la structuration temporelle et de la stabilisation normative des routines. En effet, tout au long de la
3
journée, les membres des foyers étudiés (notamment les adultes) projettent, évaluent, réorientent et coordonnent les multiples cours d'action des co-participants aux fins d'unordonnancement, d’une organisation partagée.L'accomplissement de cette organisation est caractérisé par trois types de pratiques : a) un travail de "segmentation reconnaissable" (Goffman, 1974) de l’action, rendant compte de l'orientation des participants vers des "structures en phases" de l'activité et des interactions humaines (Robinson & Stivers, 2001) ; b) le marquage des phases et la délimitation des duréesà travers la mobilisation de ressources interactionnelles, matérielles et technologiques ; c) des pratiques de coordination et de priorisation constamment développées et maintenues par les parents qui agissent ainsi en véritables ''chefs d'orchestre'' de l'ordre domestique[8].
Ces façons de faire, dont résulte une gestion pratique et intelligible du temps, sont outillées en matériaux verbaux, gestuels et artefactuels que les participants utilisent de manière opportuniste, selon les occasions offertes par l'espace-temps dans lequel ils sont engagés. En même temps que les pratiques s'ajustent localement aux contingences du contexte, la manière dont les participants (re)définissent activement ce contexte rend compte de leur orientation et préoccupation vers un déroulement global de la journée. Par conséquence, la structuration des activités dans le temps produit également du etdes temps que tous, adultes et enfants, traitent (ou sont censés traiter) comme étant légitimes, partagés et propres au groupe familial. Or, les orientations développées par les adultes sont souvent contestées ou résistée par d'autres membres, notamment par les enfants, en particulier lors des phases de transition d'une activité à une autre. Au regard de leur vulnérabilité et des problèmes pratiques qu’ils posent, ces moments sont donc propices à l'examen de l'émergence et de la stabilisation de pratiques, à l’observation du caractère à la fois créatif et récurrent des routines quotidiennes dans l’espace domestique.
4
Dans cet article, je décrirai comment des TICs(Technologies de l’Information et de la Communication) et d’autres objets usuels du foyer sont convoqués dans l'interaction en tant que ressources pour "segmenter" le flux actionnel, géreret projeter des transition entre activités, participant de manière cruciale à une organisation (ou réorganisation) domestiquecomplexe. Pour cela, trois séries d'extraits vidéo seront analysées pour montrer diverses modalités d'utilisation de contenus média, d’artefacts et d’objets aux fins de lastabilisation et de la négociation de transitions entre activités.
COMMENT LES TICs ET AUTRES OBJETS USUELS
PARTICIPENT A LA STRUCTURATION ET A LA STABILISATION
QUOTIDIENNES DES ROUTINES DOMESTIQUES
Au-delà de leur fonctionnalité première mais aussi grâce à leurs caractéristiques techniques ou physiques et aux modalités possibles de leur usage, les TICs et autres objets ordinaires sont mobilisés comme ressources organisationnelles de la vie familiale. Un ancrage pratique et social qui, à son tour, contribue largement à la manière dont les membres des foyers'lisent'[9], interprètent, utilisent ou détournent la matérialité et la technologie qui supportent un grand nombre d’activités à la maison. On verra que matérialité et technologie sont évoquéesdans la parole-en-interaction et/ou corporellement maniées pour projeter des clôtures ou des ouvertures de phase d'action, pour préparer à, pour faire et 'faire faire' des transitions. Or, selon les moments et les acteurs en jeu, les fins pratiques de ces productions langagières et de ces manipulations d'objets diffèrent et parfois s’opposent radicalement. D'un coté, les parents tendent à contrôler et (ré)orienter les activités et leurs cadres de participation tout en gérant un ''millefeuille'' temporel et des situations de multi-activité (co-occurrence, imbrication, suspension de cours d'action, etc.). De l'autre coté, les enfants tendent à défier ces contrôles et réorientations essayant de prolonger les activités de loisir dans lesquelles ils sont engagés, et/ou de repousser au maximum le début d’activités ou detaches qui requièrent leur collaboration. Ainsi, alors que les
5
parents (et parfois les enfants plus âgés) sont les organisateurs et les accélérateurs du rythme de vie, les enfants en sont les 'dilatateurs' et les 'retardateurs'.
Tous les extraits analysés ici son tirés du corpus du foyer à double revenu que l’on a appelé PR, composé du couple parental (Justine et Eric) et de leurs trois enfants scolarisés ou en crèche (Simon, 13 ans, Chloé, 6 ans et demi et Arthur, 2 ans et demi)[10] ; cette famille habite un grand 3 pièces à Paris.
Les deux premiers extraits illustrent la manière dont la mèreprojette l'imminence de la clôture de l'activité "regarder la télé" dans laquelle sont engagés Chloé et Arthur. On verra que Justine s'oriente vers la frontière temporelle, publiquement disponible et connue des participants, fournie par la segmentation des dessins animés en épisodes de durée régulière.
1. Les dessins animés : un découpage temporel reconnaissable et public
En effet, exploitant à la fois les propriétés physiques du signal audiovisuel en tant que contenu dynamique (émis/réceptionnégrâce à un modem/box) et le format régulier des dessins animés (délimités par des génériques musicaux), j’analyserai la manière dont la mère de famille marque le passage du temps et défini le temps restant à l'action ''regarder la télé''.
1.1. Lundi 21 mars 2005, 18h54. Justine prépare le dîner ; quand les aliments cuisent elle quitte la cuisine et sur le seuil de la porte dit à voix haute :
1 JUS bon\ j' vous fais couler le bain/ Arthur 2 et Chloé/ 3 (1.5)4 JUS hein/ . Arthur/5 ((silence))
Les enfants continuent à regarder la TV. Justine (hors-champ), va dans la salle de bain. 50 secondes plus tard on entend le
6
générique de fin du dessin animé. Les enfants se mettent à jouer puis on entend l'annonce du dessin suivant :
6 TV (et maintenant) Duffy Duck/♫
Justine apparaît dans le salon, les enfants jouent toujours :
7 CHL ((à Art?)) X (qu'il retourne)/ .. [XX8 JUS [bon\ les 9 en- (h)e- après cel- après celui-ci::/ 10 *Chloé:/ . on éteint\ . . c'est [clair/11 *marche vers l’ordinateur du salon12 ART [XXXX13 CHL oui::/ mais avant/ . on fait les fous avec 14 Arthur 15 JUS *non on fait pas les fous::/ je cherche des16 *cherche quelque chose près de l’ordi17 docume::nts (.) ça m'énerve/
(…)
Aux lignes 1-2 Justine quittant la cuisine annonce aux enfants qu'elle va faire "couler le bain". Après un assez long silence, à la l. 4 elle cherche un retour de la part du plus jeune enfant. Bien qu’aucun des deux enfants ne lui réponde (l. 5), Justine va rapidement vers la salle de bain. Dans le salon, après le générique de fin du dessin animé, Chloé et Arthur initient un jeu. Lorsqu'on entend le générique de début du dessin animé suivant Justine arrive dans le salon en prévenant les enfants, et plus particulièrement Chloé, qu'après le dessin animé qui s’apprête à commencer la télévision sera éteinte (l.8-10). Chloé, pour sa part, défie la directive parentale en plaçant un jeu (« faire les fous ») avant le bain, conditionnant ainsi à son tour l'acceptation de l'ordonnancement annoncé/projeté par l’adulte.
On voit que Justine ''lance'' à la fois le dîner et le bain des enfants, puis s’oriente corporellement vers une nouvelle activité individuelle à l’ordinateur (l. 10-11) tout en annonçant publiquement la fin de l'activité "regarder la télé". Alors que les processus de cuisson des aliments et d’écoulement de l’eau dans la baignoire se poursuivent, la temporalité établie par l’unité du (dernier) dessin animé, lui offre un créneaux disponible pour
7
travailler à l'ordinateur, tout en annonçant une fin d'activité dont l'horizon temporel est à la fois escomptable et restreint. Ainsi, la mère initie, projette et contrôle simultanément plusieurs processus et cours d'action, propres et autrui.
Plus particulièrement, la manière dont le signal télévisuel est mobilisé ici a souvent été observée chez les PR, ainsi que dans d'autres foyers. Cette utilisation récurrente de la télévision explique que le sujet pronominal (« celui-ci », l. 9) soitfacilement contextualisé et compris par Chloé (l. 13-14). Par ailleurs, la manière dont on s’oriente vers le flux et le contenu télévisuels change selon les moments, les participants et les cadres de participation : dans cet extrait, par exemple, le statut attentionnel et interactionnel du flux et du contenu télévisuels subissent d'importants changements passant d'une position depremier plan (l.1-5) à une autre d'arrière-plan (dimensionattentionnelle) pour revenir, par le truchement de l'intervention de Justine, au premier plan (dimension interactionnelle) (l. 6-17).
On a vu que les émissions télé, caractérisées par un flux son-image et par le découpage en épisodes réguliers, permettent à Justine de faire du dessin animé une "unité" de mesure temporelle pratique, bornée au début et à la fin par des génériques musicaux et des annonces de programmationéminemment publics. Sur la base des caractéristiquestechniques et des connaissances culturelles partagées par les membres des foyers, on voit ici plusieurs procédés organisationnel à l'œuvre : 1) Justine suit et contrôle l'activitédes enfants sans devoir s'approcher physiquement du lieu de l'action de ces derniers ; 2) au regard du triptyque "bain/dîner/coucher" (observé tous les jours chez les PR ainsi que dans d'autres familles), "regarder la télé" occupe uneposition de coda, constituant une dernière tranche ou phase d'activité mise à disposition des enfants avant le passage au bainet aux enchaînements successifs. Contrairement à "regarder la télé", et tout comme le dîner ou le coucher, la prise du bain des enfants demande un engagement et une présence parentaux
8
considérables ; 3) Ainsi, la mise à disposition de cette dernière phase permet aux enfants d'anticiper et de se préparer à la transition et, conséquemment, permet à Justine de disposer d'un créneau d’action individuelle relativement garanti "sans sollicitations" (de la part des enfants) ; 4) plus globalement, on peut dire qu’en plus de leur caractère graduel, et multi-cadre(au niveau des cadres de participation la gestion des transitions peut comme ici concerner simultanément des activités d’autrui, d’une part, et des activités propres, de l’autre, et ce de façon imbriquée) les transitions se réalisent souvent "sans coupure". Je veux dire par là que les procédés organisationnels dépliés par les adultes leur permettent de rationaliser et d’optimiser les temporalités des divers cours d’actions, avec un minimum de "temps morts" ou vides.
Comme le premier extrait, le suivant rend compte de connaissances pratiques partagées par les membres en ce qui concerne la segmentation des émissions télé et sa pertinence pour l'organisation de la soirée, bien qu’ici ces connaissancessoutiennent des modalités de contrôle parental périphériques et minimales, ainsi que des modalité de résistance enfantine au contrôle, tout aussi minimales.
1.2. Lundi 21 mars 2005, 18h41. Quelques minutes avant de la scène extrait 1.1. Ici, Justine travaille à l'ordinateur, tournée à 30° vers Chloé et Arthur qui regardent la télévision. On entend le générique de fin d'un dessin animé :
1 TV ♪ Scooby Dooby Doo: ♪ . [où est-tu/♪2 JUS [BO::N\ #13 (0.8)4 CHL mais atte:::nds/ c'est pas °la fin°
9
Image # 1
Chloé chante le générique de fin alors que Justine, sans s'orienter vers les enfants, poursuit pendant quelques secondes son activité à l'ordinateur. Lorsque la TV annonce le dessin suivant, Justine commence à éteindre le PC ; quelques secondes plus tard elle ira dans la cuisine pour préparer le dîner.
Dans cet extrait, la chanson annonçant la fin du dessin animé vient à peine de commencer lorsque la mère produit un tour pré-clôturant : le "bon" (l. 2) utilisé ici, avec une prosodie appuyée et un ton descendant marquent assez typiquement la fin d'un 'topic' ou thème, conversationnel, ou, plus généralement, la fin d'une phase d'action. Chloé, réciproquement, traite cet énoncé minimal en tant que pré-cloture et le conteste (l.4) argumentant que le dessin animé n'est pas encore fini. Cet échange "pré-clôture/refus de clôture" est réalisé sans que les interlocutrices ne changent ni l'orientation corporelle ni le cours de leurs actions principales respectives. L'échange n'a pas de suite : Justine poursuit son travail à l’ordinateur pendant quelques secondes puis s'engage dans d'autres activités, alors que lesenfants continuent de regarder la télé.
Ce bref extrait rend observable : 1) le fait que la mère, bien que prêtant une attention périphérique à ce que font les enfants, peut s'engager dans des 'monitorings' ou séquences de contrôlese servant du flux audio de la télévision afin de segmenter l'activité en cours (regarder la télé) ; 2) là où il est produit, le tour de parole de Justine est traité par Chloé en tant que pré-
10
clôture imminente, menaçante pour l'activité en cours ; 3) comme pour le premier extrait, les participants configurent le salon en tant qu'espace commun où se déploient des activités relativement autonomes pouvant se rejoindre à tout moment[11].
Comme toute image-récit, nécessairement déployée dans le temps, le dessin animé télévisuel non seulement véhicule un contenu mais il ''façonne'' aussi le temps, contribuant à sa structuration. En tant que séquence audiovisuelle, le dessin animé est à la fois une ressource et une contrainte pour les participants : puisqu’il fonctionne comme créneau prédéfini, il permet d’une part une attribution temporelle stable correspondante à la durée de l'activité de visualisation et, d'autre part, exige une acceptation de frontières plutôt figées et peu négociables. En effet, les deux premiers extraits montrent comment les membres négocient le nombre d'unités à visionner, leur position et leur hiérarchie dans les enchaînementsd’actions, alors que leur durée (ainsi que celle de l’unitéchanson, comme on le verra plus loin) est moins négociable.
C'est ainsi que les émissions télévisuelles sont configurées par les parents et par les enfants comme des "donneurs de temps" (Amphoux, 1988) technologiques : elles exhibent une durée prévisible, partagée et empiriquement reconnaissable et marquent une frontière temporelle endogène (vs. des frontières de temps standard établies par des horloges, par ex.) propre aux activités dans laquelle sont engagés les acteurs.
Au regard de la clôture d’activité ''regarder la télé'' amorcée parJustine et contestée par Chloé dans le deuxième extrait, les interventions parentales du premier extrait, lignes 1 à 3, puis lignes 9 à 11, se placent rétrospectivement dans une "série" de rappels à l'ordre domestique. Un ordre qui, comme on le voit,est construit à la fois localement, dans les séquences conversationnelles et le pas-à-pas interactionnel de la soirée, etglobalement, à l’échelle des expériences passées que constituent des activités et des enchaînements d’activités routinisés, quotidiens et cycliques.
11
2. L'organisation de la matinée : de la musique à la télé et vice-versa
Deux extraits d'enregistrements du matin seront maintenant analysés afin d'examiner la manière dont la télévision est mobilisée en combinaison avec l'utilisation d’autres artefacts technologiques ordinaires, tels que la chaîne Hi-fi. Flux télévisuel et morceaux de musique s’enchaînent et s’imbriquent au cours et au service de la gestion parentale des activités et demandes des enfants. Le premier extrait concerne la transition de l'activité en cours ''écouter de la musique'' (proposée par la mère) vers celle de ''regarder la télé'' (demandée par un des enfants), alors que le deuxième extrait illustre la pratique et l’enchaînement inverse.
2.1. Mercredi 23 mars 2005, 8h18. Arthur est au lit alors que dans le salon Chloé, en pyjama, lit un livre ; Justine ouvre les fenêtres pour aérer la pièce.
1 JUS on s'est pas écouté notre musique du matin 2 (1) ((souriant)) °petite *musique du matin°3 *va mettre 1 disque
Chloé et Jus. se coiffent ; peu après Arthur se lève.
4 ART ((hors-champ)) maman/ . °(re)garder la télé° 5 JUS (at)tends/ >'tends 'tends tends< d'abord on 6 s'écoute un musique\ je voulais faire 7 écouter ça à Chloé *regarde8 *change de disque10 ART ((plaintif)) (re)ga[rder la télé11 JUS [non attends . n::on12 Arthur/ tu vas pas tout nous XXX avec ta 13 télé::/ écoute [bien . écoute 14 ART [xx ((pleurnichant))15 JUS oui je vais te donner le biberon/ d'abord 16 on met une musique parce que Chloé je 17 (voudrais) bien voir les mots d'espagnol 18 qu'elle reconnaît 19 ART no:n . *X20 *se rapproche de la TV21 JUS mh/ terrible Arthur avec sa télé/22 ART °regarder°23 JUS attends/ juste une chanson
12
Plusieurs lignes omises. Chloé continue à lire.
24 ART ((pleurant)) la: té:::lé:::25 JUS j- j' te la mets mais on met pas l' son 26 trop fort
JUS met le morceau recherché
Mus ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ 27 ART XX ((il pleure))28 JUS ((à Art)) #2 tiens* 29 *allume TV, règle vol.
Plusieurs lignes omisesMus ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ 30 CHL se tourne vers écran #3 -----------31 (2)32 JUS après j'éteins Chloé . c'est juste -----------------------------------Mus ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ 33 cette chan[son 34 CHL [XXX -----------------------------------
# 2 # 3
35 (2) ---------------|*
36 CHL *reprend lecture
Presque deux minutes s'écoulent
Mus ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ 37 JUS s'assoit s/canapé et met chaussure n°1 #4Mus ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫ ♫♫♫♫
Fin du morceau38 (0.8)39 JUS et voilà::::/*40 *finit de chausser ch.n°1 &
se lève ch. n°2 à la main
Justine
ArthurChloé
13
41 JUS #5 tu vois/* j'avais dit juste une musique42 *va vers chaîne H-F, arrete disque
#4 #5
Justine va donc enlever le disque sans avoir encore enfilé la chaussure n°2.
Au début de cet extrait, une fois les fenêtres ouvertes, Justine va mettre de la musique pour elle et pour sa fille tout en rendant compte que l'écoute musicale des mercredis (et parfois d'autres jours) n'a pas encore eu lieu (l. 1-3). Lorsque, quelques minutes plus tard, Arthur apparaît dans le salon, il demande immédiatement de ''regarder la télé'' (l. 4). La mère, tout en réalisant des manipulations sur la chaîne Hi-Fi, refuse la requête d’Arthur, puis justifie son refus par le fait qu'elle souhaite faire écouter quelque chose à Chloé (l. 5 à 8). Cette dernière partie du tour est d’ailleurs produite en même temps que le disque est remplacé.
Face aux plaintes insistantes d'Arthur (l. 10, puis l. 14), Justine refuse en premier lieu d'allumer la télé, traitée comme intrusive par rapport à son activité avec Chloé, puis incite le jeune garçon à écouter la musique qui commence (l.11-13). Après une nouvelle plainte du garçonnet, le refus de la mèrechange de forme : d’abord elle lui annonce qu'il aura son biberon (partie de son petit déjeuner) puis elle reprend l'ordre séquentiel des activités préalablement projetées. Il s'agit cette fois-ci d'un report plutôt que d'un véritable refus : en exposant
JUS
14
la raison pour laquelle elle veut écouter un morceau particulier (l. 16-18) Justine fournit un argument ou account[12] à Arthur ; aussi, sur le plan des cadres de participation, elle s'adresse simultanément aux deux enfants, incluant Chloé dans le projet d'activité (alors que la fillette continue à lire). Or, à la l. 19Arthur, combine une nouvelle plainte avec un mouvementcorporel de rapprochement vers le poste de TV. Après une évaluation négative du comportement insistant d’Arthur (l.21) la mère produit une nouvelle explication, ou account mettant davantage d’emphase notamment sur le plan prosodique, sur la finitude de l'activité (l. 23). Aux lignes 25-26on voit que Justine finit par céder aux demandes d'Arthur, à condition de ne pas mettre le son "trop fort". Arthur s'installe alors sur le canapé, près de sa sœur, qui continue de lire. On voit ici que la mère cherche à rendre compatible la superposition des activités, donc, sur un plan matériel et perceptif, les flux musical et télévisuel. Or, l’écran allumé de la télévision attire l'attention de Chloé. Ce nouveau focus attentionnel demande à ce que l’horizon temporel du contexte d’action, ainsi que ses priorités, soient redéfinis : ainsi entre les l. 32 et 33 Justine annonce à Chloé la fin imminente de l'activité 'écouter la musique''.
Lorsque le morceau musical arrive à sa fin, Justine, installée sur le canapé, commence à enfiler une première chaussure. Saisissant le silence qui suit la fin de la chanson, Justine produit l'énoncé de l. 39, marquant ainsi verbalement et interactionnellement la fin du morceau. Je souhaite attirer l'attention sur le fait que Justine se lève avec la deuxième chaussure à la main, encore chaussée d'une pantoufle, pour aller enlever le disque et éteindre la chaîne. Elle est déjà en mouvement vers la chaîne lorsqu'elle dit : "tu vois, j'avais dit juste une musique" (l. 41-42), rendant explicite son action en cours et confirmant la fin de l'activité ''écouter la musique''. Cette partie de l'extrait est exemplaire des pratiques de mise en intelligibilité observées dans la sphère domestique : alors qu'elle s'est installée sur le canapé pour se chausser, Justine suspend son action en cours de route (avec une seule chaussure enfilée) afin d'atteindre la chaîne Hi-fi pour arrêter le disque au momentoù le morceau prend fin (ni avant, ni après). De cette façon,
15
avec des moyens verbaux, corporels et techniques, Justine s'efforce de faire correspondre l'arrêt physique du flux audioavec la segmentation temporelle et pratique mobilisée dans ses multiples annonces : l’unité de mesure temporelle de type "musique/chanson" est fabriquée dans, par et pour l’action, à travers des bornages pratiques, des procédés verbaux et non-verbaux de structuration, des ancrages matériels et symboliques,des quantifications. Cette manière de faire confirme réflexivement la pertinence organisationnelle de ce type d'unité et lui confère une valeur appréhensible et prévisible par les membres, y compris les moins "compétents" au regard du maniement temporel, comme dans le cas d'Arthur. On voit l’importance de l'ancrage artefactuel, spatial et matériel des activités et des relations inter-subjectives ayant lieu dans la sphère domestique et familiale, dans l’étude des pratiques d'apprentissage de la vie ordinaire et de sa normativité, et plus largement, des phénomènes de production et de maintien d’un certain ordre social.
Justine s’oriente vers la chaîne Hi-Fi (ou plutôt vers la lecture et la manipulation des CDs) non pas de manière abstraite, sur le plan des fonctionnalités, mais en tant qu’artefact ancré dans des actions dont il s’agit d'assurer la transition, et de concilier les divers cadres de participation, tout en gérant la tenue générale de la routine matinale. Ce que la théorie des scripts décrit comme des caractéristiques ontologiques de la technique (vitesse, rythme, interruption/continuité, etc.), qui imposeraient aux utilisateurs des modes d'action conformes à un temps donné (cf. Shove, 2003, p. 175, par ex.) résulte de notre point de vue de la manière dont la mère saisit le découpage du flux acoustique en morceaux -séparés par des silences- aux fins pratiques de sa gestion temporelle de l’action collective, constituant ainsi des unités et un script intelligible et disponible publiquement.
Comme annoncé plus haut, le suivant extrait se penchera surla transition entre ''regarder la télé'' et ''écouter de la musique'',c’est à dire en sens inverse par rapport à l’extrait 2.1.
16
2.2. Vendredi 25 mars 2005, 7h40. Dans le salon. Arthur regarde la télévision alors que Justine termine de ranger le canapé lit des parents. Simon et Chloé sont dans leur chambre.
1 JUS (on) va pas mettre la télé toute la2 matinée hein/ . chéri3 (1)4 JUS on va bientôt [éteindre\ & 5 ART [X6 JUS & *d'accord/7 *regarde vers Arth et TV ------------8 ART se tourne vers JUS9 (1.5)
---------------------------------10 JUS >si si si< on va se mettre un peu de &
--------|11 & musi::*que/ #612 *pose vêtements de Art s/table
#6
13 (1)14 ART °no:::::n/°15 JUS range affaires((continue de regarder la TV))
A 7h41 Arthur invite Chloé à regarder Scooby-Doo. Elle hésite puis accepte ; Justine va dans la cuisine.
A 7:4316 JUS ((depuis cuisine)) Chloé:/
Arthur
JUS
17
17 (1)18 CHL *ou:i::[:/]19 *se tourne vers Jus #720 JUS [à la] fin de ce Scooby-Doo on 21 éteint\ . d'accord/
# 7
22 CHL se tourne à nouveau vers TV23 (0.8)24 CHL si (y en) a un autre
7:47:1326 TV "annonce émission suivante"27 CHL ah ouais/ . bon ça va\*28 *descend du canapé29 CHL y a pas d'autre Scooby-Doo30 CHL va s'habiller dans sa chambre 31 ART reste devant la TV
7:50:3432 JUS ((hors-champ)) bon\ *(1) monsieur Arthu:r\ & 33 *va dans salon34 & voilà/ (0.5) on arrete maintena::nt/ 35 on >va mettre un peu de musique< 36 ART se tourne vers Jus37 JUS d'accord/ 38 (1)39 JUS *tiens regarde Elvis\ ça/ chuis sure que & 40 *manipule la chaine Hi-Fi41 & tu vas adorer\ °qu'est-ce que c'est ça/< 42 Astrud Gilberto h:: c'est pas pour se 43 réveiller Astrud Gilberto° . Elvis/ ça va 44 nous réveiller davantage (1.5) allez/45 (5) ((JUS cherche un morceau musical))
Arthur
Chloé
18
46 ART c'est pas [ça::/]47 JUS [ah ça:] .. écoute ça\ ça 48 c'est *pour Arthur 49 *va vers TV50 JUS *éteint la TV #851 ART *se tourne vers TV ------------------- 52 JUS c'est la musique d'Arthur ça\
-------------------------------------- 53 JUS monte le son, se met à danser
-------------------------------|54 ART ((rit, taquiné par Jus)) #9
#8 #9
Entre les l. 1 et 7 on voit que la mère, affairée et en mouvement dans l'appartement, prévient Arthur que le poste ne restera pas allumé « toute la matinée » (expression hyperboliquequi participe à l’apprentissage -épistémique et pratique- des temps sociaux, ici des phases de la journée) et qu'il sera éteintdans un court délais. Malgré la tentative de Justine pour que le jeune enfant s'aligne sur cette nouvelle dynamique d’action (l. 6), Arthur ne répond pas. Aux tours suivants, la mère confirme d'abord l'annonce d’arrêt de la diffusion télévisuelle, puis, tout en rangeant des vêtements, elle projette une nouvelle activité : écouter de la musique. Celle-ci "déplace" en quelque sorte l'activité centrée sur la TV ; à nouveau, la prospection de l'ordre séquentiel des actions est un procédé central pour configurer et coordonner un temps collectif.
19
Or, peu après, lorsque Chloé rejoint Arthur dans le salon, ce dernier l'invite à regarder un dessin animé ensemble (il s'agit d’un des dessins préférés de ces enfants) : l'activité 'télé' se voit ainsi prolongée. Face à ce prolongement et au nouveau cadre de participation coté salon, quelques minutes après Justine interpelle Chloé depuis la cuisine : comme précédemment, ici l'unité temporelle mobilisée est le dessin animé (l. 16-21). Justine cherche à nouveau une confirmation/acceptation, cette foi-ci de la part de Chloé, qui répond en défiant la structuration que cherche à imposer Justine (l. 24). Le dessin animé qu’ils étaient en train de regarder se termine et Chloé va s'habiller dans sa chambre (ayant préalablement vérifié qu'elle ne ratera pas un épisode de Scooby Doo ! l.27-29). Arthur reste à nouveau seul devant le poste et quelques minutes après Justine le rejoint : elle regagne le salon tout en projetant verbalement laclôture, dans la continuité des annonces précédentes (l. 32-35). L'annonce de l'activité suivante est répétée avec la même syntaxe qu'aux tours des l. 10-11. Stratégiquement postée près de la chaîne, Justine verbalise l'ensemble des actions, à l'intention d'Arthur, qui reste orienté vers la TV encore allumée : la mère encourage le garçonnet à écouter la musique qu’elle vapasser, puis, tout en cherchant un morceau, elle justifie son choix cherchant à aguicher Arthur (l. 39-44).
Comme on le voit, les pratiques de ''réveil musical'' dans cette famille sont récurrentes ; en particulier, la projection imminente de l'écoute musicale et l'incitation de la part de Justine (« écoute ça ») tend ici à détourner l'attention d'un co-participant de la TV encore allumée. Mais les flux musicaux et télévisuels se superposent : comment Justine gère-t-elle ce problème pratique tout autant que technique ? Entre les l. 48 et 52 on voit que, sur le plan discursif, en même temps qu'elle s’approche de la TV, puis qu'elle appuie sur le bouton on /offpour éteindre le poste télé, Justine parle de ''musique pour Arthur'', puis, au moment critique de l’extinction du poste, reformule le tour : il s'agit désormais de la "musique de Arthur". Sur le plan plus matériel, soulignons que la mère laisse la télévision allumée jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le flux musical soit perceptible à l’enfant et que l'activité
20
préparatoire à la musique soit verbalisée, argumentée et rendue "attrayante". La continuité perceptive du support du cours d'action qu'il s'agit de clore est ainsi garantie par une transition par "superposition" et "glissement", vers la nouvelle activité du matin.
Dans un environnement technologique relativement complexe, la superposition des flux télévisuel et musical et le passage graduel de l'un à l'autre sont activement constitués en un matériau perceptuel continu au service d'un procédé d'organisation déployé dans l'interaction. Par ailleurs, les interventions de la mère se poursuivent après l'extinction du poste : elle claque des doigts et danse au rythme de la musique jusqu'à ce que Arthur semble entièrement engagé dans la nouvelle activité. Des engagements corporels multimodaux (du sonore, du visuel et du mouvement) sont ainsi à l'œuvre pour modifier l'orientation et l'engagement du co-participant. Bien que la musique soit audible et qu'elle ait déjà été configuréediscursivement en tant que nouvelle activité en cours, Justine attire visuellement l'attention d’Arthur, peut être dans le but decompenser, au regard du nouveau contexte, l’attrait perceptuel, audio et visuel de la télévision. Comme on le voit, corps, interaction et technique ne sont jamais loin. Crucialement, dans des espaces fortement outillés tels que les espaces domestiques,les éléments saillants et pertinents pour l’action ne relèvent pas uniquement de l’action que l’on initie (ou que l’on souhaite initier) mais aussi de l’action qui précède et des possibilités techniques, perceptuelles et d’agencement offertes par l’environnement pour imbriquer, pour passer de l’une à l’autrede manière plus ou moins graduelle.
3. Des objets hétérogènes et 'flexibles' dans la négociation de transitions d'activités
Par cette dernière série d'extraits je vais montrer comment des objets autres que les TICs font partie des moyens pertinents pour organiser la temporalité des cours d'action à la maison. Ici on verra comment un livre et un pot de yaourt, à la différence
21
des artefacts 'émetteurs' de flux segmentables en unités fixée par les caractéristiques techniques des artefacts, semblent être des objets conteneurs de 'substances' dont le débit de "consommation" est plus flexible.
3.1. Mardi 22 mars 2005, 20h21. Après le dîner Justine et Chloé s'installent pour lire une bande dessinée ; Arthur est près d'elles sur le canapé. La télé est allumée (volume bas). Chloé commence à lire à haute voix lorsque Arthur la taquine puis la frappe ; Justine le gronde et ensuite dit à Chloé :
1 JUS Chloé écoute-moi ((à Art)) XXXX >Chloé2 écoute-moi on lit ça/< après on va 3 mettre le pyjama et on va au lit 4 CHL ((commence la lecture))5 ART taquine et frappe Chloé à nouveau
Justine essaie de distraire Arthur ; une fois celui-ci parti, elle propose à Chloé de lui lire elle-même l'histoire. Justine commence, mais Arthur revient à la charge
20:23
6 JUS ((fâchée)) *mais/ ça VA PAS Arthur/ 7 *regarde fixement Art8 JUS ((fâchée) j'ai lu les *livres avec toi &9 *touche livres 10 & maintenant je lis les livres avec 11 Chloé (...)
Trois lignes omises
12 JUS on- Chloé/ on lit UNE histoire\(…)
20:27 - Justine vient de finir la lecture et fait un commentaire sur un personnage de l'histoire :
13 JUS exagère un peu X*X14 *se détache de Chl reg TV 15 (6)16 CHL ((soupirant)) oh là là: elle est 17 court(e) celle-là::/18 (3.5)19 JUS se tourne vers C20 JUS bo:n\ . . [(nous a-)21 CHL [*qu'est-ce qu'elle est courte 22 *se jette en arrière s/canapé
22
23 celle-là:::24 JUS ouais °(dis) X°
Huit lignes omises
25 JUS oui allez/ (1) *on va se mettre en pij'/ 26 *commence à bailler27 et on va au dodo\ *Chloé/ 28 *reg. vers TV29 CHL la frite qui pi:que/ s'il te plai::t X 30 (dernière) h.[X31 JUS [attends >je (re)garde< 32 *juste ça\33 JUS *monte volume et regarde émission (JT)34 (30)35 JUS *°bon\ .. allez/°36 *détache corps, détourne regard de TV37 CHL h. mais (tu) XXXX::/= 38 JUS =j- Chloé/ on lit la frite qui [pique et 39 aprè-40 CHL [je peux 41 te lire °XX°42 JUS mh:::43 (…)
Ici, les participantes s'engagent dans une activité de lecture tout en devant gérer en même temps les interruptions et le mécontentement d'un co-participant. On voit que la mère demande à Chloé de l'écouter pour lui annoncer les activités à venir et leur ordre séquentiel : elles vont lire "ça", c'est-à-dire le matériel qui les occupe déjà, puis elles vont s'orienter vers les activités de préparation du coucher. La lecture est donc désormais encastrée dans une série ordonnée d'actions (l. 1-3). Après plusieurs tentatives pour calmer et éloigner Arthur, la mère demande à Chloé de la remplacer pour lire l'histoire. Alors le rythme de la lecture s'accélère considérablement. Après une énième intervention de Justine à l'encontre du petit Arthur qui poursuit ses 'abordages', la mère interpelle Chloé en lui annonçant qu'elles vont lire "une histoire". A travers la mobilisation et le dénombrement de l'unité "histoire", Justine précise la modalité et la durée approximative (envisageable par la connaissance que les participantes ont de ces livres) de l'activité projetée précédemment.
Lorsque Justine finit la lecture elle éloigne son torse de Chloé, puis, se tourne vers la télé allumée. Ces deux
23
mouvements consécutifs sont interprétés par Chloé comme un désengagement de la mère de l'activité partagée. Après un long silence pendant lequel Justine regarde l'écran, Chloé se plaint du la courte durée de l'histoire lue, en utilisant une construction pronominale. Mais, comme dans d’autres cas, le manque de référent ne pose aucun problème à l'interaction : les co-participantes connaissent les enjeux de l'activité et de son évaluation. Puis Justine se tourne à nouveau vers sa fille et produit un "bon" qui, comme on l'a déjà vu (extrait 1.2.), annonce la "clôture" d'une phase de la conversation, ou plus globalement, d'une phase d'action. Face à la "menace" que pèse sur l'activité conjointe avec Justine, Chloé reprend et renforce sa plainte sur la durée de l'histoire (l.9-11), s'enfonçant davantage dans le canapé. Parole et corps s'articulent de manière à rendre le plus visible possible l'orientation de Chloé vers la suite, et non pas vers la fin, de l'activité en cours. Mais aux l.25-28 est produite une injonction parentale à double tiroir (mettre le pyjama puis, en conséquence, aller dormir), injonction accompagnée d'un bâillement de la mère, ce qui vient renforcer la pression temporelle sur la lecture. Suit alors une assez longue séquence de négociation explicite sur le plan verbal (l.29-39) : Chloé demande une dernière histoire en la nommant par son titre mais Justine se désengage quelques secondes du travail de "clôture de l'activité commune", en s’orientant vers la TV. Puis, de manière elliptique mais tout à fait claire pour Chloé Justine produit une clôture d'activité semblable à celle de l. 20, bien que plus emphatique : le "bon" clôturant est accompagné du "allez" qui inaugure la nouvelle phase. A la l. 37, l'énième insistance de Chloé aboutit et la mère accède à une dernière lecture (l.38-39), tout en amorçant "et après". L'acceptation parentale de la dernière lecture réclamée exige le rappel des contraintes de la routine du soir.
3.2. Lundi 21 mars 2005, 20h05 : Simon est le seul encore à table : assis, il mange un yaourt et regarde de temps à autres les informations à la télévision. Alors qu'Eric s'occupe de Chloé et d'Arthur (hors-champ) Justine débarrasse. Elle demande de l'aide à Simon :
24
20:05:051 JUS dit Simon s'il te plaît . tu veux bien 2 (passer) faire passer les XX hein/ . . 3 SimSim/ . *t'as pas fini\4 SIM *se remet à manger yaourt
Justine poursuit le débarrassage et Simon continue à manger le yaourt.
#10 #11
5 minutes s'écoulent ; Justine interpelle Simon depuis la cuisine (interaction à travers le passe-plat).
20:09:435 JUS *dit Simo:n/ t'es sympa/ mais t-6 *range affaires dans lave-vaisselle7 tu:: tu prends un peu de temps/ pour8 >manger ton yaourt<9 (5)10 JUS serait-ce fait exprès/11 (7.5) JUS poursuit le rangement12 JUS tiens/* . tu me passe eu:::: #1213 *regarde Simon par passe-plat14 SIM *met cuillère dans sa bouche15 JUS *oui [ben non\ ((ton plaintif)) 16 SIM [*tu vas voter non toi/ alors/17 *tourné vers Jus, il tient yaourt
JUS
Simon
25
#12
18 (0.5)19 JUS °non\° 20 SIM Thierry il est pour #1321 no*(n) 22 *met cuillère dans bouche
#13
23 JUS oui j' sais X XX (1) tiens\24 SIM pose pot yaourt vide sur table25 SIM *°XX°26 *regarde Jus par passe-plat27 JUS pas- passe-moi les affaires à::: 28 débarrasser/ 29 SIM passe paquet de sucre, tjs assis 30 JUS *pfffff/31 *saisit le sucre32 JUS ((ironique)) ▪ça va/ . . pas trop & 33 ▪fixe Sim, tape s/paquet34 & vite le matin/ doucement l'après 35 midi/36 SIM qu'est-ce qu'y a:/(…)
26
Face à la demande d'aide formulée par Justine, Simon ne réagit guère ; face à cela, Justine évoque le fait qu’il n’a pas encore fini le repas et cesse temporairement et légitimement de le solliciter (l. 1-4). A partir de ce moment et jusqu’à la l. 22(plusieurs minutes plus tard), Simon réalise un très long ''étirement'' temporel de l’activité 'manger le yaourt', qui le dispense de s’engager dans le débarrassage avec Justine. Il exhibe à tout moment, avec son corps et grâce au support matériel de la cuillère et du pot de yaourt, l’incomplétude de l’action. Simon réussi ainsi à se soustraire aux sollicitations parentales pendant un temps relativement long. Or, un peu plus tard, cette façon de faire est traitée comme une ruse par Justine qui, toujours prise dans le débarrassage et le rangement, interpelle Simon d'un ton ironique : d’abord elle souligne le fait qu’il prend trop de temps (par rapport à une moyenne dictée par le sens commun et l’expérience pratique) et le taquine ironiquement sur son ''éventuelle'' intentionnalité (l. 7 à 10).
Malgré le fait que le comportement de Simon est désormais constitué en trouvaille pour échapper aux taches domestiques, Simon poursuit le procédé d’étirement, en particulier lors des échanges face-à-face avec Justine à travers l’ouverture entre salon et cuisine (l. 12-17 ; 21-22 ; etc.) alors que Justine rend compte, de plus en plus explicitement sur le plan conversationnel, de la nécessité pour Simon de clore le repasafin que les taches de débarrassage (auxquelles il doit participer) soient menées à bien (12-13 ; 23-28). La fin de l'extrait montre que Simon, bien qu'il accède à la demande de collaboration, reste peu proactif (garde sa position assise, met trop de temps aux yeux de Justine à faire passer les affaires, etc.). Justine finit par s'agacer devant la situation (l. 29 à 35), alors que Simon traite sa réaction comme étant opaque (l. 36).
On a vu que dans les deux derniers extraits, les acteurs négocient la durée de l'action non pas sur la base de flux déjà segmentés, d'unités fournies par un fonctionnement technique ou médiatique donné, mais à partir de connaissances de "sens commun" sur la lecture d'un texte e sur l'ingestion d'aliments.
27
On pourrait dire que les pages du livre et le pot de yaourt 'contiennent' des substances que l’on 'consomme' à débitsflexibles : l'histoire peut être lue par des participants différents et à différents rythmes, le yaourt mangé plus ou moins rapidement (dans le cadre de certaines ''limites''). La temporalité des flux et contenus provenant d'artefacts émetteurs ou lecteurs,comme la télévision ou la chaîne audio, est en revanche plus rigide, imposant un rythme d’écoute et de lecture plus contraignants. Néanmoins, la flexibilité de la lecture humaine ou de la consommation d’un dessert est relative : les objets et leur propriétés matérielles (la taille de la bande dessinée ou la quantité de yaourt dans le pot) deviennent des supports d'actiondans la mesure où ils sont intégrés à des temporalités plus larges et interdépendantes, dans la mesure où les acteurs les mobilisentde manière reconnaissable et acceptable. C’est la condition pour que ces objets, avec leurs particularités et différences, puissent être traités comme autant d'unités "donneuses de temps" constitutives du vaste répertoire d’outils organisationnels développés dans le foyer. Ainsi, les objets du monde servent non seulement comme signaux, comme "aide-mémoire" individuels mais participent au travail de distribution de tâches cognitives et interactionnelles complexes.
DISCUSSION
Si des éléments aussi hétérogènes que des contenus télévisuels ou musicaux, un livre ou de la nourriture peuvent devenir des supports pour organiser la vie de famille au quotidien, c'est d'abord parce que, comme l'a montré la théorie de l'activité, toute activité humaine est médiatisée par des artefacts culturellement élaborés et par des relations sociales (Engeström,1999). Plus particulièrement, j'ai montré que la coordination des divers cours d'action de la journée est en partie soutenue par des objets ou artefacts caractérisés par une utilisation (ou consommation) ne pouvant avoir lieu que sur une temporalité relativement longue, des objets dont la 'substance' (plus ou
28
moins tangible) est découpée et découpable en unités pratiques telles que le dessin animé, le morceau de musique, l'histoire à lire ou le pot de yaourt.
Plusieurs approchent définissent les scripts temporels comme étant propres au fonctionnement des artefacts, incorporée à la technique et imposée à l'action. De notre point de vue, il ne s’agit pas tant d'une exigence temporelle figée mais d'une exigence potentielle actualisée par l'exigence temporelle du déploiement structuré de l'action collective. Si ce déploiement, comme nous l’avons vu, est en grande partie soutenu par des artefacts ayant un fonctionnement et des caractéristiques propres, on ne peut comprendre, dans le cas de la chaîne Hi-Fi, par exemple, comment des simples coupures du flux perceptif -relativement flexibles sur le plan temporel- sont configurées, par le truchement d'un travail fin de la part de l’adulte, en des unités de mesure ''prélevables'' et publiquement mobilisables pour organiser les actions dans le temps. Par ailleurs, les visées éducatives des diverses interventions parentales (insistant sur l'ajustement des actions et des accounts, ainsi que sur le décompte des unités temporelles pratiques), sont également centrales pour comprendre ces phénomènes. Pour résumer :
1) Technologie et objets sont exploités aux fins pratiques de l'organisation des activités qu'ils supportent. Ils opèrent en tant que "donneurs de temps" de l'action qu’ils supportent, mais aussi de cours d'action parallèle, passés ou à venir. En effet, les membres chercher à produire des segmentations reconnaissables des cours d'action et d'activité, segmentations dont l'épaisseur temporelle permet de marquer, et de projeter, des actions pour soi et pour autrui, ou encore de réaliser des calculs pratiques avec un engagement attentionnel plus oumoins périphérique. En tant que ressources mobilisées dans la structuration temporelle de la vie quotidienne, les unités pratiques de mesure ne sont pas simplement offertes par la technologie mais sont plutôt produites par les usages : relativement flexibles mais à la durée prévisible, grâce à desconnaissances partagées dont disposent les membres, ces unités
29
ne prennent forme que dans la mesure où –ancrées dans les pratiques et dans leur mise en intelligibilité- elles sont également ancrées dans les temporalités locales et globales. Locales de l'action en cours, et globales au fil de la sédimentation des routines, dans une temporalité plus longue et cyclique. A court et moyen terme, donc, et sur la base de lastructuration des journées et de leurs phases, les pratiques observées se déploient grâce à (et contraintes par) un environnement matériel et social complexe. Ainsi, les membres (notamment les adultes) s'orientent vers la légitimité, l'attrait et, plus généralement, les potentialités[13] -ou affordances- offertespar les objets ''à toutes fins organisationnelles''.
2) Comme cela apparaît également dans d'autres études, les parents (souvent les mères) réalisent un effort permanent de coordination, d'évaluation, de priorisation et de publicisation des actions en cours et à venir, travail mené dans des contextes multi-participants et, surtout, multi-activité. Justine agit en effeten véritable chef d'orchestre (Taylor & Swan, 2005) : il s'agitpour de coordonner le "jeu" (ici les actions et activités) des co-participants pour le rendre "cohérent" et imposer un certain rythme. Par ailleurs, elle ne dirige pas toujours un groupes homogène mais, souvent, coordonne des dyades (ou des triades), des 'solistes' et des sous-groupes entre eux ; pour cela, la mère utilise tout son corps, la parole-en-interaction, les déplacements dans l'espace et, bien sûr, des ressources matérielles (toutes ces ressources sont également exploitées par les co-participants, comme on l'a vu lors des phases de négociation ou résistance). Il s'agit aussi pour la mère d'interpréter publiquement le contexte, de hiérarchiser et de modifier des actions selon une vision globale du déroulement de la journée. Enfin, ce travail se réalise à travers une publicisation constante des activités en cours, de leur projectabilité et de la directionnalité de l'action. Malgré la forte analogie entre parents et chefs d'orchestre, les procédés organisationnels développés dans les foyers semblent se rapprocher davantage des standards de jazz et des ''compétences pratiques incorporées'' qu’ils exigent (Sudnow, 1978) que des partitions classiques : connus et massivement interprétés par l'ensemble
30
des membres, ces 'standards' font partie d'un répertoire commun qui permet d'improviser et de retravailler les manières d'accomplir des routines ordinaires en ajustement avec les contingences et les contraintes.
3) L'écologie de l'espace domestique est un mille-feuilles spatio-temporel qui favorise la multi-activité et des formes particulières de co-présence : les 'espaces communs' ne sont pas figés dans les structures architecturales ou par la disposition des objets, mais se voient re-configurés dès que des activités s'initient, se suspendent, se négocient, etc. (Relieu & Olszewska2004). Le déploiement d'activités conjointes, disjointes, parallèles, etc., est possible dans ce type d'espace dans la mesure où les participants établissent des passages reconnaissables d'une configuration à l'autre.
4) L'organisation domestique en tant qu'accomplissement ordinaire participe de façon primordiale à la socialisation des enfants. Les relations intersubjectives de parenté, les procédés éducatifs et de socialisation et leur dimension morale, en particulier en ce qui concerne la temporalité[14] peuvent êtreabordés du point de vue de la production et du maintien d’un certain ordre familial et domestique dont les enfants sont constitués en apprentis. De ce point de vue, le collectif familial n’est plus donné d’avance mais est examiné en tant que communauté de pratiques (Lave & Wenger, 1991) : laroutinisation, contingente et toujours à accomplir, de la vie quotidienne, exige la mobilisation de catégories d'appartenance familiale (mobilisant à leur tour des droits/obligations mutuels) qui ne prennent sens que dans des contextes d'action et d'interaction changeants et dynamiques.
Remerciements
Un grand merci aux membres de la famille PR pour leur disponibilité et pour la confiance accordée à l'équipe tout au long su processus d’enquête. Merci aussi à Lorenza Mondada (ICAR/Lyon2), à Benoît Lelong et à Moustafa Zouinar
31
(SENSE/Orange Labs) pour leur précieux commentaires et conseils au cours de l’écriture de cet article. Enfin, merci beaucoup à l’ensemble des personnes ayant coordonné et édité le présent numéro, en particulier à Nicolas Hossard pour son épaulement et sa patience.
Notes
[1] Aujourd’hui, cette approche exerce également une certaine influence sur les sciences du langage, et plus particulièrement sur la sémiotique : on est passé de la "sémantique des objets" de Barthes (centrée sur les aspects communicatifs et symboliques des objets) à des analyses qui croisent leurs caractères "esthétique, fonctionnel, communicatif et praxéologique". L'objet dans le monde ne peut plus être abordé indépendamment de son support sensible dans les pratiques (le corps en mouvement), ni dissocié de toute "sémiotique des cultures" (Zinna 2005)
[2] Fornel et Léon, (2000) ; Mondada, (2001).
[3] Sacks, Schegloff, & Jefferson, (1974) ; Sacks, (1992).
[4] Garfinkel, (1967 ; 2002).
[5] Goodwin, (1996) ; Heath & Hindmarsh, (2002) ; Mondada, (2007) ; Ochs et al., (2006) ; Suchman & Trigg (1991).
[6] Cf. La Valle & al. (à paraître) pour une description détaillée de la méthode et du déroulement du travail de terrain. Signalons ici que les participants ont été pleinement informés des objectifs scientifiques de l'enquête et que les adultes ont reçu un dédommagement à la fin de l’enquête.
[7] En France, une grande partie des études concernant l'espace domestique (du moins en sciences sociales) se focalisent sur des thématiques telles que la répartition 'genrée' des tâches (en particulier suite à Hochschild, 1989), les représentations d’investissement spatial, le rapport entre "vie professionnelle et vie privée", la socialisation ou encore la passation inter-générationnelles de biens (Attias-Donfut & al., 2002 ; Kaufmann 1992, 2005 ; de Singly, 1998 ; Weber, 2006, pour ne citer que quelques auteurs). Par ailleurs, des architectes travaillent sur des thématiques proches (Welzer-Lang & Filiod 1992 ; Desprès & Piché 1992) ou, plus spécifiquement, sur la relation entre expérience des familles habitantes et dispositifs architecturaux (Léger & Decup-Pannier, 2005). De nombreux sociologues intéressés aux usages des TICs à la maison se focalisent sur les phénomènes de réception ou sur les usages (télévision et téléphone respectivement), et travaillent au moyen de questionnaires, carnets de bord et entretiens, plus ou moins directifs. Ces méthodes permettent d'enquêter sur des échantillons relativement représentatifs d'une population donnée (bien qu’ils ne donnent qu’un accès limité aux pratiques "en train de
32
se faire"). Aussi, un nombre croissant de géographes s’intéressent aux pratiques habitantes (Lévy & Lussault, 2003), notamment à partir des travaux de Pezeu-Massabuau (1983 ; 2003), puis de Collignon & Staszak (2003).
[8] Cf. La Valle, N., (2006[2008]) ou Taylor & Swan (2005), par exemple.
[9] Les perspectives praxéologiques de tradition phénoménologique, nourriespar les travaux de A. Schütz qui, dès les années 1940, met l'accent sur la distribution de la connaissance entre individus et objets culturels (Schütz, 1964), ne nient pas a priori l'influence des scripts que porteraient les objets technologiques sur les modes d'action, ni la présupposent. S'attachant plutôt à examiner les procédés et les raisonnements pratiques par lesquels les acteurs gèrent leurs activités et résolvent leurs problèmes ordinaires, il s’agit de ce point de vue de traiter les 'usages' technologiques et l'éventuelle ''lecture'' de scripts dans la mesure où cette dernière se donne à voir (notamment comme ressource et/ou comme contrainte) au cours de l'accomplissement de l'action.Plus connue, la ''technologie comme texte'' du constructivisme anti-essentialiste (Grint & Woolgar, 1997), ainsi que la théorie de l’acteur-réseau stipulent que les objets jouent un rôle décisif (mais non ''déterminant'') dans le scripting des pratiques et des stratégies de leurs utilisateurs. Dans le scriptanalysis de Latour et Akrich (1992), le script fait référence aux manières dont les artefacts et les acteurs non-humains configurent leurs utilisateurs : le couple indissociable objet-environnement s’exprime dans le script et le défi de l'innovateur est donc de traduire les usages technologiques en scripts "réalistes" (Akrich, 1991), pour imaginer des pratiques nouvelles.
[10] Les prénoms de tous les participants ont été changés.
[11] Schegloff & Sacks (1973) parlent d'un "continuining state of incipient talk", notamment à propos de situations telles que des "membres d'un foyer dans leur salon ou des employés qui partagent un bureau". Dans ce type de contexte, les participants n’initient pas, ni ne clôturent véritablement des conversations au sens car ils demeurent potentiellement et mutuellement disponibles.
[12] Ensemble avec l’indexicalité et la réflexivité, l’accountability est l’un des trois piliers conceptuels de l’ethnométhodologie. L’accountability postule queles ressources pour comprendre les activités quotidiennes -ainsi que les raisonnements de sens commun et l’ordre social instauré par ces activités et ces raisonnements- se trouvent dans ces mêmes activités, dans la mesure où les membres de la société peuvent produire des accounts, c’est à dire des comptes rendus, des justifications, des explications, etc., au cours et après leurs actions.
[13] Cf. Hutchby (2001) sur la notion d'affordance (d'abord développée parGibson, 1979), faisant référence aux "potentialités" pratiques offertes par les objets et les technologies.
[14] Cf. notamment Wingard (2007) sur ce dernier point.
33
Bibliographie
Akrich, M., (1991), "L’analyse socio-technique", Vinck, D., (éd.), La gestion de la recherche, Bruxelles : De Boeck, pp. 339-353.
Akrich, M., & Latour, B., (1992), "A Summary of a ConvenientVocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies", Bijker, W., & Law, J., (éds.), Shaping Technology/ Building Society Studies in Sociotecnical Change, Cambridge : MIT Press, p.259-264.
Attias-Donfut, C., (dir.), (1995), Les solidarités entre générations. Vieillesse, familles, État, Paris : Nathan.
Amphoux, P., (1988), "Les donneurs de temps", Temporalistes, n° 8, pp. 25-26.
Bruner, J., (1996), The Culture of Education, Cambridge : Harvard University Press.
Collignon, B., & Staszak, J-F., (éds.), (2004), Espaces domestiques, construire, habiter, représenter, Paris : Bréal.(résumé : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=314).
Conein, B., & Jacopin, E., (1993), "Les objets dans l'espace. La planification dans l'action", Raisons pratiques, n°4, pp. 59-84.
Crabtree, A., & Rodden, T., (2004), "Domestic routines and design for the home", CSCW, vol.13, n° 2, pp. 191-220.
Desprès, C., et Piché, D., (1992), "Introduction. Femmes et espaces : perspectives sur le changement dans les pratiques culturelles", in Architecture et comportement, vol. 8, n°2, pp. 113-118.
Engeström, Y., (1999), "Activity theory and individual and social transformation", Engeström, Y., Miettinen, R. &
34
Punamaki, R-L., (éds.), Perspectives on activity theory,Cambridge : CUP, pp. 19–39.
Gibson, J., (1979), The ecological approach to visual perception, Londres: Lawrence Erlbaum associates.
Goffman, E., (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor Books.
Goffman, E., (1961), Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
Goffman, E., (1974), Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, London: Harper & Row.
Grint, K., & Woolgar, S., (1997), The Machine at Work: Technology, Work and Society, Cambridge: Polity Press.
Hochschild, A. R., (1989), The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home, New York : Viking.
Hutchby, I., (2001), Conversation and Technology: From the Telephone to the Internet, Cambridge : Polity Press.
Kaufmann, J-C., (1992), La trame conjugale : analyse du couple par son linge, Paris : Nathan Pocket.
Kaufmann, J-C., (2005), Casseroles, amour et crises. Ce que cuisiner veut dire, Paris : Armand Collin.
Korvela, P., (2006), "Video-data and the activity theory in analysing dynamic everyday family life", Methodological and theoretical tools for studying everyday family life, 3ème congrèsintern. ESFR, sept., Darmstadt, Allemagne.
Lave, J., & Wenger, E., (1991), Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge : CUP.
La Valle, N., Zouinar, M., & Relieu, M., (à paraître), "La constitution du terrain et la fabrication de données vidéo comme processus composite", Renaud, P., & Greco L., (dir.), Du projet
35
individuel à l’activité sociale. L’entrée du chercheur sur son terrain, Coll. Cahiers de la Nouvelle Europe, Paris : L’Harmattan.
La Valle, N., (2006[2008]), "Redéfinitions du contexte domestique : la réorganisation des activités familiales suite à des appels téléphoniques", Mondada, L., (éd.), n° spécial de la revue Verbum, La pertinence du contexte. Contributions de l’Ethnométhodologie et de l’Analyse Conversationnelle, Tome XXVIII, n° 2-3.
Léger, J-M., & Decup-Pannier, B., (2005), "La famille et l'architecte : les coups de dés des concepteurs", La famille dans tous ses espaces, Espaces et sociétés, n°120-121, éd. Erès.
Lévy, J., & Lussault, M., (dir.), (2003), Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris : Belin.
Licoppe, C., & Smoreda, Z., (2000), "Liens sociaux et régulations domestiques dans l'usage du téléphone", Quéré, L., & Smoreda, Z. (dirs.), Le sexe du téléphone, Réseaux, vol.18, n°103, Paris : Hermès.
Lynch, M., (1991), "Method: Ordinary and scientific measurement as ethnomethodological phenomena", Button, G., (éd.), Ethnomethodology and the Human Sciences, Cambridge : Cambridge University Press, pp. 77-108.
Mondada, L., (2001), “Pour une linguistique interactionnelle”, Marges Linguistiques, n°1, mai (disponible en ligne http://www.marges-linguistiques.com).
Mondada, L., & Balthasar, L., (2005), "Corpus R*ICAR", présentation, Paris EPML Corpus, février.
Nomura, S., Tamura, H. & Hollan, J., (2005), "Information Management Centers in Everyday Home Life", 11th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2005), Las Vegas.
36
Norman, D.A., (1988), The psychology of everyday things, New York : Basic Books.
Ochs, E., Graesch, A.P., Mittman, A., Bradbury, T., & Repetti, R., (2006), "Video Ethnography and EthnoarchaeologicalTracking", The Work-Family Handbook: Multi-Disciplinary Perspectives and Approaches to Research, Pitt-Catsouphes, M.,Kossek, K., & Sweet, S., (dirs.), pp. 387-409, New Jersey : Lawrence Erlbaum Ass.
Pasquier., D., (1999), La culture des sentiments. L'expérience télévisuelle des adolescents, Paris, MSH.
Pasquier, D., (2001), "La famille, c’est un manque. Enquête sur les nouveaux usages de la téléphonie dans les familles immigrées", Jouët, J., & Pasquier, D., (dir.), Médias et migrations, Réseaux, vol. 19, n°107, pp.183-207.
Relieu, M., & Olszewska, B., (2004), "La matérialisation de l'internet dans l'espace domestique : une approche située de la vie domestique", Lelong, B., & Martin, O., (dirs.), L'Internet en famille, Réseaux, vol.22, n°123.
Relieu, M., Zouinar, M., & La Valle, N., (2007), "At home with video cameras", Home Cultures, vol.1 , n°4, Oxford : Berg.
Robinson, J., & Stivers, T., (2001), "Achieving activity transitions in primary-care encounters: From history taking to physical examination", Human Communication Research, n° 27, pp. 253-298.
Schegloff, E.A., & Sacks, H., (1973), "Opening up closings", Semiotica, n°8, pp. 289-327.
Schütz, A., (1964), Collected Papers (tomes 1 & 2), The Hague: Nijhoff.
Shove, E., (2003), Comfort, Cleanliness and Convenience: The social organization of normality, London : Berg.
37
Singly, F. de, (1998), "Habitat et relations familiales", éd. du Plan Construction, ParisV-Sorbonne (avec Singly C., de).
Sudnow, D., (1978), Ways of the Hand: the Organization of Improvised Conduct, Londres : Routledge & Kegan Paul.
Taylor, A., & Swan, L., (2005), "Artful Systems in the Home", Proc. of the CHI '05, Avril, Portland : ACM Press.
Tolmie, P., Pycock, J., Diggins, T., MacLean, A., & Karsenty, A., (2002), "Unremarkable Computing", SIGCHI [Special Interest Group on Computer-Human Interaction], Conference on Human Factors in Computing Systems, New York : ACM Press, pp. 399-406.
Traverso, V., & Galatolo, R., (2006[2008]), "Accès multiples au(x) contexte(s) : l'exemple de cuisinières en action",Mondada, L. (éd.), n° spécial de la revue Verbum, La pertinence du contexte. Contributions de l’Ethnométhodologie et de l’Analyse Conversationnelle, Tome XXVIII, n° 2-3.
Weber, F., (2006), "Ethnographie du quotidien", ent. Ténédos, J., vol.1, L’économie domestique, Paris : Aux Lieux d’Être.
Welzer-Lang, D., & Filiod, J-P ., (1992), "Les Hommes à la conquête de l'espace domestique", Architecture et Comportement, vol.8, n°2, pp.159-180.
Wingard, L., (2007), "Constructing Time and Prioritizing Activities in Parent-child Interaction", Discourse & Society,vol.1, n° 18, pp. 75-91.
Zinna, A., (2005), "L'objet et ses interfaces", Fontanille, J., & Zinna, A., Les Objets au quotidien, Limoges : Pulim, coll. Nouveaux Actes Sémiotiques (également disponible en ligne http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=416).
38
Conventions ‘Jeffersoniennes’ de transcription pour l’Analyse Conversationnelle (Atkinson & Heritage, 1984 ; Mondada, 2004)
exemple/
exemple\
Intonation montante
Intonation descendanteexe:::mple Allongement vocalique
>exemple < Débit plus rapide
Ex- Troncation exemple
EXEMPLE
° exemple °
Prononciation accentuée, appuyée
Volume de voix plus fort
Volume de voix plus bas, chuchotéXXX Syllabes incompréhensibles [
[
Chevauchement de deux tours de parole
(1)
. . . …
Pauses en secondes
Pauses de moins d'une seconde (diverses longueurs)
=
=
Tours de parole "enchainés" de deux locuteurs (se suivant sans pause)
&
&
Continuation du tour d'un même locuteur
exemple*
* regarde
Articulation de phénomènes non-verbaux en simultanéité avec la parole
CHR (italique) Participant effectuant actions non verbales
Va vers salon(italique)
Description d'actions non verbales













































![L'organisation territoriale dans le nord-ouest de la péninsule ibérique (VIIIe-Xe siècle): vocabulaire et interprétations, exemples et suggestions [2009]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631fe5ebfdf36d7df603732f/lorganisation-territoriale-dans-le-nord-ouest-de-la-peninsule-iberique-viiie-xe.jpg)