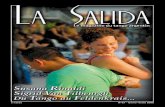Policiers au travail : réflexions sur l'organisation du temps et des activités au sein de la...
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Policiers au travail : réflexions sur l'organisation du temps et des activités au sein de la...
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
333
Policiers au travail!: réflexions sur l’organisation du temps et des activités
au sein de la police du Châtelet (XVIIIe!siècle)
Vincent MILLIOT
La littérature de colportage est riche de nombreuses complaintes et autres misères de métiers qui font la part belle au caractère infernal des rythmes de travail1. Dans ce registre, les commissaires au Châtelet interprètent une partition similaire, déplorant que le repos de la nuit leur soit ôté2. Louis-Sébastien Mercier émet, dans le Tableau de Paris, un jugement assez ambivalent sur l’activité des commissaires. Il évoque leur surcharge possible de travail pour justifier la mauvaise effectuation de certaines tâches!:
«!La malveillance publique soupçonnait leur forfaiture quand seulement peut-être l’excès de labeur dépassait les forces des magistrats. L’opinion leur reprochait d’abandonner le balayage des rues, les visites des marchés, la vérification des poids et du pain3.!»
L’historiographie traditionnelle a plutôt entériné le point de vue des commis-saires, en présupposant que l’activité était «!à peine à la mesure d’un homme4!».
L’étendue des domaines de compétences de la police d’Ancien Régime a de quoi impressionner. La masse d’archives laissées par chaque officier, conservées dans la série!Y des Archives nationales, renforce cette représentation apocalyptique. Toutefois, le risque de ce discours!est clairement celui de l’instrumentalisation corporatiste par la compagnie des commissaires. En effet, le temps, c’est de l’argent. Les commissaires doivent constamment arbitrer entre les fonctions civiles, ou d’une façon générale les fonctions rémunératrices de leur office et les tâches de police, de maintien de l’ordre qui ont la réputation d’être gratuites et pour lesquelles il faut trouver des financements. Le reproche récurrent de l’ absentéisme –!les! commissaires
1. MILLIOT V., Paris en bleu. Images de la ville dans la littérature de colportage, Paris, Parigramme, 1996, p.!106-124 ; MINARD P., Typographes des Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 1989, p.!59 et suiv.
2. Factum, Archives de Paris, 2 AZ 13, p. 62-63, cité par KAPLAN S., «!Note sur les commissaires de police de Paris au XVIIIe!siècle!», RHMC, t. XXVIII, 1981, p.!675.
3. MERCIER L.-S., Tableau de Paris, tome!I, édition établie par BONNET J. C., Paris, Mercure de France, 1995, chap. CDLXXXIX, p.!1332.
4. CHASSAIGNE M., La lieutenance générale de police, (1906) Genève, Slatkine reprints, p.!181 ; FARGE!A., Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe!siècle, Paris, Gallimard, coll. «!Archives!», 1979, p.!203.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
334
préfèrent courir après de gras scellés plutôt que de rester disponibles pour le public!– trouve son fondement ici. En outre, un tel discours comprend également un implicite jugement moral qui a ses vertus légitimantes pour la police. La Police, entendons là commissaires au Châtelet et inspecteurs, est sur-active parce que le peuple doit être en permanence contenu!: «!les cabarets sont pleins et les commis-saires sont accablés de besogne!»5.
Par-delà ce doute critique, poser la question du temps de travail policier sous l’Ancien Régime, de son organisation, de ses rythmes fait directement écho aux problématiques les plus récemment développées sur le chantier de l’histoire des polices. Celles-ci renvoient à l’étude des pratiques, à la lente spécialisation des tâches policières et à l’essor de formes de professionnalisation6. Une synthèse géné-rale étant difficile pour un univers marqué par une très grande diversité de situa-tions entre les villes, entre les corps et les institutions dotées de pouvoirs de police, nous nous contenterons ici d’un certain nombre d’observations et d’interrogations, concernant les officiers de la police du Châtelet, formulables à partir du nombre encore très réduit d’études ayant osé affronter ce problème7.
Police surmenée ou négligente ? On peut tenter d’appréhender cette question à travers les dispositifs réglementaires qui posent les cadres, on va le voir, assez lâches, de l’organisation du travail, en particulier pour les commissaires enquêteurs au Châtelet. Cette souplesse ou ce flou ne sont pas uniquement imputables à une conception et à une organisation du travail qui ne seraient pas encore totalement déterminées par la rationalité productiviste du capitalisme industriel, comme l’at-teste l’irrégularité des rythmes productifs dans le monde artisanal8. En effet, l’acti-vité policière relève d’une autre logique, celle des professions de service et exige en outre une disponibilité de chaque instant, fondatrice de la continuité attendue des fonctions de sûreté, ce qui rend l’appréhension du temps de travail «!productif!» particulièrement malaisée, peut-être impossible, à tout le moins sujette à d’infi-nis débats9. Toutefois les usages du temps, c’est-à-dire l’arbitrage que les policiers effectuent entre leurs diverses tâches, les efforts qu’ils leur consacrent et la dispo-nibilité qu’ils ménagent à l’égard de telle ou telle d’entre elles sont des questions
5. BRENNAN T., Public drinking and popular culture in Eignteenth Century, Princeton, 1988.6. BERLIÈRE J.-M., DENYS C., KALIFA D. et MILLIOT V. (dir.), Métiers de police. Être policier en Europe, XVIIIe-
XXe!siècle, Rennes, PUR, 2008. 7. Cette préoccupation est pourtant ancienne. Au-delà des cadres proposés par KAPLAN S., «!Note sur les
commissaires…!», art. cit., ma réflexion est tributaire dans cet essai de l’étude pionnière de COLIN!C., Le métier de commissaire. Pierre Régnard le jeune et le quartier de police Saint-Eustache (1712-1751), mémoire de maîtrise de l’université Paris VII-Denis Diderot, 1990, dont les propositions ont été retra-vaillées et prolongées par les travaux récents de Justine Berlière pour les commissaires, BERLIÈRE!J., «!Policer Paris au!siècle des Lumières. Les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe!siècle!», Paris, École des Chartes, 2012 et de Rachel Couture pour les inspecteurs, COUTURE!R., «!Inspirer la crainte, le respect et l’amour du public!»!: les inspecteurs de police parisiens, 1740-1789, doctorat de l’université de Caen et de l’université du Québec à Montréal, 18 janvier 2013.
8. MÉNÉTRA J.-L., Journal de ma vie, présenté par ROCHE D., Paris, Montalba, 1982 ; DEWERPE A. et GAULUPEAU!Y., La fabrique des prolétaires. Les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas, 1760-1815, Paris, Presses de l’ENS, 1990.
9. MONTJARDET D., Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996, p.!137-144.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
335
sensibles, discutées et révélatrices des conceptions que l’on peut avoir du service «!aux publics!». C’est pourquoi, de la norme aux pratiques, la question d’une quan-tification du temps de travail policier, ou du moins d’une reconstitution des usages du temps, mérite d’être posée. Peut-on reconstituer des emplois du temps et des agendas, selon les règlements et au travers des pratiques ? Quelle impression laisse finalement cette reconstitution, celle d’officiers harassés ou d’agents qui «!se hâtent lentement!» ? La mise en lumière des arbitrages qui sont effectués sur le terrain et de leurs logiques, les formes de répartition des tâches et de division du travail que l’on semble pouvoir discerner ne témoignent-ils pas, finalement, de l’émergence d’une culture professionnelle, d’une spécificité policière!et d’un souci plus manifeste de mieux articuler les interventions des divers acteurs du système policier ?
L’organisation du travail policier!: un vœu pieux ?
Absentéisme, retard, discontinuité du travail policier constituent des lieux communs de la dénonciation de la police sous l’Ancien Régime qui traversent l’époque révolutionnaire et qui sont toujours actifs au XIXe!siècle10. Ces reproches sont-ils bien établis ? Que prévoient les textes pour y obvier ?
Des reproches récurrents
Rappelons l’un des jugements émis par L.-S Mercier!:
«!Trop souvent le commissaire est absent ; il est allé à ses plaisirs, ou apposer des scellés […]. Le guet promène souvent un délinquant avec les menottes de quartier en quartier, faute de rencontrer le commissaire chez lui11!».
L’observateur résume le conflit latent entre les fonctions lucratives de l’ office et les tâches gratuites de police, il y ajoute une implicite coloration morale. Les!commissaires seraient plus souvent motivés par «!l’appât du gain!» que par le service au public, voire délaisseraient leurs missions pour raisons privées. Les!conséquences de cet absentéisme sont implicitement évoquées!: les procédures sont lentes ou bloquées (seul le commissaire, «!premier juge!», peut dresser un procès-verbal et ordonner une arrestation), les droits de la personne ne sont pas respectés (le délinquant est promené de rue en rue…), les troubles à l’ordre public sont toujours possibles (badauds qui s’assemblent et ameutent le voisinage…). Peu flatteur, ce constat appelle d’autres interrogations sur la qualité des rapports police/population, sur la prise de distance des commissaires à l’égard des habitants de leur quartier et l’effritement de leur capacité de médiation12. Toute la question
10. EMSLEY C., «!Policing the streets of early nineteenth-century Paris!», French History, vol. 1, no!2, p.!269-270 ; DELUERMOZ Q., Policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris, 1854-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.
11. MERCIER L.-S., op. cit., t. I, p.!1334-1335.12. L’hypothèse a été émise par GARRIOCH D., «!The people of Paris and their Police in the Eighteenth
Century: reflections on the introduction of a “modern” Police force!», European History Quaterly, t.!XXIV, 1994, p.!511-535 et The making of Revolutionary Paris, University of California Press, 2002.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
336
reste de savoir si le jugement du moraliste est généralisable et jusqu’à quel point ? Les!pamphlets des premiers temps de la Révolution évoquent également le délais-sement de la police ordinaire et quotidienne, celles des rues, de la salubrité, de la circulation, moins par absence de zèle et par paresse que par substitution à d’autres tâches, celles de la bureaucratie tatillonne, du secret et de l’espionnage. Un mésu-sage du temps en quelque sorte et un investissement dans des tâches que les Droits du citoyen réprouvent.
À lire les circulaires des lieutenants généraux de police, le reproche de l’absen-téisme semble sinon fondé dans l’absolu, du moins suffisamment récurrent pour qu’on veuille y porter remède. Une circulaire de Sartine du 9!février!1764, adressée aux syndics de la compagnie des commissaires au Châtelet, évoque les plaintes des lieutenant de police, lieutenant criminel et procureur du roi au Châtelet contre l’absentéisme des commissaires, de jour comme de nuit, leur refus de recevoir le guet, de se transporter sur les lieux des incendies13. La lettre mentionne l’anecdote d’une patrouille du guet qui a tourné pendant 3!heures la nuit, qui a été contrainte de se rendre chez 7 à 8 commissaires sans avoir pu trouver un officier disponible où se faire entendre ! La lettre recommande, au minimum, «!aux clercs [des commis-saires] d’être exacts à ouvrir la nuit soit au guet, soit à ceux qui auraient besoin de [leur] ministère!». Pour éviter ce type de pérégrination, une assemblée générale de police, du 27!mai!1764, décide que la garde doit rester chez le commissaire où elle se transporte d’abord, puis détacher un soldat dans les études voisines pour trou-ver un commissaire disponible. Si l’on en croit la copie d’une lettre de Lenoir aux syndics, du 29!juin!1776, les réprimandes doivent ranimer le zèle des subordonnés du lieutenant général à intervalle régulier14. Lenoir demande alors la transmission au commandant de la garde, par la compagnie des commissaires, d’une copie des états de service des commissaires afin de pouvoir mieux orienter les patrouilles de la garde vers les bonnes études. Lenoir est fréquemment soucieux de normer toutes les opérations liées à l’appréhension des suspects, aux arrestations, notamment celles des mendiants et des vagabonds. Limiter les divagations des patrouilles et des personnes arrêtées est une façon de réduire le risque de troubles, le désagrément pour les personnes, l’interruption des patrouilles qui ne peuvent plus suivre leurs itinéraires. Au-delà des avantages immédiats en termes de préservation de l’ordre public, l’attention porte aussi sur ce qui pourrait entacher les procédures, produire des actes non conformes et prêter le flanc aux contestations. En 1779, en 1782, des lettres encore adressées aux commissaires, comme aux inspecteurs, visent les délé-gations inconsidérées de certaines tâches aux clercs et aux commis, consécutives à l’absentéisme trop fréquent des officiers et des magistrats15.
Pourtant à bien lire ces documents, il s’agit moins de réguler des rythmes et de régler le temps de travail de chacun, que d’améliorer la répartition des tâches, la hiérarchie des fonctions et leur bonne articulation en vue d’assurer la conti-nuité, la célérité et la conformité du service. Dans la seconde moitié du XVIIIe!siècle,
13. AN, Y 13728.14. Idem.15. AN, Y 12830.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
337
l’ objectif de la lieutenance générale de police est avant tout de coordonner l’activité des divers corps qui constituent l’appareil policier de la capitale pour un fonc-tionnement sans à-coups, indépendamment des logiques corporatistes des uns et des autres, des statuts particuliers qui peuvent néanmoins fonder les réticences manifestées à l’égard de certaines tâches ou l’impression d’être accablé de travail16. Les!textes normatifs ne proposent pour leur part que des cadres assez lâches.
Ce que disent les textes normatifs
Les textes réglementaires, circulaires de la lieutenance générale de police, statuts des compagnies d’officiers visent à organiser certaines séquences de travail policier (réunions hebdomadaires de concertation, patrouilles régulières par exemple), à assurer la permanence de ce travail dans les quartiers ou à s’efforcer de régler l’arti-culation des tâches entre elles. Mais l’organisation précise du temps de travail reste dans l’ombre et du ressort des officiers sur le terrain.
Assurer la continuité du service ou souscrire à l’obligation de résidence dans son département sont des exigences précoces!: déjà un arrêt du Parlement de Paris du 20!juillet 1546 stipule «!qu’un commissaire ne peut s’absenter ni quitter la ville, sans s’assurer qu’il peut se faire remplacer17!». On peut lire dans le célèbre Traité de la police de Delamare que «!ce n’est pas seulement le jour, mais encore à toutes les heures de la nuit que les commissaires doivent être prêts à agir lorsque le public a besoin de son secours18!». L’image du bon commissaire disponible se précise encore!:
«!Ainsi l’on peut dire des commissaires, avec beaucoup de raisons, ce qu’on disoit autrefois des tribuns du peuple, que leurs maisons doivent être ouvertes jours et nuits, comme un port et un refuge asseuré à tous ceux qui sont en quelque péril, ou qui ont besoin de quelque secours.!»
Depuis Delamare, les mêmes termes sont employés dans nombre de textes!: exactitude, immédiateté, célérité. Ils brossent un idéal-type, définissent une norme rêvée. Les statuts de la compagnie des commissaires de 1688, offrent des cadres temporels plus précis, mais dont la dimension normative et «!idéale!» n’est pas moins certaine19. Le texte revêt en outre une dimension politico-corporatiste forte puisqu’il propose un modèle d’auto-organisation des commissaires, «!à côté!» du lieutenant général de police, voire sans lui. L’agenda théorique des commissaires au
16. MILLIOT V., Un policier des Lumières suivi de Mémoires de J.!C.!P. Lenoir…, Seyssel, Champ Vallon, 2011, deuxième partie.
17. Article!35, copie manuscrite collationnée par le commissaire Henry, en 1769, AN, Y 16290 ; MILLIOT!V., «!Saisir l’espace urbain!: la mobilité des commissaires au Châtelet et le contrôle des quartiers de police parisiens au XVIIIe siècle!», in DENYS C. et MILLIOT V. (dir.), «!Espaces policiers, XVIIe-XXe siècle!» RHMC, 50-1, janvier-mars 2003, p.!54-80.
18. DELAMARE N., Traité de la police, Paris, M. Brunet, Hérissant, 1705, livre!I, chapitre!VII!: «!Fonctions de police des commissaires concernant la sûreté publique, la voirie, les sciences et les arts libéraux, le commerce, les arts mécaniques, les serviteurs domestiques et les pauvres!».
19. Précis des règlements des conseillers du roi, commissaires en son Châtelet […] (1688), archives du commissaire Ninnin, AN, Y 15114.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
338
Châtelet apparaît!: réunion inter-commissaires au sein de chaque quartier tous les lundis, à partir de 8!heures (article!4) ; visite commune de tous les commissaires d’un quartier, assistés de leurs huissiers, tous les quinze jours, pour s’informer auprès des bourgeois. Cette inspection donne lieu à des rapports à la chambre de police, chaque vendredi (article!5).
L’article 6 évoque les rôles de police, soit l’accompagnement par les commissaires des patrouilles du guet sur le terrain les dimanches, mercredis et samedis pour s’ assurer du respect des ordonnances qui règlent la sanctification du dimanche, l’ horaire de fermeture des lieux de boisson, les assemblées illicites, etc. Ces rôles mobilisent 6 des 48 commissaires parisiens, chaque semaine selon l’ordre du tableau établi par les syndics et doyens de la compagnie. L’article 9!prévoit tous les premiers lundis du mois, la réunion de tous les commissaires au Châtelet!:
«!Et comme il est important que tous les commissaires agissent dans leurs fonc-tions de police, avec uniformité et par un même esprit dans toute l’étendue de Paris, la compagnie s’assemblera en la chambre au Châtelet tous les premiers lundis des mois à neuf heures du matin pour conférer ensemble sur les matières de police.!»
Ces articles ne fournissent que des repères ponctuels, qui déterminent parfois un jour et un horaire, qui fixent le rythme d’une intervention particulière, mais sans jamais offrir la moindre indication de durée et en préservant, pour l’essen-tiel, une liberté totale dans la manière qu’ont les officiers d’organiser leurs tâches. Sallé dans son Traité des fonctions des commissaires enquêteurs examinateurs (1759), n’aborde pas la question de l’organisation du temps de travail, il se concentre sur le descriptif des fonctions, des droits, des privilèges des membres de la compa-gnie alors prise dans un épisode judiciaire dont le monde du travail corporé était friand20. Le!fameux mémoire du commissaire Lemaire, La Police de Paris en 1770, qui est censé «!conseiller!», «!informer!» la Cour de Vienne sur l’organisation poli-cière parisienne, ne dit rien non plus sur l’organisation du temps des acteurs de la police21. Dans la version orléanaise de ce manuscrit, revu en 1780, et annoté au début de la Révolution par l’ancien lieutenant de police Lenoir, des éléments à peine plus précis de répartition du travail sont fournis22. Mais le raisonnement de Lenoir intègre alors de manière très fonctionnelle le souci de proportionner l’espace admi-nistré à la densité de la population, afin de favoriser la disponibilité des officiers!:
«!Les quartiers sont partagés en deux ou trois départements suivant leur étendue ou la quantité d’habitants qu’ils renferment, en sorte que chaque commissaire à son département particulier qui lui est assigné par le magistrat et dans lequel il est obligé de demeurer.
Cette distribution a pour objet de les mettre en état de veiller plus particulièrement et plus facilement à tout ce qui intéresse la police dans l’étendue de ces départements
20. SALLÉ M., Traité des fonctions, droits et privilèges des commissaires au Châtelet de Paris, Paris, 1759 ; KAPLAN S. L, «!Note…!», art. cit.
21. La Police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine, sur la demande de Marie-Thérèse, notes et introduction par GAZIER A., Mémoires de la Société de l’Histoire de Paris, tome!V, Paris, Champion, 1879.
22. Papiers Lenoir, médiathèque d’Orléans, Ms 1424, deuxième partie, art. II, Des commissaires.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
339
et d’y pourvoir avec plus de célérité et afin que de leur côté, les habitants de ces mêmes départements puissent recourir plus aisément à eux pour en obtenir la justice et les secours dont ils peuvent avoir besoin […].
Ainsi les maisons des commissaires sont à cet égard comme autant de tribunaux érigés dans Paris où les citoyens de tous les ordres trouvant, la nuit comme le jour, tous les secours et la protection que l’autorité publique pouvait établir en leur faveur. Toujours prêts à les entendre, ils ne les renvoient point sans satisfaire à leur demande, sans régler leurs différends ou sans faire tout ce qui peut dépendre d’eux pour les concilier, et mettre fin à leurs discussions.
Cette justice prompte et sommaire qu’ils leur rendent sans cesse et gratuitement, doit être regardée comme une des causes qui contribuent principalement au bon ordre et à cette étonnante tranquillité qui règnent à Paris.!»
En préparant ses «!mémoires!», assimilables à une «!défense et illustration!» de la police d’Ancien Régime, Lenoir synthétise à la fois les prescriptions qui pèsent sur les commissaires et les lieux communs (disponibilité, célérité, assiduité), les qualités attendues par le public et par la hiérarchie qui font les «!bons ouvriers!» de la police. La disponibilité contribue à rendre la police légitime aux yeux des popu-lations. Au passage, Lenoir insiste sur le pouvoir tutélaire du lieutenant général. De fait, l’idéal de police consultative animé par la seule compagnie des commis-saires, imposant la présence à des réunions organisées selon des rythmes établies et prévues à l’avance, n’est pas forcément la chose la mieux partagée!et l’absen-téisme reste une plaie. Le 20!mars 1778, Lenoir adresse une lettre aux syndics de la compagnie pour exiger l’organisation au début de chaque mois d’une conférence appelée à régler le service de la police, réunissant les commissaires dans chaque quartier, assistés de l’inspecteur du département, avec la possibilité d’y convier un certain nombre d’auxiliaires!: commis de l’inspecteur, logeurs du quartier et «!autres personnes qui par état sont spécialement chargés d’exécuter les ordonnances et règlements de police23!». En un!siècle, le zèle auto-organisateur des commissaires décrit par les règlements de 1688, semble avoir singulièrement faibli. Les circulaires montrent aussi que l’impulsion qui déclenche un certain nombre de descentes, de perquisitions et de patrouilles, notamment en matière de police des mœurs et de surveillance des garnis, est d’abord centrale à la fin du XVIIIe!siècle24. Le lieutenant général de police est en quelque sorte devenu le «!maître du temps!» de ses subor-donnés, constat particulièrement net dans le cas des inspecteurs qui entretiennent des relations directes et fréquentes (quotidiennes pour les inspecteurs de la sûreté) avec leur supérieur. Il veille à la continuité du service de multiples manières comme l’exemple des inspecteurs, récemment bien documenté, le montrerait!: en limi-tant les vacances lors du changement de titulaire d’un office, en organisant un système de remplacement de plus en plus systématique, en formalisant mieux le travail policier afin de permettre aux inspecteurs d’anticiper, de mettre en place
23. AN, Y 13728, 20 mars 1778.24. BENABOU E.-M., La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe!siècle, Paris, Perrin, 1987 ; MILLIOT!V.,
«!La surveillance des migrants et des lieux d’accueil à Paris du XVIe!siècle aux années 1830!», in ROCHE!D. (dir.), La ville promise. Mobilités et accueil à Paris fin XVIIe-début XIXe!siècle, Paris, Fayard, 2000, p.!21-76.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
340
les premiers éléments d’une procédure, même lorsqu’un commissaire est absent, à charge pour les magistrats d’opérer ensuite les vérifications et la validation qui s’imposent25. L’incontestable perfectionnement de la machine policière parisienne à la fin du XVIIIe!siècle repose sur une répartition et une hiérarchisation des tâches plus précises entre des acteurs devenus un peu plus nombreux, mais surtout plus sûrs des contours de leur mission. Mais la critique persistante de l’absentéisme, celle qui vise la mauvaise effectuation de certaines fonctions exigent toujours un effort d’éclaircissement. Les policiers parisiens ont-ils trop à faire, en trop petit nombre dans une ville en expansion ? Sont-ils confrontés à des emplois du temps surchargés ?
Peut-on quantifier le temps de travail policier ?
Les archives des commissaires au Châtelet, registres de leurs minutes ou liasses, sont d’utilisation difficile pour qui veut reconstituer finement les emplois du temps «!réels!», les rythmes de travail quotidiens, mensuels, annuels des subor-donnés du lieutenant général de police. Les lacunes, l’absence de traces laissées par certaines activités, la tenue inégalement précise de ces documents n’autorisent que des aperçus assez généraux. Lorsqu’on se risque sur ce terrain, les travaux effectués, en nombre limité, fournissent des indications contradictoires ou problé-matiques. On!peut à la fois obtenir la remise en question radicale de toute idée de surmenage policier dans le cas de Pierre Régnard le Jeune, commissaire du quartier Saint-Eustache entre 1712 et 1750, ou, à l’inverse, l’impression que les «!journées ne finissent jamais!», à l’image de la suractivité de Pierre Chenon, commissaire du quartier du Louvre dans la seconde moitié du!siècle26.
«!Pesées globales!»
Le répertoire des minutes du commissaire Pierre Régnard, en poste dans le quar-tier Saint-Eustache, couvre les années 1712 à 175127. Sur 39 années d’exercice, on comptabilise 6 759 actes, soit, en moyenne, un peu plus de 173 actes annuels. Par tranche chronologique décennale, on obtient une quinzaine d’actes mensuels en moyenne.
Les variations mensuelles peuvent être fortes. On note, de juillet à septembre, un maximum d’été de l’activité policière (juillet étant le mois plus chargé au cours de 10 de ces 39 années). Les temps creux coïncident avec les mois d’hiver, les derniers mois de l’année en cours et ceux du début de la nouvelle année civile. Un!mois chargé comme l’est juillet!1731 regroupe 47 actes ; un creux exceptionnel comme celui de janvier!1726 n’offre qu’un seul acte. La longueur du jour qui a une
25. COUTURE R., Inspirer…, op. cit., p.!203-210, p.!313-350, p.!373-376 ; BERLIÈRE J., Policer…, op.!cit., p.!337-342.
26. COLIN C., op. cit. ; BERLIÈRE J., op. cit.27. AN, Y 15310, Répertoire des minutes de Pierre Régnard le Jeune ; les minutes elles-mêmes sont
conservées sous les côtes Y 15219 à Y 15259 ; et pour ce qui suit, COLIN C., op.!cit., p.!163-170.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
341
incidence sur le déploiement des activités humaines a apparemment et assez logi-quement une incidence sur le travail policier.
En répartissant le nombre théorique d’actes annuels légèrement supérieur à 170, obtenu par pointage sur le registre des minutes de Régnard, par un nombre théorique de jours ouvrés, on obtient un peu plus d’un acte tous les deux jours28. Pierre!Régnard le Jeune ne semble donc pas se «!tuer au travail!» à l’aune de cet aperçu. En revanche, il semble respecter ses obligations de service, puisqu’au cours de la semaine, le lundi, jour de l’assemblée de police du quartier présente une moindre activité, celle-ci étant plutôt concentrée en fin de semaine, du vendredi au samedi.
Le contraste est complet avec la sur-activité du commissaire Pierre!Chenon, départi dans le quartier du Louvre, dans la seconde moitié du XVIIIe! siècle. Les!chiffres détonnent immédiatement!: en 1751, l’étude de Pierre Chenon compta-bilise 559 actes, soit plus de 46 sur le mois ; en 1752 et en 1760, on atteint respec-tivement 963 et 1 198 actes, soit plus de 80 et près de 100 actes mensuels. Ce n’est pas là le résultat de l’enthousiasme d’un jeune commissaire, certes secondé par son clerc, puisque jusqu’au milieu des années 1770, on constate toujours ce haut niveau d’activité. Un sondage effectué sur huit années, de 1751 à 1790, révèle une production de 5 526 actes, soit une moyenne de 58 actes mensuels ou de 2 actes journaliers29. Parmi les paramètres auxquels on songe pour éclairer cette diffé-rence d’avec Régnard, il y a la notoriété de Chenon, puisque celui-ci exerce entre 1767 et 1775, les responsabilités de syndic de la compagnie des commissaires, et la renommée attire probablement des affaires dans son étude. On ne peut imputer ce contraste à l’éventuel perfectionnement de la machine policière et au zèle accru dont pourraient faire preuve les commissaires de la seconde moitié du XVIIIe!siècle. Le commissaire Cadot, contemporain et confrère de Chenon dans le quartier du Louvre, produit 40 actes mensuels au maximum et parfois beaucoup moins, jusqu’à des jours sans écritures.
Au-delà de cette comptabilité brute et approximative, peut-on reconstituer une journée de travail type et ses rythmes ? Être disponible à toute heure constitue une exigence manifestée par la hiérarchie qui nourrit, en retour, les complaintes. Comme les notaires, les commissaires doivent préciser à quel moment de la jour-née les affaires se déroulent. Les jours de la semaine sont indiqués sur leurs actes. Des précautions s’imposent dans l’utilisation des heures mentionnées, car il s’agit toujours des heures pleines, sans distinction de fraction de temps. L’heure indi-quée est celle du début, par exemple de l’audition d’un premier témoin alors qu’on commence une fournée d’auditions. Il s’ensuit d’inévitables inexactitudes qui peuvent donner le sentiment que les commissaires sont doués d’ubiquité ! Pour les
28. COLIN C., Le métier…, op.!cit., p.!169 et suiv. Le calcul est en pratique malaisé, car si Régnard chôme l’essentiel des dimanches, il lui arrive aussi de travailler. Micheline Baulant se livre à de savants calculs à propos des ouvriers parisiens du bâtiment, et déduit environ 80 à 90 jours chômés dans une année, dimanches et jours de fêtes, entre la fin du XVIIe!siècle et les années 1720, BAULANT!M., «!Le!salaire des ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726!», AESC, 26e année, no!2, 1971, p.!463-483.
29. Sondage effectué par BERLIÈRE J., op. cit., p.!151-165, qui a choisi 8 années!: 1751-1752, 1760, 1774-1775, 1785, 1789, 1790.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
342
actes civils (scellés après décès, scellés simples, compte de tutelle et de commu-nauté, partage de biens), la durée est connue puisque le commissaire doit comptabi-liser le temps de chaque intervention, et l’on sait quand commence et finit la rédac-tion. En revanche, l’appréhension de la durée est impossible pour un procès-verbal, une déclaration, la réception d’une plainte. En 1720 dans le quartier Saint-Eustache, le commissaire Régnard concentre plus de 60!% de son activité quotidienne l’après-midi, entre 13!heures et 20!heures et un gros quart (26,6!%) le matin, à partir de 8!heures. La chute est nette passée 20!heures et jusqu’à 23!heures avec 7,4!% de l’activité quotidienne et cette activité est très ralentie, mais pas inexistante, entre 23!heures et 8!heures du matin (3,7!% de l’activité). Dans le cas de Régnard, l’acti-vité nocturne reste assez exceptionnelle, liée aux rondes et à la surveillance exer-cée par les patrouilles du guet et de la garde. Le travail de nuit relève de l’obliga-tion statutaire, incontournable mais pas forcément spontanément intégrée par le commissaire. Le rythme suivi par Pierre!Chenon laisse au contraire l’impression que certains commissaires au moins, travaillent tous les jours de la semaine, même les dimanches, même les nuits. Il participe à d’assez nombreuses patrouilles nocturnes. En 1752, il est de 47 patrouilles, surtout l’été!: on en compte 10 entre juin et août, mais 1 en janvier, 1 en février. Les mois de mars, septembre, octobre, décembre comptabilisent 6 patrouilles chacun. S’ajoutent à cela des patrouilles particulières, à la réquisition d’officiers de police, parfois au rythme de plusieurs par mois comme en 1755 et 1756, parfois plusieurs nuits consécutives. L’hypothèse qui est dès lors la plus plausible est celle de la pratique par ces officiers de «!style!» de police différents, plus pro-active, plus centrée sur la dimension administrative, à la fois préventive et répressive, dans le cas de Chenon ; plus traditionnelle et jurispruden-tielle dans le cas de Régnard. Mais l’opposition pourrait aussi valoir de manière simultanée au sein du même quartier du Louvre, entre Cadot et Chenon. Pendant les mêmes périodes et au sein des mêmes espaces, plusieurs manières de faire la police coexistent, donc plusieurs manières de gérer son temps.
En fait, ce genre de comptabilité, ces chiffres «!bruts!» rendent assez mal compte de ce qui peut déterminer les emplois du temps!puisque tout dépend de la nature des affaires traitées. En outre, le travail du commissaire est loin de se limiter à son activité bureaucratique et à son activité enregistrée. Tout ce qui relève du temps d’écoute, des accommodements oraux et de «!l’infra-judiciaire!» ou para-judicaire laisse peu de traces. Les inspecteurs de police sont également de plus en plus inves-tis dans ce type de tâches, indépendamment de leur rôle plus spécifiquement répres-sif. De manière assez étonnante, ce qui témoigne de la bureaucratisation accrue du travail policier, cette activité infra-procédurière peut être enregistrée par les inspecteurs dans la seconde moitié du!siècle, mais sans porter mention du temps passé30. Pour suivre malgré tout le fil des doléances policières, et tester leur possible validité, on peut s’interroger sur ce qui peut déterminer la variabilité des rythmes et de l’intensité du travail.
30. COUTURE R., Inspirer…, op. cit., p.!494-535.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
343
De quelques paramètres qui influent sur le volume et les rythmes d’activité d’une étude
Au fil d’une carrière, le rythme et la nature des activités d’un commissaire sont susceptibles d’évoluer. La notoriété!progressivement acquise, fruit d’une meilleure insertion dans le quartier!produit ses effets. On constate ainsi la progression constante du nombre d’actes réalisés à Saint-Eustache par Pierre!Régnard de 1712 à 1717. Passé le temps de la prise de fonction, les habitants, les escouades du guet apprennent à se tourner vers ce commissaire nouvellement arrivé. L’âge et l’ancien-neté dans la fonction semblent avoir une influence sur la nature de l’activité et sur la gestion du temps, déterminant par exemple les arbitrages entre police active et actes civils, sur l’activité sédentaire et le nombre de transports. Le commissaire!Chenon apparaît ainsi moins actif le dimanche et la nuit avec le temps. Mais plus qu’un effet de l’âge et de la modification des activités liée à la notabilisation du commissaire, l’exercice de responsabilités plus générales, celle de receveur ou de syndic de la compagnie, ou encore l’exercice d’une spécialité confiée par le lieutenant général induisent forcément une réorientation des tâches qui rend plus complexe encore la reconstitution d’un «!temps de travail!». Le déclin de l’activité enregistrée dans les minutes de Chenon à partir du milieu des années 1770 correspond au moment où il commence à succéder à son confrère Rochebrune, comme commissaire de la Bastille. Cette spécialité oblige à conduire de longs interrogatoires, à entreprendre des perquisitions chez les libraires, voire à effectuer des déplacements en province qui ne laissent pas de trace dans les minutes. La coloration de l’activité d’une étude peut dépendre de la volonté du lieutenant général de police et de l’architecture donnée au système policier. La répression du vol par exemple constitue une part importante de l’activité de Pierre!Chenon dans le quartier du Louvre. Or la lieute-nance générale de police insiste de plus en plus sur l’articulation de l’activité des inspecteurs de la sûreté et du travail de quelques commissaires choisis, qui reçoi-vent prioritairement les déclarations et plaintes pour vols. Les Parisiens ne vont plus alors chez le commissaire de leur quartier, les inspecteurs semblent les conduire chez le commissaire spécialisé, payé pour cela31. La police d’un quartier s’apparente à un «!système!» articulé, à la fois topographiquement et par domaines de spécialités policières. Il peut évoluer dans le temps, donner une image de vases communicants ; l’erreur est ici d’appréhender un commissaire isolément. Si un événement affecte l’activité d’une étude, les conséquences sont visibles dans les études circonvoisines. Le renforcement ou l’altération de l’encadrement policier, l’évolution du maillage ont aussi des incidences. Ainsi, le décès du commissaire Lemarrier dans le quartier Saint-Eustache, fin 1719, provoque le gonflement de l’activité de Régnard en 1720. L’ arrivée en 1721 de Langlois, venu du quartier Saint-Jacques de la Boucherie pour succéder à Lemarrier, réduit ensuite l’activité de Régnard, d’autant que Langlois désigné «!commissaire ancien!» exerce alors une rude concurrence. La maladie de Lemarrier conduit Regnard à concentrer son activité dans l’enceinte du quartier et
31. Ibid., p.!350-383 et BERLIÈRE J., op.!cit., p.!322-327.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
344
à ralentir ses activités à l’extérieur comme le montre l’évolution de l’origine géogra-phique de sa clientèle32. Régnard, dont l’étude est située rue Montmartre, «!vis-à-vis la Jussienne!» récupère alors la clientèle «!de quartier!» de Lemarrier, dont l’étude se trouve à proximité, à la pointe Saint-Eustache. La clientèle de Lemarrier qui n’est pas du quartier se répartit plutôt dans les études des commissaires du Palais royal, installés rue Saint-Honoré.
Il faut encore faire la part du prévisible et de l’imprévisible dans le travail poli-cier dont on cherche à reconstituer les rythmes et les paramètres. L’activité civile, une partie de l’activité judiciaire (hors flagrants délits) des commissaires peuvent s’organiser dans un agenda. Les levés de scellés, les informations au criminel, les enquêtes au civil, les interrogatoires avec convocation préalable de témoins sont de l’ordre de ce qui est programmable et le commissaire est libre alors d’organiser son emploi du temps. Chenon en début de carrière choisit le dimanche et l’heure de la messe, ou le matin, ce qui est une manière pour les témoins de ne pas perdre une journée de travail. Mais par la suite, l’accumulation d’affaires fait que dimanches et matinées ne suffisent plus et cette activité déborde sur d’autres moments. Néanmoins, le propre de l’activité policière est de rester soumise aux sommations imprévisibles!: scellés après-décès (civil), plaintes, procès-verbaux… La vie urbaine est riche de tout ce pour quoi on peut faire appel au commissaire pour qu’il dresse procès-verbal!: péril imminent, procès-verbal d’écroulement, d’incendie, de vol, d’effraction. Les commissaires ont le droit de dresser et de faire emprisonner de leur propre autorité, dans les cas de flagrant délit ou d’un particulier interpellé par la garde qui doit alors se rendre chez le commissaire le plus proche. Premiers juges, les commissaires peuvent commencer de suite leur information, sur la demande des plaignants, dans les cas de flagrant délit. Ultime activité non programmable, les arrestations ordonnées par le lieutenant général, qui s’effectuent accompagnés d’huissiers et d’exempts.
Il ressort de toutes ces remarques plusieurs choses. La reconstitution «! comptable!» du temps de travail policier ne livre que des ordres de grandeur, imprécis, incomplets qui ne permettent pas de trancher de manière évidente dans le jeu des représentations contrastées, entre tenants du «!surmenage policier!» et adeptes de la thèse du moindre effort. En revanche, la réflexion sur le temps de travail pousse à la reconstitution des pratiques et fait apparaître les effets d’une politique, impulsée par la lieutenance générale, qui conditionne le travail des agents et rejaillit sur la nature de l’activité des études. Dans le quartier du Louvre, le commissaire!Cadot, peu pro-actif, n’a pas la même structure d’activité, pas la même intensité d’activité que les Chenon père et fils, commissaires de confiance. Cela!suggère un partage possible des tâches, une forme possiblement raisonnée de division du travail!qui a ses implications dans la conduite des carrières.
32. En 1717, la clientèle «!hors quartier!» représente 43!% de son activité ; en 1718, 32!%, et en 1720, 26!% ; COLIN C., op. cit.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
345
Divisions du travail
Il faut donc concevoir une sorte de répartition «!horizontale!» des tâches de police qui renvoie, assez clairement passé 1750, à des types de «!policiers!», plus ou moins engagés selon les cas dans l’exercice plus paisible de fonctions civiles ou dans une conception pro-active du métier, tournée vers le maintien de l’ordre, qui détermine plus souvent des emplois du temps surchargés, sans limites. Mais cette division s’opère aussi «!verticalement!» entre acteurs de statuts différents!: l’hyper-activité de certaines études qui supposerait en pratique l’ubiquité des commissaires, repose en fait sur la répartition des tâches entre le commissaire, son clerc et ses commis.
Clercs et commissaires
Au sein d’une étude de commissaire, la division du travail est obligatoire car certains actes exigent le transport des commissaires. Une étude associe un commis-saire, un ou plusieurs clercs dont un clerc principal, des «!commis!»!: l’inflation de ces subordonnés tend à être dénoncée par les circulaires. Les clercs et commis vont donc assurer la continuité attendue des fonctions de police, assurer la permanence dans les études et s’occuper aux tâches d’écriture de plus en plus proliférantes, aux expéditions liées aux actes de justice civile33. Cette multiplication de subordonnés est un indicateur détourné de la masse de travail à effectuer malgré tout. Les années où le nombre d’actes augmente correspondent à celles où l’on constate le plus grand nombre d’auxiliaires en activité dans l’étude de Pierre Chenon. La moindre activité de son confrère Cadot se traduit inversement par un nombre de clercs plus limité ; parfois, il n’y en a même aucun !
Quelle est la logique de la répartition des tâches ? Les opérations de rangement ordinaire sont confiées aux clercs. Ils héritent de la!tenue des registres des minutes, rendue (une nouvelle fois) obligatoire par un arrêt de la cour de Parlement du 18!août 1740. Quoi qu’il en soit, après 1740, les grands livres de «!main courante!» semblent tenus de façon plus exhaustive34. Par effet rétroactif de cet arrêt, l’officier était contraint «!de constituer le répertoire de toutes ses minutes depuis le jour de sa réception!» et par conséquent d’entretenir la mémoire de son activité, la compa-gnie des commissaires veillant par ailleurs à la bonne tenue de ces registres. Le clerc principal est chargé de cette tâche ; dans l’étude de Pierre!Régnard par exemple, l’écriture du commissaire n’apparaît pas dans ces livres. L’arrêt oblige également au classement des actes!: il faut donc constituer un fonds d’archives par étude. Le(s)!clerc(s) assumerai(en)t l’essentiel de ce travail bureaucratique reposant sur la mise en place d’intercalaires mensuels, d’un système de chemises et de classement dossiers par affaire, avec fiche «!signalétique!» comportant nom, adresse des parties concernées, type d’acte, ainsi qu’un bref résumé de l’affaire. Mais la correspondance
33. BERLIÈRE J., Policer…, op. cit., p.!191-199.34. MARTIN CHABOT E., Inventaire des répertoires anciens des minutes des commissaires du Châtelet, extrait
de la Bibliographie moderne, 1914-1915, t. XVII, p.!326-327.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
346
avec les supérieurs resterait de la responsabilité du commissaire, même si le clerc prend copie.
À ce jour, le travail des clercs n’est pas très bien connu (tout comme leur profil socio-professionnel), mais plusieurs observateurs insistent sur la montée en puis-sance des responsabilités qui seraient confiées aux clercs35. Mercier accuse les commissaires absentéistes d’abandonner trop souvent leur étude à ces derniers36. La distribution du travail aux clercs révèle les priorités du commissaire qui préside à ces choix et la plus ou moins grande confiance qu’il accorde à ses auxiliaires. Le!maître clerc (ou principal) n’est pas un simple copiste à la différence du commis. Il détient la confiance du commissaire ; il peut l’accompagner dans des affaires délicates et accomplir des opérations que le commissaire contresigne après coup. Parfois, ils prennent des vacations de scellés, la délégation de pouvoir étant alors facilitée car l’huissier le commissaire-priseur, ou le notaire participent à l’opération et la garantissent. En permanence, les clercs accueillent le guet, les plaignants, les déclarants. On le voit enregistrer les plaintes de ceux qui se déplacent à l’hôtel du commissaire (c’est son activité principale ; il ne se déplace pas chez les particuliers), ou boucler des informations réalisées dans l’étude. Dans ce cas, il s’agit normale-ment de l’audition d’un témoin secondaire, qui n’est pas décisif pour la progression ou la conclusion de l’affaire. Indéniablement, le clerc principal assume un rôle d’auxiliaire de confiance, d’intermédiaire indispensable. Le clerc peut donc béné-ficier d’une certaine autonomie mais pour des tâches routinières. Normalement, le commissaire doit superviser et ne pas déléguer n’importe quoi. Il doit norma-lement conserver la main sur les actes civils avec enjeux financiers ou familiaux, tels que scellés ou enquête en séparation. Le commissaire prend en charge les gens de qualité, en particulier dans les affaires qui mettent en cause la réputation37. Il! s’occupe toujours des affaires les plus graves, comme les plaintes avec atteintes à la propriété. Les vols, vols des domestiques, vols de bourse, d’épée, de chevaux, vols à la tire dans la rue, même pour des objets de faible valeur requièrent l’attention du commissaire car la transgression est forte, le danger social avéré. Dans ce cas, l’auxiliaire le plus important du commissaire est l’inspecteur de la sûreté qui relève de son département territorial38.
Qui doit faire quoi ?
La multiplication des responsabilités des clercs est vue d’un mauvais œil par la Lieutenance générale de police ; la division excessive du travail policier inquiète d’autant qu’elle se généralise jusqu’aux inspecteurs qui ont leurs commis et auxi-
35. Cheirouze, maître clerc de Chenon est en même temps huissier à verge au Châtelet, logé chez le commissaire, Almanach royal, 1774, cité par BERLIÈRE!J., op.!cit.
36. MERCIER L.-S., op. cit., p.!1334.37. FARGE A. et FOUCAULT M., Le désordre des familles!: lettres de cachet des archives de la Bastille au
XVIIIe!siècle, Paris, 1982 ; DINGES M., Der Maurermeister und der Finanzrichter: Ehre, Geld und soziale Kontrolle im Paris des 18 Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994.
38. COUTURE R., Inpirer…, op. cit., p. 296-383.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
347
liaires39. Les responsables comme Lenoir redoutent les risques multipliés de vices de forme dans les procédures, d’arbitraire qui peuvent nourrir des tensions avec la population autant que la plume des pamphlétaires dans les années 1780, voire des querelles corporatistes au sein de la police. Les indices sont nombreux, émanant de la lieutenance de police, d’un souci de formaliser le travail policier, de mieux établir des circuits hiérarchiques autant que de rappeler les officiers à leurs devoirs40. Le!personnel subalterne, recruté sur des bases clientélaires, familiales, formé «!sur le tas!» n’offre pas toujours toutes les garanties en termes de maîtrise des procédures. Cette division du travail qui progresse doit donc être interrogée parallèlement à la constitution souhaitée de «!métiers!» et à l’affirmation de formes de spécialisation, et cela dans de nombreux corps chargés de responsabilités policières. Au-delà des officiers du Châtelet qui ont un statut clair de ce point de vue, la double activité n’est plus de mise, et de moins en moins, pour les personnels subalternes et pour ceux qui sont chargés du maintien de l’ordre comme la garde de Paris. La spécia-lisation autour de certaines tâches va de pair avec la recherche d’une productivité policière attendue pour certains objets considérés comme «!prioritaires!», ainsi la lutte contre la mendicité et le vagabondage, ou contre la prostitution41.
Plusieurs circulaires de Lenoir illustrent ces déviations en cours et les remèdes envisagés qui passent par une stricte hiérarchisation des tâches imparties à chacun. En octobre 1779, il pointe les dysfonctionnements survenus lors des emprisonne-ments qui exigent théoriquement un procès-verbal!du commissaire!:
«!Ce qui vient d’arriver au clerc de M. Legretz, messieurs, m’a démontré la possibi-lité d’un abus qu’il est nécessaire d’arrêter. Il m’avait été déjà rapporté que plusieurs délinquants avaient été conduits en prison, sans avoir été vus ni entendus par le commissaire en l’hôtel duquel ils avaient été conduits et que quelquefois les clercs s’étaient ingérés même en l’absence des commissaires d’ordonner et de faire les bulle-tins qu’on doit remettre à la garde en les souscrivant ainsi!: “Le commissaire…” […]
Je désire que pour obvier à cet abus, tous les bulletins à donner à la garde soient à l’avenir signés du commissaire même42.!»
D’un même mouvement, Lenoir dénonce dans la suite de la circulaire!les abus de clercs corrompus qui se font payer la délivrance, théoriquement gratuite, des passeports. Et enfin, il critique le refus de plusieurs commissaires de se transporter «!lorsqu’ils ont été requis par la garde à l’occasion de gens retirés de la rivière!». Un!commissaire a répondu en pareille circonstance «!qu’il n’avait pas le temps et qu’on avait qu’à lui amener la personne qu’on venait de repêcher!»… Le chef de la police du Châtelet, convaincu de l’importance de la réputation et du sentiment de
39. Ils sont très mal connus, COUTURE R., op. cit, p. 559-582.40. MILLIOT V., «!Despotisme policier ou réduction de l’arbitraire ? Quelques réflexions sur la formalisa-
tion des pratiques policières à Paris, XVIIIe!siècle!», in ANTONIELLI L. (a cura di), Le polizie informali, Rubbettino Editore, 2010, p. 145-166.
41. BENABOU E. M., op. cit ; MILLIOT V., «!Réformer les polices urbaines au!siècle des Lumières!: le révé-lateur de la mobilité!», Crime, histoire et sociétés/Crime, History and Societies, Paris, Droz, 2006/1, p.!25-50 ; ROMON C., «!Mendiants et policiers à Paris au XVIIIe!siècle!», HES, 1982, no!2, p. 259-295.
42. Copie de la lettre de M. le Lieutenant général de Police à messieurs les syndics, du 8 octobre 1779, AN, Y 12830.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
348
justice comme fondements de la légitimité policière ne peut que réprouver «!cette conduite […] contraire au devoir et même à l’humanité!».
Dans une lettre adressée à la compagnie des inspecteurs cette fois, et dont le double est transmis à celle des commissaires, Lenoir dénonce des délégations de tâches en cascade43. Il parle «!d’abus introduit sans doute par l’aisance et par un esprit de mollesse!». Il interdit aux inspecteurs de se faire suppléer par leurs prépo-sés, commis, aides «!notamment pour l’exécution des ordres du roi, les visites et patrouilles!». Il en est de même pour les vérifications demandées par la lieutenance concernant les affaires du quartier, notamment les demandes d’enfermement des familles, qui représentent une part non négligeable de l’activité des inspecteurs dans les quartiers, une activité alors plus souvent médiatrice que répressive44. Il exige des syndics qu’on lui fasse rapport sur les officiers absentéistes et rappelle que, dans les cas de force majeure, le système classique d’un remplacement par un confrère reste envisageable.
La prudence s’impose au moment de généraliser à partir de circulaires dont la vocation est de redresser des abus. Au sein du petit groupe de policiers d’élite, que constituent les inspecteurs de la Sûreté, les remplacements semblent bien fonction-ner dans les vastes circonscriptions territoriales spécialisées qu’ils administrent et qui regroupent plusieurs quartiers de police45. Le souci de continuité du service semble s’imposer et être relativement partagé. De tels rappels à l’ordre n’interdisent pas les accommodements que les urgences du terrain dictent parfois. L’essentiel est de savoir régulariser la procédure à temps et de pouvoir présenter «!in fine!» une documentation conforme. Lenoir tolère ainsi que les auxiliaires des inspecteurs procèdent à des arrestations «!en certaines occasions!» «!d’après les recherches dont vous les aurez chargés!» (en gros les «!enlèvements de police!»). Mais il rappelle qu’il «!n’est presque point de cas où l’on ne doive conduire devant un commissaire!», et exige des préposés qu’ils donnent «!avis des captures qu’ils auront pu faire dans ces sortes de cas hors de la présence des inspecteurs!», afin que ces derniers puissent «!assister aux opérations du commissaire et signer à l’instant sur son procès-verbal46!». La répartition des tâches et la division du travail, même éloignées de tout formalisme juridique, doivent avoir pour corollaire une bonne circulation de l’information autant qu’un marquage strict des responsabilités.
Le temps, c’est de l’argent
La bonne gestion du temps (rapidité, répartition des tâches, spécialisation) par les officiers, commissaires et inspecteurs, s’avère concrètement décisive pour leur niveau de rémunération. Idéalement dans le cas des commissaires au Châtelet, il convient d’obtenir un certain équilibre entre les fonctions civiles, rémunératrices et les fonctions de «!police!», gratuites. Mais ces dernières font l’objet de gratifications
43. Juillet!1782, AN, Y 12830.44. COUTURE R., op. cit., p. 494-535.45. Ibid., p. 296 et suiv.46. Juillet!1782, AN, Y 12830.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
349
que l’administration s’efforce, avec le temps, de payer plus régulièrement et d’un système de mutualisation partielle et de redistribution des gains qui justifie l’exis-tence de la bourse commune gérée par la compagnie des commissaires47. Une!orga-nisation redistributive semblable existe au sein de la compagnie des inspecteurs. Son rôle est de lisser des inégalités de revenus liées aux caractéristiques des quartiers, à la perception des droits levés sur certaines professions contrôlées par les inspecteurs qui, eux, ne sont pas magistrats, et, à la nature de leurs activités de police48.
Saisir les revenus des officiers du Châtelet, leur montant et leur composition, en particulier pour les commissaires et les inspecteurs, reste malaisé et complexe, illustration de la difficulté qu’il y a à aborder la question minée, mais décisive de l’argent de la police49. Outre les gages de leur office, les commissaires doivent l’essentiel de leurs revenus à l’exercice de leurs fonctions de justice civile, en parti-culier à la pose de scellés après décès ou aux procès-verbaux d’ouverture de porte. Variables en fonction de la nature des actes effectués, de l’ancienneté dans la carrière et de la qualité de l’implantation dans un quartier, ces revenus peuvent représenter plusieurs centaines, voire milliers de livres par an50. L’âpreté au gain des commis-saires sur ces matières, dénoncée par les observateurs, s’explique par l’obligation qui leur est faite de reverser la moitié de leurs vacations de justice civile à la bourse commune de leur compagnie. Une absence de versement se traduit par des dettes, dûment enregistrées, et pour ce que l’on en sait, les commissaires au Châtelet consacrent une énergie non négligeable à récupérer leur dû, même s’il leur arrive d’ effectuer des actes gratuits, par humanité et compassion51. Les inspecteurs n’ont pas à effectuer de tels arbitrages, mais les droits qu’ils sont censés percevoir ne le sont pas toujours facilement ; leur rémunération fondée pour une plus large part sur des gratifications dépend davantage du mérite et de leur investissement.
Ce type de rémunération semble se diffuser et rapprocher sinon les corps de policiers, du moins certains de leurs membres qui pratiquent un style de police similaire. Les spécialités de police active et administrative octroyées à des officiers de confiance, dont l’exercice peut modifier fortement la structure de leur activité comme l’organisation de leur temps de travail, sont spécialement rémunérées52. S’il
47. KAPLAN S. L., «!Note…!», art. cit.48. COUTURE R., op.cit., p. 214-250 ; Précis des représentations faites à Mgr le Procureur général par la
compagnie des inspecteurs de police (1756), BN, ms coll. Joly de Fleury 346, fol. 152-170.49. L’état des archives est l’une des causes de cette difficulté, très lacunaires sinon perdues pour ces
deux compagnies d’officiers. On dispose dans les minutes des commissaires des feuilles de bourse commune, fournissant le montant des vacations qu’ils rapportent à leur compagnie. La reconsti-tution est plus acrobatique pour les inspecteurs, mais les travaux de J. Berlière et de R. Couture montrent que les métiers de police peuvent être lucratifs sans que la corruption soit, par principe, nécessaire. Celle-ci demeure malgré tout, même si des dispositifs existent pour l’endiguer, PEVERI P., «!L’exempt, l’archer, la mouche et le filou. Délinquance policière et contrôle des agents dans la Paris de la Régence!», in FELLER L. (dir.), Contrôler les agents du pouvoir, Limoges, Pulim, 2004, p. 245-272 et COUTURE R., op. cit., p. 539-559.
50. COLIN C., Le métier de commissaire, op. cit., p. 188-206. BERLIÈRE J., Policer …, op. cit., p. 167-186.51. COLIN C., op. cit. p. 248-290.52. Pour tout ce passage, Documents sur la police de Paris telle qu’elle existait en 1789, BHVP, Ms CP
5175, fol. 216 et suiv. C. Romon signale le cas du commissaire Ferrand abandonnant dans les années 1780 toutes les fonctions civiles et lucratives de son office pour se consacrer aux arrestations de mendiants, art. cit.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
350
est difficile d’appréhender la dimension temporelle de cette activité spécialisée que les lieutenants de police semblent valoriser, on peut s’efforcer d’en appréhender l’importance par le biais de son financement. Les archives de la Maison du Roi conservent des «!états des sommes que le roi veut et ordonne être payées par le garde de son trésor royal aux commissaires au Châtelet, inspecteurs de police et autres officiers pour leurs vacations53!». Seuls les états des années 1762-1768 ont été conservés. Sur ces six années, la somme totale versée à tire de gratification s’élève à 1 690 761!£, soit en moyenne annuelle de 281!793!£ et de 67!630!£ par quartiers. Les variations entre quartiers sont fortes et pas forcément liées au nombre de policiers à récompenser. Il faut surtout regarder ces sommes comme la marque d’une politique salariale, notamment à l’égard des inspecteurs et des commissaires engagés dans des tâches de police administrative et de police active, qui seule a permis d’imposer et d’autonomiser cette police face aux fonctions judiciaires les plus lucratives, mais les plus éloignées du maintien de l’ordre public «!moderne!». Sur ces états, on retrouve les 20 inspecteurs, fers de lance de cette nouvelle police promue depuis d’Argenson et soutenue depuis lors, et de 20 à 27 des 48 commis-saires au Châtelet. On remarque que la gratification des commissaires, qui ont d’autres sources de revenus et d’autres occupations, peut porter sur des sommes très faibles et qu’elle est toujours moins importante que celle attribuée aux inspecteurs dont les tâches sont plus ciblées. Les commissaires les plus hautement gratifiés!sont les commissaires «!exceptionnels!» et spécialisés. Au début des années 1760, on repère Machurin, syndic de la compagnie et commissaire du quartier des Halles, lieu sensible à surveiller ou encore, Rochebrune, commissaire du quartier Saint-Paul, mais surtout chargé du département de la Librairie et de la Bastille. Il travaille avec le célèbre Joseph d’Hémery, inspecteur de la Librairie, le mieux payé de tous les inspecteurs. Le commissaire Pierre Chenon apparaît également dans ces états comme le commissaire touchant les gratifications les plus élevées, cela avant même qu’il ne succède à Rochebrune comme «!commissaire de la Bastille!». Mais il ne peut rivaliser avec le montant des sommes régulièrement allouées aux inspecteurs dotés de départements spécialisés comme d’Hémery (Librairie), Durocher (Soldats), Framboisier (Nourrices), Chassaigne (Jeux) ou encore les inspecteurs de la Sûreté. Parmi eux, Villegaudin, Sarraire et Receveur peuvent percevoir sur un seul mois des gratifications allant jusqu’à 4 000-4 500!£. Les sommes perçues par les inspecteurs, tenues secrètes, peuvent nourrir bien des fantasmes. Il faut les pondérer par le fait que les inspecteurs doivent rémunérer à leur tour leurs mouches et auxiliaires.
Ces états indiquent que le système de gratification destiné à récompenser les acteurs d’une nouvelle police s’est largement stabilisé depuis l’époque d’ Argenson54. Dès la fin du XVIIe!siècle, l’administration royale avait prévu de rétribuer correc-tement la nouvelle police incarnée par les inspecteurs en tolérant un système de cumuls de fonctions et de rémunérations, car là était la clef d’une certaine régula-rité d’action, garante de la reconnaissance que cette police pourrait obtenir du fait
53. AN, O1 361 ; BERLIÈRE J., op. cit., p. 167 et suiv.54. PEVERI P., «!L’exempt, l’archer, …!», art. cit., p. 245-272.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
LE TEMPS DE TRAVAIL EN QUÊTE DE MESURE!: LA CORVÉE ROYALE AU XVIIIe SIÈCLE
351
de son efficacité répressive. Dans la seconde moitié du XVIIIe!siècle, si l’on suit les conclusions de Rachel!Couture, le cumul des fonctions, qui conduit à l’absentéisme et la mauvaise effectuation de certaines tâches, régresse. Une spécialisation assortie d’un système de rémunération régularisée progresse qui accompagne un effort de hiérarchisation des tâches. Mais plus que le niveau de revenus, c’est la régularité des paiements et du remboursement des sommes avancées par les officiers pour rétribuer leurs auxiliaires et informateurs, ou par nécessité de service, qui consti-tue peut-être le point critique tout au long du XVIIIe!siècle. Au-delà des plaintes de Lenoir face au «!manque de moyens!» à la fin du XVIIIe!siècle, la «!nouvelle!» police qui associe désormais inspecteurs et commissaires constitue peut-être pour un certain nombre d’agents une bonne façon de s’enrichir. Voilà qui a pu contri-buer à nourrir la légende noire de policiers trop aisés pour être honnêtes, même si ces gains supposaient –!pour autant qu’on puisse approcher les pratiques!– la récompense d’un investissement professionnel lourd et exigeant. Accaparé par des spécialités qui le conduisent souvent hors de son quartier, Pierre Chenon est au fil du temps un commissaire de plus en plus «!absentéiste!» sans que son image en pâtisse beaucoup. Sa sur-activité, la qualité de ses auxiliaires, son charisme y suppléent. Le modèle est peut-être exceptionnel ; Chenon construit l’idéal type du «!bon policier!» et de l’officier zélé, précisément parce qu’il ne «!compte pas son temps!».
Mercier reproche aux commissaires leur absentéisme, motivé par «!l’appât du gain!», c’est-à-dire un arbitrage dans la gestion du temps de travail défavorable aux tâches de la police ordinaire (la voirie, la salubrité…). Le reproche est encore présent dans les pamphlets révolutionnaires55. Mais le moraliste tait l’autre aspect de l’évolution du travail policier, la montée en puissance des tâches de police admi-nistrative relatives à la «!sûreté!» et qui correspondent à la fois aux attentes «!sécu-ritaires!» de certaines franges de la population et aux impulsions politiques de la lieutenance56. De fait, cette police gratuite est aussi la plus chronophage, pour une rémunération qui n’est pas immédiatement à la hauteur de l’investissement consenti et par comparaison avec la rémunération de l’heure de «!vacations!». L’individu policier peut n’y pas trouver son compte. Mais inversement, le service rendu, l’apti-tude à résoudre rapidement les tensions, à «!rassurer et protéger!», sont source de reconnaissance auprès du public.
Le temps «!policier!», c’est assurément de l’argent et la lieutenance générale s’efforce de ne pas l’oublier. Ce temps peut être soumis à des impératifs de produc-tivité qui construisent l’image d’une «!efficacité!», mais il n’est pas équivalent à un temps «!marchand!», comptable et productif, car il crée du «!service au public!»,
55. MANUEL P., La police de Paris dévoilée par l’un des administrateurs de 1789, Paris, J. B. Garnery, vol. 1, l’an second de la liberté.
56. BROUILLET P. et MILLIOT V., «!Entre tradition et modernité!: Hardy et la police de Paris!», introduction à HARDY S.-P, Mes loisirs ou Journal d’événemens tels qu’ils parviennent à ma connaissance (1753-1789), volume IV (1775-1776), sous la direction de BASTIEN P., JURATIC S. et ROCHE D., Paris, Hermann, sous presses.
C
O
P
Y
R
I
G
H
T
ANNE CONCHON
352
une autre forme d’utilité sociale sur laquelle les lieutenants généraux cherchent à s’appuyer pour promouvoir une police nouvelle. C’est même un argument majeur sous la plume de Lenoir, dernier grand lieutenant général de police avant 1789. Les!tensions qui surgissent à travers cette question du temps de travail policier agissent, à la fin de l’Ancien Régime, comme des révélateurs de la nécessité de reconnaître la spécificité de l’activité policière, distincte de celle des juges, et de voir la société accepter d’assumer le coût de corps professionnalisés.