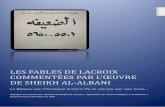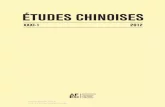2546) Géoéconomie du Brésil : un géant empêtré? (2014)
Transcript of 2546) Géoéconomie du Brésil : un géant empêtré? (2014)
68
68
Robert DUSSEY
Henri LACHMANN
Jean-François CIRELLI
Eric WOERTH
20 euros
ApartésJean-François CIRELLIOù va l’Europe de l’énergie ?
Éric WOERTHFiscalité et compétitivité
Henri LACHMANNComment freiner la désindustrialisation ?
Pascal CHABOISSEAULe marché des télécoms en France
Jean-François DI MEGLIO & Jacques GRAVEREAULes investissements chinois en Europe
Village globalMickaël R. ROUDAUTKaboul-Paris : voyage d’un gramme d’héroïne
Barthélémy COURMONTChine - Taiwan : ennemis un peu, partenaires beaucoup
Rodolphe GREGGIO & Benoît MAFFÉIRente pétrolière et crise économique
Paulo Roberto DE ALMEIDAGéoéconomie du Brésil, un géant empêtré ?
Jean-François BOUCHARDBCE, le nouvel empereur de l’Europe
Horizons africainsEmmanuel NIAMIEN N’GORANRéconciliation, justice et croissance économique en Côte d’Ivoire
Robert DUSSEYLa piraterie maritime : quels enjeux pour le Golfe de Guinée ?
Claude JAMATIL’Afrique et l’eau
Silver MUGISHAL’amélioration des services de l’eau en faveur des pauvres dans les pays émergents
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
102
Géoéconomie du Brésil: un géant empêtré?
Paulo Roberto de AlmeidA
Diplomate brésilien de carrière, Paulo Roberto de Almeida est professeur d’économie politique à l’Uniceub (Brasília)
LLe Brésil occupe une position spéciale dans la communauté des nations : sa place dans la géopolitique mondiale n’est
pas déterminée par une volonté de s’imposer à l’extérieur, ou par sa capacité à projeter un pouvoir qu’il n’est pas certain d’avoir, ou dont il ne veut pas se servir. Sa présence dans le monde ne devrait donc être déterminée que par des facteurs domestiques, ayant peu de rapports avec sa diplomatie. Cet essai s’occupera plus des éléments internes à son développement que des externes. Le Brésil ne peut être important dans le monde que s’il est développé économiquement, avancé socialement, moins inégalitaire, ou tant que son niveau d’innovation ne lui permet d’accéder aux technologies compétitives, à partir d’une éducation de qualité.
Il n’y a aucun obstacle technique, ou économique, qui s’oppose à la conquête de ces objectifs, sauf l’existence d’un système politique dysfonctionnel, de « règles du jeu » peu adéquates à une croissance soutenue, un pouvoir judiciaire enfermé dans ses privilèges de classe, et des dirigeants politiques médiocres, capables de s’équivoquer continuellement sur les politiques économiques. Le Brésil a des
103
atouts suffisants pour surmonter une dotation de facteurs encore trop basée sur les ressources naturelles et pas assez sur le capital humain, mais les « externalités » négatives sont encore trop puissantes pour être éliminées dans l’immédiat, et la coalition actuelle du pouvoir politique n’est pas susceptible de remplir ce rôle ; au contraire, elle semble les aggraver. Cet essai s’efforcera d’analyser les raisons qui font du Brésil un « géant empêtré ». Le titre n’est pas démérité, mais la faute en incombe à ses élites politiques.
le géant sud-américain est-il bien parti ?
Le Brésil était, récemment, une bonne promesse de croissance et d’affirmation globale : la bourse de Sao Paulo battait des records de valorisation, les exportations augmentaient, et les projets d’infrastructure attisaient la convoitise des entrepreneurs. Après plus d’un siècle de domination économique des États-Unis, la Chine remplaçait la puissance de l’hémisphère Nord en tant que principal partenaire commercial, assurant désormais au Brésil le gros de son surplus extérieur, en compensant les déficits avec l’ancienne puissance hégémonique. Les mesures de redistribution commencées sous Fernando Henrique Cardoso, avaient été renforcées par Lula, pour toucher, à la fin de son deuxième mandat, un quart de la population totale, soit 45 millions de brésiliens auxquels on a garanti un transfert mensuel de 100 euros, en moyenne, par famille.
En politique étrangère, le succès du Brésil, de Lula en personne, semblait avoir été transmis au successeur, Dilma Rousseff, auparavant méconnue du grand public, pourtant élue avec aisance, grâce au prestige du charismatique syndicaliste. Lula avait conduit une diplomatie présidentielle faite de nombreuses voyages et d’initiatives qui lui ont valu l’appréciation de la planète : création, en 2003, de l’IBAS (surnommé « G3 »), avec l’Inde et l’Afrique du Sud ; les sommets réunissant les chefs d’État des pays sud-américains et leurs contre-parts de l’Afrique et des pays arabes ; l’Union des nations sud américaines (Unasur), un groupe forgé pour éloigner les Américains
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
104
de l’Amérique du Sud ; les BRICS, avec la Chine, la Russie et l’Inde, élargi après à l’Afrique du Sud ; des tentatives de faire la paix au Moyen-Orient, en poussant au dialogue entre israéliens et palestiniens, et en s’alliant à la Turquie pour trouver une solution au contentieux lié au programme nucléaire iranien.
Avec la croissance en accélération modérée, la réduction des inégalités sociales, le prestige à l’extérieur, les succès dans l’attribution de grands évènements sportifs mondiaux (Coupe du monde de football en 2014, Jeux olympiques à Rio, en 2016), tout s’ajustait pour que le Brésil saute la barrière qui sépare un pays émergent d’une puissance émergée. Il se plaçait dans la cour des grands, en confirmant son leadership en Amérique du Sud, en préparant le chemin de son entrée au Conseil de sécurité de l’ONU – en raison de son rôle à Haïti – et en renforçant sa participation dans les grands forums de coordination, au sujet de l’environnement, dans le G20 financier ou à côté des autres BRICS. Le Brésil avait navigué en douceur pendant toute la première décennie du millénaire, étant même épargné par la « grande dépression » commencée aux États-Unis en 2008.
Un État plus grand que le pays
Pourtant, des déséquilibres en sommeil sont tout à coup sortis de leur cage. Tout ce qui paraissait parfait sous Lula commence à se détériorer sous Dilma, et sans que ceci ne soit lié à un désastre économique mondial. En dépit de ses diatribes contre le « tsunami financier » et la « guerre des changes » des pays riches, les fantômes qui sont apparus étaient 100 % brésiliens, des vieux maux « made in Brazil », comme la productivité médiocre, le manque d’éducation des travailleurs, la faible capacité d’innovation de ses ingénieurs, le piteux état des infrastructures, le poids démesuré de l’État, la bureaucratie écrasante, un dirigisme exacerbé, la lenteur de l’appareil judiciaire, l’ampleur de la corruption et l’autisme arrogant de la classe politique.
Après un taux presque « chinois » de croissance en 2010, le peu de dynamisme économique depuis 2011 a renoué avec les années
105
médiocres de crise et d’ajustement, avant et pendant Cardoso. Il n’y a pas que cela, car l’optimisme de la période Lula s’est effondré en raison même des abus commis par le président : les dépenses publiques faites pour des motifs électoraux, justement, et poussées par une idéologie politique qui privilégie l’État et son rôle « directeur » dans l’économie. À cela s’ajoute un culte immodéré de l’État, par les Brésiliens en général, et par les socialistes du Parti des travailleurs (PT) en particulier : les Brésiliens aiment l’État, demandent toujours plus d’État, veulent travailler dans l’État et pour l’État ; ils espèrent tous que l’État leur procure l’essentiel dans la vie : la sécurité dans l’emploi, la protection contre les démissions, santé et éducation de qualité et gratuites, une retraite convenable, des demi-tarifs dans les transports et pour la culture, si possible terres et habitations à des prix subsidiés, etc. Dilma a promis plus de deux millions d’habitations, tout comme elle est décidée à « en finir » avec les pauvres en incluant le plus grande nombre possible dans les transferts sociaux de l’État : le Brésil est le seul pays au monde où la politique officielle consiste à toujours élargir le nombre d’assistés de la charité publique, sans contreparties visibles.
Certes, la « Bourse Famille »1 ne coûte que 1,5 % du PIB et aide à maintenir la demande dans des régions reculées. Mais, beaucoup plus importantes sont les aides aux capitalistes et aux banquiers, sous forme des prêts subsidiés de la Banque de développement ou au moyen du service de la dette. Le Brésil est aussi le seul pays en développement qui ait une charge fiscale de pays riche : 38 % du PIB, égale à celle de l’OCDE, contre dix points de moins pour les autres pays émergents. Il faut toutefois reconnaître que le PT n’est qu’à moitié responsable de cette situation, bien que ses dirigeants s’efforcent d’aggraver la faim de l’ogre insatiable qu’est l’État brésilien.
...............................................................................................................................................................
1. Bourse Famille est un système d’allocations attribuées, sous la forme d’une carte de crédit, aux familles vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1 dollar par jour). Cette «bolsa familia», créée en 2003 par le président Lula, est aujourd’hui versée à plus de13 millions de foyers, soit 50 millions de personnes sur 190 millions de Brésiliens. Il s’agit du plus grand programme au monde de subsides à la consommation des plus pauvres.
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
106
Colbertisme, mercantilisme, étatisme : les manières françaises
Le Brésil était l’un des pays les plus protectionnistes sous l’Empire, pour des motifs fiscaux ; il a renforcé ses défenses commerciales pendant l’industrialisation, jusqu’à atteindre le paroxysme à la fin de la dictature militaire : au milieu des années 1980, l’État était responsable pour un tiers du PIB et l’offre domestique couvrait 95 % de la demande. La dette externe et l’émission de monnaie nationale ont été multipliés plusieurs fois, avec les projets mégalomaniaques d’un Brésil « grande puissance » : barrages, routes, ports, usines sidérurgiques, chantiers, industrie aérospatiale, informatique, matériel de guerre et, surtout, le programme nucléaire, aussi bien énergétique – au moyen d’un accord avec l’Allemagne pour la construction de huit centrales – que militaire, duquel a survécu le sous-marin nucléaire.
L’ambition géopolitique a sombré dans la décennie perdue de la crise de la dette et de l’hyperinflation. En commençant par Fernando Collor (1990-92), en passant par Itamar Franco, le vice-président investi après l’impeachment du premier, en arrivant à Cardoso – qui a modifié la Constitution pour permettre deux mandats successifs – le Brésil a expérimenté, pour la première fois dans l’histoire, une réduction du poids de l’État : les privatisations commencées par Collor ont été élargies sous Cardoso, qui a aussi modifié la Constitution pour permettre la vente ou des concessions au secteur privé de pans entiers de l’économie : sidérurgie, distribution électrique, transports, gaz, pétrole, mines, ports, aérospatiale, téléphonie et presque toutes les banques des états. Sous Cardoso, qui a aussi créé des agences publiques, séparées du gouvernement, pour la régulation sectorielle, le nombre des fonctionnaires a diminué d’un tiers, tout comme l’État s’est ouvert aux jeux du marché, par la compétition ouverte dans les achats gouvernementaux et la concurrence pour des services publics (routes, etc.).
Il n’a pas, toutefois, réussi à démanteler l’État corporatif dans certains aspects cruciaux : la législation et la « justice » du travail,
107
hérités du fascisme des années 1940, et le culte des « produits stratégiques », comme le pétrole ; la Petrobras, devenue un géant mondial, est toujours considérée comme intouchable, tout comme la Banco do Brasil, la Banque nationale du développement, et des agences régionales de « développement ». Il n’a pas complété, non plus, l’ajustement dans le régime de sécurité sociale et de pensions, ce qui fait du Brésil un pays « développé » par ses dépenses avec les retraités.
la revanche des étatiques : le PT occupe et monopolise le pouvoir
Deux paradoxes – touchant à la vie syndicale et aux politiques économiques – ont marqué l’action du PT dans sa marche vers le pouvoir, avec des comportements contradictoires, avant et après la conquête de l’État. Le parti avait commencé son parcours, en 1980, par la défense de la démocratie, la dénonciation du régime militaire et la constitution de syndicats alternatifs à ceux inféodés au ministère du Travail. Le PT s’est renforcé dans les luttes syndicales contre l’inflation, en promettant d’abolir l’impôt syndical, et a constitué la plus puissante centrale syndicale dans l’histoire du mouvement ouvrier brésilien, la CUT (pour Central Única dos Trabalhadores), contrôlée par le parti. Une fois arrivés au pouvoir, en 2003, les dirigeants politiques et syndicaux ont entrepris une inversion de course : non seulement en confirmant la subordination des syndicats au ministère du Travail au moyen de l’impôt syndical, mais aussi, de façon suspecte, en redistribuant des volumes appréciables de ressources publiques à des centrales, sans aucun contrôle sur leur utilisation.
L’autre paradoxe a consisté à suivre l’économie de la période autoritaire. Il n’y a rien de plus semblable au « fascisme économique » des militaires, en particulier leur « Stalinisme industriel » – fait de grands groupes monopolistes, intégrés verticalement – que la politique économique de Lula, maintenue par Dilma. Lula n’est pas revenu sur les privatisations de Cardoso, mais il a créé des dizaines
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
108
de nouvelles entreprises d’État, tout comme il a porté le nombre des fonctionnaires publiques à des hauteurs méconnues depuis les années 1980. La présidence est passée de quelques centaines à plus de quatre mille « serviteurs », la plupart sans concours (des fonctions de « confiance », occupées, bien sur, par des apparatchiks du PT). Les ministères sont passés de 25 à 39 et la présidence contrôle plus de 23 000 postes de « confiance », sans compter des centaines ou des milliers d’autres créés dans les nouvelles entreprises d’État.
Lula et le PT ont ainsi ressuscité des politiques économiques visant l’autarcie, le nationalisme forcené, la discrimination contre le capital étranger dans des secteurs considérés stratégiques, l’opposition à l’« anarchie des marchés » et la promotion idéologique du planning étatique et des grands projets prétendument intégrés. Là où les militaires favorisaient les aspects techniques et les compétences opérationnelles – en admettant même des fonctionnaires « de gauche », à condition qu’ils fussent taillés pour la fonction – les « petistes » ont privilégié la militance, les apparatchiks du parti, les cadres de confiance, même s’ils étaient totalement incompétents dans les domaines visés. Une raison explique le noyautage de l’appareil d’État : chaque militant, en plus de rendre le « dixième » de ses gains au parti, doit payer, dès qu’il occupe une fonction de « confiance », de 20 a 30 % de son salaire au parti. Le PT a constitué, ainsi, un formidable trésor de guerre, dont il entend ne pas se séparer.
En fait, sans faire la révolution, et sans intention de construire le socialisme - ils ont compris que ce serait un échec total - le PT, par l’action de ses dirigeants historiques, la plupart issus de l’aristocratie ouvrière ou anciens guérilléros recyclés, constitue ce qu’on a déjà appelé la « bourgeoisie du capital d’autrui », la nouvelle Nomenklatura. Ceci est d’autant plus vrai que le PT recueille, volontairement ou par des pressions qui ressemblent à des extorsions, des ressources considérables auprès des capitalistes favorisés par ses politiques, ainsi que des banquiers et d’autres millionnaires qui sont satisfaits du fait de la continuité de leurs petits ou grands monopoles. Le Brésil continue d’être une économie fermée, avec de nombreux cartels et
109
oligopoles (aviation, transports, services publics, achats de matériaux scolaires, médicaments par l’État, et d’autres domaines où le pouvoir de l’Exécutif est toujours dominant ou décisif).
le fascisme corporatif en construction : le début de la décadence brésilienne ?
Le Brésil enregistre un taux de croissance médiocre – depuis longtemps, d’ailleurs – parce qu’il n’a pas d’investissements suffisants. Il est vrai que son taux d’épargne a toujours été bas – moins de 18 % du PIB –, mais cela doit être mis en rapport, d’un côté, avec le rôle économique de l’État dans l’industrialisation et, de l’autre, avec la manière par laquelle l’État a modelé les politiques macroéconomiques et sectorielles qui sont au cœur de nombreux déséquilibres.
Le taux d’épargne national n’est pas un déterminant absolu de l’investissement, mais il représente, tout de même, un facteur négatif pour la mobilisation de ressources adéquates pour renforcer la base productive du pays. Les raisons de cette situation sont aussi connues et sont en rapport avec le phénomène que les économistes appellent « crowding out », c’est-à-dire, l’érosion de l’épargne privée due à la capture de la richesse sociale par l’État, qui possède des mécanismes compulsoires pour le faire, ou peut offrir des taux d’intérêt assez attractifs pour détourner les ressources qui auraient pu aller vers la consommation privée ou être mobilisées par les entrepreneurs. Dans le cas du Brésil, une tendance perverse a contribué à réduire encore plus le taux global d’investissement : en dépit de la croissance soutenue de la charge fiscale, la part de l’épargne public dans le taux total a constamment diminué depuis les années 1980, et cela de manière indépendante de la dynamique des cycles de croissance.
Les militaires ont assumé le pouvoir en 1964, héritant d’un système fiscal très arriéré et dysfonctionnel, avec des recettes à 12 % du PIB, tout au plus. Après des profondes réformes administratives, ils ont « remis » le pouvoir laissant sous le contrôle de l’État près d’un quart de la valeur ajoutée annuelle ; il faut reconnaître, néanmoins,
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
110
que le taux d’investissement a réussi à atteindre, dans la période, une proportion à peu près similaire du PIB, et l’État lui-même était responsable pour plus de 3 % du chiffre total. La démocratisation, à partir de 1985, a été, hélas, associée à une détérioration des principaux vecteurs d’activité : les investissements, l’inflation, les réserves internationales, les dettes interne et externe, la crédibilité du pays, enfin, avec la désorganisation des comptes publics, des budgets des états et les abus grandissants des mandarins de l’État (surtout dans le Judiciaire). Une nouvelle Constitution, caractérisée par un excès de droits sociaux et une carence notable d’obligations, a encore confirmé, a partir de 1988, la prééminence du modèle distributif sur l’option productive ; elle est fondée sur la sur-attribution de tâches sociales sous la responsabilité de l’État : tout le monde a des droits et l’État doit veiller à leur satisfaction. À cette époque, la charge fiscale était déjà montée à 28 % du PIB (avec une certaine redistribution en faveur des états, après des années de centralisation dans l’Union), mais l’assiette fiscale était partie pour une expansion régulière et incessante dans les années qui allaient suivre.
La réponse de l’État à cette montée des demandes déterminée par la Constitution a consisté dans la création de nouveaux impôts et l’élévation des existants. L’expansion de la charge fiscale totale – de l’Union, des états et des municipalités – était nécessaire pour payer les générosités concédées de manière irresponsable par les constituants, mais l’exécutif est allé beaucoup plus loin : il a notamment crée et surchargé les « contributions » – qui, d’après la Constitution, n’ont pas besoin d’être réparties avec les deux autres niveaux de la fédération – et a introduit des impôts sur les mouvements financiers, impossibles d’évader, mais très pervers dans la pratique, car gravant le processus productif en cascade, cumulativement.
La « Receita » fédérale est devenue l’organe le plus puissant de l’État, en même temps que la vie des entrepreneurs a été convertie en un enfer comptable : un rapport de la Banque mondiale sur l’ambiance des négoces pointe le Brésil comme le champion mondial d’obligations administratives : 2 600 heures par an, contre 176 heures
111
pour les pays de l’OCDE et une moyenne de 480 heures en Amérique Latine. D’autres agences de l’État, au lieu de défendre les intérêts des consommateurs, sont devenues des avant-lobbies pour des groupes d’intérêt du secteur soumis à la régulation sectorielle.
Pendant toute la présidence Cardoso, et à nouveau sous Lula, la charge fiscale a continué à croitre régulièrement, d’un demi-point du PIB par an en moyenne. À la fin du second mandat de Cardoso, elle était déjà à la hauteur de 34 % du PIB, et toujours en progression. C’est un fait que, pendant les gouvernements du PT, l’accroissement des recettes a toujours dépassé, année après année, aussi bien la croissance du PIB que le taux d’inflation, ce qui est révélateur de l’extraordinaire capacité d’« extraction » de l’autorité fiscale, contre les entreprises et les citoyens. Une simple consultation à un quelconque rapport international comparatif sur la compétitivité relative des pays (celui du World Economic Forum, par exemple) confirmerait que le Brésil se situe très loin dans le classement général – en moyenne après la 120ème place, sur 160 pays – mais la situation s’aggraverait encore si l’on sépare les facteurs microéconomiques (relevant, donc, du secteur privé) des éléments proprement macroéconomiques (qui dépendent du gouvernement), situation dans laquelle le classement tombe après la 150ème place. Ils sont, précisément, le poids des impôts, la lenteur de la justice, les conditions effroyables de l’infrastructure, la corruption et le manque de transparence, la protection excessive à l’importation, le travail informel et les marchés parallèles, la régulation parfois imprévisible, et, de manière générale, l’horreur bureaucratique, en partie héritée des anciens colonisateurs Portugais, mais perfectionnée à l’infini par les Brésiliens.
le rouge est la couleur la plus froide : déficits en série, retour en arrière ?
Un chansonnier déjà disparu, Antonio Carlos Jobim, avait l’habitude de dire que « le Brésil n’est pas un pays pour amateurs », car les règles du jeu peuvent changer, en fonction des personnages.
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
112
Un ancien dicton confirme cela, en disant que, « dans les affaires publiques, pour les amis on fait tout, pour les ennemis on ne fait qu’appliquer la loi ». Le folklore politique brésilien est plein de ces aspects étranges en matière de gouvernance, ce qui est aussi confirmé par des études mettant en rapport l’observance de l’État de droit – Rule of Law – et des progrès économiques. L’itinéraire des gouvernements du PT, depuis 2013, a précisément révélé une détérioration sensible dans l’application de la loi au Brésil, avec une augmentation quantitative et qualitative des cas de corruption.
Le plus préoccupant est la perte progressive de qualité dans l’application des politiques économiques, aussi bien au niveau macro que sectoriel. Au début, quand le PT avait besoin de prouver sa capacité à gérer une économie capitaliste, pendant la transition entre Cardoso et Lula (2002-03), les grands principes établis dans la deuxième phase de stabilisation du Plan Real (en 1999) ont été maintenus tels quels : le régime de change flexible (taux flottants en fonction du marché), le surplus budgétaire (pour le service de la dette), la loi de responsabilité fiscale (pour empêcher les dirigeants politiques de dépenser sans indiquer les recettes correspondantes) et, plus important, des limites à l’inflation, contenue dans une bande non exactement étroite (de 4 % de variation), mais toujours à un seul chiffre, pour vraiment couper avec les mécanismes d’indexation généralisé des périodes précédentes. Ces bases ont été maintenues lors du premier mandat de Lula, en dépit de l’augmentation des dépenses publiques (dument compensée par l’expansion des recettes, garantie à sa manière par la Receita fédérale).
Après la réélection de Lula, et pendant son second mandat, les vecteurs principaux de la politique économique héritée de l’administration précédente ont été transformés, jusqu’à être déformés à outrance, déjà sous le mandat de Dilma Rousseff. La série de méfaits est longue : manipulation du change, réduction du surplus budgétaire, changements dans les règles fiscales, augmentation démesurée des dépenses publiques, surtout au bénéfice des fonctionnaires publics, devenus la principale base syndicale du PT.
113
Le troisième gouvernement du PT a, en plus, ajouté des distorsions dans la plupart des politiques sectorielles, surtout dans les domaines industriel – en faveur de grands groupes, qui sont les mêmes généreux donateurs lors des campagnes électorales – et commercial, avec la hausse de tarifs à l’importation et un protectionnisme généralisé, en contradiction avec les objectifs du Mercosur. Les taux d’inflation ont été constamment poussés vers le haut, la dette publique n’a cessé d’augmenter et les déficits dans les transactions courantes s’accumulent de manière inquiétante (déjà autour de 4 % du PIB en 2013), attestant que le Brésil est devenu un pays trop cher et très peu compétitif sur la scène du commerce international. L’érosion de la situation a été construite peu à peu, étant donné l’absence de réformes pendant les années grasses de la demande chinoise et de la survalorisation des Commodities. En effet, l’économie brésilienne est redevenue trop dépendante de l’exportation d’un nombre limité de produits primaires. Le peu d’innovation d’un système productif maintenu protégé pendant trop longtemps – dont le protectionnisme fut encore renforcé par la nouvelle équipe installée depuis 2011 – n’offre pas de bonnes perspectives pour les années à venir.
Les pêchés économiques de l’équipe au pouvoir – mercantilisme, étatisme, dirigisme, subventions, etc. – constituent seulement une partie des problèmes actuels, car il y a toute une autre série de méfaits de nature politique, dont le nouveau clientélisme lié à la « Bourse Famille » n’est pas la pire des mystifications au service de la monopolisation du pouvoir déguisée en politique sociale. Les « compagnons » au pouvoir ont aussi poussé des actions mimétiques aux politiques dites affirmatives en vigueur dans certains pays en introduisant des quotas raciaux – en faveur des afro-brésiliens et indigènes – qui risquent de créer un nouvel apartheid au Brésil, un pays qui, certes, n’est pas exempt de discriminations, mais qui n’a jamais possédé une autre culture que celle du mainstream brésilien, un mélange de races et de couleurs, de religions et d’ethnies très diversifiées et qui se sont souvent confondues au long des âges et du melting-pot brésilien.
| Paulo Roberto DE ALMEIDA
114
Conclusions : encore du chemin à faire dans les ajustements internes
Le Brésil a parcouru un long chemin dans sa quête d’une économie stable – ce qu’il a finalement réussi à créer avec le Plan Real, mais qui est toujours sous la menace d’avarie et de dégradation, dans les nouvelles conditions de gouvernance socialiste – et d’un système productif capable de gérer des emplois de qualité, ce qui ne semble pas toujours assuré en vue de l’état moins que satisfaisant de l’éducation publique. Aucun autre pays au monde n’a connu, comme le Brésil, le remplacement, huit fois de suite, dans l’espace de deux générations, de la monnaie nationale, signe incontesté de l’incapacité des élites dirigeantes à remplir convenablement les tâches, certes complexes, de l’administration d’un pays moderne, inséré pleinement dans les rouages d’une économie mondialisé et compétitive.
La tâche principale - assurer la stabilité macroéconomique - a été accomplie seulement en partie, car il faut encore mettre en ordre les comptes publics, réduire les déficits budgétaires, aligner les taux d’intérêt et d’inflation avec les moyennes en vigueur dans le monde et placer les mouvements des capitaux et la parité du change beaucoup plus sous l’emprise des marchés que sous la manipulation de bureaucrates. La deuxième tâche - construire une microéconomie compétitive - reste incomplète elle aussi, car il y a trop de monopoles et des cartels légaux ou informels, qu’il faut démanteler, en faveur d’une plus large compétition dans plusieurs secteurs. La troisième tâche, la bonne gouvernance, est, hélas, une promesse, car elle dépend fondamentalement de l’éducation politique du peuple, toujours attiré par des mirages populistes et démagogiques ; le système judiciaire est presque aussi dysfonctionnel que le système politique, vicié, lui, par des comportements autistes d’une classe politique qui fait de sa survie le seul but à atteindre dans l’engrenage du gouvernement.
La quatrième tâche, celle de construire le capital humain de la nation au moyen d’un système éducatif de qualité, reste aussi un énorme défi non seulement pour la présente génération, mais pour
115
la prochaine et peut-être la suivante encore. C’est, de loin, la tâche la plus difficile, surtout parce que tout l’édifice de l’éducation nationale est déformé dans son essence, et qu’il faut le reconstruire à partir de bases nouvelles, ce qui n’est même pas en vue de s’accomplir par manque total de conscientisation sur les erreurs commises au cours de dix dernières années. La cinquième tâche, une plus grande ouverture aux investissements étrangers et au commerce international, ne serait pas difficile à atteindre, car dépendante de simples décisions de politique économique sectorielle, mais butte peut-être contre le problème de la compétitivité insuffisante des entreprises brésiliennes, ce qui est dû aussi bien à des obstacles structurels – charge fiscale trop élevée, infrastructure défaillante – qu’à des externalités négatives : éducation de mauvaise qualité, qui se reflète dans le peu d’innovation du système productif. En tout et pour tout, le principal défi est celui de l’émergence de leaders politiques à la hauteur des défis détectés, ce qui est encore une autre promesse qui reste dans le domaine des contingences.
Résumé
Cet article analyse l’évolution politique du Brésil de ces dernières années, en soulignant les changements pertinents opérés depuis l’orientation social-démocrate de l’administration Cardoso, ainsi que les choix économiques étatiques voulus par Lula et les gouvernements successifs du Parti des Travailleurs (à partir de 2003). Il affirme que le Brésil pourrait tomber dans une phase de relative stagnation de la croissance économique et d’une détérioration sensible de son appareil institutionnel en raison de l’orientation néo-bolchevique des nouveaux dirigeants.
Abstract
Analytical essay about the political development of Brazil in recent times, stressing the relevant changes since the social-democratic orientation of Cardoso administration, and the more state-guided economic choices made by Lula and the Worker’s Party governments (starting in 2003). Brazil could be on the verge of a relative stagnation in economic growth and a sensible deterioration in its institutional apparatus, due to the neo-Bolshevik orientation of the new leaders.
M, Mme, Mlle Prénom
Société/Institution
N° Rue
Code postal
Ville Pays
Adresse électronique
France Autres pays1 an (5 numéros) 95 135
2 ans (10 numéros) 180 220 Je souscris un abonnement pour 1 an 2 ans
À partir du numéro
Je souhaite commander un numéro à l’unité (20 + frais de port : France, 2.10 ; Autres, 4.50 )Numéro Signature/CachetDate
Paiement par virement bancaire versCrédit du Nord 59, boulevard Haussmann, 75361 Paris, cedex 08Banque : 30076 - Agence : 02019 Compte : 57336700200 - clé RIB : 09IBAN : FR76 3007 6020 1957 3367 0020 009swift (BIC) : NORDFRPPprécisez « frais bancaires à la charge du donneur d’ordre »
ouPaiement par chèque à l’ordre de Choiseul éditions, Attention, les chèques étrangers doivent être en euros, compensables en France.
CONTACT:Choiseul éditions16 rue du Pont Neuf, 75001 ParisTel. : +33 (0)[email protected]
BULLETIN D’ACHAT, D’ABONNEMENT OU DE RéABONNEMENT
68
68
Robert DUSSEZ
Henri LACHMANN
Jean-François CIRELLI
Eric WOERTH
20 euros
ApartésJean-François CIRELLIOù va l’Europe de l’énergie ?
Éric WOERTHFiscalité et compétitivité
Henri LACHMANNComment freiner la désindustrialisation ?
Pascal CHABOISSEAULe marché des télécoms en France
Jean-François DI MEGLIO & Jacques GRAVEREAULes investissements chinois en Europe
Village globalMickaël R. ROUDAUTKaboul-Paris : voyage d’un gramme d’héroïne
Barthélémy COURMONTChine - Taiwan : ennemis un peu, partenaires beaucoup
Rodolphe GREGGIO & Benoît MAFFÉIRente pétrolière et crise économique
Paulo Roberto DE ALMEIDAGéoéconomie du Brésil, un géant empêtré ?
Jean-François BOUCHARDBCE, le nouvel empereur de l’Europe
Horizons africainsEmmanuel NIAMIEN N’GORANRéconciliation, justice et croissance économique en Côte d’Ivoire
Robert DUSSEYLa piraterie maritime : quels enjeux pour le Golfe de Guinée ?
Claude JAMATIL’Afrique et l’eau
Silver MUGISHAL’amélioration des services de l’eau en faveur des pauvres dans les pays émergents