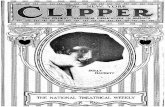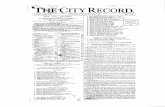2012 « J’ai mal aux os ». Rituels, imaginaire partagé et changement social
L'épopée moderniste — Construction d'un imaginaire politique au Brésil (1917-1930)
Transcript of L'épopée moderniste — Construction d'un imaginaire politique au Brésil (1917-1930)
UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCEInstitut d'Études Politiques de Grenoble
Vassili RIVRON
L'ÉPOPÉE MODERNISTEConstruction d'un imaginaire politique au Brésil
(1917-1930)
Mémoire de MaîtriseSéminaire "Fins de Siècle"
Dir.: Jean-Pierre BERNARDAnnée 1995-1996
1
Notes préliminaires
1- Un certain nombre de termes n'ayant pas d'équivalent en français, nous les avons laissés en portugais dans le texte. Ces mots figureront en italique et seront marqués d'un astérisque, renvoyant au lexique qui se trouve en dernière page.
2- Les textes sur lesquels nous allons travailler au cours de ce mémoire n'ayant quasiment jamais été édités en français, je me suis donc chargé de les traduire, tout en sachant que les textes perdent alors forcément de leur richesse.
3- Au cours de ces traductions, des remarques s'imposaient et sont renvoyées en bas de page, avec l'abréviation "n.t." (note de traduction).
4- Les illustrations qui ont été insérées dans le texte n'y comportent qu'un titre indicatif; la table des illustrations qui présente leurs références complètes est placée à la fin de l'ouvrage, p. 147.
En couverture: Etude de Vítor Brecheret pour le Monumento às Bandeiras (1920). (Extraite de Francisco Alambert, A Semana de 22, São Paulo: ed. Scipione, 1992. -
p37).
2
Sommaire
Notes préliminaires 1
Sommaire 2
Introduction 5
Première PartieLe Modernisme: construction d'une rupture dans l'histoire de l'art au Brésil 8
1.1.- Du futurisme au modernisme 81.1.1.- LE BRÉSIL DES ANNÉES 20 ET LE CONTEXTE ARTISTIQUE AVANT 1922 8
a) Structures du pouvoir et mutations sociales 9b) Une culture sous influence 12
1.1.2.-ANTÉCÉDENTS DE LA SEMAINE D'ART MODERNE ET DU MODERNISME 14a) Le pré-modernisme et la question sociale au Brésil 15b) Le futurisme et la libération des formes de l'art 17c) Vers l'autonomisation du futurisme brésilien 21
1.2.- La Semaine d'Art Moderne et les dédoublements du modernisme 231.2.1.- LA SEMAINE DE 22 ET SES PREMIÈRES CONSÉQUENCES DANS LE CHAMP ARTISTIQUE 23
a) La Semaine d'Art Moderne, naissance officielle du modernisme brésilien23b) Le modernisme de 1922 à 1924, un iconoclasme systématisé 26
1.2.2.- MATURATION DU MODERNISME ET ÉMERGENCE DE LA QUESTION DE LA BRÉSILIANITÉ
29a) Pau-Brasil et le virage de 1924 29b) La radicalisation de la rhétorique brésilianiste: Verdeamarelismo et Antropofagía 33
3
Seconde PartieLe Modernisme et la société brésilienne: du discours politique à la découverte de la Nation 36
2.1.- Aboutissement politique de la démarche esthétique 362.1.1.- VERS UN ENGAGEMENT POLITIQUE DE L'AVANT-GARDE MODERNISTE 37
a) La poésie Pau-Brasil contre l'Ecole de l'Anta 37b) Des mouvements plus politisés, dans l'État de Minas Gerais 39
2.1.2.- SOCIOLOGIE DES MODERNISTES: DES STRATÉGIES DIVERSES POUR UN STATUT INCERTAIN 42a) Le déclin des oligarchies rurales 42b) Les "hommes sans profession" et le dandy Oswald de Andrade 44c) Les "cousins pauvres" et le profil type de Mário de Andrade 46
2.2.- De l'avant-garde à l'intellectualité 472.2.1.- LES MODERNISTES ET LE POUVOIR PENDANT LES ANNÉES 20 47
a) Cadre général de l'intellectualité pendant la période étudiée 47b) Soutien politique et engagement partisan des modernistes 49
2.2.2.- TRANSFORMATION DU STATUT DE LA LITTÉRATURE DANS LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE
52a) Légitimation du statut d'intellectuel des modernistes et constitution d'un marché littéraire 52b) Divulgation du modernisme et "substitution des importations" de biens culturels 55
2.3.- La découverte du Brésil 572.3.1.- LE BRÉSIL DÉCOUVERT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'EUROPE 57
a) Voyages d'étude et tourisme européen 57b) Intervention étrangère dans la reconnaissance de talents nationaux 60c) Réaction anti-exotiques chez certains écrivains 61
2.3.2.- EXPLORER LE BRÉSIL 62a) L'expérience du Brésil 62b) Nouvelles démarches littéraires: le régionalisme 65c) Folklorisme Sciences Sociales 67
4
Troisième PartieLe Brésil: Démarche imaginaire et démarche constructive 72
3.1.- Le Brésil imaginé: figures de l'imaginaire moderniste 723.1.1.- LA RECRÉATION DU BRÉSIL 74
a) Les origines tupi de la nation 74b) Récits épiques et mythes fondateurs 76c) La réinterprétation de l'histoire du Brésil 79
3.1.2.- LA NATION, LE PEUPLE INVENTÉS 81a) L'avant-garde moderniste et la culture populaire 81b) Les fondements objectifs de la Nation 84c) L'idéologie du caractère national 87
3.2.- Construire le Brésil 903.2.1.- L'IDENTITÉ ET LE RÔLE DE L'AVANT-GARDE 91
a) L'avant-garde et la Nation 91b) L'action et le progrès thèmes centraux 93
3.2.2.- LE MYTHE DE LA CIVILISATION BRÉSILIENNE 94a) Antécédents du mythe de la civilisation brésilienne 94b) La décadence de la société brésilienne et la prophétie 96
3.2.3.- FONDEMENTS MODERNISTES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NATION 99a) A Estética da vida, fondement philosophique du modernisme 99b) Le nationalisme et ses fondements philosophiques au Brésil 101c) La Révolution Anthropophagique contre l'école de l'Anta 104
Conclusion 109
Table des Illustrations 112
Table des Annexes 114
Annexes 115
Bibliographie 142
Lexique 147
5
Introduction
La modernité est, par définition, un problème d’actualité, et repose essentiellement sur un système de représentations définissant cette actualité. En Amérique Latine, mais particulièrement au Brésil, la question de la modernité acquiert un tournant quelque peu agité pendant les années 20.
Si cette question surgit au Brésil, dans le domaine littéraire et artistique en général, nous verrons qu’elle implique une transformation des façons de penser le politique, et la réalité d’une manière générale, et qu’elle impliquera donc des secteurs beaucoup plus larges de la société.
La société brésilienne du début du XXe siècle vit une transformation profonde de ses conditions matérielles et humaines. Le processus industriel et urbain, qui s’amorce dans certains secteurs de la société, amène une remise en cause de la représentation du monde et de la légitimité des formes de pouvoir.
Cette transformation du mode de vie et des formes de sociabilité a surtout lieu dans la ville de São Paulo, qui, jusqu’au début du siècle, n’était qu’une petite capitale provinciale vivant du commerce de produits agricoles. La question de la modernité surgira donc dans un milieu où les transformations économiques, politiques et sociales ont été perçues avec acuité. En effet, au début du siècle, et grâce principalement au lucratif commerce du café, une dynamique industrielle et urbaine se révèlent brutalement dans cette ville.
Les transformations sociales se font ressentir fortement, principalement par l’apparition de nouvelles catégories socio-politiques liées au développement industriel: une bourgeoisie urbaine apparait, concurrençant les oligarchies rurales traditionnelles, et un prolétariat urbain se forme progressivement, constitué d’éléments d’origine culturelle très diverse. São Paulo a été fortement touché par les vagues d’immigration du début du siècle, accueillant ainsi de nombreuses familles provenant des campagnes, et principalement de l’étranger (d’Europe, du Moyen Orient, du Japon).
Cette évolution particulièrement marquante de la société de São Paulo est interprétée dans le sens d’une modernité urbaine et technologique qui se caractériserait essentiellement par une prise de vitesse et une mécanisation de la vie quotidienne.
Toutes ces transformations,auxquelles il faut ajouter, au début des années 20, un contexte économique instable, expliquent un certain nombre de troubles sociaux et politiques dans la vie paulista*. Mais c’est sans aucun doute par le biais de la question de l’art que surgit au Brésil celle de la modernité. La modernité, en ce sens, est perçue comme réelle et immédiate, et la problématique qui lui est associée est celle d’adapter les modes d’expression à la nouvelle réalité urbaine et technologique.
La formation d’une mondanité particulièrement agitée dans certains secteurs classes aisées de São Paulo et la découverte des avant-gardes européennes amènera quelques artistes brésiliens à se regrouper pour remettre en cause les formes de l’art telles qu’elles avaient été conçues auparavant (c’est-à-dire un art mimétique et ornemental). Face à l’évolution de la «réalité» à São Paulo, ces quelques personnalités posent le problème de la modernité de l’art, pour faire céder les dernières résistances (celles de la représentation) à la civilisation technologique.
7
Telle est en tout cas la manière dont est posée, à la fin de la première décennie du XXe siècle, la question de la modernité. Nous verrons cependant qu’assez rapidement, cette façon d’aborder le thème de la modernité évoluera et même, s’inversera. En effet, si les premières manifestations du modernisme au Brésil (sous la forme d’un courant futuriste) se proposaient uniquement d’adapter la représentation à la réalité moderne, ces préoccupations se transformeront au cours des années 20. L’immédiateté de l’accès à la modernité par l’adoption de nouveaux modes d’expression est substituée par la prise de conscience que la modernité ne faisait pas encore partie du réel au Brésil, et qu’il revenait au contraire à l’art de guider la société vers la modernité. L’art n’est alors plus la dernière résistance à la modernité, mais au contraire la première intuition.
Nous nous proposons ici de montrer quelles ont été les raisons d’une telle inversion de la façon d’aborder la question de la modernité, dans la perspective de mieux comprendre les relations des modernistes brésiliens avec la politique. En effet, la transformation de la conception de la modernité amenait une implication politique des modernistes (principalement les écrivains, qui se sont construit une identité sociale oscillant entre l’artiste et l’intellectuel), car vu leur façon de présenter cette question, ils devaient assumer une responsabilité fondamentale dans la construction d’une modernité au Brésil.
Le modernisme, mais traditionnellement aussi toutes les formes d’expression artistique, s’est toujours affirmé en prenant pour repère l’évolution de l’art en Europe. Mais la façon de concevoir cette influence s’est elle-même transformée. En un premier temps, l’accès à la modernité dans l’art était imaginée par l’application des nouvelles techniques d’expression artistique importées d’Europe (incarnation de la modernité). Puis la découverte que la modernité n’était pas encore entièrement intégrée dans la réalité et les mentalités au Brésil amènera les modernistes à concevoir l’accès à la modernité comme l’accès à une temporalité nationale propre. Ce second temps du modernisme prend alors toujours comme référent l’Europe, mais dans la perspective de s’en distinguer.
L’apparition de la question de la temporalité nationale comme moyen d’accès à la modernité universelle est le tournant principal du mouvement qui, par la formulation de la question de la nationalité1, s’ouvre à des questions beaucoup plus larges que le simple domaine de l’esthétique.
Il semblerait qu’il n’y ait pas de rapport direct, à ce niveau là, entre les questions de la modernité et les problèmes politiques concrets du Brésil des années 20, liés aux évolutions fondamentales des structures de pouvoir. Or, après avoir présenté en une première partie, d’une part l’évolution de la société et de son organisation politique, et d’autre part la mise en place du mouvement moderniste sur la scène artistique jusqu’à la fin de la décennie, nous montrerons, dans une seconde partie, que les écrivains que nous prenons ici en considération se sont largement impliqués dans les tumultes politiques divisant l’élite brésilienne, et dans les évolutions fondamentales de la société.
Ils prennent parti, de plus en plus radicalement, dans leur art et dans leurs pratiques quotidiennes, en faveur d’un nationalisme soit conservateur, soit progressiste. Cette évolution sur le plan politique sera largement perceptible, dans leur propre propos esthétique ou dans leurs œuvres littéraires, et est intimement liée à l’idée de leur rôle à jouer dans l’avenir de la société brésilienne. Finalement, les écrivains modernistes, s’identifiant, par leur prétention à pouvoir révéler la brésilianité au peuple, à l’élite de la Nation (notion qui se confond chez les modernistes avec celle d’avant-garde), trouvent une possibilité de concrétisation de ce statut par l’identification à l’intellectualité.
L’épopée moderniste au long des années 20 s’articule finalement à une modification profonde du statut de l’art (principalement de la littérature) dans la société, transformation qui se manifeste à travers la constitution d’un marché littéraire et intellectuel, et la mercan-tilisation de l’œuvre d’art.
8
La question de la modernité, dans ces conditions, ne perd ni de son actualité ni de sa centralité dans le propos moderniste qui, la posant en termes de brésilianité, sera amené à s’interroger sur leur pays et surtout sur les fondements de l’idée de nation. La connaissance du Brésil devient alors un enjeu central pour les écrivains prétendant à l’intellectualité et à une situation favorable dans le jeu du pouvoir, au sein de l’élite culturelle et politique.
C’est donc dans cette perspective que nous analyserons, en troisième partie, sur la base d’œuvres littéraires, les structures de l’imaginaire politique moderniste qui s’est formé au cours des années 20. La formation de l’imaginaire politique moderniste, constitué en idéologie autour d’un certain nombre de structures cognitives que sont les représentations et les mythes politiques, permet aux auteurs d’un côté de légitimer leur statut d’intellectuels, et de l'autre de se forger une identité leur permettant de prétendre à participer à la construction de la Nation.
L’aboutissement de cette démarche imaginaire et constructive des modernistes est la formulation d’un projet politique particulier, qui leur permettra, dans le contexte du nationalisme des années trente, de participer activement aux politiques culturelles de construction de l’identité nationale.
C’est dans cette perspective que se comprend l’intérêt d’un travail comme le nôtre, car l’étude de la formation et de la structuration de cet imaginaire politique spécifique nous permettrait de mieux appréhender l’engagement des modernistes auprès des structures étatiques, perceptible au cours des années 30, ainsi que la place qu’occupent les modernistes dans la tradition intellectuelle brésilienne, et dans ce que l’on appelle la Culture Nationale.
9
Première partie
Le Modernisme : construction d'une rupture dans l'Histoire de l'Art au Brésil
Nous tenterons avant-tout en cette première partie, de mettre en valeur, à travers une perspective chronologique sur la période que nous étudions (1917-1929), les moments significatifs de l'histoire du modernisme ainsi que leur contexte et leurs antécédents, mais nous présenterons aussi les idées et concepts fondamentaux du mouvement, considérés essentiellement sous leur aspect artistique.
Les parties qui suivent celle-ci prendront pour base ces événements artistiques afin de pouvoir analyser plus profondément la construction de l'imaginaire politique moderniste, au niveau non plus seulement de l'histoire de l'art, mais dans la perspective d'une sociologie et d'une anthropologie politique du mouvement.
1.1.- Du futurisme au modernisme
1.1.1.-LE BRÉSIL DES ANNÉES 20 ET LE CONTEXTE ARTISTIQUE AVANT 1922
Cette rapide présentation du contexte politique, économique et culturel dans lequel va se dérouler le modernisme, s'attachera essentiellement à évoquer la situation et les événements-clés qui ont marqué les écrivains dont nous étudions ici l'œuvre, et motiver les transformations profondes du champ littéraire que nous présenterons plus loin.
Pour mieux comprendre le modernisme, ses implications historiques et le sens des interprétations dont il est l'objet jusqu'aujourd'hui, nous devons présenter le processus social et historique dans lequel s'est fondée la culture moderniste au Brésil.
Nous devons ici préciser que le mouvement que nous étudions est le produit de cette période mouvementée de l'histoire de la société brésilienne, mais que les événements politiques, économiques et sociaux que nous exposons à suivre apparaissent en fait assez rarement dans l'œuvre des écrivains modernistes. Cependant le modernisme, comme nous le montrerons ultérieurement, est étroitement lié à ce contexte.
La période que nous étudions ici est marquée par un ensemble d'évènements politiques, de crises économiques, de transformations de la société, et nous apparaît comme une période clé dans le processus de modernisation du Brésil. Du début de la décennie à sa fin, de nombreux troubles politico-économiques et de nombreuses mutations sociales aboutissent à une profonde transformation du pays, marquée en 1930 par des élections présidentielles houleuses et la contestation de la domination des États de São Paulo et Minas Gerais, par la marche des sudistes gaúchos sur la capitale, et par la "Révolution Constitutionnaliste" de 1932.
Ces transformations de la société mèneront à une remise en cause du statut de l'art au sein de la société brésilienne, et à l'apparition de nouvelles expressions artistiques,
10
plus étroitement impliquées en politique et contestant le formalisme académique assimilé à une époque révolue.
a) Structures du pouvoir et mutations sociales1
La fin du XIXe siècle et le début du XXe se caractérisent au Brésil par un développement accéléré de l'économie industrielle, fondé sur une augmentation des gains liés à la production de café et qui ont pu être investis dans l'industrie naissante. La concentration de l'économie brésilienne sur la production agricole et extractive (caoutchouc, minerai) avait en fait mis en place un processus qui allait mener cette même économie, à sa perte. Elle avait en effet rendu possible l'industrialisation et créé les conditions d'une concentration démographique et d'une urbanisation du Sud-est brésilien, en particulier à São Paulo.
Le développement de l'industrie amenait une remise en cause fondamentale du libéralisme économique, interprété par les nouveaux investisseurs brésiliens comme favorisant la dépendance par le biais de la reproduction de l'économie agraire essentiellement dominée par des groupes financiers étrangers. Le parti pris d'une faction de l'élite économique en faveur de l'industrialisation propose un modèle de développement et d'émancipation nationale par la formation d'un marché interne de production et de consommation.
Mais malgré ce tableau prometteur, la spécialisation du Sud-est dans l'industrie a fait augmenter les disparités régionales et la dépression économique qui surgit avec les années 20 empêche le pouvoir industriel de se consolider. La tendance de l'économie brésilienne est, à une constante spécialisation régionale, déterminée par les nouveaux centres dynamiques de l'économie nationale. Les régions agricoles dépendent de ces nouveaux centres, et fournissent aliments et matières premières en échange de produits manufacturés.
La période qui va de 1920 à 1922 se caractérise d'autre part par une profonde crise de la production de café, une forte inflation et spécialement une crise fiscale grave. Le volume des importations chute, affaiblissant la recette fiscale de l'Etat. Le niveau d'activité et d'investissement se réduit.
La fin du gouvernement d'Epitacio Pessoa (élu en 1919), dont le début avait été celui d'un gouvernement de confiance dans une période de prospérité, déçoit les attentes économiques des classes dirigeantes .
Le rapide développement de l'activité industrielle a amené une explosion urbaine du pays, et plus particulièrement de São Paulo, qui en 1920, commence à se détacher des autres centres urbains, de par sa dynamique industrielle particulière.
Nous assistons à cette époque à une accélération de l'immigration dans les nouveaux centres urbains, de familles provenant de l'étranger (principalement d'Italie et d'Allemands, mais ausi d u Moyen-Orient) et des milieux ruraux, ainsi qu'à la mise en place d'une société industrielle sur la base des modèles du XIXe siècle européen. Il y a formation d'une bourgeoisie et d'un prolétariat urbain (on compte 138 000 ouvriers en 1922, dont un tiers d'immigrants ruraux). Un mouvement revendicatif ouvrier assez combatif se forme, largement influencé par l'anarchisme, et en 1922 se crée le Parti Communiste Brésilien. Entre 1915 et 1929 on a pu compter 107 grèves, ce qui est un nombre important pour une industrie, somme toute, naissante. Cependant, les thématiques anti-cléricales et anti-militaristes développées n'étaient pas adéquates pour la formation d'un mouvement ouvrier dans le contexte politique des années 20, et la population ouvrière urbaine représentait finalement une petite minorité dans la population brésilienne.
Les années 20 apparaissent au contraire comme une période de reflux du mouvement ouvrier qui s'était formé entre 1917 et 1920 dans les grandes villes, reflux causé, d'une part, par les lois de 1921 et 1927 contre l'anarchisme et permettant la
11
répression des mouvements syndicaux, et d'autre part par la concurrence entre anarchisme et communisme (liée à la création d'un parti communiste).
C'est cependant ce choc industriel et urbain, accompagné d'une mécanisation du quotidien, dont le symbole est l'apparition au début du siècle, des premières voitures, du train, et du tram, qui amènera à la fin des années 1910 le futurisme d'Italie et le culte de la civilisation technologique. Un certain nombre d'évènements symboliseraient l'avènement de cette nouvelle société au Brésil, par exemple, l'installation en 1920, de la première fabrique de montage de Ford installée au Brésil, de la première ligne de bus à São Paulo. En 1922 de nouvelles lignes postales, télégraphiques et téléphoniques sont installées, et apparaît en 1925 le premier réseau de radio-diffusion (la Radio-Educadora de São Paulo).
Mais, en 1920, la nouvelle société industrielle et urbaine n'a pas encore entièrement pris le pas sur l'ancienne société oligarchique. Beaucoup d'éléments patriarcaux et conservateurs demeurent en effet à la tête du pays, organisant la politique à partir de l'exportation de produits agricoles. S'il y a un certain développement de la production industrielle, le café représente, encore en 1901, 75% des exportations.
Cette dualité se manifeste bien sur le plan politique. D'un côté, la vieille oligarchie rurale cherche à se maintenir au pouvoir pour assurer les intérêts des propriétaires terriens. Héritière de la colonie, cette oligarchie dominait ce que l'on a appelé la República Velha*, celle de l'ordre du "café au lait" (où l'État de Minas Gerais, grand producteur de lait et São Paulo, producteur de café, alternaient au pouvoir politique). C'est dans le climat de la crise du début des années 20 que se formalise l'accord tacite Minas-São Paulo, qui assure l'élection d'Artur Bernardes de Minas Gerais, mais donne à São Paulo le contrôle absolu sur l'économie, avec Sampaio Vidal au Ministère de l'économie. Les conséquences de cette politique, baptisée par les commentateurs la "République du café au lait" était le premier compromis formel du gouvernement fédéral pour la valorisation permanente du café.
La machine étatique était donc entièrement au service des planteurs, lancée dans une politique économique axée sur le maintien des prix du café, rentrant ainsi en rupture avec la tradition libérale, credo officiel de la république.
À la structure oligarchique du pouvoir s'oppose, peu à peu, et sans réelle manifestation politique autonome, certains milieux de la population urbaine, encore peu différenciés, mais insatisfaits par la préférence faite pour la politique du cours du café. Ceux-ci se mobilisent et trouvent des canaux de résonance dans les moments de scission oligarchique, c'est-à-dire dans les moments de réorganisation des alliances entre factions de la classe dirigeante. A la República velha s'opposent les "Tenentes" (les "lieutenants", fils de classes moyennes qui organisent entre autres, la prise du fort de Copacabana en 1922) et une bourgeoisie qui demande la libéralisation du régime afin de favoriser l'industrialisation. Ces nouvelles forces politiques s'expriment soit par la violence (soulèvements de 1922 et révolution de 1924) soit par un organe représentatif, créé en 1925 : le Parti Démocratique. Ce dernier, défendant des valeurs libérales ainsi qu'un certain nationalisme et la valeur de la jeunesse, acceptera plus tard en son sein une faction des modernistes.
Les différentes rébellions des lieutenants pendant la décennie sont l'expression de l'éclosion d'une remise en cause "par dedans" et "par dehors" du pacte politique. Ils profitèrent de l'affaiblissement du régime pour former en 1922 une coalition des oligarchies des États du Rio Grande do Sul, Bahía, Pernambuco et Rio de Janeiro, contre la dictature de l'axe Minas Gerais-São Paulo.
Vecteurs d'une idéologie hautement élitiste, et tournés en même temps vers l'idée de la purification des forces militaires et de la société en général, les lieutenants avaient un programme autoritaire et nationaliste, défendant une plus grande centralisation de
12
l'État, l'uniformisation législative et l'attaque à l'oligarchie paulista. C'est cet aspect qui a pu séduire certains dissidents de l'oligarchie étatique et conquérir leur appui.
D'autre part, pour les couches populaires, si le "tenentismo" avait été, pendant un moment, le catalyseur des espérances d'altération de l'ordre en place, les lieutenants s'identifiant à l'agent du "salut national" au nom et à la place du "peuple inerte", l'articulation de ce dernier avec les classes populaires a donc été limitée.
Cependant, alors qu'en 1925, la rébellion militaire commençait à dépasser le secteur urbain, avec notamment une longue marche de 25 000 km dans le pays pour "maintenir vivante la flamme de la révolution" (c'est la légendaire colonne Prestes), les factions oligarchiques se sont entendues entre elles, pour garantir au candidat du gouvernement un nouveau prestige. L'élargissement des alliances pour la chute du grand "club oligarchique" devrait attendre la nouvelle manifestation de la crise du café, accompagnée d'un interventionnisme économique (monnétariste) d'une montée du coût de la vie, un questionnement anti-oligarchique généralisée et une mobilisation sociale.
La crise brésilienne de 1929 fut le résultat du lent épuisement d'une économie mercantile exportatrice, qui avait certes fait preuve de vitalité et de potentialités de développement surprenantes, mais qui était soudainement remise en cause par une dynamique industrielle moins libérale, qu'elle avait elle-même rendu possible.
Les élections préparées en 1929 furent le thermomètre immédiat de la réarticulation des forces politiques et sociales dans cette conjoncture, marquée par une nouvelle scission oligarchique qui regroupait un front régional connu sous le nom d'Alliança Liberal (composée de Minas Gerais, Rio Grande do Sul et Paraíba ), intégrant cette fois des anciens militaires révoltés et les secteurs populaires. De son échec sur la voie électorale résulte le recours aux armes de 1930.
Ce coup d'État peut être vu comme un volonté d'ascension des forces de la bourgeoisie urbaine et industrielle, au pouvoir du pays, mais sans succès réel, puisque jusqu'en 1937 (début de l'Estado Novo) le régime est divisé entre les différentes tendances, et en est d'autant affaibli.
Les années 20 sont donc une période houleuse de la politique et de l'économie brésilienne, période au cours de laquelle se manifestent les premières faiblesses du système oligarchique hérité de l'Empire, et prennent forme peu à peu les nouvelles structures du pouvoir.
Les années 20 furent d'une manière générale, la scène d'un crise socio-économique et politique sérieuse, dont on ne sort qu'avec l'instauration de l'Estado Novo en 1937. Politiquement parlant, ce fut une crise d'hégémonie qui prit au cours des années 20, le sens ultime d'une contestation de la prépondérance de la bourgeoisie du café, culminant avec la "révolution de 1930". Au cours des années 30, la crise de l'hégémonie peut être prise au sens strict, c'est-à-dire qu'aucune classe ne put établir un contrôle incontesté sur le pouvoir étatique. A ce sujet, l'année 1922 est souvent citée comme symbolisant la mutation en cours. À la révolte des Tenentes, s'ajoutent la naissance du Parti Communiste Brésilien (qui deviendra bientôt nationaliste), l'irruption du modernisme dans le domaine artistique et culturel et le retour en force d'une mouvance catholique.
Le mouvement artistique moderniste est le résultat de ces transformations de la société brésilienne. La naissance du mouvement moderniste se fait effectivement dans un cadre nouveau: la plupart des modernistes, nés vers les années 1890, ne connaissent pas le São Paulo tranquille du début de l'époque du café (époque pendant laquelle São Paulo était encore une vieille ville traversée par quelques ruelles tortueuses et sombres, elle n'avait qu'une cathédrale et quelques monastères). Ce que les modernistes ont, par contre, connu c'est le "boom industriel" et l'euphorie techniciste de São Paulo, plus
13
hospitalier pour les Italiens et les Syriens que pour les caboclos* ou les anciens esclaves venant des campagnes.
b) Une culture sous influence
Du point de vue culturel et artistique, c'est l'Europe qui prédomine en tant que modèle pour la culture érudite et urbaine brésilienne. Après la rupture de l'indépendance, en 1822, l'oligarchie brésilienne s'était ouverte, au delà de l'Europe ibérique, à une Europe continentale qui lui paraissait représenter le summum de la civilisation.
Au début du XXe siècle, la monnaie brésilienne étant forte, grâce à l'exportation de café, les riches fazendeiros* effectueront de nombreux voyages en Europe avec leur famille, pour de longs et luxueux séjours. Et les Brésiliens découvrent avec émerveillement ce qui est pour pour le centre de la culture mondiale.
Au XIXe siècle, l'oligarchie brésilienne ressentait encore quelque nostalgie pour la culture ibérique et "latine", disposée à préserver le "trésor perdu" de ses racines européennes. Convaincue de la "pureté" de son sang, fière de ses origines "blanches", la faction dominante de la société brésilienne feignait d'ignorer le vieux fond indien, les apports africains et asiatiques du "Brésil profond". Ce hiatus entre un modèle idéalisé et la complexité des sociétés américaines avait d'ailleurs suscité un débat central au XIXe siècle: ne fallait-il pas condamner la "barbarie" du métissage biologique et culturel au nom de la supériorité de la civilisation européenne?
Il semblerait d'autre part que le rapport à l'ancienne métropole, ne soit toujours pas assumé par les élites brésiliennes, si bien que l'on rejette, ou du moins on fait entièrement abstraction du Portugal dans les commentaires de la vie politique et artistique internationale (le modernisme portugais passera quasiment inaperçu au Brésil). Le centre du monde pour l'élite brésilienne cultivée n'est plus Coimbra, mais La Sorbonne.
Cette admiration avouée pour l'Europe Latine et principalement pour la France a été constatée par Clémenceau qui, en voyage en Amérique du Sud en 1910, constate un grand courant de sympathie pour la France et sa "haute civilisation". Il rappelle d'autre part l'impact de la Révolution française sur les idéaux d'une certaine jeunesse Latino-américaine (il parlait des milieux militaires et des "tenentes")
Comme le note Mário Carelli, "malgré les velléités coloniales telles que la fondation d'une «France Antarctique» dans la baie de Rio de Janeiro au XVIe siècle, puis celle d'une «France Equinoxale» au XVIIe, sans parler de la prise de Rio par Duguay-Trouin en 1711, les Français n'ont pas réussi à conquérir le Brésil à coups de canons"1. Mais le Brésil a été français comme l'Europe du XVIIIe siècle était française.
La République brésilienne fut proclamée en 1889 au chant de La Marseillaise, sur un fond idéologique comtien, et Rio de Janeiro fut remodelée en profondeur en 1922, à l'exemple du Paris Haussmannien. Se rendre à Paris devient une nécessité pour tout intellectuel digne de ce nom.
La culture française établissait son hégémonie sur les milieux intellectuels. Tous les intellectuels brésiliens de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle, parlaient et lisaient le français couramment, et nous pouvons voir dans différents journaux du début du siècle, des articles et des chroniques quotidiennes en français. Des compagnies théâtrales françaises se présentaient régulièrement dans les grandes capitales.
Le lucratif commerce obtenu par la plantation de café avait créé une élite politique qui désirait s'imposer dans le domaine des idées et de la culture. Cette nouvelle bourgeoisie du café exerçait ses loisirs et satisfaisait sa soif de culture à travers des pièces de théâtre françaises, de la poésie parnassienne (formelle et rigide) ou des opéras
14
italiens (qui, particulièrement à São Paulo, étaient relativement populaires à cause de l'immigration italienne).
Par contre il y existait un gouffre entre cette culture et les pratiques culturelles des travailleurs, qui fréquentaient plutôt les théâtres de revue, où étaient véhiculée ce qui serait plus tard appelé "musique populaire" (comme par exemple le fameux "Corta Jaca" de Chiquinha Gonzaga). La Samba était encore à l'époque un langage stigmatisé, associé à la "malandragem"2 marginale des favelas de Rio de Janeiro et était absente des salons et de la vie "cultivée".
Les différentes colonies étrangères installées à São Paulo --arabe, juive, portugaise, japonaise, russe, allemande, arménienne, etc...-- se sont rassemblées tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, formant des quartiers, créant des entreprises, des commerces, travaillant dans les usines récemment installées, et mélangeaient de cette façon leur culture avec celle des immigrants ruraux, s'adaptant ainsi à un monde nouveau dont on ne connaissait pas encore la nature.
En 1922, l'année de la Semaine d'Art Moderne, São Paulo comptait 14 salles de cinéma, avec des sessions quotidiennes et généralement trois films au programme. Certains de ces films étaient ceux dont le script avait été écrit par Menotti del Picchia et commentés par le critique du journal O Estado de São Paulo Guilherme de Almeida, qui seront protagonistes du mouvement moderniste.
Du point de vue des questions spécifiquement artistiques, le début du siècle
présente peu de différences par rapport aux questions soulevées au XIXe siècle: les canons européens, romantique, parnassien ou naturaliste prédominent dans un milieu où l'académisme est la règle. Nous pouvons d'autre part constater une quasi absence de marché artistique, le statut social des artistes étant assuré par les soutiens politiques et familiaux. Et il existe toujours un décalage temporel (un retard) d'environ deux décennies entre les manifestations culturelles européennes et brésiliennes.
Le succès des divers courants artistiques diffère d'autre part entre l'Europe et le Brésil puisque des manifestations comme le Parnassianisme ont eu au Brésil une importance beaucoup plus importante. Le romantisme obtient un grand succès au Brésil, et consiste, comme en Europe, en un culte de l'émotion et de l'imagination, en une fuite du présent dans le rêve et le fantastique, rejetant le rationnalisme dans une expression baroque des sentiments. En franchissant l'Atlantique, ce courant s'était transformé en académisme, qui n'exprimait finalement qu'une sorte de mal de vivre plus ou moins affecté.
Le formalisme parnassien et le symbolisme sont peu représentés, de façon générale, en Amérique Latine, mais acquièrent au Brésil, où le goût pour la perfection formelle a toujours été plus prononcé qu'en Amérique hispanique, une importance primordiale. Ce sont des poètes parnassiens qui fondent, en 1897, l'Académie Brésilienne des Lettres contre laquelle vont se rassembler les modernistes.
Nous pouvons enfin noter que la littérature, à la fin du XIXe, passait au large des grandes questions de la société brésilienne , et n'était finalement qu'une forme de distraction de l'élite érudite. La culture érudite et l'art au Brésil semblent donc se décaler dans le temps, ne prenant pas en compte dans ses diverses manifestations des mutations profondes de la société brésilienne et restant attachés aux valeurs d'une société oligarchique et principalement rurale pour qui le centre du monde se trouvait outre-atlantique.
1.1.2.-ANTÉCÉDENTS DE LA SEMAINE D'ART MODERNE ET DU MODERNISME
15
Malgré le décalage et la tendance mimétique de l'art et de la culture brésilienne, un certain nombre de préoccupations nouvelles émergent parmi les romanciers, et les artistes plastiques depuis le début du XXe, à travers le courant que l'on a rétrospectivement catalogué de pré-modernisme, et à travers le futurisme. D'une part les pré-modernistes (avec principalement Euclides da Cunha et Graça Aranha), cherchent à mettre en place une nouvelle conception de la culture, dépassant l'idéologie évolutionniste et raciste prédominante jusque là. Et d'autre part les futuristes cherchent à libérer l'art du carcan académique rigide et dépassé, proposant de l'actualiser.
a) Le pré-modernisme et la question sociale au Brésil
La catégorie du pré-modernisme est en fait très vague et varie selon les historiens de la littérature. Nous opterons ici pour une définition qui s'applique moins à un courant littéraire qu' à une époque, qui couvre les dix premières années de ce siècle. C'est au cours de cette période que nous pouvons constater que de certains auteurs se dégagent des caractéristiques originales qui seront largement développés par les modernistes. Nous englobons ici dans cette catégorie des auteurs comme Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha et Lima Barreto.
Les pré-modernistes cherchent à soulever des problèmes de fond de la société brésilienne, opposant leur réalisme et leur naturalisme au romantisme totalement dégagé de la réalité socio-culturelle du Brésil. Leur littérature tente de mener le lecteur à réfléchir sur les problèmes qui touchent profondément la société brésilienne. Ils savent voir plus loin que leurs contemporains, et leur vision critique par rapport à la réalité brésilienne fait qu'on les a classés dans cette catégorie de pré-modernisme, malgré leur attachement à un langage littéraire caractéristique du XIXe siècle.
Euclides da Cunha a écrit un livre puissant, intitulé Os Sertões (la traduction française s'appelle Hautes Terres), qui déclencha bien des polémiques lors de sa parution, pour devenir par la suite un classique de la littérature brésilienne en particulier et de la langue portugaise en général.
Os sertões révèle la situation misérable du sertanejo (habitant du sertão*) brésilien, abandonné par le gouvernement qui, au lieu de comprendre et de résoudre les problèmes de la misère sociale, ne réagit que par la violence. Cet ouvrage repose d'une part sur des faits auxquels Euclides da Cunha avait assisté et dont il a fait un reportage pour le quotidien O Estado de São Paulo (paru en 1897 sous le titre de "Notre Vendée" ) et d'autre part sur les enseignements fondamentaux de l'Ecole Militaire dans des domaines aussi variés que la physique expérimentale, la chimie organique, la minéralogie, la géologie, la botanique, la tactique militaire, la balistique ou la mécanique rationnelle. Partant de ces notions générales, complétées par quelques recherches personnelles, Os sertões a pu être valorisé par son caractère encyclopédique car y sont développées des théories originales sur l'histoire, la climatologie, la stratégie militaire, la psychologie sociale et criminelle, l'anthropologie, la sociologie, le folklore, la religion brésilienne. Ces thématiques anticipent en quelque sorte des sujets qui deviendront centraux pendant la période moderniste
Publié en 1902, cet ouvrage massif a un gros impact, par son originalité et son exubérance de style, comme pour sa position radicale contre l'Armée qui avait assumé le gouvernement en 1889 et proclamé la République. Os sertões est l'un des premiers textes engagés du début du siècle, et raconte la guerre de Canudos, répression sanglante d'une communauté paysanne "millénariste", par l'armée brésilienne. Cette communauté formée autour d'une leader charismatique (Antônio Maciel) et ayant atteint des milliers de personnes, fut en effet rasé au nom de la République, à coup d'explosifs, après avoir été accusée de royalisme et après avoir résisté à trois offensives successives de la police, de l'armée fédérale et de l'armée nationale. Dans une véhémente accusation de l'injustice perpétuée par la nation contre quelques milliers de pauvres persécutés à Canudos, le
16
livre introduit une réflexion qui perdure, sur le processus de modernisation et sur son prix à payer.
Si le naturalisme avait déjà produit ses meilleurs fruits, les premiers indices du modernisme, qui ferait sa bruyante irruption lors de la Semaine d'Art Moderne, en 1922, se manifesteraient après la mort d'Euclides da Cunha en 1909. Pour ces raisons, on a tendance à le classer sous l'étiquette du pré-modernisme, par défaut d'une catégorie plus adéquate. Essentiellement naturaliste et positiviste, Euclides da Cunha sera rejeté par le modernisme. Sa rhétorique de l'excès, son registre grandiloquent, son style élevé ne pouvaient être que contraires à l'esprit moderniste.
Le modernisme embrayera cependant le pas sur les préoccupations d'Euclides da Cunha quant à l'avenir de l'arrière-pays et à son rejet de l'imitation du modèle européen dans les villes de la côte. Os Sertões effectue en quelque sorte un repérage des thèmes qui seront essentiels dans la production intellectuelle et artistique du XXe siècle, à savoir le Noirs, les Indiens, les pauvres, les sertanejos, la condition colonisée, la religiosité populaire, les insurrections, le sous-développement, la dépendance.
Pour Mário Carelli, "(...) la modernité d'Os Sertões, qui, par bien des aspects ne paraît pas moderne, naît [d'une] distorsion d'angle: il contient en même temps un épique qui est également tragique, un livre scientifique qui se réalise comme une œuvre d'art littéraire, un schéma déterministe qui s'adapte aux configurations de la Bible, une apocalypse avec une Genèse, mais sans rédemption, une quête où le héros est l'auteur, un dialogue écrit par l'organisateur d'un symposium dont les participants sont absents, un chant du bouc émissaire entonné par le bourreau" 1.
Cet ouvrage nous montre les débuts du processus de modernisation du pays, dont il est contemporain et dont il examine l'aspect non euphorique. Les victimes de ce processus de modernisation seraient le bas peuple de Rio de Janeiro et celui du sertão, chassés par la police de Pereira Passos ou par l'armée, dont Euclides était membre. Il appartenait par sa formation à cette armée qui, par l'Ecole militaire, était porteuse de l'idéal de la Révolution française, et se présentait en avant-garde du tiers-état, mais qui soudain se trouve être le bourreau de ce dernier. C'est là encore un aspect d'Euclides da Cunha qui anticipe le modernisme des années 20, moins par la forme dont sont présentées les idées que par le fond des problèmes traités.
D'autres auteurs comme Lima Barreto ou encore Monteiro Lobato, abordent de façon typiquement moderniste les problèmes de la société brésilienne. Monteiro Lobato montre l'abattement physique et culturel des hommes de l'arrière pays brésiliennes alors que Lima Barreto traite de la vie obscure du prolétariat urbain, des habitants des banlieues et des favelas cariocas du début du siècle.
Dans Triste fim de Policarpo Quaresma (1911), Lima Barreto prend du recul par rapport à la question de la nation telle qu'elle avait été posée jusque là. À travers les déceptions du héros du roman, un major réformé et isolé du monde qui se faisait une idée totalement fausse et artificielle de la nationalité (il voulait instaurer le dialecte tupi comme langue nationale officielle), Lima Barreto montre les limites de la vision romantique de la nation.
Mais si le pré-modernisme et le futurisme trouvent postérieurement un point d'accord dans le modernisme, Lima Barreto et Monteiro Lobato (Euclides da Cunha meurt avant l'apparition des premières manifestations du modernisme en tant que mouvement) et la plupart de ceux que l'on catégorise comme "pré-modernistes" sont violemment anti-futuristes.
Graça Aranha, de ce point de vue, adoptera, et contrairement à la plupart des écrivains pré-modernistes, une attitude particulière. Membre de l'Académie brésilienne
17
et auteur d'un succès d'édition (Canãan, édité pour la première fois en 1902), celui-ci renoncera à ses titres d'honneur pour se lancer dans la lutte esthétique, du côté futuriste, et contre l'académie.
Graça Aranha, dans Canãa1, met en scène une discussion sur la modernité, la nationalité et la civilisation au Brésil, à travers la description des problèmes des immigrants et de leur intégration dans la société brésilienne. Au sein de cette discussion apparaît l'une des thématiques principales du modernisme à venir, celle du décalage entre art et réalité:
"Rien ne correspond au temps. L'esprit mort anime encore faiblement le monde... Les races ne sont plus guerrières et s'arment toujours...(...) L'art n'exprime pas la vie, ni l'âme du moment; la poésie s'est tournée vers le passé et sa langue subtile, fine et mesquine, sans sève ni vigueur, n'est pas la lame puissante et poignante où se reflète l'image des nouveaux hommes." 2
Mais Canãa anticipe sous beaucoup d'autres aspects le modernisme, dans ses expressions les plus mûres, remettant en question non seulement le retard de l'art par rapport à la société, mais cherchant aussi à établir une nouvelle conception de la culture (qui ne soit plus fondée sur la race), et s'interrogeant sur l'avenir du Brésil. La façon de traiter ces question peut être considérée comme moderniste (nous reparlerons d'ailleurs de Canãa à plusieurs reprises au cours de notre propos) mais le langage qu'il utilise et l'identité même de l'auteur le distinguent de ce mouvement.
b) Le futurisme et la libération des formes de l'art
Dès la fin de la première décennie du siècle, des jeunes artistes, ayant eu pour la plupart la possibilité de voyager en Europe, se sensibilisent aux innovations esthétiques des avant-gardes européennes. Ils ont ressenti les besoin d'exprimer la nouvelle réalité urbaine qui se mettait en place, et de remettre en cause l'ancienne perception du monde, formellement limitée, et définitivement dépassée.
Ce trouble se trouve cependant limité en un premier temps, à un travail sur la langue. D'une part une attaque vive surgit contre l'académisme, représenté par le langage de Coelho Neto: un langage baroque, précieux, compliqué et symbolisant une société décatie. D'autre part, Oswald de Andrade, à travers le personnage de Juó Bananére, cherche à incarner l'explosion urbaine cosmopolite de São Paulo par l'utilisation d'un nouveau langage qui mélangeait l'italien "lusitanisé" parlé dans les quartiers ouvriers, avec le langage du "caipira"(paysan). Il esquisse une chronique de São Paulo, découvrant et représentant le nouvel univers qui s'ouvre (malheureusement, ses poèmes sont intraduisibles).
Le renouveau du milieu intellectuel et artistique se manifeste aussi par l'augmentation à vue d'œil d'une mondanité inexistante auparavant, d'une effervescence artistique nouvelle dans certains quartiers du centre de São Paulo.
On ne pouvait pas proprement parler de trouble culturel, mais seulement de la prise de conscience du besoin d'adapter la vision du monde aux mutations de la société. Au delà de la révolte linguistique, c'est la prise de conscience d'un déphasage entre réalité et représentation, qui caractérise les innovations dans le domaine culturel du début du XXe siècle.
La lutte pour la réactualisation de l'art sera celle d'un groupe baptisé "futuriste", qui prend forme principalement à partir de 1917. Mais l'histoire du futurisme brésilien avait en réalité commencé bien avant la Première Guerre mondiale, en Europe. En 1909, le poète Oswald de Andrade avait pu apprécier les "mots en liberté" du manifeste futuriste, et avait rencontré Marinetti. Il fut aussi impressionné par le couronnement de Paul Fort, le "Prince des poètes" à la Closerie des Lilas. L'écrivain Manuel Bandeira avait d'autre part connu Paul Éluard en Suisse, et Ronald de Carvalho avait participé en
18
1915 à la création d'une revue moderniste portugaise, Orfeu, à laquelle collaboraient Fernando Pessoa et Sá Carneiro. Le modernisme brésilien issu du futurisme, aurait fait ses premiers pas dans le Paris de la bohème et des avant-gardes.
Peu à peu un mouvement novateur, se développe et passe à l'avant de la scène artistique brésilienne, non pas cette fois dans le domaine de la littérature (comme pour le pré-modernisme) mais principalement dans celui des arts plastiques. Le futurisme brésilien, largement influencé en un premier temps par le mouvement italien de Marinetti, pose sa volonté de rupture avec le passé et avec le passéisme artistique.
La recherche d'une nouvelle esthétique débute avec Anita Malfatti (peintre, revenant d'études en Allemagne et inspirée par l'expressionnisme), Vítor Brecheret (sculpteur, revenant en 1919 de Rome, cf couverture), Emiliano Di Cavalcanti (peintre de Rio de Janeiro), Lasar Segall (peintre lituanien exilé au Brésil, après des voyages d'études dans plusieurs pays d'Europe) et quelques autres artistes.
Ils commencent à exposer entre 1913 et 1920 et sont la plupart du temps incompris, voire mal reçus par la presse Paulista . Cependant, un petit groupe sensible aux expériences esthétiques, et découvrant peu à peu ces artistes, se chargera d'en divulguer les œuvres et de défendre ces nouvelles valeurs artistiques. Les journalistes Menotti del Picchia et Oswald de Andrade vont prendre quelque temps la tête de ce groupe qui va recevoir, de par sa tendance à se considérer comme une avant-garde artistique et à attaquer violemment ceux qui refusent d'accepter le renouveau artistique, la désignation générique de "futurisme", terme extrait de l'avant-garde italienne guidée par Marinetti.
L'année 1917 apparaît comme une année inaugurale pour le modernisme, car c'est à ce moment que se déclenchent les polémiques opposant les modernes d'une part, et d'autre part les représentants et défenseurs du vieil ordre esthétique.
Ces polémiques naissent autour de l'exposition des toiles d'inspiration cubiste et expressionniste d'Anita Malfatti (São Paulo, décembre 1917 et janvier 1918), cristallisant d'ors-et-déjà les positions de détracteurs et de défenseurs engagés de ce que l'on appellera un peu plus tard le "futurisme". Revenant d'un voyage en Europe et aux Etats-Unis, où elle avait été en contact avec l'art moderne, Anita Malfatti, encouragée par quelques amis, décide d'exposer ses dernières toiles (voir ci-contre).
Dans l'étroit milieu artistique paulista, cette exposition provoque des critiques et des éloges, cependant, ce qui déchaîne la polémique ne fut pas tant le cas spécifique de la peintre, que la question de la validité du nouvel art.
Monteiro Lobato, quoique lucide sur les problèmes du Brésil et de sa culture, s'oppose violemment aux nouvelles formes d'expression artistique et dénonce dans un article de l'Estado de São Paulo, du 29 décembre 1917, la "paranoïa" et la "mystification" dans l'œuvre d'Anita Malfatti. Il y oppose aux artistes réalistes et classiques "qui voient normalement les choses", une "autre espèce (...) formée par ceux qui voient anormalement la nature et l'interprètent à la lumière de théories littéraires, sous la suggestion strabique d'écoles éphémères (...). Ils sont le produit de la fatigue et du sadisme de toutes les périodes de décadence"1.Monteiro Lobato, comme la plupart des intellectuels et artistes de cette période, rejette en bloc les propositions de ceux que l'on appelle les "futuristes": "Soyons sincères : futurisme, cubisme, impressionnisme et "tutti quanti"2, ne sont rien d'autre qu'une des nombreuses branches de l'art caricatural"3.
Mais Lobato s'attaque aussi dans ce texte, à la poésie "moderne": "Dans la poésie surgissent, parfois, des furoncles de cet ordre provenant de la cécité innée de certains
poètes élégants (...), et la justification est toujours la même: art moderne" 4.
La radicalité et la nouveauté des idées futuristes au Brésil, dans le contexte culturel brésilien, explique l'incompréhension et le rejet en bloc de leurs propositions, par les artistes et la critique de l'époque. Ainsi, comme nous l'avons vu, les premières
19
manifestations "futuristes" à São Paulo, ne passent pas inaperçues du grand public qui peut suivre leur détraction ou leur faible défense par les médias. La répercussion de la critique de Monteiro Lobato, un nom connu à l'époque, est instantanée: des toiles d'Anita vendues, furent rendues; la peintre passa par quelques moments difficiles et l'art moderne fut ridiculisé.
Cependant, hors ces discussions de sourds entre "futuristes" et "passéistes" qui étaient ouvertes au grand public, seuls quelques petits cercles d'initiés (la plupart ayant auparavant séjourné en Europe et côtoyé les milieux d'avant-garde internationale) sont vraiment en mesure d'apprécier les expériences esthétiques des futuristes.
Parmi ces derniers, Oswald de Andrade, revenant d'un séjour en Europe où il fut probablement l'un des premiers Brésiliens à prendre connaissance du manifeste futuriste italien de 1909, soutient la peintre cherchant à en expliquer la sensibilité:
"En art, la réalité dans l'illusion est ce que nous recherchons tous. Et les naturalistes les plus parfaits sont ceux qui arrivent le mieux à illusionner. Anita Malfatti est un tempérament nerveux et une intellectualité perfectionnée, au service de son siècle. L'illusion qu'elle construit est particulièrement émue, individuelle et forte, et porte en elle les vertus et les défauts propres à l'artiste"1 .
Ce texte exprime d'autre part l'opinion qu'il est naturel d'adopter un point de vue moderne. Ce qui importe est de voir chaque chose dans son temps, et par conséquent, de mettre en rapport le langage moderne au temps présent. L'œuvre de Malfatti est dotée d'une qualité importante pour l'artiste: son actualité. Oswald de Andrade témoigne de la relation créée par les artistes "modernes" de São Paulo, entre la vitesse de l'urbanité "post-caféière" et le besoin de l'avènement d'un nouvel art, devant exprimer la nouvelle société. Il dénonce le milieu intellectuel peu à peu formé à partir du XIXe siècle qui s'était associé à l' élite économique et politique du café, vivant dans un exercice routinier d'imitation des modèles des cultures françaises et anglaises, sans aucune intuition expérimentale.
Une autre personnalité des arts plastiques a été au centre des attentions et des débats entre "futurisme" et "passéisme". Il s'agit du sculpteur Vítor Brecheret, revenant à peine d'une période d'apprentissage à Rome. Celui-ci, qui avait préféré jusque là le travail solitaire aux présentations publiques, est découvert avec émerveillement par les modernistes, dans un atelier où il expérimentait modestement son art. Pris d'euphorie et d'admiration face à ses œuvres différentes, à sa vigueur et à ses conceptions artistiques, les modernistes élèvent Brecheret à la catégorie de génie. Comme le témoigne plus tard Mário de Andrade "Vítor Brecheret était pour nous, dans le pire des cas, un génie. C'était le minimum avec lequel nous pouvions nous contenter, tels étaient les enthousiasmes avec lesquels il nous secouait"2.
Bien sûr Brecheret avait dû se confronter, comme les autres, à la critique des conservateurs, mais quand il gagna un concours à Paris, les modernistes explosent de joie, car c'était pour eux la victoire de ses idées novatrices. Vaincre à Paris, c'était vaincre dans le monde civilisé, et c'était traiter de rétrogrades ceux qui n'acceptaient pas le nouvel art. Menotti del Picchia s'emporte dans un article du Correio Paulistano du 10 novembre 1920:
"Brecheret est la grande victoire du 'futurisme' paulistano. C'est la consécration du nouveau groupe. C'est la mort de la vieillerie, de l'archaïsme, du mauvais goût. C'est le triomphe de la jeunesse de Piratininga 3 , qui est la plus belle et la plus forte de notre chère Patrie!"4.
Le futurisme italien se caractérise comme une tendance à la négation de tout art du passé. Ne voulant adopter qu'une perspective exclusivement prospective, le futurisme s'affirmait comme un art uniquement lié à la nouvelle civilisation technologique qui
20
surgissait. Certains aspects du mouvement moderniste naissant montrent effectivement une filiation au mouvement italien. Ils adoptent un discours analogue, en refusant tout héritage du passé:
"(...) en plaçant le problème de la réforme esthétique entre nous, on sauvera peu de chose du passé. Tout, presque, va disparaître. La liquidation littéraire au Brésil, atteint des proportions de brûlis (...)"1.
La vieille perception du monde est donc rejetée de façon radicale, passant à revendiquer, selon le terme de Menotti del Picchia, l'"Apostolat du Verbe Nouveau".
Sur le plan des réalisations artistiques, quelques correspondances s'établissent aussi, notamment au niveau de l'état d'esprit qui est celui d'une haine contre toute forme de passéisme esthétique (classicisme ou académisme). C'est du moins le cas de Paulicéia desvairada (de Mário de Andrade, 1920), premier livre radicalement moderniste, qui fut inspiré en un moment de réaction contre ceux qui ne comprenaient pas la nouvelle sensibilité. Toujours sur le plan de la réalisation des œuvres, le futurisme se retrouve à São Paulo au niveau de la recherche de nouvelles techniques de production, celles-ci étant en réalité largement calquées sur toutes les avant-gardes européennes (Expressionnisme, Cubisme, Futurisme italien).
c) Vers l'autonomisation du futurisme brésilien
Mais ce questionnement, essentiellement formaliste, qui suivait, encore une fois, des modèles européens, évoluera rapidement, posant cette fois des questionnements associant le rapport au passé et le rapport à l'Europe. Car le passé brésilien, c'est la colonisation. Rompre avec le passé est une façon d'émanciper la culture brésilienne. C'est ainsi que la réflexion futuriste aura pu se marier aux idées développées précédemment par les Pré-Modernistes, pour donner un fruit nouveau qui sera baptisé (pour se distinguer du futurisme) de modernisme.
Contrairement au pré-modernisme qui est une catégorie créée a posteriori et qui ne repose sur aucun lien particulier des auteurs entre eux, ni sur aucune forme de courant littéraire, les futuristes qui émergent en 1917, se démarquèrent, dès le départ, de tous les autres artistes. Rejetant toute forme "dépassée" d'expression artistique, ils se constituent assez rapidement une identité propre et s'affirment en tant que mouvement.
En termes plus proprement constructifs, ce groupe exprimait le besoin d'élaborer une nouvelle posture esthétique, adéquate à la vie moderne: il est nécessaire de produire des langages artistiques qui puissent rendre compte de la réalité présente. Le modernisme brésilien paraît parfois, dans cette perspective, être une nouvelle forme de réalisme, allant dans le sens de l'adéquation du monde et de sa représentation.
La spécificité du futurisme brésilien, au-delà de leur simple volonté d'autonomie, est la focalisation de la révolte contre l'Académie. D'autre part, et contrairement à ce qui eut lieu avec le modernisme européen, où l'idée de révolution et de discrédit du passé est au centre des préoccupations, dans le cas brésilien la modernisation signifie l'actualisation des formes de l'art, mais n'écarte pas la possibilité de compromis avec la tradition.
Le recueil Paulicéia desvairada de Mário de Andrade, publié en 1920, inaugure le premier scandale littéraire de l'histoire du modernisme, et la première contestation de l'appellation futuriste. Ce recueil de poèmes avait été rattaché au futurisme par Oswald de Andrade dans un article du Jornal do Commércio du 27 mai 1921. Mais vue la réception enragée de la critique, Mário de Andrade, inconnu jusque là, décida de répudier sa filiation au futurisme, adoptant une position originale dans sa conception du modernisme. Cette conception sera formalisée dans son "Intéressantissime préface" à l'édition de 1922 de Paulicéia desvairada. Il ne s'agissait plus en effet pour lui, de nier le passé, mais prenant au contraire position dans un article du 6 juin 1921 (Jornal do Commércio ), il défend les traditions brésiliennes:
21
"Non, notre poète [c'était le surnom que lui avait donné Oswald de Andrade] ne se lie pas au futurisme international, de même qu'il ne s'attache pas à une école quelconque(...). Quant à renier nos traditions, rares mais dorées, les méconnaître, prêcher, comme Oswald le fit (lui aussi "brésilianissime") un internationalisme chimérique et sans caractère, il s'agit d'une inconsidération qui disparaîtra au premier clairon de guerre."
Il s'agissait pour Mário de Andrade, de créer un nouveau lien avec le passé. Ainsi, Mário va rendre hommage à la tradition artistique brésilienne, mais d'une façon particulière, en publiant une série de sept essais ( dans le Jornal do Commercio, août 1921) où il "sculpte" (avec des mots) les bustes des "Maîtres du passé". Ce sont sept textes , dont cinq études sur les poètes parnassiens les plus connus (Francisca Júlia, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac et Vicente de Carvalho) et deux textes explicatifs, où il prétend régler les comptes avec le passé littéraire.
Il exprime dans ces textes une conception de l'art sensiblement futuriste. En effet pour lui, "moderniser c'est actualiser la production culturelle à un temps nouveau". Il ne s'agit pas pour autant de disqualifier les manifestations artistiques passéistes, mais de les rejeter parce qu'elles risquent d'intervenir, avec leur sensibilité et leurs formes d'expression dépassées, dans un temps qui ne les concerne plus: le présent. Il ne semble en effet pas naturel pour les nouveaux temps d'utiliser la métrique et la rime parnassienne, ni les formes académisantes de la peinture. L'idée centrale de cet article est que les maîtres du passé doivent laisser place aux hommes du présent. La perspective modernisatrice se caractérise alors elle même, comme adéquate à un temps nouveau.
A la fin de 1921, les relations entre jeunes artistes de São Paulo et de Rio de Janeiro s'intensifient, et peu à peu, ce qui n'était jusque là qu'un groupe d'artistes qui échangeaient des idées, est devenu un "mouvement" artistique, futuriste.
La formation d'un mouvement de jeunes artistes était en partie due à la constitution d'une mondanité intense à São Paulo, dans un circuit du centre de la ville qu'ils appelaient le Triangle Moderniste et qui comprenait les rues Direita, São Bento, et 15 de Novembro. On y trouvait les cafés Papagaio, Brandão et Guarani où les jeunes se réunissaient pour des discussions animées. On y trouvait aussi la Librairie Garraux, où l'on pouvait acheter quelques livres importés. Les rédactions du Jornal do Commércio et de la Gazeta, étaient elles aussi installées dans ce quartier où travaillaient beaucoup d'intellectuels.
Cette mondanité du modernisme en formation était aussi complétée par des réunions agitées, chez des artistes comme Mário et Oswald de Andrade, et plus tard chez la peintre Tarsila do Amaral.
Les idées de ce groupe circulent vite par cette mondanité nouvelle, mais aussi par les circuits traditionnels des idées artistiques (c'est-à-dire les salons et les réunions artistiques des riches aristocrates).
Se constituant en mouvement artistique, les modernistes forment un corpus d'idées communes, et en janvier 1921 paraît un article de Menotti del Picchia dans O Correio Paulistano, dans lequel il présente synthétiquement les principes du mouvement littéraire. Ces principes sont:
-la rupture avec le passé, c'est à dire le rejet des conceptions romantiques, parnassiennes et réalistes;
-l'indépendance mentale du Brésil, par l'abandon des suggestions européennes, principalement "lusitanes" et "gauloises";
-une nouvelle technique pour la représentation de la vie, étant donné l'incapacité des procédés anciens ou connus à appréhender les problèmes contemporains;
-une autre expression verbale pour la création littéraire, qui ne soit plus une simple transcription naturaliste , mais une récréation artistique, transposition sur le plan artistique des réalités vitales.
22
1.2.- La Semaine d'Art Moderne et les dédoublements du modernisme
Sur la base de cette volonté de rupture du jeune mouvement moderniste, un événement symbolique viendra confirmer leur unité, par-delà les arts et les régions (des artistes de toutes les disciplines et de diverses grandes villes du pays y seront représentés) et leur positions sur la scène artistique nationale.
La Semaine d'Art Moderne de 1922 sera souvent par la suite représentée comme un moment de rupture dans l'histoire de la culture brésilienne, voire même comme une époque héroïque de fondation de la culture brésilienne. Menotti del Picchia commentant la Semaine de 22, la présente comme étant le "premier symptôme culturel de la transformation de notre conscience".
C'est en tout cas cet événement qui amena une réflexion plus structurée des modernistes, révélant l'ampleur de leurs possibilités et de leurs adhérents. A la suite de la Semaine d'Art Moderne, se créeront de nombreuses revues artistiques qui divulgueront la pensée des modernistes, mais aussi leur divergences et leurs désaccords, nous permettant ainsi de suivre l'évolution et le dédoublement du mouvement pendant la période qui nous intéresse.
1.2.1- LA SEMAINE DE 22 ET SES PREMIÈRES CONSÉQUENCES DANS LE
CHAMP ARTISTIQUE
a) La Semaine d'Art Moderne, naissance officielle du modernisme brésilien
L'idée initiale de la Semaine d'Art Moderne revient à Di Cavalcanti qui, arrivant de Rio de Janeiro, avait proposé d'intégrer à la fête du centenaire de l'Indépendance, en 1922, le cadre d'une nouvelle indépendance, celle de la culture brésilienne.
Cette idée est ensuite reprise par Graça Aranha qui, revenant de plusieurs missions diplomatiques en Europe, commençait à s'intéresser sérieusement au mouvement, et cette idée sera soutenue par tout le groupe futuriste. Après quelques péripéties, et grâce à des influences dans le secteur oligarchique agraire, le Théâtre Municipal de São Paulo (le plus prestigieux) fut obtenu pour que s'y tienne la manifestation futuriste. L'annonce de l'événement eut lieu le 29 janvier 1922 dans le quotidien O Estado de São Paulo, et fut rédigée de la façon suivante:
"Sur l'initiative de l'écrivain célébré, Mr Graça Aranha, de l'Académie Brésilienne de Lettres, aura lieu à S. Paulo, une "Semaine d'Art Moderne", à laquelle participeront les artistes qui, dans notre milieu, représentent les courants artistiques les plus modernes."
La Semaine d'Art Moderne se déroula du 11 au 18 février 1922 . Une exposition d'art plastique était fixée continuellement dans les locaux du Théâtre Municipal. Des spectacles de musique, de danse, des conférences et des lectures de poésie et de prose étaient programmés pour les soirées du 12, 15 et 17 février. D'autres spectacles de danse et de musique non prévus eurent aussi lieu.
La répartition en trois journées (nommées "festivals") séparées était calculée pour mieux évaluer et profiter de l'impact de l'événement. Effectivement, les journaux des 14, 16 et 18 février publiaient des articles scandalisés ou euphoriques qui n'étaient que les premières répercussions de la Semaine. Mais ce n'était pas tant la musique, que la littérature et les arts plastiques qui provoquaient l'irritation du public.
23
Le programme du "premier festival" comprenait la conférence de Graça Aranha "l'émotion esthétique dans l'art moderne" illustrée par la musique d'Ernani Braga et la poésie de Guilherme de Almeida et Ronald de Carvalho, suite à laquelle eut lieu un concert de Villa-Lobos. La seconde partie du spectacle prévoyait une conférence de Ronald de Carvalho, "la peinture et la sculpture moderne au Brésil", suivie de trois solos de piano de Ernani Braga, et de trois danses africaines de Villa-Lobos.
La grande soirée de la Semaine fut la seconde. La conférence de Graça Aranha, avait été entendue respectueusement et en silence. Par contre, le spectacle de Villa-Lobos fut perturbé par le "futurisme" provocateur que l'on croyait voir dans le fait que le musicien avait exécuté ses morceaux en par-dessus et en nu-pieds (ce qui était en fait dû à la misère complète dans laquelle il se trouvait).
Le bruit se répandait que la seconde soirée, celle du 15, allait être houleuse. Mais Menotti del Picchia, orateur officiel de cette soirée, arrive à exposer entièrement ses idées. Il affirme de façon officielle, dans cette conférence-manifeste restée célèbre, la prise de distance du groupe brésilien par rapport au futurisme italien:
"Notre esthétique est de réaction. En tant que telle, elle est guerrière. Le terme futuriste, avec lequel elle fut étiquetée par erreur, nous l’acceptons, parce que c’était une image de défi. Dans la glacière de marbre de Carrare du Parnassianisme dominant, la pointe agressive de cette proue verbale éclate comme un bélier. Nous ne sommes pas, et nous fumes jamais ‘futuristes’. Personnellement, j’exècre le dogmatisme et la liturgie de l’école de Marinetti. Son chef est, pour nous, un précurseur illuminé, que nous vénérons comme un général de la grande bataille de la Réforme, qui étend son ‘front’ 1 dans tout le monde. Au Brésil, il n’y a, cependant, pas de raison logique et sociale pour un futurisme orthodoxe, parce que le prestige de son passé n’a pas de moule qui empêchera la liberté de sa façon d’être future. De plus, la cage d’une école répugne notre individualisme esthétique. Nous cherchons, chacun de nous, à agir en accord avec notre tempérament, dans la sincérité la plus intrépide. (...)Nous voulons de la lumière, de l’air, des ventilateurs, des aéroplanes, des revendications ouvrières, des idéalismes, des moteurs, des cheminées de fabriques, du sang, de la vitesse, du rêve, dans notre art! Et que le roulement de tambour d’une automobile, sur les rails de deux vers, effraye de la poésie le dernier poète homérique, qui, anachroniquement, dort et rêve, à l’ère du ‘jazz-band’ et du cinéma, de la flûte des pasteurs d’Arcadie et les seins divins d’Hélène!"2.
Il semblerait que cette conférence ait provoqué une vive réaction parmi le public, car, venu le moment de l'illustration des propos de Menotti del Picchia, par la prose et la poésie moderniste, Mário de Andrade n'osa pas déclamer ses vers devant un public aussi agité. Le poème "Les Crapauds" (Os Sapos) de Manuel Bandeira, qui critiquait assidûment le Parnassianisme, fut déclamé par Ronald de Carvalho, sous les cris et les sifflements de la majorité du public.
Ronald de Carvalho déclama aussi des poèmes de Ribeiro Couto et de Plínio Salgado. Agenor Barbosa aurait obtenu des applaudissements pour le poème "Les Oiseaux de Fer" ("Os Pássaros de Aço"), sur le thème de l'avion, mais Sérgio Milliet parla aussi de miaulements et de grincements. De même, Mário de Andrade réussit à prononcer dans les escaliers intérieurs du Théâtre Municipal, une conférence présentant les "hallucinantes créations des peintres futuristes" exposées dans le hall, sous les cris et les insultes du public.
Le calme ne revint qu'avec les numéros dansés d'Yvonne Daumerie et le concert de Guiomar Novais.
24
Il est difficile de déterminer avec précision quels furent les écrivains qui participèrent activement à la Semaine. L'Estado de São Paulo, dans son article du 29 janvier 19223 annonce la présence de Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreyra, Elísio de Carvalho, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Renato Almeida, Luís Aranha, Mário de Andrade, Ribeiro Couto, Agenor Barbosa, Moacir Deabreu, Rodrigues de Almeida, Afonso Schmidt, et Sérgio Milliet. A cette liste, nous pouvons rajouter, selon les affirmations de Mário da Silva Brito 4, les écrivains Cândido Motta Filho, Armando Pamplona, Plínio Salgado, Rubens Borba de Morais, Tácito de Almeida (frère de Guilherme), Antônio Carlos Couto de Barros, Manuel Bandeira (qui participa, comme Ribeiro Couto et Alvaro Moreyra, à l'organisation, mais n'étaient pas présents), et Henri Mugnier, suisse et ami de Sérgio Milliet.
Selon Mário da Silva Brito la Semaine de l'Art Moderne "rénovait la mentalité nationale, défendait l'autonomie artistique et littéraire brésilienne et nous levait le rideau sur le XXe siècle, plaçant le Brésil dans l'actualité du monde qui avait déjà produit T.S. Eliot, Proust, Joyce, Pound, Freud, Planck, Einsentein, la physique atomique"1 .
La Semaine d'Art Moderne peut finalement être définie comme une entreprise aux connotations utopiques qui affirmait la volonté d'être moderne, et dénonçant une modernité non-effective. Cette position contribue à caractériser la spécificité du mouvement brésilien qui, alors que les avant-gardes européennes s'attachaient à dissoudre les identités et à faire tomber les icônes de la tradition, s'efforçait d'assumer les conditions locales, les caractériser, les rendre positives.
Avec la Semaine d'Art Moderne, le débat se déplace ou du moins s'enrichit au-delà de la remise en cause d'un décalage temporel. L'événement était bien né de la prise de conscience du déphasage de l'intelligentsia paulista par rapport au développement matériel. Mais une inquiétude et finalement une remise en cause culturelle et politique du monde tel qu'il était perçu en découlait et cette question était ouvertement posée. Cette remise en cause de l'officialité culturelle où créateurs, critiques et consommateurs "se donnaient la main dans la farandole de l'homogénéité culturelle", allait en effet au-delà de la critique de son retard esthétique par rapport à l'Europe. La recherche d'un nouvel idéal artistique amenait en effet à un questionnement.: malgré tout, sommes nous en retard? Quelle vision avons-nous de ce que nous sommes? Quel est notre rôle dans le monde?
b) L e modernisme de 1922 à 1924, un iconoclasme systématisé
Le modernisme qui naît en 1922 est, en grande partie, l'héritier du "futurisme brésilien", et les thématiques qui le caractérisent ne se démarqueront que progressivement de celles du premier moment.
Les thèmes centraux des débats succédant à la Semaine de 22 s'articulent en effet essentiellement autour des questions de l'art et de son décalage temporel avec la réalité. Le progrès scientifique et technique, la vitesse et la violence caractéristiques des grands centres urbains y sont exaltés, et sont vus comme la plus pure expression de la modernité.
La fascination pour la vitesse est exprimée dans la plupart des manifestations littéraires et plastiques. La vitesse, dans la perspective du modernisme, serait le signe particulier de la vie moderne et est symbolisée par la machine, en tant qu'accélérateur de la vie (l'automobile, la locomotive, l'avion, les nouvelles techniques de télécommunication...) et en tant que nouveau mode d'expression (principalement le cinéma). Le cinéma apparaît en effet à l'époque comme le meilleur moyen pour capter la fugacité de la vie moderne, et est rehaussé à la catégorie d'art.
Mais à côté de cette fascination pour la nouvelle temporalité de la vie moderne, c'est bien l'anti-académisme qui apparaît comme thème central de la révolution esthétique entreprise par les modernistes. La littérature et les écrivains nationaux sont
25
représentés chez Plínio Salgado, par exemple, comme une série de vaniteux, une "faune d'inutiles, de vendeurs de phrases, de fréquentateurs assidus des lettres françaises, pleins de manières, de vanités futiles, de rêves irréels" 1.
L'opposition à l'académisme est radicale, mais ne repose finalement que sur la volonté de changer de canons esthétiques, c'est-à-dire échanger le référentiel néo-classique par celui du post-cubiste. En effet, les principes modernistes de progrès (actualisation de l'art) et d'identité nationale sur lesquels nous reviendrons plus loin, étaient déjà présents dans l'Académie (chez Debret, Porto Alegre, Ameida Júnior). La négation en bloc de l'académie et de l'art du XIXe siècle mènera ultérieurement les modernistes à revaloriser l'art colonial comme dépositaire de valeurs considérées plus authentiques de la culture brésilienne.
Klaxon est la première revue spécifiquement moderniste, et apparaît comme l'héritière directe du futurisme et du mouvement cristallisé à l'occasion de la Semaine d'Art Moderne de São Paulo. La modernité prend à ce moment là pour référent la vie spécifique des grands centres urbains. Klaxon se situe du coté de l'actuel, du progrès, des sciences, de la rationnalité, des techniques, de l'ingénieur. L'éditorial du premier numéro de Klaxon (15 mai 1922), qui prend la forme d'un manifeste, revendique cette soif de progrès et affirme:
"(...)Klaxon sait que le progrès existe. Pour cela, sans renier le passé, elle marche en avant, toujours, toujours. Le clocher de São Marcos était un chef-d'œuvre. Il aurait dû être conservé. Il est tombé. Le reconstruire fut une erreur sentimentale et coûteuse - ce qui fait scandale, face aux besoins contemporains (...)"2 .
Dans Klaxon, l'accès à la vie moderne est représenté comme l'accès à la civilisation technologique; d'où la critique virulente du romantisme, vu comme une étape pré-moderne (donc pré-rationnelle) de la civilisation. Klaxon en déduit la nécessaire "extirpation des glandes lacrimales"3.
Dans l'optique de Klaxon et du modernisme issu de la Semaine de 22, encore largement influencé par le futurisme, ce qui est important c'est de comprendre la modernité comme vie en mouvement, marquée de façon impressionniste par le rythme de la ville où s'abritent en désordre, les éléments les plus variés. Les modernistes veulent mettre en valeur la richesse nouvelle de la vie urbaine et moderne dont les attributs sont la vitesse et la variété. Ils insistent cependant sur l'impossibilité de le faire par les formes consacrées de l'académisme et du romantisme.
A escrava que não é Isaura est écrit par Mário de Andrade en 1922. Il s'y représente la nouvelle poésie comme le "résultat inévitable d'une époque, (...) conséquence de l'électricité, télégraphe, câble sous-marin, T.S.F., chemin de fer, transatlantique, automobile, aéroplane"1. C'est cependant toujours sur un moule réaliste que se fonde cette nouvelle esthétique, puisqu'il s'agit d'adapter les représentations artistiques à la nouvelle réalité.
L'incorporation dans l'ordre moderne est encore conçue à ce moment du mouvement, comme urbaine et industrielle, marquée par l'accès à la rationnalité au pragmatisme, enfin, à l'éthique capitaliste.
Les modernistes brésiliens, malgré leurs thématiques largement inspirées du futurisme italien, rejettent du futurisme "orthodoxe", sa volonté de rupture radicale avec le passé. Pour les modernistes, et cette tendance était déjà présente chez Mário de Andrade et Menotti del Picchia au moment de la Semaine d'Art Moderne, la modernité ne se conçoit alors qu'en continuité avec l'évolution dont elle est le produit. Aussi on affirme clairement la nécessité de respecter "le passé sans lequel Klaxon ne serait pas Klaxon"2.
26
Mais ce qui caractérise la modernité pour nos artistes, autant que sa continuité avec le passé, c'est l'existence d'un ordre universel qui est propre à cette modernité. L'accès à la modernité est alors vu comme entrée dans l'universalité, ou du moins la mise en place d'une nouvelle relation entre le particulier et l'universel. L'idéal modernisateur s'exprime alors à travers la volonté de participer au "concert des nations". Pour rendre viable le processus d'adéquation de la représentation à la nouvelle réalité, les modernistes du début des années 20 vont chercher chez les nouvelles tendances européennes les instruments qui leur permettront d'effectuer l'actualisation de la production artistique nationale. C'est donc encore une fois la réalité urbaine, et principalement celle de São Paulo, symbole de la ville nouvelle, en pleine expansion, que l'on croit pouvoir le mieux incarner la nouvelle esthétique.
On imaginait que l'adhésion aux procédés modernes d'expression culturelle, mènerait immédiatement à l'incorporation de la culture faite au Brésil, dans le contexte international. Et Mário de Andrade ne se lasse pas de lamenter le retard de São Paulo dans le processus d'absorption des ingrédients novateurs.
L'originalité de la période qui va de février 1922 jusqu'à la publication du Manifesto da poesía Pau-Brasil3 (Paru dans O Correio da Manhã, le 18 mars1924) ne se situe pas dans le domaine de l'innovation des thématiques modernistes, mais plutôt dans le changement de statut des artistes dans le domaine de l'art. La Semaine d'Art Moderne ne peut pas vraiment se voir comme une rupture sur le plan esthétique (les futuristes leur avaient déjà ouvert les voies principales), mais comme une affirmation et un renforcement soudain du mouvement tant par rapport au milieu artistique et littéraire, que dans le public plus large qui commence à s'intéresser aux questions artistiques. Les grands débats modernistes s'exprimèrent en effet à travers des revues spécialisées mais aussi à travers des quotidiens nationaux, faisant ainsi acte de présence sur les principaux moyens de communication de masse. La période qui va de 1922 à 1924 a donc été un grand pas pour les modernistes qui renforçaient leur position sur la scène artistique , par la conquête de nombreux adhérents sceptiques jusque là, et soulevant déjà l'attention d'un public plus massif.
1.2.2. MATURATION DU MODERNISME ET ÉMERGENCE DE LA QUESTION DE LA BRÉSILIANITÉ
La présence des modernistes dans les journaux nationaux ou régionaux (qui se multiplient au début du siècle) permet l'expansion du mouvement dans tout le pays, atteignant un public vaste et divulguant les débats théoriques. Des revues modernistes vont ainsi éclore dans différentes régions 1, et des auteurs vont se distinguer atteignant par ce biais une envergure nationale.
Cependant, cette évolution s'accompagne d'une division du mouvement en de multiples tendances qui s'expriment par des revues ou des groupes distincts. Nous présentons ici les tendances emblématiques de cette évolution et des dédoublements qui caractérisent la période postérieure à 1924.
Le modernisme perd ainsi de son homogénéité, puisque s'y raccrochent des groupes et des revues de plus en plus nombreux, qui s'identifient au modernisme mais prétendent à une autonomie ou du moins à une originalité.
De même, un certain conflit se noue entre Rio et São Paulo, car les milieux artistiques de Rio voient le statut de capitale culturelle de leur ville remis en cause. Jusque là aucune ville brésilienne n'avait dépassé Rio dans le rayonnement artistique brésilien. Cependant São Paulo, avec le futurisme et la Semaine de 22, s'affirmait décidément sur la scène artistique d'avant-garde. Rio reste en arrière, assimilée dans l'imaginaire moderniste, à la ville oligarchique, ouverte à l'Europe, sans le caractère
27
noble de São Paulo, incarnation de l'esprit moderne, en un premier temps, puis brésilien, quand en 1924 la question de la brésilianité prendra le pas sur celle de la modernité. Tout au long du modernisme, Rio est indirectement associée au littoral ouvert sur l'extérieur, aliéné, alors que São Paulo est vue comme représentant l'intérieur et l'idéal Bandeirante auquel tiennent les modernistes.
a) Pau-Brasil et le virage de 1924
La parution du Manifesto da poesía Pau-Brasil, symbolise le passage de la phase "iconoclaste" à la phase "constructive" du modernisme, et suivant un processus politique des plus classiques, quitte la détraction unificatrice pour rentrer dans une période où les propositions de solutions aux problèmes soulevés divisent les opinions.
Les positions modernistes étant assurées comme nous l'avons vu, par des réseaux médiatiques solides et un succès croissant face au public, les conflits intestins ont alors remplacé la lutte contre l'ennemi extérieur au mouvement (l'Académie Brésilienne de Lettres, principalement).
Les questions de fond évoluent, et peu à peu, le modernisme brésilien, sans oublier la question de l'universalité, s'intéresse aux problèmes liés à son identité nationale. La question de la brésilianité surgit dans le cadre de préoccupations qui ont trait à la caractérisation du rôle du Brésil sur la scène internationale.
A partir de 1924, le propos moderniste insiste de plus en plus sur le besoin de prendre en compte des compromis à établir entre la culture actuelle et la tradition dans la caractérisation d'un projet dans lequel soit exprimée la nationalité. Ce qui définit le mieux le mouvement à ce moment là sont ses tentatives de rendre compatibles l'ancien et le nouveau. La participation du Brésil dans le concert des nations est alors vue à travers l'idée d'une culture nationale fondée sur un registre temporel propre, national, où s'abrite aussi le passé.
La poésie Pau-Brasil représente le mieux le changement d'orientation du mouvement. Le Manifesto da Poesía Pau-Brasil 1 publié dans le quotidien paulista Correio da Manhã le 18 mars 1924, fut au centre des polémiques qui marquèrent 1924 et 1925. Oswald y fait preuve de lucidité par rapport au modernisme initial:
"Le travail de la génération futuriste a été cyclopéen. Mettre à l'heure l'horloge Empire de la littérature nationale.
Cette étape franchie, le problème est différent. Être régional et pur dans son époque".
Mais Oswald sait aussi y situer le cas brésilien dans le contexte plus large dans lequel la production nationale devrait s'encadrer. Il pense que la perspective modernisatrice doit à partir de ce moment s'inscrire dans les paramètres du nationalisme. La catégorie régionale paraît alors s'opposer à l'internationalisme affirmé jusque là. L'idée de l'intégration de l'élément national dans l'ordre international se formule de la façon suivante.
"Le Brésil profiteur. Le Brésil docteur. Et la coïncidence de la première construction brésilienne et du mouvement de reconstruction générale. Poésie Pau-Brasil."
Dans cette conception, c'est avant tout la recherche d'une définition spécifique de reconstruction pour le Brésil qui rend possible la participation du modernisme brésilien sur la scène internationale. Pour cela, Oswald propose d'établir une rupture dans le processus d'importation des modèles culturels et d'adopter une perspective de production de modèles culturels propres et adéquats à l'exportation. "Divisons: Poésie d'importation. Et la poésie Pau Brasil, d'exportation."
Le texte fait référence à la problématique artistique depuis le début du siècle, la présentant comme un processus révolutionnaire en deux temps: le premier, "la
28
déformation, à travers l'impressionnisme, la fragmentation, le chaos volontaire. De Cézanne à Mallarmé, Rodin et Debussy jusqu'à ce jour". Le second correspond à un projet constructif dans lequel s'insère la Poésie Pau-Brasil.
Ainsi, le décalage temporel entre art et réalité moderne dénoncé par les futuristes, devient à partir de ce moment un décalage géographique et culturel que les modernistes plus ou moins proches de l'idéal Pau-Brasil cherchent à corriger. Il est vrai que cette question peut être retrouvée dans certains textes dès la Semaine d'Art Moderne. Ainsi Menotti del Picchia, dans sa conférence-manifeste insiste sur le fait que le groupe moderniste veut faire naître "un art véritablement brésilien, fils du ciel et de la terre, de l'homme et du mystère"1
. Dans le contexte de la publication du Manifeste Pau-Brasil, Mário de Andrade
s'adresse à Joaquim Inojosa, en novembre 1924 , et exprime clairement les idées issues du virage moderniste:
"(...) la réalité contemporaine au Brésil, si elle peut avoir des points communs avec la réalité contemporaine de la civilisation essoufflée du Vieux Monde, ne peut pas avoir le même idéal parce que nos besoins sont entièrement autres. Nous devons créer un art brésilien. C'est la seule façon pour que soyons artistiquement civilisés. (...) Cela signifie seulement que le Brésil, pour être civilisé artistiquement, pour qu'il entre dans le concert des nations qui dirigent aujourd'hui la civilisation, doit concourir dans ce concert avec sa participation personnelle, avec ce qui le singularise et l'individualise (...). C'est comme dans la perspective pratique. Si nous voulions concourir à l'organisation économique de la Terre, avec le blé propre à la Russie ou le vin propre à la France ou à l'Italie, notre collaboration serait inférieure, secondaire, subversive et inutile parce que ni le blé ni le vin sont spécifiques à notre terre. Mais avec le caoutchouc, le sucre, le café et la viande nous pouvons allonger, agrandir l'économie humaine. De la même façon, nous aurons notre place dans la civilisation artistique humaine, le jour où nous concourrons avec le contingent brésilien, dérivé de nos besoins, de notre formation par le moyen de notre mélange racial transformé et recréé par la terre et le climat, au concert des hommes terrestres"2.
L'idée de la participation spécifique de chaque nationalité au concert universel de la modernité s'exprime ainsi chez Plínio Salgado: "(...)Je crois en chaque instrument d'un
orchestre, dans la distinction des partitions, sans renier l'unité du volume orchestral. L'humanité doit être un orchestre accordé" 3.
Ainsi, en ce second moment du mouvement moderniste, cette entrée par la modernité, dans le concert des nations, exige la définition d'une vocation nationaliste du mouvement. La valeur sociale ( en accord avec la thèse nationaliste) et la valeur artistique est ce que les écrivains modernistes cherchent à faire coïncider dans la nouvelle conception de la modernité. La dimension universelle, sa reconnaissance sur le plan international, dépend du degré de nationalité qu'elle peut exprimer. Mais Mário de Andrade insiste sur la contextualisation de ce nationalisme culturel: ces propos nationalistes ne concernent que les pays dont la problématique culturelle est celle des peuples et des nations nouvelles, et non-pas ceux dont les situations culturelles sont déjà sédimentées. En effet, si pour les pays les plus avancés dans ce sens là, l'intégration dans l'ordre moderne se fait de façon immédiate (ils sont en réalité l'incarnation de la modernité), pour les pays nouveaux, émergents, la participation au concert des nations doit se faire par l'affirmation de leurs caractères nationaux.
Pour l'organisation de la scène internationale, les modernistes tentent alors de distinguer le rôle de chaque participant. C'est ce que dira clairement Mário de Andrade
29
dans sa Pequena História da Música (1942): "La recherche du caractère national se justifie uniquement dans les pays nouveaux, comme le nôtre, ne possédant pas encore dans la tradition de siècles, de faits, de héros, une constance psychologique innée." 1
Sur la base de ces préoccupations , les modernistes élaborent au cours des années 20 une série de "portraits du Brésil" où ils cherchent à rendre compte de la véritable réalité brésilienne. Ces portraits comportent deux dimensions essentielles. La première est critique: on prétend rendre caduques les représentations de la réalité brésilienne faites au long de son histoire culturelle. Cette critique se fonde sur l'idée que ces représentations sont liées à des racines étrangères, totalement détachées du monde brésilien et du besoin réel de créer la brésilianité. Ces représentations sont donc forcément inadéquates au temps présent, et à la réalité du Brésil. Et l'Ensaio sobre a Música Brasileira (1928) de Mário de Andrade va dans le sens d'attirer l'attention sur l'absence de culture nationale et sur le fait que les hommes de culture au Brésil sont imprégnées de la culture européenne.
Le modernisme n'est donc plus à cette hauteur un mouvement proposant une rénovation dans le strict domaine artistique. La seconde dimension des portraits du Brésil, est celle par laquelle le modernisme tient avant tout à s'affirmer comme élément-clé de la constitution de l'entité nationale. Le modernisme croit pouvoir atteindre le Brésil par delà les apparences, et révéler une réalité nationale plus profonde, essentielle, dans laquelle le Brésil apparaît comme une totalité. C'est là une question que nous développerons largement en seconde et troisième partie.
Ce que le modernisme dénonce, c'est une crise de l'identité, de la conscience nationale, qui se manifeste dans le divorce entre culture et réalité, le dépassement de cet état des choses étant possible à travers un effort pour connaître le véritable être national. Le mouvement se caractérise alors par son refus de la dépendance culturelle européenne et l'affirmation radicale de la brésilianité.
D'une façon générale, la deuxième phase du modernisme telle que nous l'avons présentée, fait face à la situation de "retard" du temps national comme faisant partie de la temporalité propre au pays. La constitution d'une théorie de la temporalité de la vie nationale va rendre possible la réévaluation de la situation de "retard" sur la scène internationale. Elle va aussi fournir les bases de la définition d'un processus de modernisation propre à la nationalité.
Mais qu'est-ce que le Brésil? Un pays fragmenté par les différences ou un ensemble homogène? Les différences culturelles régionales sont-elles un signe de retard, un obstacle à l'actualisation de la culture brésilienne, ou au contraire dépositaires de la véritable identité brésilienne?
Le régionalisme qui naît en 1926 (avec le Manifesto régionalista do Nordeste de Gilberto Freyre) proteste contre la modernité homogénéisante, critiquant le style de vie citadin, la culture urbaine occidentalisée. Mais l'idée la plus répandue parmi les modernistes est bien de valoriser l'identité nationale, c'est-à-dire ce qu'il y aurait de commun entre tous les Brésiliens
b) La radicalisation de la rhétorique brésilianiste: Verdeamarelismo et Antropofagía
L'irruption, avec la phase Pau-Brasil du modernisme, de la question de la brésilianité apparaît comme un changement profond du sujet principal des débats artistiques. La question devient dorénavant de produire une littérature "vraiment" brésilienne, et de mettre en place des critères de brésilianité pour l'art. Les modernistes sont en effet d'accord sur l'idée que la modernité ne sera possible que par le biais de la brésilianité. Mais les modernistes en inventent plusieurs recettes, ce qui alimentera les débats jusqu'à la fin de la période que nous étudions. Celles-ci se constituent autour de
30
deux groupes modernistes: le groupe Verdeamarelo* et le groupe de la Revista de Antropofagía.
Les articles écrits par Menotti del Picchia et Plínio Salgado dans différents journaux, ont donné dès 1925 un ton verdeamarelo au débat sur la question de la littérature et de la culture nationale. Plínio Salgado, Menotti del Picchia, Cândido Motta Filho et Cassiano Ricardo, les personnalités du groupe verdeamarelo, idéalisent une culture xénophobe, ultranationaliste et donc réticente à toute influence extérieure. Ils ouvrent à nouveau le débat du lien au passé, inversant la tendance futuriste et n'ayant d'yeux que pour celui-ci: un passé national mythique, totalement idéalisé. Ils proposaient, anticipant l'intégralisme (le mouvement fasciste brésilien) des années trente, de construire le futur de la nation autour d'une discipline rigoureuse et élitiste.
Les verde-amarelos rompent en 1925 et 1926 avec les groupes de la revue Terra Roxa e Outras Terras1 et Pau-Brasil. Une polémique se déchaîne alors sur la question de la relation nationalisme-régionalisme. Pour ce groupe, les modernistes ont commis l'erreur fondamentale d'avoir honte des régionalismes et des traditions qui leur sont assimilées, les interprétant comme un signe de retard sur le temps universel. Pour les verdeamarelos, ces intellectuels (ils visent essentiellement le courant Pau-Brasil) persistent à voir le Brésil avec des yeux parisiens. Les verdeamarelos voient au contraire le régionalisme et le culte des traditions comme les points de départ d'accès à la modernité, car il permet de mettre en place une politique nécessaire de défense de l'Esprit National.
La question de l'art débouche dès lors sur une question plus globale et plus politique qui est celle de la construction de la culture nationale. Plínio Salgado, Menotti del Picchia, Candido Motta Filho, et Cassiano Ricardo sont les principales personnalités de ce mouvement. Leur programme en tant que verde-amarelistas était la "résurrection de l'esprit natif, le nativisme comme tel, l'homme et les choses du Brésil, histoire, légendes, folklore, costumes et traditions brésiliennes"2 .
Cassiano Ricardo, revenant dans le Manifesto Verde-Amarelo, à la question de l'art, affirme:
"(...)nous voulions un art qui eut une Patrie: ou plutôt, un art qui, pour acquérir son plus grand sens humain et universel, réaliserait la pensée de Gide, que Martain (un catholique) reproduit dans son "Art Scolastique": "Toute œuvre d'art sera d'autant plus universelle qu'elle réfléchira les signes de la Patrie""1.
Face à ce discours patriotique des verdeamarelos, le groupe issu de Pau-Brasil réagit, et constitue une nouvelle revue, qui en un premier temps restera ouverte à certaines personnalités du verdeamarelismo (Plínio Salgado y participera, et Raúl Bopp oscille entre les deux positions). Dans le manifeste qui ouvre le premier numéro de la Revista de Antropofagía2 , Oswald de Andrade expose sa conception de la brésilianité.
Il s'agit d'une prise de position nettement moins politique (du moins en apparence), et la brésilianité y apparaît sous la métaphore anthropophagique: la déglutition des autres cultures par la Terra Brasilis, aurait amené et amènerait toujours la formation et enrichissement de la culture nationale.
Cette vision de la brésilianité permettrait de résoudre le problème posé par la modernité au Brésil, en établissant une vision dynamique de la nationalité, permettant de comprendre autant le processus de formation de l'identité brésilienne, que le problème de l'art moderne au Brésil.
En effet, la métaphore anthropophagique permettrait de comprendre la nationalité en postulant une assimilation des codes européens par un présumé caractère national, qui s'expliquerait par la combinaison d'une mentalité pré-logique (cf Lévy-Bruhl) avec des formes civilisées superposées pour des raisons historiques: colonisation, catéchèse, etc.
L'idée de "dévoration culturelle", permet d'autre part aux Brésiliens d'adopter une position particulière dans la modernité artistique (position qui trouve ici continuité avec
31
l'idée exprimée dans le Manifesto da Poesía Pau-Brasil): il s'agit de dévorer les techniques et les informations des pays sur-développés, pour les réélaborer de manière autonome, les transformant à nouveau en produits d'exportation (de la même façon que l'anthropophage dévorait ses ennemis pour en conquérir les qualités).
On aura parfois reproché au courant anthropophagique de suivre des courants européens. Cette accusation provient principalement des détracteurs verdeamarelos, et en effet, la Revista de Antropofagía, fut précédée par la Revue Cannibale et le Manifeste cannibale Dada de Francis Picabia de 1920. Étant donné les succès archéologiques et ethnologiques et la mode du primitivisme et de l'art africain, comme de la psychanalyse, au début du siècle, il était tout naturel que la métaphore du cannibalisme rentre dans le lexique des avant-gardes européennes. Mais au sein de Dada, le cannibale ne fut qu'un déguisement en plus, dans la garde-robe avec laquelle le mouvement entendait épouvanter la mentalité bourgeoise (objectif qui n'était pas écarté de la perspective brésilienne). Le fait est que l'image de l'anthropophage était dans l'air, et nous la retrouvons ainsi dans Les Almanachs du Père Ubu, ou encore l'article Anthropophagie (1902) d'Alfred Jarry
Mais même si l'on fait ouvertement référence à Montaigne et à Freud (Totem et Tabou, 1912), dans le mouvement anthropophage brésilien, leur idéologie ne peut être qu'artificiellement raccroché au Cannibalisme de Picabia, sauf, justement, dans une perspective anthropophagique...
L'évolution du modernisme tel que nous l'avons présentée va donc dans le sens d'une recherche de nouveaux systèmes esthétiques, étant donné le déphasage des formes de l'art héritées du XIXe siècle, face aux profondes mutations sociales et politiques de la culture brésilienne. La confrontation des modernistes entre eux et avec la modernité telle qu'elle se présentait au Brésil les a menés à formuler leur questionnement non plus autour de la modernité conçue comme la civilisation technologique et rationnelle, mais comme harmonisation des modes d'expression avec la réalité nationale.
La période qui va de 1917 à 1929 (avec la fin de la Revista de Antropofagía) est présentée comme la phase héroïque du modernisme, au cours de laquelle se serait formée une nouvelle conscience de la culture brésilienne.
32
Seconde partie
Le Modernisme et la société brésilienne: du discours politique à la découverte de la Nation.
La raison pour laquelle nous pouvons affirmer qu'il y a eu une "période" moderniste dans l'histoire de l'art et de la culture au Brésil, est que des années 20 jusqu'à la fin des années 1940 l'ensemble des propositions et des questions soulevées par les modernistes servent de référentiel pour tous, dans les débats esthétiques, et finalement dans les discussions politiques. Que l'on défende ou que l'on détracte le modernisme, c'est bien ce dernier qui oriente les problématiques d'actualité artistique et sociétale.
Comme le montre l'évolution du courant littéraire moderniste brésilien, les questions esthétiques autour desquelles s'était cristallisé le mouvement ont été à l'origine du soulèvement de questions beaucoup plus vastes. A partir de 1924, la question de la modernité de l'art aboutit à une remise en question de la culture nationale, et à des tentatives d'en fonder une nouvelle. L'année 1924 s'annonce donc comme un virage dans l'histoire du mouvement moderniste, puisqu'au delà des préoccupations esthétiques (en continuité avec la Semaine d'Art Moderne), surgit la question de la brésilianité.
Le modernisme est donc plus qu'un mouvement purement esthétique. Il s'inscrit dans une dynamique sociale et intellectuelle et prend aussi la forme d'un mouvement d'idées et d'un mouvement culturel et politique nationaliste.
Nous tenterons en cette seconde partie de mettre l'accent sur ce discours nationaliste et en même temps, de réinsérer le mouvement dans la société à laquelle il se rattache, afin d'articuler les débats d'idées à la problématique sociale à laquelle étaient confrontés les modernistes. Il s'agira de montrer comment la teneur politique de leur discours est due à la situation sociale particulière des auteurs, dans une société en mutation. La réinsertion des écrivains dans leur milieu social et dans le contexte politique de l'époque, nous permettra de mieux comprendre le sens que pouvaient revêtir leurs propos théoriques et leur engagement politique.
C'est par cette nouvelle approche sociologique du modernisme que nous pourrons comprendre d'une part l'engagement politique du discours moderniste, et d'autre part ses pratiques sociales et culturelles. L'évolution sociale du groupe considéré, associée aux modifications structurelles du statut de l'art dans la société permettra enfin de comprendre l'ouverture du modernisme hors des limites posées jusque là, entre littérature et politique. Le statut de l'intellectualité moderniste conquis progressivement explique leur volonté de connaissance du social et du culturel brésilien. La situation sociale particulière des auteurs permet, elle, de mieux comprendre la motivation des modernistes à "découvrir le Brésil" comme il l'ont fait tout au long de la période que nous étudions ici.
Une précaution doit cependant être posée ici sur le contenu de nos affirmations. La politisation des débats modernistes est une évidence indéniable, mais nous ne devons cependant pas pour autant surestimer le caractère politique des attitudes des modernistes. En effet, mis à part une bonne partie des mouvements littéraires de l'Etat de Minas Gerais qui s'affichent ouvertement comme des mouvements politiques nationalistes (Carlos Drummond de Andrade affirmait en effet "(...)Nous sommes, finalement, un organe politique(...)" 1, ils ne participent presque jamais aux mouvements révolutionnaires qui animent la vie politique des années 20. Les auteurs modernistes au
33
cours des années 20 donnent le plus souvent priorité à leur action dans le domaine culturel, et leur nationalisme est avant tout rhétorique.
Ils sont en quelque sorte convaincus que l'essence de la politique se trouve dans le processus qui amène l'avènement d'une identité culturelle.
2.1.- Aboutissement politique de la démarche esthétique
2.1.1.- VERS UN ENGAGEMENT POLITIQUE DE L'AVANT-GARDE MODERNISTE
a) La poésie Pau-Brasil contre l'Ecole de l'Anta
La problématique artistique posée par le futurisme et le modernisme de la Semaine d'Art Moderne est largement dépassée au bout d'un certain temps. En 1924, plus qu'un art moderne, c'est un art brésilien qu'il faut découvrir ou même inventer. Le manifeste de la poésie Pau-Brasil et la conférence à la Sorbonne de Oswald de Andrade inaugurent cette nouvelle phase du mouvement. Dorénavant la question de la Brésilianité est fondamentale pour déterminer la place de l'art brésilien dans la modernité universelle.
La Modernité défendue par le mouvement que nous avons étudié, est en ce sens porteuse d'un engagement politique potentiel. Le débat cosmopolitisme / nationalisme culturel qui prédomine à partir de 1924 sur la scène artistique brésilienne est en effet hautement connoté politiquement et montre que culture et politique ne peuvent être dissociées. La preuve en est que rares sont les modernistes qui ne se rangent pas plus tard du côté du nationalisme, de façon militante: soit par un nationalisme conservateur et patriotique, soit par un nationalisme progressiste et "éclairé".
Et si au début des années 20 les modernistes tendaient du point de vue politique partisan, à un dégagement bohémien ou à l'appui aux partis oligarchiques, ils vont peu à peu chercher de nouvelles possibilités. Les alternatives politiques choisies par les modernistes se manifesteront comme nous le montrerons plus loin, soit par l'engagement auprès du Partido Democrático soit, après 1930, par l'engagement dans l'un des deux courants idéologiques qui ont marqué le siècle: le communisme et le fascisme.
Les portraits de la "réalité" brésilienne qui caractérisent cette nouvelle phase du mouvement montrent que les conceptions politiques des écrivains considérés se sont affinées et se sont renforcées, et montrent surtout qu'une relation directe s'est définitivement établie entre les questions artistiques et les questions culturelles et politiques.
L'inauguration de la phase "politique" du modernisme a cependant aussi amené les dédoublements entre différentes tendances , groupes et revues que nous avons présentés en fin de première partie. Des désaccords se nouent entre auteurs qui se taxent réciproquement de manque d'originalité ou qui conçoivent différemment leur engagement en tant que littéraires, dans le champ politique.
La division du modernisme en tendances politiques se confond avec les dédoublements esthétiques qui caractérisent la phase suivant la période Pau-Brasil. A la suite de cette période, les auteurs qui avaient collaboré à peu près sans distinction aux revues modernistes, se regroupent autour d'idéaux communs. D'un côté le verdeamarelismo se cristallise autour de personnalités comme Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado. De l'autre se regroupent, toujours sous l'idée de la poésie Pau-Brasil, des auteurs comme Oswald de Andrade, Mário de Andrade, associés à des peintres comme Tarsila do Amaral.
La rupture entre ces deux tendances est liée surtout à une différence d'attitudes envers la politique. D'une part les tenants du verdeamarelismo développent un discours
34
nationaliste et patriotique très affirmatif qui se fonde sur la vision d'un Brésil mythique et unifié. Leurs œuvres littéraires (nous pouvons prendre l'exemple de O Estrangeiro, de Plínio Salgado, 1926) ne distinguent pas l'art de la politique, et ils n'attribuent à l'art qu'un sens politique. D'autre part, le mouvement Pau-Brasil se caractérise par une attitude plus critique envers la politique. Ils n'abordent jamais directement et sérieusement ces thèmes, leur discours se caractérisant surtout par une critique sociale faite sur un ton ironique et iconoclaste.
La tendance à la politisation des débats modernistes mènera ces groupes opposés à exacerber leurs positions vers la fin de la décennie. Ces auteurs se retrouvent alors opposés en deux "écoles", elles aussi définies par des manifestes. Il s'agit du mouvement anthropophagique qui naît en 1928, à la suite de la publication du Manifesto Antropofágico (1er mai 1928), et de l'Escola da Anta qui prend une forme fixe avec le manifeste Nhengaçu Amarelo, qui paraît le 19 mai 1929, donnant continuité aux idées du verdeamarelismo.
Le Manifeste anthropophagique est en quelque sorte héritier de la poésie Pau-Brasil, mais affecte un langage encore plus subtilement politique, et encore plus critique. S'inspirant du mouvement dada (en particulier du Manifeste cannibale dada de Francis Picabia), il veut exprimer un modernisme à la brésilienne, éclectique et ironique: "la revue d'anthropophagie n'a aucune orientation ni pensée; seulement un estomac" 1; "Le mouvement anthropophage n'est pas une révolution littéraire. Ni sociale. Ni politique. ni religieuse. Elle est tout cela en même temps [...]"2. Le concept d'"anthropophagie" apparaît comme une vraie métaphore du primitivisme; emprunté à la tradition cannibale des Indiens Tupi, il est censé exprimer une forme de mépris à l'égard du bourgeois et du capitaliste, et aussi un rejet de l'impérialisme culturel européen. Dans un langage ludique, quelque peu freudien, on suggère de dévorer les colonisateurs afin de s'imprégner de leurs vertus et de leurs pouvoirs, et de transformer le tabou en totem.
L'absence d'engagement politique clair de Pau-Brasil et du courant anthropophagique, entraînera des divergences au sein de l'avant-garde: alors que le groupe Anta, fondé en 1927, s'orientait vers une idéologie fasciste - dont Plínio Salgado sera le produit achevé-une rupture officielle intervenait à partir de 1932 entre le SPAM (Sociedade Pro-Arte Moderna), plus élitiste, et le CAM (Club dos Artes Modernos), un peu plus engagé.
b) Des mouvements plus politisés, dans l'Etat de Minas Gerais
La tendance la plus ouvertement politique du modernisme est liée au nationalisme verdeamarelo, et prend racine à Rio comme à São Paulo, mais surtout dans les villes du Minas Gerais comme Belo Horizonte (la capitale) ou comme Cataguazes. Il semblerait que la radicalité des propos de ce modernisme particulier soit bien dû au milieu social spécifique de ses auteurs. En effet, dans les petites villes, les écrivains ne pouvaient compter sur l'appui de personne. Les mécènes locaux focalisaient encore leur attention sur l'art passéiste, et quand par leur propres moyens, ces modernistes s'organisent en groupes ou en revues, la réaction du public local est assez violente. C'est en tout cas ce qui est signifié dans le Manifeste du groupe VERDE de Cataguazes:
"Notre mouvement VERDE est né d'un simple petit journal de la terre --JAZZ BAND.Un tout petit journal avec des tendances modernistes qui a tout de suite scandalisé les habitants hyper-pacifiés de cette Meia-Pataca (••Meia-Pataca signifie la petite taille de la ville de Cataguazes••) . On a même entendu parler de coups de matraque... (...)
35
L'absence de publications, de maisons d'édition et d'argent -- nous a fait attendre le moment propice pour apparaitre".1
Le développement à partir de 1925-1926, du modernisme mineiro (de l'État de Minas Gerais) marque profondément l'engagement politique du discours des écrivains modernistes. Les revues rassemblant des jeunes écrivains comme Martins de Almeida, Carlos Drummond de Andrade ou Francisco L. Peixoto sont les lieux d'expression d'un nationalisme radical, ouvertement politique et non plus exprimé sous-couvert d'un discours esthétique ou culturel. Les manifestes-programmes de ces différentes revues (A Revista, 1925; Verde, 1927) illustrent particulièrement bien cette radicalité politique des jeunes écrivains. Ils s'y affirment nationalistes, se présentant comme la pointe de lance de la construction du sentiment national, et comme la jeunesse qui sera à la base du Brésil futur.
Cette radicalité s'exprime aussi notamment dans la détraction des mouvements modernistes les ayant précédés. Ils reconnaissent certes la valeur de la Semaine d'Art Moderne et des révélations artistiques qui s'y sont faites. Mais critiquent leur vanité purement iconoclaste qu'ils interprètent comme un nihilisme ou comme une dépendance par rapport à l'avant-garde internationale. L'affirmation nationaliste prend dans ce cas un ton régionaliste, puisqu'on se mesure aux mouvements non plus européens, mais aux modernistes paulistas et cariocas:
"C'est de [ce milieu hostile] qu'est née notre ferme volonté de montrer à tous ces gens que, même en habitant dans une petite ville de province, nous avons le courage de faire concurrence à ceux d'en-haut."1
L'"Action" est au centre de leur discours et c'est autour de cette idée que s'articule le nationalisme des modernistes mineiros.
Le manifeste Para os Céticos 2 ("Pour les sceptiques") de la revue A revista dont le premier numéro paraît au cours de l'année 1925 commence ainsi:
"Le programme de cette revue ne peut nécessairement pas s'écarter de la ligne structurelle de tous les programmes. Il se résume en un seul mot: Action. Action signifie vibration, lutte, effort constructeur, vie. (...)"
Plus loin, le thème de l'action est associé à celui de la jeunesse, vue comme une forme de romantisme engagé:
"(...)Entre tous les romantismes, nous préférons celui de la jeunesse et, comme lui, celui de l'action. Action intensive dans tous les domaines: dans la littérature, dans l'art, dans la politique. Nous sommes pour la rénovation intellectuelle au Brésil, ce qui est devenu un impératif catégorique.(...)"3.
Nous sommes donc ici bien loin du modernisme esthétique affichant ses considérations politiques, toujours sous le couvert de l'art ou des formes de style, telles qu'elles sont exprimées dans les manifestes de la Poesía Pau-Brasil ou de l'Antropofagía, par exemple. Mais la filiation moderniste des mineiros est ici incontestable. Ils font dans ces manifestes une réinterprétation particulièrement "droitiste" de la conception nationaliste de la modernité présentée par les mouvements paulistas, afin d'en déduire une attitude à adopter.
"Sera-t-il nécessaire de dire que nous avons un idéal? Il s'appuie sur le plus franc nationalisme, la confession de ce nationalisme constitue le plus grand orgueil de notre génération, qui ne pratique ni la xénophobie, ni le chauvinisme, et qui, loin de répudier les courants
36
civilisateurs d'Europe, essaye de soumettre chaque fois plus le Brésil à son influence, sans casser notre originalité nationale(...)" 4.
Dans le manifeste Para os espíritos criadores ("Pour les esprits créateurs", rectificatif dans le numéro 2 de A Revista, au programme Para os céticos), l'accent est mis sur le passé moderniste et sur une réinterprétation de ses acquis:
"Nous nous opposons à toute dévalorisation de notre petit héritage intellectuel. Si nous adoptons la réforme esthétique, c'est justement pour multiplier et valoriser le capital artistique réduit que nous ont laissé les générations passées" 1.
Mais cette fois, cet idéal se veut entièrement articulé à l'actualité des mouvements politiques, et les prend donc entièrement en compte dans ses commentaires et ses propositions politiques. Ce modernisme prend alors autant position sur la scène politique locale et nationale, que sur la scène artistique:
"Dans l'ordre interne, nous sommes contraints d'avancer encore une affirmation. Nés sous la République, nous assistons au spectacle poignant des désordres intestins, au long desquels se dessine, nette et perturbatrice, dans notre horizon social, une terrible crise d'autorité (...)"2 .
Tout en reconnaissant l'acquis des générations politiques et artistiques, ils en critiquent la faiblesse, et évaluent l'ampleur des travaux à venir:
"Après la destruction du joug colonial et du joug esclavagiste, et de l'avènement du modèle républicain, il semblait qu'il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est croiser les bras.«Erreur. Il nous reste à humaniser le Brésil»"3.
Les implications politiques du modernisme brésilien sont donc clairement explicitées dans les manifestes que nous venons de citer. Si nous pouvons effectivement distinguer les groupes mineiros de ceux des autres régions, par leur radicalité nationaliste, nous ne pouvons pas cependant nier leur filiation aux courants issus de la Semaine d'Art Moderne, dont ils se réclament, et dont la pensée leur a largement servi de fondement idéologique.
D'autre part, cette radicalité nationaliste n'est pas l'apanage des Mineiros et est concrètement présente dans le discours nationaliste d'écrivains paulistas comme Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo, et surtout Plínio Salgado. Le manifeste Nhengaçu Amarelo4, paru dans le quotidien O Correio Paulistano, à la fin de la période que nous étudions (précisément le 17 mai 1929) exprime le mieux la formalisation d'une idéologie nationaliste issue des recherches faites en un premier temps sur la modernité.
S'opposant certes au nationalisme de Verde, par l'affirmation de l'existence subjective du caractère national (alors que Verde se voulait objectiviste), la conception de la nécessité de l'engagement nationaliste de modernistes exprimée dans Nhengaçu Amarelo, comme son analyse de la situation politico-socio-culturelle du Brésil, s'en rapproche beaucoup.
Le nationalisme politique est donc largement représenté dans les rangs des écrivains modernistes. Un certain nombre d'auteurs se méfient cependant de cette attitude engagée de l'art, et essaent de distinguer (malgré leur militantisme dans des partis politiques) l'approche politique de la pratique littéraire. Mais cette attitude est minoritaire et se trouve essentiellement illustrée par la personnalité de Mário de Andrade.
D'une façon générale, l'engagement politique du discours des modernistes est plutôt bien accueilli par le public et par la critique littéraire. Tristão de Athayde (alias Alceu Amoroso Lima), à propos du lancement de O Esperado, et annonçant le dernier volume de cette trilogie, mesure l'amplitude politique des propos de Plínio Salgado et met bien en valeur les préoccupations politiques qui sont à la base de son écriture:
37
"Il nous promet (...) un troisième volume, qui complétera la trilogie et contiendra certainement la vision du São Paulo révolutionnaire de nos jours, si inquiétants pour ceux qui voient dans l'impérialisme communiste la plus grande menace qui pèse sur les peuples sans personnalité et sans structure comme le nôtre"1.
La politique fait donc irruption dans les textes des modernistes, et contribue non pas à les compromettre, mais en fait, à les valoriser. Mais la dimension politique du modernisme ne se limite pas, nous le montrerons à cet aspect direct du discours. Elle est beaucoup plus ample et englobe autant l'engagement des modernistes au sein des structures de pouvoir, que le soutien politique qu'ils obtiennent pour divulguer leurs œuvres et leurs idées ou leurs pratiques quotidiennes sociales et littéraires. Nous montrerons en troisième partie que le modernisme implique une autre dimension politique qui est celle de la formation d'un imaginaire politique particulier et innovateur.
2.1.2.-SOCIOLOGIE DES MODERNISTES: DES STRATÉGIES DIVERSES POUR UN STATUT SOCIAL INCERTAIN
Le fondement essentiel de l'engagement moderniste en politiques est essentiellement, pour les sociologues de l'intellectualité au Brésil, le contexte social particulier des élites culturelles au Brésil, à partir du début du XXe siècle. Confrontés à un certain nombre de difficultés, en termes de statut social, nos écrivains ont développé des stratégies individuelles qui varient en fonction de leur condition sociale de départ et en fonction de leur milieu. Leur réflexion sur la politique brésilienne trouve alors ses fondements dans leur parcours individuel et dans leur nécessité de légitimer un statut social d'intellectuels qui n'assure pas facilement les conditions de leur survie matérielle.
a) Le déclin des oligarchies rurales et la nécessité de reconversion
Les inquiétudes et les conceptions politiques développées par les modernistes au cours des années 20 sont intimement liées à leur propre condition sociale. Leur vécu individuel est une conséquence du processus social de l'époque qui se caractérise principalement par la décadence des oligarchies rurales, dont ils sont,pour la plupart, issus. Cette décadence de l'élite politique et économique du Brésil rural explique d'une part le besoin de reconversion sociale de ses membres, et l'expression d'une nouvelle conception du monde due à une transformation de l'identité des membres de l'élite économique, politique et culturelle du pays.
La crise de société au cours de laquelle apparaît le modernisme est une crise artistique, nous l'avons vu en première partie, mais c'est avant tout une crise des structures de pouvoir au Brésil. Il s'agit principalement de la décadence sans retour des familles de l'oligarchie rurale, due essentiellement à la crise du cours du café au début de années 20, et à l'apparition progressive de nouveaux prétendants au pouvoir, liés cette fois à une autre forme de domination économique. Cette dernière classe est constituée de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie urbaine qui trouvent leurs bases financières dans la production industrielle, de plus en plus rentable, au Brésil.
L'oligarchie rurale s'était relativement bien accommodée de la République instaurée en 1889, et renforçait ses intérêts par la pratique de la "politique du café au lait", mais se trouve finalement minée par son échec économique. Et la crise des structures de pouvoir traditionnelles se manifeste aussi depuis le début du siècle, à tous les niveaux de la politique brésilienne. L'intervention indirectement politique des
38
modernistes s'insère dans une conjoncture de re-création institutionnelle généralisée. Aucune institution n'échappe à la nécessité de se doter d'une nouvelle légitimité: l'Église autant que l'État, l'armée ou les établissements d'enseignement supérieur doivent revoir les fondements de leur domination.
La réforme esthétique replacée dans ce contexte démontre alors toute l'ampleur de ses implications. Et c'est en ce sens que nous pouvons réinterpréter certains aspects du pré-modernisme. En 1880, l'Ecole militaire dans laquelle Euclides da Cunha s'était formé devient un siège d'opposition au régime monarchique et de défense de la République. S'y concentraient en effet des éléments provenant de la petite bourgeoisie (les héritiers de l'oligarchie s'orientant généralement vers une formation en Droit), et la carrière militaire leur apparaissait comme un tremplin social efficace.
La manifestation d'une vision non-conformiste de la société brésilienne exprimée par les pré-modernistes, mais aussi plus directement par la révolte des tenentes (les lieutenants) du fort de Copacabana en 1922, est indubitablement liée à cette remise en cause de la domination des structures traditionnelles et rurales du pouvoir.
Dans ce contexte, la réflexion moderniste sur la question de la culture nationale est fondamentale dans la mise en place des idées de la nouvelle génération politique, qui s'oppose à la survivance d'une pensée de pacotille, de la culture ornementale prédominante jusque là, indifférente aux réalités nationales.
L'appartenance à des groupes sociaux menacés de disparition ou de réformes est une des explications essentielles de la formation de l'imaginaire politique moderniste. La notion d'"intérêt" des modernistes est donc liée d'une part à l'appartenance à un groupe social d'origine, mais aussi à l'identification à une nouvelle catégorie sociale (l'intellectualité littéraire), et à l'insertion de ces écrivains dans l'appareil d'État.
Face à ces difficultés, les modernistes adoptent une attitude stratégique, soit de maintien des acquis sociaux, soit de conquête d'un nouveau statut au sein d'une société où l'héritage socio-économique familial n'est plus suffisant pour assurer des ressources financières et un statut valorisant.
Le sociologue brésilien Sérgio Miceli1 applique avec succès les analyses de Pierre Bourdieu, aux intellectuels des années 20 à 40, et identifie pour les modernistes 2 stratégies différentes:
D'une part nous pouvons distinguer "les héritiers" ou les "hommes sans profession", c'est-à-dire la part des écrivains qui cherchent avant tout à reproduire les positions de leurs propre groupe social et de leur formation intellectuelle. A ceux-ci s'opposent, "les parents pauvres", ou les "cousins pauvres" qui assurent des refuges professionnels la plupart du temps dans la fonction publique grâce à leur maigres triomphes dans le domaine littéraire et intellectuel.
Presque tous les écrivains modernistes sont issus d'anciennes familles dirigeantes, plus ou moins impliquées dans le processus de décadence qui emportait les familles d'exploitants agricoles. Ils se distinguent entre eux, non pas par le volume de capital économique ou scolaire, mais plutôt par la différence de proximité de leurs familles en relation avec les milieux intellectuels et politiques de la classe dominante et par conséquent par le degré de conservation ou de dilapidation de leur capital de relations sociales.
b) Les "hommes sans profession" et le dandy Oswald de Andrade
Les "héritiers" adoptaient une attitude particulière qui s'exprime assez directement dans leur œuvre littéraire ou dans leurs mémoires. Les frères Almeida (Guilherme et Tácito), les frères Alcântara Machado (Antônio et Brasílio), Cândido Motta Filho, ou Oswald de Andrade appartenaient à des familles spécialisées depuis plusieurs générations dans les fonctions culturelles, étant fils d'avocats ou de magistrats illustres.
39
Leur préoccupation affichée est plus de défendre leur liberté que leur statut social. Cette révolte contre un statut dont le prestige n'est de toute façon plus assuré est exprimé dans les mémoires de Cândido Motta Filho:
"Plus qu'un bachelier, je voulais être libre. Ne pas avoir de titre. Ne pas avoir de profession. Ne pas être docteur. Mais être un homme capable d'être homme! Ce que je ne voulais pas c'est être un bachelier sans être."1
Les hommes sans profession étaient en fait des héritiers nés dans des familles qui monopolisaient depuis longtemps les positions de prestige dans la classe dirigeante. Leur simple nom leur garantissait le libre accès aux cercles dirigeants. Ils étaient liés de diverses façons aux groupes économiques dominants par mariages, amitiés, négoces en commun, comités partisans. Dans leur cas, l'orientation vers les professions intellectuelles a beaucoup plus à voir avec des stratégies de reproduction de ces familles, qu'avec des effets provoqués par le déclin social et économique dont furent victimes les "cousins pauvres".
"Le couple formé par le poète Oswald de Andrade et par la peintre Tarsila do Amaral est l'incarnation la plus parfaite et achevée du style de vie des membres des cercles modernistes, obsédés en même temps par l'ambition de l'éclat social et par la prétention à la suprématie intellectuelle. Le fait qu'ils appartiennent tous deux à des familles aisées de l'oligarchie et qu'ils puissent vivre des rentes provenant de la spéculation immobilière sur les terrains où s'édifieront les futurs quartiers élégants de la ville de São Paulo et des profits dérivés de l'exportation de café, leur assurèrent le capital nécessaire pour qu'ils puissent s'imposer comme modèles raffinés d'importateurs autant au niveau de la consommation de luxe que dans le champ des investissements culturels."1
Au cours de leurs voyages successifs en Europe, ils menèrent jusqu'aux ultimes conséquences un style de vie ostentatoire où l'on a du mal à distinguer l'investissement intellectuel de l'importation de symboles de prestige social. Ils fréquentaient dans les grandes capitales du "vieux monde", les spectacles de théâtre d'avant-garde, les balais russes, les nuits des cercles diplomatiques, les conférences de la Sorbonne, les cours des peintres modernes, les courses équestres et automobiles, les rencontres de boxe; ils apprenaient à danser le Charleston; achetaient des toiles de Léger, des objets "Art-Déco", des chaussures Perugia, des chemises Sulka, des ‘pyjamas d'appartement’, des parfums Rosine, des meubles Martine, des robes de Poiret, avaient des audiences avec le pape, etc... Les "exploits" de ces écrivains modernistes en matière de décoration, de vêtement, d'éthique sociale et sexuelle, semblent donc plutôt s'inscrire dans l'histoire de l'importation des modèles de goût pour la classe dirigeante liée à la production de café que dans l'histoire de la production intellectuelle.
Les œuvres des écrivains modernistes sont imprégnées de ce mode de vie ostentatoire, mais leur existence dépend en même temps des mécènes qui organisaient des salons dans la capitale de l'État de São Paulo.
La Semaine d'Art Moderne de São Paulo, moment emblématique du mouvement moderniste et de la réforme esthétique "anti-passéiste", n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien du pouvoir politique oligarchique. Le mécène et essayiste Paulo Prado, issu de la famille la plus riche du Brésil à l'époque, a en effet rendu possible à ce groupe de jeunes inconnus et quelque peu révoltés contre l'état de l'art défendu par l'élite, d'occuper pendant une semaine le Théâtre Municipal de São Paulo, lieu suprême d'expression de l'art qu'ils dénigraient.
D'autre part, s'il est vrai que plus tard, un certain nombre de ces écrivains modernistes sont devenus des "semi-professionnels" de la production littéraire nationale, la divulgation des œuvres du premier temps moderniste se limitait à un cercle
40
relativement restreint d'initiés, appartenant aux familles aisées de l'oligarchie locale, et qui détenaient les codes pour déchiffrer de telles œuvres.
La première édition de 500 exemplaires de Juca Mulato de Menotti del Picchia, celle de 800 exemplaires de Losango Cáqui, de Mário de Andrade, l'édition parisienne de Pau-Brasil, d'Oswald de Andrade, sont des entreprises éditoriales financées par les auteurs eux-mêmes ou par leurs mécènes, se caractérisant essentiellement par le fait qu'il s'agissait d'une production artisanale et de luxe.
Contrairement aux écrivains professionnels de la República Velha qui vivaient des rentes de leur métier d'écrivains, les modernistes "sans profession", tenaient leurs conditions de vie d'investissements personnels ou familiaux. Nous verrons que dans le cas des "cousins pauvres", ils sont obligés d'exercer des professions dans des institutions politiques et culturelles de l'oligarchie.
L'accès des modernistes aux avant-gardes européennes grâce à leur proximité sociale des cercles intellectuels de l'oligarchie, fut donc paradoxalement la condition qui leur permit d'assumer le rôle d'innovateurs culturels et esthétiques dans le champ littéraire local, prenant des initiatives décisives dans le processus de "substitution des importations" de biens culturels. Vu que les principales institutions de production culturelle (surtout la presse) ne détenaient pas le monopole des instruments de consécration, les écrivains cherchèrent à imposer les modèles esthétiques étrangers par leur propres moyens. Aussi pouvons nous dire que les changements introduits par les modernistes dans le champ intellectuel brésilien se firent de façon presque indépendante des demandes formulées par le marché du livre hérité de la República Velha.
c) Les "cousins pauvres" et le profil type de Mário de Andrade
Mário de Andrade, Paulo Duarte, Cassiano Ricardo, Fernando de Azevedo, Plínio Salgado, etc., étaient les "cousins pauvres" dont les parents durent affronter une situation matérielle plus modeste. Les familles de ces "cousins pauvres" se trouvaient relativement plus écartées socialement des sphères intellectuelles et politiques de la classe dirigeante, que leurs contemporains du mouvement moderniste, les "hommes sans profession". Ils grandirent et furent éduqués dans des petites villes de l''interior" et ne vinrent habiter à la capitale qu'à la fin de leur adolescence. C'est notamment le cas de Plínio Salgado
Leur parcours individuel se caractérise d'autre part par un retard relatif de leurs investissements scolaires. Mário de Andrade ne conclut aucune de ses études supérieures, Fernando de Azevedo ne fait ses études de droit, qu'après un stage prolongé dans l'Ordre des Jésuites et de nombreuses péripéties professionnelles. Paulo Duarte n'y arrive aussi que tardivement.
Dans ces conditions, et selon l'interprétation de Sérgio Miceli, la carrière ecclésiastique est un moyen détourné d'échapper à la "dégradation sociale" et d'accumuler un certain capital culturel (philosophie scolastique, philologie...). L'initiation littéraire et érudite de fernando de Azevedo à travers le séminaire (le latin et autres langues classiques) est une condition indispensable pour qu'il puisse mener à bien son tortueux parcours de reconversion aux professions intellectuelles.
L'apparition de l'engagement des modernistes dans le sens d'une valorisation de la production artistique nationale a parfois été interprétée comme étant liée à la baisse de ressources des grands planteurs et des gros commerçants qui aurait amené la chute des pratiques culturelles liées au cosmopolitisme, qui leur permettaient jusque là d'effectuer de nombreux voyages touristiques ou de financer les études de leurs enfants en Europe, comme d'acquérir des œuvres d'art.
Contrairement à l'"homme sans profession", Oswald de Andrade (qui put assumer le rôle d'avant-gardiste à ses frais personnels), Mário de Andrade est le prototype du "cousin pauvre" qui réussit aussi à exercer une
41
grande influence dans le champ intellectuel, mais cette fois, par des voies différentes, grâce d'une part à ses larges investissements en capital culturel, et d'autre part au développement des institutions culturelles de l'oligarchie.
Mário de Andrade ne pouvait compter que sur le capital social hérité du côté maternel de sa famille, pour contrebalancer ses désavantages familiaux et scolaires. Il était une espèce de fils cadet indésiré. Son père et les autres membres de la famille ne contenaient pas leur tendance à le culpabiliser pour la mort de son jeune frère qui était le petit préféré: comblé de dons, beau, blond, "intelligent" et "sensible". D'autre part, Mário de Andrade fut le seul écrivain moderniste à ne pas avoir fait d'études de droit, n'ayant pas fini son cours de comptabilité et suivant la formation du Conservatoire Dramatique et Musical de São Paulo.
Par rapport à Oswald de Andrade qui cherchait à se mettre en valeur par ses exploits intellectuels comme par sa "supériorité" sociale, Mário ne pouvait prétendre être le leader du mouvement moderniste que par l'approfondissement et la diversification de sa formation culturelle polyvalente. Autodidacte, Mário de Andrade s'investit intellectuellement à un tel point qu'il finit par couvrir presque tous les domaines littéraires, artistiques et scientifiques de l'époque, et reste solitaire et misogyne toute sa vie, uniquement accompagné par sa mère, sa marraine, sa jeune sœur, et par la "négresse" ("a preta" en portugais ) Sebastiana qui travaillait pour la famille.
Alors même qu'il s'engage très tôt dans les rangs du Partido Democrático, Mário ne dépasse pas le statut d'adjoint ou de conseiller intellectuel prestigieux, contrairement à son frère plus âgé qui réussit à rentrer dans la carrière politique.
Telles furent donc les conditions qui menèrent Mário à devenir un intellectuel à part entière.
2.2.-De l'avant-garde à l'intellectualité
Étant données les structures sociales brésiliennes et les familles dont sont issus les modernistes, les écrivains modernistes semblent s'intégrer à l'élite brésilienne, sous le double statut d'artistes et d'intellectuels.
En fait les intellectuels comme les artistes n'appartiennent pas vraiment à un groupe autonome. Les intellectuels ont trois profils de base, qui sont liés à leur formation intellectuelle: ils peuvent être soit ingénieurs (et sont alors souvent marqués par le positivisme et par une vision technocratique de la société), soit avocats (la grande majorité des écrivains modernistes sont formés en droit), soit enfin ils ont le profil des "hommes de culture" (qui se caractérisent par leur formation en sciences humaines). Le profil des écrivains modernistes s'accommode des deux derniers cas, étant majoritairement formés en droit, mais ayant tous un large attrait pour les multiples expressions de la culture et pour les sciences sociales.
2.2.1.-LES MODERNISTES ET LE POUVOIR PENDANT LES ANNÉES 20
a) Cadre général de l'intellectualité pendant la période étudiée
Les intellectuels brésiliens de ce siècle sont nombreux à se percevoir comme une catégorie sociale à part, convaincus de leur vocation à participer à la construction de la société, aux côtés ou contre l'État.
Étant donné l'écart particulièrement important au Brésil, entre le social et le politique, les intellectuels légitiment leur statut, en s'érigeant en médiateurs irremplaçables entre ces deux pôles. Dans leur vision des choses les intellectuels se substituent aux classes et se placent dans le lieu du pouvoir, en surplomb du social.
42
L'intellectuel brésilien est de par cet aspect logé à la même enseigne que le politicien: il est pris dans cette réalité dont il détient les secrets. Les intellectuels modernistes, comme nous le verrons plus loin, fondent la légitimité de leur discours sur le social, par leur application des sciences sociales à la société brésilienne. C'est sur cette légitimité que se fondera pendant les années 30, l'action politique de nos auteurs, ce qui explique d'une certaine façon le succès de la sociologie au cours de cette décennie.
Même s'il attribuent une valeur importante à l'histoire et au patrimoine culturel hérité de l'Empire et de la República Velha, les intellectuels modernistes se sentent libres de tout passé et de toute pesanteur actuelle, et affirment savoir où aller, et être en mesure de guider la nation brésilienne. La conviction des ces intellectuels est que les idées peuvent être des forces matérielles et sont susceptibles de transformer le cours des choses. Ils sont convaincus d'autre part que la politique et la science sont deux aspects de la même maîtrise de la réalité.
La priorité pour les modernistes qui prétendent parler au nom de la Nation est de convaincre qu'elle est déjà là, en filigrane. Comme nous le verrons en troisième partie, tout est bon pour le prouver: la manière d'être (le "caractère" brésilien), la culture, le peuple. Mais, dans cette perspective, le plus effectif est d'inventer des mythes unificateurs, autour de l'idée de progrès, de civilisation ou encore de nation.
Ayant fait des efforts incessants pour doter la nation d'un peuple ou faire du peuple une nation (tout en ayant une tendance à ne pas croire que les masses ont une capacité d'être un sujet politique), ils sont lancés dans l'exploration de la réalité nationale et la mise en forme de la société. Ils ne veulent en aucun cas séparer pensée, connaissance et action.
Le parti pris réaliste, affirmé en même temps que la défense du caractère intuitif de leur connaissance de la nation, est un détour pour libérer l'inventivité idéologique: "Proclamer que le réel [la Nation, le caractère National] s'engendre par soi seul est une manière de lester la représentation qui en est donnée, d'un poids de vérité et d'efficacité."1.
Les modernistes, s'identifiant à l'intelligentsia nationale auront ainsi assumé une responsabilité essentielle dans la construction de l'identité nationale, contribuant à imposer de nouvelles représentations du politique. Les intellectuels brésiliens établissent différemment au cours du XXe siècle, leur rapport à l'État et à l'idéologie d'État. Leur vision du politique, au sein de laquelle naît la pensée moderniste, se construit à en croire Daniel Pécaut 2, suivant quatre dimensions.
La première de ces quatre dimensions se situe entre le spécifique et l'universel. Elle est particulièrement évidente chez les modernistes, puisque leur pensée se structure comme nous l'avons vu autour de la question de la modernité universelle, puis de la brésilianité. Cette dimension du discours intellectuel moderniste tente de répondre à la question: quelle peut être l'identité brésilienne au-delà des inégalités et des différences?
La seconde dimension se construit elle, entre le réalisme et le constructivisme: le discours moderniste se caractérise d'une part par sa prétention à la connaissance du réel national, tout en affirmant paradoxalement sa volonté de construire la civilisation brésilienne.
Cet aspect sera surtout exprimé par les intellectuels des années trente qui auront hérité de la pensée moderniste, leur volonté de revenir à la "réalité" brésilienne pour mieux en terminer avec les institutions "artificielles" et copiées de l'extérieur, de la República Velha. A ces idées s'ajoute une certaine influence néo-darwinienne, qui leur fait éprouver une forme de mélancolie à propos du "mélange des races", et une certaine peur du désordre.
La troisième dimension de la pensée politique moderniste s'établit entre le continuisme et l'évolutionnisme. L'imagination d'un mythe des origines et la constitution d'une idéologie du caractère national chez les écrivains que nous étudions ( nous
43
développerons plus largement ces aspects en troisième partie) contribue à fonder la pensée d'une continuité de la nationalité au Brésil. Gilberto Freyre (Casa Grande e Senzala, 1933) et Sérgio Buarque de Hollanda (Raízes do Brasil, 1936), donnant suite à la pensée moderniste décrivent, cette continuité présente dans l'art de se jouer des normes et des hiérarchies formelles par la "conciliation" et la "cooptation". Mais les conceptions politiques modernistes se caractérisent aussi par la croyance dans une certaine forme de sélection et dans un évolutionnisme déterminant la formation de la nation.
Enfin, l'imaginaire politique moderniste se constitue entre la reconnaissance du non-rationnel et le scientisme. Le comtisme est un facteur inévitable dans la formation de la pensée sur le Brésil, et il fait partie de la tradition intellectuelle brésilienne. Les modernistes, voulant fonder leur projet de national sur une connaissance "scientifique" de la société considèrent aussi que l'"affectivité" et la "cordialité" sont des ressources qui peuvent être mises au service de stratégies rationnelles.
b) Soutien politique et engagement partisan des modernistes
Les rapports des modernistes avec le politique et la légitimation de leur statut d'intellectuels ne prennent cependant pas uniquement corps à travers les conflits théoriques. L'engagement progressif du discours moderniste est en grande mesure lié à l'approche qu'ont eue les écrivains non pas de la pensée politique, mais de la politique mise en pratique, c'est-à-dire d'une part les appuis politiques dont ont pu bénéficier les modernistes par le biais de leur capital social acquis ou hérité, et d'autre part de l'engagement des modernistes dans les mouvements et les partis politiques.
Dès le premier moment, les écrivains modernistes avaient pu compter sur le soutien financier ou de prestige de différentes personnalités significatives de la vie économique ou politique paulista. L'ampleur qu'a pu prendre le mouvement est en large mesure due au riche réseau de relations qu'ont pu entretenir les écrivains modernistes. Le cas de la Semaine d'Art Moderne en 1922 est à ce titre largement significative. Selon Mário da Silva Brito:
"La Semaine fut patronnée par l'élite financière et mondaine de la société de l'État de São Paulo. Elle put compter sur la collaboration de Paulo Prado, Alfredo Pujol, Rodrigues Alves, Numa de Oliveira, Alberto Penteado, René Thiollier, Antônio Prado Júnior, José Carlos de Macedo Soares, Martinho Prado, Armando Penteado et Edgar Conceição. Il est intéressant de signaler que le Correio Paulistano, organe du PRP, duquel Menotti del Picchia était rédacteur politique, couvrait les 'avant-gardistes', avec le consentement de Washington Luís, président de l'Etat"1
Il existe concrètement une certaine connivence entre les intellectuels et les gestionnaires brésiliens: "ils se sentent pareillement appelés à construire la société et, du reste, nombre d'intellectuels sont à chaque moment invités à assumer des responsabilités directes dans l'État"2 . Ils sont identifiés à une intelligentsia, et les modernistes, en tant qu'intellectuels, et au même titre que les militaires ou les technocrates, ont contribué à définir l'image de la nation et de nouvelles formes de légitimation du pouvoir.
La prise de position des écrivains modernistes se manifeste essentiellement par leur répartition dans l'espace politique brésilien du début du siècle, et par leur engagement auprès des nouvelles formations politiques issues des partis traditionnels.
Selon Sérgio Miceli3, "la différenciation du champ politique et du champ de production idéologique rendit pratiquement enviable le passage presque automatique de la situation d'étudiant à la condition de membre à part entière de la classe dirigeante". C'est cette nouvelle condition qu'ont dû affronter les intellectuels modernistes pour
44
assurer le maintien des positions acquises par leurs familles, et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la mobilisation partisane des intellectuels du front moderniste et des autres intellectuels qui militeront dans les organisations politiques et culturelles dominantes.
De 1901 à 1926, la concurrence politique entre groupes dirigeants de São Paulo se résume aux conflits et scissions autour de la direction de l'unique parti oligarchique de l'époque (Partido Republicano Paulista, PRP). Cette opposition aboutira principalement à la création du Partido Democrático (PD). Ce nouveau parti, surgissant sur la scène politique en 1926, permet de cristalliser les dissidences, autour d'une idée centrale, la "moralisation" électorale. Mais tant la Liga Nationalista (opposée elle aussi au PRP), que le Partido Democrático prétendaient se transformer en "porte-parole" de la faction dominante, spécialisée dans le travail technique, politique et culturel.
L'adhésion au Partido Democrático prit le sens, pour la nouvelle génération de politiques, d'une alternative viable afin de faire une carrière politique hors du situationnisme dominant (surtout au PRP) qui, par la force de ses traditions militantes, réservait le droit à une participation politique directe à ses cadres les plus anciens.
Les scissions et les querelles qui eurent lieu au sein du mouvement moderniste à partir de 1924, se doivent surtout à des raisons politiques. Les écrivains liés au PRP cherchaient à mettre leurs œuvres au service d'une idéologie "nationaliste" qui pourrait être utilisée par les groupes dirigeants ou des tendances réformistes qui cherchaient à conquérir le pouvoir. Ces intellectuels "perrepistes" (PRP) se divisèrent en "droite" et "gauche" littéraire, à cause de leurs positions divergentes quant au degré et aux modalités d'engagement des intellectuels et des artistes avec le travail politique. Cette division interne des "perrepistes" suivit la publication du "Manifesto Pau-Brasil" (1924), donnant origine aux mouvements "verde-amarelo" et "Anta". Les écrivains de ces mouvements, ne distinguant pas leurs prises de positions politiques et littéraires, ont pu par la suite pour la carrière politique, ainsi, après 1930, Menotti del Picchia et Plínio Salgado furent élus députés au PRP.
Au contraire, les intellectuels "démocratiques" (liés au PD), sous la direction de Mário de Andrade, s'efforcent de ne pas compromettre le contenu de leur production littéraire et esthétique par leurs prises de position politico-partisanes.
Le rapport des modernistes à la politique passe enfin, après le soutien de l'Etat et l'engagement partisan, par la conquête du relais médiatique, essentiellement la presse. Les dissidences politiques sont renforcées au Brésil du début du siècle, par le poids croissant des instances de production idéologique, la substitution des petits journaux de province par la grande presse commerciale ou ouvrière, et tout spécialement de groupes liés à la famille Mesquita qui détenait depuis 1897 le contrôle de la plus grande partie des actions du journal "indépendant", O Estado de São Paulo. Ce quotidien est le fer de lance des fronts d'opposition successifs au PRP, et divulgue sa conception du ‘libéralisme’ oligarchique.
O Estado de São Paulo augmente considérablement son tirage et, en 1915, lance un titre du soir intitulé O Estadinho, et A Revista do Brasil ("Mensuel de Haute Culture", lancé en 1915). La Revista do Brasil, devient rapidement importante et atteint son objectif en créant un noyau de propagande nationaliste. Elle se propose de susciter une prise de conscience de la part de la nouvelle génération d'intellectuels et de politiciens de l'oligarchie, et accueille les penseurs de l'autoritarisme (dont Oliveira Vianna) et ceux du renouveau catholique (Jackson de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima...). Mais la Revista do Brasil reste ouverte aux jeunes qui se raccrocheront rapidement au modernisme, et c'est dans ce cadre que Plínio Salgado, Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Hollanda, et Gilberto Freyre, manifesteront leur engagement politique.
45
D'autres quotidiens et revues soutenaient aussi les idées modernistes, et contribuèrent à divulguer leurs œuvres et à exprimer les débats et les dissidences du mouvement originel. Parmi ces journaux nous pouvons distinguer O Correio Paulistano, O Diário Nacional, O Jornal do Commércio. A Noite, cède un espace aux modernistes dans ses pages, et annonce le 11 décembre 1925: "A Noite a engagé six écrivains futuristes pour écrire pendant un mois"1. "O Mês Modernista" (le mois moderniste) aura ainsi permis une large diffusion des œuvres de jeunes auteurs comme Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Milliet, Manuel Bandeira, Martins de Almeida, Mário de Andrade et Prudente de Moraes Netto.
Les modernistes obtinrent aussi des postes fixes au sein de certains journaux, assurant ainsi une divulgation et une présence symbolique des modernistes autant dans l'actualité artistique que dans les débats sociaux et politiques: Menotti del Picchia fut chroniste social (sous le pseudonyme de Hélios) et rédacteur politique du Correio Paulistano, où Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Oswald de Andrade, et encore beaucoup d'autres éléments de l'état-major intellectuel du PRP, eurent l'occasion de travailler. Paulo Duarte, travaille à l'Estado de São Paulo depuis 1919 (à différents postes, du correcteur au rédacteur). Mário de Andrade, enfin, collabora intensivement au Diário Nacional, suivant l'exemple de Paulo Duarte, Vicente Raó, Sérgio Milliet, Rubens Borba de Morais, et encore d'autres partisans du PD.
2.2.2.- TRANSFORMATION DU STATUT DE LA LITTÉRATURE DANS LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE
Les rapports concrets du groupe moderniste avec les différentes expressions du pouvoir dans la société brésilienne les ont menés à adopter une attitude particulière dans laquelle entraient en jeu tant les structures traditionnelles du pouvoir, que de nouvelles structures dont les modernistes ont profité. Avec les années 20, la littérature et l'art au Brésil changent de statut au sein de la société. Les écrivains vivant beaucoup plus difficilement de leur production, ils cherchèrent à s'imposer comme intellectuels. Il s'agit là du processus de modernisation de la littérature au Brésil, processus par lequel la littérature se mercantilise et s'industrialise, s'associant à un phénomène de "substitution des importations" de biens culturels et de formation du marché interne. Cette transformation profonde du statut de la littérature au sein de la société brésilienne a en quelque sorte assuré l'imposition des modernistes sur la scène culturelle.
a) Légitimation du statut intellectuel des modernistes et constitution d'un marché littéraire
Nous assistons, avec l'imposition progressive du modernisme sur la scène artistique, à la disparition progressive des limites entre œuvre littéraire (et artistique en général) et politique. Une des caractéristiques du modernisme, en comparaison avec les autres courants de l'histoire littéraire et artistique au Brésil, est en effet l'abolition de la distinction entre la pratique littéraire et l'activité politique de l'artiste. Dans l'œuvre des auteurs qui élaborèrent la question de la brésilianité, nous remarquons la progressive ouverture des question traitées, en dehors du pur domaine littéraire ou artistique. Au cours de la décennie que nous étudions, les écrivains, pris dans un mouvement de plus en plus radical, finissent par ne plus distinguer la vie littéraire de l'engagement politique. Le thème de l'actualisation artistique de la première phase du modernisme s'étant transformé à partir de 1924, en celui de la culture nationale, l'attitude nationaliste des modernistes se déclare et se radicalise progressivement vers un engagement politique en termes de production artistique et d'activité partisane.
L'œuvre littéraire cesse de traiter littérairement la question de la brésilianité et se propose d'intervenir activement sur la réalité de la nation où elle s'inscrit. Les œuvres de
46
Plínio Salgado et d'Oswald de Andrade en sont particulièrement illustratives. Leurs manifestes, pamphlets, et témoignages ont pour objectif affirmé de transformer pratiquement et immédiatement la réalité nationale.
Si cet engagement politique peut être reconnu comme un trait commun des avant-gardes du début du siècle, il a rarement pris une telle ampleur . Dans peu d'autres pays d'Amérique Latine ou d'Europe, les avant-gardes modernisatrices se sont senties et se sont trouvées si près du pouvoir politique. Leurs carrières dans les institutions culturelles et éducatives, publiques comme privées, près des postes ministériels, leur familiarité et leur présence auprès des médias, et des centres de reconnaissance et de divulgation intellectuelle témoignent de cette proximité de fait avec le pouvoir politique. De même le front commun proposé par Plínio Salgado à la fin des années 20, alliant écrivains et politiques dans le combat nationaliste, reflète cette situation nouvelle dans l'histoire de la littérature au Brésil.
Les modernistes, s'insérant dans la société et dans l'espace politique en tant qu'intellectuels, réagissent ainsi à l'isolement vécu avant les années 20, et ont la ferme volonté de mettre la littérature au service de la récupération de la nationalité, de la transformation sociale et politique.
En s'érigeant en porte-parole de la nation, les modernistes se situent comme s'ils étaient en charge de lui donner forme et comme s'ils étaient habilités à se placer en position de pouvoir. Cette importance accordée aux écrivains et à l'intellectualité, dans la politique est due au caractère traditionnellement bureaucrate de l 'État brésilien, dont le pouvoir ne repose pas tant sur la représentativité que sur l'unité idéologique à laquelle contribue largement le modernisme, au-delà même de ses dédoublements superficiels.
Les modernistes ont d'autre part eu la capacité de percevoir et d'agir sur les
relations politiques existant à l'intérieur du système de l'art et permettant la divulgation des œuvres. Nous pouvons distinguer deux moments dans le processus historique de l'art moderne. Le premier serait celui de l'affirmation de la qualité artisanale de l'art, à l'intérieur de la société industrielle, démontrant la spécificité de son mode de production. Le second impliquerait la reconnaissance de l'œuvre d'art en tant que marchandise.
Curieusement, si en Europe, le retour à l'ordre, après la première guerre mondiale, représenta la récupération du moderne par le marché, le même dispositif acquit au Brésil, une connotation révolutionnaire. N'ayant pas de marché organisé au Brésil, l'affirmation moderniste se confronte avec les institutions culturelles dominées par l'Académie.
Ainsi, l'avant-gardiste brésilien ne conteste pas tant les langages antérieurs que la structure dans laquelle cet art est produit et divulgué. L'"institution de l'art" est contestée sur deux points principaux: comme appareil figé et comme idéologie ségrégatrice qui sépare la production artistique des pratiques quotidiennes de la vie. Exclue des circuits officiels de production et de divulgation artistiques, l'avant-garde se construit alors elle-même un système alternatif. Dépendant toujours, mais dans une moindre mesure de la reconnaissance officielle, l'imposition du modernisme sur la scène littéraire et intellectuelle se fait surtout par son articulation à la formation d'un marché intellectuel et artistique, et surtout à la constitution d'un public potentiellement beaucoup plus vaste.
Selon les analyses de Sérgio Miceli: "les possibilités d'accès au marché du travail intellectuel ne se restreignent plus aux exigences dictées par les préférences et les options des anciennes classes dirigeantes en matière d'importation culturelle. Dorénavant, le champ des institutions et des groupes dont les décisions se répercutent sur la "substitution des importations" sur le plan culturel tend à se diversifier de façon considérable, impliquant mécènes (les familles cultivées, les autorités publiques, les maisons d'édition, l'Église, les cadres (••executivos, en portugais••) et administrateurs des institutions culturelles, etc.), passant par les
47
différents types de public (les étudiants des nouveaux cours supérieurs, les participants des nouvelles carrières doctorales, etc.), par les producteurs (les romanciers professionnels, les auteurs de romans féminins, de livres infantiles, (...), jusqu'à l'impact dû à l'importation massive d'articles culturels d'origine nord-américaine, dans le cadre du marché international"1.
La lutte politique qui se noue à Rio de Janeiro pour le contrôle de l'Escola Nacional de Belas Artes, fait partie de la concurrence traditionnelle entre écoles artistiques pour acquérir une reconnaissance officielle dans les institutions pré-existantes. Mais São Paulo, moins attaché à cette lutte institutionnelle put constituer plus facilement son propre système artistique. De la Semaine d'Art Moderne, aux différents salons, jusqu'au CAM (Club des Artistes Modernes) et à la SPAM (Société Pro-Art Moderne) créés en 1932, São Paulo s'est distingué de l'attitude traditionnelle de lutte politique pour les charges culturelles qui se manifestait à Rio, en montrant une volonté de constituer un système moderne et autonome pour l'art. Cette dynamique nouvelle amènera plus tard la création d'institutions de diffusion culturelle autonomes telles que le MASP (Musée d'Art Moderne de São Paulo) et la Biennale d'Art Moderne qui durent jusqu'à aujourd'hui.
La dynamique de formation d'un marché intellectuel et littéraire est liée d'autre part à un processus caractéristique de la modernisation de la production artistique, et qui est celui de l'industrialisation et de la production en masse de la culture. L'opposition traditionnelle existant au Brésil, entre culture populaire et culture érudite, se trouve complétée d'un troisième pôle, la culture industrielle ou commerciale (qui ne se distinguera clairement, il est vrai, qu'à partir des années 50).
Représentant incontestablement la culture érudite (se définissant comme le monde de la production écrite ou d'étude) de par leur statut social et de par leur formation, les modernistes brésiliens cherchent cependant à établir des relations, des échanges, voir même une fusion entre leur production culturelle et la culture populaire (qui rassemble tout ce qui a trait à la vie du corps, du groupe, le travail manuel, les croyances religieuses...). Cela fait en effet partie de leur projet politique de constituer une culture nationale dont le caractère n'est donc plus l'universalité urbaine, mais la particularité des traditions et des pratiques rurales (caractérisées par l'oralité).
Cependant la fusion de la culture populaire avec la culture érudite est une utopie dont la réalisation n'a généralement pas été politiquement innocente. La relation culture érudite-culture populaire a en effet principalement pris la forme d'un populisme aveugle et démagogue dont la meilleure illustration est l'utilisation par le mouvement Anta des motifs populaires pour fonder sa théorie nationaliste.
L'œuvre d'art élaborée autour de motifs populaires est en effet susceptible de manipulations, et est rarement sujet dans les œuvres modernistes. Pour Alfredo Bosi, "il n'y a qu'une seule relation valable entre l'artiste cultivé et la vie populaire: la relation amoureuse"2 . Cette relation amoureuse serait caractéristique par exemple de l'œuvre de Mário de Andrade, qui, fasciné par les manifestations de la culture populaire, essayait de ne pas en faire une lecture idéologique. Dans le domaine de la musique, cette relation amoureuse est typique de la recherche artistique de Villa -Lobos.
b) Divulgation du modernisme et "substitution des importations" de biens culturels
L'irruption de la culture de masse, ou de la culture commerciale et industrielle, nous apparaît aussi comme une nouvelle forme de médiation entre culture érudite et culture populaire. La divulgation très large des modernistes, facilitée par une médiatisation intense, mais aussi par une politique éditoriale autonome, a pu avoir le sens non seulement d'assurer le statut social des écrivains (et surtout leur survie), mais
48
de répandre leur vision du monde et leur sensibilité dans un public nouveau, et beaucoup plus large. Il serait cependant faux d'affirmer qu'ils ont réussi à imprégner par ce biais les mentalités populaires, pour la simple raison que les couches moins aisées sont caractérisées par un taux d'analphabétisme élevé. Mais le public littéraire s'est quand même sensiblement élargi au cours des années 20, et encore plus pendant les années 30.
L'imposition des œuvres et d'une pensée moderniste au Brésil, par la voie mercantile et industrielle a cependant amené un effet pervers caractéristique du développement d'une pensée critique de type avant-gardiste. Il s'agit du phénomène de l'"institutionnalisation des avant-gardes" dont nous parle Adorno et qui est repris par Alfredo Bosi dans Dialética da colonização1, phénomène par lequel une pensée novatrice comme celle des modernistes, devient un langage schématique, abstrait et satisfait de soi-même.
C'est là l'un des problèmes les plus angoissants de la diffusion de la culture dans une société de consommation. La critique moderniste devient alors une marchandise dépendant d'un phénomène de mode, et qui est diluée par l'abus verbal, s'intégrant finalement dans la bonne conscience des bien-pensants... Révolutionnant incessamment ses formes de production, l'artiste fait paradoxalement son auto-portrait d'anti-bourgeois, alors que l'art et l'artiste entrent simultanément dans les flux de marchandises.
La diffusion des idées modernistes dans les milieux aisés a surtout pu être assurée
grâce à l'intense mondanité de la plupart de ces artistes. Réceptions, salons, spectacles, vernissages, concerts (souvent animés par des débats houleux) ont facilité l'omni-présence de la pensée moderniste dans les différents milieux où l'on pouvait discuter d'art et de politique.
Leur médiatisation a d'autre part été possible, non seulement grâce à leur participation dans différents quotidiens (nous en avons déjà parlé), mais aussi par leur engagement actif dans l'aire littéraire et éditoriale. Le mouvement a en effet fondé, au cours des années 20, au moins une vingtaine de revues dans tout le pays1 , qui ont atteint un public varié . Ces revues étaient destinées à divulguer les débats esthétiques et les conceptions politiques, sociales et culturelles des différentes tendances et scissions du mouvement.
Les modernistes ont même parfois ouvert des maisons d'édition, qui se sont alors spécialisées dans la publication de leurs ouvrages et d'une littérature fondamentalement orientée dans le sens de la formation du sentiment national au Brésil. C'est le cas par exemple, de l'Editora Hélios Ltda, fondée par les composants du mouvement verdeamarelo.
Les transformations du mode de production et de "consommation" littéraire au Brésil commencent avec les années 20, mais c'est une dynamique qui caractérise surtout les années 30: la forte croissance des maisons d'édition brésiliennes prend en effet tout son essor après 1930.
L'édition des livres au Brésil s'est accompagnée d'une modification du profil des maisons d'édition et de l'élargissement du public. Suivant Afrânio García Jr.1 nous pouvons dire que cela est dû en partie aux stratégies de reconversion des familles de planteurs en déclin, les conduisant à s'investir de plus en plus dans le système scolaire. L'image de marque des nouvelles maisons d'édition s'est trouvée comme liée à la reconnaissance d'une littérature nouvelle et "authentiquement nationale".
Nous assistons de 1910 à 1930, à une certaine "substitution des importations" littéraires, qui se manifeste par une baisse considérable des importation de livres de France, et en même temps, à une augmentation des publications au Brésil. À São Paulo, 900 000 exemplaires étaient produits en 1920, contre 2 110 000 en 1940.
Ce phénomène de "substitution des importations" dans le domaine éditorial est en partie dû au nationalisme ambiant, mais surtout, semblerait-il, à la chute de ressources des grands planteurs et des gros commerçants qui entraîne la baisse des pratiques
49
culturelles liées au cosmopolitisme. La constitution d'un marché éditorial au Brésil s'est d'autre part caractérisé par la fin des publications des principaux auteurs brésiliens en Europe. En effet, jusque là, les auteurs reconnus par le public érudit n'étaient pas publiés par des maisons brésiliennes, mais portugaises et surtout françaises.
Ce développement du marché éditorial au Brésil est incontestablement dû à la croissance de la scolarité au Brésil, et à la formation progressive d'un public ouvert à la production nationale. La réforme du système scolaire brésilien est en cause tout au long des années 20, et est défendue essentiellement par Fernando Azevedo. Ses projets se concrétisent en 1930 où définitivement nous assistons à une expansion et unification du système scolaire brésilien, ce qui amènera ultérieurement (et comme prévu), une reconnaissance de la littérature nationale.
La croissance du public scolaire donne une assise à la construction du marché du livre national. La dynamique établie en 1930 se renforce progressivement, et nous assistons à l'accroissement du nombre des jeunes susceptibles de lire les modernistes, ou en tout cas une forme ou une autre de "littérature nationale". De 1930 à 1960, le nombre d'étudiants en secondaire est multiplié par 14, et ceux arrivant au niveau de la licence, par 6 2.
Ce développement de la culture scolaire est interprété par Alfredo Bosi 3 comme étant un nouveau processus d'acculturation ou de colonisation des couches pauvres de la population brésilienne (Indiens, anciens esclaves noirs, métis des banlieues pauvres, sous-prolétaires, ...). Ils furent en un premier temps colonisés par la culture rustique ou éventuellement urbaine des Portugais, et par le catholicisme ritualisé des Jésuites. Ce nouveau processus culturel établi sur les bases de l'idéologie des années 20, remet en marche cette colonisation des couches pauvres de la société, par l'Etat, par l'école primaire, par l'armée, par l'industrie culturelle qui se développe et par toutes le agences d'acculturation qui vont du centre vers la périphérie.
2.3.-La découverte du Brésil
La situation sociale et stratégique des modernistes, au sein de la société des années 20 et du système de l'art qui se met en place pendant cette période, explique la mise en place d'un nouveau processus de connaissance du social au Brésil. Le refus de la décadence amène les modernistes à revaloriser la culture nationale et à redéfinir l'État grâce aux compétences "socialement rares" qu'ils possédaient. Les modernistes manifestent en effet la volonté d'asseoir leur statut social d'intellectuels au sommet de la société par uneprétention à la connaissance du Brésil, et par l'affirmation de la responsabilité qu'elle a en charge, de révéler la nation au Brésil.
Au delà des efforts pour implanter un marché culturel dans le pays et développer le système scolaire, qui donnait la possibilité de diffuser de nouveaux schèmes de pensée liés à la modernisation, la contribution spécifique des modernistes apparaît en effet pour Afrânio García Jr.1 comme la valorisation de l'image de soi par l'abandon de la question qui avait été au centre des débats intellectuels --celle de l'infériorité d'un peuple métis-- au profit d'une autre représentation, celle d'une nation jeune, marquée par un lourd passé, mais porteuse d'avenir.
Les modernistes, prétendant à la connaissance de la nationalité, vont concevoir une nouvelle vision de la nation brésilienne (que nous exposerons en troisième partie) et dont la légitimité se fondera d'une part sur l'intervention de l'étranger, et d'autre part sur la revendication des modernistes d'une "expérience" et d'une "connaissance" du Brésil profond.
2.3.1.-LE BRÉSIL DÉCOUVERT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'EUROPE
50
L'intervention de l'étranger est fondamentale dans la formation d'une image de soi et de la mise en forme des critères définissant la culture nationale "originale". Dans le cas moderniste, cette intervention de l'étranger (principalement l'Europe) se fait par le biais de voyages touristiques en Europe d'où l'on distingue mieux, soudain, les caractéristiques de la nation brésilienne. Mais l'intervention de l'étranger se joue aussi au niveau de la reconnaissance des talents nationaux et dans l'affirmation des écrivains modernistes sur la scène littéraire nationale.
a)Voyages d'étude et tourisme européen
Au début du siècle, la monnaie brésilienne étant forte grâce à l'exportation de café, et les riches fazendeiros n'hésitaient pas à voyager avec leur famille pour de longs et luxueux séjours en Europe, et notamment à Paris (dont témoignent par exemple certains écrits d'Alceu Amoroso Lima ou d'Afonso Arinos de Lima). Cette nouvelle habitude se prolonge pour les familles aisées dont sont issus une bonne part des écrivains que nous étudions, jusqu'aux années 20, et marque profondément la pensée des artistes modernistes.
La majeure partie des écrivains que nous prenons en compte dans notre propos ont effectivement réalisé des séjours prolongés en Europe, en postes diplomatiques, en tant que touristes ou en tant qu'étudiants. La comparaison avec la situation artistique européenne pendant les périodes mouvementées du modernisme a été fondamentale dans la formation d'une pensée culturelle et politique des auteurs.
Nous pouvons ici remarquer que les contacts avec l'Amérique Latine hispanophone ont été très limités, se résumant essentiellement au parcours de Ronald de Carvalho dans différents pays d'Amérique du Sud (dont témoigne son ouvrage Toda a América, 1926) et au passage de Mário de Andrade en Amazonie péruvienne (dans le cadre de ses recherches ethno-folkloristes).
Par contre, les échanges avec la culture européenne ont été beaucoup plus riches, influençant les écrivains ayant voyagé vers ce "centre" de la modernité. Le modernisme brésilien est en quelque sorte né à Paris, et a évolué pour une grande partie grâce aux réseaux existant entre Paris et São Paulo ou Rio, réseaux dont les principaux acteurs étaient Paulo Prado, Vicente do Rêgo Monteiro, et Cícero Días et les Français initiés au Brésil, Cendrars, Milhaud, Géo Charles. Les rapports mondains et diplomatiques connurent leur point fort autour de la Maison de l'Amérique Latine (inaugurée à Paris en 1923) et du comte Robert de Billy.
Ces solides réseaux se consolidèrent et intensifièrent plus tard leur activité, avec à l'UNESCO, Paulo Carneiro, Luis Heitor Correa de Azevedo et Roger Caillois. La création de l'Université de São Paulo en 1934, amena la participation active des universitaires Lévy Strauss, Braudel, Roger Bastide, Pierre Manbeig, au renouvellement de la connaissance du Brésil.
Pour avoir une idée de la proximité des avant-gardes brésiliennes et françaises, nous pouvons d'autre part citer le cas significatif de la peintre Tarsila do Amaral (dont la toile Abaporu sera prise comme emblême de la tendance anthropophagique). Cette femme qui émerge du groupe moderniste issu de Pau Brasil, a séjourné à Paris à partir de 1920, fréquenté le studio de Fernand Léger et étudié avec André Lhote, qui s'intéressait lui-même à l'art nègre et qui l'a initié à une sorte de cubisme académique. Elle a aussi fréquenté les ateliers de Picasso, de De Cherico et de Brancusi, écouté Manuel de Falla et Stravinski, dialogué avec André Breton et blaise Cendrars, dont elle a illustré Feuilles de route (1924).
51
Si la préoccupation des modernistes de connaître le Brésil trouve son origine dans une grande mesure, dans leur confrontation avec le monde extérieur, cela est dû d'une part au recul pris au cours d'un voyage, par rapport à la complexité d'une société, qui fait qu'on arrive à lui attribuer un sens unique. Mais il s'agit aussi de l'influence, de la conformation ou de la remise en cause par les modernistes des images de la nation brésilienne, déjà constituées à l'extérieur. Il est en effet plus facile de se faire une idée synthétique du Brésil et de ses caractéristiques, quand on en est loin.
La préface du mécène paulista Paulo Prado, au recueil de poèmes oswaldiens Pau-Brasil, illustre assez bien cet aspect de la constitution d'une connaissance du Brésil:
"La poésie 'pau-brasil' est l'œuf de Colomb - cet œuf, comme le disait un inventeur, ami à moi, en qui personne ne croyait, et finit par enrichir le gênois. Oswald de Andrade, lors d'un voyage à Paris, du haut d'un atelier de la Place Clichy -nombril du monde- découvrit, émerveillé, sa propre terre. Le retour à la patrie confirma, dans l'enchantement des découvertes manuelines1, la révélation surprenante que le Brésil existait. Ce fait, dont certains se doutaient déjà, ouvrit ses yeux à la vision radieuse d'un monde nouveau, inexploré et mystérieux . La poésie 'pau-brasil' était créée."2 La dédicace même de ce recueil confirme cette idée: "A Blaise Cendrars, à l'occasion de la découverte du Brésil".
Cette découverte du Brésil se fait donc de l'Europe, mais aussi à travers le regard des E uropéens eux-mêmes. L'un des souvenirs marquants du critique, peintre et mémorialiste Sérgio Milliet ("Serge Milliet" quand il était de passage en France), était d'avoir retrouvé son pays en 1921, à travers une œuvre française:
"(...) en entrant légèrement en retard au théâtre des Champs Elysées de Paris pour voir et écouter L'homme et son désir de Claudel et Milhaud, j'ai eu la chair de poule parce que quatre-vingt voix masculines scandaient ‘O meu boi morreu’. Il y avait 3 ans que je n'avais pas eu de nouvelles du Brésil et cette mélodie me transporta un instant vers un sertão mystérieux que j'avais connu alors que je voulais tout oublier et qui me rappelait les longues journées de cheval à travers les montagnes du Minas Gerais, de Campanha à Paredes, Machadinho, Ouro Fala, São Gonçalo do Sapucai et les autres petites villes aux noms sonores"4.
La fondation d'un art national et d'une culture nationale, se fait donc à partir de l'expérience et du contact avec les milieux avancés européens. La fondation moderniste de la culture nationale se fait du point de vue du découvreur, et c'est dans cette perspective que l'on va explorer le monde "nouveau" et "mystérieux".
La formation de la pensée des grands penseurs de la société brésilienne, profondément marqués par le modernisme -- Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, et Caio Prado Jr. -- se fit elle aussi au cours des années 20, dans des universités européennes ou nord-américaines (dans le cas de Gilberto Freyre). Et c'est de ce contact avec l'Autre (du point de vue culturel) que naît une réflexion approfondie sur les particularités nationales.
b) Intervention étrangère dans la reconnaissance de talents nationaux
Mais l'Europe n'est pas seulement un lieu de prise de conscience de l'identité brésilienne pour de nombreux artistes. Elle joue un rôle éminent dans la reconnaissance des talents brésiliens. La constitution d'une image de soi, même quand il s'agit d'une image collective, d'une identité, fonctionne tant au niveau de la connaissance de soi que de la reconnaissance d'autrui.
C'est un processus qui a été mis en évidence par exemple, pour la Samba1 ou encore le football et plus récemment la Lambada, qui sont des phénomènes culturels momentanément discriminés en tant que culture populaire, ou culture ethnique, et qui passent au statut de symbole national. Cette transformation se fait bien sûr par la
52
reconnaissance ou par la récupération politique, mais aussi par le jeu de miroir qui s'établit entre deux cultures. Dans notre cas, cette relation se construit entre le Brésil et l'Europe, ou du moins entre les avant-gardes de ces deux aires culturelles.
La preuve en est qu'un des grands pas de l'histoire du modernisme a été franchi, à partir de la reconnaissance du sculpteur Vítor Brecheret à Paris. En effet, découvert quelque temps auparavant par le groupe futuriste paulista, il gagne le premier prix au salon d'automne, en novembre 1920, pour son Temple de ma race. Ce n'est qu'avec cette victoire que les futuristes brésiliens purent critiquer l'archaïsme des manifestations passéistes, et obtenir une certaine légitimité face au public de l'élite. C'est en tout cas ce qu'en conclut Menotti del Picchia (sous le pseudonyne de Hélios) dans un article du Correio Paulistano, "le baptême de la gloire, impartial, étranger, a été la sentence qui a donné gain de cause à la cohorte futuriste de São Paulo"2 .
Plus tard, à l'occasion de la conférence d'Oswald de Andrade à la Sorbonne, en 1923, ce phénomène se répète. L'affirmation et la reconnaissance sur le vieux continent est accueillie par les modernistes comme une véritable victoire. Rubens Borba de Moraes communique ce succès dans une lettre à Joaquim Inojosa: "Sais-tu qu'Oswald a fait à la Sorbonne une conférence sur nous? Sérgio m'a écrit en racontant qu'à Paris notre mouvement a suscité le plus vif intérêt. Ivan Goll, qui a publié l'année dernière une antologie mondiale où tous les modernes des 'Cinq Continents' (c'est le titre du volume) sont réunis, va rajouter un apendice consacré à la poésie brésilienne moderne"3.
De même, l'ambition moderniste étant à partir du Manifesto da Poesía-Pau Brasil, de créer une culture d'exportation, le parrainage de l'exposition de peinture de Tarsila do Amaral par Blaise Cendrars apparaît comme une reconnaissance de la qualité de la production brésilienne, selon les critères modernes. Cendrars présentera d'autre part la traduction du premier roman de José Lins do Rêgo O Menino do Engenho (en français L'enfant de la Plantation).
Cet ensemble de succès est vu comme un argument de plus pour la défense des modernistes dans les débats esthétiques, car la reconnaissance des milieux européens "avancés" est une garantie face au public et aux détracteurs.
c) Réactions anti-exotiques chez certains écrivains
Le modernisme brésilien donc, malgré sa réelle volonté d'autonomie et de découverte du Brésil, a toujours tendance à adopter une attitude influencée, voire même soumise aux critères européens. Le modernisme de la Semaine de 22, surtout, celui de Klaxon et de Paulicéia Desvairada, défendant ainsi l'absorption des formules de modernité présentes dans les centres les plus "avancés" dans la production culturelle. Paris, principalement, fonctionnait comme référentiel pour le mouvement. L'ordre moderne, prétendaient-ils, peut s'implanter indisctinctement n'importe où, et l'intégration du Brésil dans le monde moderne supposait de suivre le chemin tracé par d'autres nations.
Mais la problématique de la brésilianité au sein du modernisme, paraît au bout d'un certain temps pour quelques écrivains, être une question plus satisfaisante pour intégrer la modernité. Ainsi l'approche du Brésil d'un point de vue extérieur, que nous avons décrite ici, concerne surtout, même si cela marquera la postérité du mouvement, la première phase du modernisme, qui va comme nous l'avons déjà vu, jusqu'en 1924.
Cette brésilianité "exotique" est très rapidement remise en cause par Mário de Andrade. Dans une lettre à Tarsila do Amaral, il expose sa conception de la découverte de la brésilianité, et sa critique aigüe de l'exotisme pratiqué par les futuristes envers leur propre pays, tout en reconnaissant son vif intérêt pour connaître l'Europe:
"Attention! Renforcez-vous bien de théories et d'excuses et de choses vues à Paris. Quand vous arriverez, nous aurons certainement une dispute. Je vous défie d'ors et dèjà tous, Tarsila, Oswald, Sérgio pour
53
une discussion formidable. Vous êtes allés à Paris comme des bourgeois. Vous êtes épatés (••en français dans le texte••). Et êtes devenus futuristes! hi! hi! hi! Je pleure de jalousie. Mais il est vrai que je vous considère tous comme des paysans à Paris. Vous vous êtes parisianisés à l'épiderme. C'est horrible! Tarsila, Tarsila, reviens en toi-même. Abandonne le Gris et le Lhote, entrepreneurs de critiques décrépies et d'esthésie décadente! Abandonne Paris! Tarsila! Tarsila! Viens à la forêt vierge, où il n'y a pas d'art noir, où il n'y a pas non plus de gentils ruisseaux. Il y a de la FORÊT VIERGE. J'ai créé le forêtviergisme1. Je suis forêtviergiste. C'est de ça que le monde, l'art, le Brésil et ma chère Tarsila ont besoin."2
Cette opinion est confirmée par Macunaíma, le héros de sa "rhapsodie" à qui il fait dire: "(...) Patience mes frères! non! je refuse d'aller en Europe. Je suis américain et ma place est en Amérique. La civilisation européenne briserait sûrement l'intégrité de notre caractère. (...)" 3
Il exprime ainsi son choix, certes contraint par sa condition financière (qui l'empêchait d'effectuer des voyages en Europe), pour une conception de la modernisation à partir des particularités de la réalité de la nation.
L'influence de Paris est parfois vue avec un certain recul, par d'autres auteurs modernistes, parmi lesquels se détache Antônio Alcântara Machado. Ce dernier, en voyage en Europe en 1925, renverse le point de vue dominant jusque là, en brossant à l'aide de son regard narquois quelques scènes parisiennes incongrues (il décrit notamment des bals populaires, le langage de la rue et les cris des boulangères...). Alcântara Machado fait le choix de démythifier Paris par des récits iconoclastes dans lesquels il livre des réflexions savoureuses et agacées sur l'éblouissement de ses compatriotes qui débarquent à Paris.
Certains Français même réagissent négativement à cette attitude des Brésiliens à Paris. Abel Bonnard raconte dans Océan et Brésil, qu' "[ils] nous montrent les trésors de leur sol et nous demandent ceux de notre culture. Cela rappelle la franchise et la naïveté des anciens échanges: ils nous offrent des papillons et nous demandent des idées"1. Irrité, Alcântara Machado commente: "on a besoin de se contenir pour ne pas lâcher un gros mot."
Cette critique de la vision exotique et "fausse" du Brésil se manifeste surtout à travers la scission qui oppose à partir de 1924 le mouvement issu du Manifesto da Poesía Pau-Brasil, et les verde-amarelos. Ces derniers voient la découverte du Brésil de l'Europe comme une continuation de l'aliénation traditionnelle des élites érudites à la culture européenne, et comme le signe de la dépendance et du manque d'originalité de ces auteurs "bourgeois".
2.3.2.-EXPLORER LE BRÉSIL
Sur la base de cette critique de l'exotisme vécu par les modernistes envers leur propre patrie, mais aussi sur la base de l'émergence de la question de la brésilianité au sein des débats modernistes, la perspective de découverte du Brésil est complétée chez nos auteurs, par une volonté d'explorer le Brésil, pour le connaître, par delà les images et les préjugés. Cette nouvelle attitude envers le pays fait que les modernistes entreprennent un certain nombre de démarches qui transforment en profondeur le contenu et la forme de leur littérature. En effet, la volonté d'explorer le Brésil sera réalisée à travers les expériences personnelles des auteurs, mais se caractérisera surtout par un regain d'intérêt pour la culture populaire et régionale, comme un attrait nouveau envers les sciences sociales.
54
a) L'expérience du Brésil
Comme nous l'avons vu en première partie, à partir d'un certain moment, la problématique de la modernité dans la littérature brésilienne, change d'orientation et se transpose sur la question de la brésilianité. L'identité brésilienne ayant été auparavant découverte "du haut d'un atelier de la place de Clichy", les modernistes (surtout de la tendance du verdeamarelismo) ne se satisfont pas de cette définition, et prétendent, pour pouvoir révéler la véritable identité nationale aux Brésiliens et faire accéder le Brésil à la modernité, connaître le Brésil et sa profonde originalité.
Cette démarche, défendue précocement par Mário de Andrade, se répandra, et à partir de 1924, l'exploration du Brésil et de ses richesses est entreprise.
Il est vrai que les modernistes (surtout les "cousins pauvres"), ont parfois eu l'occasion, par leur parcours individuel, d'être confrontés au "vrai" Brésil. Ce n'est pas celui de l'élite européanisée, mais celui des couches populaires et de la culture rurale ou des banlieues pauvres. Plínio Salgado, par exemple, est né dans une petite ville de São Paulo. Son père étant mort prématurément, il a connu la vie quotidienne et difficile de la petite bourgeoisie et des classes populaires. D'autre part, José Lins do Rêgo naît, lui, dans l'Engenho1 Corredor, dans la campagne profonde de l'Etat de Paraíba.
Graça Aranha et Ronald de Cravalho ont eux aussi connu momentanément le Brésil profond que l'on avait tendance à oublier dans la littérature brésilienne. Ils ont en effet réalisé une partie de leur cursus professionnel dans des régions reculées.
Le fait d'avoir eu l'expérience de ces "racines", et une certaine proximité avec les couches populaires (même si ce n'est que par le biais de la petite bourgeoisie urbaine ou de l'oligarchie rurale en déclin) a été pour ces auteurs un argument de plus pour défendre leur prétention à la connaissance du Brésil. Cette expérience du Brésil marque souvent leur œuvres: Graça Aranha 2 et José Lins do Rêgo3 expriment cette expérience dans des romans indirectement autobiographiques, les utilisant aussi pour exposer des questions sociales et culturelles d'actualité (le problème de l'immigration européenne au Brésil, au début du siècle, ou celui du fléchissement des familles rurales face à la concurrence des exploitations semi-industrielles de canne à sucre, les usinas).
La quête de la modernité n'est donc plus celle de l'urbanité cosmopolite, mais est envisagée sous l'angle de la découverte des racines profondes qui font l'originalité de la culture et de la nation brésilienne. Les thèmes de la ruralité envahissent à nouveau la production littéraire (reprenant par là des sujets abandonnés depuis le romantisme) autant par le biais de l'indianisme que du régionalisme. Les racines de la nation, comme nous le verrons plus loin sont souvent vues (même si ce n'est que symboliquement) comme étant des racines indigènes, provenant principalement de l'ethnie tupi. D'autres conçoivent ces racines à travers le processus de colonisation portugaise, et les formes de sociabilité héritées de cette époque.
Qu'elle soit conçue à travers l'esprit indigène ou à travers la culture des fazendas*, la particularité brésilienne est donc recherchée dans les différentes sociétés rurales ayant vécu sur le territoire brésilien. Anxieux de réhabiliter des valeurs proprement américaines, la nature grandiose, l'extrême richesse des cultures régionales et indiennes, les modernistes nés dans les grandes villes du littoral (donc symboliquement ouvertes à la culture internationale) entreprennent ainsi d'aller voir de plus près ce Brésil mystérieux, de découvrir son essence, son intérieur profond.
C'est donc à partir des dédoublements de 1924 que s'effectue le revirement moderniste, passant d'une conception citadine de la modernité (incarnée par le modèle cosmopolite de la ville de São Paulo), à une conception plus tournée vers la culture de l'"intérieur", dans le sens de la province, de la ruralité traditionnelle, de la brésilianité profonde.
55
Pour les verdeamarelos, le symbole de la Brésilianité n'est plus la ville de São Paulo, mais est incarnée par l'État de São Paulo, qui, par le caractère même de sa géographie exprime le bandeirantismo national. Ainsi, le fait que les rivières paulistanas ne soient pas tournées vers la mer (ouvertes à l'Europe), mais vers l'intérieur de l'État, est pris comme un véritable signe du rôle unificateur de São Paulo.
En 1924, à l'occasion de la venue de Blaise Cendrars au Brésil1 , les artistes modernistes projettent un voyage touristique de découverte, ayant essentiellement pour objectif l'Etat de Minas Gerais. C'est au cours de ce voyage qu'est revalorisé pour la première fois tout le patrimoine colonial méprisé depuis l'indépendance, et qui trouve son expression la plus resplandissante dans les églises baroques, ou encore la statuaire de O Aleijadinho .
Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Paulo Prado et peut-être même Mário de Andrade (je n'ai mlaheureusement pas réussi a en avoir la confirmation dans les ouvrages consultés) participent à ce voyage, qui sera un véritable émerveillement pour les modernistes. Découvrant la richesse et la force des manifestations culturelles du Minas Gerais, ils inaugurent leur lutte pour la défense du patrimoine brésilien, lutte dont le couronnement sera la création en 1937 par Mário de Andrade du Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, premier organisme public de défense du patrimoine brésilien. Les modernistes se trouveront au cours des années 30, et pendant le régime autoritaire-nationaliste de l'Estado Novo, au centre de la conception des politiques culturelles et patrimoniales.
La découverte du Brésil profond se transforme donc en exploration de sa ruralité et de l'histoire de sa société, dans la perspective de valoriser (et non plus un dénigrement catégorique) le passé artistique et culturel, ce que l'on pouvait concevoir comme les "racines du Brésil" (selon le titre de l'ouvrage de Sérgio Buarque de Hollanda, Raízes do Brasil).
Fin 1927 début 1928, Mário de Andrade parcourt le Nord du Brésil et l'Amazonie, poussant son périple jusqu'au Pérou. Ce voyage qu'il aura lui même caractérisé comme un "voyage ethnographique" 2 suit encore cette volonté de découvrir l'interior* du Brésil. Mais Mário ne se laisse pas avoir au jeu de l'exotisme, et sa conception du voyage n'est autre que celle du touriste émerveillé par la magie de la culture populaire. D'ailleurs, ce voyage de 1927 n'était pas ouvertement touristique: il s'agissait plus pour lui, de faire une série de conférences dans les grandes villes du Nord (Recife, Fortaleza, São Luiz do Maranhão) et de réaliser des prospections ethno-musicologiques.
b)Nouvelles démarches littéraires: le régionalisme
La préoccupation pour la valorisation des traditions culturelles et folkloriques brésiliennes est caractéristique de la prise de position moderniste après 1924. Les récupérer signifie construire l'identité brésilienne, sans laquelle il serait impossible pour le pays d'affirmer son autonomie dans le panorama international. La production artistique moderniste va alors s'appuyer sur la découverte du Brésil, prenant un ton particulier avec le régionalisme, qui est une tendance du modernisme, mais qui se présente comme en étant une alternative.
Gilberto Freyre conçoit une nouvelle approche de la nation et de la société brésilienne, par la valorisation des cultures régionales, de leurs valeurs, leurs traditions, leur créativité. Le Manifeste régionaliste de Recife 1 (dans l'Etat de Pernambuco) lu à l'occasion du Premier Congrès Brésilien de Régionalisme qui eut lieu pendant le mois de février 1926 en est la première expression publique.
Le jeune Gilberto Freyre revenait alors à peine de ses études à New York, et d'un voyage en Europe (au cours duquel il visita Paris, Berlin, Munich, Londres, Oxford, et Lisbonne), qui avait largement influencé la formation de sa pensée sociale.
56
Le mouvement naissant, qui se définissait comme "Régionaliste, traditionnaliste, et moderniste à sa manière" se donnait pour objectif de mettre en relief et de valoriser l'esprit créateur de la culture régionale brésilienne, prise dans le sens anthropologique (c'est-à-dire l'ensemble des façons d'être, de vivre, de penser et de parler caractéristiques de la population d'une région) et s'exprimant à travers les traditions rurales, le folklore, la peinture, le dessin, la musique, la littérature. La valorisation de cette culture est le but premier de la littérature et de l'art régionaliste. C'est dans cette perspective que développent leur création artistique à partir de la fin des années 20, des poètes comme Afonso Ferreira ou Manuel Bandeira, des peintres comme Rêgo Monteiro, Luís Soares, mais aussi des critiques comme Olívio Montenegro, ou des psychologues comme Sylvio Rabelo.
A Bagaceira 2 , de José Américo de Almeida3 est publiée en 1928 et inaugure ce que la critique littéraire aura baptisé comme le "cycle de la canne-à-sucre" du roman régionaliste nordestin. Les romans sociaux de José Lins do Rêgo qui sont écrits à partir de la fin des années 20, et sont publiés à partir de 1932 (avec Menino do Engenho), sont l'une des plus fameuses expressions de ce cycle, et cherchent à mettre en relief d'une part les difficultés sociales des classes populaires rurales, mais aussi l'extrême richesse de ses manifestations culturelles .
Mais ce qui nous intéresse ici est de montrer comment ce mouvement, il est vrai, relativement particulier et atypique dans l'histoire du modernisme, a ouvert les préoccupations artistiques des écrivains à des questions sociales et politiques beaucoup plus larges et, en quelque sorte, beaucoup moins théoriques que celles développées par les autres tendances.
En effet, du mouvement de Recife de 1926 naît par exemple le Premier Congrès Afro-Brésilien (réalisé en 1934), et les préoccupations des régionalistes englobent autant la mise en forme d'expressions artistiques érudites (peinture, littérature, musique) enracinées dans la culture régionale, que les pratiques culturelles comme l'art ou la science culinaire héritée de traditions culturelles très différentes (la cuisine du nordeste est beaucoup plus influencée par la culture africaine que dans les régions du Sud).
Le régionalisme représente, enfin, l'application de méthodes d'analyse révolutionnaires, au Brésil véhiculées dans les cours de Sociologie de Gilberto Freyre (présentée comme science sociale, mais aussi écologique) et concrétisée dans l'ouvrage Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre (qui sera publié en 1936).
La littérature régionaliste apparaît alors comme une variante du modernisme, dans laquelle on cherche à dépasser les valeurs aristocratiques et élitistes qui mettaient l'accent sur la modernité conçue comme universalité, et surtout adéquation à des modèles européens. La volonté régionaliste était avant tout de reconnaître, et de réutiliser le matériel régional témoin de la spécificité de l'expression créative brésilienne. Le régionalisme protestait ainsi contre l'homogénéisation, critiquait le style de vie citadin et occidentalisé, et entendait établir une vision brésilienne des réalités culturelles spécifiquement nationales (révélée par les particularités régionales).
L'idée régionaliste ne s'est cependant pas confinée au Nordeste brésilien, et trouve son expression dans d'autres régions avec des auteurs modernistes que nous avons déjà rencontrés. Ainsi Alcântara Machado et Cassiano Ricardo effectuent des études romancées sur le Banderismo, c'est-à-dire l'esprit de conquête des terres de l'intérieur. Sérgio Milliet, Paulo Prado et Afonso de Taunay effectuent eux, des études sur la région de production du café.
Tous ces ouvrages sont perçus jusqu'à nos jours comme un tout, participant à l'enrichissement de la connaissance du Brésil, de sa diversité, comme de son "admirable unité politique, sociale et, en grande partie aussi, culturelle (...)"1.
57
Ce qui fait la particularité de ce mouvement est incontestablement son effort de rénovation culturelle plus endogène qu'exogène. Nous ne pouvons cependant pas nier, comme pour le reste du modernisme, un certaine inspiration étrangère, provenant surtout de l'irlandisme de William Butter Yeats, de la "New poetey", la "New History" et les nouveaux courants anthropologiques américains (représentés par la figure de Franz Boas). Gilberto Freyre étant lui-même en voyage d'études en Amérique du Nord et en Europe jusqu'en 1923, témoigne de ses lectures dans son journal personnel publié en 1975 sous le titreTempo morto e outros tempos, (temps morts et autres temps)1. Des auteurs comme Yeats, disions-nous, mais aussi comme Geddes, Le Play, Mistral et Maurras semblent avoir marqué la formation de sa pensée régionaliste.
Nous pouvons aussi retrouver une dynamique endogène très ressemblante dans le régionalisme français de la fin du XIXe siècle2 profondément marqué par l'œuvre d'Emile Verhæren, et notamment ses ouvrages Campagnes Hallucinées (1893) et Les villages illusoires. Le "réveil des provinces" françaises à la fin du XIXe siècle, s'il est négligé aujourd'hui dans les manuels scolaires, représente à l'époque des milliers d'auteurs actifs tant au niveau de la presse que de l'édition locale.
Ces courants littéraires européens et brésiliens se caractérisent par leurs revendications autant sur la scène politique qu'artistique, dans un contexte où un champ intellectuel autonome est encore en pleine formation. Et s'il est vrai, comme le note Anne-Marie Thiesse, que l'on ne peut pas confondre régionalisme et nationalisme, on ne peut pas non plus les opposer. Le parcours sociologique des régionalistes brésiliens est similaire à ceux des autres courants modernistes des années 20: ils font aussi partie de la jeunesse instruite des provinces qui tente de subvertir la hiérarchie du champ littéraire et d'exprimer ses inquiétudes par rapport aux changements induits par la modernité, dans le monde social. Ce sont des bacheliers et des diplômés de l'enseignement supérieur, soucieux de prendre place dans la société et confrontés à la nécessité d'inventer ou d'imposer leurs positions et leurs carrières. Cela se manifeste donc par les thèmes caractéristiques du modernisme, où l'on mêle l'action, l'énergie et la jeunesse, à la volonté de reconnaissance nationale.
Etroitement impliqués au niveau idéologique avec le tronc commun du modernisme, ils ont joué un rôle fondamental dans la constitution de l'identité régionale et nationale brésilienne, par la formation de ces images régionales qui fondent aujourd'hui la vision que l'on se fait des différents Etats brésiliens, de leurs campagnes, de leurs caractéristiques propres et de leur relation à la nationalité.
c) Folklorisme et Sciences Sociales
La dynamique du régionalisme ne se confond pas avec celle du roman populaire, et correspond à la constitution d'un "contre-champ littéraire" qui établit de nouvelles thématiques. Le régionalisme se rapproche ainsi par sa défense d'un "art social", de ce qui caractérise le reste du modernisme.
Il est d'autre part intéressant d'établir le parallèle entre le développement du folk-lorisme et l'ethnographie, incontestablement impliqués dans la formation d'une vision nouvelle du Brésil. Le modernisme à partir d'un certain moment, mais surtout le régionalisme, fondent leur production littéraire sur une exploration scientifique ethno-anthropologique de la société et du folklore brésilien.
Nous assistons avec les années 20 à la création d'un réseau universitaire et à une multiplication de la production en sciences sociales. En 1920 se fonde l'Université de Rio de Janeiro, première université brésilienne. Mais les modernistes anticipent surtout un mouvement qui va caractériser les années 30, période pendant laquelle les sciences sociales prennent une dimension nettement plus vaste dans le domaine de la valorisation de la culture nationale. La création en 1934 de l'Université de São Paulo (USP) et en 1937 de l'Université du Brésil sont autrement significatives. Le Brésil et la nationalité
58
deviennent des objets d'étude récurrents avec la création, au sein de L'USP, d'un Institut d'Étude Brésiliennes (IEB) qui contribue à constituer une catégorie particulière dans les sciences sociales: les "Etudes Brésiliennes" qui participent autant à la constitution d'une vision scientifique de la particularité culturelle brésilienne, qu'à l'attribution aux modernistes d'un rôle central dans la formation de l'identité nationale.
Les sciences ne pouvaient pas être absente de la genèse d'une nouvelle vision politique du Brésil. Malgré le refus par la majorité des écrivains modernistes, du rationnalisme froid et européen auquel on a opposé à partir de 1924 la sentimentalité et la spontanéité du caractère brésilien, la science a joué un rôle important dans l'imagination politique du Brésil. En effet, l'intellectualité brésilienne, au-delà des modernistes, est imbibée de scientisme comtien, et l'imposition d'une vision légitime dans le champ intellectuel ne pouvait que passer par l'argumentation scientifico-rationnelle. D'où l'importance attribuée par la plupart des modernistes aux écrits anthropologiques sur le Brésil, au folklore vu comme science, à l'ethnologie, à la sociologie ...
L'apport des sciences sociales au modernisme s'exprime donc dans leurs propos politiques, mais est aussi présent dans l'œuvre littéraire. Les sciences sociales, principalement l'ethnologie et la sociologie, sont des pratiques des modernistes pour réfléchir et argumenter leur conception de la culture et de la société brésilienne, mais servent aussi à documenter leur œuvres littéraires ayant pour cadre le Brésil rural, ou indien.
Mário de Andrade est la figure la plus marquée par cet intérêt pour les sciences sociales. Pour lui, "la sociologie est l'art de sauver rapidement le Brésil"1 . Etant donnée son origine sociale, Mário de Andrade cherche à fonder sa position d'intellectuel, par l'extension de ses domaines de connaissance. Pendant que d'autres font des voyages successifs en Europe, Mário approfondit son érudition par des voyages d'études et des recherches à l'intérieur du pays, profitant du matériel collecté pour diversifier ses domaines de production intellectuelle, ou alors, les utilisant pour sa production littéraire, comme par exemple, dans le cas de Macunaíma (1928), qu'il revoit au retour de son voyage en Amazonie (1927).
En 1928, il publie aussi Ensaio sobre Música Brasileira, toujours produit à partir des matériaux musicaux collectés pendant ses voyages. Dans cet ouvrage, il cherche une définition des "critères de musique brésilienne pour l'actualité", ce qui implique le projet de nationaliser les manifestations culturelles locales. Plus tard, il publie d'autres études sur le folklore, les arts plastiques et d'innombrables études sur le thème de la musique.
L'ethnologie joue un rôle essentiel dans les œuvres de nombreux modernistes , et principalement dans celles qui prennent comme toile de fond le Brésil rural des plantations et surtout, celles qui prennent pour héros des Indiens ou des personnages populaires. Les différentes épopées et rhapsodies indigénistes ou inspirées de la culture populaire utilisent largement un matériel collecté dans des ouvrages de type ethnologique ou folkloriste. C'est par exemple le cas de Macunaíma de Mário de Andrade 1 , mais aussi de Juca Mulato2 , de Martim Cererê3 ou de Cobra Norato4. Dans ces ouvrages sont mis en scène de nombreux éléments de la culture "nationale" brésilienne, parmi lesquels se distinguent la mythologie indigène (majoritairement de l'ethnie tupi) et populaire. Contes, légendes et personnages mythiques sont amalgamés dans des récits héroïques qui prennent pour cadre le "Brésil profond", sauvage ou du moins rural.
L'apport de l'ethnologie est fondamental pour la documentation de ces textes qui prouvent la vaste érudition des modernistes dans ces domaines. Le folklorisme participe lui aussi dans une grande mesure à la confection de la pensée et des œuvres modernistes. Le refus de la culture érudite, "européanisée" les fait se tourner vers la culture populaire, véritable témoin de l'originalité du caractère et de la richesse de la culture nationale.
59
Cet intérêt pour la culture tradititonnelle des couches sociales les plus pauvres est dans une large mesure représenté par le régionalisme. Mais cette tendance est présente dans les différents courants du modernisme. La Revista de Antropofagía a par exemple publié plusieurs chansons populaires et études folkloristes. La réflexion et l'argumentation de ses membres puisait largement dans les images populaires ou les récits "pré-ethnologiques" des voyageurs européens au Brésil5.
"Le folklore touche à la linguistique, à l'étude de la musique et des arts décoratifs. Il comprend cérémonies, jeux, danses..., la maison et la vie domestique, le costume, les outils, (...)."6.
Le folklorisme naît à la fin du XIXe siècle en France (avec Sainte Beuve), et trouvera au Brésil sa plus ferme expression avec la personnalité de Florestan Fernandes, qui écrit après la période que nous étudions.
L'engouement des modernistes pour le folklorisme est dû à leur volonté de connaître ou du moins d'argumenter leur conception des fondements sociaux et culturels de la nation brésilienne, et par la volonté de révéler son antériorité. Le folklore permet en effet de connaître 'les institutions créées par le peuple, ou survivant de périodes anciennes"7 et comme le dit Van Gennep, "la manière de sentir et de s'exprimer qui différencierait le populaire du supérieur"8. Le folkore est une survivance d'un passé oublié.
L'attrait du folklore, dans la perspective d'un modernisme nationaliste, est qu'il est aussi une façon de mettre en scène la communion nationale, car tout fait de folklore est collectif. Son caractère sociologique exclut tout usage individuel. Le folklore est associé à l'idée d'oralité, de transmission orale, de l'anonymat, et trouve souvent une mythologies à sa base, mythologie qui sera récupérée dans les récits "brésiliens" ou du moins "brésilianistes" des écrivains modernistes.
Mais la relation des modernistes avec les sciences sociales ne se limite pas à une illustration de leurs propos par une pensée scientifique ou par la récupération d'éléments d'érudition extraits de propos scientifiques. La pensée politique moderniste des années 20 inaugure en quelque sorte une nouvelle tradition scientifique au Brésil, dont l'expression la plus marquante a été sans aucun doute ce que le critique littéraire Antônio Candido a considéré1 comme la trilogie des nouvelles sciences sociales au Brésil. Cette trilogie est constituée de Casa Grande e Senzala2 de Gilberto Freyre, de Raízes do Brasil3 de Sérgio Buarque de Holanda et de Formação do Brasil Contemporâneo 4 , de Caio Prado Júnior.
Ces trois auteurs ont en effet amené dans leur réflexion scientifique les éléments d'une vision du Brésil qui rentrait en adéquation avec la volonté moderniste et régionaliste de redécouverte de la brésilianité et du caractère brésilien, critiquant le préjugé de race, la valorisation des influences africaines, les fondements "patriarcaux" et agraires du pouvoir, et la démystification de la rhétorique libérale. Ces œuvres ont cependant été vivement critiquées par les modernistes les plus à droite de la tendance verdeamarela, puis intégraliste, qui étaient, eux, en faveur du renforcement du pouvoir autoritaire.
Les modifications des structures de pouvoir au Brésil, et la nécessité pour les modernistes de légitimer leur rôle dans la société a donc amené une transformation profonde du statut de la littérature et de ses limites. Avec le modernisme, la littérature s'ouvre d'une part aux question politiques, et englobe dans les questions soulevées par la brésilianité, des pratiques qui ne lui étaient pas associées jusque là (principalement les sciences sociales).
Le parcours des modernistes au cours des années 20, leur vécu tant sur le plan politique que sur celui de l'intellectualité ou des pratiques sociales quotidiennes montre bien l'intérêt de ces écrivains à prendre une position politique dépassant le simple enga-
60
gement rhétorique. Ce parcours nous permettra d'autre part de mettre en valeur la teneur politique impliquée dans les textes modernistes, et les outils dont leurs auteurs ont disposé pour formuler un imaginaire politique correspondant autant à leurs besoins qu'à ceux du renouvellement de la classe dirigeante au Brésil.
L'exposition que nous avons faite du contexte et des conditions dans lesquels s'est produite l'œuvre moderniste nous permet à présent de mieux comprendre comment se structure la pensée politique moderniste ou du moins quel sens elle a pu revêtir pour eux.
61
Troisième partie
Le Brésil :Démarche imaginaire et démarche constructive
Au-delà de l'appréciation sociologique du sens qu'a pu prendre la relation entre les modernistes et la politique, une question fondamentale de l'étude de l'implication politique des modernistes, est de savoir s'il ont pu réellement transformer idéologiquement et politiquement l'art brésilien, dans le sens de son insertion dans la modernité.
Ils purent effectivement, comme nous l'avons montré précédamment, percevoir et agir sur les relations politiques existant à l'intérieur du système de l'art et permettant la divulgation de leurs œuvres et de leur pensée.
L'accès des modernistes au statut d'intellectuels, et leurs relations étroites avec le pouvoir donne d'autre part toute sa force à leur pensée politique, et montre qu'ils ont effectivement produit une œuvre signifiante par elle-même, une pensée visuelle ne pouvant être réduite à l'illustration d'un discours, rompant toute relation avec la conception illusionniste de la représentation.
Cette troisième partie va effectuer une relecture du modernisme à partir de l'étude de ses différentes motivations politiques. Nous chercherons à étudier d'une part le tronc commun de leur imaginaire politique, ses structures fondamentales et les dédoublements de la rhétorique nationaliste moderniste. Ces structures fondamentales apparaissent majoritairement sous la forme de structures cognitives récurrentes dans leur discours qui s'agencent originalement en ce que nous pouvons appeler des "mythes nouveaux", mais qui, pour l'essentiel, reprennent des éléments idéologiques hérités de l'histoire de la pensée politique.
Nous chercherons d'autre part, mais sans prétendre à une exhaustivité qui n'aurait pas sa place dans notre propos, à mettre en valeur les filiations existantes entre le discours moderniste, et les différentes expressions du nationalisme au Brésil, avant les années 20.
Les mythes sont des structures cognitives, parfois inconscientes, mais faisant toujours preuve de constance, de continuité dans le discours. Ce sont, selon Gilbert Durand "un élément directeur"1 du discours et de l'action.
Les structures mythiques sont présentes à plusieurs niveaux des propos modernistes: elles peuvent être d'abord, un instrument rhétorique pour fonder et surtout illustrer leurs propos nationalistes. C'est en tout cas comme cela que nous interprétons la récupération et l'utilisation de nombreux contes, légendes et rites indiens ou populaires, dans les textes que nous avons présentés.
Nous rencontrons, d'autre part, les structures mythiques dans un certain nombre de récits originaux, vus comme fondateurs, et qui prennent la forme de légendes recyclées ou inventées, de contes épiques, de rhapsodies, ou de poésies. C'est le cas de Macunaíma (Mário de Andrade), Cobra Norato (Raúl Bopp) et Martim Cererê (de Cassiano Ricardo), qui sont tous contemporains de la phase anthropophagique du modernisme.
Enfin, la troisième forme de présence mythique dans le discours moderniste se manifeste très indirectement et, perdant les caractéristiques du récit, ne s'identifie au mythe que par la présence récurrente d'images ou de propos dans la mise en rapport
62
d'éléments explicatifs. Ce sont ses fondements cognitifs inconscients du modernisme, qui expliquent notament leur conception de la nation ou de l'action, et qui permettent surtout de donner une cohérence et un sens aux représentations, à l'intérieur de leur vision du monde.
La structuration et l'argumentation de la rhétorique nationaliste des modernistes donne un fondement idéologique, ainsi qu'une légitimité aux motivations sociales et aux implications politiques des écrivains modernistes, que nous avons étudiés en première partie. La dynamique de formation de ces motivations politiques, est complexe, et associe comme nous l'avons vu, le problème de la reconversion de élites issues du système oligarchique rural, à celui la formation d'un marché culturel interne, à l'évolution du statut de l'art dans la société brésilienne, et à l'interférence de la culture internationale dans la nouvelle approche de la "culture nationale".
L'étude des représentations et des structures mythiques du discours moderniste nous permettrait de mieux comprendre le fondement idéologique et le sens qu'ont pu revêtir un certain nombre de pratiques nationalistes pendant l'Estado Novo. Les modernistes, assumant leur statut intellectuel ont en effet contribué pour une grande part à la constitution de nouveaux instruments cognitifs, par leur formulation de la question nationale au Brésil.
Si comme l'affirme Daniel Pécaut :"Forger un peuple, c'est aussi dessiner la culture susceptible d'assurer son unité"2 , alors la volonté formulée par les intellectuels modernistes d'informer le peuple dans la culture nationale, ou du moins révéler la brésilianité au Brésil, a joué un rôle effectif dans la formation de l'identité nationale. Les "portraits du Brésil" inaugurés par les modernistes sont autant de produits néo-réalistes qui, selon l'expression de Raúl Antelo, "inaugurent le musée imaginaire de notre modernité"3 .
3.1.- Le Brésil imaginé : figures de l'imaginaire moderniste
3.1.1.- LA RECRÉATION DU BRÉSIL
L'invention d'une nouvelle représentation du Brésil et de sa culture nationale est un gros travail de recyclage du matériel cognitif ou du moins idéologique dont ont hérité les modernistes. La constitution de "mythes nouveaux" pendant la phase rhétorique du modernisme (c'est-à-dire celle que nous étudions, par opposition à la phase "constructive" qui caractérise les années 30) amène la fondation d'une nouvelle tradition idéologique qui perdure jusqu'aujourd'hui et qui participe à la structuration du rapport des élites intellectuelles à la politique et à la société brésilienne.
a) Les origines tupi de la nation
Le modernisme développe dans ses textes tout un aspect mythique sur les origines et la spécificité socio-culturelle du Brésil, qui prend essentiellement pour objet la figure de l'indien. L'invention de la nation brésilienne passe donc par la mise en forme mythique des éléments culturels valorisés lors des démarches visant à "découvrir" le Brésil par le biais de l'étranger mais surtout par celui de la connaissance scientifique de ses caractéristiques propres. Le recyclage idéologique de ces éléments a permis d'une part d'illustrer les thèses sur la brésilianité: son originalité mais surtout l'antériorité nationale. L'absence au Brésil d'une origine héroïque de la nation se perdant dans la nuit des temps et donnant cohérence et unité au groupe social était ressenti sur le plan du
63
sentiment national des auteurs comme une lacune et une frustration. Les modernistes tentèrent d'y remédier en inventant une antériorité de la nation, ignorée jusque là.
Il s'agissait d'imaginer les ancêtres des Brésiliens, des hommes rattachés au territoire brésilien, en communion avec le sol, et ayant vécu une histoire héroïque. Le passé brésilien, tel qu'il avait été représenté par les élites intellectuelles jusque là était celui d'un Brésil condamné à l'infériorité, dégradé par une histoire de dépendance et de soumission, et menacé par la dissolution du caractère noble de l'européanité dans le métissage. Les modernistes tenteront de revoir cet aspect négatif et de valoriser au contraire le passé colonial, et le début de l'histoire indépendante.
Mais ce qui s'exprime surtout dans les œuvres modernistes, c'est la volonté de dépasser cette conception historique de la nation qui était forcément dévalorisante car l'histoire brésilienne en tant que telle n'avait que deux siècles et était trop proche pour qu'on puisse en faire un récit sur l'origine de la nation brésilienne.
L'antériorité de la nation brésilienne est donc conçue à travers un stratagème qui permettait de combler l'imaginaire collectif nationaliste: il fallait inventer des ancêtres brésiliens, et mettre en place des récits mythiques sur les origines du monde, des récits héroïques affirmant un passé oublié ou volontairement ignoré précédemment étant donné la dépendance et l'aliénation du peuple brésilien dans l'état de colonisation subi pendant les siècles passés.
La figure de l'Indien est donc la plus pratique pour fonder la nation sur une terre et un peuple antérieurs. La thématique indigène ne s'impose qu'à partir de 1924, quand la question de la brésilianité passe au premier plan des préoccupations des modernistes, et gagne de l'ampleur dans tout le mouvement prenant différentes formes selon les tendances.
Les modernistes n'y croient pas forcément, mais leur rhétorique nationaliste les mènent ainsi à exprimer leur vision de la cohésion nationale à travers l'image certes pratique de l'homme qui vivait avant sur cette terre. Mais ce point de vue relève d'une certaine ambiguité sur laquelle n'insistent pas les modernistes, car la thèse de l'origine indienne des Brésiliens est difficilement défendable objectivement. Or les intellectuels modernistes doivent d'une certaine manière légitimer leur propos sur le plan scientifique ou du moins rhétorique. Et l'Indien est alors ouvertement présenté soit comme image et symbole du parcours national, soit comme l'esprit de la brésilianité dont héritent subjectivement et inconsciemment les Brésiliens.
L'Indien apparaît dans les textes modernistes, soit comme symbole des origines du Brésil, soit comme nous l'avons vu en seconde partie, en tant qu'objet d'étude. L'indigène pris comme mythe et symbole des origines du Brésil, illustre la culture et l'homme en adéquation totale au milieu et à la terre. En effet, l'Indien ayant déjà pratiquement disparu du territoire brésilien au début du siècle il est aisé de plaquer sur sa mémoire l'image de l'État de Nature, et de lui attribuer toutes les "caractéristiques" du peuple brésilien. L'Amérique, dans l'histoire des idées politiques, est en effet traditionnellement prise comme exemple pour illustrer l'État de Nature et abriter la figure du «bon sauvage». Dans le cas de la pensée politique brésilienne, et d'une façon particulièrement aigüe pour le modernisme, c'est l'ethnie tupi (tupi-guaraní) qui est prise comme symbole des origines.
La figure de l'indigène apparaît le plus souvent dans les textes modernistes , comme un moyen d'illustrer leurs nouvelles thèses sur le processus culturel brésilien et sur le caractère national. C'est ainsi que Ronald de Carvalho dans Toda A América (1926), pour donner un ton national et "authentique" à son langage poétique, emprunte de nombreux mythes ou termes typiquement Indiens et les intègre dans sa poésie et dans l'iconographie qui l'illustre1, sans que le sens original de ces mots et mythes aient une importance réelle dans ces textes. La langue tupi est utilisée de par ses sonorités exotiques et mystérieuses, et est un outil créatif facile, car original et vierge de sens pour
64
les oreilles inaccoutumées. Plínio Salgado affirme ainsi: "Il y a plus d'enseignements de modernité de style, de conception absolument inédite de l'art, dans un quelconque mot tupi que dans un manifeste de Marinetti, une harangue ultraiste, un pamphlet Dada ou dernièrement les raisons des surréalistes"2.
Dans le cas d'une telle production littéraire il n'y a pas vraiment la nécessité d'approfondir la connaissance des sociétés indigènes, celles-ci ayant déjà presque toutes disparu. D'ailleurs, mises à part les épopées héroïques dont nous allons parler, l'Indien est rarement sujet dans les textes réalistes du modernisme. La connaissance de ces sociétés est le plus souvent très sommaire, et plutôt intéressée (sélective). C'est ainsi qu'on n'hésite pas, soit à amalgamer les ethnies, soit à en juger les différences en identifiant le caractère national à celui des tupis, et en rejettant les autres ethnies brésiliennes comme anti-nationales (les membres du groupeAnta, considèrent dans leur manifeste, cf Annexe••, que l'ethnie tapuia est une ethnie sans caractère, sujette à la disparition), soit encore, à récupérer l'image de l'Indien afin de l'adapter aux préjugés concernant l'Indien et son rapport à la nature.
La nostalgie des origines, indirectement suggérée dans les récits modernistes ne se comprend que dans la perspective de produire du sens au niveau de l'attachement des Brésiliens au territoire national et à une histoire mythique unificatrice.
b) Récits épiques et mythes fondateurs
D'une façon générale les modernistes dans leur invention de la nation, privilégient donc largement les récits mythiques à l'exposition rationnelle de leur façon de voir. Un des aspects fondamentaux de la fondation d'un mythe de la nation au Brésil est la formulation, au delà de l'idée de son antériorité et de la nostalgie des origines, d'un certain nombre de récits héroïques ou fondateurs, qui ne sont certes pas autre chose que des fictions, mais entretiennent une certaine ambiguité sur leur utilisation de la dimension mythique, car ils emploient un ton affirmatif et tendent parfois à effacer la distinction entre langage littéraire et réflexion politique.
Les modernistes utilisent soit inconsciemment, soit volontairement soit même de façon ironique, les formes traditionnelles de cosmogonies, ou de mythe des origines nationales. Les récits fondateurs ou héroïques, sous la forme de rhapsodies, d'épopées, ou de poèmes, contribuent dans une grande partie à fonder un nouvel imaginaire politique. Toute vision du monde cohérente se fonde en effet sur une cosmogonie qui retrace symboliquement son origine, et sur des héros qui incarnent les qualités et les défauts de la nation.
Il n'est donc pas surprenant d'assister au renforcement thématique des "scènes prophétiques de fondation", surtout en ces moments de particularisme littéraire, et de préoccupation locale accentuée. Les modernistes participent activement, et au même titre que les romantiques, à la construction généalogico-littéraire de la nationalité.
Dans Martim Cererê 1 de Cassiano Ricardo, le motif de la "scène de fondation" se transforme en un vaste exercice évolutif en hommage aux Indiens, aux bandeirantes, et à la modernisation. La narration aboutit à un point d'arrivée unique: la fondation de la métropole , "(...)et la ville grandit comme un arbre".
Dans ce cas il s'agit d'une ville en particulier: São Paulo : "Ô mon São Paulo/ Ô mon Uiara aux cheveux rouges!/ Ô ville aux hommes qui se réveillent le plus tôt du monde!". Cette ville est l'image de la modernisation dans le poème, modernisation dans laquelle se condenseraient mythiquement Uiara 2 et les héros bottés géants et rouges, nés du mariage d'Uiara avec l'homme blanc. Ce passage de Martim Cererê se transforme en un récit mythique de fondation, de par son a-temporalité et de par son a-historicité, présentant l'expérience temporelle et la nationalité d'un point de vue non-évolutionniste.
L'insertion d'une scène de fondation au sein des 33 épisodes de Cobra Norato de Rául Bopp (1931) se fait elle de façon plus discrète. Elle se manifeste par la
65
transformation des "mamoranas3 des berges de la rivière" en "villes élastiques, en circulation"4 . Cette allusion est complétée par l'image de la: "Forêt ventriloque qui joue à la ville"5. La vision urbaine est seulement "potentielle" dans Cobra Norato, proches du songe --les terres du sans-fin--, et prennent un caractère utopique.
Macunaíma (1928) de Mário de Andrade développe plus particulièrement cette scène de fondation épique, dans le chapitre central intitulé "Carta às Icambiabas" (Lettre aux Amazones). Faisant indirectement référence à la fondation de Rome décrite par Virgile dans le sixième chant de L'Énéide, São Paulo y apparaît "construite sur sept collines, à la façon traditionnelle de Rome, la ville césarienne, 'capita' de la Latinité dont nous provenons; et lui baise les pieds la gracieuse et inquiète lymphe du Tietê 1 ." 2
Si le ton de la glose est assez clair, il n'exclut pas l'hypothèse d'une autre fondation. "Nous prétendons en construire une similaire dans vos domaines et notre Empire", dit Macunaíma aux amazones, même si ce n'est qu'un mensonge pour leur extirper quelques dizaines d'embarcations remplies de cacao.
L'aspect mythique de ces récits est assuré fondamentalement par une indétermination temporelle et une non-linéarité du discours épique qui caractérise des œuvres comme Martim Cererê, Cobra Norato, mais dont l'expression majeure est certainement Macunaíma. La reprise anti-épique des "scènes prophétiques de fondation" dans Macunaíma, est sans aucun doute une critique des généalogies caractéristiques des projets épiques romantiques brésiliens, mais n'en perd pas pour autant son aspect mythique fondateur.
Le modernisme brésilien, une fois dépassé le stade futuriste, met en place un vision particulière de la ville où coexistent deux temps contrastés, deux rythmes juxtaposés, rompant avec l'idée de continuité, de linéarité, et associant aux signaux urbains de la modernisation, ceux du regard naïf de l'homme de la campagne, indien, caboclo, ou métisse. Ce regard spécifique est particulièrement bien exprimé dans les tableaux de Tarsila do Amaral sur le thème de la ville.
L'utilisation de la dimension mythique dans les textes modernistes trouve ses fondements dans la conception d'une temporalité brésilienne autonome, vecteur d'intégration à la modernité. Les différences existant entre les différentes régions brésiliennes sont alors considérées comme les parties d'un tout incarné par la nation. La mise en scène atemporelle et "dégéographisée" d'éléments régionaux se fait dans la perspective de les rassembler sous la culture nationale. La théorie de la "dégéographisation" (en portugais, "desgeografização") est théorisé par Mário de Andrade et appliqué dans Macunaíma. La dégéographisation est le procédé qui permet de découvrir, au delà des différences régionales, une unité sous-jascente, relative à son identité. Cette unité doit constituer l'objectif ultime de la recherche régionaliste, puisque c'est en elle que réside la compréhension et la raison d'être du régional. Le régional n'a pas de sens en soi.
Le régional est cependant interprété de différentes façons. Associés à la tradition, les modernistes de la tendance verde-amarela en déduisent une volonté de retour idyllique aux traditions du pays. En effet, présentant une conception de la culture brésilienne où règnent l'intégration et l'harmonie (dûs à l'élément unificateur tupi), et privilégiant une conception spatiale de la culture à une conception temporelle (historique), ils considèrent que les traditions locales ont une valeur qui dépasse le contexte historique. Et donc, les verdeamarelos, plus que les autres modernistes, se représentent une tradition qui se fige dans le mythe des origines. Ce mythe crée une temporalité idéale à laquelle on doit revenir, car c'est en elle que réside la brésilianité.
Au contraire, Mário de Andrade, forge lui le concept de "traditions mobiles"(en portugais "tradições móveis"). Par ce concept, l'auteur cherche à sauver la dynamique des manifestations de la culture populaire locale et en même temps assurer la contnuité de l'être national. L'aspect positif des "traditions mobiles" est qu'elles actualisent les
66
manifestations de la culture populaire. Sa perspective est historique et cherche à mettre en évidence une temporalité propre au Brésil, dans le cadre de l'international.
Cette opposition se manifeste bien à travers les œuvres des auteurs. Mário de Andrade cherche par exemple dans Macunaíma, à dépasser la conception géoraphique de l'espace et à révéler une entité homogène dans laquelle les différences régionales peuvent être oubliées. Ainsi son héros Macunaíma se déplace dans l'espace de la brésilianité, rencontrant les différences régionales, mais sans jamais perdre de vue l'unité nationale. La rhapsodie Macunaíma, prend alors le sens de survoler le Brésil pour le voir dans son unité et dans sa complexité.
Par contre, à travers la conception spatiale de la tradition, le groupe verdeamarelo cherche à récupérer le temps mythique en le localisant dans la région paulista, détentrice de la plus profonde brésilianité. C'est ce que l'on peut vérifier dans Martim Cererê de Cassiano Ricardo qui crée les "héros géographiques" qui effectueront l'épopée Bandeirante, conquête de la brésilianité par l'esprit régional paulistano. Le point de départ de cette entreprise est São Paulo, comme le sera son point d'arrivée. Le parcours est circulaire et les héros ont la responsabilité de "paulistaniser" le Brésil, car les valeurs de la civilisation paulistana synthétisent la brésilianité.
Les textes de Mário de Andrade cherchent donc à exprimer une pensée beaucoup plus nuancée du Brésil. Macunaíma est le héros national qui incorpore toutes les qualités, mais aussi tous les défauts du Brésil. À sa conception de l'"hétérogénéité macunaïmique du national" s'oppose l'homogénéité traduite par le caractère des héros de Cassiano Ricardo, comblés d'attributs glorieux par leur capacité à faire face aux difficultés, leur esprit aguerri et leur altruisme incomparable.
La fondation d'une nouvelle vision du Brésil par les modernistes trouve donc largement ses bases dans un langage mythique. La forme des récits héroïques que nous avons étudiés contribue donc à la compréhension des théories modernistes sur la brésilianité, mais aussi à l'imprégnation d'un imaginaire politique particulier parmi le public large de ces ouvrages qui ont tout de suite été des succès d'édition.
Nous voyons donc que la fantaisie et le merveilleux de ces ouvrages où l'on croit assister à une expression on ne peut plus innocente (les héros sont souvent des enfants ou des personnages au caractère puéril) joue un grand rôle dans l'imagination politique du paysage brésilien.
c) La réinterpétation de l'histoire du Brésil
Les modernistes contribuent d'autre part à la fondation d'une vision objective de la culture nationale, par la réinterprétation du pays et de son histoire sur la base d'éléments considérés jusque là comme des défauts (la culture noire, le métissage, le goût et le comportement populaire, etc.). Cette dynamique prend pied sur l'intérêt nouveau des modernistes pour les sciences sociales et pour la culture populaire et régionale. Elle intervient moins comme une invention du Brésil, que comme réinterprétation des éléments culturels dévalorisés jusque là, et inversion du jugement qu'on s'en était fait.
Cette nouvelle conception de la culture est présente dès Canãa de Graça Aranha, où il met en scène les débats entre les différentes visions de la société. Dans cet ouvrage se confrontent la conception raciste prédominante jusqu'au début du XXe siècle et une conception que nous pouvons qualifier de "moderniste" (malgré l'antériorité de Canãa par rapport au mouvement lui-même) qui est fondée sur la culture. Se dégage de ces débats une vision successivement positive et négative du métissage.
Les modernistes ont procédé dans plusieurs de leurs ouvrages à la reconstitution voire même à une révision de l'histoire nationale, formulée dans différents manifestes (Pau-Brasil, Anthropofagía, Nhengaçu Amarelo), ou suggérées dans leurs poèmes épiques et leurs romans. Cette révision historique se caractérise par un rejet de la vision et de la sensibilité européenne et est motivée par la volonté de révéler le véritable Brésil.
67
Les modernistes ont tenté de fonder une nouvelle vision de l'histoire du Brésil, vu non plus de l'extérieur, mais à travers des "yeux brésiliens". Cette réinterprétation du Brésil, par l'"intérieur", fait que l'on renverse le point de vue de l'historien. Oswald de Andrade, dans le Manifeste Anthropophage renverse les récits des voyageurs "Ali vem a nossa comida pulando" ("voilà notre nourriture qui vient en sautillant"). C'est le point de vue de l'Indien cannibale qui est adopté dans ce fragment du récit de Hans Staden, mis en épigraphe en gros caractères sur la première page du premier numéro .
La métaphore anthropophagique, comme le symbole tupi dans le manifeste Nhengaçu Amarelo, insiste pour le premier sur l'antériorité de la "terra brasilis" ingurgitant la culture des colonisateurs, et sur l'antériorité de l'esprit national pour le second. La volonté des modernistes est donc clairement de revoir entièrement l'histoire de ce point de vue. Leur idée est que malgré l'apparente défaite de la culture indigène, c'est bien celle-ci qui domine la culture européenne au Brésil, car elle n'oppose pas de résistance (voir illustration ci-contre), mais s'impose subjectivement et inconsciemment.
Cependant, ces auteurs ne peuvent s'abstraire entièrement des évènements historiques, et sont bien obligés de se représenter l'histoire politique sur la base d'évènements qui eurent lieu. Les poèmes 'História" de Raúl Bopp1 et "História do Brasil" de Oswald de Andrade2 témoignent du fait que les modernistes peuvent tout aussi bien s'aligner sur la vision traditionnelle de l'histoire brésilienne, s'identifiant au Portugais plus qu'à l'Indien natif. Cependant, la façon de percevoir et de présenter cette histoire est sensiblement différente en ce qu'elle est vue positivement, à travers un regard naïf par lequel les évènements de l'histoire deviennent des objets poétiques et ludiques.
Le régionalisme de Recife joue aussi ce rôle de réinterprétation de l'histoire brésilienne, insistant beaucoup plus sur l'évolution de la société et de ses pratiques culturelles que sur les évènements marquants de l'histoire politique. Il s'agit là encore de revaloriser des aspects écartés jusque là de l'historiographie traditionnelle, et principalement de l'historiographie républicaine qui avait fait un rejet total de la période coloniale. L'intérêt des modernistes pour le patrimoine architectural colonial (principalement celui de la région d'Ouro Preto, découverte en 1924 par les écrivains modernistes) témoigne de cette volonté de faire face à la complexité du processus historique au Brésil, cherchant à mettre en relief la positivité de la spécificité brésilienne.
Le régionalisme met l'accent sur les traditions issues des différentes couches de la société brésilienne, et principalement les couches populaires, mettant en avant les contributions particulières des cultures africaine et indienne dans les formes de sociabilité, d'expression quotidienne et rituelle. Ce retour sur l'histoire consiste aussi à valoriser le passé rural du Brésil, négligé en un premier temps, par le modernisme. D'une façon générale, les historiens du Brésil avaient transmi une vision amère du passé. L'idée d'un Brésil "faux" ou "coupable" est assez récurrente dans leur appréciation de l'histoire, les images prédominantes sont celles d'un pays de métis et d'analphabètes, subissant l'exploitation d'une métropole, et dont les élans de libertés étaient réprimés.
Mais malgré la volonté d'établir une nouvelle représentation de l'histoire brésilienne, la vision moderniste du monde est décidément plus géographique qu'historique3 . Cette tendance est en réalité plus évidente chez les verde-amarelos, mais est présente aussi bien dans Antropofagía que dans le régionalisme. L'objectif étant de créer de l'identité nationale et montrer l'unité potentielle ou effective du pays, la perspective historique objective n'est pas satisfaisante car les évènements de l'histoire brésilienne sont difficilement héroïsables, et le passé brésilien ne se noie pas dans la nuit des temps comme celui des grandes nations européennes. Le discours moderniste sur l'unité nationale se projette donc moins sur le passé historique qu'il se place dans une temporalité spécifique et figée, une temporalité mythique où l'harmonie prédomine malgré les disparités nationales.
68
Cette temporalité particulière serait le résultat de la recherche de modernité à travers la brésilianité. On ne cherche plus comme pendant la phase futuriste à montrer la participation du Brésil à la modernité universelle (qui est celle de la vitesse et de la technologie). On cherche au contraire par ce regard rêveur sur le passé et le présent du Brésil, à valoriser une modernité particulière, liée à une temporalité spécifiquement brésilienne (qui n'est plus vue comme un retard) et dont la révélation permettrait l'épanouissement de la brésilianité.
3.1.2.- LA NATION, LE PEUPLE INVENTÉS
L'objectif essentiel de cette imagination nouvelle du Brésil est de montrer l'existence de la nation dans la réalité et dans le sentiment des Brésiliens. C'est aussi de montrer son antériorité et son unité par l'invention d'un nouveau regard sur le pays, montrant ses richesses et faisant abstraction de ses divergences.
Il semblerait que cela soit là une tendance typique de l'intellectualité brésilienne. En effet, pour Daniel Pécaut: "la priorité pour les intellectuels qui prétendent parler au nom de la Nation est de convaincre qu'elle est déjà là, en filigrane. Tout est bon pour le prouver: la manière d'être (le "caractère" brésilien), la culture, le peuple, l'essor des forces productives (...)"1. Et l'invention de mythes unificateurs joue encore mieux ce rôle.
Dans ce domaine, les écrivains modernistes ont finalement repris, comme nous le verrons, un certain nombre d'idées des romantiques qu'ils dénigraient si violemment. L'invention d'une nation ne peut cependant pas se faire par la simple imagination de son histoire et de son origine mythique. Elle se complète dans le cas moderniste, par l'invention d'un peuple et d'une culture originale. La nation brésilienne se définira donc pour les modernistes par une culture unificatrice particulière, due aux facteurs socio-historiques particuliers que sont le milieu, le caractère et la langue.
a)L'avant-garde moderniste et la culture populaire
La fondation d'une nouvelle théorie de la culture par les écrivains que nous étudions passe par la négation de la culture érudite soumise aux critères européens. C'est en ce sens que les pratiques culturelles modernistes sont nationalistes. Ils tentent de légitimer l'idée de culture nationale par la création d'un art érudit national, et par sa reconnaissance de la richesse et de l'authenticité des manifestations populaires de la culture. Les modernistes affirmèrent donc la volonté de dépasser le clivage entre la culture populaire, et la culture érudite, pour fondre ces deux éléments opposés dans une culture unificatrice, la culture nationale.
La culture populaire, fondamentalement illettrée, correspondait aux mœurs matérielles et symboliques de l'homme rustique, du sertão et des terres de l'intérieur, ou de l'homme des banlieues pauvres n'ayant pas encore assimilé les structures symboliques de la ville moderne. La culture érudite était, elle, centrée sur le système éducatif, principalement les universités. Ce clivage qui pourrait à la limite se résumer à l'opposition entre académie et folklore, voulait être dépassé par l'invention d'une culture unificatrice, la culture brésilienne ou culture nationale.
L'avant-garde (la culture érudite moderniste), récupérant la culture populaire dans ses manifestations, érige l'art en médiateur entre cultures, unifiant dans ses textes des réalités dont elle niait une différence pourtant tellement aigüe. La volonté de fonder le sentiment national faisait des expressions populaires un mythique esprit du peuple, l'esprit de la nation dont se veulent porte-paroles les avant-gardes modernistes à travers leurs poèmes épiques et leur volonté de sauver le vaste patrimoine culturel national.
69
La conception romantico-nationaliste, régionaliste ou populiste de la culture populaire est largement présente chez les modernistes, et attribue une validité éternelle aux valeurs transmises par le folklore.
La conception moderniste de la culture brésilienne est influencée par le nationalisme romantique du tournant du siècle qui exhaltait par ses théories sur la nature, le type et la langue brésilienne. Mais les romantiques utilisent la matière brésilienne avec des moules esthétiques européens. Ainsi cette utilisation des éléments de la culture populaire était uniquement allégorique et ne comportait aucune originalité dans leur façon de voir. L'Indien est entièrement idéalisé par le romantisme, et la figure du Noir, associée à l'escla-vage, reste toujours dévalorisée.
Le modernisme a refusé l'opposition entre culture érudite et culture folklorique, cherchant à transformer la culture d'avant-garde en une culture nationale, et donc articuler la première à la spécificité de la culture populaire brésilienne. L'originalité de ce mouvement a cependant été de vouloir dépasser le clivage entre culture populaire et érudite non plus uniquement par des images stéréotypées du Brésil comme pour le romantisme, mais par la tentative de développer une optique littéraire elle-même brésilienne, et intégrant la multiplicité des apports culturels présents sur le territoire, dans un langage unique.
La fin de l'esclavage, effective au Brésil à la fin du XIXe siècle, aurait incité les élites blanches de cette période, à s'interroger sur la capacité des Noirs à se fondre réellement dans la nation. Les modernistes, dans leur soif d'intégrer dans la culture nationale, la diversité des apports ethniques, contribuent largement à la réhabilitation de la culture noire (le premier congrès de culture afro-brésilienne eut lieu au Brésil à la fin des années 20, sur l'initiative du mouvement régionaliste de Recife).
Au Brésil, près de la moitié de la population était encore de souche noire vers 1900. Aussi, bien souvent, les descendants d'Africains s'efforçaient-ils d'oublier leur ancien statut d'esclaves en donnant de leur négritude une image convenue et "convenable". C'est cette nouvelle vision de la culture afro-brésilienne marginalisée jusque là, qui est codifiée chez des auteurs comme Nina Rodrigues, et surtout comme Gilberto Freyre (dans Casa Grande e Senzala,1937; édité en français sous le titre Maîtres et Esclaves).
La culture populaire (la musique, la cuisine, la religiosité...) prise comme un ensemble non différencié devient un objet poétique. Des manifestations spécifiques deviennent les blasons de la culture nationale. Le carnaval, évènement de masse où s'exprime le syncrétisme brésilien, fait l'objet de poèmes, ou apparaît par exemple dans le Manifesto da Poesía Pau-Brasil, comme l'expression la plus ouverte de la communion et du caractère national. Raúl Bopp, dans Cobra Norato e Outros poemas1 établit des portraits du Brésil, où s'exprime cette richesse culturelle du Brésil, et notamment dans les poèmes "O chorado"2 (où il décrit un chant "typiquement" brésilien), "Comida" 3("la nourriture), et "Cobra Norato"1 (dans lequel intervient un culte syncrétique mariant croyances indiennes, africaines et brésiliennes). L'exploration du Brésil pauvre moderne reviendra cependant surtout aux romanciers régionalistes néo-réalistes, particulièrement ceux du Nordeste.
Le mouvement Pau-Brasil prétend synthétiser tous ces aspects de la culture brésilienne dans sa poésie. Dans son manifeste, les éléments les plus divers se côtoient:
"Des obus d'ascenseurs, des grattes-ciels faits de cubes et la sage fainéantise solaire. La prière. Le carnaval. La force intime. Le sabiá (••oiseau des tropiques••). L'hospitalité un peu sensuelle, amoureuse. La nostalgie des sorciers guérisseurs et les terrains de l'aviation militaire. Pau-Brasil."
Cette synthèse est possible car (toujours dans le Manifesto da Poesía Pau-Brasil):
70
"(...)Nous avons la base double et présente --la forêt vierge et l'école. La race crédule et dualiste et la géométrie, l'algèbre et la chimie tout de suite après le biberon et l'infusion d'aneth doux (...)"2.
De ce contact entre culture populaire et culture érudite peuvent naître des fruits très différents, qui va de la démagogie populiste la plus aveugle, à la plus belle œuvre d'art, élaborée en partant de motifs populaires, comme par exemple la musique de Villa Lobos.
A en croire Alfredo Bosi, il n'existe qu'une seule relation valable et féconde entre l'artiste cultivé et la vie populaire. C'est la relation amoureuse: "Sans un enracinement profond, sans une empathie sincère et prolongée, l'écrivain, l'homme de culture universitaire, appartenant au langage réducteur dominant, se prendra dans les filets du préjugé, ou mythifiera irrationnellement tout ce qui lui paraîtra populaire, ou encore il projettera lourdement ses propres angoisses et inhibitions sur la culture de l'autre, ou enfin, il interprètera de façon fatalement ethnocentrique et colonisateur les façons de vivre du primitif, du rustique, de l'homme des banlieues pauvres."3 . Mais la relation amoureuse est en quelque sorte utopique et n' a pu être exprimée qu'exceptionnellement dans des moments particuliers où l'on pouvait concevoir une œuvre d'art moderniste désintéressée, sans chercher à légitimer une nouvelle vision politique de la société brésilienne.
La littérature nationale des modernistes alliant culture érudite et culture populaire naît la plupart du temps d'une communion qui n'est pas vécue réellement entre ces cultures opposées, et cette relation est encore une fois issue d'une projection "de l'extérieur, sur l'intérieur". Le concept de "culture populaire" pour le mouvement anthropophagique comme pour le verdeamarelismo, est l'expression de la sensibilité tupi, articulée en légendes, mythes et rites, racontés par les chronistes, jésuites, et les anthropologues contemporains. Sa relation avec la culture populaire n'est donc pas directe, et les modernistes d'une façon générale ont du mal à s'empêcher d'avoir une vision surplombante de la réalité sociale des classes moins aisées.
Pour Alfredo Bosi , le concept de "culture populaire" fait appel à une autre notion, celle de populisme, c'est-à-dire à une utilisation forcément passagère et superficielle de la culture, due à l'ignorance de la condition de l'autre, à l'absence de communauté de destin entre l'homme cultivé et l'homme pauvre. Ce populisme est associé bien sûr à un paternalisme et à un culte de l'autorité. Les modernistes, comme les intellectuels brésiliens, de façon générale, projettent sur la population brésilienne, l'image d'un peuple jeune, immature, et qu'ils ont pour responsabilité de guider.
Dans cette optique, le primitivisme et le folklorisme modernistes font partie d'un phénomène "idéologique et psychologique (...) de projection de névroses, déséquilibres, préjugés (...) plaqués d'intellectuel, sur la matière populaire"1. Ainsi Alfredo Bosi comprend-il ce phénomène comme étant une valve de sécurité de la subjectivité petite-bourgeoise. Mais le phénomène de production idéologique intense auquel nous assistons avec le mouvement moderniste est surtout dû au contexte que nous avons présenté en seconde partie et qui contraignait les écrivains modernistes à légitimer leurs héritages et leurs conquêtes sociales par une rhétorique nationaliste les plaçant en médiateurs entre culture érudite et culture populaire.
b) Les fondements objectifs de la Nation
La définition moderniste de la nation s'oppose à la vision raciale qui prédominait précédemment, et impose une nouvelle représentation qui prend pour fondement premier la culture: une culture nationale qui transcenderait les différences objectives de la population brésiliennes, dépassant les clivages raciaux, régionaux et historiques comme autant d'obstacles à la communion nationale.
71
Quoi de plus effectif pour résoudre les contradictions objectives de la nation brésilienne, que de faire allusion à la subjectivité de la nationalité? Les modernistes conçoivent le peuple et la culture nationale unis sentimentalement, non pas par la croyance dans l'appartenance nationale, mais par la façon commune qu'auraient les Brésiliens de percevoir leur relation au monde, et d'exprimer leurs sentiments. C'est le caractère brésilien, clé fondamentale de la vision moderniste de la nationalité.
Cette conception de la nation est appréhendée par nos écrivains, par le biais de la perception intuitive des caractéristiques nationales objectives. Les modernistes veulent révéler au Brésil les fondements de son unité, à travers leur intuition de la spécificité des facteurs de nationalité.
Dans cette optique, l'unité de la nation brésilienne, si elle n'existe pas encore dans l'âme des Brésiliens, existe dans les faits, dans sa terre, son caractère, sa langue, sa race, sa culture et son histoire. Ainsi, les modernistes semblent se rapprocher par là, de la conception allemande de la nation. Mais ce qui caractérise plus particulièrement le modernisme, c'est leur volonté affirmée de fonder subjectivement le sentiment d'appartenance à la nation, de produire de l'identité nationale.
Comme nous l'avons montré précédemment, la conception géographique du Brésil domine largement sa perception historique. Le Brésil, ses vastes étendues, sa végétation foisonnante et ses ressources naturelles exceptionnellement riches absorbent sans distinction la diversité des apports humains qui ont caractérisé son histoire. La nationalité anticipe et déborde largement l'histoire nationale. L'histoire elle-même apparaît dans les écrits modernistes comme le fruit de la géographie capricieuse du pays. Celle-ci est le plus souvent représentée comme la conquête des terres de l'interior* (consistant essentiellement à dominer ou à s'intégrer dans les forces de la nature). Contrairement à l'histoire, la géographie exalte la grandiosité du pays: sa carte immense, sa nature exhubérante, sa flore et sa faune, sa géographie poétique.
La conception moderniste de la culture brésilienne est d'autre part largement fondée sur les réflexions quant à l'identité culturelle nationale et régionale, développée par les régionalistes qui peuvent renvoyer à des théories métaphysico-scientifiques sur les rapports entre l'homme et le sol, rappelant parfois les idées de Maurice Barrès (Les déracinés, 1897).
La particularité et la force du milieu est d'autant plus mise en avant que la nationalité ne saurait se fonder au Brésil sur une base ethnique de plus en plus hétérogène, étant donné l'immigration massive au début du siècle. La positivité du milieu brésilien exalté par les modernistes est sa flexibilité, permettant l'absorption continue de nouveaux éléments ethniques. C'est le mythe de la démocratie raciale. Le problème du métissage est en quelque sorte maintenu hors de la réflexion moderniste, car ce qui prédomine dans leur vision de la nation, c'est l'intégration pacifique.
Cet aspect est relativement bien explicité dans le mouvement verde-amarelo pour qui l'immigration est finalement une question récurrente, traitée de façon à renforcer l'idée de cette intégration pacifique et la force du caractère national. L'immigrant perd alors son identité pour s'intégrer dans l'"organisme ethnologique national".
Cette mythique fusion des éléments culturels centripètes dans le milieu naturel était déjà présente dans la littérature pré-moderniste. Dans Canãa, le juge Maciel, au cours d'une discussion avec le héros (Milkau, un immigrant allemand venu s'installer dans la terre promise du Brésil), parle de la formation du caractère national et de la nationalité, en rapport avec le milieu:
"(...)Il fallait qu'il se forme, dans le conflit de nos espèces humaines, un type de métis qui, se conformant mieux à la nature, à notre milieu physique, et qui, étant l'expression des qualités moyennes de tous, fût le vainqueur et éliminât les extrêmes géniteurs. (...)"1.
72
C'est ainsi qu'apparaît la figure de l'Indien dans les différents textes modernistes. Ne pouvant pas associer le peuple brésilien à la terre, d'un point de vue historique, c'est l'indien tupi qui fonde le mythe des origines nationales. L'Indien est alors mis en scène comme l'incarnation de l'homme en harmonie avec son milieu. Le mythe de l'origine de la nationalité brésilienne est le mythe de l'homme naturel, et c'est ainsi qu'est perçu l'Indien, spontané, gai, et simple. Dans l'histoire de la pensée au Brésil, on attribue aux "hommes primitifs", des caractères naturels plus prononcés que ceux de l'homme blanc: la force, le désir, la sensualité, l'intuition. La culture érudite est fascinée par ce qui lui paraît être l'énergie inconsciente des peuples sauvages et des populations illettrées, énergie qui se perdrait dans le processus de civilisation. C'est ce caractère original que revendiquent les modernistes pour le peuple brésilien.
Là encore les modernistes donnent suite à la vision romantique de l'Indien. Le romantisme brésilien avait en effet eu sa tendance indianiste. Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), bâtard d'un portugais et d'une mulâtresse, et ami de l'empereur Pedro II, publie un poème indianiste, Chanson d'exil (1851), qui célèbre les Indiens Tupis comme un symbole de l'esprit national brésilien, et développe tous ses aspects sur le caractère des Indiens.
Le premier fondement objectif de la nation étant le territoire, le milieu, son second fondement serait la langue. La question de la langue "brésilienne" surgit autour de l'indépendance politique (1822) et va alimenter une vaste polémique. La revendication d'un idiome propre possède une marque d'affirmation nationale, axe principal des revendications romantiques. Ce débat sur la légitime adoption d'apports indiens et africains, ainsi que des néologismes populaires dans la langue écrite contient celui de l'autonomie de la littérature brésilienne par rapport à sa matrice portugaise.
La revendication d'une langue brésilienne autonome participe aussi au combat contre l'académisme qui pratique un langage artificiel et détaché de l'exercice oral de la langue portugaise au Brésil. C'est ce que nous dit Oswald de Andrade dans son recueil Pau-Brasil:
" (...) Donnez-moi une cigarette / Dit la grammaire/ Du professeur et de l'élève / et du mulâtre instruit / Mais le bon Noir et le bon Blanc / De la Nation Brésilienne / Disent tous les jours / Laisse tomber camarade / Donne-moi une cigarette1 (...)"2.
La question de la langue brésilienne rejoint donc à ce niveau celle de la relation entre culture érudite et culture populaire, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de changer de langue dans la littérature moderniste, mais de changer de registre. Le "brésilien" n'est pas tant une langue qu'un "parler", et la littérature moderniste cherche à transmettre cette particularité de l'expression brésilienne, en élargissant son registre et en intégrant la richesse de l'expression orale dans leurs propos érudits. Mário de Andrade, cherche à définir ce "parler" brésilien dans une chronique de 1929:
"(...) le Brésil est une nation possédant une seule langue. Cette langue ne lui est pas imposée. C'est une langue qui s'est appuyée graduellement et inconsciemment sur l'homme national. C'est la langue que tous les socialement Brésiliens doivent utiliser, s'ils veulent être compris par la nation entière. C'est la langue qui représente intellectuellement le Brésil dans la communion universelle."3
Le parler brésilien est donc encore l'un des témoins objectifs de l'unité sentimentale du peuple brésilien. Cependant, le passé littéraire du Brésil, se réclamant toujours d'une origine européenne noble, écartait systématiquement les particularismes langagiers locaux. Plínio Salgado insiste sur le contraste de ce langage utilisé jusque là dans la littérature brésilienne avec le langage national:
"(...)Ce que je veux souligner, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, face aux autres langues, disposant comme nous disposons, de mots mal germés du contact entre l'homme et la terre, avec des
73
caractères onomatopéiques ou synthèses d'impressions nombreuses, par conséquent dynamiques et vivantes, en contraste avec celles originaires d'analogies verbales ou de conventions assises sur des acceptions classiques(...)."1
Le parler brésilien est vu comme une des caractéristiques essentielles de la nationalité, car il est vu comme étant fruit du mariage entre la terre et l'homme, entre le climat et les différents apports ethniques, fusionnés dans un seul moyen d'expression. Aussi l'utilisation du parler brésilien est l'un des premiers moyens employés par les écrivains modernistes pour se réclamer de la brésilianité dans leur littérature. Le langage schématique et télégraphique du futurisme (témoin de la vitesse de la modernité) se substitue alors progressivement à un langage simple, presque infantile et très marqué par l'oralité. Cette utilisation apparaît cependant maintes fois comme étant uniquement allégorique et artificielle, car encore une fois, ce langage n'était pas toujours celui que pratiquaient quotidiennement nos écrivains. Le langage brésilien devient alors une espèce de caricature exotique, où l'on abuse, comme dans le cas Cobra Norato de Raúl Bopp, de la distortion du portugais "à l'africaine", mais aussi du vocabulaire indigène (principalement pour désigner des éléments du milieu naturel, arbres, fruits, animaux, lieux).
c) L'idéologie du caractère national
L'aspect qui demeure essentiel dans la définition moderniste de la nation, car il fait l'objet d'allusions constantes en littérature et est en même temps l'objet d'études et de théories, est incontestablement la question du caractère national.
Le caractère, trait spécifique de la psychologie collective de chaque peuple, est l'un des postulats de base de la philosophie des collectivités. Ce n'est pas une problématique nouvelle dans la pensée politique au Brésil: il a toujours été l'un des arguments centraux dans les démonstrations sur la spécificité du peuple et de la nation brésilienne. Mais dans la tradition intellectuelle raciste et évolutionniste, il était présenté comme une altération du caractère pur et civilisé de la race blanche. La promiscuité des races au Brésil faisait naître un produit métis hybride, auquel étaient associées les images d'un peuple illettré, paresseux et aux mœurs décadentes voire barbares.
Le nationalisme romantique avait tenté d'inverser ce jugement de valeur, se faisant du mélange des races mythiques, l'idée d'un enrichissement qui donnait au caractère brésilien l'image d'un peuple mélancolique et pacifique. Le romancier José de Alencar (1829-1877; O Guarani, 1857; Os Filhos do Tempo, 1867), fonde le mythe du caractère brésilien autour d'une symbiose entre l'"innocence" indienne et la "vaillance" portugaise, et même si l'indien doit être douloureusement sacrifié pour que naisse une race nouvelle.
Mais c'est bien avec le modernisme que cette question devient définitivement centrale. Le caractère est le trait commun unissant tous les Brésiliens. Il apparaît comme le fruit de la relation à la terre et au climat, et exprime une sociabilité particulière. Pour les modernistes, cette psychologie brésilienne doit être valorisée car c'est sur cette idée on ne peut plus subjective que devra se fonder le sentiment d'appartenance à la nation. Le caractère apparaît alors comme un argument décisif dans l'imagination d'une identité nationale.
Le problème de la Nation et de l'immigration au Brésil trouve une solution par l'affirmation du caractère brésilien. Dans O Estrangeiro (1926), Plínio Salgado met en scène le problème de l'immigration. Il n'accepte pas la domination de l'immigrant dans la société brésilienne, mais trouve que leur apport est nécessaire pour la formation ethnique et le développement économique du Brésil. Selon Salgado, les immigrants doivent être assimilés par l'esprit indigène, parce qu'"il n'est pas possible que ceux qui étaient là disparaissent, ceux qui étaient là avant, ceux qui avaient accumulé dans leur sang l'esprit
74
de la terre"1. Les immigrants doivent être incorporés à la nation, absorbés par le caractère national, et pour qu'ils ne s'imposent pas, ils doivent rencontrer selon les propos de Plínio Salgado, une forte résistance, qui réside dans l'esprit brésilien hérité des Indiens. Cet esprit brésilien apparaît à travers les légendes et les superstitions indigènes transformées en croyances populaires. Les légendes du Saci-Pererê, de la Mãe d'Agua, du Boiatá, do Caapora, racontées dans O Estrangeiro par le caboclo* Zé Candinho faisaient peur aux enfants qui s'imprégnaient peu à peu de l'esprit tupi.
La recherche de la nationalité et des particularités de sa psychologie collective explique partiellement l'intérêt que les modernistes ont manifesté envers la culture populaire. La valorisation du patrimoine culturel et du folklore par les régionalistes et par les modernistes de toutes tendances, prend alors toute l'ampleur de son sens. En effet, c'est bien à travers la culture populaire que s'exprimerait pour nos écrivains, l'esprit du peuple. La relation entre culture érudite et culture populaire se comprend alors sous un autre angle: la culture érudite, si elle se veut nationale, doit alors obligatoirement être en contact avec l'esprit du peuple exprimé dans la culture populaire.
Mais la conception de la culture populaire et du caractère national chez les modernistes est quelque peu équivoque, et relèvent de l'imagination politique. Les modernistes en effet auraient bien voulu donner aux expressions populaires comme aux manifestations du caractère brésilien, une antériorité indigène. Ils imaginent, et cette idée transparaît indirectement dans leurs écrits, que l'esprit du peuple est fondé sur une culture enracinée dans la terre et dans la nature brésilienne. Cette association de la culture populaire à la culture indigène est surtout présente dans les illustrations graphiques (voir ci-contre), et dans les récits épiques du modernisme. Dans Macunaíma, il y a une fusion totale dans le magma national, des éléments culturels provenant d'origines très diverses (régionales, européennes, indiennes, folkloriques, urbaines, rurales et érudites).
Cette association n'est pas entièrement fausse car des résidus culturels indiens sont bien présents dans l'imaginaire des classes pauvres au Brésil. Les figures qui font partie des récits ou des rites syncrétiques brésiliens, telles que par exemple la légende du Saci-Pererê, ont bien une certaine origine indienne. Cependant cette origine est surestimée dans les propos modernistes.
Le caractère de l'homme brésilien naît pour les modernistes, de la diversité de ces apports culturels et raciaux, et de son rapport à la terre brésilienne. Qu'il soit fondé théoriquement sur une approche raciste, culturelle, historique ou mythique, le caractère national brésilien se définit à peu près dans les mêmes termes pour nos écrivains.
Le Brésilien garde en fait, dans les textes du modernisme, le caractère qui lui était attribué dans la littérature du XIXe: il est paresseux, sensuel, il aime la vie. Mais cette fois, cela est vu d'une façon positive, alors que cela avait été présenté comme la raison du retard du Brésil. A ce caractère brésilien traditionnel s'ajoutent des traits valorisés plus particulièrement par les modernistes: le brésilien est religieux , mais pratique la religion sans discrimination de celle des autres. Le Brésilien apparaît souvent aussi comme la personne la plus adaptée à la diversité du monde car il n'a pas de préjugés religieux, raciaux ou politiques. Il est d'autre part vu comme subjectif, intuitif, antisystémiste et antirationnaliste. Ce dernier ensemble de caractéristiques serait justement l'héritage de la culture indienne et de l'état de nature, dont témoigneraient aujourd'hui encore les manifestations de la vie populaire.
Ce caractère brésilien, s'il s'exprime bien par les phénomènes objectifs que sont la langue et la culture prises dans un sens anthropologique est défini par les modernistes de façon intuitive: ils ont le pressentiment de l'unité nationale à travers un caractère dont ils perçoivent les traits et dont ils veulent faire la révélation au peuple brésilien. Mais si le caractère brésilien est principalement perçu en termes subjectifs ou intuitifs dans un premier temps, l'idéologie du caractère national trouvera ultérieurement des fondements
75
scientifiques, essentiellement par les biais d'études en sciences sociales, de type ethnologique, mais aussi sociologique et anthropologique.
Parmi ces études effectuées sur des bases scientifiques Raízes du Brasil1, de Sérgio Buarque de Holanda a marqué son époque, et toute la génération moderniste. Cet ouvrage sort des bornes chronologiques que nous nous étions imposées, mais illustre un discours on ne peut plus directement hérité du modernisme des années 20. Raízes do Brasil cherche à comprendre la société brésilienne à partir de l'existence ou non d'un "type propre de culture", et veut mettre en avant la spécificité de cette culture. Une place centrale est attribuée à la psychologie des peuples ibériques dans la formation du caractère brésilien. Le caractère brésilien serait en effet issu de cette psychologie typiquement lusitane qu'est la cordialité. La cordialité est présentée par Sérgio Buarque de Hollanda, dans la perspective de son apport au processus de colonisation que les Portugais ont instauré au Brésil, ainsi qu'à un certain type de sociabilité rurale et domestique.
A la cordialité s'oppose dans Raízes do Brasil, la civilité en tant que forme d'expression des sociétés urbanisées et modernes. Cette opposition est discutée plus dans la perspective de se prémunir contre les "maux" d'une société impersonnelle et rationnalisée, que sur le besoin de répondre, surtout du point de vue politique, aux nouvelles exigences d'une société en mutation. En effet, la société brésilienne, de par sa colonisation, a toujours été principalement rurale et en découle donc un caractère "cordial" qui prédomine même dans les villes côtières, ouvertes sur l'Europe:
"(...)la ville que les Portugais construisirent en Amérique n'est pas un produit mental, et ne va pas jusqu'à contredire le cadre de la nature, et sa silhouette se confond avec la ligne du paysage. Aucune rigueur, aucune méthode, toujours cet abandon caractéristique qui s'exprime bien dans le mot desleixo(••voc••) (...)"1
Mais le caractère n'apparait déjà plus, chez Sérgio Buarque de Holanda, comme l'héritage des cultures primitives disparues: il est issu de la transformation et de l'interaction des cultures cohabitant sur le même territoire.
Ainsi donc, les modernistes réussissent à établir un discours relativement nouveau, imaginant une nation transcendant subjectivement la diversité objective du pays. Cette fusion de la multiplicité dans l'unité nationale se résume assez aisément dans un passage du manifeste Nhengaçu Amarelo, où s'exprime aussi la conception du nationalisme à mettre en pratique par les modernistes:
"(...)Le nationalisme tupi n'est pas intellectuel. Il est sentimental. Il est d'action pratique, sans détour du courant historique. Il peut accepter les formes de civilisation, mais impose l'essence du sentiment, la physionomie irradiante de son âme. Il se sent Tupã, Tamandaré ou Aricuta même au travers du catholicisme. Il a une horreur instinctive des luttes religieuses, devant lesquelles il sourit sincèrement: pour quoi faire?On lui donna un par-dessus de la Chambre des Communs, pendant plus d'un demi siècle, et la République le trouva identique à ce qu'il était déjà au temps de D. João ou de Tiradentes.Il ne combat ni religions ni philosophies, parce que toute sa force réside dans sa capacité sentimentale.(...) La Nation est la résultante d'agents historiques. L'indien, le noir, le spadassin, le jésuite, le troupier, le poète, le fazendeiro, le politicien, le hollandais, le portugais, l'indien, le français, les rivières, les
76
montagnes, l'exploitation des mines, l'élevage, l'agriculture, le soleil, les lieues immenses, la Croix du Sud, le café, la littérature française, les politiques anglaises et américaines, les huit millions de kilomètres carrés... (...)"2
3.2.- Construire le Brésil
C'est de cette vision particulière de la nation, fondée comme nous venons de le montrer sur la création mythique de la Nation, de son unité et de son identité, que naît la philosophie de l'action des modernistes qui, en tant qu'avant-gardes et intellectuels, prétendent une connaissance aigüe, objective et intuitive de la réalité nationale, et sont censés la révéler aux masses, pour construire le sentiment d'appartenance à la nation brésilienne.
La conception de la nation chez les modernistes est indissociable d'une action nationaliste. Elle est en quelque sorte fondée sur la nécessité de l'avant-garde moderniste de définir son statut et son rôle dans la société brésilienne. L'action est dès le futurisme l'un des thèmes centraux des manifestes littéraires. Mais avec l'émergence de la question de la brésilianité, l'action constructive apparaît avec une urgence nouvelle. Le fait même que les modernistes se réclament avec tant d'insistance de l'engagement dans le processus de transformation de la réalité montre la nécessité de légitimer leur statut d'intellectuels et leur proximité de l'élite politico-culturelle.
3.2.1.- L'IDENTITÉ ET LE RÔLE DE L'AVANT-GARDE
La vision du monde formulée par les modernistes, et principalement leur intérêt à prouver l'existence de la nation brésilienne, sont étroitement liés à leur place en tant que groupe eten tant qu'individus, au sein de la société. La vision du monde moderniste est donc due aux éléments que nous avons vu en seconde partie, et elle se met en place en fonction de la relation de ses auteurs aux milieux qu'ils côtoient et du statut social auquel ils prétendent. La conception de la nation exprimée par les écrivains modernistes est donc induite par la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes et de leur place dans la société.
a)L'avant-garde et la Nation Les modernistes se définissent eux-mêms en tant qu'avant-garde sur le plan
artistique, ce qui se traduit sur le plan social par une identité d'intellectuel et sur le plan politique par l'identification à l'élite de la nation. D'une façon générale, les modernistes ne peuvent pas se réclamer de l'élite traditionnelle, car les relations de pouvoir ont changé au Brésil, pour les raisons économiques et politiques que nous avons vues. Leur domination doit trouver de nouvelles bases, et, se concevant malgré tout en tant qu'élite de la nation, ils ne trouvent de légitimité au statut qu'ils défendent, qu'en se faisant les interprètes et les guides des masses populaires.
L'attitude typique des intellectuels au Brésil se manifeste à nouveau, et nos écrivains dans leurs manifestes, dans leurs articles et même dans leurs œuvres, s'érigent en médiateurs irremplaçables entre la réalité et le pouvoir, entre le peuple et l'élite, et se substituent aux classes se plaçant dans le lieu du pouvoir, en surplomb du social. Les intellectuels modernistes, soit s'identifient à l'État, soit se présentent en contre-État (cette
77
attitude critique étant particulièrement manifeste dans la seconde dentition du mouvement anthropophagique). Cette prétention au pouvoir des modernistes est en quelque sorte effective puisque l'État leur fait généralement un bon accueil, en tant qu'artistes pendant la période que nous étudions (l'Etat confie assez rapidement aux modernistes l'éxécution de ses monuments commémoratifs), et ultérieurement en tant qu'agents du Ministère de l'Education et de la Culture.
La responsabilité essentielle des modernistes réside à leur yeux, dans la construction de la nation. Cette volonté aura été effective encore une fois, puisqu'ils contribuent à imposer de nouvelles représentations du politique, dont nous avons présenté les relais politiques et médiatiques, ainsi que les structures fondamentales. Les intellectuels de 1925 à 1940 sont surtout préoccupés par les questions de l'identité nationale et des institutions. Au sein de ce milieu, les modernistes affirment que l'identité nationale est latente (dans ses formes de solidarité et de par son folklore), mais que seule la conscience nationale qui fait encore défaut, pourra mener le Brésil sur les rails du progrès.
Les modernistes brésiliens se font de leur rôle, dans le processus de modernisation du Brésil, une idée bien précise. Mário de Andrade dans une chronique du 1e novembre 1929, publiée dans le Diário Nacional, remarque:
"Il me paraît incontestable que nous sommes en train de traverser un moment très important de la nationalité, principalement par les possibilités [que le modernisme] a d'éveiller dans le peuple brésilien une conscience sociale, de race, chose qu'il n'y a jamais eue."1
Menotti del Picchia défend l'idée (et c'est là une attitude typique du courant verdeamarelo) que l'intellectuel doit s'ériger en maître par rapport à la multitude "immature" ou "infantile" qui doit être éduquée. C'est cette relation qui devrait garantir le progrès et la culture. Au-delà du maître, le poète doit assumer le rôle du soldat au service de la patrie, la défendant des invasions étrangères. Le nom de D'Annunzio est constamment mentionné dans les écrits de Menotti del Picchia comme exemple du "poète-soldat" qui sut abandonner son individualité pour lutter pour des idéaux patriotiques.
Pour Plínio Salgado, après la transformation intérieure de chacun, l'intellectuel a encore la responsabilité de rendre possible l'unité de sentiment et de pensée, et la conscience nationale. Selon lui, il manque au Brésil, l'"intime communion des hommes, de laquelle résulte la conscience créatrice des formes définitives"2.
D'autre part, Cândido Motta Filho enregistre l'état d'esprit qui règnait dans l'intellectualité brésilienne sous l'impact de la Première Guerre Mondiale 3. L'auteur caractérise sa génération comme étant essentiellement politique, car ayant vécu entre deux civilisations. Cette position "dramatique" selon l'auteur verde-amarelo, aurait mené la question de l'organisation nationale à passer au premier plan de leurs préoccupations. L'art cesserait alors d'être un subjectivisme capricieux pour intervenir directement dans l'organisation de la société. L'art a en effet son côté pragmatique, car c'est à travers le rêve qu'il est possible de faire des projets et de donner de la marge à l'action réalisatrice.
Le modernisme se présente alors comme un moment de fondation de la vie culturelle du pays. Il lui revient la tâche de révéler les fondements de la nationalité. Mais si l'idée de leur rôle dans la société semble assez clair pour les écrivains modernistes, il semblerait que leur statut social concret le soit moins: ils apparaissent successivement ou simultanément en tant qu'artistes, écrivains, intellectuels et membres de l'élite de la nation. Mais d'une façon générale, l'art apparaît dans les écrits modernistes, comme le savoir le plus capable d'appréhender le national et par conséquent le plus apte à conduire l'organisation du pays. Dans cette perspective, il serait possible de concevoir que la constitution de l'imaginaire politiques des modernistes est essentiellement lié à leur besoin de légitimer leur prétention au pouvoir.
78
b) L'action et le progrès thèmes centraux
L'engagement des modernistes dans les débats politiques et l'exaltation de l'action dans les manifestes modernistes prend alors un sens dont on peut mieux appréhender l'ampleur. Le volontarisme politique transparaît dans la plupart des textes. Ainsi, dans l'éditiorial de la première édition de la revue KLAXON,il est écrit: "KLAXON a une âme collective qui se caractérise par la poussée constructive(...)"1 transcrit et traduit en Annexe n°••) De même, dans le manifeste Para os Céticos nous pouvons lire:
"(...)entre tous les romantismes, nous préférons celui de la jeunesse et, comme lui, celui de l'action. Action intensive dans tous les domaines: dans la littérature, dans l'art, dans la politique. Nous sommes en faveur de la rénovation intellectuelle au Brésil, ce qui est devenu un impératif catégorique. (...)"2.
Nos écrivains, en tant qu'artistes, et en tant qu'intellectuels construisent alors un projet politique dans lequel ils auraient un rôle central à jouer. Ce projet part sur la base de la nécessité de construire la nation, de la fonder subjectivement dans la perspective de mener le peuple brésilien à la modernité, par le biais de la révélation de la brésilianité.
Le projet national moderniste, qu'il prenne la forme de l'instauration du "matriarcat de Pindorama" (pour la tendance anthropophagique) ou de la Nation gouvernée par la "cinquième race" (pour la tendance du groupe Anta) exige un engagement politique des œuvres modernistes. Les intégrants des divers groupes modernistes concevaient que leur rôle à jouer dans la construction de ces "nouvelles" utopies, devait se concrétiser dans l'action politique de transformation de la société. La question de la brésilianité cesse alors d'être un problème uniquement intellectuel, car elle exige la tranformation de la société. La pensée de Plínio Salgado et d'Oswald de Andrade répondent de ce point de vue à l'appel lancé par Graça Aranha dans A Estética da vida 3 ("l'Esthétique de la vie"): la philosophie et l'esthétique doivent se concrétiser dans l'action sociale. Les années trente verront d'ailleurs les modernistes faire leurs choix entre leurs différentes façons de concevoir cette action sociale: à travers le communisme ou l'intégralisme 4.
Mário de Andrade, avec le recul du temps, fait en 1942 une conférence célèbre dans laquelle il exprime ses regrets et ses conclusions sur le modernisme des années 20. Là encore le thème de l'action revient, mais cette fois, il considère que les modernistes ne se sont pas assez impliqués, perdant leur énergie entre la découverte voyeuriste et l'invention du Brésil:
" L'homme traverse une phase intégralement politique de l'humanité. (...) Jamais plus il ne fut aussi "momentané" que maintenant. Les abstentionnismes et les valeurs éternelles peuvent rester pour plus tard. Et malgré notre actualité, notre nationalité, notre universalité, il y a une chose que nous n'aidons pas vraiment, une chose à laquelle nous ne participons pas: l'amélioration politico-sociale de l'homme. Et telle est l'essence de notre époque. (...) Faites ou refusez de faire de l'art, des sciences, des métiers. Mais ne restez pas là-dessus, espions de la vie, épiant la multitude passer. Marchez avec les multitudes." 1
3.2.2. LE MYTHE DE LA CIVILISATION BRÉSILIENNE
La fondation d'un projet politique nationaliste chez le modernistes brésiliens place la nationalité comme point de départ (ou comme postulat), mais aussi comme objectif ultime: ils se fixaient pour but de révéler la brésilianité aux Brésiliens pour les faire accéder à une utopique modernité. Ce projet prend donc la forme des mythes mobilisateurs et unificateurs du progrès et de la civilisation brésilienne.
79
Le progrès, pour les intellectuels brésiliens, imbibés de positivisme, c'est de "procéder d'en haut à la mise en forme de la société". Leur idéologie consiste à démontrer que le développement économique, l'émancipation des classes populaires, et l'indépendance nationale sont trois aspects d'un même projet , auquel se rajoute l'idée de la révolution par le haut. C'est dans ce "projet" que s'intègre le modernisme.
Le progrès n'est pas un mythe nouveau dans l'histoire des idées au Brésil, mais acquiert une force particulière dans les années 20. En effet, enraciné au plus profond de l'intellectualité brésilienne, le positivisme comtien aura largement influencé la conception moderniste du progrès. Cependant, le contexte euphorique de l'industrialisation et de l'urbanisation du pays donne un contenu nouveau à cette idée de progrès. L'idée de progrès est récurrente dans le futurisme qui exalte la machine et le progrès scientifique et technique et qui s'identfifie au nouveau et à la jeunesse .
a) Antécédents du mythe de la civilisation brésilienne
Le modernisme brésilien, s'il met en forme, comme nous le verrons, un mythe relativement nouveau dans l'histoire des idées politiques brésiliennes, rentre dans les schémes mentaux traditionnels opposant la civilisation à la barbarie. Il est inutile d'insister ici sur le fait que la civilisation, dans ce contexte, c'est la modernité.
Rentrant entièrement dans la conception traditionnelle de la civilisation, les modernistes, après avoir brièvement, pendant la période futuriste, cru à la possibilité d'un accès immédiat à la civilisation technologique et à la modernité, ont élaboré une conception plus complexe mais aussi plus classique de la civilisation.
En effet, après le constat de l'échec de l'immédiatisme (qui se fondait, au niveau de l'art, sur l'imitation des modèles européens "avancés" et donc civilisés) la modernité est conçue comme un processus historique, selon les grands modèles organicistes d'Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain (E. Gibbon,1776) . Ce processus historique, dans le cas moderniste, est représenté selon les auteurs, de façon cyclique ou linéaire. L'idée est que la décadence de l'ancienne civilisation touche à sa fin, et qu'une nouvelle est censée la remplacer.
La variante moderniste du vieux mythe de la civilisation est le principe selon lequel celle-ci aura à son centre la nation brésilienne, qui, retrouvant ses racines et son rapport à la nature hérité des Indiens, assumera la tête du progrès universel. La culture originelle est ici enrichie et modifiée par l'apport des races africaine et européenne. Le schéma de base est classique: le déclin de la civilisation passe par les différentes étapes du désordre, puis de la décadence, aboutissant à la barbarie. Inversant le processus, la modernité est supposée apporter, par le biais de la construction, l'ordre, le progrès et finalement la civilisation.
Même si tout au long du XIXe siècle, de l'affrontement entre barbarie et civilisation, l'Europe et surtout Paris sont les modèles incontestés du Progrès, l'idée de la décadence de l'ancienne civilisation, c'est-à-dire la civilisation européenne, est profondément enracinée dans la mythologie traditionnelle de la colonisation américaine.
Pour les ordres mendiants installés au Mexique, cette nouvelle Amérique devait constituer la plate-forme d'attente pour un royaume de mille ans infiniment espéré depuis des siècles. Et ce royaume de mille ans, ils ne voulaient le bâtir que sur des populations "aborigènes" préservées de tout contact avec les espagnols, jugés peu aptes à tenter une pareille aventure, en raison de leur peu de vertus1.
L'Amérique Latine -- cette utopie européenne --, avant même d'être inventée par les Européens, avait été longement espérée par ceux-ci, et cette attente s'était manifestée à travers les mythes de l'Eldorado, des Amazones, et certaines variantes de ceux de l'âge d'or ou de l'état de nature. Et la découverte du nouveau monde, avait laissé aux Européens l'impression du "merveilleux" de l'Amérique, dans le droit fil des légendes médiévales. Les premières îles découvertes par Christophe Colomb (San Salvador,
80
Cuba), aux aspects paradisiaques, paraissaient en effet être le terrain idéal pour faire renaître les utopies de l'âge d'or.
Sans prétendre faire l'histoire du mythe de la civilisation brésilienne et retrouver ses origines, nous pouvons signaler l'attention particulière attribuée par les modernistes à un certain nombre d'ouvrages qui ont profondément marqué les penseurs brésiliens et d'un façon plus générale, latino-américains .
D'une part, Le déclin de l'Occident, de l'allemand Oswald Spengler qui paraît en 1920, fait un gros succès outre-atlantique. L'auteur de cet ouvrage, empruntant la vision organiciste et cyclique de l'histoire de Giambattista Vico (1668-1744) et de Wilhelm Dilthey (1833-1911), s'attache à contester la «religion du progrès», dont l'Occident s'était fait le chantre, et à analyser les prodromes du déclin européen.
D'autre part, The rediscovery of North America, de Waldo Franck (1929), prolonge la thèse de Spengler, en soutenant l'idée que l'Amérique bâtirait une nouvelle civilisation sur les décombres du vieux monde.
Le mythe de la civilisation brésilienne, trouve sous une autre angle, quelques antécédents dans le nationalisme romantique mais essentiellement, il naît d'une réinterprétation du mythe progressiste du positivisme. Le positivisme au Brésil a profondément marqué l'histoire des idées politiques , et c'est à partir de ce corpus idéologiques que se crée en 1889 la République des Etats du Brésil. Cet héritage positiviste perdure jusqu'à nos jours, puisque la devise nationale, "Ordre et Progrès" est toujours inscrite sur le drapeau, et que le Brésil est l'un des rares pays où subsiste une église positiviste.
Nous ne devons pas survaloriser l'influence du positivisme chez les modernistes puisqu'ils en combattaient ouvertement l'esprit scientiste qui représentait pour eux un ordre dépassé. Cependant, leur influence est incontournable, et nous la retrouvons comme nous l'avons vu, dans le mythe du progrès. Mais leur influence ne se limite pas là, et est perceptible dans la conception verdeamarela de la nouvelle civilisation, où pointe l'idée qu'elle serait issue de la fusion des quatre races fondant la cinquième race qui nous ferait accéder à un stade supérieur de la civilisation.
b) La décadence de la société brésilienne et la prophétie moderniste d'un monde nouveau et rayonnant
Dans le cadre du modernisme, la vision de la décadence de la "vieille" civilisation s'exprime bien sûr par des considérations sur l'Europe, mais surtout sur la décadence de la société traditionnelle brésilienne.
Plínio Salgado exprime bien l'idée de la décadence européenne à laquelle il associe celle de l'aurore américaine: "Les institutions américaines reposent sur la roche vivante des droits de l'Homme. Quand tombera le déluge russe, ses dernières vagues viendront mourir ici sur ces murs (...). Et l'Amérique, alors, reconstruira ce qui aura été détruit dans le monde."1
Mais la prophétie moderniste de la civilisation nouvelle exprime surtout l'idée de décadence par la narration de la fin d'une époque de l'histoire brésilienne, époque où le peuple brésilien était assujetti à un système économique dépendant des intérêts du néo-colonialisme. Cette décadence de la culture et de la société brésilienne héritée de l'Empire est exprimée par la narration de la fin de la grandeur des grands planteurs et du Brésil rural traditionnel. Ce thème est cher aux modernistes, car comme nous l'avons vu, ils sont directement concernés par la déliquescence de l'oligarchie rurale, dont ils sont pour la plupart issus.
Ainsi, dès le pré-modernisme, la description des difficultés et de la décadence de la vie rurale est un thème central, abordé par exemple par Graça Aranha dans Canãa. Plantant le décor de sa narration, Graça Aranha fait du propriétaire d'une exploitation agricole, le colonel Affonso, la description suivante:
81
"Sa physionomie était triste, comme s'il avait conscience que retombait sur lui tout le poids de la ruine de sa race et de sa famille; (...) l'épuisement de ses facultés émotives et sensitives était total, et le réduisait à l'attitude misérable d'un automate. Mais même ainsi, il représentait encore la figure humaine, cette même vie supérieure, emportée dans la chute des choses, traînée dans la ruine générale. Et il n'y a pas de vision plus douloureuse que celle où l'action du temps, la force de destruction ne se limite pas seulement aux traditions et aux êtres inanimés, mais emporte dans la déchéance les personnes, et les paralyse, les fulmine, faisant d'elles les axes centraux de la mort, et augmentant la sensation désolante d'une mélancolie infinie"1 .
Mais la décadence de cette forme de civilisation est surtout l'apanage du roman régionaliste du nordeste dont Canãa est le précurseur. Nous pouvons cependant citer quelques noms clés de ce genre particulier de la "littérature brésilienne", comme celui de José Lins do Rêgo, qui dès son premier roman Bangüê (1934), décrit la fin d'une période faste de l'économie et de la société brésilienne, celle où l'engenho* se plaçait au centre du monde, cet équilibre étant remis en cause par l'industrialisation des techniques et la rupture des hiérarchies traditionnelles.
La vision moderniste de la décadence est un tremplin utilisé pour aborder la question de la civilisation nouvelle, celle dont ils annonçaient la construction. Le Brésil est une nation jeune, un peuple nouveau dont les potentialités permettent de croire, dans le contexte euphorique des années 20, à la possibilité d'une civilisation brésilienne rayonnant sur le monde occidental décadent.
Le thème de la jeunesse est récurrent dans la littérature moderniste des années 20. Dans les manifestes littéraires, la jeunesse apparaît comme le caractère de l'avant-garde ayant pour mission de rénover les formes de l'art au Brésil. Mais elle est en même temps assimilée au caractère de la nation qui elle aussi est jeune. Cette jeunesse est symbolisée dans les romans, comme dans les récits épiques soit par des personnages infantiles, soit par une vision et un langage lui-même infantile .
La foi dans le progrès qui se manifeste à travers le modernisme prend une intensité particulière car elle est liée au climat euphorique qui caractérise l'entre-deux-guerres des grandes villes au Brésil. Les réformes du centre de Rio de Janeiro sont témoins de ce désir de se "mettre à jour". São Paulo reflète également cette ambiance qui se "métropolise" rapidement, avec des projets urbanistiques et une prospérité du café assurant le nouveau processus d'industrialisation. Tout paraissait contribuer à un climat de foi en l'avenir.
Cette passion pour le progrès et pour la ville (intimement associés dans le discours moderniste) se manifeste dès les premier temps du modernisme, dans un ouvrage comme Paulicéia Desvairada, ("São Paulo hallucinée") lancé par Mário de Andrade en 1922. Blaise Cendrars, de passage à São Paulo, en 1926, sera un témoin averti de cette ambiance d'euphorie qu'il retranscrira dans son Brésil, des hommes sont venus... (1e édition 1952):"Saint-Paul / j'adore cette ville / Saint-Paul est selon mon cœur / Ici nulle tradition / Aucun préjugé / Ni ancien ni moderne / Seuls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure de tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord sud égyptien-yankee-cubiste / Sans autre préoccupation que de suivre les statistiques prévoir l'avenir le confort l'utilité la plus value et d'attirer une grosse immigration / Tous les pays / Tous les peuples / J'aime ça (...)"1
São Paulo est donc présenté par les modernistes comme point central de la civilisation émergente.
82
Cette opposition entre deux mondes, l'un dépassé, en ruines, et l'autre nouveau, spontané, avec tout l'avenir devant-lui, est particulièrement clairement exprimée dans Canãa, au moment où les héros du roman (Milkau et Felicissimo) découvrent le paysage campagnard, du haut d'une colline.
"Milkau, lisait dans ce vaste panorama l'histoire simple de cette terre obscure. Porto do Cachoeiro était la limite de deux mondes qui se touchaient. L'un traduisait, dans le paysage triste et •esbatida• du levant, le passé, où la marque de la fatigue s'étaient gravées sur les choses •minguadas•. Là, nous voyions des restes de fazendas, des maisons abandonnées, des senzalas en ruines, des chapelles, tout cela avec le parfum et la génération de la mort. La chute d'eau était la division. De l'autre côté de celle-ci (...) [il] y avait une terre nouvelle, prête à abriter l'avalanche venant des régions froides de l'autre hémisphère et lui descendant aux seins chauds et •fartos•; et c'est là que devait germer le futur peuple qui couvrirait un jour tout le sol, et la chute d'eau ne séparerait plus deux mondes, deux histoires, deux races qui se combattent (...)" 2.
Le Brésil est constamment représenté, alors même que l'on prétend à l'antériorité de la nation brésilienne par les racines tupi, comme une nation jeune. Dans les textes de la tendance verdeamarela le Brésil est montré avec fierté: d'un côté c'est un géant, de l'autre un enfant. Malgré les différences entre courants, il se dégage du modernisme une idée centrale dans leur représentations et leurs métaphores du Brésil: sa potentialité.
Graça Aranha met en scène avec une discussion entre le héros Milkau et Lentz, les débats entre nouvelle et ancienne conception de la civilisation. Pour Milkau: "Les races se civilisent par la fusion; c'est dans la rencontre des races avancées avec les races vierges, sauvages, que se trouve le repos conservateur, le miracle de la réjuvenescence de la civilisation" 3. "Mon culte de l'humain est actif, et réside dans la double conscience de la continuité et de l'indéfinition du progrès. Ce que l'Europe nous montre, comme forme de vie, est seulement une prolongation désharmonique des forces d'hier et des sollicitations du présent"4.
La conception de la culture exprimée par Graça Aranha dans ce texte est incontestablement moderniste avant l'heure . En effet, pour Milkau: "(...)la crise de la culture est ici motivée par la divergence de stades de civilisation des différentes classes du peuple (...). Il n'y a pas de races incapables de civilisation, toute la trame de l'histoire est un processus de fusion: seules les races stagnantes, c'est-à-dire celles qui ne se fondent pas avec les autres, qu'ils soient noirs ou blancs, se maintiennent dans l'état sauvage" 5.
Le mythe de la cinquième race est donc substitué, avec l'émergence de l'idée de la civilisation brésilienne dans le cadre du mouvement moderniste, par celui d'une culture alliant au sein de la nationalité les potentialités de ses multiples apports ethniques.
3.2.3.- FONDEMENTS MODERNISTES POUR LA CONSTRUCTION DE LA NATION
Les modernistes, de par leurs représentations politiques, c'est-à-dire, leur vision de la nation, l'identité qu'ils s'attribuent, et d'une façon générale, leur mythologie politique, mettent en place un projet politique dont l'ampleur des implications transparaît au regard de la sociologie et de l'anthropologie. Cet imaginaire politique moderniste, s'il trouve comme nous allons le montrer, des fondements philosophiques et métaphysiques communs, se manifestera concrètement dans des tendances partisanes diverses,
83
principalement entre Parti Républicain Paulista et le Parti Démocrate pendant les années 20, et entre le fascisme intégraliste et le communisme pendant la décennie qui suit.
Le projet national moderniste que nous avons identifié précédemment, prend forme dans un contexte intellectuel particulier qui explique l'écho qu'a pu avoir le modernisme dans les milieux intellectuels et politiques conservateurs, ainsi que la réaction sarcastique de la seconde dentition anthropophagique.
a) A Estética da vida, fondement philosophique du modernisme
Avec la fin de la première guerre mondiale, le mythe scientiste du progrès indéfini et tout son corollaire de valeurs avaient été démasqués, et avaient perdu de leur prépondérance. Raisons, lois, développement linéaire, modèles civilisateurs, etc., sont associées par les penseurs de la modernité, aux représentations dépassées d'une époque révolue. Dans ce contexte, les théories de Bergson, la valorisation de l'intuition et de l'émotion sont décidément plus attractives, car elles offrent une nouvelle place à l'art dans le champ de la connaissance. Liée à l'émotion et à l'intuition, l'art est consacré par les modernistes comme dépositaire de valeurs supérieures devant exercer une action plus dynamique au sein de la société.
Partant de ces bases, les modernistes s'affirmant en tant qu'intellectuels, posséderaient un savoir sur le social, admis et valorisé par d'amples secteurs de la société qui reconnaîtraient leur aptitude à définir le national et à dire les conditions de son organisation. Dans ce contexte, la connaissance du social et du national se fonde sur l'intuition.
A Estética da Vida ("L'esthétique de la vie" ), est un ouvrage qui est passé plutôt inaperçu dans les débats esthétiques des années 20. Mais pour Eduardo Jardim de Morais1, cet essai, publié pour la première fois en 1921, sert de repère pour tous les modernistes. Les questions soulevées et les solutions proposées par ces écrivains pendant toute la période que nous avons étudiée y sont en effet déjà présentes en germe, et parfois même expressément.
Graça Aranha anticipe dans cet ouvrage la vaste problématique de la brésilianité, telle qu'elle sera vue par les différentes tendances du mouvement, au cours des années qui suivent, et surtout à partir de 1924. Lisant l'histoire du modernisme à travers l'œuvre de Graça Aranha A estética da vida, à la façon de Eduardo Jardim de Moraes , nous pouvons, en fait, retrouver les racines philosophiques de la conception moderniste de la culture, de la société et de la politique, dans les textes de Tobias Barreto (Ecole de Recife, Pernambuco). Tobias Barreto voit l'univers comme un tout infini se présentant à nous comme un spectacle en mouvement.
Tobias Barreto recherche une vision synthétique de l'univers (et non pas une vision parcellaire comme la science). Vision du tout, intégration dans le cosmos sont des objectifs qui ne peuvent être atteints que par les voies émotionnelles ou intuitives comme la religion, la philosophie, l'art et l'amour. Cette vision synthétique de l'univers ne s'obtient qu'à travers l'intégration de l'homme dans la nature.
Graça Aranha, partant sur ces bases insistera plus sur l'importance de la culture pour l'adéquation de l'homme à la nature. Les trois travaux moraux énoncés par Tobias Barreto pour intégrer l'homme dans le Cosmos, s'appliquent avec Graça Aranha, à l'art et aux diverses manifestations de la culture.
Le premier travail, celui de la résignation à la fatalité cosmique, exige que l'art se détache de l'anecdotique, de la liaison au sujet ou à la thèse, ainsi que des fonctions représentatives-mimétiques, pour pouvoir exprimer et préciser le sentiment vague d'unité infinie de l'univers. Une œuvre plastique ou la musique, qui ne signifient rien, mais "sont" simplement, réalisent le mieux la fusion de l'esprit au tout.
84
Cette conception de l'art est largement illustrée par la tendance expérimentaliste des premiers modernistes, et surtout par leur mépris de toute forme d'art représentatif, de théâtre à thèse, ou de toute esthétique naturaliste. Une application, indirecte et involontaire, de la pensée de Graça Aranha se fait dans le Manifesto da Poesía Pau-Brasil:
"(...)Il y avait eu l'inversion de tout, l'invasion de tout: le théâtre à thèse et la lutte des moraux et des immoraux sur la scène. La thèse doit être décidée par la guerre des sociologues, d'hommes de loi, gros et dorés comme le Corpus Juris. Que le théâtre soit agile, fils du saltimbanque. Agile et illogique. Que le roman soit agile, né de l'invention. Que la poésie soit agile.La poésie Pau-Brasil. Agile et innocente. Comme un enfant. (...)Le naturalisme devint une institution. Copier. Des brebis peintes sur une toile qui ne fût pas de laine ne valait rien (...)"1.
La seconde tâche à réaliser pour l'art est, selon l'idée de Tobías Barreto , l'intégration à la Terre, son intégration au rythme de la nature. Graça Aranha , considérant que le travail humain se fait en conformité avec le rythme universel de la modernité, l'art ne saurait rester figé en dehors du temps moderne. C'est là l'essentiel de la pensée moderniste sur la temporalité, sous la forme futuriste en un premier temps, mais surtout sous la forme de la brésilianité qui cherche à mettre en adéquation les expressions culturelles à la nature locale. C'est d'ailleurs pour cette même raison que les Indiens incarnent la brésilianité, car en effet, ils semblent s'être intégrés au mieux au rythme de la nature.
Le troisième travail moral à effectuer étant la liaison avec les autres hommes, la transposition de cette question dans le domaine esthétique, nous amène à celle de la position de l'artiste envers les autres hommes. Face à la création de l'artiste, les émotions de ceux qui la contemplent est le chemin de la fusion de la communauté dans le tout universel. Attaché d'un côté à la terre qu'il perçoit de façon synthétique, et de l'autre aux hommes, l'artiste a la possibilité de mener les autres hommes à la fusion de la communauté avec le Cosmos Infini. Cette idée rejoint finalement le thème de l'avant-garde et de l'importance de son engagement pour le progrès et l'intégration à l'esprit universel par le biais de la modernité et de la construction de la civilisation brésilienne.
Appliqué à la situation brésilienne du début des années 20, cette philosophie explique pour beaucoup les schémas mentaux mis en place par les modernistes de toute tendance. Graça Aranha, se prononçant, dans A Estética da Vida, contre toute forme de pédantisme de la fausse culture (inculquée ou importée, sans aucune adéquation avec le milieu et l'homme), il annonce que les modernistes devront synthétiser toute la réalité brésilienne, notamment en faisant l'épopée des éléments barbares de la culture brésilienne, qui furent en un premier temps reniés. La tâche de l'artiste est finalement pour Graça Aranha d'élaborer un projet culturel (enraciné dans le sol de la nation), et qui devra se constituer à partir d'une nouvelle relation à la nature brésilienne.
L'imaginaire et le projet politique du modernisme semble donc bien prendre racine dans l'Ecole de Recife, à travers l'œuvre de Graça Aranha.
b) Le nationalisme et ses fondements philosophiques au Brésil
Dans cette perspective, la constitution et le succès de cet imaginaire politique, ainsi que l'importance du projet national moderniste dans la politique de l'époque, sont en grande mesure liés à un contexte idéologique national et international où prédomine la question de la nationalité, et où les fondements de l'ordre libéral sont remis en cause.
Les années 20 sont marquées par un contexte international où l'ultra-nationalisme et le fascisme prennent de l'essor. Avec l'après guerre, le mythe libéral de l'ère internationale qui rendait caducs les nationalismes, s'effondre.
85
La faillite dans l'après guerre du projet libéral amena la remise en question profonde d'une certaine idée de la raison et de la rationnalité en politique, en culture, en art (ouvrant une brèche dans laquelle allait pouvoir se développer le fascisme). Ce nationalisme, dans le contexte de réorganisation des forces après la Première Guerre, servit donc de base idéologique à la production littéraire que nous avons étudiée, et explique l'importance de l'irrationnalisme et de l'intuition dans les textes modernistes.
De façon genérale, nos écrivains suivent le contexte politique de l'époque, et se positionnent contre le libéralisme qui fait obstacle à l'affirmation nationale par l'imitation de modèles étrangers.
Le nationalisme moderniste s'est développé autour de la question de la modernité culturelle, et prend pour postulat philosophique de base, que c'est par l'affirmation des nationalités que nous parviendrons à l'intégration à l'universel car il n'est pas possible de passer à l'intégration universelle, sans avant procéder à l'adéquation de l'âme nationale à la nature du pays.
Définitivement assimilés aux intellectuels, les écrivains modernistes prennent place dans un contexte idéologique avec lequel ils entretiennent des relation serrées. Au début du siècle, nous assistons au sein de la classe intellectuelle brésilienne à une vague nationaliste associée à une forte volonté de modernisation culturelle, à un certain réveil catholique et à une poussée anti-libérale. Un corpus idéologique se forme dans les secteurs militaro-politiques (avec Euclides da Cunha, Alberto Torres, Jackson de Figueiredo, et Oliveira Vianna). Cet ensemble d'idées, au sein desquelles le modernisme prend une place croissante à partir de la fin des années 20, donne à certaines sphères de l'élite politique brésilienne, les outils mentaux nécessaires pour soulever et penser la remise en cause d'un système politique et économique dépendant (dont la survie était assurée par l'économie du café, qui empêchait un développement industriel du pays) .
Cette catégorie d'hommes politiques étroitement liée à l'intellectualité, a pris conscience de deux urgences: celle de forger une conscience nationale et celle de promouvoir une organisation nationale.
Alberto Torres semble être l'une des figures centrales du nationalisme brésilien. Son œuvre aura constamment été rééditée et reinterprétée après sa mort (1917), alors même que de son vivant il était resté isolé. C'est une référence majeure du mouvement des lieutenants en 1922, et sa pensée prend un sens nouveau avec la révolution de 1930. Il souligne dans ses textes l'urgence de la construction nationale et de l'instauration de "critères de jugement sur les choses les plus simples de la vie sociale" propres aux Brésiliens. Il insiste aussi sur le besoin des modifications des structures mentales par la réforme des institutions économiques et étatiques:
"La Nationalité, c'est la vie d'un peuple, faite par la chaleur et par l'énergie d'un esprit, sur la santé d'une économie. Nous sommes tenus de fonder l'économie de notre patrie. (...) Pour cela, il n'y a qu'un seul chemin à suivre: tracer sa politique; et pour concevoir sa politique, il faut former une Conscience Nationale . L'autonomie d'un peuple naît dans sa conscience". 1
Le projet national moderniste semble donc devoir entrer en continuité avec cet idéal qu'ils interprètent et récupèrent à leur profit. Ils se sentent responsables de la production de l'identité nationale qui pour eux aussi est le point de départ de la construction de la nation et de son développement économique et politique.
Plínio Salgado, alors même qu'il cherchait à prendre du recul par rapport au modernisme, procède dans le Manifeste intégraliste d'octobre 1932, à une récupération des idées d'Alberto Torres, auquel il s'identifie. Pour lui, la construction d'un modèle politique propre à la nationalité est essentiel:
"Depuis la monarchie nous avons vécu avec la préoccupation d’imposer à notre pays des systèmes politiques étrangers. Nous avons
86
fait l’expérience du parlementarisme anglais, jusqu’en 1889; depuis, nous nous sommes tournés vers le modèle américain et, maintenant, c’est toujours entre les États Unis, l’Italie, et la Russie qu’oscille une certaine mentalité qui prétend nous imposer des imitations. Ainsi nous ne devons pas transplanter au Brésil, ni communisme ni fascisme (c’est nous qui le disons) ni d’autres systèmes exotiques. Le Brésil, jusqu’à aujourd’hui, -- rappelait Alberto Torres -- a servi la République; il faut que dorénavant la République serve le Brésil.(...)"1
Mais la construction du système politique brésilien doit avant tout passer par la construction de la conscience nationale. Les modernistes semblent ainsi devoir s'aligner sur le reste de l'intellectualité brésilienne, dans la perspective de procéder à la mise en forme de la société. Les écrivains modernistes s'allient ainsi à des auteurs qu'ils ont souvent critiqués, comme Monteiro Lobato, Sílvio Romero, Oliveira Vianna, s'associant à eux dans leur projet de construction de la conscience nationale, par le biais de la culture, et de l'art.
L'absence d'identité nationale est la lacune principale du Brésil, pour les modernistes, et pour la plupart des intellectuels. Pour Ronald de Carvalho, par exemple, le Brésil a des possibilités immenses, mais apparaît comme peuple en formation. Dans ses "terres immenses, dépeuplées", surgissent des "conflits d'intérêts économiques, entre les différents groupes humains qui habitent nos Etats", provoquant "instabilité de la fortune publique, manque d'esprit de cohésion, méconnaissance des exigences de la collectivité". La génération moderne doit alors créer "un art direct, pur, profondément enraciné dans la structure nationale, un art qui fixe tous nos tumultes de peuple en gestation". "L'erreur primordiale de nos élites, jusqu'à aujourd'hui, a été d'appliquer au Brésil, artificiellement, la leçon européenne"2 .
A cette conception du projet politique brésilien, s'ajoute chez les modernistes, un élitisme qui est dû, nous l'avons vu, à leur identité et au rôle qu'ils s'imaginent dans la société. Cette attitude est typique des nationalistes conservateurs, chez qui l'élitisme est consubstantiel à la représentation qu'ils se font du social. Mais même les libéraux sont convaincus que la République est incapable de former les élites nécessaires à la modernisation et conçoivent la nécessité de formation de nouvelles élites.
La production idéologique moderniste prend donc dans cette perspective un sens nouveau, qui est celui de fournir les outils intelectuels et mentaux nécessaires pour procéder à la mise en forme du peuple et de la nation. C'est principalement dans ce sens qu'évolue l'école de l'Anta, issue du courant verdeamarelo, qui quittera finalement le domaine littéraire pour s'occuper essentiellement de politique.
La personnalité de Plínio Salgado incarne le mieux cette évolution. En effet, il aura, tout le long des années 20,milité activement dans des partis politiques (le PRP, au début), et sera élu député à plusieurs reprises; il fonde en 1932 l'Ação Integralista Brasileira, qui est un mouvement politique extrêmement proche du fascisme portugais. Cette radicalisation de son propos se voit bien dans sa production romanesque (la trilogie O Estrangeiro, O Esperado, et O Cavalheiro de Itararé).
Après avoir étudié dans O estrangeiro, le problème plus important d'un peuple encore non défini ethniquement, c'est-à-dire le problème du métissage, il conclut que son produit sera psychologiquement brésilien. Dans O esperado, et dans O Cavalheiro de Itararé, il passe à l'observation du caractère social, politique, moral et spirituel de ce peuple. Il défend et prêche, dans O Esperado, la foi en Dieu, dans O Cavalheiro de Itararé, la croyance dans l'Esprit.
Dans O Esperado, édité pour la première fois en 1930, Plínio Salgado met en scène les tensions entre le capital et le travail, accusant les grands bourgeois de ne penser qu'à leur négoces, et d'être entièrement indifférents à la réalité de la vie brésilienne. Il
87
accuse d'autre part l'anti-patriotisme de l'impérialisme commercial, et montre que dans les démocraties libérales, le peuple passe toujours au second plan.
Cette réflexion de Plínio Salgado aboutit finalement à un projet politique très proche du fascisme et qui fait de nombreux emprunts à la "droite révolutionnaire" européenne (Sorel, Spencer, Vacher de Lapouge, Gumplowicz, Gustave Lebon..). Ainsi pouvons-nous mieux comprendre l'évolutionnisme, l'irrationnalisme, et l'organicisme largement présents chez la plupart de nos auteurs, leur glorification des spécificités nationales et des racines propres au Brésil, leur exaltation des origines tupi de la Nation . "Pénétrer les racines de l'âme nationale était le premier pas d'un obscur et long chemin à parcourir jusqu'au jour où sonnera l'heure de la réunion"1. Et ces racines, il faut les chercher chez les premiers habitants du Brésil, chez les Indiens.
Le projet politique issu du courant de l'Anta s'exprime en quelque sorte dans le manifeste Intégraliste de 1932. Les premiers mots de celui-ci sont "Deus dirige os destinos dos povos" ("Dieu dirige les destins des peuples"). Le manifeste se divise en plusieurs parties qui sont: l'Homme (l'homme "intégral", créé à l'image de Dieu), la Famille (premier groupe social naturel; idée du salaire familial présente dans O Estrangeiro), la Municipalité (conçue comme cellule mère de la Nation Brésilienne), la Nation et l'État (autorité morale irrécusable, car constituée d'hommes conscients de leurs droits et surtout de leurs devoirs face à Dieu, face à la Patrie, et face au Peuple qu'ils dirigent).
c)La Révolution Anthropophagique contre l'école de l'Anta
Oswald de Andrade et Raul Bopp, prenant conscience de la dérive progressive du mouvement anthropophagique vers une expression artistique codifiée et vers un nationalisme systématique, prennent une position critique radicale, dans le seconde dentition de la Revista de Antropofagía. La radicalité de leur propos, sous le titre de "révolution anthropophagique" renie la première dentition qui s'était laissée influencer par le verdeamarelismo et l'Ecole de l'Anta.
L'opposition au verdeamarelismo et à Anta est constamment réaffirmée, et prend une attitude et un vocabulaire révolutionnais. La contestation du manifeste du Verdeamarelismo apparaît dans l'article "Une adhésion qui ne nous intéresse pas": "Non! Nous ne voulons pas, comme les graves enfants du verdeamarelo restaurer des choses qui ont perdu leur sens - l'anta et la dame bourgeoise, le sonnet et l'académie."1
En effet le manifeste verdeamarelo, supposément avant-gardiste, affirmait: "Nous acceptons toutes les institutions conservatrices, car c'est en elles même que nous réaliserons la rénovation innévitable du Brésil, comme le fit, au cours de quatre siècle, l'âme de nos gens, à travers toutes les expressions historiques(...)"2. Aussi les anthropophages rétorquent "(...)les verdeamarelos d'ici veulent le pourpoint et l'esclavage moral, la colonisation de l'Européen arrogant et idiot, et au milieu de tout cela, le Guarani d'Alencar• dansant une valse. Une adhésion comme celle-là ne nous sert à rien, puisque l'"anthropophage" n'est pas l'Indien des étiquettes de bouteilles. Évitons cette confusion une fois pour toutes! Nous voulons l'anthropophage de knicker-bockers et non l'Indien d'opéra".
La critique du verdeamarelismo et d'Anta devient donc l'une des constantes thématiques de la "seconde dentition" anthropophagique. Nous retranscrivons à suivre, un épigramme contre les verdeamarelistas, paru dans le nº6 de la "seconde dentition", probablement écrit par Oswald de Andrade (il est signé Jacó Pum-Pum).
COMBINAÇÃO DE CORES C O M B I N A I S O N S D E COULEURS
Verdeamarelo Vert-jauneDá azul? Ça fait du bleu?Não. Non.Dá azar. Ça porte malheur.
88
Jacó Pum-Pum
Même si sous certains aspects, la critique pamphlétaire de la seconde dentition anthropophagique, était superficielle, il nous faut reconnaître qu'elle a mis ici le doigt sur le point faible du modernisme. Celui-ci était né compromis avec les forces conservatrices, alors même qu'il voulait se libérer de tout carcan, et il s'acheminait déjà vers une nouvelle forme d'académisme. En résumé, Oswald et sa tribu d'anthropophages s'insurgeait contre la perte du caractère iconoclaste et novateur du mouvement, et contre la dilution de la révolution moderniste.
La seconde dentition anthropophagique apparaît finalement comme un terrorisme littéraire dont l'objectif principal est de rétablir la ligne radicale et révolutionnaire du modernisme, que l'on sentait soit pâlir dans la dilution et le ramollissement, soit s'orienter dans un conservatisme réactionnaire. Mais au-delà, Bopp, Oswald, et ceux de la seconde dentition, comptaient lancer les bases d'une nouvelle idéologie: la dernière utopie qu'Oswald irait rajouter plus tard à ce qu'il a appelé la "marche des utopies".
Oswald de Andrade, expliquant sa conception de la révolution anthropophagique (dans A Marcha das Utopías et A Crise da Filosofía Messiânica) imaginait que les sociétés primitives seraient capables d'offrir des modèles de comportement social plus adéquats à la réintégration de l'homme par la pleine jouissance de l'oisiveté que devait pouvoir offrir la civilisation technologique.
Son projet politique s'écarte alors largement de ce que proposaient l'école de l'Anta. La formulation essentielle de l'homme, comme problème et comme réalité, dans la théorie anthropophagique d'Oswald de Andrade, pourrait se résumer schématiquement dans une dialectique: Premier terme (thèse):l'homme naturel; second terme (antithèse): l'homme civilisé; troisième terme (synthèse): l'homme naturel technicisé. L'humanité en serait pour Oswald de Andrade, resté à la seconde étape, qui est la négation pure de l'être humain, et dans laquelle il aurait été précipité par la culture messianique.
L'idéologie anthropophagique s'affirme donc finalement dansun projet politique qui s'oppose à la culture "messianique", répressive, fondée sur l'autorité du père, la propriété privée et l'État, Oswald défendait la culture "anthropophagique", correspondant à la société matriarcale et sans classe, ou sans État, qui devrait surgir avec le progrès technologique, pour rendre l'homme à la liberté originelle, dans un nouvel Âge d'Or.
L'anthropophagie ne se situe donc plus sur le seul plan littéraire, et ne s'affirme plus sur le plan politique par l'intermédiaire de propositions esthétiques ou sarcastiques. "La descente anthropophagique n'est pas une révolution littéraire. Ni sociale, Ni politique. Ni religieuse.Elle est tout ça en même temps." 1. Condamnant "la fausse culture et la fausse morale de l'Occident", les partisans de l'anthropophagie s'investissent contre les spiritualistes, les métaphysiques, les nationalistes d'inspiration fasciste.
Mais ils refusent aussi les extrêmismes de la gauche canonique: "nous sommes contre les fascistes, de quelque espèce, et aussi contre les bolchevistes, aussi de quelque espèce qu'ils soient. Ce qu'il y aura dans ces réalités politiques de favorable à l'homme biologique, nous le considérons bon. C'est à nous. (...) Comme notre attitude face au Primat du Spirituel ne peut être que dis-respectueuse, notre attitude envers le marxisme sectaire sera aussi celle du combat. (...) Quant à Marx, nous le considérons l'un des meilleurs "romantiques de l'Anthropophagie"2. Un certain anarchisme semble animer le groupe, alors qu'il cherchait encore la définition d'un nouvel humanisme, revitalisé par la vision de l'homme naturel américain.
Le projet politique anthropophagique prend une forme ultime dans l'avant-dernier numéro de la Revista de antropofagía, du 19 juillet 1929 où est annoncée l'organisation du Premier Congrès Brésilien d'Anthropophagie, pour l'étude de "quelques réformes de notre législation civile et pénale et de notre organisation politico-sociale". Entre ces
89
propositions, il y a le divorce, la maternité consciente, l'impunité de l'homicide compatissant, la nationalisation de la presse, la suppression des académies et leur substitution par des laboratoires de recherche. Enfin, entre autres propositions, ils affirment: "(...) nous sommes pour l'enseignement laïc. Contre le catéchisme dans les écoles. N'importe quel catéchisme (...)".
Mais c'est ce radicalisme de la revue, en dehors du domaine purement littéraire ou symbolique qui l'amènera à sa fin . Rubens de Amaral, du Diário de São Paulo, suite à l'agressivité du ton pris par le groupe anthropophage, se sentit obligé d'en finir avec la Revista de Antropofagía, au sein de ce journal.
En octobre 1929, il y eut le crach de la Bourse et la crise du café. Oswald et Pagu s'engagèrent dans le Parti Communiste, s'écartant ainsi des idées de l'anthropophagie, auxquelles ils ne reviendront qu'après 1945.
L'aboutissement des tendances anthropophagiques et verdeamarela aura donc mené la postérité à les dissocier entièrement. Mais nous avons vu qu'ils avaient été intimement unis pendant les années 20 dans la fondation d'un imaginaire nationaliste commun. L'évolution des deux mouvements, dans la radicalisation conservatrice ou dans la radicalisation critique, fera que la critique littéraire postérieure à 1945 dissociera effectivement les deux mouvements, assimilant la première tendance au modernisme, et ayant tendance à passer sous silence l'importance de la seconde.
Mais nous pouvons en quelque sorte affirmer que la communauté de destin entre tendances modernistes perdure dans la période qui suit, malgré bien sûr quelques divergences liées à des prises de position politiques radicalement opposées. En effet, nous pouvons constater une proximité des modernistes avec les institutions politiques et du pouvoir en général, tant pour les personnalités issues d'Anta (Menotti et Plínio) que pour des personnalités plus proches de la perspective anthropophagique (comme Mário de Andrade). L'exception se fait surtout avec des personnalités comme Oswald de Andrade qui, en tant qu'"hommes sans profession" s'engagent politiquement dans le discours, mais ont les moyens de rester détachés du jeu du pouvoir.
Le modernisme (à l'exception de la seconde dentition anthropophagique), dans la séquence de son évolution, montre finalement un penchant paradoxal vers une "modernisation conservatrice". Sa lutte pour l'innovation n'arrive que superficiellement à mener la culture brésilienne à la modernité. "Les apparences trompent, mais servirent, au moins, à produire un exercice culturel capable de mener la société à débattre ses propres valeurs symboliques et à dynamiser son système de production et de circulation de l'art.(...) Le modernisme aurait été une espèce de rituel de passage pour l'effective réalisation du moderne dans l'art brésilien (...)."1
Renato Ortiz dans A moderna tradição brasileira2 ("la moderne tradition
brésilienne") considère que le modernisme (il parle du modernisme des pays périphériques en général): "est obligé de se construire sur des fantômes et des rêves de modernité" (...)le désir de modernité anticipe dans ce cas la réalité, et la modernité devient liée à la construction de l'identité nationale. Ainsi se confirme l'idée centrale du modernisme brésilianiste que le Brésil ne sera moderne que s'il est national.
Cette idée prend donc forme pendant les années 20, et guidera toute les tentatives de construction de la nation à travers la culture ou l'action de l'Etat. Ortiz pousse cette idée jusqu'au point d'affirmer qu'au Brésil, la modernité finit par ne plus être questionnée et par être assumée comme une valeur en soi. La modernité, valeur implantée par les modernistes, était avant tout une utopie, et s'impose finalement en tant que telle. Elle devient une norme, une tradition. Etre moderne, à partir de ce moment là, c'est être conservateur. C'est contre ce processus d'institutionnalisation des avant-gardes que réagit
90
sans succès réel la "seconde dentition anthropophagique". L'institutionnalisation des avant-gardes caractérise le parcours intellectuel et littéraire des modernistes, et est due d'une part au processus d'industrialisation et de mercantilisation de la production artistique, mais elle est surtout liée au contexte socio-politique des années 20, qui fait que ces artistes deviennent progressivement des intellectuels au service de l'Etat.
91
Conclusion
L’épopée moderniste au cours des années 20 a donc été un phénomène dont nous pouvons maintenant mesurer l’ampleur des implications politiques. Les modernistes au cours de cette période ont développé un rhétorique qui leur a permis de s’intégrer dans une société où leur statut d’héritiers ne leur garantissait pas une position prestigieuse. S’affirmant sur la scène politique en tant qu’intellectuels, ces écrivains ont pris place dans un contexte idéologique où le nationalisme était prépondérant. Par leurs démarches sociales et idéologiques, les modernistes ont contribué pour une grande part à l’avènement de nouvelles structures de pouvoir au Brésil, s’assurant une place privilégiée au sein de celles-ci en tant qu’intellectuels et hommes de culture.
La fin des années 20 s’annonce cependant comme un moment de rupture pour le modernisme. D’une part, sur le plan politique, l’aboutissement des démarches idéologiques a mené à des positions contrastées où s’opposent essentiellement l’école anthropophagique (qui disparaît en tant que telle avec la fin de la Revista de Antropofagía, en 1929) aux personnalités issues du mouvement de l’Anta. D’autre part, l’évolution de la vie politique brésilienne les mènera à adopter une nouvelle position sur le plan du nationalisme. En effet, nous pouvons considérer que 1930 est un moment charnière du modernisme, en ce qu’il passe d’un nationalisme rhétorique (constitution d’un imaginaire politique) à un nationalisme constructif (impliqué dans l’action politique et culturelle de construction de la "conscience nationale"). Ce nationalisme constructif se manifestera soit par l’engagement dans des carrières politiques (Plínio Salgado crée en 1932 l’Ação Integralista Brasileira, organe politique à tendance fasciste) soit par la participation des écrivains aux politiques culturelles publiques (Mário de Andrade contribue à la création en 1937 du SPHAN, Service du Patrimoine Historique et Artistique National).
Cette rupture au sein du mouvement moderniste prend place dans une rupture plus large, au niveau de la vie politique du pays. L’année 1930 symbolise en effet l’échec définitif de l’oligarchie, et du monopole du pouvoir entre les mains des élites de São Paulo et Minas Gerais: c’est la fin de la República Velha et des dernières traces de la «politique du café au lait». Les élections présidentielles de 1930 sont marquées par la candidature de Getúlio Vargas (de l’État du Rio Grande do Sul) qui s’allie à João Pessoa (président d’une province secondaire du nordeste) et aux élites foncières plus modeste que celles de l’oligarchie rurale. De son échec aux élections résultera la Révolution de 1930 et la mise en place de la República Nova (la nouvelle république).
Le Brésil traverse une crise politique profonde qui durera tout au long des années 30, car l’Etat Brésilien vit une crise de légitimité qui se manifeste par une remise en cause de son monopole de la violence physique. Les population urbaines sympathisent en effet avec les participants des diverses révolutions qui ont agité la période qui va jusqu’en 1937. La diversité des opposants et l’ampleur des crises
92
politiques au cours de cette période expliquent les alliances de dernière heure entre forces politiques hétéroclites et l’absence de programmes à l’issu de chaque crise.
C’est la volonté de donner sens à ces différentes victoires sur l’oligarchie qui explique le succès accru des idées nationalistes et notamment des idées modernistes. L’échec des oligarchies, fondées sur un pouvoir régional, sera interprété comme favorisant la constitution d’un Etat National. L’intérêt des intellectuels modernistes va bien dans le sens du renforcement de l’Etat National, car le besoin de reconversion des familles de planteurs se renforce, et cette reconversion est facilitée par la forte expansion des postes publics.
Dans l’histoire des mentalités politiques au Brésil, les années trente apparaissent comme le moment de consécration de l’idéologie nationaliste à laquelle avaient largement contribué les modernistes. Cette consécration se manifestera d’une part par une reconnaissance et d’une divulgation des écrivains au niveau du marché éditorial, et d’autre part, par un resserrement des relations de confiance avec l’Etat et la República Nova.
La période Vargas (1930-1945) se caractérise par une revalorisation du statut de l’intellectuel, par la création de nombreux postes de fonctionnaires dont ils profitent. En 1931, par exemple, est créé le Ministère de l’Education et de la Culture (MEC) au sein duquel nous retrouvons une forte concentration de poètes, romanciers, architectes et peintres qui gravitent autour du pouvoir politique. En 1937, avec le coup d’Etat mettant en place l’Estado Novo, les modernistes ont d’autre part la possibilité de s’intégrer dans le projet corporatiste qui reconnaît l’activité intellectuelle.
La reconnaissance des modernistes en tant que producteurs d’une forme de «littérature nationale» est un autre aspect de la postérité des modernistes. Cette reconnaissance se fera par l’intermédiaire du Roman Régionaliste du Nordeste qui symbolisera pendant les années trente, le roman typiquement national. La valorisation du modernisme en tant que rupture esthétique, et fondement de la littérature nationale intervient à partir de ce moment, et leur permet de mettre en application leur projet de construire l’identité et la conscience nationale, associant ainsi leur œuvre à la construction politique du pays.
Cependant, si au cours des années 30, le modernisme est une forme d’art largement reconnue, avec la fin de la seconde guerre mondiale, il devra subir une certaine dévalorisation. En effet, la critique littéraire aura alors tendance à fermer les yeux sur les aspects que nous venons de développer, mettant principalement l’accent sur l’iconoclasme infécond de la tendance futuriste.
Par contre, au cours des années 50 et 60, nous assistons à une sensible mise en valeur de la production moderniste des années 20. Cela est lié d’une part à la réhabilitation du mouvement effectuée par le critique littéraire Antônio Cândido, mais surtout par l’émergence du modernisme comme thème d’études en littérature, en philosophie ou en sciences sociales. Une des majeures contributions à la revalorisation du modernisme des années 20 est incontestablement celle de l'Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), de l'Université de São Paulo, qui redécouvre l’œuvre moderniste, sous l’angle soit de la théorie de la dépendance culturelle (étudiant les relations entre la découverte du Brésil et les avant-gardes européennes) soit sous celui des relations entre histoire politique et changements d’orientation du modernisme. Malgré la rationnalité et la vision souvent critique du modernisme développées par les études de l’IEB, il semblerait que leur fixation sur le modernisme brésilien ait contribué à fonder, dans l’imaginaire politique brésilien, l’idée d’une phase héroïque du modernisme brésilien (axé autour de la Semaine de 22), suggérant parfois même l’idée du mythe de s origines de la culture nationale brésilienne autour du modernisme.
Nous voyons donc que la période que nous avons étudié a bien marqué l’histoire de la pensée politique au Brésil, contribuant d’une part à fonder
93
idéologiquement des projets politiques (l’utopie moderniste de la Civilisation Brésilienne se concrétisera par la construction à partir de 1957, de la nouvelle capitale nationale : Brasília), et initiant une espèce de tradition intellectuelle qui fera perdurer jusqu’à aujourd’hui leur imaginaire.
94
Table des Annexes
-p.115 -Annexe nº1: Carte des Revues Modernistes.-p.116 -Annexe nº2: Chronologie des principaux évènements artistiques et politiques au cours de
la période Etudiée.-p.121 -Annexe nº3: Biographies des principaux auteurs abordés (Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Graça Aranha, Menotti del Picchia, Cassiano Ricardo et Plínio Salgado.
-p.124 -Annexe nº4: Conférence-Manifeste de Menotti del Picchia (1922): Arte Moderna.-p.126 -Annexe nº5: Éditorial du premier numéro de la revue Klaxon (1922).-p.127 -Annexe nº6: Manifesto da poesía Pau-Brasil (1924).-p.129 -Annexe nº7: Manifeste Para os Céticos (1925).-p.130 -Annexe nº8: Manifeste Para os Espíritos Criadores (1925).-p.131 -Annexe nº9: Présentation du premier numéro de Terra Roxa e Outras Terras (1926).-p.132 -Annexe nº10: Manifeste Régionaliste (1926).-p.133 -Annexe nº11: Manifeste du Groupe Vert de Cataguazes (1927).-p.135 -Annexe nº12: Manifesto Antropófago, (1928).-p.137 -Annexe nº13: Manifeste Nhengaçu Amarelo (1929).-p.140 -Annexe nº14: Extrait de Macunaíma (Mário de Andrade), paru dans la Revista de
Antropofagía.-p.141 -Annexe nº15: Extrait du Reccueil Toda a América, de Ronald de Carvalho (1926).
Les Manifestes (à l'exception du Manifesto Antropófago) sont extraits : de Gilberto Mendonça Teles, Vanguarda Européia e Modenismo Brasileiro, apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas, Petrópolis: ed. Vozes, 1972, 271 p.
95
Table des illustrations
Nous présentons ici les références des illustrations insérées dans le texte, et dans les annexes
-p.19 - Anita Malfatti, Dessin au fusain, 1915/1916, extrait de Marta Rossetti Batista (col.), Brasil: 1º tempo modernista - 1917-1929, documentação, São Paulo: IEB, 1972, 459p.
-p.24 -Annonce du "Premier festival" de la Semaine d'Art Moderne, dans O Estado de São Paulo, du 11 février 1922, extrait de Marta Rossetti Batista (col.), Brasil: 1º tempo modernista - 1917-1929, documentação, São Paulo: IEB, 1972, 459p.
-p.25 -Klaxon, couverture du premier numéro de la revue (nov. 1922), extrait de Francisco, Alambert, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
-p.27.-Satire de la Semaine d'Art Moderne, caricature de Belmont pour la revue D. Quixote, extrait de Francisco, Alambert, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
-p.44 -Caricature d'Oswald de Andrade pour le journal A Gazeta, extrait de Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: ed. Perspectiva, coll. "debates/arte", 1970.-323 p.
-p.46 -Caricature de Mário de Andrade pour un article du journal O Diário Carioca (1934), extrait de Telê Porto Ancona Lopez, Mário de Andrade: entrevistas e depoimentos, São Paulo: T.A. Queiroz, Biblioteca de letras e ciências humanas, 1983. -114 p.
-p.58 -Blaise Cendrars, couverture de la première édition de Feuilles de route sud-américaines, extraite deAntoine Kaspi et Antoine Marès (dir.), Le Paris des étrangers (depuis un siècle), Paris: Imprimerie Nationale ed., coll. "notre siècle", 1989. - chap. XXI, pp. 287-298.
-p.59 -Les modernistes en partance pour Paris, extrait de Antoine Kaspi et Antoine Marès (dir.), Le Paris des étrangers (depuis un siècle), Paris: Imprimerie Nationale ed., coll. "notre siècle", 1989. - chap. XXI, pp. 287-298.
-p.65 -Gravure régionaliste de Poty (1988) pour A bagaceira, extrait de José Américo de Almeida, A Bagaçeira, 25e édition, Rio de Janeiro: Biblioteca do exército Editora,Coleção General Benício, 1988 (1e éd. 1928). -125 p.
-p.70 -Illustration de Poty pour Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, Rio de Janeiro: José Olympio, 1973 (1e éd. 1933).-573 p.
-p.77-Tarsila do Amaral "E.F.C.B." (Estrada de Ferro Central do Brasil) (1924), extrait de Modernidade, art brésilien du XXe siècle, catalogue de l'exposition qui eut lieu au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (10 déc. 1987 - 14 févr. 1988), Paris: Ministère des affaires étrangères / Association Française d'Action Artistique, 1987. - 425 p.
-p.78 -Macunaíma, dessin signé Nestor, paru dans le Jornal do Comércio, 2 fev. 1929, extrait de Marta Rossetti Batista (col.), Brasil: 1º tempo modernista - 1917-1929, documentação, São Paulo: IEB, 1972, 459p.
-p.79 -Hans Staden, illustration d'un rite anthropophage, extrait de Hans Staden,, Nus, féroces et anthropophages, Paris: Métaillié, coll. Points, 1929, 252p.
96
-p.80 -"História", illustration pour Menotti del Picchia, República dos Estados Unidos do Brasil, 1928, extraite de Marta Rossetti Batista (col.), Brasil: 1º tempo modernista - 1917-1929, documentação, São Paulo: IEB, 1972, 459p.
-p.85- "Bananal" de Lasar Segall (1924), extrait de Francisco, Alambert, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
-p.97 -Macunaíma, illustration de Cícero Días, extraite de Francisco, Alambert, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
-p.102--Couverture du Manifeste Intégraliste de janvier 1936(remaniement du Manifeste de 1932, avec lequel le groupe intégraliste se présente aux élections présidentielles de 1936), extraite de Hélgio Trindade, La tentation fasciste au Brésil dans les années trente, Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Brasília, 1988. -256 p.
-p.103 -Plínio Salgado et le salut au soleil (anauê), extrait de Hélgio Trindade, La tentation fasciste au Brésil dans les années trente, Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Brasília, 1988. -256 p.
-p.115 -Carte des revues modernistes, extraite de Francisco, Alambert, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
-p.121 -Mário de Andrade par Tarsila do Amaral (1922), extrait de Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: ed. Perspectiva, coll. "debates/arte", 1970.-323 p.
-p.122-Oswald de Andrade, par Tarsila do Amaral (1922), extrait de Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: ed. Perspectiva, coll. "debates/arte", 1970.-323 p.
-p.122 -Graça Aranha par Tarsila do Amaral (1922-23), extrait de Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: ed. Perspectiva, coll. "debates/arte", 1970.-323 p.
-p.123-Plínio Salgado, extrait de Hélgio Trindade, La tentation fasciste au Brésil dans les années trente, Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Brasília, 1988. -256 p.
97
Manifeste de la Poésie Pau Brasil.
Manifeste paru dans le quotidien Correio da Manhã, le 18 mars 1924
La poésie existe dans les faits. Les petites cabanes de safran et d'ocre au milieu de la Favela 1, sous l'azur cabralin2, sont des réalités esthétiques.Le Carnaval à Rio est l'événement religieux de la race. Pau Brasil. Wagner est noyé par les cortèges carnavalesques de Botafogo3. Barbares et nôtre. La riche formation ethnique. Richesse végétale. Le minéral. La cuisine. Le vatapá 4, l'or et la danse.
Toute l'histoire des bandeirantes5 et l'histoire commerciale du Brésil. Le côté docteur, le côté citations célèbres. Touchant Rui Barbosa 6: haut-de-forme en Sénégambie. Transformant tout en richesse. La richesse des danses et des phrases toutes faites. Négresses au club hippique. Odalisques au Catumbi 7. Langage recherché.
Le côté docteur. Fatalité du premier blanc jetant l'ancre et dominant politiquement la forêt vierge. Le bachelier. Nous ne pouvons douter d'être doctes. Docteurs. Pays de douleurs anonymes, de docteurs anonymes. L'Empire fut ainsi. Nous transformons tout en érudition. Nous avons oublié l'ingénieux.L'exportation jamais faite de la poésie. La poésie continue cachée dans les lambruches malicieuses de la sagesse. Dans les lianes de la saudade 8 universitaire.
Il y eu pourtant une explosion dans le domaine du savoir. Les hommes qui savaient tout se déformaient comme des baudruches. Ils ont éclaté. Le retour à la spécialisation. Philosophes se mêlant de philosophie, critiques de critique et ménagères de cuisine.La poésie pour les poètes. La joie de ceux qui ne savent pas et découvrent.
Il y avait eu l'inversion de tout, l'invasion de tout : le théâtre à thèse et la lutte des moraux et des immoraux sur la scène. La thèse doit être décidée par la guerre des sociologues, d'hommes de loi, gros et dorés comme le Corpus Juris.Que le théâtre soit agile, fils du saltimbanque. Agile et illogique. Que le roman soit agile, né de l'invention. Que la poésie soit agile.La poésie Pau Brasil. Agile et innocente. Comme un enfant.
Une suggestion de Blaise Cendrars : -Vous avez les locomotives bondées, vous allez partir. Un Nègre tourne la manivelle du déviateur rotatif sur lequel vous vous trouvez. La moindre négligence vous fera partir dans la direction opposée à votre destin.
Contre le bureaucratisme, la pratique cultivée de la vie. Des ingénieurs au lieu de jurisconsultes, perdus comme des chinois dans la généalogie des idées.Le langage sans archaïsmes, sans érudition. Naturel et néologique. La contribution millionnaire de toutes les erreurs. Comme nous parlons. Comme nous sommes.
Il n'y a pas de lutte dans le domaine des vocations académiques. Il n'y a que des costumes. Que les futuristes et les autres.Une seule lutte - la lutte pour le chemin. Divisons : Poésie d'importation. Et la poésie Pau Brasil, d'exportation.
99
Il y avait un phénomène de démocratisation esthétique dans les cinq parties érudites du monde. Le naturalisme devint une institution. Copier. Des brebis peintes sur une toile qui ne fût pas de laine ne valait rien. L'interprétation du dictionnaire oral des Écoles des Beaux-Arts signifiait qu'il fallait reproduire exactement... Vint la pyrogravure. Les jeunes filles de toutes les familles devinrent artistes. Apparut l'appareil photographique. Et avec toutes les prérogatives d'une longue chevelure, des pellicules et du génie mystérieux du regard chaviré - le photographe.En musique, le piano envahit les petites salles nues, calendrier au mur. Toutes le jeunes filles devinrent pianistes. Le piano à manivelle fit son apparition et le piano à queue. Le Pleyel. Le piano mécanique. Et l'ironie slave composa pour le Pleyel. Stravinski.La sculpture était à la traîne. Les processions sortaient toutes neuves des fabriques.Ne manquait que l'invention d'une machine à fabriquer des vers mais il y avait déjà le poète parnassien.
Eh bien, la révolution indiqua seulement que l'art revenait aux élites. Et les élites commençaient à détruire. Deux phases: d'abord, la déformation à travers l'impressionnisme, la fragmentation, le chaos volontaire. De Cézanne et Mallarmé, Rodin, et Debussy jusqu'à ce jour. Ensuite, la présentation au temple, les matériaux, l'innocence constructive.Le Brésil profiteur9. Le Brésil docteur. Et la coïncidence de la première construction brésilienne et du mouvement de reconstruction générale. Poésie Pau Brasil.
Comme l'époque est miraculeuse, les lois sont nées de la rotation des éléments destructeurs.La synthèse.L'équilibre.La perfection d'une carrosserie.L'invention.La surprise.Une nouvelle perspective.Une nouvelle échelle.
N'importe quel effort naturel dans ce sens sera bon. Poésie Pau Brasil.
Travailler contre le détail naturaliste - pour une synthèse, contre la morbidité romantique - pour l'équilibre géométrique et l'achèvement technique ; contre la copie, pour l'invention et la surprise.
Une nouvelle perspective.L'autre, celle de Paolo Ucello, à son apogée, créa le naturalisme. C'était une illusion optique. Les objets éloignés n'étaient pas réduits. C'était une loi de ressemblance. Voici maintenant le moment d'une réaction contre la ressemblance. Réaction contre la copie. Il faut remplacer la perspective visuelle et naturaliste par une perspective d'un autre ordre: sentimentale, intellectuelle, ironique, ingénue.
Une nouvelle échelle:L'autre, celle d'un monde proportionné et catalogué avec des lettres dans les livres, des enfants au cou. La réclame qui produit des lettres plus grandes que des tours. Et les nouvelles formes de l'industrie, des transports, de l'aviation. Poteaux. Gazomètres. Rails. Laboratoires et bureaux techniques. Voix et grésillements de fils et ondes et fulgurations. Des étoiles familiarisées avec des négatifs photographiques. L'équivalent en art de la surprise en physique.Réaction contre le sujet envahisseur, différent par sa finalité. La pièce à thèse était un arrangement grotesque. Le roman d'idées une mixture. Le tableau historique une aberration. La sculpture éloquente une horreur insensée.Notre époque annonce le retour au sens pur.Un tableau est lignes et couleurs. La sculpture est volumes sous la lumière.
100
La poésie Pau Brasil est une salle à manger dominicale, avec des petits oiseaux chantant dans la forêt condensée des cages, une personne maigre composant une valse pour flûte et la Mariette lisant le journal. Dans le journal se trouve tout le présent.
Aucune formule pour l'expression contemporaine du monde. Il faut voir avec des yeux libres.
Nous avons la base double et présente - la forêt vierge et l'école. La race crédule et dualiste et la géométrie, l'algèbre et la chimie tout de suite après le biberon et l'infusion d'anet doux. Un mélange de "dors petit enfant sans quoi le loup Garou viendra te prendre" et d'équations.Une vision qui bat les meules des moulins, les turbines électriques, les usines productrices, les questions de change, sans pour cela perdre de vue le Musée National. Pau Brasil.
Ascenseurs obus, des gratte-ciel faits de cubes et la sage fainéantise solaire. La prière. Le carnaval. La force intime. Le sabiá10. L'hospitalité un peu sensuelle, amoureuse. La nostalgie des sorciers guérisseurs et les terrains de l'aviation militaire. Pau Brasil.
Le travail de la génération futuriste a été cyclopéen. Mettre à l'heure l'horloge Empire de la littérature nationale.Cette étape franchie, le problème est différent. Etre régional et pur dans son époque.
L'état d'innocence se substituant à l'état de grâce qui peut être une attitude de l'esprit.
Le contrepoids de l'originalité indigène afin de rendre inutile l'adhésion académique.
Réaction contre toutes les indigestions de l'érudition. Le meilleur de notre tradition lyrique. Le meilleur de notre démonstration moderne.
Être à peine Brésiliens de notre époque. Le minimum de chimie, de mécanique, d'économie et de balistique. Tout cela digéré. Sans meeting culturel. Pratiques. Expérimentaux. Poètes. Sans réminiscences livresques. Sans s'appuyer sur des comparaisons. Sans recherche étymologique. Sans ontologie.
Barbares, crédules, pittoresques et affectueux. Lecteurs de journaux. Pau Brasil. La forêt vierge et l'école. Le Musée National. La cuisine, le minéral et la danse. La végétation. Pau Brasil.
OSWALD DE ANDRADE
1-Quartiers pauvres des grandes villes brésiliennes.2-Pedro Alvares Cabral: navigateur portugais qui découvrit le Brésil.3-Botafogo, quartier résidentiel de Rio.4-Vatapá: plat afro-brésilien.5-Bandeirantes: aventuriers explorateurs et chasseurs d'esclaves.6-Rui Barbosa: homme d'état brésilien.7-Catumbi: quartier résidentiel populaire de Rio.8-Saudade: forme de nostalgie ou de mélancolie typiquement luso-brésilienne.9-En français dans le texte.10-Sabiá: oiseau des tropiques.
101
Manifeste Antropophage
Oswald de Andrade, in Revista de antropofagía, 1e année, nº1, mai 1928
Seule l'anthropophagie nous unit. Socialement. Économiquement. Philosophiquement.
Unique loi du monde. Expression déguisée de tous les individualismes, de tous les collectivismes. De toutes les religions. De tous les traités de paix.
«Tupi or not tupi that is the question».
Contre toutes les catéchèses. Et contre la mère des Gracques.
Ne m'intéresse que ce qui n'est pas à moi. Loi de l'homme. Loi de l'anthropophage.
Nous en avons assez de tous les maris catholiques soupçonneux de mélodrame. Freud a mis fin à la femme énigme et à tous les autres épouvantails de la psychologie imprimée.
Ce qui empêchait la vérité c'était l'habit, imperméable entre le monde intérieur et le monde extérieur. Réaction contre l'homme habillé. Le cinéma américain instruira.
Fils du soleil, mère des vivants. Rencontrés et aimés férocement, avec toute l'hypocrisie de la nostalgie, par les immigrés, les trafiqués et les touristes1. Dans le pays du grand serpent.
C'est que nous n'avons jamais su ce qu'était urbain, suburbain, frontalier et continental. Paresseux dans la mappemonde du Brésil.Une conscience participante, un rythme religieux.
Contre tous les importateurs de consciences en boîtes. L'existence palpable de la vie. Et la mentalité pré-logique pour que Monsieur Lévy-Bruhl l'étudie.
Nous désirons la révolution caraïbe. Plus grande que la révolution française. L'unification de toutes les révoltes efficaces en direction de l'homme. Sans nous, l'Europe n'aurait peut-être pas sa pauvre Déclaration des Droits de l'Homme.L'âge d'or annoncé par l'Amérique. L'âge d'or. Et toutes les girls.
Filiation. Le contact avec le Brésil caraïbe. Où Villegaignon print terre. Montaigne. L'homme naturel. Rousseau. De la Révolution Française au Romantisme, à la Révolution Bolchevique, à la révolution Surréalistes et au barbare technicisé de Keyserling. Nous avançons.
Nous n'avons jamais été catéchisés. Nous vivons comme des somnambules. Nous avons fait naître le Christ à Bahía. Ou à Belém do Pará.
Nous n'avons jamais permis l naissance de la logique entre nous.
Contre le père Vieira. Auteur de notre premier emprunt pour toucher une commission. Le roi analphabète lui dit : mettez ceci par écrit sans fourberie. L'emprunt se réalisa. Le sucre brésilien fut cédé par écrit. Vieira lui laissa l'argent au Portugal et nous apporta la fourberie.
102
L'esprit refuse de concevoir l'esprit sans le corps. L'anthropomorphisme. Nécessité de la vaccination anthropophage. Pour l'équilibre contre les religions de méridien. Et les inquisitions extérieures.
Nous ne pouvons nous porter garants que du monde auriculaire.
Nous avions la justice codification de la vengance. La science codification de la magie. Antropofagia : Transformation du Tabou en totem.
Contre le monde réversible et les idées objectivées. Cadavérisées. L'arrêt de la pensée qui est dynamique. L'individu victime du système. Source de injustices classiques. Des injustices romantiques. Et l'oubli des conquêtes intérieures.
Itinéraires. Itinéraires. Itinéraires. Itinéraires. Itinéraires. Itinéraires. Itinéraires.
L'instinct Caraïbe.
Mort et vie des hypothèses. De l'équation moi partie du Cosmos à l'axiome Cosmos partie du moi. Subsistance. Connaissance. Antropofagia.
Contre les élites végétales. En communication avec le sol.
Nous n'avons jamais été catéchisés. Ce que nous avons fait c'est le Carnaval. L'Indien en costume de sénateur de l'Empire jouant le rôle de Pitt. Ou jouant dans les opéras d'Alencar tout imbu de bons sentiments portugais.
Nous avions déjà le communisme. Nous avions déjà le langage surréaliste. L'âge d'or.Catiti CatitiImara NotiáNotiá Imara Ipejú.
La magie et la vie. Nous avions la relation et la distribution des biens physiques, des bien moraux, des bien honorifiques. Et nous savions alors transcrire le mystère et la mort à l'aide de quelques formes grammaticales.
J'ai demandé à un homme ce qu'était le Droit. Il m'a répondu que c'était la garantie de l'exercice de la possibilité. Cet homme s'appelait Galli Mathias. Je l'ai mangé.
Il n'y a déterminisme que là où il y a mystère. Mais qu'avons-nous à voir avec ça?
Contre les histoire de l'homme qui commencent au Cap Finisterre. Le monde sans date. Sans rubriques. Sans Napoléon. Sans César.
La fixation du progrès à l'aide de catalogues et d'appareils de télévision. Rien que les machines. Et les transfuseurs de sang.
Contre les sublimations antagonistes. Apportées par les caravelles.
Contre la vérité des peuples missionnaires, définie par la sagacité d'un anthropophage, le Vicomte de Cairu: - C'est le mensonge tant de fois répété.
Mais ceux qui venaient n'étaient pas des croisés. C'étaient des fugitifs d'une civilisation que nous sommes en train de manger, parce que nous sommes forts et vindicatifs comme le Jabuti.
103
Si Dieu est la conscience de l'Univers incréé, Guaraci est la mère des vivants. Jaci est la mère des végétaux.
Nous n'avions pas de spéculation. Mais nous avions l'intuition. Nous avions la Politique qui est la science de la distribution. Et un système socio-planétaires.
Les migrations. La fuite des états ennuyeux. Contre les scléroses urbaines. Contre les conservations et l'ennui spéculatif.
De William James à Voronoff. La transfiguration du Tabou en totem. Antropofagia.
Le pater familias et la création de la Morale de la Cigogne : Ignorance réelle des choses + manque d'imagination + sentiment d'autorité comme réponse à la curiosité des enfants.
Il faut partir d'un profond athéisme pour arriver à l'idée de Dieu. Mais le caraïbe n'en avait pas besoin . Parce qu'il y avait Guaraci.
L'objet créé réagit comme les Anges déchus. Après Moïse divague. Qu'avons-nous à voir avec ça?
Avant d'avoir été découvert par les Portugais, le Brésil avait découvert le bonheur.
Contre l'Indien porteur de chandelles. L'Indien fils de Marie, parent de Catherine de Médicis et gendre de Dom Antônio de Mariz.
Le bonheur est la preuve par neuf.
Dans le matriarcat de Pindorama.
Contre la mémoire source de traditions. L'expérience personnelle renouvelée.
Nous sommes des concrétistes. Les idées s'imposent, réagissent, brûlent des gens sur les places publiques. Supprimons les idées et toutes autres paralysies. En faveur des itinéraires. Croire aux signaux, croire aux instruments et aux étoiles.
Contre Gœthe, la mère des Gracques et la cour de Dom João VI.
Le bonheur est la preuve par neuf.La lutte entre ce qui s'appellerait Incréé et la Créature - illustrée par la contradiction permanente de l'homme et de son Tabou. L'amour quotidien et le modus vivendi capitaliste. Antropofagia. Absorption de l'ennemi sacré. Pour le transformer en totem. L'aventure humaine. La finalité terrestre. Toutefois, seules les élites pures ont réussi à réaliser l'anthropophagie charnelle qui porte en elle le sens le plus élevé de la vie et évite tous le maux identifiés par Freud, péchés du catéchisme. Ce qui arrive n'est pas une sublimation de l'instinct sexuel. C'est le baromètre de l'instinct anthropophage. De charnel, il devient électif et crée l'amitié. Affectif, l'amour. Spéculatif, la science. Il se dévie et se transfère. Nous aboutissons à l'avilissement. La basse anthopophagie agglomérée dans les péchés du catéchisme, l'envie, l'usure, la calomnie, le meurtre. Peste des soi-disant peuples civilisés et christianisés, c'est contre cette peste que nous agissons. Anthropophages.
Contre Anchieta glorifiant les onze mille vierges du ciel dans la terres d'Iracema, le patriarche João Ramalho, fondateur de São Paulo.
104
Notre indépendance n'a toujours pas été proclamée. Phrase typique de Dom João VI : - Mon fils, mets cette couronne sur ta tête avant que quelqu'un d'autre ne la mette sur la sienne. Nous avons expulsé la dynastie. Il faut expulser l'esprit bragantin, les ordinations et le tabac à priser de Maria da Fonte.
Contre la réalité sociale, habillée et oppressive, lotie par freud - la réalité sans complexe, sans folie, sans prostitutions et sans pénitenciers du matriarcat de Pindorama.
OSWALD DE ANDRADEA Piratiniga
L'an 374 de la déglution de l'évêque Sardinha.
(Revista de Antropofagia, première année, nº1, 1e mai 1928)
105
Pour les sceptiques(Traduction partielle)
Manifeste programme de la revue A Revista qui paraît en 1925 à Belo Horizonte (État de Minas Gerais).Ce manifeste n'a pas été signé mais serait de la plume de Carlos Drummond de Andrade.
Le programme de cette revue ne peut nécessairement pas s’écarter de la ligne structurelle de tous les programmes. Il se résume en un mot : Action. Action signifie vibration, lutte, effort constructeur, vie. Il ne manque que l’accomplir, et avec loyauté, nous confessons ; ici commencent les difficultés. On suppose que nous ne sommes pas encore suffisamment appareillés pour maintenir une revue de culture, ou même un simple hebdomadaire de bonshommes cinématographiques : il nous manque tout, depuis la typographie jusqu’au lecteur. Quant aux écrivains, oh!, ça nous en avons en trop. (Dieu notre seigneur veuille nous envoyer une épidémie qui les réduisit de moitié!) De cet chance, un injustifiable découragement fait de Belo Horizonte la plus paradoxale des villes : centre d’études, elle n’a aucun mensuel d’études. Ici et là pointent une tentative dans ce sens, et le choeur des citoyens expérimentés et sceptiques exclament: "Quoi! C’est de la bêtise... L’idée ne venge pas". Et comme, effectivement, l’idée ne venge pas, le scepticisme astucieux et stérile va acheter sa Revista do Brasil qui vient de São Paulo et, pour cela, doit être profondément intéressante...(...)Nous ne sommes pas romantiques, nous sommes jeunes. Un adjectif en vaut un autre, dira-t-on. Peut-être. Mais, entre tous les romantismes, nous préférons celui de la jeunesse et, comme lui, celui de l’action. Action intensive dans tous les domaines : dans la littérature, dans l’art, dans la politique. Nous sommes pour la rénovation intellectuelle au Brésil, ce qui est devenu un impératif catégorique. Nous luttons pour l’assainissement de la tradition, qui ne peut pas continuer à être la tombe de nos idées, mais plutôt la source généreuse d’où elles émanent. Nous sommes, finalement, un organe politique. Ce qualificatif fut corrompu par l’interprétation vicieuse à laquelle nous fumes obligés par l’exercice effréné de la politique mesquine1 . Cependant, nous ne connaissons pas de mot plus noble que celui-ci : politique. Sera-t-il nécessaire de dire que nous avons un idéal? Il s’appuie sur le plus franc et franc nationalisme. La confession de ce nationalisme constitue le plus grand orgueil de notre génération, qui ne pratique ni la xénophobie ni le chauvinisme, et qui, loin de répudier les courants civilisateurs d’Europe, essaye de soumettre chaque fois plus le Brésil à son influence, sans casser notre originalité nationale.Dans l’ordre interne, nous sommes contraints d’avancer encore une affirmation. Nés sous la République, nous assistons au spectacle quotidien et poignant des désordres intestins, au long desquels se dessine, nette et perturbatrice, dans notre horizon social, une terrible crise d’autorité. Au Brésil, personne ne veut obéir. Un esprit de critique unilatéral domine tant ce qu’on appelle les élites culturelles comme les classes populaires. Il y a mil pasteurs pour une seule brebis. C’est pour cela même que les passions occupent la place des idées, et, au lieu de discuter des principes, on discute les hommes. "Untel est au gouvernement, alors allons renverser Untel!" Et zás! Mitrailleuses, canons, régiments entiers en activité...C’est contre cet opprimant état des choses que la jeunesse brésilienne veut et doit réagir, en utilisant ses pures réserves d’esprit et de cœur.Au Brésil désorienté et névrotique connu jusqu’ici, opposons le Brésil travailleur et prudent que la civilisation exige de nous. Sans vacillation, comme sans ostentation. C’est l’œuvre d’un raffinement intérieur, que seuls les moyens pacifiques du journal, de la tribune et de la chaire pourront véhiculer. Après la destruction du joug colonial et du joug esclavagiste, et de l’avènement du modèle républicain, il semblait qu’il n’y avait plus rien à faire, si ce n'est de croiser les bras.
«Erreur. Il nous reste à humaniser le Brésil».
1-En Brésilien: ‘politicagem’.
106
Pour les esprits créateurs
Le Manifeste Pour les sceptiques, subit une espèce de rectificatifqui parut dans le numéro 2 de A Revista.
Ce second manifeste toujours anonyme, serait cette fois l'œuvre de Martins de Almeida.
Nous nous sommes adressés aux sceptiques; il est maintenant le moment de nous adresser aux esprits créateurs. Nous amenons une autre sérénité. Nous venons réaffirmer notre orientation dans le sens de la plus ranche nationalisation de notre esprit. Il y a, de notre temps, un retour à la réalité. Nous ne nous enfonçons plus dans les idéologies menteuses des générations passées, qui déguisaient notre terre de couleurs chimériques. Nous avons souffert un rapprochement plus intime, un contact plus vif de notre milieu. C’est pourquoi nous revient une œuvre de dure discipline et de sérénité constructive. Nous n’avons pas uniquement besoin d’actes d’intelligence, mais surtout d’actes de foi. Il y un besoin incontournable d’affirmation dans tous les sens. Entrant en collision avec la vie réelle, nous devons confier en notre force pour ne pas tomber dans l’inaction et dans l’indifférentisme. Nous ne voulons pas jeter de pierres sur le passé. Notre vrai objectif est de sculpter le futur. Et là sont les problèmes essentiels de la nationalité qui exigent une solution immédiate. Nous prétendons réaliser, en même temps, un œuvre de création et de critique. Nous avons laissé à chaque collaborateur la plus large liberté de points de vue et d’opinions. Nous voulons seulement imprimer à notre travail une unité en harmonie avec notre tendance nationaliste. Sans préjugés rigides. Sans exclusivismes stériles. Nous voulons concentrer tous les efforts pour construire le Brésil dans le Brésil ou, si possible, Minas dans Minas.
Nous accueillons avec sympathie le régionalisme. Nous avons utilisé les aspects particuliers de notre milieu, et l’originalité locale de nos campagnes1 que ce mouvement sait rendre.
Bien que nous prétendions avancer dans un autre sens: dominer par l’esprit notre milieu et pas nous asservir à lui. Mais il est nécessaire que nous superposions des volontés identiques pour créer un esprit national. L’effort intense de chacun, dans ce même sens, constitue le fécond travail sous-terrain des racines.
La nationalité se forme au prix de douloureuses expériences individuelles.Nous ne pouvons pas mépriser la moindre contribution. Nous pressentons le danger énorme du cosmopolitisme.
C’est la menace de la dissolution de notre esprit dans les réactions de transplantation exotique. Nous ne pouvons offrir aucune perméabilité aux produits et détritus des civilisations étrangères. Nous devons recomposer notre faculté d’assimilation pour transformer en substance même, ce que nous vient de l’extérieur. Nous voyons là un autre mouvement nationaliste qui donne aussi ses fruits: le primitivisme. Celui-ci vient, surtout, humaniser notre conscience intellectuelle, la dénuant de son caractère olympique. Il y a longtemps que nous aurions dû quitter notre Turris Eburnea2 et en finir avec l’orgueilleuse aristocratie de la pensée, pour nous engager dans l’humanité, dans notre humanité. Nous devons comprendre que notre rôle est de vivre et pas de contempler le spectacle quotidien.
En fait, un de nos objectifs principaux est de solidifier le fil de nos traditions. Nous sommes traditionalistes dans le bon sens.
Nous nous opposons à toute dévalorisation de notre petit héritage intellectuel. Si nous adoptons la réforme esthétique, c’est justement pour multiplier et valoriser le capital artistique réduit que nous ont laissé les générations passées.
Nous avons dit que nous étions un organe politique. Dans les relations intérieures, notre orientation se définit dans le sens d’une centralisation du pouvoir. Tant pour la politique que pour l’écriture: des éléments de dissolution extrêmement dangereux nous menacent. Nous pouvons percevoir, à travers des explosions isolées, un néfaste esprit de révolte désorganisé, qui cherche à affaiblir notre organisme social.
Pour le combattre, nous ressentons le besoin que le gouvernement soit fonction d’une volonté forte, d’un esprit dominateur. Si le pouvoir devient périphérique, au lieu de se centraliser, nous assisterons à la dispersion des forces latentes du pays. Actuellement au Brésil, il n’a pas de socialisation des masses populaires. Seule une personnalité inflexible, dirigée par une bonne compréhension de nos besoins peut résoudre les plus grands problèmes de la nationalité. Pour les relations extérieures au pays, nos conditions actuelles exigent une position, nous ne dirons peut-être pas stratégique, mais, du moins, tactique des classes dirigeantes en relation aux éléments étrangers. Nous ne pouvons pas nous en passer. C’est le problème de l’immigration qui, accueillie massivement, est extrêmement dangereuse pour la formation actuelle de nos caractères. Elle pourra perturber encore plus l’état de notre métissage psychique. Nous ne pouvons pas l’empêcher mais nous pouvons l’organiser. La création de noyaux de colonisation est déjà une mesure, pour le moment. Elle aurait l’avantage d’empêcher le mélange irrégulier des types les plus différents, et d’étendre l’urbanisation de l’intérieur du pays3. Cohérents par rapport à notre programme nationaliste, nous sommes en faveur de la réforme de notre constitution. Celle-ci présente une pompeuse façade de fédéralisme nord-américain et un fond calqué sur le libéralisme anglais. Nos lois fondamentales sont nées sous l’influence du romantisme politique du Second Empire. Elles furent conçues par le vague idéalisme et le verbalisme sonore des derniers représentants de notre brillant et dissolvant parlementarisme. Il y a un désaccord profond entre beaucoup de principes constitutionnels et notre mentalité sociale. Il est nécessaire que nous annulions cette disproportion. Nos lois doivent être les conséquences de l’observation directe de la vie brésilienne, et non pas copiées des modèles étrangers.
1- Littéralement en brésilien «intérieur».2-Tour d’ivoire.3-Intérieur: par opposition à la zone côtière, beaucoup plus développée, urbanisée et occidentalisée que le reste du pays.
107
KLAXONÉditorial du premier numéro de la revue KLAXON,
daté du 15 mai 1922, à São Paulo, et signé La Rédaction
SignificationLa lutte a vraiment commencé aux débuts de 1921 dans les colonnes du ‘Jornal do Comércio’ et du ‘Correio Paulistano’. Premier résultat : ‘Semaine d’Art Moderne’ -- espèce de Conseil International de Versailles. Comme celui-là, la semaine eut une raison d’être. Comme lui : ni désastre, ni triomphe. Comme lui : elle donna des fruits verts. Il y eut des erreurs proclamées à voix haute. Des idées inadmissibles furent prêchées. Il faut réfléchir. Il faut éclaircir. Il faut construire. D’où KLAXON.Et KLAXON ne se plaindra jamais d’être incompris par le Brésil. C’est le Brésil qui devra s’efforcer pour comprendre KLAXON.
EsthétiqueKLAXON sait que la vie existe. Et, conseillé par Pascal, vise le présent. KLAXON ne se préoccupera pas d’être nouveau, mais d’être actuel. Telle est la grande loi de la nouveauté.KLAXON sait que l’humanité existe. C’est pour ça qu’il est internationaliste. Ce qui n’empêche que, pour l’intégrité de la patrie, KLAXON meure et ses membres brésiliens meurent.KLAXON sait que la nature existe. Mais il sait que le mouvement lyrique, producteur de l’œuvre, est une lentille transformante et même déformante de la nature.KLAXON sait que le progrès existe. Pour cela, sans régénérer le passé, il marche en avant, toujours, toujours. Le clocher de São Marcos était un chef-d’œuvre. Il aurait dû être conservé. Il tomba. Le reconstruire fut une erreur sentimentale et coûteuse -- ce qui crie devant les besoins contemporains.KLAXON sait que le laboratoire existe. Pour cela, il veut donner des lois scientifiques à l’art; des lois surtout fondés sur les progrès de la psychologie expérimentale. À bas les préjugés artistiques! Liberté! Mais une liberté bridée (sic) par l’observation.KLAXON sait que le cinématographe existe. Pérola White est préférable à Sarah Bernhardt. Sarah est tragédie, romantisme sentimental et technique. Pérola est raisonnement, instruction, sport, vitesse, joie, vie. Sarah Bernhardt = XIXe siècle. Pérola White = XXe siècle. La cinématographie est la création artistique la plus représentative de notre époque. Il faut lui faire observer la leçon.KLAXON n’est pas exclusiviste. Malgré cela, il ne publiera jamais de mauvais inédits de bons auteurs déjà morts.KLAXON n’est pas futuriste.KLAXON est klaxiste.
Affiche (ou placard)KLAXON cogite principalement sur l’art. Mais veut représenter l’époque qui commence en 1920. Pour cela il est polymorphe, omniprésent, inquiet, comique, irritant, contradictoire, envié, insulté, heureux.KLAXON cherche : trouvera. Frappe : la porte s’ouvrira. KLAXON ne démolit pas de clocher. mais ne reconstruira pas ce qui tombera en ruines. Avant tout, elle profitera du terrain pour de solides, d’hygiéniques, d’arrogants édifices de béton armé.KLAXON a une âme collective qui se caractérise par la poussée constructive. Mais chaque ingénieur utilisera les matériaux qui lui conviendront. Cela signifie que les écrivains de KLAXON répondront seulement aux idées qu’ils signeront.
ProblèmeXIXe siècle -- romantisme, Tour d’Ivoire, Symbolisme. Ensuite, le feu d’artifice international de 1914. Il y a près de 130 ans que l’humanité fait des astuces. La révolte est justissime. Nous voulons construire la joie. La propre farce, le burlesque ne nous répugne pas, comme cela n’a pas répugné Dante, Shakespeare, Cervantes. Mouillés, enrhumés, rhumatisés par une tradition de larmes artistiques, nous nous sommes décidés. Opération chirurgicale. Extirpation des glandes lacrymales. Ère des 8 Batutas, du Jazz-Band, de Chicharrão, de Carlito, de Mutt & Jeff. Ère du rire et de la sincérité. Ère de construction. Ère de KLAXON.
LA RÉDACTION1-en français dans le texte original
108
TERRE ROUGE ET AUTRES TERRESPrésentation de la Revue TERRA ROXA E OUTRAS TERRAS
dont le numéro 1 paraît le 20 janvier 1926.
Présentation
Il semblerait que ce journal, en naissant, fait preuve d’un courage digne d’Anhangüera1. il se destine a un public qui n’existe pas. C’est là même son programme: être fait pour l’homme qui lit.Notre terre rouge, grâce à sa fertilité complexe et exagérée a accouché de tout ce qui pouvait être le rêve d’une imagination de pionnier: sucre, café, gratte-ciels, trains électriques, lance-parfums, directoires politiques, omnibus et même hommes de lettres. Tout. Sauf, là dans ce banc de jardin anglais, ou sur ce fauteuil de véranda de bungallow, ou dans ce club, ou dans cet hamac de fazenda2 , ou dans ce Pullman de la Paulista3, l’entité rare et inestimable qu’est l’homme qui lit. Et c’est pour cet homme imaginaire, ou du moins encore inconnu comme un roi en voyage de plaisance, que nous avons décidé de lancer au monde le TERRA ROXA ... e outras terras4.Entre nous, le phénomène est assez singulier: ce n’est pas le lecteur à la recherche d’un journal, mais un journal à la recherche d’un lecteur. Apprenons à ce lecteur, à lire. Sans abécédaire. Sans gâteaux. Sans prix de fin d’année.Trois désirs mènent l’homme civilisé à la lecture: celui de s’instruire, celui de se divertir, celui de faire bon effet devant parents, amis ou connaissances. TERRA ROXA fournira de la lecture satisfaisant ces trois finalités. Celui qui la lira avec cette assiduité qui étonne toujours les administrations journalistiques, pourra facilement apprendre, se distraire et, comme on dit dans notre admirable langue italo-pau-brasil, ‘bancar o intelectual’5 .À l’être hypothétique et incertain, pour qui nous composons se bi-hebdomadaire, nous offrons comme sur un plateau paysan, le pâturage varié et succulent qui convient à un appétit vierge: chronique littéraire, chronique artistique, chronique philosophique, chronique musicale et théâtrale, essais de critique, essais d’histoire, créations de poètes, nouvelles, romans, tous les genres, sauf, nous avons foi en Dieu, ce genre pau (ennuyeux en français) duquel nous fuirons comme de la peste.Les travaux publiés obéirons à une ligne générale appelée esprit moderne, dont nous ne savons pas exactement ce que c’est, mais qui est manifestement délimitée par ses exclusions.Camarade lecteur: enchanté et très honoré de vous découvrir.
1-Vieux diable en langue tupi):2- Fazenda: grande propriété agricole. Par extension, la construction qui s’y trouve.3- L’Avenue Paulista est un des axes principaux de São Paulo.4-Terre rouge... et autres terres.5-Intraduisible exactement, mais peut vouloir dire : "se la jouer intellectuel".
109
MANIFESTE DU GROUPE VERT DE CATAGUAZESManifeste du Groupe Vert de la ville de cataguazes (Minas Gerais),
qui paraît dans le numéro un de la revue VERDE, en 1927.
Ce manifeste n'est pas une explication. Un explication de notre part ne serait pas comprise par les critiques de la terre, par les innombrables conseillers b. b. qui dogmatisent perchés du haut des colonnes prétendues importantes, des journaux mineurs de l'intérieur1. Et ce serait inutile pour tous ceux qui nous ont déjà compris et qui nous appuient.Ce n'est pas non-plus une limitation de nos objectifs et de nos procédés, parce que le moderne est innombrable.Mais c'est une limitation entre ce que nous avons fait et la montagne de ce qu'on fait les autres.Une séparation entre nous et la queue de nos adhérents de dernière heure, dont l'adhésion est un inconfort.Nous prétendons aussi focaliser la ligne qui divise et nous oppose au reste des modernistes brésiliens et étrangers.Nous n'avons pas souffert l'influence directe de l'étranger. Et nous avons tenu à oublier le français. Mais que personne ne pense que nous prétendons dire que nous sommes -- ceux d'ici -- tous identiques.Nous sommes différents. Diverssissimes même. Mais beaucoup plus différents que ceux des maisons voisines.Notre situation topographique fait que nous ayons une vision ressemblante de l'ensemble brésilien et américain et de l'heure qui est passée, qui passe et qui va passé.d'où l'union du groupe "VERDE". Sans préjuguger, cependant, de la liberté personnelles, des procédés et façons de chacun de nous.Une des nombreuses particularités de notre groupe est l'objectivisme. Nous sommes tous exclusivistes presque. Explication? Pas besoin. Il suffit de mettre la main à la tête, penser, comparer et... être d'accord.La place qui est aujourd'hui bien à nous, dans le Brésil intellectuel fut conquise uniquement grâce à la dyonisiaque entreprise du fort groupe de Belo Horizonte, ayant à sa tête l'enthousiasme jeune de Carlos Drummond, Martins de Almeida et Emílio Moura, et la fondation de A REVISTA, qui, quoique n'ayant pas eu la vie longue, a marqué une époque dans l'histoire de l'innovation moderne à Minas.Bien que nous citions les noms de jeunes de Belo Horizonte, nous n'avons, absolument, aucun lien avec leur style et leur vie littéraire.Nous sommes nous. Nous sommes VERDE. Et ce manifeste fut fait spécialement pour provoquer un savoureux (sic) scandale intérieur et même des mécontentements intimes.Nous accompagnons S. Paulo et Rio dans toutes leurs innovations et rénovations esthétiques, autant dans la littérature que dans tous les arts, nous ne fûmes et ne sommes pas influencés par eux, comme certains le veulent.Nous n'avons pas de pères spirituels. Alors que d'autres groupes, malgré les cris et les protestations et le diable, dans le sens de la brésilianisation de nos sujets et de notre parler, passent leur vie à pasticher le 'modus' de mr. cendrars et d'autres français brossés ou pacifiés.Nous n'avons aucune prétention d'écorcher nos amis. Non. Absolument pas.Nous voulons seulement démontrer notre indépendance dans le sens scolastique, ou mieux, 'partisan'.
110
Notre mouvement VERDE est né d'un simple petit journal de la terre2 --JAZZ BAND.Un tout petit journal avec des tendances modernistes qui a tout de suite scandalisé les habitants hyper-pacifiés 3 de cette Meia-Pataca4. On a même entendu parler de coups de matraque...C'est de là qu'est née notre ferme volonté de montrer à tous ces gens que, même en habitant dans une petite ville de province, nous avons le courage de faire concurrence à ceux d'en-haut.Le manque de publications, de maisons d'édition et d'argent -- nous a fait attendre le moment propice pour apparaître.
Mais VERDE est sortie. VERDE a vaincu. Nous pouvons prendre des coups ou en donner. Nous n'attendons pas d'applaudissement ni de huées publiques, parce que ce qui provoque un véritable scandale laisse les brésiliens indifférents, en apparence... apeurés ou honteux de rentrer dans le bruit.Oui. Nous n'attendons pas d'applaudissement ni de huées publiques. Les applaudissements de certains publics vont honte à ceux qui les reçoivent, parce qu'ils mettent l'œuvre applaudie au niveau de ceux qui l'on comprise.La huée n'est pas loin derrière. La huée est parfois une expression simulée de reconnaissance de valeurs...C'est pour cela que nous préférons l'indifférence. Celle-ci sera le plus bel hommage que pourront nous faire ceux qui ne nous comprennent pas encore. Pour quoi attaquer VERDE? Nous sommes ce que nous voulons être et non pas ce que les autres veulent que nous soyons. Cela paraît compliqué, mais c'est simple.Exemple: les autres veulent que nous écrivions des sonnets portugais lyriques et acrostiches, avec noms et surnoms.Nous préférons laisser le sonnet dans son antre avec ses quatorze ciprès importés, et chanter simplement la terre brésilienne. Cela ne vous plaît pas? Peu importe.Ce qui importe, en vérité, c'est la gloire de VERDE, la victoire de VERDE. Celle-ci a déjà gagné du terrain dans les villes les plus cultivées du pays.La grande presse nous considère comme les seuls littéraires à avoir eu le courage inédit de maintenir une revue moderne au Brésil, alors que le public de notre terre, le public respectable, nous prend encore pour de simples fous créateurs de choses absolument incroyables.C'est positivement comique. Et c'est pour dire ces choses que nous lançons ce manifeste d'aujourd'hui, qui malgré son embarras n'a rien d'un manifeste, mais seulement un léger parcours au tour de nos gens, de notre milieu.
EN RESUME:
1º) Nous travaillons indépendamment de tout autre groupe littéraire.2º) Nous avons parfaitement déterminé la ligne de division qui nous sépare des autres modernistes brésiliens et étrangers.3ª) Nos procédés littéraires sont parfaitement définis.4º) Nous sommes objectivistes, quoique diverssissimes les uns des autres.5º) Nous n'avons aucune espèce de lien avec les style et la modalité littéraire d'autres cercles.6º) Nous voulons laisser bien claire notre indépendance dans le sens 'scolastique'.7º) Nous n'attribuons pas la moindre importance à la critique de ceux qui ne nous comprennent pas.
111
C'est tout.
Henrique de ResendeAscânio LopesRosário Fusco
Guilhermino CésarCristóphoro Fonte-Boa
Martins MendesOswaldo AbrittaCamillo Soares
Francisco l. Peixoto
1-Dans un Etat, tout ce qui exclue la capitale.2-Dans le sens de la province.3-En portugais "pacatíssimos".4-"Meia-Pataca" doit ici vouloir signifier la petite taille de la ville de Cataguazes. "Pataca" était une unité de valeur et une monnaie pendant la période coloniale. "Meia" signifie "demie" en français
112
NHENGAÇU VERDE AMARELO
Manifeste du VERDE-AMARELISMO OU DE L'ECOLE DE L'ANTA,
paru dans le quotidien Correio Paulistano du 17 mai 1929.
La descente des tupis des hautes plaines continentales en direction de l'Atlantique fut une fatalité historique pré-cabraline, qui prépara l'ambiance pour l'entrée dans le sertão des aventuriers blancs dompteurs de l'océan. L'expulsion, faite par le peuple tapir, des tapuias du littoral, signifie bien, dans l'histoire de l'Amérique, la proclamation du droit des races et la négation de tous les préjugés.Bien que les guerriers venus de l'Ouest soient venus en disant: "ya so Pindorama koti, itamarana po anhatim, yara rama recê", en réalité, ils ne sont pas descendus avec leur Anta1 pour absorber les hommes blancs et se fixer objectivement à la terre. Où sont les traces des anciens colonisateurs?
Les tupis sont descendus pour être absorbés. Pour se diluer dans le sang nouveau. Pour vivre subjectivement et transformer en une prodigieuse force la bonté du brésilien et son grand sentiment d'humanité.Son totem n'est pas carnivore: Anta. C'est un animal qui ouvre les chemins, et là paraît être indiquée la prédestination du peuple tupi.Toute l'histoire de cette race correspond (depuis le royaume Martim Afonso au nationaliste 'verdeamarelo', José Bonifácio) à une disparition lente des formes objectives à un apparition croissante des forces subjectives nationales. Le tupi signifie l'absence de préjugés. Le tapuia est le préjugé en personne, en fuite vers le sertão. Le jésuite a pensé qu'il avait conquis le tupi, et c'est le tupi qui avait conquis pour lui la religion du jésuite. Le portugais jugea que le tupi avait cessé d'exister; et le portugais se transforma, se levant avec la physionomie d'une nation nouvelle contre la métropole; parce que le tupi a vaincu dans l'âme et le sang du portugais.
Le tapuia s'est isolé dans la jungle, pour vivre; et il fut tué par les arquebuses et les flèches ennemies. Le tupi s'est socialisé sans peur de la mort; et il reste éternisé dans le sang de notre race. Le tapuia est mort, le tupi est vivant.Le mameluco2 s'est retourné contre l'indien, pour détruire l'expression formelle, l'extériorité aborigène, parce que ce qu'il y a d'intérieur dans le bugre3 substistera toujours dans l'âme du mameluco et se perpétuera dans les nouveaux types de croisement. C'est la physionomie propre des gens brésiliens, non fichée dans des définitions philosophiques ou politiques, mais révélée par les tendances générales communes.
Toutes les formes de jacobinisme en Amérique sont tapuias. Le nationalisme sain, de grande finalité historique, de prédestination humaine, celui là est forcément tupi. Jacobinisme ne veut pas dire isolement, mais désagrégation.
113
Le nationalisme tupi n'est pas intellectuel. Il est sentimental. Il est d'action pratique, sans détour du courant historique. Il peut accepter les formes de civilisation, mais impose l'essence du sentiment, la physionomie irradiante de son âme. Il se sent Tupã, Tamandaré ou Aricuta4 même à travers du catholicisme. Il a une horreur instinctive des luttes religieuses, devant lesquelles il sourit sincèrement: pour quoi faire?On lui donna un par dessus de la Chambre des Communs, pendant plus d'un demi siècle, et la République le trouva identique à ce qu'il était déjà au temps de D. João ou de Tiradentes.Il ne combat ni religions ni philosophies, parce que toute sa force réside dans sa capacité sentimentale.
La Nation est la résultante d'agents historiques. L'indien, le noir, le spadassin, le jésuite, le troupier, le poète, le fazendeiro, le politicien, le hollandais, le portugais, l'indien, le français, les rivières, les montagnes, l'exploitation des mines, l'élevage, l'agriculture, le soleil, les lieues immenses, la Croix du Sud, le café, la littérature française, les politiques anglaises et américaines, les huit millions de kilomètres carrés... Nous devons accepter tous ces facteurs ou détruire la Nationalité, par l'établissement de distinctions, par le démembrement nucléaire de l'idée que nous nous faisons d'elle.Comment accepter tous ces facteurs? En ne concédant de prédominance à aucun.
La philosophie tupi doit forcément être la 'non-philosophie'. Le mouvement de l'Anta se fondait sur se principe. L'indien était pris comme symbole national, justement parce qu'il signifiait l'absence de préjugé. D'entre toutes les races qui ont formé le Brésil, l'autochtone fut la seule qui disparut objectivement. D'une population de 34 millions nous ne comptons qu'un demi million de sauvages. Cependant c'est la seule des races qui exerce subjectivement sur toutes les autres l'action destructrice des traits caractérisants; c'est la seule qui évite le florissement de nationalismes exotiques; c'est la race transformatrice des races, et ce, parce qu'elle ne déclare pas de guerre, parce qu'elle n'offre à aucune des autres l'élément vitalisant de la résistance.
Cette expression de nationalisme tupi, qui fut découverte avec le mouvement de l'Anta (duquel est ressorti un sectarisme exagéré et dangereux), est évidente dans tous les moments de la vie sociale et politique brésilienne. Il n'y a pas entre nous de préjugé de races. Quant eu lieu le 13 mai, des noirs occupaient déjà des hautes positions dans le pays. Et avant, comme après cela, les fils d'étrangers de toutes les procédences n'ont jamais vu leurs pas empêchés.Nous ne connaissons pas non-plus de préjugés religieux. Notre catholicisme est trop tolérant, et tellement tolérant, que ses propres défenseurs les plus extrêmes accusent l'Eglise Brésilienne d'être une organisation sans force combative (v. Jackson de Figueiredo ou Tristão de Athayde).Il n'y a pas non-plus au Brésil de préjugé politique: ce qui importe c'est l'administration, dans laquelle nous avons le plus de succès, car c'est seulement ainsi que nous consultons les réalité nationales. Les théoriciens de la République furent ceux qui ont le moins influencé l'organisation pratique du nouveau régime. Pendant l'Empire, le système parlementaire s'est uniquement effectué par l'interférence du Pouvoir Modérateur. Dans la République ceux qui réalisent le plus sont ceux qui doctrinent le moins. Encore aujourd'hui, dans les programmes de nos candidats, nous cherchons pas les traces d'une idéologie politique, mais ce qui nous intéresse est seulement la directive de l'administration.
114
Pays sans préjugés, nous pouvons détruire nos bibliothèques, sans la moindre conséquence sur le métabolisme fonctionnel des organes vitaux de la Nation. Tout cela, est dû au nationalisme tupi, à la non-philosophie, à l'absence de systématisations.
Nous sommes un pays d'immigration et nous continuerons à être le refuge de l'humanité pour des raisons géographiques et économiques trop connues. Selon celles de Reclus, le Brésil peut contenir 300 millions d'habitants. Dans l'opinion bien fondée du sociologue mexicain Vasconcelos, c'est entre les bassins de l'Amazone et du Plata que naîtra la 'cinquième race', la 'race cosmique', qui réalisera la concorde universelle, parce qu'elle sera fille des douleurs et des espérances de toute l'humanité. Nous devons construire cette grande nation, intégrant dans la Patrie Commune toutes nos expressions historiques, ethniques, sociales, religieuses et politiques. Par la force centripète de l'élément tupi.
Mais si le tupi s'érige en philosophie, il créera des antagonismes, provoquera la dissociation, sera une force centrifuge. Et le Brésil faillira, car il précipitera les événements.Toutes et n'importe quelle systématisation philosophique sera entre nous tapuia (destinée à disparaître étouffée par tant d'autres doctrines) parce qu'elle vivra la vie éphémère des formes idéologiques de l'anticipation, des formules arbitraires d'intelligence, ayant besoin de créer une exégèse spécifique, unilatérale et sans l'amplitude des larges et soulagés sentiments américains et brésiliens.
C'est l'Inndien qui nous a appris à rire de tous les systèmes et de toutes les théories. Créer un système en son nom serait subsituer notre intuition américaine et notre conscience d'hommes libres par une mentalité d'analyse et de généralisation caractéristique des peuples déjà définis et cristallisés.La continuation du chemin historique tupi ne sera possible que par l'absence d'impositions thématiques, d'impératifs idéologiques. L'arbitraire mental ne peut pas se superposer aux fatalités cosmiques, ethniques, sociales ou religieuses.
L'étude du Brésil ne sera déjà plus l'étude de l'indien. De la même façon que l'étude de l'humanité, qui a produit le bouddhisme, le christianisme, la Grèce, le Moyen-Âge, le romantisme et l'électricité, ce ne sera que la recherche freudienne de l'homme à la pierre taillée. Si Freud nous donne un chiffre, l'histoire de l'humanité nous a offert une équation dans laquelle ce chiffre n'est qu'un des très nombreux facteurs.
Ainsi, de même, l'indien est un terme constant de la progression ethnique et sociale brésilienne; mais un terme n'est pas tout. Il a déjà été dominé, quand s'est agité entre nous le drapeau nationaliste, --le dénominateur commun des races adventices. Le placer comme numérateur serait le diminuer. Le superposer serait le condamner à la disparition. Parce qu'il vit encore, subjectivement, et vivra toujours comme un élément d'harmonie entre tous ceux qui, avant de débarquer à Santos, ont jeté à la mère, comme le cadavre de Zaratoustra, les préjugés et le s philosophies d'origine.
Nous avions et nous en avons assez de l'Europe et nous avons proclamé sans arrêt la liberté de l'action brésilienne.
Il y a une rhétorique faite de mots, comme il y a une rhétorique faite d'idées. Au fond, elles sont toutes deux faites d'artifices et de stérilités.
115
Nous combattons, depuis 1921, la vieille rhétorique verbale, nous n'acceptons pas une nouvelle rhétorique soumise à trois ou quatre règles, de penser et de sentir. Nous voulons être ce que nous sommes: brésiliens. Barbarement, avec les arrêtes sans auto-expériences scientifiques, sans psychanalyses ni théorèmes.
Nous invitons notre génération à produire sans discuter. Bien ou mal, mais produire. Il y sept ans que la littérature brésilienne est en discussion. Cherchons à écrire sans esprit pré-conçu, non-par pure expérience de styles, ou pour véhiculer des théories, quelles qu'elles soient, mais avec la seule intuition de nous révéler, libres de tous les préjugés.La vie, voilà ce qui intéresse la grande masse du peuple brésilien. En sept ans, la nouvelle génération a été son propre public. Le gros de la population ignore son existence et si elle entend parler de mouvement moderne c'est par le prestige d'une demi-douzaine de noms qui se sont imposés par la force personnelle de leurs propres talents.
Le groupe 'verdeamarelo', dont la règle est la liberté pleine de chacun d'être brésilien comme il le veut et le peut; dont la condition est que chacun interprète son pays et son peuple à travers soi-même, de sa propre détermination instinctive; --le groupe 'verdeamarelo', à la tyrannie des systématisations idéologiques, répond avec sa franchise et avec l'amplitude sans obstacle de son action brésilienne. Notre nationalisme est d'affirmation, de collaboration collective, d'égalité des peuples et des races, de liberté de pensée, de croyance dans la prédestination du Brésil, dans l'humanité, de foi dans notre valeur de construction nationale. Nous acceptons toutes institutions conservatrices, car c'est en elles que nous ferons l'inévitable rénovation du Brésil, comme le fit, à travers quatre siècles l'âme de notre peuple, à travers toutes ses expressions historiques.Notre nationalisme est 'verdeamarelo' et tupi.L'objectivisme des institutions et le subjectivisme du peuple sous l'action des facteurs géographiques et historiques.
1- Espèce de tapir.2- Métis d'indien avec Européen blanc3- Nom générique indiquant l'indien, principalement révolté ou guerrier.4- Ethnies indigènes.
116
ART MODERNE
Conférence de Menotti del Picchia pour la seconde soirée de la Semaine d’Art Moderne,
le 17 février 1922
"Sur la route de rotation de la voie lactée, les automobiles des planètes courent vertigineusement. Il bêle, l’Agneau du Zodiaque, poursuivi par la Grande Ourse, toute dentée d’astres. Les étoiles jouent le ‘jazz band’ de lumière, rythmant la danse harmonique des sphères. Le ciel paraît une immense pancarte électrique, que Dieu installa en hauteur, pour faire l’éternelle réclame de son omnipotence et de sa gloire".Ceci est le style qu’attendent de nous les passéistes, pour nous pendre, un à un, dans les fines cordes que sont les sifflements de leurs huées. Pour eux, nous sommes une bande de bolchevistes de l’esthétique, courant à 80 H.P. dans la direction de la paranoïa. Nous sommes le scandale à deux jambes, le cabotinage organisé en école. Ils nous jugent les cangaceiros1 de la prose, du vers, de la sculpture, de la peinture, de la chorégraphie, de la musique, ameutés dans la jagunçada2 du Canudos littéraire de Paulicéia Desvairada3...Quelle erreur! Rien de plus ami de l’ordre et de plus pacifique que cette meute d’avant-garde, libérée du totémisme traditionaliste, actualisée dans la vie d’aujourd’hui, policée4, violente et américaine. Personne ne respecte plus le ‘casse tête’5 du garde-civil du coin de la rue, que ce groupe d’apparence criminelle, avec les mains encore fumantes du sang d’Homère, de Virgile, Dante, Camões, Victor Hugo, et surtout Zola et ses néo-grecs, avec Heredia avant tous...C’est que, si nous assassinons, sans peine, de grands papes inactuels, nous leur baisons, avec révérence, les tombes, les aimant avec l’âme localisée à la date des épitaphes de leurs basanes.Nos yeux rayés par la vitesse des tramways électriques et des avions sont choqués par la vision des momies éternisées par l’art des embaumeurs. Cultiver l’hellénisme comme force dynamique d’une poétique du siècle équivaut à placer le corps sec, enroulé dans des bandelettes (sic), d’un Ramsès ou d’un Annésis, en position de gouverner une république démocratique, où il y a des fraudes électorales et des grèves anarchistes.Aux discoboles de Spartes, nous opposons Friedenreich et Carpentier. À la débâcle d’Illion, la résistance de Verdun ou une bataille de kémalistes. Aux princesses de ballades des châteaux construits sur les rochers, nous préférons la fille dactylographe. Nous ne voulons pas de fantômes! Nous sommes en un temps de réalités et de violences.
Notre esthétique est de réaction. En tant que telle, elle est guerrière. Le terme futuriste, avec lequel elle fut étiquetée par erreur, nous l’acceptons, parce que c’était une image de défi. Dans la glacière de marbre de Carrare du parnassianisme dominant, la pointe agressive de cette proue verbale éclate comme un bélier. Nous ne sommes pas, et nous fumes jamais ‘futuristes’. Personnellement, j’abomine le dogmatisme et la liturgie de l’école de Marinetti. Son chef est, pour nous, un précurseur illuminé, que nous vénérons comme un général de la grande bataille de la Réforme, qui étend son ‘front’6 dans tout le monde. Au Brésil, il n’y a, cependant, pas de raison logique et sociale pour un futurisme orthodoxe, parce que le prestige de son passé n’a pas de moule qui empêchera la liberté de sa façon d’être future. De plus, la cage d’une école répugne notre individualisme esthétique. Nous cherchons, chacun, agir en accord avec notre tempérament, dans la sincérité la plus intrépide.Ce qui nous rassemble n’est pas une force centripète d’identité technique ou artistique. La diversité de nos manières vous la vérifierez dans la complexité des formes que nous pratiquons. Ce qui nous regroupe est l’idée générale de libération contre le fakirisme stagnant et contemplatif, qui annule la capacité créatrice de ceux qui espèrent encore voir le soleil se lever derrière le Parthénon en ruines. Nous voulons de la lumière, de l’air, des ventilateurs, des aéroplanes, des revendications ouvrières, des idéalismes, des moteurs, des cheminées de fabriques, du sang, de la vitesse, du rêve, dans notre art! Et que le roulement de tambour d’une automobile, sur les rails de deux vers, effraye de la poésie le dernier poète homérique, qui, anachroniquement, dort et rêve, à l’ère du ‘jazz-band’ et du cinéma, avec la flûte des pasteurs d’Arcadie et les seins divins d’Hélène! (p. 176)(...)Que le dadaïsme, le tatilisme, le cubisme, le futurisme, le bolchevisme, l’erotrastisme ne vous effraient pas: ce sont les ingrédients magiques et éphémères de l’alchimie humaine, préparant un nouveau moule
117
mental sur lequel s’entraîneront, séculairement, les futurs académiciens, décadents et passéistes. Nous sommes l’Alfa du nouveau cycle. Nous voulons détruire seulement les derniers restes de l’Oméga du cycle mort, pour développer l’autonomie vibrante de notre façon d’être dans le temps et l’espace. (p.176)(...) Jupiter pourra entrer dans notre Art, mais nous ne l’admettrons pas nu, inactuel, chevelu, comme l’acceptent les parnassiens. Nous ne voulons pas entendre parler de scandales, ni de devoir régler des comptes avec la police. Le père des dieux, pour transiter dans nos rues, doit être un mister7 qui va, avant, chez le barbier, se couvre d’un pardessus sobre, et laisse à la maison le dangereux revolver olympique, qu’est la petite boîte à foudre, et que, bourgeois et pacifique, tel comme l’a peint André Gide, il s’annule dans la vie commune, dans la tragédie des autres hommes. (p.177)(...) Il suffit de décrire les cavalcades des satyres caprins derrière les nymphes ‘lévipèdes’ et efflanquées: la Babylone qu’est São Paulo est pleine de faunes urbains et les nymphes modernes dansent le maxixe8 au son du ‘jazz’ sans craindre les égéries de la République...(p. 171)(...)Que meure la femme tuberculeuse lyrique! Dans le campement de notre civilisation pragmatiste, la femme est la collaboratrice intelligente et alerte de la bataille nocturne, elle vole dans l’aéroplane, qui réaffirme la victoire brésilienne de Santos Dumont, et crée le mécanicien de demain qui découvrira l’appareil destiné à la conquête des astres! (p. 178)
(...)Nous voulons exprimer notre plus libre spontanéité dans la plus spontanée liberté. Être comme nous sommes, sincères, sans artificialismes, sans contortionnismes, sans écoles. (...) Donner à la prose et au vers ce qui leur manque encore entre nous : des os, des muscles, des nerfs. Tailler, avec le courage d’un Jeca9
qui dégrossit10 à la faucille la "jungle austère et forte" de l’adjectivation frondeuse, farfelue, incompatible avec un siècle d’économie, où la minute est de l’or. (...)Rien de postiche, de mielleux, d’artificiel, de détourné, de précieux : nous voulons écrire avec du sang -- qui est humanité; avec de l’électricité -- qui est mouvement, expression dynamique du siècle; violence -- qui est l’énergie du bandeirante11.Ainsi naîtra un art véritablement brésilien, fils du ciel et de la terre, de l’homme et du mystère. (p.178)(...)Aujourd’hui qu'à Ouro Preto12, le ‘cow-boy’13 national reproduit, sur son cheval indien, l’épopée équestre des Rolands furibonds; que l’industriel à la vision aquiline accumule des millions plus visibles que ceux de Crésus; qu’Edu Chaves reproduit avec l’audace de São Paulo le rêve d’Icare, pourquoi n’actualisons-nous pas notre art, en chantant ces Illiades brésiliennes? Pourquoi préférons-nous un Athènes dont les restes d’Acropole sont déjà criblés de balles de mitrailleuses?Non! Arrêtons-nous devant la tragédie hodierne. La ville tentaculaire enracine ses ganglions dans une aire territoriale qui abrite 600 000 âmes. Il y a dans l’angoisse et dans la gloire de ses luttes des odyssées plus formidables que celles que chanta l’aède aveugle ; celle de l’ouvrier revendiquant ses droits; celle du bourgeois défendant son arche; celle des fonctionnaires glissant sur les rails des règlements; celle de l’industriel combattant le combat de la concurrence; celle de l’aristocrate exhibant son faste; celle du politicien assurant son ascension; celle de la femme cassant les menottes de son esclavage séculaire dans les gynécées éventrés par les idées libertaires post-bellum....Tout cela -- et l’automobile, les fils électriques, les usines, les aéroplanes, l’art -- tout cela constitue nos éléments de l’esthétique moderne, fragments de pierre avec lesquels nous construirons, jour après jour, la Babel de notre Rêve, notre désespoir d’exilés d’un ciel qui brille là-haut, et vers lequel nous grimpons, dans l’angoisse dévorante de toucher avec les mains, les étoiles.
-1-paysans révoltés du nordest brésilien -2-groupe de jagunços, qui sont les fanatiques révolutionnaires de la bataille de Canudos-3- soit: São Paulo hallucinée, en référence au texte de Mário de Andrade, pris ici comme symbole de la Semaine d’Art Moderne-4- note du traducteur: "policiada" signifie policée, mais également civilisée-5- En français dans le texte-6- en français et entre guillemets dans le texte-7- en anglais dans le texte-8- maxixe: danse urbaine originaire de Rio de Janeiro résultant d’une fusion d’une danse afro-cubaine et de la polca-9- nom et symbole du caboclo de l’intérieur du Brésil, éternisé par le personnage Jeca-Tatú du Roman de Monteiro Lobato. Le caboclo est fils d’un blanc et d’une indienne
118
-10- "desbasta" signifie aussi "civilise"-11- Le bandeirante est le pionnier, le conquérant de la ‘steppe’ qu’est le sertão brésilien-12- capitale de l’État de Minas Gerais-13- En anglais dans le texte
119
Bibliographie
Ouvrages théoriques et ouvrages généraux
•BOSI, Alfredo, História concisa da literatura brasileira, 2e éd, São Paulo: Editôra Cultrix, 1973. -671 p.
•BOSI, Alfredo, Dialética da Colonização, 3e édition, São Paulo: Companhia das Letras, 1992. -412p.
•CAILLOIS, Roger, Le mythe et l'homme, Paris: Gallimard, coll. Folio / Essais, 1987. -188p. •CASTRO FARÍA, Luiz de, A guisa de depoimento e reflexão, Nacionalismo, nacionalismo -
dualidade e polimorfía, conférence retranscrite par Adriana de Resende Barreto Vianna et Antonio Carlos de Souza Lima (PPGAS / Museu Nacional - UFRJ), document non-daté (mais postérieur à 1993). -16 p.
•DURAND Gilbert, Figures mythiques et visage de l'œuvre, Paris: Berg International, 1979. - pp. 11-36.
•DURAND Gilbert, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, 10e édition, Paris: Dunod, 1984. -pp. 15-40.
•ORY, Pascal (Dir.), Nouvelle Histoire des Idées Politiques, Parsi, Hachette, coll. "Pluriel", 1987. -832 p.
•SAID, Edward W., Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, São Paulo, ed. Companhía das Letras, 1990. -370 p.
•SIRONNEAU Jean-Pierre, Figures de l'imaginaire religieux et dérive idéologique, Paris: L'Harmattan, collection Logiques Sociales, 1993. -238 p.
•TADIE, Jean-Yves, La critique littéraire au XXe siècle, Paris: ed. Belfond, 1987. 317 p.
Ouvrages de première main et recueils
•ALMEIDA, José Américo de, A Bagaçeira, 25e édition, Rio de Janeiro: Biblioteca do exército Editora,Coleção General Benício, 1988 (1e éd. 1928). -125 p.
•ANDRADE, Mário de, Poesías Completas, São Paulo: Livr. Martins ed., coll. Obras Completas de Mário de Andrade, vol. 2, 1955. - 491 p.
•ANDRADE, Mário de, Balança, Trombeta e Battleship ou o descobrimento da alma, "édition génétique et critique" de telê Porto Ancôna Lopes, São Paulo: Instituto Moreira Salles, Instituto de estudos Brasileiros, 1994. -179 p.
•ANDRADE, Mário de, Macunaíma: o herói sem nenhum caráter, 29e édition (texte revu par Telê Porto Ancona Lopez), Belo Horizonte: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., Coleção Biblioteca de literatura Brasileira: 1, 1993 (1e éd. 1928). - 135 p.
120
•ANDRADE, Mário de, "O movimento modernista" (conférence faite à la casa do Estudante de São Paulo en 1942), in Aspectos da Literatura Brasileira, São Paulo: Livr. Martins ed./MEC, sans date.
•ANDRADE, Oswald de, Pau-Brasil, 5e éd., São Paulo: Globo ed., coll. Obras Completas de Oswald de Andrade, vol. 3, 1991 (1e éd. 1924). - 145 p.
•ARANHA, Graça, Chanaan, Rio de Janeiro: Ed. Briguiet & Cia., Obras completas de Graça Aranha, vol. 1, 1939 (1e édition 1902). - 276 p.
•BOPP, Raúl, Cobra Norato e outros poemas, Barcelona: ed. Dau Al Set, 1954 (1e éd.1931). - 133p.
•BOPP, Raúl, Vidas e morte da Antropofagía, Rio de Janeiro: ed. Civilisação Brasileira/MEC, 1977. - 94 p.
•CARVALHO, Ronald de, Estudos Brasileiros, 3e éd., Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1931 (1e. ed. 1930). -170 p.
•BUARQUE de HOLANDA, Sérgio, Raízes do Brasil, 26e édition (Éditorial et Post-scriptum d'Antonio Candido), São Paulo: Companhía das Letras, 1995 (1e édition 1936).- 220p.
•CANDIDO, Antonio, L'endroit et l'envers: essais de littérature et de sociologie, Paris: Éditions UNESCO/Éditions Métailié, 1995.- 262p.
•CENDRARS, Blaise, Brésil, des hommes sont venus..., Montpellier: Fata Morgana, 1987. -103p.
•CENDRARS, Blaise, Folhas de Viagem Sul-Americanas, Édition Bilingue (Trad. de Sérgio Wax), Belém: Ed. Universitária UFPA, 1991. -202 p.
•CENDRARS, Blaise, Páscoa em Nova Iorque, Prosa do Transiberiano e outros poemas, Édition bilingue (trad de Sérgio Wax), Belém: Ed. Universitária UFPA, 1995. -195p.
•FREYRE Gilberto, Tempo morto e outros tempos, trechos de um diário de adolescência e primeira mocidade, 1915 - 1933, Rio de Janeiro: José Olympio, 1975.- 267p.
•FREYRE, Gilberto, Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economía patriarcal, 16e édition, Rio de Janeiro: José Olympio, 1973 (1e éd. 1933).-573 p.
•FREYRE , Gilberto, Manifesto Regionalista, 6e édition, Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, Série Documentos 6, 1976 (1e éd. 1926), 80 p.
•PACHECO, João, Antología do conto paulista, São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, Comissão de Literatura, coleção Textos e Documentos, 1959. -275 p.
•PICCHIA, Menotti del, Juca Mulato, 5e édition, São Paulo: Cia grafico-Editora Monteiro Lobato 1925 (1e éd. 1917).-85 p.
•PICCHIA, Menotti del, Juca Mulato suivi de Máscaras, Angústia deD. João et O amor de Dulcinéia, São Paulo: Martins, 1965.-225p.
•RÊGO, José Lins do, Bangüê, 11e éd, Rio de Janeiro: livr. José Olympio ed., 1979 (1e éd. 1934). -207 p.
•RICARDO, Cassiano, Martim Cererê (o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis), 13e édition, Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1974 (1e éd. 1928). -188 p.
•SALGADO, Plínio, O esperado, 2e édition, Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1936 (1e éd.1930). - 304 p.
•STADEN Hans, Nus, féroces et anthropophages, Paris: Métaillé, coll. Points, 1979 (1e édition intitulée "Véritable histoire et description d'un pays habité par des hommes sauvages nus et féroces et anthropophages situé dans le nouveau monde nommé Amérique inconnu dans le pays de Hesse avant et depuis la naissance de Jéus Christ jusqu'à l'année dernière, 1557). -252 p.
•Modernidade, art brésilien du XXe siècle, catalogue de l'exposition qui eut lieu au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (10 déc. 1987 - 14 févr. 1988), Paris: Ministère des affaires étrangères / Association Française d'Action Artistique, 1987. - 425 p.
121
Revues et recueils de documents d'époque.
•ANCONA LOPEZ, Telê Porto, Mário de Andrade: entrevistas e depoimentos, São Paulo: T.A. Queiroz, Biblioteca de letras e ciências humanas, 1983. -114 p.
•ANDRADE, Mário de, Cartas a Manuel Bandeira (correspondance), São Paulo: Ediouro, col. Prestígio, 1958.
•DE MORAES NETO, Prudente de, BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio (dir.), Estética, nº1, 1e année, vol 1, Sept 1924, Rio de Janeiro: Livr. Odeon.
•DE MORAES NETO, Prudente de, BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio (dir.), Estética, nº2, 2e année, vol 1, Janvier-Mars 1925, Rio de Janeiro: Livr. Odeon.
•LISTA, Giovanni, Futuriste (manifestes, documents, proclamations), Lausanne: ed. L'Age d'Homme, 1973. -450 p.
•MENDONÇA TELES, Gilberto, Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro, apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas, Petrópolis: ed. Vozes, 1972.- 271 p.
•ROSSETTI BATISTA, Marta, ANCONA LOPEZ, Telê Porto, SOARES DE LIMA, Yone, Brasil: 1º tempo modernista - 1917/29, Documentação, São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1972. -459 p.
•Revista de Antropofagía, Réédition de la revue littéraire publiée à São Paulo - '1e et 2e dentitions' (1928 -1929), São Paulo: Metal Leve S.A., 1976
Études
•ABDALA Jr, Benjamin & CAMPEDELLI Samira Youssef, Tempos da literatura Brasileira, 3e éd., São Paulo, ed. Ática, 1990. -304.
•ALAMBERT, Francisco, A Semana de 22, a aventura modernista no Brasil, São Paulo: Ed. Scipione, coll. "história em aberto", 1992. -104p.
•ALENCAR, Francisco, CARPI, Lucia & RIBEIRO, Marcus Venício, História da Sociedade Brasileira, 3e éd., Rio de Janeiro, Ed. Ao Livro Técnico, 1985. -339 p.
•AMARAL, Aracy, Artes plásticas na Semana de 22, São Paulo: ed. Perspectiva, coll. "debates/arte", 1970.-323 p.
•BOAVENTURA, María Eugenia, A vanguarda antropofágica, São Paulo: Ed. Ática, Ensaios 114, 1985. -211 p.
•BRITO, Mário da Silva, História do Modernismo brasileiro: Antecedentes da Semana de Arte Moderna, 5e édition, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. -322 p.
•CARELLI, Mário, "Les brésiliens à Paris de la naissance du romantisme aux avant-gardes", in KASPI Antoine et MARES Antoine (dir.), Le Paris des étrangers (depuis un siècle), Paris: Imprimerie Nationale ed., coll. "notre siècle", 1989. - chap. XXI, pp. 287-298.
•CARELLI, Mário & NOGUEIRA GALVÃO, Walnice, Le roman brésilien, une littérature anthopophage au XXe siècle, Paris: PUF, coll. écriture, 1995. - 168 p.
•FABRIS, Annateresa (org.), Modernidade e modernismo no Brasil, Campinas: ed. Mercado das Letras, Coll. Arte: ensaios e documentos, 1994. -160p.
122
•GARCÍA DOREA, Augusta, O romance modernista de Plínio Salgado, 2e édition, São Paulo: IBRASA (instituição Brasileira de Difusão Cultural S.A.-Brasília), INL(Instituto Nacional do Livro - Ministério de Educação e Cultura), 1978 (1e éd. 1956). -125p.
•JARDIM DE MORAIS, Eduardo, A brasilidade modernista: sua dimensão filosófica, Rio de Janeiro: Graal, 1978. -192 p.
•LAPLANTINE, François, "Le merveilleux, l'imaginaire en liberté", in Lieux et non-lieux de l'imaginaire, Paris, Actes Sud / Babel, coll. Internationale de l'imaginaire, 1994. -pp. 68-79.
•LEENHARDT, Jacques et KALFON, Pierre (dir.), Les Amériques Latines en France, Paris: Gallimard, coll "découvertes" (en assoc. avec l'AFAA), 1992. -156 p.
•MACHADO NETO, Zahidé, Estrutura social dos dois Nordestes na obra literária de José Lins do Rêgo, Bahía, Universidade Federal da Bahía, Coleção Ciência e Homem, 197.-118 p.
•MICELI, Sérgio, Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945), São Paulo: DIFEL/Difusão Cultural S/A, Corpo e Alma do Brasil, 1979. -210p.
•MOISÉS, Massaud, História da literatura brasileira (volume V): Modernismo, São Paulo: Cultrix/ Editora da Universidade de São Paulo, 1989. -591 p.
•ORTIZ, Renato, A moderna tradição brasileira, São Paulo: ed. Brasiliense, 1988. -222p.•PECAUT, Daniel, "Les intellectuels brésiliens et la pensée politique", in PECAUT Daniel &
SORJ Bernardo, Métamorphoses de la Représentation politique, au Brésil et en Europe, Paris: Ed. du CNRS, 1991. - pp 109 -121.
•PÉCAUT, Daniel, Entre le Peuple et la Nation (les intellectuels et la politique au Brésil), Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Brasília, 1989. -315p.
•SANDRONI, Carlos, Um sabor de Joana d'Arc, cultura e política em Mário de Andrade, (thèse de l'IUPRJ), Rio de Janeiro, 1987.
•TRINDADE, Hélgio, La tentation fasciste au Brésil dans les années trente, Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection Brasília, 1988. -256 p.
•THIESSE, Anne-Marie, Ecrire la France: le mouvement régionaliste de langue française entre la belle époque et la libération, Paris: PUF, coll. "ethnologies", 1991. -314 p.
•VAYSSIERE, Pierre, l'Amérique Latine de 1890 à nos jours, Paris: Hachette Livre, coll. "Carré Histoire", 1996. -255 p.
•VELOSO MOTTA SANTOS, Mariza, O tecido do tempo: a idéia do patrimônio Cultural no Brasil, 1920 - 1970, (thèse de doctorat présentée au Programa de Pós-graduação em Antropología, Departamento de Antropología, Instituto de Ciências Sociais Humanas) Brasília: Universidade de Brasília, 1992. - 486 p.
•VIANNA Jr., Hermano Paes, A descoberta do Samba, Música popular e identidade nacional, (thèse de doctorat), Rio de Janeiro: UFRJ / PPGAS, 1994.
•WENZEL WHITE, Erdmute, Les années vingt au Brésil: le modernisme et l'avant-garde au Brésil, Paris: ed. Gay-Lussac, coll. Thèses, Mémoires et Travaux, 1972. -230 p.
Périodiques
•AMARAL, Aracy, "Oswald de Andrade e as artes plásticas no Modernismo dos anos 20", in Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, (Univ. de São Paulo), São Paulo: nº33, 1922. -pp.68-75.
•AVELINO FILHO, George, "Cordialidade e civilidade em raízes do brasil", in Revista Brasileira de Ciências Sociais (ANPOCS), Vértice, nº12, février 1990. -pp. 5-14.
123
•CASTRO GOMES, Angela de, "A dialética da tradição", in Revista Brasileira de Ciências Sociais (ANPOCS), Vértice, nº12, février 1990. -pp.15-27.
•FERREIRA, Antonio Celso, "Historia que se fragmenta - Oswald de Andrade, Marco Zero", in História (Univ. Estadual Paulista/UNESP), São Paulo: nº11, 1991, pp.17-24.
•GARCIA Jr., Afrânio Raul, "Les intellectuels et la Conscience Nationale au Brésil", in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Paris: nº98, juin 1993, pp. 20-33.
•LOPES DA SILVA, Zélia, "A cultura popular nas artes plásticas: estudo da obra de Tarsila do Amaral de 1923 a 1938", in História (Univ. Estadual Paulista/UNESP), São Paulo: nº11, 1992. -pp. 121-136.
•OLIVEIRA, Márcio de, "Une mise en perspective historique du mythe de la nation", in Cahiers du Brésil Contemporain (CRBC / EHESS), Paris: nº23-24, 1994. -pp.129-143.
•SALA, Dalton, "Mário de Andrade e o anteprojeto so SPHAN", in Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (Univ. de São Paulo), São Paulo: nº31, 1990. -pp. 19-26.
•SALDANHA, Nelson, "O modernismo Brasileiro e as ciências sociais", in Cultura e economía, (Comunicações da UFP), Recife: ed. Pimes, nº 16, 1977. -pp. 1-12.
•"Os anos 20", in Estudos Históricos, (Cpdoc/FGV), Rio de Janeiro: nº 11, 1993. -144p.•"Les futurismes-1", numéro spécial de la revue Europe, Paris: nº551, 53e année, Mars 1975.
-248p.•":Le modernisme brésilien", numéro spécial de la revue Europe, Paris: nº599, 57e année,
Mars 1979. -249 p.
124
LexiqueNous traduisons ici les mots clés qui apparaissent à plusieurs reprises dans le texte, et qui n'ont pas d'équivalent en français. Nous n'avons retenu que la définition de ces mots, dans le sens où nous les avons utilisés.
Bandeira: traditionnellement, il s'agissait des expédition militaires portgugaises de conquête des terres reculées. Dans le contexte du début du siècle, il s'agit de la conquête des terres non-exploitées jusque-là par les travailleurs ruraux. Ces expéditions prennent dans le contexte nationaliste du début du siècle, un sens héroïque.Bandeirante: pionnier, ou membre des bandeiras.Caboclo: Métis de blanc avec indien (c'est aussi l'ancienne dénomination de l'indigène).Carioca: habitant de la ville (à l'époque capital;e du Brésil) ou de l'Etat de Rio de Janeiro.Fazenda: domaine et exploitation agricole. Fazendeiro: propriétaire d'une fazenda.Interior: littéralement "intérieur". Nous utilisons ce mot dans trois sens principaux, celui de la campagne, de la province, ou enfin de tout ce qui n'est pas la capitale d'un Etat. C'est enfin la région qui s'oppose au littoral.Mineiro: habitant de l'Etat de Minas Gerais.Paulista: habitant de la ville de São Paulo.Paulistano: habitant de l'Etat de São Paulo.República Velha: la "Vieille République", est celle qui est fondée en 1889 et qui va jusqu'à la Révolution de 1930.Sertão: originellement, ce terme se rapproche de celui d'"interior". Mais c'est surtout une région reculée du Brésil, en particulier dans le Nord-Ouest du Brésil, zone aride, peu peuplée, où prédomine l'élevage et où perdurent des traditions et des coutumes anciennes.Verdeamarelo: "Vert-Jaune": ce sont les couleurs du drapeau Brésilien, et c'est le nom d'un des courants du modernisme brésilien.
125