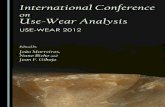La reconnaissance sociale et le Mouvement des Sans Terre du Brésil. En quête de dignité
MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET...
Transcript of MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET...
133
MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
André PROUS, Andrei ISNARDIS, Ângelo PESSOA LIMA, Marcio ALONSO, Henrique PILO & Maria Clara MIGLIACIO
Setor de Arqueologia, Museu de Historia Natural, Federal University of Minas Gerais, Cx. P. 1275, 31080-010 Belo Horizonte, Brazil,
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Résumé: Débité à main libre ou sur enclume, le quartz est la matière première taillée principale sur le littoral brésilien (filonien) et dans le centre du pays (cristallin). Les éclats furent utilisés soit bruts, soit retouchés en grattoir ou en pointe bifaciale. Les quartzites ont fourni les éclats coupants dans le sud du Brésil et, dans le centre, les outils retouchés les plus robustes (limaces, plan-convexes divers). Taillée sur enclume, l’agate a fourni des éclats dans certaines parties du Brésil méridional. Dans le Pantanal, elle a été utilisée comme perçoir pour fabriquer des éléments de colliers. L’hématite compacte a également été taillée (couteaux et préformes de lames de haches polies). Mots clés: Industries de quartz; quartzite, hématite; calcédoine; Brésil
Abstract:Quartz is the most common flaked raw material in Brazil. It predominantly occurs on the coast and has been generally flaked on anvil-stones. Many flakes were used without further modification, but end scrapers and bifacial points are found in central Brazil, where heavy implements (limaces, side scrapers) were made of quartzite. Minimally retouched or unretouched quartzite flakes are numerous in the southern regions. Agate flakes worked on anvil stones are common in the far south and in the far-west, where they were used as drills to perforate stone beads. Hematite has been flaked in Minas Gerais State and was primarily used to manufacture bifacial preforms for axes that where exported away from the production sites covering very long distances. Keywords: Quartz industry; quartzite; hematite; calcedony; Brazil
INTRODUCTION
Dans la plus grande partie du Brésil, le sílex est rare ou de mauvaise qualité et les roches les plus utilisées pour la taille et le polissage seraient considérées “exotiques” en Europe.
En premier lieu vient le quartz, particulièrement abondant le long des côtes (quartz de filon) et dans certaines régions du Brésil central (cristal de roche, dans l’État de Minas Gerais). Ensuite diverses variétés de quartzite (dont celle que les brésiliens appellent “grès silicifié”, dans le Brésil méridional), que nous ne ferons ici que mentionner rapidement. Beaucoup plus rare, des matières comme l’hématite compacte (dans l’État de Minas Gerais et dans la Serra de Carajas, en Amazonie), la sillimanite (une bonne partie de Minas Gerais) et l’agate (sud du Brésil et Mato Grosso) ont joué localement um rôle important, surtout pour la fabrication de lames polies. La taille du quartz continue encore dans le centre du Brésil, où les industries exigent de la silice absolument pure; il faut donc décortiquer les cristaux avant de les vendre. Comme cette opération se fait souvent dans les abris à peintures rupestres déjà utilisés par les tailleurs préhistoriques, il est très important pour les archéologues de différencier les amas de taille récents des ensembles de débitage anciens. Nous avons observé les derniers villageois qui taillent la pierre, dont nous présenterons ici le travail, comparant le résultat de leurs actions à celui des ensembles préhistoriques.
LA TAILLE DU QUARTZ DANS LE MINAS GERAIS: DE LA PREHISTOIRE A L’ERE INDUSTRIELLE (AI, AP, A. PESSOA)
Le quartz a été la principale matière taillée depuis de début du peuplement dans le centre de Minas Gerais (dès avant 11.000 BP à Lagoa Santa) jusqu’à la veille de la conquête portugaise. Toutes les populations ont débité ce matériel, soit à main libre, soit sur enclume; ce fut surtout pour obtenir des éclats coupants mais les plus anciennes industries comportent des petits grattoirs sur éclat de couronne de cristal et de magnifiques pointes de trait bifaciales sur grands éclats.
Nous ne détaillerons pas ici ces industries préhistoriques, que nous avons décrites ailleurs (Prous et alii sous presse; Prous & Isnardis, sous presse) mais montrerons en quoi elles diffèrent des debitages modernes pratiqués par les centaines de collecteurs de cristaux de quartz travaillant pour les industries de télécommunication dans la région de Diamantina.
Les variétés de quartz
Les tailleurs actuels de la région de Diamantina travaillent le cristal de roche et distinguent plusieurs qualités de quartz, éventuellement présentes dans un même cristal:
− la première qualité est très hyaline. Nous avons vérifié qu’elle produit des éclats à face interne lisse et des
NON-FLINT RAW MATERIAL USE IN PREHISTORY / L’UTILISATION PRÉHISTORIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES ALTERNATIVES
134
Fig. 14.1. Grand dépôt de déchets de quartz
Fig. 14.2. Tailleur moderne en action
stigmates classiques (bulbe, ondes, voire lancettes). On la trouve particulièrement près de la couronne des cristaux.
− la deuxième qualité est hyaline avec des défauts. La face interne des éclats est irrégulière, presentant de faibles rugosités; les ondes ne sont pratiquement pas visibles et le bulbe, très diffus.
− le quartz de troisième qualité, translucide, est normale-ment mis au rebut.
L’objectif des tailleurs n’est pas de mettre en forme les blocs qui seront vendus, mais de les débarrasser de toutes les impuretés. Celà suppose de retirer complètement le cortex, puis d’entamer les blocs là où existent des plans de fissure potentielle. Il n’y a pas de dimension minimum pour les produits finaux, mais les plus petits mesurent encore environ 4 cm de diamètre alors que les plus grands sont décimétriques.
Les tailleurs distinguent deux types de travail:
a) tout d’abord la “casse”, qui consiste à débiter de grosses tranches dans les cristaux, en commençant par la racine, pour ne pas abimer la couronne où se concentre le matériel de meilleure qualité. Ils utilisent pour ce faire un gros marteau de métal, dont le poids varie entre 1 et 2 kg, jusqu’à 8 kg, selon la taille des cristaux (bien que la plupart soit de dimensions décimétriques, il existe des cristaux de près de 2m de long). Quand il faut plusieurs coups pour fracturer le cristal, des fractures parasites se forment, donnant naissance à des blocs et éclats irréguliers. Ces tranches, ou ces blocs fracturés, offrent des angles adéquats pour le détachement des premiers éclats corticaux; opération que l’on nomme “martelage”.
b) Le martelage se fait avec des petits marteaux (fer pesant entre 50 et 100 g) possédant une pointe opposée à une surface plane; le manche est long (25 à 30 cm) et étroit (1 à 2 cm). Le marteau est tenu à mi-manche pour les percussions d’intensité “normale” (décorti-
cage), mais la main s’éloigne du fer quand il faut plus de force (fracture des grands éclats-nucleus là où l’on devine des clivages et des impuretés). Il faut frapper à coups francs, évitant de pulvériser ou de fissurer les parties hyalines, ce qui leur ferait perdre toute valeur. Les blocs sont tenus de façon diverse selon les tailleurs: certains les gardent dans le creux de la main, appuyant le doigt contre le flanc em cours de débitage. Il ne s’agit pas d’aider l’éclat à filer, mais de faire em sorte que les éclats tombent dans la main et n’atteignent pas leurs jambes, évitant ainsi des coupures.
Les blocs sont abordés à partir de plans de frappe les plus divers, de manière opportuniste, ce qui crée des formes globulaires; il arrive cependant que l’on tourne autour d’un plan unique, provoquant la formation d’um pseudo “nucleus” pyramidal.
Fig. 14.3. Eclat moderne, produit des garimpeiros
A. PROUS ET AL.: MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
135
Fig. 14.4. a & b. Racloir en quartz
Tab. 14.1. Restes de la préparation d’un ensemble de cristaux – village de Cuiaba
Produits vendables (“lascas” = blocs) 7830 g 67%
Grands déchets (“esperdicio”, “bagulho” = cassons, esquilles) 3296 g 29%
Petit déchets (“areia” = poudre) 406 g 4%
On remarque que les tailleurs ne se rebutent pas devant les angles les plus obtus, insistant avec la pointe du marteau pour détacher des éclats corticaux en position mésiale sur le bloc débité, au risque de provoquer des fractures et des éclats parasites. Si nécessaire, la pointe du marteau crée une petite marche qui établit un angle droit. Quand l’opération s’avère impossible, l’éclat-nucleus est alors fracturé de manière à atteindre la zone corticale. Les plans de fracture ou de clivage potentiels sont systématiquement recherchés et ouverts, tant pour exposer les impuretés qu’ils contiennent que pour obtenir l’accès aux parties corticales les plus éloignées des bords.
Le matériel résiduel propre à la vente est donc formé de blocs nucléiformes, qui rappellent parfois des outils retouchés (racloir), éventuellement plan-convexes (limaces, rabots, grattoir caréné). Selon les habitudes, l’habileté des tailleurs et la qualité du quartz, les détritus sont plutôt des cassons ou des éclats typiques. Les bulbes et contre-bulbes ne sont nets que dans les meilleurs variétés de cristal. Il n’y a souvent qu’une unique onde, très envahissante et peu bombée (Tableau 14.1).
Dans un des villages étudiés, les cristaux sont ramenés entiers au village, par camion. C’est le patron – un homme – qui “sait” faire la casse, que les femmes ne se hasardent pas à la tenter. Par contre, elles se chargent du
“martelage”. Dans un autre village, où les gisements sont plus difficiles d’accès (le transport se fait à dos d’âne), les hommes taillent près des lieux d’extraction et il n’y a pas de division sexuelle ou hiérarchique du travail. Tous ont créé un vocabulaire spécialisé pour désigner les blocs décortiqués (“éclats”), les déchets (le f...), et la poudre résiduelle (le “sable”), etc.
Des villages entiers ont ainsi vécu, tout au long du XX° siècle, de la recherche et de la préparation du quartz pour les industries; un bon tailleur préparant jusqu’à 200kg par jour. Ce commerce est actuellement en crise (le quartz décortiqué de première qualité se vend 30 centimes d’Euro par kg aux acheteurs japonais). La taille des cristaux est donc de plus en plus remplacée par la collecte de pièces entières pour l’industrie touristique.
Les éclats provenant du décorticage que nous avons examinés sont, pour la plupart épais et présentent un angle abrupt, voire légèrement aigü, entre le talon (épais et large) et la face interne; la morphologie dominante est quadrangulaire, rarement allongée (on ne recherche pas les nervures pour faire filer les éclats).
Le matériel préhistorique retiré des couches profondes des abris se caractérise par contre par la rareté des cassons, par des éclats à talon lisse et mince, bulbe court, angle de
NON-FLINT RAW MATERIAL USE IN PREHISTORY / L’UTILISATION PRÉHISTORIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES ALTERNATIVES
136
Fig. 14.5. a & b. Point de projetil en quartz
Tab. 14.2. Comparaison entre les attributs des éclats de quartz préhistoriques et modernes
Industries de l’Holocène moyen et supérieur
industrie des garimpeiros
Points d’impact bien marqués bien marqués ou écrasés
Partie proximale entières fort esquillement et fissures
talons lisses et minces très épais, parfois écrasés
Angle de chasse obtus droit ou aigü
bulbes bien marqués, limités à la partie proximale bien marqués, envahissants
ondes irregulières et accentuées discrètes, souvent unique
cortex Assez fréquent sur les éclats et nuclei seulement sur les éclats de decorticage
Facettes formées par des plans de clivage absentes assez fréquentes
cassons petits et peu fréquents grands et nombreux
chasse plus fermé, et un système d’ondes distinct (Tableau 14.2).
Notons que le débitage des industries préhistoriques de Diamantina, qui sélectionnaient les très beaux cristaux hyalins, est assez différent de celui des régions plus méridionales de Minas Gerais (Serra do Cipó, Lagoa Santa, Quadrilatère ferifère) ou du reste du Brésil (surtout littoral) dans lesquelle le quartz a été essentiellement taillé sur enclume
LE TRAVAIL DE L’HEMATITE DANS LE QUADRILATERE FERREUX (HP, APESSOA, AP)
L’état de Minas Gerais est l’un des plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer, qu’on trouve sous forme de concrétions, d’hématite compacte à haute teneur, ou d’itabirite.
Les fouilles de A. Baeta et H. Piló ont révélé la présence de grottes dans le minerai ferreux, On y trouve des foyers préhistoriques, des outils en quartz et, en période finale,
de la céramique fine. Comme la région est très pauvre en faune et en plantes alimentaires, on peut penser qu’elle a été surtout fréquentée pour l’acquisition de la matière première nécessaire à la fabrication des haches de pierre polie en hématite. On trouve en effet ces outils dans les régions voisines, à des dizaines de kilomètres de distance, particulièrement, dans les abris de Lagoa Santa et de la Serra do Cipó, depuis des niveaux datés de plus de 8.000 ans. Dans la région productrice, certains feuillets d’hématite semblent avoir été extraits pour leurs tranchants. Nous avons étudié la taille, le piquetage et le polissage de l’hématite de plusieurs sources (blocs retirés em affleurement et galets de rivière) pour évaluer les propriétés de cette roche et l’investissement nécessaire à sa transformation.
Matière première
On trouve l’hématite sous quatre formes principales.
− Minerai contenant des minéraux oxydables, qui laissent des porosités après leur évacuation. Il se défait en petits blocs quand il est taillé et les défauts apparaissent au
A. PROUS ET AL.: MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
137
a b
c d
Fig. 14.6. a, b, c & d. Lames de hache et préformes en hématite
polissage, laissant une surface rugueuse. Il semble que cette variété n’ait pas été utilisée par les préhistoriques.
− Minerai feuilleté ou bandé, en raison de la disposition an-isotropique des impuretés minérales; cette forme est abondante dans les grottes, mais rare sous forme de galets dans les rivières, où elle est rapidement détruite par les chocs. Elle permet d’obtenir par taille des feuillets à bords coupants.
− Hématite compacte et homogène, granuloplastique, dont la surface naturellement polie est visible dans les grottes ou sur les galets. Son polissage est facile et permet l’obtention d’une surface très lisse. Malgré sa relative tenacité et la difficulté de contrôler la forme des éclats, sa taille est possible grâce à une fracture qui tend à être conchoidale. Cette variété est particulièrement
présente dans les rivières (galets) et a été privilégiée pour la fabrication des lames polies.
− Itabirite: formée par des feuillets d’hématite compacte pris au milieu de la quartzite.
Fabrication de lames de hache
Les lames préhistoriques ont généralement entre 6 à 11 cm de long (les plus grandes de notre collection atteignent 15 cm, mais on en connait de plus longues); elles ont en moyenne entre 4 et 5,5 cm de large (les plus grande atteignent 7 cm) et 2 à 3 cm d’épaisseur. Le tranchant porte souvent des marques de taille sous le polissage incomplet, alors que le talon a parfois été piqueté. Quand elles ont été faites à partir de galets de forme régulière, la
NON-FLINT RAW MATERIAL USE IN PREHISTORY / L’UTILISATION PRÉHISTORIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES ALTERNATIVES
138
Fig. 14.7. Taille experiméntale de l’hématite
Fig. 14.8. Face interne d’un eclat de façonnage
surface originale est parfois maintenue, surtout dans la partie mésiale. Les préformes dont nous disposons suggèrent que la taille bifaciale (marginale ou envahissante) était fréquente et l’on a trouvé dans les sites les plus anciens de véritables bifaces, dont le polissage se limite à un petit tranchant arrondi. Le piquetage intense provoque souvent des fractures. La forme finale des lames est rarement régulière, car leurs auteurs ont généralement dédaigné l’aspect esthétique. Notons que cette aspect est en revanche privilégié lors de la fabrication des haches en roche verte (diabase, gabro, amphibolites).
Les pièces expérimentales manufacturées par deux des auteurs (AP – taille et HP – polissage) ont montré la tenacité de la variété compacte, qui demande des coups répétés pour que les éclats se détachent. Les éclats sont généralement larges et courts et ne présentent ni bulbe, ni onde, ni lancette, et se terminent souvent en marches d’escalier (step).
Il existe cependant des exceptions et certains éclats de dimensions modestes présentent des stigmates très exagérés par rapport à ceux des roches fragiles “normales” (quartz, silex, obsidienne). On note parfois une lèvre sur la face interne, juste au-dessous du talon, semblable à celles qui sont souvent interprétées comme le résultat d’une taille au percuteur tendre.
Nous avons tenté tout d’abord un façonnage appuyé sur enclume, en inclinant les pièces, comme nous l’avions fait avec succès pour reproduire des lames en quartzite amazonienne (Prous 2004). Mais, avec l’hématite, la plupart de ces tentatives ne permirent de retirer que des éclats marginaux, ou aboutirent à des fractures. Nous avons donc préparé les quatre préformes par percussion à main libre, utilisant des percuteurs de roche verte et d’hématite. La taille de la variété poreuse s’est révélée incontrôlable. Le polissage s’est révélé beaucoup plus
rapide que nous l’espérions, permettant de retirer em moyenne 2 g. de matière toutes les 10 minutes, sur un polissoir de grès. Selon leur dimension, les tranchants des quatre haches ont ainsi demandé entre 30 et 50 minutes de polissage. Il s’agit d’une performance bien meilleure que celle que nous avions obtenue avec des roches vertes basiques (gabro ou diabase), ce qui pourrait expliquer le succès de l’hématite. Nous n’avons pas encore eu le temps de polir des haches de forme régulière, ni de tester l’efficacité et la durabilité des tranchants d’hématite par rapport a celles des roches vertes (Prous et al. 2004) (Tableau 14.3).
Obtention d’éclats coupants
On a trouvé, dans les sites Capão Xavier et Ponte de Pedra, des feuillets en forme de parallélopipède et à bord coupant brut et dos naturel. Il ne semble pas s’agir de fragments détachés spontanément du plafond ou de la paroi, car ils sont les seuls éléments ferreux de grande taille dans le sédiment pulvérulent des couches dans lesquelles ils se trouvent et on n’en retouve pas au milieu des blocs massifs qui abondent hors du principal niveau archéologique. On pense donc qu’ils auraient été détachés volontairement pour servir de couteaux.
Il est facile d’obtenir ces lames, comme nous avons pu le vérifier, soit en profitant des blocs tombés, soit en provoquant la chute des plaquettes qui forment le plafond de la plupart des grottes formées dans l’hématite. Les plaquettes sont percutées latéralement et se défont en feuillets immédiatement utilisables. Les tranchants naturels sont légèrement micro-denticulés et les pointes de ces denticules se cassent rapidement en cours d’utilisation. Nous avons vérifié que les tranchants permettent de couper de la viande, des cordons végétaux ou de baguettes de bois peu épaisses, mais se polissent très vite, perdant leur acuité
A. PROUS ET AL.: MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
139
Tab. 14.3. Variété; poids initial, après taille et/ou piquetage; temps et perte de poids polissage
HACHE 1: hématite compacte; poids initial 652g; polissage direct du tranchant 55', perte 10,8g. HACHE 2: hématite poreuse: polissage 30', perte 6,2g. HACHE 3: hématite compacte; poids initial 782g; après taille: 610,1g; polissage 50', perte 9,8g.
Fig. 14.9. Préforme experiméntale de lame polie en hématite
Blocs travaillés
Les fouilles dans les grottes ferrugineuses ont permi de trouver des objets cassés très massifs; certains paraissent être des préformes de très grandes haches mais pourraient tout aussi bien correspondre à des outils retouchés. C’est le cas d’un objet plan-convexe qui ressemble à un macro-racloir, dont la fabrication aurait été abandonnée en raison d’un angle trop obtus qui empêcha de terminer le tranchant entre les deux parties déjà retouchées. Un galet présente à une extrémité un piquetage d’utilisation comme percuteur, tandis qu’une enclume sur itabirite présente de nombreuses marques de percussion sur une de ses faces planes. Certaines de ces marques ont formé une dépression (cupule piquetée) qui à pu être utilisée pour casser des noix de palmes. Les autres marques, de forme circulaire et profonde, ou virgulées, sont plus étalées et ne forment pas de dépression. Nous les interprétons comme les traces d’un débitage sur enclume des éclats de quartz (ceux-ci sont nombreux tout au long de l’occupation de ces grottes et leur grande majorité porte les marques typiques d’un débitage de cette sorte.
En conclusion, on peut dire que l’hématite a été peu utilisée sous forme brute ou taillée hors de la zone de production. Son poids, sa relative fragilité au choc et la faible dureté de ses tranchants ne lui permettait pas de concourrir avec les matières disponibles hors du quadrilataire du fer. Les lames polies, par contre, furent amplement exportées vers le nord (Lagoa Santa, Cipó) jusqu’à près d’une centaine de kilomètres. Des trouvailles isolées montrent que quelques outils ont voyagé loin vers
le sud-est (vallé du Rio Doce) et nous avons observé la présence d’une hache provenant probablement du centre de Minas Gerais dans le site de Justino, sur le bas Rio São Francisco, a plus de 1.400 km en ligne droite de la région d’origine. Cette pièce a pu voyager par voie fluviale, car le Rio das Velhas qui prend sa source près des gisements est un affluent du Rio São Francisco.
L’exploitation du fer dans la Serra de Carajás (état du Pará, en Amazonie) a permis de localiser des grottes ouvertes sous des concrétions ferrugineuses; quelques éclats en hématite ont été localisés lors de travaux archéologiques récents et sont exposés au Museu Goeldi, à Belém. Il est donc possible que d’autres industries sur hématite soient prochainement reconnues dans le nord du Brésil.
LE TRAVAIL DE L’AGATE – SANTA CATARINA ET MATO GROSSO (MA, HP, APESSOA; MCM)
Le débitage d’éclats plats
L’agate ou la calcédoine sont abondantes dans l’extrême sud du Brésil (états du Parana et Santa Catarina). L’agate a été utilisée occasionnellement dès les périodes anciennes, fournissant la presque totalité des outils taillés dans certains sites tardifs (Tupiguarani) du littoral de Santa Catarina. Chez ces derniers, on note l’extraction systématique sur enclume d’éclats minces, très plats et allongés. Pour obtenir cette forme, les tailleurs ont placé les blocs à débiter dans le sens des fibres. À l’exception d’un perçoir, ces pièces ont été utilisées brutes de débitage (Prous, Alonso et al., no prelo). Une couleur rouge envahissante, fréquente dans la collection étudiée, suggère qu’il pourrait y avoir eu préparation thermique pour faciliter le débitage. Nos premières tentatives de chauffe en four industriel ont montré un début de changement dans l’aspect de la matière à partir de 300 degrés. À 400 degrés, les blocs commencent à se fendre. Nos expériences de débitage ont montré qu’il s’agit d’une matière extrêmement tenace et que seul le travail sur enclume permet de prévoir avec un certain succès la forme des éclats (Prous 2004).
La fabrication d’éléments de collier
Dans le Pantanal du Mato Grosso, un des auteurs (MCM) a localisé des ateliers de fabrication de perles et de pendentifs en agathe, percés avec des mèches fabriquées dans la même roche, mais aussi en silex (Migliacio 2006). Ces structures remontent au dernier millénaire avant
NON-FLINT RAW MATERIAL USE IN PREHISTORY / L’UTILISATION PRÉHISTORIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES ALTERNATIVES
140
Fig. 14.10. Débitage préhistorique sur enclume de l’agate
l’arrivée des Européens et n’ont été reconnues que dans deux des sites de cette époque, probablement spécialisés dans la fabrication des ornements.
On n’a pu déterminer si leur couleur, généralement rouge, était naturelle (cornaline) ou conséquente à une chauffe, accidentelle ou contrôlée, dont les marques se voient également sur les pièces de silex.
Les éléments de collier sont de petits éléments de forme variée: la plupart sont cordiformes ou discoidaux, mesurant entre 4 et 14 mm, avec une épaisseur de 1 à 10 mm, mais on trouve aussi des pendentifs de plus grandes dimensions.
Les préformes sont ce que nous appelons des pièces nucléiformes, c’est-à dire des blocs taillés sur enclume (Prous et Lima 1991; Prous 2004). Ce façonnage permet d’obtenir diverses morphologies (principalement bicôni-que et prismatique) semblables à celles des pièces es-quillées classiques. Les artisans extrayaient probablement de grands éclats (d’au-moins 6 cm, dimension des plus
grandes pièces taillées retrouvées lors des fouilles) par taille directe à main libre. On a en effet retrouvé un labret de 17 cm montrant l’existence de grands blocs de matière première. Ils étaient réduits ensuite sur enclume jusqu’à ce que les pièces nucléiformes (dont les plus grandes font encore 6 cm) ne mesurent pas plus de 2 cm. Elles étaient ensuites polies et perforées. On a retrouvé les préformes et des centaines de mèches de foret dans les ateliers de taille, alors que les pendentifs sont principalement retrouvés dans les sépultures. Les mèches sont nombreuses (plus de 200 ont été recueillies em deux points de collecte du seul site Descalvados 1); mesurant entre 1,3 e 1,7 cm, ce sont des éclats allongés obtenus sur enclume et sélectionnés pour leur section triangulaire ou quadrangulaire de 3 a 4 cm de large. À la différence des mèches en silex, les pièces d’agate ne sont pas retouchées. Leur pointe présente un émoussé visible à l’oeil nu, mais les esquillements latéraux sont épars et très rares.
Nous avons reproduit quelques pièces, pour vérifier le temps nécessaire au polissage et à la perforation des perles. A notre surprise, le polissage (à la main et sous le
A. PROUS ET AL.: MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
141
Fig. 14.11. & 14.12. Perçoirs d’agate
Fig. 14.13. Micro-vestige d’utilisation sur un perçoir d’agate préhistorique
Fig. 14.14. Racloirs sur les plaquettes de quartzite
pied) s’est montré assez rapide; nous avons utilisé, au départ, un polissoir fixe en grès de grain moyen, avec du sable fin et de l’eau. Le polissage a été terminé dur un polissoir mobile à grain fin. Nous avons ainsi retiré en moyenne 1g de matière par heure de travail.
Nos tentatives de perforer des éclats en agate (avec une matière de provenance différente de celle des pièces étudiées) ont échouées jusqu’à présent. Nos mèches (également d’agate), maniées à la main ou emmanchées, glissent sur la surface. Nous avons essayé en vain de pratiquer avec un éclat coupant des rainures perpendiculaires sur la perle pour immobiliser la pointe foreuse. Le seul moyen de fixer la partie active fut de creuser une petite dépression par piquetage, mais on n’observe aucun indice de l’utilisation d’une telle technique sur les pièces préhistoriques.
LA TAILLE DES QUARTZITES
Hors de la zone littorale, dans presque tout le Brésil méridional (états de São Paulo, Santa Catarina, Paraná et
São Paulo), ce sont des quartzites qui ont servi de matière première préférentielle pour la taille. Il s’agit d’une va-riété, localement nommée “grès silicifié”, métamorphisée entre des coulées de laves.
Cette matière ne se prête pas au débitage de lames (il n’y a d’ailleurs pas d’industries laminaires au Brésil), mais elle permet de façonner facilement des pièces bifaciales. De fait, on trouve des bifaces épais en basalte et en quartzite dans les industries anciennes de l’extrême sud du pays (industries Humaita et Altoparanaense). Un peu plus au nord, les préhistoriques ont surtout produit des éclats simples, bien qu’on trouve épisodiquenent des racloirs, des grattoirs, voire des pointes de projectile bifaciales.
En Amazonie, les roches aptes à la taille ou au polissage sont rares, et les grès silicifiés/quartzites du moyen Amazone, disponibles lors des basses eaux près de Manaus, semblent avoir été exploités intensivement. Là encore, ce sont surtout des éclats simples qui ont été recherchés, mais nous avons identifié également des
NON-FLINT RAW MATERIAL USE IN PREHISTORY / L’UTILISATION PRÉHISTORIQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES LITHIQUES ALTERNATIVES
142
a
b
Fig. 14.15. a & b. Pièce plan-convexe en quartzite
bifaces façonnés appuyés sur enclume, qui nous semblent être des préformes de lames polies.
Dans le Brésil central, les plaquettes de quartzite on été retouchées en racloir (état de Minas Gerais) alors que des outils plan-convexes étaient façonnés à partir de blocs ou de galets. Deux techniques ont été utilisées pour les produire: dans un cas, de grands éclats épais furent détachés, puis retouchés latéralement pour l’obtention de limaces sur éclats épais. Dans les régions riches en galets (Buritizeiro, Goias), des galet aplatis ont été unifaciale-ment retouchés. La face “plane” de l’outil, en fait légère-ment convexe, était alors formée par le cortex et non par une surface de débitage. Dans la vallée du Rio Peruaçu, ces outils robustes étaient souvent faits en quartzite plutôt qu’en silex. L’analyse des micro-traces d’utilisation a montré qu’il étaient destinés à travailler le bois.
CONCLUSIÓN
Dans une bonne partie du Brésil, les quartz et les quartzites de type très variés, voire les agates, ont été les matières les plus utilisées pour obtenir par taille des tranchants aigus; occasionnellement, même l’hématite et l’améthiste ont été taillées. Toutes ces matières se comportent différemment du silex ou de l’obsidienne, qui ont souvent été privilégiés par les travaux de technologie “classiques”.
Il en va de même pour les outils polis. Quand il s’agissait de fabriquer des lames de hache, les roches vertes (basaltes, diabases, diorites, amphibolites) ont été large-ment privilégiées dans l’ensemble du territoire brésilien. Elles étaient grossièrement taillées, avec un talon généra-lement piqueté et un tranchant poli, beaucoup plus tenace que celui de pièces en silex. Localement, dans l’État du Minas Gerais, l’hématite compacte et la sillimanite (ou fibrolite, à laquelle sa structure fibreuse assure une grande ténacité) ont concurrencé les roches basiques. De nombreux ornements, des mains de pilon, des sculptures, ont également été fabriqués dans ces roches riches en olivine, alors que les roches fragiles ne furent qu’excepti-onnellement traitées par piquetage ou polissage.
Remerciements
Nous remercions les géologues Joël Quémeneur pour ses observations sur l’utilisation du sens des fibres dans les débitages d’agate et Gilberto Costa pour ses informations sur les minerais de fer. Nous exprimons notre gratitude pour l’archéologue Rodrigo Lavina, qui nous a permis d’étudier le matériel provenant de ses fouilles dans les sites tupiguarani de Santa Catarina. Notre reconnaissance va aux habitants des villages de San Juan et Cuiaba, près de Diamantina, pour leur gentillesse et leur intérêt à nous montrer leur savoir-faire.
A. PROUS ET AL.: MATIÈRES PREMIÈRES “ALTERNATIVES” DANS LE BRÉSIL CENTRAL: QUARTZ, QUARTZITE, AGATE ET HÉMATITE
143
Références
Hématite:
BAETA, A.; PILO, H. (2005) – Arqueologia do Quadrilatero ferrifero. O Carste. Belo Horizonte. 17, 3, p. 116-131.
PILO, H.; BAETA, A. (2005) – Relatório do programas de Salvamento – Sítio Arqueológico Ponte de Pedra, Mina do Pico, MBR. Belo Horizonte.
PROUS, A. (et al.) (2002) – Os machados pré-históricos no Brasil – descrição de coleções brasileiras e trabalhos experimentais: fabricação de lâminas, cabos, encabamento e utilização. Canindé. UFSE. 2, p. 161- 236.
Agate:
LAVINA, R. (2000) – Salvamento da ZPE Imbituba SC / Relatório final do Projeto de Salvamento da rodovia Inter-praias CD Rom.
MIGLIACIO, M.C. 2006 – O doméstico e o ritual: cotidiano Xaray no alto Paraguai até o século XVI . São Paulo, Thèse.
PROUS, A. (2004) – Apuntes para análisis de indústrias líticas. Ortegalia. Fundación Federico Maiñeira. 172 p.
Quartz:
PROUS, A.; ISNARDIS, A. (sous presse) – Les technologies lithiques des populations préhistoriques du Brésil central e septentrional. Karapa, Cayenne.
PROUS, A.; LIMA, M. (1986/90) – A tecnologia de debitagem do quartzo no centro de Minas Gerais. Arquivos do Museu de História Natural UFMG. Belo Horizonte, 11, p. 91-114.
PROUS, A. (sous presse) As indústrias liticas dos cera-mistas Tupiguarani. In: Os ceramistas Tupiguarani, Chapecó, CEOM. vol. 3.
PROUS, A. (et al.) (sous presse) – La place et les caractéristiques du débitage sur enclume (“bipolaire”) dans les industries brésiliennes. Palaeo. (Actes du Colloque Entre le Marteau et l’Enclume, Toulouse 2004).
PROUS, A. (et al.) (2002) – Os machados pré-históricos no Brasil. Descrição de coleções brasileiras e trabalhos experimentais: fabricação de lâminas, cabos, encabamento e utilização. Canindé, Xingó. 2, p. 161-236.
VIALOU, A. VILHENA (1980) – Tecno-tipologia das indústrias líticas do sítio Almeida.Museu Paulista, São Paulo. 170 p.
Quartzites et généralités
COSTA, F. (2002) – Análise das indústrias líticas da área de confluência dos rios Negro e Solimões, Mémoire de Maîtrise.
MANSUR-FRANCHOMME, M.E. (1986) Microscopie du matériel lithiques préhistorique. Bordeaux. Cahiers du Quaternaire, 9.
PROUS, A.; MOURA, M.T.; ALONSO, M. (1991) – Indústia lítica de Santana do Riacho- tecnologia, tipologia e traceologia. Arquivos do Museu de História Natural. UFMG, Belo Horizonte. 12, p. 187- 285.
PROUS, A.; ISNARDIS, A. (sous presse) – Les techno-logies lithiques des populations préhistoriques du Brésil central e septentrional. Karapa, Cayenne.