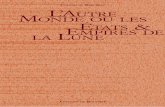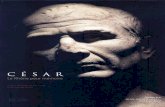LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L´UE ET LE BRÉSIL EN MATIÈRE DE BIOCARBURANTS: LES ENJEUX DES...
-
Upload
univ-nantes -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L´UE ET LE BRÉSIL EN MATIÈRE DE BIOCARBURANTS: LES ENJEUX DES...
UNIVERSITE DE NANTES
FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
Les relations commerciales entre l’UE et le Brésil en matière de biocarburants :
Les enjeux des critères de durabilité face à l’OMC
MÉMOIRE PRÉSENTÉ POUR L’OBTENTION DU MASTER 2 EN DROIT ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE
PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR Elaise MOREIRA LANDIM
SOUS LA DIRECTION DE
Professeur Mme Mary SANCY
JURY COMPOSÉ DE Professeur Mme Mary SANCY
Professeur M Joël BOUDANT
Chaire Jean MONNET
JUIN - 2012
RÉSUMÉ
LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE L´UE ET LE BRÉSIL EN MATIÈRE
DE BIOCARBURANTS: LES ENJEUX DES CRITÈRES DE DURABILITÉ FACE À
L´OMC
L´Union Européenne a mis en place des politiques publiques dans le but d´inciter le
recours à des sources renouvelables d´énergies et a fixé comme objectif d´ici 2020
d´accroître la part des sources renouvelables de 20% par rapport à la consommation
totale en énergie. Ainsi, la demande de biocarburants a augmenté, ce qui est une
conséquence de la volonté d´atteindre l´objeticf fixé. À son tour, le Brésil apparaît
comme le principal producteur et exportateur de biocombustibles, surtout l´éthanol.
Néanmoins, l´Union Européenne envisage restreindre le libre commerce de
biocombustibles avec le Brésil en se fondant sur des éventuels impacts négatifs –
environnementaux, agroalimentaires et sociaux - que cette production pourrait
engendrer. De ce fait, l´UE impose des critères de durabilités qui devront être respectés
a fin que l´entrée des biocombustibles dans le territoire communautaire soit autorisée.
Pour cette raison, ce travail a pour but d´analiser dans quelle mseure les restrictions
imposées par les pays européens en ce qui concerne l´achat de biocarburants brésiliens
sont susceptibles de violer les règles de commerce international institués par
l´Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L´objectif de cet étude est ainsi
d´analiser si de telles restrictions peuvent se traduire en un protectionnisme comercial
deguisé en lute environnementale ou, au contraire, s´il s´agit des restrictions légitimées
par le système conçu par l´OMC ele-même, lequel, dans des cas exceptionnels, permet
la dérogation de ses propres normes au profit des príncipes plus importants que les
intérêts purement commerciaux.
Mots-clés: Union Europénne. Brésil. Biocarburants. Éthanol. Critères de durabilité.
Libre commerce. Organisation Mondiale du Commerce.
RESUMO
AS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE UNIÃO EUROPEIA E BRASIL EM
MATÉRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS: A QUESTÃO DOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE FACE À OMC
A União Europeia instituiu políticas públicas visando fomentar a utilização de energias
renováveis, e fixou como objetivo para 2020 que pelo menos 20% da matriz energética
seja derivada de fontes renováveis. Assim, aumentou a demanda por biocombustível, a
fim de atingir a meta fixada. Por sua vez, o Brasil desponta como grande produtor e
exportador de biocombustíveis, sobretudo o etanol. Entretanto, a União Europeia cogita
restringir o livre comércio de biocombustíveis com o Brasil alegando eventuais
impactos negativos - de ordem ambiental, agroalimentar e social – que a produção de
biocombustíveis, como o etanol, pode engendrar. A UE impõe, dessa forma, critérios de
sustentabilidade que deverão ser preenchidos pelos biocombustíveis para que sua
entrada no território comunitário seja autorizada. Diante disso, o presente trabalho se
propõe a analisar em que medida as restrições impostas pelos países europeus quanto à
aquisição de biocombustíveis brasileiros são suscetíveis de contrariar as regras de
comércio internacional preconizadas pela Organização Mundial de Comércio. O
objetivo do estudo é analisar se tais restrições traduzem-se em protecionismo disfarçado
de proteção ambiental ou, a contrário, se se trata de restrições justas, legitimadas pelo
sistema derrogatório previsto pela própria OMC, que excepcionalmente permite a
derrogação de suas normas em prol de princípios mais relevantes que os interesses
meramente comerciais.
Palavras-chave: União Europeia. Brasil. Biocombustíveis. Etanol. Critérios de
sustentabilidade. Livre comércio. Organização Mundial do Comércio.
SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................... 01
SECTION A) La biomasse: une alternative appropriée aux combustibles fossiles ...... 01
SECTION B) Des différentes réactions aux critiques émises aux biocarburants .......... 05
PARTIE I) UNE OPPOSITION DE POINTS DE VUE EXPLIQUÉE PAR DES CONTEXTES ET INTÉRÊTS DIVERGENTS ......................................................... 11
CHAPITRE I) Une politique intégrée en matière de climat et d’énergie ...................... 11
CHAPITRE II) Un lobby orchestré par le Brésil en vue d’éliminer les barrières commerciales contre les biocarburants ............................................................................. 33
PARTIE II) LES ARGUMENTS ÉVOQUÉS PAR L’UE ET LE BRÉSIL À LA LUMIÈRE DE L’OMC ................................................................................................. 55
CHAPITRE I) Un discours officiel de recherche d’équilibre entre la protection environnementale et les intérêts commerciaux. ................................................................ 55
CHAPITRE II) Une analyse juridique des enjeux évoqués .......................................... 65
SECTION A) L´encadrement par l´OMC de l´impact des subsides sur le libre jeu de la concurrence ....................................................................................................................... 65
SECTION B) La mise en compatibilité des critères de durabilité ................................... 68
CONCLUSION ............................................................................................................. 79
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 86
1
INTRODUCTION
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA, en anglais), la croissance
économique alliée, à l’augmentation de la population mondiale conduira à une demande
croissante d’énergie, d’environ 1,8% par an entre 2005 et 20301. Cette énergie provenant
essentiellement de sources pétrolières, épuisables, de plus en plus chères, et surtout
polluantes, divers pays au monde ont été motivés pour rechercher des sources
renouvelables et alternatives, parmi lesquelles la biomasse.
Dans une première section de cette introduction, nous discuterons quels sont les
avantages qui font de la biomasse une alternative pertinente aux combustibles fossiles.
Dans une deuxième section, nous verrons que, malgré ses bénéfices, cette source d’énergie
est objet d’un certain nombre de critiques féroces. Nous aborderons donc de quelle façon
l’Union Européenne et le Brésil ont réagi à ces critiques, et ensuite nous annoncerons les
problématiques et le plan du travail.
SECTION A) LA BIOMASSE : UNE ALTERNATIVE APPROPRIEE AUX COMBUSTIBLES
FOSSILES
La technique d’utilisation de la biomasse pour la production énergétique,
notamment de carburant pour le secteur du transport, est maitrisée depuis longtemps.
Cependant, ce n’est qu’avec les préoccupations croissantes liées au réchauffement
climatique de la planète que les biocarburants se sont présentés comme une alternative
viable aux combustibles fossiles, tout en représentant également une réponse pertinente
aux défis énergétiques, environnementaux et économiques.
L’importance stratégique acquise par ces produits a contribué à l’émergence d’un
marché de biocarburants d’échelle mondiale, qui ne cesse de croître. D’un côté, certains
pays en développement présentent un fort potentiel de production, à des prix
comparativement bas, et d’un autre, les importations sont devenues une voie intéressante
pour plusieurs pays développés, qui n’ont pas de surfaces de terres suffisantes pour
1 International Agency of Energy (IEA), World Energy Outlook 2007. Disponible à: www.iea.org/textebase/npsum/WEO2007SUM.pdf
2
subvenir à leur besoin. Une partie non négligeable des échanges commerciaux dans ce
marché sont réalisés entre l’Union européenne (UE), important marché consommateur, et
le Brésil, un des principaux producteurs de biocarburants et le premier exportateur
mondial.
Les biocarburants sont issus des matières végétales, la biomasse. Pour leur
croissance et leurs besoins en énergie, ils utilisent le gaz carbonique présent dans
l’atmosphère, grâce au processus de la photosynthèse2. Ainsi, à la différence des énergies
fossiles telles que le pétrole, le gaz naturel et le charbon qui sont en cours d’épuisement, la
biomasse est une source renouvelable.
Les biocarburants sont habituellement sous-divisés selon deux générations. Les
biocarburants dits de première génération comportent deux filières : le biodiesel, utilisé en
mélange dans le gazole des moteurs Diesel, fabriqué à partir d’huiles végétales (colza,
tournesol, soja, palme) et l’éthanol, issu de la fermentation des sucres contenus dans les
plantes sucrières (betterave, canne à sucre) et dans les céréales (blé, maïs, orge). Il peut
être employé directement ou en mélange dans les essences.
La biomasse de deuxième génération (ou lignocellulosique) est fabriquée à partir
des résidus d’origine agricole (pailles, tiges de maïs), résidus forestiers et sous-produits de
la transformation du bois3. Les filières de la 2e génération sont un fort potentiel
d’élargissement de l’éventail des matières carboniques transformables en biocarburants,
comme les déchets organiques des industries papetières et agroalimentaires. Cette
production présente l’avantage d’apporter une optimisation de l’utilisation de la biomasse.
Actuellement, seuls les biocarburants de première génération sont viables
économiquement, dans la mesure où leur technique de fabrication peut être exploitée à un
coût abordable. En revanche, ceux de 2e génération nécessitent davantage de recherches
technologiques pour que leurs procédés de production soient opérationnels à l’échelle
industrielle.
2 BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011, p. 1.
3 Ibid., , p. 1-2
3
De ce fait, puisque les biocarburants de deuxième génération n’ont pas de
représentativité dans les échanges commerciaux entre l’UE et le Brésil, ils ne seront pas
concernés par cette recherche. Parmi les biocarburants de première génération, le
bioéthanol sera davantage mis en évidence plutôt que le biodiesel, car les échanges
concernant ce premier sont plus importants en volume et chiffres d’affaires.
L’intérêt accru au cours des dernières années du remplacement de carburants
fossiles par les sources d’énergie renouvelable s’explique tout d’abord par les craintes
relatives au réchauffement climatique de la planète, causé en partie par les émissions de
gaz à effet de serre (GES) issues de la combustion des dérivés du pétrole4, notamment dans
le secteur du transport.
En effet, le secteur du transport est fortement dépendant des combustibles fossiles.
À l’échelle mondiale, les carburants issus du pétrole constituent 98% de l’énergie utilisée
dans le secteur5. Cette dépendance a un coût très élevé pour l’environnement. En 2001, le
secteur a été le principal responsable pour les émissions de GES et des estimatives
prévoient que les émissions annuelles seront multipliées par deux au cours des 30
prochaines années6.
C’est durant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui a
eu lieu à Rio en 1992, que l’attention de la communauté internationale a été alertée sur les
menaces issues du réchauffement climatique. Ainsi, la convention-cadre (constituée lors de
la conférence) s’est fixé des objectifs visant à stabiliser les concentrations de GES à un
niveau sûr pour le système climatique.
En 1997, le Protocole de Kyoto vient renforcer cette volonté. Un plan ambitieux de
réduction d’émissions de GES jusqu’en 2012 est mis en place. Les pays signataires se sont
4 Environ 50% du rayonnement solaire sont absorbés par le sol qui réémet de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouges. Ceux-ci sont interceptés en partie par des gaz naturellement présents à faible concentration dans l’atmosphère (vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O). De ce fait, la couche atmosphérique retient la chaleur en jouant le même rôle que les parois d’une serre. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne de la terre serait de – 18°C. BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011, p. 11.
5 Ibid., p. 11.
6 BENANADJI Fadéla, Biocarburants, questions – réponses, E-T-A-I, 2006, p. 9
4
engagés à parvenir à une réduction annuelle moyenne de 5% par rapport aux valeurs de
1992.
Parallèlement à ce défi d’ordre climatique, une autre préoccupation aussi pertinente
explique le recours aux biocarburants. Il s’agit du caractère épuisable des combustibles
d’origine pétrolière. Bien qu’il n’ait pas d’estimation précise sur la durée où ces sources
pourront encore être exploitées avant leur épuisement total, il est indéniable qu’elles ne
seront pas éternelles.
Cette perspective, alliée aux instabilités politiques des principaux marchés
fournisseurs, a comme conséquence double la montée des prix et la crainte par rapport à
une crise d’approvisionnement. Cela a été d’autant plus vrai après les chocs pétroliers
successifs qui ont eu lieu durant les années 70. Par conséquent, un autre facteur vient
s’ajouter aux premiers (la question climatique et l’épuisement éventuel du pétrole), celui
économique. Les pays se sont aperçus qu’il fallait s’affranchir de la dépendance
économique de l’exportation du pétrole, étant donné que sa production est concentrée
majoritairement sur un petit groupe de pays.
Pour ces deux raisons essentielles, divers pays se sont mis à rechercher des
solutions alternatives au pétrole. Les biocarburants se sont présentés comme une voie
pertinente, même si pas unique. En effet, la biomasse est réputée pour avoir un des
meilleurs rapports coût/efficacité à moyen terme parmi les options de source énergétiques
renouvelables7. Le Brésil et l’Union Européenne, faisant partie des pays concernés par ces
recherches, ont développé une politique propre à chacun, afin d’encourager à la production
de biocarburants.
Les biocarburants offrent des perspectives réelles en faveur de la lutte contre le
réchauffement climatique. Leur substitution aux combustibles fossiles permet un
abaissement important des niveaux d’émissions de GES. Il y a une sorte de compensation
carbonique, car le CO2 prélevé de l’atmosphère par la photosynthèse lors de la production
7 BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011, p. 18.
5
des matières premières compense les émissions futures lors de la combustion dans les
moteurs.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que certains pays se soient lancés dans des
programmes de promotion des biocarburants, en mettant en place soit des niveaux
contraignants de mélange avec l’essence (cas du Brésil), soit en établissant des objectifs
chiffrés pour leur utilisation, encouragés par le biais d’incitations fiscales ou aides
économiques (le choix européen).
Néanmoins, cette euphorie initiale a été frappée par de violentes critiques au cours
des années 2000, concernant certains désavantages liés à la production de biocarburants
qui pourraient, en dernière instance, ternir les bénéfices envisagés. La manière dont l’UE et
le Brésil réagissent à ces critiques sera totalement distincte, ce qui s’explique par leurs
intérêts opposés dans le domaine.
SECTION B) DES DIFFÉRENTES RÉACTIONS AUX CRITIQUES ÉMISES AUX
BIOCARBURANTS
Plusieurs études ont été menées dans le but d’évaluer d’éventuels impacts négatifs
de la production de biocarburants. Le principal objet de ces critiques repose sans doute sur
la crainte que les terres utilisées pour la production de biocarburants puissent entrer en
concurrence avec les surfaces dédiées à des fins alimentaires, entrainant ainsi une
augmentation des prix des aliments. Ces conclusions s’appuient sur un raisonnement tout à
fait logique, selon lequel la disponibilité des terres cultivables tend à diminuer dans la
mesure où la population mondiale s’accroît. Dans ce scénario, les biocombustibles de
première génération auraient un effet beaucoup plus néfaste que ceux de la deuxième
génération.
Lors de la crise économique de 2007/2008, les prix du marché mondial des aliments
ont connu une hausse importante, parallèlement au fait que la production de biocarburants
atteignait des niveaux record à l’échelle mondiale, situation qui a servi de renforcement
empirique à ces études.
La préoccupation relative à la concurrence avec le marché d’aliments n’est
cependant pas le seul sujet desdites critiques. Les possibles menaces sur la biodiversité
6
sont aussi également mises en évidence. En réalité, les matières premières pour la
production d’éthanol ou biodiesel sont cultivées dans un régime de monoculture intensive,
aboutissant à un appauvrissement du sol. Les risques de déforestation et destruction des
végétations natives afin de mettre en place de telles cultures sont aussi au cœur des
critiques.
De plus, la déforestation, la dégradation de végétations natives, le changement de
l'usage des sols et l'utilisation de fertilisants peuvent, au-delà des menaces à la biodiversité,
sont susceptibles d’occasionner des dégagements élevés de CO2 provenant des sols. Il faut
empêcher le risque d’avoir un bilan carbonique négatif; c’est-à-dire, quand les émissions
de CO2 évitées par rapport à l’utilisation des carburants fossiles sont inférieures aux
émissions dépensées pour produire le biocarburant (plantation, transformation de la
matière première et transport).
Cela crée une situation paradoxale : une solution envisagée initialement pour faire
face à un souci d’ordre environnemental, à savoir, le réchauffement climatique, se voit
accusée d’entrainer des risques non négligeables justement sur l’environnement.
Ces critiques féroces ont fortement influencé la manière dont certains pays se sont
saisis du problème. Elles ont eu un impact particulièrement important dans l’Union
Européenne, qui a opéré un changement sérieux d’orientation dans sa politique de
promotion de biocarburants, afin de prendre en compte ces éléments de critique. La
solution envisagée a été de contrebalancer les effets négatifs avec des mesures assurant la
durabilité de la production de biocarburants. Cela veut dire que l’encouragement à la
production est désormais limité par des précautions visant à la suppression de tout risque
lié à l’environnement.
À l’inverse, le Brésil n’a pas tenu compte de ces critiques pour freiner sa politique
de promotion, surtout à l’égard de l’éthanol. D’un côté, même si non officiellement, les
autorités brésiliennes font valoir que telles critiques relèvent d’un protectionnisme masqué
de la part des pays riches en faveur de leur production nationale de biocarburants, de
l’autre côté, le pays s’efforce de démontrer que ses biocombustibles sont fabriqués dans le
respect de l’environnement et du développement durable.
7
Ces évènements ont abouti sur une situation de tension entre ces deux partenaires
commerciaux : l’UE, soucieuse des risques environnementaux qui pourraient être causés
par la production de biocarburants, se définit un juste milieu, consistant à imposer des
objectifs contraignants pour l’incorporation des biocarburants dans le secteur de transport,
tout un mettant en place un système de contrôle basé sur des critères de durabilité. Ces
critères devront être respectés par tous les biocarburants circulant dans son territoire,
indépendamment de leur origine. En plus, afin d’encourager les producteurs locaux à
atteindre les objectifs contraignants, l’UE prévoit des aides financières. Ce dispositif a été
réalisé par le biais de la directive 2009/28/CE.
De leur côté, les exportateurs brésiliens, qui se battent depuis longtemps contre les
barrières tarifaires élevées imposées aux biocarburants, se voient confrontés à ces
nouvelles formes d’entraves à l’accès au marché européen : les règles relatives aux critères
de durabilité, ainsi que la possibilité d’octroi d’aides financières.
Cette tension, quoique contournée jusqu’à présent par la voie diplomatique, nous
amène à nous interroger sur l’éventuelle compatibilité de ladite directive européenne à
l’égard des règles qui régissent le commerce internationale, telles qu’établies par
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).
L’OMC est fondée sur le principe du libre-échange et ne permet de déroger à ce
principe, sauf dans certains cas exceptionnels et particuliers, parmi lesquels se trouve le
respect des ressources naturelles, sous des conditions bien précises. La justification de ce
système dérogatoire repose sur le fait que la libéralisation du commerce peut faciliter la
circulation de produits pouvant endommager l’environnement, situation qui doit être
combattue.
La littérature spécialisée est loin d’être unanime lorsqu’il s’agit d’analyser la
question. Pour certains, il s’agit plutôt d’un protectionnisme vert déguisé, qui ne serait
pourtant pas conforme avec les règles de l’OMC. Pour d’autres, les critères de durabilité
imposés par la directive reposent sur des justifications légitimes en faveur de la
préservation de l’environnement.
8
L’objectif principal de ce travail consiste donc à dévoiler les politiques européenne
et brésilienne en matière de promotion de biocarburants, pour ensuite confronter les
intérêts de deux parties avec les normes de l’OMC. Le but ultime est d’essayer de montrer
quels seraient les arguments qui pourraient être évoqués par chacune des parties lors d’un
éventuel litige sur la question devant l’Organe de Règlement de Différends (ORD) de
l’OMC.
Finalement, en se basant sur l’état actuel de la jurisprudence de l’ORD, nous
tenterons de définir quelles solutions pourraient se présenter dans une telle perspective. Et
si, en dernière instance, il est possible d’envisager des solutions non contentieuses sur le
sujet, et lesquelles.
L'accomplissement de cet objectif doit surmonter un obstacle. L’OMC n’a pas un
régime spécifique sous lequel elle traite le sujet des biocarburants. Même en ce qui
concerne la classification de ces produits dans le Système Harmonisé, il n’y a aucune
uniformisation. Ce traitement flou rend l’exercice de la confrontation souhaitée plus
difficile, nous amenant ainsi à examiner la situation sous la lumière des règles et
exceptions générales de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
Ainsi, bien que d'autres accords au sein de l'OMC puissent être employés en tant
qu'outils pour trancher la question de la compatibilité de la politique européenne avec le
système OMC (tels que l'Accord sur l'Agriculture et l'Accord sur les barrières techniques
au commerce), ils ne seront pas vraiment pris en considération lors de cette analyse. Par
contre, nous aborderons l’éventuel impact restrictif des subventions autorisées par la
directive sur les échanges commerciaux, sans pour autant trancher à fond la question de
leur compatibilité avec le système OMC.
Au-delà des enjeux cités dans le paragraphe précédent, il y a plusieurs d’autres qui
entourent la question et qui méritaient d’être traités ou approfondis, mais qui ne le peuvent
pas dans ce modeste travail. Nous avons choisi d’examiner la question exclusivement sous
la lumière de l’OMC, parce qu’il s’agit d’une recherche dans le cadre du Droit
Économique International. Néanmoins, puisqu’il relève d’un sujet transversal, il est
débattu sous différentes approches, et également, au sein d’autres organisations
internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies.
9
Une analyse plus approfondie des études scientifiques évaluant les impacts négatifs
de la production des biocarburants, surtout quant aux émissions de GES lors du processus
de production des biocarburants et des impacts indirects sur le changement des sols, se
présente comme une importante clé pour trancher la question.
Le sujet est évoqué de manière plutôt disperse dans le texte, surtout lorsque l'on
explicite les efforts entrepris par le Brésil pour faire preuve de la durabilité de ses
biocarburants. Toutefois, encore en raison des ambitions modestes de ce travail, une
analyse plus détaillée de ces études ne sera notre objectif principal.
Afin de répondre aux objectifs généraux qui ont guidé cette recherche, nous
présenterons dans une première partie, les politiques européennes (chapitre 1) et
brésiliennes (chapitre 2) en matière de promotion de biocarburants. Quant à l'Europe, nous
aborderons la mise en place de sa politique énergétique communautaire, fortement intégrée
avec sa politique climatique. Plus précisément, nous traiterons du choix effectué au profit
des énergies renouvelables (y compris les biocarburants et la prise en compte des critiques
concernant leur durabilité, exprimée notamment dans la directive 2009/28/CE).
En ce qui concerne la politique brésilienne, nous nous interrogerons tout d'abord
sur les raisons qui ont amené le pays à avoir l’ambition d’être pionner dans le
développement des biocarburants et principal exportateur de biocarburants dans le monde,
et, par conséquent, être le grand promoteur des bénéfices de cette source énergétique.
Ensuite, nous démontrerons les efforts conjoints entrepris par les secteurs privés et publics
du pays, afin de garantir à ses partenaires commerciaux que la production nationale de
biocarburant répond positivement à toutes les contraintes en termes de durabilité.
Cette comparaison nous servira d’outil pour confronter, dans une deuxième partie,
la compatibilité des mesures européennes potentiellement restrictives au commerce vis-à-
vis le système OMC. Nous nous intéresserons, tout d’abord, à la manière dont l'OMC
essaie de rendre compatibles les règles du libre-échange avec les contraintes d'ordre
environnementales, tout en abordant le discours officiel de l'institution lorsque le droit à un
commerce mondial libre entre en conflit avec le droit à un environnement sain (chapitre 1).
10
Ensuite, nous entamerons un travail de confrontation proprement dit, entre la
directive européenne et les règles de l'OMC, afin de savoir si les mesures en cause, bien
qu'ayant un effet restrictif aux échanges, peuvent être justifiées à l'égard d'un motif
d'intérêt général exprimé par la protection des ressources naturelles épuisables (chapitre 2).
11
PARTIE I) UNE OPPOSITION DE POINTS DE VUE EXPLIQUÉE PAR
DES CONTEXTES ET INTÉRÊTS DIVERGENTS
Dans cette première partie, nous aborderons en détail les différentes stratégies des
politiques européenne et brésilienne en promotion de biocarburants, afin de comprendre les
relations, parfois tendues, que l’UE et le Brésil entretiennent dans le domaine.
Dans ce but, nous analyserons dans un premier chapitre la mise en place d’une
politique européenne intégrée en matière de climat et énergie. Dans un deuxième chapitre,
nous examinerons le lobby orchestré par le Brésil en vue d’éliminer les barrières
commerciales contre les biocarburants.
CHAPITRE 1) Une politique intégrée en matière de climat et d’énergie
Les défis liés aux engagements internationaux pris dans le cadre du changement
climatique (notamment ceux du Protocole de Kyoto), ont amené l’Europe à reconsidérer
son modèle de développement économique. L’Union européenne (UE) a vite compris que,
pour faire face au réchauffement climatique, il fallait inciter les États membres à dissocier
la croissance économique du gaspillage d’énergie.
Dans une première section, nous aborderons la politique énergétique européenne,
en mettant un accent particulier sur la promotion des énergies renouvelables et des
biocarburants (1) ; ensuite, nous analyserons les chiffres actuels du marché européen de
biocarburants, afin de déterminer si cette promotion atteint les fruits espérés (2)
SECTION A) LA DIFFICILE CONCILIATION ENTRE LE DEFI ENERGETIQUE ET LES
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Concilier les obligations en matière d’énergie et climat avec les contraintes d’ordre
environnementales, économiques et sociales, exige une mobilisation considérable de la part
des institutions européennes. Le premier effort institutionnel dont nous discuterons sera la
promotion des sources d’énergie renouvelables (i), suivi de la promotion largement plus
controversée des biocarburants (ii).
12
SOUS-SECTION (i) Une politique orientée vers la promotion de sources
d’énergie propres
Sachant que l’émission de gaz à effet de serre (GES) est la principale responsable
du réchauffement de la planète, et qu’environ 80%8 de ces émissions proviennent de la
production et l’utilisation de l’énergie dans l’UE, la mise en œuvre d’une politique intégrée
en matière de climat et d’énergie s’est imposée comme une alternative efficace pour
affronter le défi de réduire les émissions de GES.
La mise en place de cette politique énergétique commune est assez récente dans
l’Union, car ce n’est à partir du Traité de Lisbonne, signé en 2007, qu’elle a gagné un
fondement juridique propre, avec l’article 1949. Auparavant, l’UE intervenait dans ce
domaine en utilisant comme base la clause de flexibilité de l’art 308, qui exigeait
néanmoins, une unanimité, ce qui laissait peu de marge pour une action plus ciblée.
Désormais, les actions en matière énergétique relèvent des compétences partagées.
Les États n’interviennent que dans la mesure où l’Union n’exerce pas sa compétence (art.
2, TFUE). Les décisions sont prises par le biais de la procédure législative ordinaire,
démarrée avec par une proposition de la Commission européenne, et établie par le
Parlement Européen et le Conseil Européen.
Dans ce cadre, le Conseil européen de mars 2007 a approuvé la mise en œuvre d’un
plan d’action énergétique, à partir d’une proposition de la Commission européenne. Il
s’agissait de la Stratégie de Lisbonne, structurée autour de trois axes - dont l’élaboration
d’une « politique européenne intégrée en matière de climat et d’énergie qui soit viable à
long terme »10.
8 COM(2010) 639 final. COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS - Énergie 2020 : Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre. Bruxelles, le 10.11.2010
9 L’article 194 énonce les résultats attendus en matière d’énergie, qui consistent à garantir un marché compétitif, assurant des prix abordables pour tous les consommateurs, dont l’approvisionnement est garanti, tout en tenant compte de sa viabilité environnementale et de la lutte contre le changement climatique.
10 Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (8 et 9 mars 2007). http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/93141.pdf
13
L’effort suivant a consisté dans l’adoption du paquet Énergie-Climat, le 6 avril
2009, après un an de négociations. Une des sections plus importantes du Paquet était la
prévision d’une nouvelle réglementation concernant les énergies renouvelables, à savoir, la
Directive européenne 2009/28/CE11.
La stratégie de Lisbonne est remplacée depuis le début 2010 par la stratégie
« Europe 2020 », qui fixe des objectifs pour transformer l’Europe dans une économie
intelligente, durable et inclusive. Structurée autour de cinq objectifs (emploi, recherche et
développement, éducation, pauvreté et exclusion sociale), elle reprend également les
objectifs ambitieux en matière de changement climatique et énergie, qui devront être
accomplis jusqu’en 2020.
Ce sont repris des objectifs chiffrés appelés « 20-20-20 », c’est-à-dire :
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux niveaux de 1990 (ou même de 30% si les conditions le permettent12),
améliorer l’efficacité énergétique en 20%
accroître la part des sources renouvelables à 20% de la consommation totale.
L’accomplissement de ce dernier but contribuera à renforcer la réduction des
niveaux de pollution, dans la mesure où cela permettra de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 600-900 MtCO2 (millions de tonnes de CO2) par an.
Mais, cette stratégie énergétique, quoique axée sur la lutte contre le changement
climatique, a été également conçue pour faire face à des enjeux d’ordre économique :
développer des sources propres d’énergie permettra de diminuer les coûts colossaux liés à
la prévention du changement climatique et de la pollution. Et surtout, une des plus
importantes motivations est sans doute de freiner la dépendance des importations de
combustibles fossiles pour le secteur de l’électricité et des transports.
11 Directive que l’on abordera en détail dans la sous-section ii) 12 «pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives».
14
Néanmoins, selon une évaluation de la politique énergétique élaborée par la
Commission européenne en novembre 201013, on constate que les efforts déployés pour
atteindre les objectifs jusqu’à 2020 apparaissent insuffisants, étant même jugés par ce
rapport d’« inadéquates » si l’on tient compte des défis à plus long terme.
Par exemple, le but d’économiser 20% d’énergie jusqu’à 2020, est encore loin
d’être atteint. Il s’agit pourtant d’un objectif clé dans la stratégie énergétique, puisqu’il
constitue le moyen le plus rentable de réduire des émissions, d’assurer
l’approvisionnement, la compétitivité et des prix abordables pour les consommateurs.
De ce fait, le rapport précité préconise le renforcement des engagements politiques,
en s’appuyant sur un « contrôle effectif du respect des normes, une surveillance adéquate
du marché, l’utilisation généralisée des services et audits énergétiques »14
Dans ce contexte, les énergies renouvelables jouent un rôle majeur dans la
conciliation de la croissance économique avec une faible émission de carbone. Elles
peuvent être utilisées pour couvrir tous les types de besoins énergétiques, c’est-à-dire, la
production d’électricité, les transports et le chauffage.
La politique européenne concernant la promotion des sources renouvelables est
relativement récente : le premier effort institutionnel remonte au livre blanc publié en
1997. Dans un premier moment, la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables
dans l’Union était réalisée dans un cadre plutôt incitatif, avec la stipulation des objectifs
indicatifs aux secteurs de l’électricité et de transports.
Le premier acte législatif dans le domaine était l’adoption de la directive
2001/77/CE, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables. Ensuite, en 2003, une directive statuant spécifiquement sur la promotion des
biocarburants a été adoptée. Dans les deux cas, il s’agissait de la fixation d’objectifs
d’ordre incitatif, comme l’augmentation à 20% de la part des sources renouvelables dans la
consommation totale d’énergie et l’utilisation de 5,75% de biocarburants dans le secteur du
transport jusqu’à 2010.
13 COM(2010) 639 final. Bruxelles, 10/11/2010 14COM(2010) 639 final. Bruxelles, 10/11/2010, p. 8.
15
Le caractère purement incitatif de ces objectifs n’a pas été suffisant pour générer les
résultats attendus. L’examen présenté par une étude de la Commission européenne conclut
que seuls quelques États Membres avaient atteint les objectifs fixés :
« Seuls quelques États membres, à savoir l'Allemagne, le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Lituanie, la Pologne et le Portugal comptent atteindre leurs objectifs de 2010 pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de même que seuls l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Suède comptent atteindre leurs objectifs pour les énergies renouvelables dans les transports. »15
Face à ce scénario d’échec par rapport aux objectifs fixés pour 2010, un
changement d’orientation s’est imposé, en vue de la fixation d’objectifs juridiquement
contraignants. Ceci a été concrétisé notamment par l’implémentation d’un cadre
réglementaire plus solide à travers la nouvelle directive 2009/28/CE, du 23/04/2009,
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables, dont le délai maximum pour la transposition par tous les États membres
était le 5 décembre 2010.
Tout en poursuivant le but d’atteindre la part des 20% d’énergie renouvelables dans
la consommation totale, cette directive impose aux États l’exigence légale d’élaborer des
plans d’action nationaux, qui devront tenir compte des réalités de chaque État membre, par
exemple, les sources d’énergie qui sont à leur disposition. En outre, la directive prescrit la
reformulation les infrastructures, ainsi que le développement des réseaux électriques. Allié
à ces exigences légales, un effort budgétaire a été mis en place, de sorte qu’en 2009, 62%
des investissements en matière de production d’énergie ont été consacrés aux secteurs
renouvelables.
L’adoption d’un cadre législatif contraignant en vue d’accroître la part des énergies
renouvelables dans la consommation totale n’est qu’un premier pas pour l’atteinte effective
d’un tel objectif. Pour une application juste de la directive, les organes de l’UE savent qu’il
va falloir, dans un premier temps, investir lourdement dans la recherche des nouvelles
technologies avancées et des mécanismes de soutien, afin d’encourager les investisseurs
privés à soutenir de nouvelles solutions en matière d’énergie renouvelable.
15 COM 2011(21) final. Communication de la Commission européenne au Parlement Européen et au Conseil. 31.01.2011. Énergies renouvelables, progrès à accomplir pour atteindre l’objectif de 2020.
16
En effet, si l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources propres ne
se fait pas accompagner d’une adaptation des infrastructures de réseau (par exemple, des
voitures prêtes à rouler avec d’autres types de carburants que ceux d’origine fossile)
l’effort risquera d’être en vain.
La Communication COM(2010) 639 met l’accent de manière assez insistante sur la
nécessité d’investir des sommes milliardaires afin de renforcer à la fois l’infrastructure
interne, mais également les interconnexions aux frontières extérieures, ainsi que de
moderniser les structures obsolètes, tout en créant un parc énergétique basé sur une faible
émission de carbone.
Malgré les difficultés envisagées, les projections des États membres concernant
l’horizon de 2020, dans le cadre de leurs plans nationaux, sont assez optimistes,
lorsqu’elles indiquent que l’Europe dépassera l’objectif de 20% quant aux énergies
renouvelables.
Selon des données présentées par la Communication 2011(21) final de la
Commission européenne16, presque la moitié des Etats membres espèrent dépasser
individuellement cet objectif, à savoir, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark,
Espagne, France, Grèce, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Slovénie, Suède et République
tchèque, et même être en mesure de fournir des excédents à d'autres États membres. A
contrario, Italie et Luxembourg prévoient qu’une petite partie de leur production d’énergie
renouvelable devra être complétée soit par des transferts intra-communautaires, soit par le
biais de l’importation des pays tiers.
Rappelons-le, les besoins énergétiques comprennent l’électricité, le chauffage et la
réfrigération, et les transports. Dans l’UE, en ce qui concerne l’électricité, la part des
énergies renouvelables utilisée en 2008 était déjà de 16,8% par rapport à la consommation
16 COM 2011(21) final. Communication de la Commission européenne au Parlement Européen et au Conseil. 31.01.2011. Énergies renouvelables, progrès à accomplir pour atteindre l’objectif de 2020.
17
totale, dont 57,7% provenant de l’énergie hydraulique, 20,9% de l’énergie éolienne, 19%
de la biomasse, 1,3% de l’énergie solaire et 1% de la géothermie17.
Le chauffage (domestique ou industriel) et la réfrigération absorbent la moitié de la
consommation énergétique finale en Europe. Pourtant, malgré l’existence d’un grand
potentiel à être exploité concernant des sources (telles que la biomasse, l’énergie solaire ou
la géothermie), la part des énergies renouvelables utilisées afin de couvrir les besoins dans
le secteur reste au-dessous des expectatives, à savoir, environ 12% de la consommation. De
ce total, la biomasse représente la grosse majorité, avec 63 Mtep (millions de tonnes-
équivalent pétrole) sur un total de 67,5 Mtep18.
Quant aux transports, la part qu’ils occupent dans la consommation finale d´énergie
et l’émission des GES s’est accrue avec le temps. Et 96% de l’énergie utilisée dans le
secteur provient des sources pétrolières. De ces faits, il s’agit d’un domaine pour lequel les
stratégies d’amélioration du rendement énergétique sont indispensables.
Étant donné la forte dépendance au regard du pétrole, la directive 2009/28/CE
impose un objectif de 10% d’énergies renouvelables dans le secteur d’ici à 2020. Les
biocarburants constituent les principaux substituts à l’essence et au gazole. Dans un
premier moment, la source prépondérante sera les biocarburants de première génération ;
les biocombustibles dits de deuxième génération, ainsi que les véhicules électriques,
n’occuperont une place significative qu’à partir de 2020.
D’une façon générale, les institutions européennes sont convaincues que
l’utilisation des biocarburants tels que le bioéthanol, biodiesel et le biogaz peut rendre le
secteur de transports plus durable, tout en diminuant la dépendance vis-à-vis les
combustibles fossiles, ainsi que les émissions des GES. Pour cela, il faut évidemment
accroître la production des véhicules roulant à l’aide des sources d’énergie renouvelable,
qui ne sont guère utilisés dans le marché européen.
17 Commission européenne. Les énergies renouvelables font la différence. Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2011. 18 Commission européenne. Les énergies renouvelables font la différence. Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2011
18
Afin de se rassurer que la production des biocarburants soit faite dans le respect de
toutes contraintes d’ordre sociale et environnementale, la directive 2009/28/CE a prévu
tout un encadrement de critères de durabilité, ainsi que des méthodes de vérification, que
nous allons analyser dans la sous-section suivante.
SOUS-SECTION (ii) Le passage d’une politique d’encouragement à une
méfiance à l’égard de la production de biocombustibles.
Nous analyserons comment s’est développée la politique européenne à l’égard des
biocarburants, en mettant l’accent sur les successifs changements de stratégie depuis les
années soixante-dix. De la négligence initiale, l’Europe est passée à une époque
d’euphorie, qui n’a pas duré, avant d’être remplacée par une nouvelle phase, plus
équilibrée.
Parmi les sources énergétiques renouvelables, les biocarburants de première
génération sont, indiscutablement, ceux ayant le plus grand potentiel d’exploitation, ainsi
que la plus grande viabilité économique et technologique, ce qui explique les efforts
entrepris afin de développer ce marché, tout en annulant des éventuels effets négatifs d’une
production en large échelle.
En effet, le moment actuel est marqué, d’une part, par la nécessité d’accroître la
part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale (objectif qui sera
plus facilement atteint par le biais des biocarburants) et d’autre part, par une certaine
méfiance par rapport à la durabilité de ce choix. En quelques mots, l’Europe s’est aperçue
que les biocarburants ne peuvent contribuer à la protection de l’environnement que dans la
mesure où leur production s’effectue aussi dans le respect de l’environnement.
Bien que la technique permettant d’utiliser la biomasse pour des fins énergétiques
ait déjà connue depuis la fin du 19e siècle, durant une grande partie du 20e siècle, l’Europe
a privilégié les sources pétrolières, qui étaient abondantes et bon marché.
À la suite du premier choc pétrolier, en 1973, certains pays européens se sont
inquiétés des éventuels problèmes d’approvisionnement. Ceci a amené à une
19
reconsidération de la question des biocarburants, sans qu’aucun effort concret n’ait été
réalisé, au contraire d’autres pays, comme le Brésil et les États Unis.19
Aucune initiative n’est prise jusqu’aux années 2000, période où les prix du pétrole
connaissent une nouvelle hausse. La crainte de la dépendance d’une source devenue à la
fois chère et limitée, en outre concentrée dans le territoire des pays ayant une faible
stabilité politique, a réactivé le débat autour des biocarburants. Par ailleurs, les
engagements internationaux liés à la lutte contre le changement climatique ont également
contribué à la recherche de solutions alternatives. Par conséquent, l’UE met pour la
première fois en place (même si tardivement) une politique de soutien aux biocarburants.
La première action de promotion de biocarburants s’est traduite par la publication
d’un Livre Vert par la Commission européenne le 29 novembre 2000, proposant l’objectif
ambitieux d’augmenter à 20% la participation des biocarburants dans la consommation
totale d’énergie jusqu’à 2020. Cette première vague de valorisation des biocarburants
aboutit ainsi à l’adoption de la directive 2003/30/CE, la première concernant le secteur.
Conformément à ce que l’on a déjà exposé précédemment, la directive établissait
des valeurs de référence ayant plutôt un caractère incitatif. Elle reflète ainsi les différences
de points de vue entre les institutions européennes lors de son élaboration. Tandis que le
Parlement envisageait une série d’autres mesures incitatives (comme l’exonération fiscale
et l’aide financière) et même contraignantes, les États membres refusaient un tel niveau
d’engagement.20
Malgré l’absence des normes contraignantes, on observe avec cette directive une
volonté assez claire de promouvoir les biocarburants, contrairement à la tendance des
décennies antérieures. Des soutiens fiscaux sont mis en place afin de réveiller chez les
agriculteurs l’intérêt pour leur production, ainsi que d’inciter les industriels à investir dans
les filières de biocarburants. L’enjeu en cause était précisément d’équilibrer les
importations avec la production sur place.
19 HOGOMMAT, Benjamin. Les enjeux de la prise en compte des biocarburants au regard des orientations de la politique agricole commune. Revue juridique de l’environnement, 2010. 20 Rapport d'information n° 52 (2004-2005) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 3 novembre 2004. Sénat français.
20
C’est ainsi que la politique des biocarburants rentre dans la politique agricole
commune (PAC), bénéficiant des soutiens financiers au nom de l’intérêt général de la
réduction des émissions de GES. En principe, cette solution paraissait idéale, car elle
permettrait de concilier deux secteurs traditionnellement ennemis : celui de l’agriculture et
de la protection à l’environnement. De plus, cela permettrait à l’UE de se battre pour une
partie de ce marché mondial déjà dominé par d’autres puissances étrangères.21
D’autres dispositifs sont conçus durant ce pic d’euphorie. Par exemple, le
règlement 1782/2004 relatif à la PAC établit une aide financière de 45 euros par hectare,
octroyée aux producteurs agricoles dédiant une surface de leurs terres à des fins
énergétiques. De même, le système conditionnant l’octroi d’aides directes à un gel de
terres d’au moins 10% d’une exploitation, instauré en 1988, ne s’appliquait pas aux terres
utilisées pour des fins non alimentaires.
Les efforts engagés apportent un résultat faible, mais non négligeable. Entre 2001 et
2005 la part des biocarburants dans la consommation d’énergie est passée de 0,3% à 1%,
selon un rapport élaboré par la Commission et remis le 10 janvier 200722. C’est ainsi que la
nécessité de réviser la directive, de sorte à mettre en œuvre un cadre législatif plus strict,
s’est imposée ; ce qui a été concrétisé par l’adoption de la directive 2009/28/CE fixant des
objectifs contraignants.
Néanmoins, en Europe, au cours des dernières années, l’opinion publique s’est mise
à douter de l’efficacité réelle des biocarburants en tant que source énergétique à faible
émission de carbone. Plusieurs études23 démontrant que le bilan carbone à la fin du cycle
de vie complet des biocarburants pouvait être égal ou même supérieur à celui des énergies
d’origine fossile, en fonction des impacts environnementaux causés lors de leur
production, sont apparues. Nous n’allons pas nous concentrer ici sur l’analyse des
21 Voir référence 11 22 COM(2007)2 final. Communication de la Commission du 10 janvier 2007, «Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius - Route à suivre à l'horizon 2020 et au-delà» 23 Par exemple, on peut citer les études “How biofuels could starve the poor”, de C. Ford Runge et Benjamin Senauer, Foreign Affairs, mai/jun 2007; “Fuelling destruction in Latin America”, Friends or the Earth International, septembre 2008; et encore le dossier synthétique sur différentes études élaboré par la revue Sciences et vie, intitulé “Le dossier noir des énergies vertes”, numéro 1086, mars 2008, qui remet en cause les avantages propagés des biocombustibles.
21
différentes conclusions concernant la durabilité des biocombustibles, car elle sera
présentée dans la deuxième partie de ce travail.
Par ailleurs, on s’est aperçu que la production des biocarburants exigeait une
utilisation extensive de la terre, en y dédiant des grandes surfaces. Ce constat amenait à
envisager une concurrence avec l’agriculture à fins alimentaires, ce qui pourrait induire un
impact négatif sur les prix des aliments, ainsi qu’à une incitation à la monoculture,
menaçant ainsi la biodiversité.
Un exemple des réactions causées par ces critiques était la déclaration de l’ancien
Commissaire à l’environnement, M. Stavros DIMAS, en 2008, selon laquelle il fallait
mieux rater les objectifs fixés que les atteindre en endommageant les pauvres et
l’environnement.24
En tenant compte de ces arguments, les institutions européennes ont freiné
l’enthousiasme par rapport à leur programme de promotion des biocarburants, dans le sens
d’un recul. Le changement d’orientation est ainsi synthétisé par Benjamin HOGOMMAT :
« Devant l’accumulation des rapports défavorables aux biocarburants et suite au repli de certains
États habituellement favorables à ceux-ci (la meilleure illustration en la matière est celle de
l’Allemagne), l’UE ne peut maintenir sa politique en l’état. Elle ne passe bien sûr pas du jour au
lendemain d’une attitude totalement favorable à une manifestation de rejet complet à l’égard des
biocarburants de première génération. Toutefois, il demeure qu’en 2008, soit cinq ans après le
lancement de la promotion des biocarburants, aucune norme juridique concrète n’est intervenue
pour garantir leur viabilité environnementale.25 »
C’est ainsi que, lors de l’exposé de la directive de 2009, l’UE a réitéré la nécessité
d’imposer des objectifs chiffrés pour la part des sources renouvelables dans les transports,
tout en rappelant qu’en contrepartie, les biocarburants doivent faire preuve d’un caractère
durable et que ceux de deuxième génération doivent être privilégiés.
24 EU rethinks biofuels guidelines, 14 janvier 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7186380.stm 25 HOGOMMAT, Benjamin. Les enjeux de la prise en compte des biocarburants au regard des orientations de la politique agricole commune. Revue juridique de l’environnement, 2010.
22
Dans le corps de la directive, les éléments de ce changement peuvent être
exemplifiés. Tout d’abord par l’intitulé même de l’objectif majeur de la politique. Au lieu
de prévoir une part de 10% des « biocarburants » dans la consommation totale d’énergie,
le nouveau texte impose désormais l’obligation d’utiliser 10% des sources d’ « énergies
renouvelables », concept plus large qui comprend d’autres sources comme l´énergie
solaire, éolienne, la géothermie etc26.
En outre, la directive 2009/28/CE introduit des critères de durabilité détaillés, à
appliquer même si la matière première a été cultivée en dehors du territoire de l’UE afin de
ne pas cautionner des pratiques attentatoires à l’environnement ayant lieu dans des pays
exportateurs.
Ces critères servent à mesurer la conformité de l’énergie produite à partir des
biocarburants avec les objectifs nationaux, tels qu’exigés par la directive ainsi qu’avec les
autres obligations en matière d’énergie renouvelable. Le respect de ces critères conditionne
l’octroi d’aides financières à la production des biocarburants. Les critères de durabilité sont
énoncés par l’article 17 et peuvent être ainsi résumés:
- La production du biocarburant doit permettre une réduction des émissions de
GES d’au moins 35%, pourcentage pouvant atteindre 60% en 2018 (paragraphe
2) ;
- Que les terres utilisées pour la production de la matière première de
biocarburants ne soient pas de grande valeur en termes de diversité biologique.
À savoir, les forêts primaires ou surfaces boisées primaires, les zones affectées
à la protection de la nature, et des prairies naturelles présentant une
biodiversité (paragraphe 2);
- Que les terres utilisées ne représentent pas un important stock de carbone,
comme des zones humides et zones forestières continues ;
- Que les terres utilisées ne soient pas des tourbières, à moins que leur
exploitation n’ait pas entrainé le drainage des sols (paragraphe 5).
26 Considérant 13: Compte tenu des points de vue exprimés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de définir des objectifs contraignants nationaux qui correspondent à une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie pour la Communauté et à une part de 10 % de ce type d’énergie destinée au transport, et ce, d’ici à 2020.
23
Ainsi, les critères de durabilité de la directive sont de deux ordres : critères
concernant les émissions de GES et l’utilisation des sols. Dans le premier cas, la directive
prend en compte les taux de gaz carbonique émis lors des étapes de production de la
matière première, transformation en biocarburant et transport, et les compare avec le CO2
qu’aurait été émis si l’on avait utilisé un combustible fossile. Ce calcul est dénommé de
« balance énergétique » et selon les règles de la directive, elle doit être positive au point de
permettre une mitigation d’au moins 35% (60% en 2018) des GES par rapport au
combustible fossile.
Quant au critère relatif à l’utilisation des sols, le raisonnement est pareil. La
déforestation d’une zone riche en carbone et le changement de l’usage du sol
(remplacement de cultures, par exemple), entrainent le dégagement du carbone qui était
déposé dans ce sol, ce qui peut neutraliser les effets positifs des biocarburants en termes
d’émissions de GES. À cet égard, la directive n’a pas imposé un pourcentage minimal de
réduction par rapport au combustible pétrolier. Le choix a été d’interdire tout simplement
la production de biocarburants issus de zones ayant un stock important de carbone.
La directive impose également aux États membres une obligation de suivi continu
quant aux impacts de la production de biocarburants sur le sol, l’air et l’eau, ainsi que sur
les répercussions sociales, même si celles-ci ne font pas objet d’un encadrement légal
spécifique. Il s’agit du premier cadre normatif contraignant au monde en ce qui concerne
les critères de durabilité, pouvant, de ce fait, servir d’exemple à d’autres pays producteurs.
D’ailleurs, la nécessité d’établir des critères de durabilité s’explique également par
la perspective que la seule fixation des objectifs contraignants sans un te encadrement
puisse conduire à un développement d’investissements dans le secteur, peu concernés par
les impacts négatifs sur l’environnement.
Comme nous l’avons signalé plus haut, les critères proposés par la Commission
européenne sont d’ordre environnemental. Ceux d’ordre social ou liés à des effets plus
larges sont exclus de son champ d’application. Ce choix s’explique par des considérations
de viabilité technique et par la crainte que telles conditions s’avèrent incompatibles avec
les règles de l’Organisation mondiale du commerce. En effet, ces critères de durabilité
peuvent être considérés comme des barrières non tarifaires susceptibles d’entraver le
24
commerce international, problématique qui sera également analysée dans la deuxième
partie de ce travail.
Néanmoins, ce choix plutôt timide de la Commission, qui privilégie les critères
d’ordre environnementaux, fait l’objet de plusieurs critiques émises par un certain nombre
d’États membres, la société civile, et même au sein du Parlement européen.
Selon le rapport « Make certification work for sustainable development 27», ces
organismes défendent le développement des critères permettant de couvrir un ensemble
beaucoup plus large de questions, à savoir, les effets négatifs sur les coûts des aliments et
sur l’approvisionnement de l’eau. Il s’agit, néanmoins, d’un débat très controversé qui n’a
pas pu aboutir lors de l’adoption de la directive 2009/28/CE.
Il est vrai que n’importe quelle évaluation d’impact environnemental doit forcément
tenir compte d’autres aspects plus larges, tels que les questions économiques et sociales,
comme le débat qui oppose les biocarburants au marché d’aliments. D’un autre côté,
mettre en œuvre un système d’évaluation objectif de durabilité en fonction de ses variantes
est extrêmement complexe, voire impossible, du fait des divers contextes économiques et
humains concernés.
Même en ce qui concerne les méthodes de vérification des critères de durabilité
strictement environnementaux, il y a de grands obstacles à surmonter, à cause de la
difficulté d’établir des méthodes scientifiquement attestées et convenables pour chaque
type de culture. Plusieurs études ont été déjà menées avec ce desideratum mais, en raison
des différents critères méthodologiques utilisés, elles aboutissent à des conclusions
opposées en ce qui concerne l’impact réel de la production des biocarburants dans la
diminution des émissions de carbone, la biodiversité ou la réduction de
l’approvisionnement alimentaire.
Il est donc, sans aucun doute, assez compliqué d’établir une méthodologie générale,
qui pourrait être appliquée à différentes types de technologie et de niveaux de production,
pour mesurer et certifier la quantité totale de GES émis pendant un cycle de vie
27 Make certification work for sustainable development: the case of biofuels. United Nations Conference on Trade and Development Making, United Nations, New York and Geneva, 2008.
25
énergétique complet, surtout en ce qui concerne les impacts indirects issus de l’exploitation
de la terre.28
Ainsi, l’EU a défini sa propre méthode de vérification, appelée « système de bilan
massique ». Ceci afin de solutionner le problème de la pluralité méthodologique. Ce
système doit être appliqué indistinctement aux produits d’origine communautaire et
externe.
Selon B. HOGOMMAT, cette disposition est issue d’une volonté de cohérence.
Pour lui, « avoir recours aux importations des pays engagés de façon efficace dans ces
filières (reviendrait) à cautionner les problèmes de déforestation et les conséquences
sociales dramatiques qu’on observe dans les pays actuellement compétitifs 29». Ainsi,
étant donné que la production intracommunautaire est censée respecter des critères de
durabilité, permettre l’importation de biocarburants produits de façon non durable ne serait
qu’une manière de repousser le problème au-delà des frontières européennes.
La chaine de production des biocarburants est composée de plusieurs étapes, allant
du champ cultivé jusqu’à la distribution du produit. La matière première est généralement
transformée dans un produit intermédiaire qui ensuite devient le produit final.
Le système de bilan massique consiste à établir une connexion entre toutes les
phases de la chaine de production, de manière à tenir compte des émissions de carbone
depuis la production et récolte des matières premières, en passant par les produits
intermédiaires et les produits finaux, jusqu’au transport vers le lieu de consommation.
C’est alors par rapport au bilan final que la compatibilité avec les obligations imposées par
la directive doit être démontrée.30
En effet, la directive impose aux États membres l’obligation de rendre des rapports
sur la mise en œuvre de ce schéma de durabilité. Néanmoins, puisque le délai pour sa
28 CORREIA, Bruna de Barros et al. The biomass real potential to reduce greenhouse gas emissions: a life-cycle analysis. Universidade Estadual de Campinas, Brésil. 29 HOGOMMAT, Benjamin. Les enjeux de la prise en compte des biocarburants au regard des orientations de la politique agricole commune. Revue juridique de l’environnement, 2010
30 Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC. Commission européenne, SEC(2011) 129 final, Brussels, 31.1.201.
26
transposition dans le droit interne n’a expiré que le 5 décembre 2010, il n’y a pas encore
assez d’information disponible sur l’application de la méthode de vérification.
En outre, il faut tenir compte des spécificités de chaque écosystème. Cela signifie
que l’on ne peut pas étendre automatiquement des conclusions concernant une exploitation
donnée à d’autres n’ayant pas les mêmes caractéristiques. La méthodologie utilisée par des
chercheurs étrangers prend peu souvent en considération la réalité géographique et
climatique de chaque pays producteur pour calculer les émissions des données. L’absence
de négociations multilatérales ayant pour but de discuter l’harmonisation
méthodologique de critères de durabilité accentue ce problème.
Par conséquent, un critère, aussi objectif soit-il, restera très probablement arbitraire,
lorsqu’il est amené à être appliqué à un écosystème particulièrement distinct de celui où il
a été élaboré. Et pour cela, la décision européenne d’imposer ses critères de durabilité à des
produits provenant des pays tiers, malgré sa justification, suscite des débats concernant
l’existence d’une éventuelle intention protectionniste.
L’expansion de la production des biocarburants, en vue d’atteindre les objectifs
imposés par la politique énergétique de l’UE, est susceptible d’exercer un fort impact dans
le marché mondial de biocombustibles d’ici à la fin de la décennie en cours. En effet,
l’augmentation de la production, accompagnée des restrictions apportées par les critères de
durabilité, concernant les terres où les matières premières qui peuvent être cultivées,
affecteront, d’une manière générale, la structure du marché global, ainsi que les
consommateurs et producteurs des pays développés et en voie de développement.
Afin d’observer les résultats concrets de la politique européenne en matière de
biocarburants, nous allons ensuite discuter des données actuelles quant à la production,
importation et exportation de ces produits en Europe.
SECTION B) LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION
INTERNE ET L’IMPORTATION
Dans un premier temps, nous aborderons les chiffres concernant la production
européenne des biocarburants, tout en les comparant avec les objectifs contraignants
imposés par la politique énergétique communautaire (i). Ensuite, nous allons nous
27
concentrer sur données de la politique étrangère européenne dans le secteur, qui conserve
un caractère indiscutablement protectionniste (ii).
SOUS-SECTION (i) Une production encore écartée des besoins de la
consommation
Le discours officiel de l’Union européenne s’oriente vers une approche équitable
entre la production interne des biocarburants et l’importation des pays tiers. Cette
orientation a été exprimée lors de plusieurs documents, comme la « Feuille de route pour
les sources d’énergies renouvelables », de 2007 et la « Stratégie en faveur des
biocarburants » de 200631. Dans ce dernier, la Commission souligne sa volonté de
poursuivre « une approche équilibrée dans les négociations commerciales en cours et
futures avec les régions et pays producteurs d'éthanol – l'UE respectera à la fois les
intérêts des producteurs nationaux et de ses partenaires commerciaux, dans le cadre de la
demande croissante de biocarburants » (Point 3.5)
En 2009, Le biodiesel représentait 80% des biocarburants déjà utilisés dans le
secteur du transport en Europe, tandis que le bioéthanol occupait les 20% restant du
marché. La différence s’explique par la préférence des consommateurs européens pour les
véhicules à moteur diesel.
Malgré les efforts de la politique européenne en faveur des biocarburants, la
consommation totale des biocombustibles dans le secteur de transport n’a pas atteint
l’objectif incitatif de 5,75% pour 2010, qui était prévu par la directive 2003/30, selon les
chiffres du Rapport annuel sur les biocarburants dans l’UE, 200132.
De plus, au cours de la dernière décennie, on observe un déficit constant entre la
production européenne de biocarburants et la consommation interne, ce qui exige une
importation des pays tiers afin de garantir l’approvisionnement. Étant donné que les pays
membres de l’UE n’ont pas encore atteint les objectifs fixés en matière d’énergie
31 COM (2006) 848 final et COM(2006) 0034. 32Disponible à : http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-27_6 11-2010.pdf
28
renouvelable, il s’avère assez probable que la demande d’importation continue de
s’accroître, au moins jusqu’à ce que la technologie concernant les biocarburants de
deuxième génération soit bien maitrisée, vers 2020.
De plus, même en admettant que l’UE possède, du point de vue des terres
cultivables, la capacité de produire pour atteindre ses objectifs, il sera toujours prudent
d’importer une partie des biocarburants, afin que les prix des matières premières
européennes ne subissent pas une forte pression.33
Le tableau ci-dessous démontre bien l’écart entre production et consommation de
l’éthanol ainsi que les quantités importées entre 2006 et 201034 :
OFFRE ET DEMANDE D’ÉTHANOL DANS L’UE35
2006 2007 2008 2009 2010 Progression
annuelle
moyenne
Capacité
installée
2.220 3.800 5.960 6.720 8.870 41,4%
Production 1.635 1.840 2.660 3.040 3.800 23,5%
Exportation 38 44 51 57 63 13,5%
Importation 230 1000 1.105 1.115 1.270 53,3%
Consommation 1.825 2.795 3.715 4.100 5.010 28,7%
Dans la sous-section suivante, nous verrons dans quelle mesure et pour quelles
raisons le bilan que l’on peut faire de la politique européenne en promotion de
biocarburants reste mitigé.
33 EU Annual Biofuels Report, 06/11/2010. USDA Foreign Agricultural Service.
34 EU Annual Biofuels Report, 06/11/2010. USDA Foreign Agricultural Service
35 En milliers de m³.
29
SOUS-SECTION (ii) Un bilan mitigé par le protectionnisme, malgré
l’insuffisance de la production.
Le renforcement d’un marché européen des biocarburants, par le biais de la mise en
place d’objectifs contraignants d’utilisation des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie (et plus précisément dans les transports), a été interprété comme
une perspective positive par les principaux pays exportateurs. Effectivement, les Etats
membres ne sont pas en mesure de produire eux-mêmes la part des biocombustibles
nécessaire pour accomplir les objectifs imposés, même en ayant recours au commerce
intracommunautaire. En outre, les produits d’origine communautaire ne sont pas toujours
économiquement avantageux par rapport à ceux importés.
Pourtant, le plan énergétique n’a pas prévu des modifications sur les tarifs
douaniers appliqués aux biocombustibles, qui restent très élevés. Pour exemple, nous
allons nous concentrer ici sur les l’exemple de l’éthanol et le biodiesel qui représentent la
plupart des importations en provenance du Brésil.
Le prix de l’éthanol produit dans l’Union européenne est en moyenne 3 fois plus
élevé qu’au Brésil. Cependant, il est nécessaire d’y ajouter les coûts du transport jusqu’au
lieu de l’utilisation, ce qui inclut le transport par voie terrestre ou ferroviaire jusqu’au port
et ensuite le transport maritime jusqu’en Europe. De plus, l’éthanol brésilien est frappé des
taxes de douane assez importantes, car il ne bénéficie d’aucun avantage douanier,
contrairement aux autres pays en voie de développement.
Il y a deux taxes qui peuvent frapper l’éthanol brésilien. Le tarif varie selon le type
d’éthanol, non dénaturé ou pur36 (NC 22 07 10 00), dont la commercialisation est plus
habituelle ou dénaturé (NC 22 07 20 00).
L’éthanol non dénaturé est celui plus habituellement produit par le Brésil et le seul
accepté par la plupart des pays européens, car il présente des niveaux plus élevés de pureté.
36 La dénaturation consiste en l'adjonction à l'alcool, pour bénéficier d'une fiscalité plus favorable, de produits tendant à le rendre impropre à certains usage « nobles » (alcool de bouche) et aptes à d'autres utilisations (cosmétiques)
30
Il est frappé lors de son entrée sur le territoire européen d’un tarif de 0,192 euro par litre37.
Si l’on considère le taux d’échange de la fin du mois d’avril 201238, (1 euro coûtant 2,43
« reais »39), et le prix moyen de l’éthanol à 1,21 « reais »40, on obtiendra la valeur du litre,
qui sera de 0,50 euros, ce qui nous permet de calculer un tarif d’importation d’environ 40%
par rapport au prix de l’éthanol vendu au Brésil.
Appliquant le même raisonnement à l’éthanol dénaturé, frappé d’un tarif de 0.192
euro par litre et étant vendu à environ 1.16 « reais », selon les mêmes sources utilisées pour
le paragraphe précédent, on obtiendra un tarif d’importation d’environ 21%.
En ce qui concerne l1e biodiesel, NC 38 14 00 90, considéré comme un produit
chimique, les droits de douane sont de 6,5%. Il n’existe néanmoins pas un marché
exportateur consolidé de biodiesel au Brésil.
D’après les chiffres cités, il est possible de conclure que le marché interne des
biocombustibles en Europe est fortement protégé. Ce niveau actuel de protection doit être
maintenu dans un avenir proche, selon l’opinion du rapporteur-général du Sénat
français.41Il ajoute que « le maintien d’une protection suffisante du marché européen
contre les importations à très bas prix est une condition impérative du développement des
filières de carburants »
Ce même rapport souligne encore la crainte de l’UE par rapport à un « afflux
déstabilisant » des biocarburants en provenance des pays du sud. Le rapport conclut qu’il
convient de prévoir des aides, fiscales et non fiscales, et des protections particulières afin
de favoriser l’essor des biocarburants en Europe, ce qui démontre clairement l’existence
d’un protectionnisme important dans le secteur, contrairement aux principes majeurs de
l’OMC.
37 Nomenclature combinée 2207 10 00. Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff.
38 Banque Centrale du Brésil. http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO
39 Le réal brésilien (en portugais, real sans accent et pluriel “reais”) est la monnaie de Brésil. 40 Cotation du 20/04/2012. Source: website d’UNICA (Union de l’industrie de cane-de-sucre du Brésil). http://www.unica.com.br/q10/ 41 Rapport disponible sur le site du Sénat français : http://www.senat.fr/rap/r04-052/r04-05261.html
31
À titre d’exemple, peuvent être cités le subventionnement de la production, le
système différencié d’allégement fiscal en faveur de certains producteurs, et les droits
élevés de douane précités. Dans la deuxième partie, nous aborderons avec plus de précision
la question de la compatibilité des subventions avec le droit de l’Organisation Mondial du
Commerce.
Le cas de la Suède, le plus grand promoteur européen du mélange de biocarburant
avec l’essence et diesel, illustre bien le degré de protectionnisme du marché. Face à une
production encore insuffisante – malgré les avantages fiscaux – et au prix élevé du
biocarburant communautaire, la Suède a recours aux importations de l’éthanol brésilien.
Afin d’approvisionner le marché et garantir l’accomplissement de ses objectifs de
mélange obligatoire à un coût plus bas, le gouvernement suédois demande à l’Union
européenne depuis 2008 une autorisation d’importer l’éthanol du Brésil à un taux douanier
plus bas que celui officiel. Au lieu d’être classé en tant qu’alcool, avec la nomenclature
combinée 22 07, l’éthanol est classé en tant que produit chimique, NC 38 24 bénéficiant
d’un droit de douane de 6,5%.42
La concession doit être renouvelée chaque année par la Commission européenne, ce
qui crée une situation d’insécurité chez les importateurs suédois, amplifiée par la forte
pression des producteurs européens de biocarburants, qui s’opposent fermement à une telle
concession.
En réponse au lobby des producteurs communautaires contre cette possibilité de
contourner le système douanier, la Commission a envoyé en octobre 2011 au Comité du
code des douanes une proposition envisageant de modifier la classification de l’éthanol et
des mélanges d’essences. Ceci ayant pour but de diminuer les importations qui font recours
à cette procédure. Selon la Revue Agrapresse43, un nouveau règlement sur le sujet doit être
publié prochainement.
42 L’éthanol vendu dans le marché suédois (E85/E95) en réalité s’agit d’un mélange de produits agricoles avec des produits chimiques, raison par laquelle il peut être classé en tant que produit chimique. Source : Government Offices of Sweden. http://www.sweden.gov.se/sb/d/10165/a/96322
43 http://www.agrapresse.fr/agriculture-societe/vers-une-modification-de-la-classification-douani-re-europ-enne-du-bio-thanol-art326539-13.html
32
Jusqu’au présent, le bilan que l’on peut faire de la politique de l’UE en matière de
biocarburants est d’un côté mitigé, mais de l’autre, il est possible d’envisager une réussite
par rapport aux défis qu’elle s’est imposés.
Après un début tardif, par rapport à d’autres pays producteurs, quand l’Union s’est
finalement rendu compte de la nécessité d’organiser un politique énergétique commune
pour faire face à la question climatique et garantir la sécurité d’approvisionnement, sa
décision de baser sa stratégie sur les énergies renouvelables, et plus précisément les
biocarburants, a suscité tellement des critiques qu’il a fallu réorienter les choix initiaux.
D’une phase d’euphorie, où l’utilisation des biocarburants de première génération a
été largement promue, y compris dans le cadre de la Politique Agricole Commune, l’UE
est passée à une orientation plus prudente, en introduisant des critères de durabilité et en
soutenant le développement des recherches en matière de biocombustibles de deuxième
génération.
Les diverses conclusions sur les impacts négatifs des biocarburants, parfois même
contradictoires, alliées aux différents intérêts en jeu, ont provoqué des débats – et parfois,
des impasses – importants au sein et entre les différentes institutions communautaires. Cela
peut être démontré par la prolifération des soft laws, c’est-à-dire, des textes de caractère
non contraignant ayant pour objet discuter et analyser la progression de la politique
réservée aux biocarburants.
À juger par l’abondante production législative dans la matière, il est possible de
conclure que l’Union européenne a eu du mal à trouver une voie unique dans la façon dont
elle doit conduire sa politique. S’il est vrai que les objectifs sont bien fixés, il n’en va pas
de même pour les moyens mis en œuvre afin de les atteindre. À partir de ces constatations,
il semble que l’Union est dans une certaine mesure perdue au milieu d’un feu croisé entre
les divers courants et intérêts en conflit autour de la promotion des biocarburants.
En tout état de cause, le marché européen de biocarburants reste fortement protégé,
à la fois par l’imposition des droits de douane élevés et par ces barrières non tarifaires
33
exprimées par les critères de durabilité. De son côté, le Brésil emploi d’efforts divers afin
de forcer une ouverture pour écouler sa production abondante. Nous verrons dans un
prochain chapitre quelles sont les stratégies adoptées afin d’atteindre ce but.
CHAPITRE 2) Un lobby orchestré par le Brésil en vue d’éliminer les
barrières commerciales contre les biocarburants
Les deux principaux dérivés de la biomasse utilisés à des fins énergétiques au
Brésil, notamment dans le secteur des transports, sont le bioéthanol (qui remplace
totalement ou partiellement l’essence) et le biodiesel (qui remplace le diesel). Par
conséquent, nous nous concentrerons sur ces deux produits, en raison de la part qu’ils
occupent dans le marché de la biomasse et du nombre de données scientifiques disponibles.
Le Brésil est le deuxième producteur mondial d’éthanol, ayant perdu la première
place au profit des États-Unis en 2006. En 2008, le pays a produit 27,6 milliards de litres,
dont 20 milliards ont été destinés à la consommation nationale. Néanmoins, le Brésil reste
le premier exportateur d’éthanol au monde, avec 5,1 milliards de litres exportés sur cette
même année44.
En ce qui concerne le biodiesel, la production annuelle de 2010 est estimée à 2,4
milliards de litres, selon l’Agence nationale de pétrole (ANP).45 Ce chiffre est au-dessous
de la capacité de production, qui serait de 5,8 milliards de litres pour la même période.
Malgré ce grand potentiel de production, le pays est le troisième producteur mondial,
derrière l’Union européenne et les États-Unis.
Dans la section A), nous aborderons les raisons pour lesquelles le Brésil est devenu
le grand promoteur des avantages de la substitution des combustibles fossiles par les
biocarburants. Dans la section B), nous aborderons les politiques menées par ce pays afin
d’assurer une production durable de l’éthanol, et dans quelle mesure ces efforts constituent
44 WALTER Arnaldo et al. Sustainability assessment of bio-ethanol production in Brazil considering land use change, GHG emissions and socio-economic aspects. Revue Électronique Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 3 septembre 2010, p. 5703 – 5716. 45 Site de l'Agence Nationale du Pétrole (Brésil) : http://www.anp.gov.br/?pg=46827&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1337616099368
34
une réponse aux critiques concernant les éventuels impacts environnementaux des
biocarburants.
SECTION A) BRESIL : LE PIONNIER ET PRINCIPAL PROMOTEUR DES BIOCARBURANTS
AU MONDE
Dans les deux sous-sections suivantes, nous aborderons les enjeux qui ont justifié la
mise en place au Brésil, des politiques en matière de promotion de biocarburants, d’abord
en ce qui concerne l’éthanol (sous-section i), et ensuite quant au biodiesel (sous-section ii).
Le développement et l’encouragement des deux politiques n’ont pas suivi un même
standard, étant donné que le gouvernement brésilien a toujours préféré de concentrer les
investissements sur l’éthanol. Mais cette position sera révisée à partir des années 2000.
Néanmoins, d’une manière générale dans le pays, la promotion du bioéthanol et du
biodiesel peut être attribuée à un évènement unique, à savoir, l’impact sévère du choc
pétrolier sur l’économie brésilienne.
En effet, le choc pétrolier de 1973 n’a pas entrainé des effets négatifs qu’en Europe.
Le Brésil a été sévèrement atteint par l’augmentation du prix de pétrole, et les
conséquences y ont été beaucoup plus néfastes, car il s’agissait d’une économie non stable
et fortement influencée par les crises du capital international.
En raison du premier choc pétrolier, les dépenses du pays dans l’importation de
pétrole sont passées de 600 millions US$ en 1973 à 2,5 milliards US$ en 1974. Ces
chiffres ont contribué à un déficit colossal de la balance commerciale brésilienne
(d’environ 4,7 milliards US$ en 1974). Ce résultat a entrainé une escalade de la dette
externe (ce qui constituerait un des grands défis économiques du pays pendant les
décennies suivantes), et une forte croissance de l’inflation, qui est passée de 15,5% à
34,5% pendant la même période46.
46 Données extraites de l’article “A verdadeira história do Proalcool” (La vraie histoire du Proalcool), écrit par Luiz Gonzaga proBERTELLI, paru le 16/11/2005 dans le journal « O Estado de São Paulo ». Disponible à http://infoener.iee.usp.br/infoener/hemeroteca/imagens/91040.htm
35
Tout ce contexte explique en grande partie le choix du Brésil d’investir lourdement
dans le développement de sources alternatives d’énergie, notamment les biocarburants.
D’autres facteurs ont bien évidemment contribué à la prise d’une telle option. Ainsi, nous
aborderons l’ensemble de ces facteurs déterminants dans cette section.
Dans un premier temps (sous-section i), nous discuterons comment l’éthanol est
passé d’une solution provisoire pour la crise pétrolière à une politique qui est référence au
niveau internationale. Dans un deuxième temps (sous-section ii), nous nous intéresserons
sur la production de biodiesel qui, malgré son début tardif, présente un avenir prometteur.
SOUS-SECTION (i) Ethanol : d’une solution provisoire pour la crise
pétrolière à une politique de référence internationale.
L’impact de la crise pétrolière dans l’économie du Brésil a amené les autorités à
redéfinir la politique nationale de combustibles, afin de réduire la dépendance du pétrole.
Inquiété par la perspective d’un manque d’approvisionnement, et dans le but de rétablir le
taux de croissance affecté par l’inflation, le gouvernement fédéral a créé à l’époque un
groupe de travail composé des représentants du secteur privé et des experts en énergie, afin
de débattre de la crise et de discuter sur la possibilité de remplacer le pétrole par des
sources énergétiques alternatives.
Ce groupe de travail a conclu que la substitution de l’essence par l’alcool provenant
de la canne à sucre serait la meilleure solution au défi qui se présentait. Ce choix
s’explique par des raisons multiples, d’ordre à la fois politique, économique et historique.
À l’époque, le prix du sucre dans le marché mondial était en chute, et la production de
l’alcool, considéré jusqu’alors comme un sous-produit du sucre s’est montrée très
convenable.
En outre, la viabilité technique de l’utilisation de l’alcool comme carburant était
déjà connue depuis un siècle. Le secteur sucrier du Brésil était bien développé. Le type de
terre et le climat étaient favorables et le pays disposait d’une manœuvre abondante et
détentrice du savoir-faire en production industrielle de l’alcool.
36
De plus, la monoculture de la canne à sucre a été la base de l’économie brésilienne
pendant la période coloniale47 et le pays était le principal exportateur mondial de sucre,
produit qui avait une forte valeur marchande en Europe. Poussés par l’enrichissement du
Portugal par le commerce de sucre, d’autres pays européens (comme la France,
l’Angleterre et les Pays-Bas) se sont lancés dans sa production dans les colonies de
l’Amérique Centrale. Ainsi, l’aspect historique joue également un rôle non négligeable
dans le choix pour l’éthanol.
L’ensemble de ces facteurs ont contribué à ce que, d’une réponse temporaire à la
crise, l’investissement dans le secteur sucrier pour à fins énergétiques devienne une
politique nationale permanente. Cette politique a été concrétisée par la création du
Proálcool (Programme national de l’alcool) par le Décret nº 76.593, du 14 novembre 1975.
Son objectif primordial était la stimulation de la production de l’alcool, afin de répondre
aux exigences de la politique nationale en matière de carburants, ainsi que celles du
marché externe (art. 1er).
Le décret prévoit que le programme s’applique à n’importe quelle matière première
susceptible d’être utilisée pour la production de l’éthanol, comme la canne à sucre ou le
manioc. En revanche, parmi toutes les options de matière première, la canne à sucre est
celle qui présente le plus d’avantages économiques pour l’agriculteur. Le coût de
production de la canne est très bas par rapport à d’autres cultures, et également par rapport
au sucre produit à l’étranger, à partir surtout de la betterave.
De ce fait, soutenu par des investissements de la Banque Centrale Mondiale, le
projet se concentre sur l’expansion des zones cultivées avec la canne à sucre et
l’implémentation des distilleries d’alcool.
Afin de mieux comprendre comment le Proálcool a fait du Brésil le principal
producteur mondial d’alcool et défenseur inconditionnel de son utilisation, il va falloir voir
en détail l’évolution historique du programme. Le Proálcool peut être divisé en cinq phases
47 La période coloniale s’initie en 1500, année de l’arrivée des Portugais au Brésil, et finit en 1822, avec l’indépendance du pays.
37
distinctes48: la phase initiale (1975-1979), la phase de l’affirmation (1980-1986), la phase
de stagnation (1986-1995), la phase de redéfinition (1995-2000), et la phase actuelle (2000
jusqu’à nos jours).
Lors de la phase initiale, l’effort a été orienté vers le mélange de l’éthanol non
dénaturé (pur) avec l’essence. Comme nous l’avons déjà précisé précédemment, il y a deux
types d’éthanol, le non-dénaturé ou pur, qui présente un niveau très faible d’eau dans sa
composition (0,5%), et le dénaturé, présentant un degré de 5% de l’eau. L’éthanol dénaturé
exige un moteur spécialement conçu pour son utilisation, soit un moteur à alcool ou à
VCM (Véhicule à carburant modulable), alors que l’éthanol pur peut être utilisé dans
n’importe quel type de moteur.49 Cela explique pourquoi dans un premier temps la
production de l’éthanol non-dénaturé a été la plus encouragée.
Dans cette première phase, la production d’alcool est passée de 600 millions de
litres par an en 1975/76 à 3,4 milliards de litres entre 1979/80. Elle a été marquée aussi par
le début de la production de véhicules roulant exclusivement avec de l’alcool, en 1978.50
La deuxième phase, dite « d’affirmation » (1980-86) a été influencée par le
deuxième choc pétrolier, entre 1979 et 1980. Le pétrole a représenté 46% des importations
brésiliennes en 1980. Face à ce scénario, le gouvernement a choisi d’adopter des mesures
plus efficaces visant à une implémentation pleine du programme. Par conséquent, la
production d’éthanol a atteint un niveau inédit en 1986/87, de 12,3 milliards de litres, et la
proportion de voitures à alcool fabriquées dans le pays, par rapport au total de voitures de
passagers, est passée de 0,46% en 1979 à 76,1% en 1986.
Suite à cette phase d’euphorie, le programme a connu une période de stagnation de
1986 à 1995. À partir de 1986, le marché international du pétrole est encore bouleversé,
mais cette fois-ci par une forte chute des prix du combustible fossile, période connue
comme « le contre-choc pétrolier ». Les prix « bon marchés » remettent alors en cause la
48 Ici, on reprend la division chronologique élaborée par la revue électronique spécialisée en biocarburants « Biodieselbr.com », disponible en http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm. 49 Système d’alimentation et carburation d’un moteur à explosion, en lui permettant d’utiliser indifféremment des carburants aussi variés que l’essence, le bioéthanol ou un mélange des deux pour un taux d’éthanol compris entre 0 et 85%. 50 Revue biodieselbr.com. http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm
38
plupart des programmes mondiaux de promotion d’énergies renouvelables, par exemple en
Europe, comme nous l’avons constaté dans le chapitre précédant.
À côté de ce nouveau panorama international, la production brésilienne d’éthanol a
subi les effets d’une grande récession économique, de sorte que la plupart des subsides
gouvernementaux dispensés à cette fin ont été suspendus. De ce fait, confrontés à une forte
concurrence des produits pétroliers et à une élévation des coûts de production, les
agriculteurs étaient moins attirés par ce type de culture.
A contrario, la demande continuait d’être stimulée chez les consommateurs, à
travers une politique de maintien des prix abordables de l’alcool par rapport à l’essence, et
aussi, des impôts réduits pour les voitures roulant avec l’éthanol. Cet écart entre offre et
demande a été responsable d’une crise d’approvisionnement entre 1989/90 qui a abouti à
une diminution de la demande lors des années suivantes, et par conséquent, de la
production de véhicules à alcool.
Cette crise n’a été surmontée qu’après l’introduction sur le marché d’un
combustible constitué d’un mélange de 60% d’éthanol dénaturé, 34% de méthanol et 6%
d’essence. Cette viabilité a inauguré la phase suivante de « redéfinition ».
La quatrième phase (1995-2000) a été marquée notamment par la libéralisation du
marché, dans toutes les phases de production, distribution et revente. Désormais, les prix
sont déterminés par les seules conditions de l’offre et de la demande. Les subsides sont
finis et le gouvernement n’est plus en charge de la gestion du secteur qui doit trouver lui-
même les mécanismes d’autorégulation afin d’approvisionner le marché interne et externe.
Bien que le marché ait été libéralisé, le gouvernement n’a pas cessé d’établir des
mesures de promotion du bioéthanol. Par le biais d’un décret du 20 mai 199851, le Pouvoir
exécutif a imposé un niveau contraignant de mélange de l’alcool non dénaturé avec
l’essence, de 22% (E22). Dans la pratique, ce niveau de mélange est modifié par des
mesures réglementaires, en fonction des taux d’approvisionnement de l’éthanol dans le
51 Nomenclature en portugais: Medida provisória nº 1.662
39
marché. Depuis juillet 2007, il était établi à 25% (E25) et, après un règlement du 1er
octobre 2011, le mélange obligatoire est passé à 20% (E20).
La phase actuelle est caractérisée par une nouvelle vague d’expansion de la culture
de la canne à sucre, orchestrée par l’initiative privée convaincue du rôle primordial des
biocarburants en tant qu’alternative aux combustibles fossiles, pas seulement dans le
Brésil, mais partout dans le monde. Le résultat est l’extension de la culture au-delà des
zones traditionnellement exploitées, comme l’état de Sao Paulo et la région nord-est, vers
le centre-ouest, région du « cerrado »52 (Annexe I).
À partir de 2003, l’introduction sur le marché national de véhicules à carburant
modulable (VCM), prévus pour rouler soit avec de l’essence, de l’éthanol ou avec un
mélange des deux, a renforcé la demande nationale et par conséquent, a contribué à
l’expansion du la production. Du fait de l’adhésion étonnante des consommateurs, presque
tous les modèles de véhicules fabriqués au Brésil présentent l’option à carburant
modulable. La vente de ce type de voiture a déjà dépassé celle de véhicules roulant
exclusivement avec de l’essence.
Quelques chiffres démontrent le bilan positif du Proálcool. Entre 1975 et 2000, en
raison de la substitution contraignante de l’essence par une fraction d’éthanol (allant
jusqu’à 25%) et de la fabrication des véhicules roulant avec de l’alcool, on a réussi à éviter
l’émission de 110 millions de tonnes de gaz carbonique et l’importation d’environ 550
millions de barils de pétrole. En plus, le programme a permis une économie de 11,5
billions de dollars approximativement.53
Actuellement, près de 45% de l’énergie et 19% des carburants sont renouvelables.
Ces chiffres placent le pays dans une position enviée par de nombreux pays qui
recherchent des sources énergétiques alternatives au pétrole54.
52 Espèce de savane arborée qui constitue le 2e plus grand écosystème du Brésil, situé dans la région centrale du pays. 53 Biodieselbr.com. http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm 54 Biocarburants au Brésil. Document en français, publié par l’Agence Nationale du Pétrole, du gaz naturel et des biocarburants. Février 2010. Disponible à http://www.anp.gov.br/?id=470.
40
Néanmoins, le succès de cette politique dans le secteur sucro-alcoolier au cours de
cette dernière phase a été mitigé par des pressions internationales en matière de
développement durable. Plusieurs études (surtout en Europe, comme on l’a pu constater
dans le chapitre 1) ont remis en cause les bénéfices apportés par les biocarburants. Afin de
répondre efficacement aux critiques émises, le secteur s’est concentré sur le
développement de stratégies afin d’assurer que la fourniture de biocombustibles soit
réalisée dans le respect de l’environnement.
Dans la section B) nous reviendront sur ce sujet, à savoir les stratégies mises en
place par les secteurs publics et privés du pays afin de garantir une production durable
d’éthanol. Par contre, nous relèverons qu’il faudrait s’intéresser davantage à la politique en
matière de biodiesel dont la production actuelle est bien au-dessous de la capacité du pays,
faute de la mise en place tardive d’un programme de promotion.
SOUS-SECTION (ii) Le cas des biodiesels : un grand potentiel à être exploité.
Le biodiesel est une dénomination générique employée pour désigner tous les
combustibles issus de la biomasse renouvelable (telles que les huiles végétales et les
graisses animales) utilisés dans des moteurs diesel55. Le biodiesel remplace ainsi le
combustible d’origine fossile (gazole) traditionnellement employé dans ce type de moteur.
L’intérêt de promouvoir un tel remplacement est exactement le même que celui de la
promotion du bioéthanol : la diminution de la dépendance du pétrole.
Le Brésil a un grand potentiel en matière de production de biomasse, en raison de
son extension territoriale et ses conditions propices du sol et du climat. Le biodiesel peut
être extrait de plusieurs matières premières, telles que l’huile de ricin, l’huile de palma, de
tournesol, de babassu, d’arachide et de soja.
Par contre, contrairement au cas de l´éthanol, le pays est loin d’être en position
dominante sur le marché international. Actuellement, l’Union européenne est à la fois le
55 Moteur à combustion interne qui démarre grâce à un taux de combustion très fort, inventé par l’ingénieur allemand Rudolf Diesel entre 1893 et 1897.
41
principal marché consommateur et producteur de biodiesel, étant responsable pour 50% à
60% de la production mondiale, à partir notamment de l’huile de colza56.
Malgré le potentiel présenté par le pays et les avantages reconnus par rapport au
diesel (surtout en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes de carbone), le
biodiesel n’a pas connu le même encouragement que le bioéthanol au Brésil. Bien que la
technologie de fabrication de biodiesel ait été objet de plusieurs recherches et tests au cours
de la deuxième moitié du 20e siècle, le coût élevé était un obstacle pour une production en
grande échelle. En raison de la baisse des prix du pétrole qui a eu lieu à la fin des années
80, il s’est présenté un désintérêt pour la recherche de biocarburants, et les productions
expérimentales ont été suspendues.
Ce n’est qu’à partir des années 2000 que le gouvernement fédéral a connu à
nouveau un intérêt pour le développement de techniques de production de biodiesel. Le
Programme national de production et l’usage du biodiesel (PNPB) a alors été relancé.
En 13 janvier 2005, la loi fédérale nº 11.097 a établi un niveau contraignant de
mélange du biodiesel au gazole, actuellement de 5% (B5).
Afin d’atteindre l’objectif établi par le PNPB, le pays a dû augmenter sa capacité de
production de 51% jusqu’en 2012. Ceci a été rendu possible grâce à la création de
plusieurs usines. Cependant, selon des estimations, la production des dix premières années
du PNPB (c’est-à-dire, jusqu’en 2015 environ) ne sera pas suffisante pour créer des
excédents destinés au marché extérieur. Elle sera entièrement consacrée aux besoins
nationaux.57
Le biodiesel, ainsi que l’éthanol, présente comme principal avantage être une
source renouvelable moins polluante que le pétrole. En ce qui concerne le bilan
énergétique, c’est-à-dire la différence entre l’énergie fossile dépensée pour la production
du biocarburant et l’énergie renouvelable produite, les résultats du biodiesel sont positifs,
quoique moins avantageux par rapport à l’éthanol.
56 http://www.biodieselbr.com/biodiesel/mundo/biodiesel-no-mundo.htm 57http://www.biodieselbr.com/biodiesel/brasil/biodiesel-brasil.htm
42
Des études effectuées concluent que pour chaque unité d’énergie dépensée (en
joules) pour la plantation du soja sont produites 1,43 unité d’énergie renouvelable. Dans le
cas de l’huile de palme, le résultat est plus positif : de 5, 6358.
Quant à la réduction des émissions de GES (une des principales raisons pour
l’utilisation des biocarburants), le biodiesel présente également des avantages si on le
compare aux combustibles fossiles. Selon des études développées en Europe au cours des
années 2000, considérant le biodiesel produit à partir de l’huile de colza et du soja, on
observe une réduction entre 40% et 60% d’émissions de gaz polluants par rapport au diesel
pur.59
Malgré les avantages présentés et la mise en place d’une politique
d’encouragement, le biodiesel brésilien reste encore confronté au défi de la viabilité
économique de sa production. Le coût de production reste plus élevé que celui du pétrole.
Pour cette raison, la viabilité économique du biodiesel dépend des aides financières du
gouvernement, à travers notamment des subsides fiscaux.
Cet investissement par le biais de subsides est compensé par les autres effets
positifs du biodiesel, tels que la génération d’emplois, les avantages en matière d’émission
de GES et l’indépendance énergétique. Le sujet fait actuellement l’objet de diverses études
scientifiques, dont le but est de calculer le coût de production en fonction de l’huile
utilisée60. C’est la différence de prix par rapport au diesel minéral qui va déterminer le
montant du subside.
D’après le contexte que l’on vient d’exposer, on observe que la production de
biodiesel au Brésil n’est pas aussi développée que celle de bioéthanol, malgré la politique
de promotion mise en place depuis les années 2000. La production nationale couvre à
58 Centre des affaires stratégiques de la Présidence de la République. Cahiers NAE. p 26 et 27. Disponible à http://www.feagri.unicamp.br/energia/cnae_biocombustiveis.pdf 59 Centre des affaires stratégiques de la Présidence de la République. Cahiers NAE. p 31. Disponible à http://www.feagri.unicamp.br/energia/cnae_biocombustiveis.pdf 60 À titre d’exemple, voir le travail « Produção de biodiesel : uma análise econômica”, recherche dont le but est d’identifier le coût maximal de la matière première, pour que le biodiesel puisse être inséré dans le marché national sans la nécessité de subsides. Référence: DINARDI Marcelo Ferreira et al. Produção de biodiesel: uma análise econômica. IV Colloque brésilien de ricin, et I Simposium International d’oléagineux énergétiques, João Pessoa, Brésil, 2010. http://www.cbmamona.com.br/pdfs/BID-31.pdf
43
peine les besoins du marché national, et nonobstant le potentiel à être exploité, il reste un
long chemin à parcourir pour que le produit occupe une place importante dans le
commerce international.
De ces faits, et en raison du faible volume d’échanges entre Brésil et Union
Européenne en matière de biodiesel, nous nous restreindrons à la présentation que l’on
vient d’effectuer sur le panorama général de la fabrication du biodiesel dans le Brésil.
Ainsi, dans la prochaine section (b), consacrée aux discussions sur la durabilité du
biocombustible brésilien, nous reviendrons exclusivement sur l’éthanol.
Dans la section b) nous nous concentrerons sur les différentes statistiques et les
respectives conclusions qui peuvent en être dégagées par rapport à la production d’éthanol,
de sorte à comprendre les efforts entrepris par le Brésil dans le but de rassurer ses
partenaires internationaux.
SECTION B) L’UNION DE LA COMPETITIVITE AVEC UNE PRODUCTION DURABLE DE
L’ETHANOL
Le Brésil est en mesure de produire l’éthanol à des prix très compétitifs dans le
cadre du marché international. Néanmoins, le prix bas n’est pas suffisant pour garantir au
pays un libre accès aux marchés importateurs. Selon la perspective moderne du commerce
international, le libre-échange ne peut plus être priorisé en détriment d’un développement
durable.
En raison de ce nouveau panorama, le Brésil se voit contraint à prouver que sa
production de biocarburants n’entraine pas des risques, ni pour les végétations natives, ni
pour la sécurité alimentaire et en plus, qu’elle soit effectuée dans le respect des droits
sociaux.
Pour accomplir cette tâche, le pays a mis en œuvre un effort conjoint des secteurs
publics et privés (sous-section i) lui permettant de garantir une production nationale
d’éthanol répondant positivement à toutes les contraintes en matière de durabilité (sous-
section ii).
44
SOUS-SECTION (i) L’effort conjoint des acteurs publics et privés
Le commerce international de biocarburants est devenu un sujet d’importance
stratégique pour la politique extérieure brésilienne. Représentants à la fois de l’initiative
privée et du gouvernement fédéral par le biais de la diplomatie, renforcent fréquemment la
vocation du pays en tant que producteur et exportateur d’éthanol. Le but est de convaincre
l’opinion publique internationale que l’éthanol brésilien est une source d’énergie propre et
renouvelable, et que sa production n’entraine pas d’effets négatifs sur l’environnement et
sur le marché d’aliments.
Dans ce contexte, le principal défi est d’établir un débat technique, afin de
démontrer que la production de la canne à sucre est faite dans des zones présentant un
impact faible ou inexistant sur la biodiversité et sur les émissions de GES.
Il faut souligner tout d’abord le rôle joué par les entreprises et investisseurs privés à
cet égard. Parmi les actions entamées, on peut citer la promotion pure et simple du
bioéthanol national, mais aussi l’organisation de débats autour de l’élimination des
barrières tarifaires et non tarifaires, ainsi que la recherche d’investisseurs pour le secteur.
Bien évidemment, la raison principale de cet activisme est la volonté d’accroître leurs
propres profits. En tout cas, une partie de ces profits sera renversée dans l’économie, en
promouvant une plus grande circulation des richesses.
Comme exemple concret des efforts entrepris par l’initiative privée, on peut citer le
travail de l’UNICA61, l’association représentant la branche du secteur sucrier, qui exécute
une tâche remarquable en ce qui concerne la divulgation internationale du biocarburant
brésilien. L’UNICA a installé deux bureaux de représentation à l’étranger : un à Bruxelles
et l’autre à Washington, aux États-Unis, deux points stratégiques car proches des
principaux marchés consommateurs de biocarburants62.
Selon ses propres mots, la mission d’UNICA consiste à jouer un rôle moteur dans
la consolidation de l’industrie brésilienne de canne à sucre en tant que complexe agro-
61 Association brésilienne des industries de canne à sucre. 62 TAINO, Fabiano dos Reis. “Tarifas internacionais como barreiras à exportação de biocombustíveis brasileiros” , Dissertation (Master) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, État de Goias, Brésil, p. 70.
45
industriel équipé pour faire entretenir une concurrence durable.63 Dans ce but, l’UNICA
participe à divers événements et débats liés au secteur énergétique. Elle pratique un vrai
lobby international en vue de démontrer les avantages économiques, sociaux et
environnementaux de la canne à sucre par rapport à d’autres sources.
Un exemple de cette action est la réponse adressée à la Commission européenne par
l’UNICA, à l’issue d’une consultation du public sur le changement indirect de l’utilisation
des sols (ILUC), lancée par l’UE le 30 juillet 201064. Parmi ses commentaires, l’UNICA
renforce la nécessité d’un dialogue multilatéral en matière de critères de durabilité,
imposables à des biocarburants produits en dehors de l’UE. À ce propos, elle affirme :
« la question du changement indirect de l’utilisation des sols (ILUC) ne peut pas être traitée de
manière isolée de la dynamique de l’agriculture globale et des facteurs plus larges qui peuvent
conditionner la déforestation (y compris l’exploitation forestière illégale et l’établissement
d’ouvriers agricoles sans terre) »65
D’autres associations cherchent à assurer le même objectif, c’est-à-dire,
promouvoir le biocarburant brésilien dans le marché extérieur. Un autre exemple est
l’UDOP (Union des producteurs de bioénergie) qui organise des événements au Brésil et
invite des participants étrangers. Les deux associations citées ne sont pas les seules. Elles
servent néanmoins d’exemple de l’effort effectué par les acteurs privés à cet égard,
initiative qui est valorisée et encouragée par le gouvernement brésilien.
Conjointement à l’actuation du secteur privé, le gouvernement fédéral et la
diplomatie renforcent le lobby en faveur du bioéthanol brésilien. Dans le souci de répondre
efficacement aux critiques remettant en cause la durabilité de biocombustibles, une série
d’actions a été entreprise afin de prouver l’engagement du pays dans le respect à
l’environnement.
63 “UNICA’s mission is to play a leading role in the consolidation of the Brazilian sugarcane industry as a modern agro-industrial complex equipped to compete sustainably », Comments by the Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) on the Consultation on Indirect Land Use Change impacts of biofuels. Adressé à la Comission européenne le 29 octobre 2010, p 1.
64 Comments by the Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) on the Consultation on Indirect Land Use Change impacts of biofuels. Adressé à la Comission européenne le 29 octobre 2010.
65 « the issue of ILUC cannot be treated in isolation of world agricultural dynamics and broader deforestation drivers (including illegal logging, landless settlements, etc.), idem, p. 2.”
46
Tout d’abord, on peut citer l’annonce du Plan National sur le changement
climatique66, lors de la 15e conférence des parties de la Convention-Cadre de l’ONU sur les
changements climatiques (COP – 15), à Copenhague. Ce plan prévoit des objectifs
ambitieux pour la réduction de la déforestation de l’Amazonie, du cerrado et la restauration
des pâturages. Il estime également une diminution des émissions de GES de 36.1% à
38.9% jusqu’en 2020.
Une autre initiative importante fut l’adoption du Zonage Agro-écologique de la
canne à sucre, élaboré par le Ministère de l’Agriculture en septembre 200967. Le zonage
détermine, à l’aide des images via satellite, quelles zones sont aptes pour l’expansion de la
culture de la canne.
Il exclut toutes les zones riches en biodiversité, y compris l’Amazonie, le
Pantanal68, le Bassin du fleuve Paraguay, les zones de végétation native, comme les
pâturages du Pantanal, les zones soumises au régime légal de « protection
environnementale », les terres des Indiens, les dunes, mangroves, zones urbaines et celles
qui font l’objet d’une reforestation.
Par conséquent, le zonage indique les régions les plus adaptées pour recevoir la
production de canne à sucre. Il s’agit des zones actuellement consacrées à une production
agricole intensive ou semi-intensive, à des cultures spécialisées et les pâturages. Ces zones
ont été classées en trois groupes selon leurs potentiels (élevé, moyen et bas), en fonction du
type de sol, du climat et de l’usage qui est fait du sol (pour l’agriculture, bétail, etc).69
Les résultats obtenus démontrent que le pays possède encore 64,7 millions
d’hectares de terres aptes pour l’expansion de la production de canne, dont 19,3 millions
sont considérés comme un potentiel productif élevé.
66 Plan national sur le changement climatique. Document en portugais: http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/169_29092008073244.pdf
67 Document en portugais disponible à: http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/ZonCana.pdf 68 Ecosystème situé au centre du Brésil, caractérisé par une immense plaine alluviale et une des plus grandes zones humides de la planète. 69 Zonage Agroécologique de la canne à sucre, Ministère de l’agriculture, p. 29. Document en portugais disponible à: http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/ZonCana.pdf
47
À partir de ces estimations, l’étude conclut que le Brésil n’a pas besoin d’intégrer
des nouvelles zones de végétation native afin de remplir les exigences du marché interne et
externe des biocarburants. En outre, il affirme qu’il existe encore de marge pour
l’expansion de la culture de la canne, sans que les terres utilisées pour la production
d’aliments soient affectées.70
Certains résultats des politiques menées en matière de déforestation peuvent déjà
être soulignés. Selon le document précité élaboré par l’UNICA71, entre 2004 et 2009, la
déforestation de l’Amazonie a baissé de 75%. Dans la même période, le territoire consacré
à la plantation de canne à sucre a connu des expansions régulières. Le croisement de ces
données permet de percevoir la contradiction du discours qui associe de manière
systématique l’utilisation du sol pour la production de biocarburants et la déforestation.
Un autre point visible de la stratégie internationale de promotion externe des
biocarburants est l’ensemble des discours des chefs d’État brésiliens, surtout lors de visites
officielles à l’étranger. L’ancien président de la République, Luis Inacio Lula da Silva, a
été célèbre pour savoir mettre ses dons rhétoriques au service de la promotion des
biocarburants. Dilma Roussef, qui lui a succédé, suit le même chemin que son
prédécesseur, en plaçant le sujet au centre des tables de négociation avec les pays tiers.
Pour illustrer nos propos, lors de la récente visite officielle au Président des États-Unis,
Barack Obama, les biocarburants faisaient partie de l’ensemble de sujets stratégiques
abordés dans la réunion.72
Le corps diplomatique brésilien est aussi une entité centrale dans le développement
du commerce international des biocarburants, en mettant systématiquement l’accent sur la
durabilité des produits nationaux. À titre d’exemple, il est intéressant d’observer le
discours de l’ancien ministre des Relations extérieures du Brésil, M. Celso Amorim.
Interviewé pour le documentaire « Le monde selon Brasilia », il résume en quelques mots
70 Extrait en portugais: “Estas estimativas demonstram que o país não necessita incorporar áreas novas e com cobertura nativa ao processo produtivo, podendo expandir ainda a área de cultivo com canade-açúcar sem afetar diretamente as terras utilizadas para a produção de alimentos. » Page. 7 du Zonage Agro-écologique de la canne à sucre. 71 Comments by the Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) on the Consultation on Indirect Land Use Change impacts of biofuels. Adressé à la Commission européenne le 29 octobre 2010, p.3.
72 http://bricsnwd.com/tag/etats-unis/
48
le mécontentement du Brésil à l’égard des mesures de contrôle de durabilité imposées par
l’Union européenne :
« la restriction de l’éthanol brésilien ou de l’éthanol produit en Afrique pour des raisons
écologiques ou sociales est totalement hypocrite. L’éthanol ou plutôt la canne à sucre est plantée en
gros dans le centre-sud et dans le centre-ouest du pays. La canne à sucre occupe 0,14% du
territorial national, soit 1% des terres cultivables du Brésil. Par ailleurs, la production de l’éthanol
au Brésil a augmenté dans les mêmes proportions que la production de céréales. Rien à avoir avec
l’Europe où planter des grains de tournesol pour fabriquer du biodiesel va finir avec la culture de
l’artichaut ou je ne sais plus quel légume. C’est pourquoi il s’agit une fois encore du
protectionnisme.»73 (06 :13 à 07 :07)
En outre, lors du même interview, M. Amorim défend fermement la faiblesse des
arguments selon lesquels la production des biocarburants au Brésil puisse augmenter la
faim dans le monde ou la déforestation, en les qualifiant d’« hypocrites ».
Jusqu’à présent, la politique extérieure brésilienne est orientée dans une logique de
persuasion par la voie diplomatique. Néanmoins, le ton ferme de ces quelques discours
laisse entendre que le pays pourrait avoir recours à des moyens juridiquement plus
efficaces contre certaines barrières entravant le commerce de biocarburants, par exemple,
porter plainte devant l’OMC.
Après avoir parcouru les initiatives de la politique brésilienne de promotion de
biocarburants, nous verrons ensuite que, malgré l’absence d’un programme national de
certification de la durabilité des biocarburants, plusieurs recherches proposent des
méthodes d’évaluation de leurs impacts environnementaux.
SOUS-SECTION (ii) Le défi d’évaluation de la durabilité face à l’absence d’un
programme de certification
Le Brésil est dans la voie de développer son propre système de certification de
biocarburants, à l’exemple de l’UE. Malgré tous les efforts mis en place par les secteurs
73 Documentaire « Le monde selon Brasilia », disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=MrEHoUbSe14. 06’13’’ à 07’07’’
49
publics et privés dans le but d’atténuer la méfiance par rapport aux biocombustibles
nationaux, l’absence d’un programme d’évaluation de leur conformité environnementale
est regrettable. Conscient de ce handicap, l’ex-président de la République avait déjà énoncé
que « les biocarburants du pays seront conformes aux normes environnementales, sociales
et du travail, à travers un programme national de certification ».74
Le premier pas concret vers l’élaboration d’un tel programme remonte aux
engagements pris dans le cadre du groupe de travail tripartite dont font partie le Brésil, la
Commission européenne (en tant que représentante de l’UE) et les États-Unis.75 Ce groupe
a été établi depuis 2007, lors d’une conférence organisée par la Commission européenne.
Les participants ont convenu que l’absence de standards concernant les biocarburants
pourrait entraver la libre circulation de marchandises entre les trois régions concernées.
Le travail consistait alors à comparer les standards utilisés par les organismes de
normalisation de chacune de ces régions et, en fonction des différences trouvées,
recommander des rapprochements, dans le but d’une harmonisation. S’agissant du Brésil,
l’organisme de normalisation qui a pris parti dans ce groupe tripartite était l’INMETRO76.
Cette initiative a abouti à la publication d’un rapport intitulé « Papier blanc » (White Paper,
selon l’original en anglais), qui synthétise les acquis du groupe.
Il est important de souligner que l’harmonisation envisagée ne concernait pas les
critères de durabilité. En fait, il s’agissait d’aligner les standards relatifs à la formule, la
composition et les niveaux de mélange du bioéthanol et biodiesel. Néanmoins, c’est suite
aux travaux du groupe, que l’on a ouvert la voie pour l’élaboration d’un programme
volontaire de certification en matière de durabilité de biocarburants.
Cette tâche a été confiée à l’INMETRO qui a créé le Programme d’évaluation de la
conformité de l’éthanol biocombustible. Il s’agit clairement d’une réponse aux
74 Make certification work for sustainable development: the case of biofuels. United Nations Conference on Trade and Development Making, United Nations, New York and Geneva, 2008, p 9.
75 Tripartite Task Force, Brazil et. Al. 2007. Disponible à : http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Meetings%20and%20Events/ANSI%20Biofuels%20Standards%20Panel/Tripartite%20Task%20Force%20Report/Internationally%20Compatible%20Biofuel%20Standards.pdf 76 Institut National de Métrologie, Qualité et Technologie.
50
préoccupations quant aux éventuels impacts négatifs de l’expansion de la canne à sucre au
Brésil, et vise à faciliter l’exportation du bioéthanol, notamment vers le marché européen
(le marché ayant plus d’importance stratégique pour les producteurs brésiliens). Pour cette
raison, le programme devra se conformer, dans une certaine mesure, avec les critères de
durabilité spécifiés dans la Directive européenne 2009/28/CE.77 De ce fait, il sera basé sur
quatre axes: les conditions de travail, la biodiversité, l’eau et l’air, et l’usage rationnel de la
biomasse.
Une proposition du texte final (du Règlement instituant le Programme d’évaluation
de conformité de l’éthanol combustible) a été soumise à consultation publique le 7 août
2008, dans le but d’être enrichie par les contributions apportées par la société78. De plus,
des essais pilotes avec trois usines ont été faits. Quoique son implémentation fût prévue
pour 2009, on attend encore l’approbation du texte définitif par le gouvernement fédéral.
Malgré l’état avancé des travaux, la lourdeur bureaucratie brésilienne empêche
l’aboutissement de cet important projet.
En attendant l’avènement d’un cadre unique d’objectifs d’évaluation de durabilité,
plusieurs études scientifiques se sont concentrées sur le calcul des émissions de GES lors
du cycle de vie de la canne à sucre et de l’impact du changement de l’utilisation des sols.
Nous avons choisi de présenter les résultats de deux études différentes sur cette même
problématique, tous publiés par des revues spécialisées en politique énergétique et élaborés
par des chercheurs experts dans le domaine.79
La première étude, que l’on utilisera comme référence, est celle développée par le
Centre Interdisciplinaire de planification énergétique, de l’Université de Campinas, Brésil,
77 JANSSEN Rainer et RUTZ Dominik. Sustainability of biofuels in Latin America: Risks and opportunities. Revue Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 24 février 2011, p 5717 – 5727, p. 5721.
78 Proposition du texte du règlement définitif (en portugais). http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-certificacao-etanol081006.pdf
79 WALTER Arnaldo et al. Sustainability assessment of bio-ethanol production in Brazil considering land use change, GHG emissions and socio-economic aspects. Revue Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 3 septembre 2010, p. 5703 – 5716 Disponible à http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bbb.289/full; MACEDO Isaias et al. Greenhouse gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020, Revue Biomass and Energy 32 (2008) 582-595, publié en ligne le 14 janvier 2008.
51
coordonnée par le chercheur Isaias MACEDO. Son objet est l’évaluation des émissions de
GES et du bilan énergétique final par rapport aux combustibles fossiles.
L’approche méthodologique retenue80 comporte toutes les étapes de production et
distribution, dès la préparation du sol pour la plantation de la canne jusqu’au transport
effectué par des camions vers les centres de distribution (well-to-wheel approach). Du
point de vue géographique, l’étude se concentre sur la région centre-sud du pays,
responsable pour environ 90% de la production d’éthanol. En plus, les données sont basées
sur la récolte de 2008/2009.
Afin de calculer le bilan énergétique, la méthodologie utilisée par Macedo soustrait
le total d’énergie fossile dépensé pendant le cycle de vie de la canne du total d’énergie
renouvelable produit par ce même cycle (comprenant l’énergie issue de l’éthanol lui-même
et de ses coproduits, la bagasse et l’électricité81). C’est la relation entre les flux d´énergie
dépensés et les flux produits qui va déterminer les avantages de la production d’éthanol par
rapport à l’utilisation des carburants fossiles.
Les flux d´énergie fossile pris en compte par l’étude en question sont les suivants:
La consommation directe de combustibles fossiles et d’électricité (intrants énergétiques directs) ;
L’énergie supplémentaire requise pour la production des matériaux chimiques utilisés (les fertilisants, la chaux, les herbicides, l’acide sulfurique, les lubrifiants, etc) ;
Emissions issues du brûlage des déchets de la canne, émanées du sol en raison de l’utilisation de fertilisants et herbicides, dégagées par les déchets issus de la récolte et de l’industrie qui retournent au sol.
En ce qui concerne les émissions de GES, l´évaluation des émissions évitées
dépend de la relation entre le total d’énergie renouvelable produite (éthanol, bagasse et
électricité) et la quantité de carburants fossiles remplacés. Bien évidemment, les résultats
obtenus varieront en fonction du taux de mélange qui sera fait avec l’essence (dans le cas
80Basée sur le modèle consolidé et répandu internationalement GREET (The Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Transportation Model). Version 1.8c.0. Argonne National Laboratory(2009).
81 Les moulins peuvent utiliser les excédents de bagasse comme source d’électricité.
52
du Brésil, ce taux peut varier de 22%, pour les moteurs à l’essence, à 100%, pour les
VCM).
Lors de la récolte considérée (2008/09), l’énergie fossile dépensée (pour la
production du sucre et de l’éthanol) a été évaluée en 801 KJ/Kg et l’émission de GES a été
estimée en 255.3 CO2eq/MJ82. Selon les chercheurs, ces résultats ont permis de conclure à
des avantages comparatifs des produits issus de la canne à sucre.
Pour la production du sucre, les émissions de GES sont carrément moins
importantes en comparaison avec la production européenne du sucre de betterave ou le
maïs produit par les États-Unis. Quant à la phase industrielle de production d’éthanol, les
émissions vérifiées correspondent à une réduction d’environ 80% par rapport à l’essence,
si l’on considère un mélange de 22% d’éthanol (E22)83.
L’étude que l’on vient d’aborder n’a pas pris en compte les émissions dues au
changement de l’utilisation des sols. Selon les explications de MACEDO, les données
concernant l’expansion de la plantation de canne indiquent que seulement moins d’1% a
atteint la végétation native.
Toutefois, d’autres études84 rappellent l’importance d’analyser la question de la
durabilité des biocarburants de manière holistique, conjointement à d’autres facteurs, tels
que la structure et la pratique agricole, les impacts du changement de l’utilisation des sols,
les conditions de travail, la déforestation, l’impact éventuel sur la production d’aliments,
ainsi que d’autres questions d’ordre socioéconomique.
82 234 CO2eq/MJ émis pour la production du sucre et 21 CO2eq/MJ émis pour la production de l’éthanol. 83 “Through a consolidated analysis tool and a comprehensive database, we verifi ed the comparative advantages of sugarcane products. For sugar production, GHG emissions were estimated at 234 g CO2eq/kg, which is considerably less than what is verified for beet sugar produced in Europe, for instance. As for anhydrous ethanol, life cycle emissions were evaluated as 21.3 g CO2eq/MJ, which leads to an emission mitigation of 80% (compared to conventional gasoline), considering ethanol use in blends with gasoline (E22). » MACEDO Isaias et al. Greenhouse gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020, Revue Biomass and Energy 32 (2008) 582-595, publié en ligne le 14 janvier 2008 ,p. 530.
84 WALTER Arnaldo et al. Sustainability assessment of bio-ethanol production in Brazil considering land use changes, GHG emissions and socio-economic aspects, Revue électronique Energy Policy 39 (2011) 5703-5716.
53
La deuxième étude de référence propose une autre méthodologie qui tient des
facteurs plus vastes que la première. Elle tient compte des émissions de GES, des impacts
directs du changement des sols et des impacts socio-économiques de plantation de canne
dans les états de São Paulo et Mato Grosso, les deux principaux producteurs du pays. De
plus, le calcul du bilan carbonique prend en considération la distribution de l’éthanol
jusqu’au consommateur final en Europe.
En ce qui concerne les émissions de GES, la conclusion est très proche de celle
présentée par Macedo et al. Les émissions évitées par rapport à l’essence ont été estimées
en 78%, si l’éthanol est utilisé au Brésil et 70% dans le cas où il est exporté vers l’Europe.
En revanche, lorsque la plantation occupe de nouvelles zones qui n’étaient pas affectées à
la production de canne, les émissions évitées sont fortement impactées. En moyenne, la
réduction est d’environ 54,8% (éthanol produit à São Paulo et exporté vers l’Europe). En
fonction de l’usage précédent du sol ou des pratiques utilisées (par exemple, récolte
manuelle par brûlage ou mécanique), ce taux de réduction peut varier entre 2,9% et
106,6%85.
En fait, les deux études rappellent qu’en raison de la grande hétérogénéité des
conditions de plantation au Brésil, une généralisation des résultats n’est jamais possible.
Pour cela, les études essayent de prendre en compte cette variation de paramètres et des
scénarios (liés à la qualité du sol ou aux différentes procédures mises en place) afin
d’élaborer une moyenne. Toutefois, dans les deux estimations, la conclusion générale a été
qu’une portion considérable de la production brésilienne d’éthanol va à l’encontre des
exigences en termes de durabilité86.
85 WALTER Arnaldo et al. Sustainability assessment of bio-ethanol production in Brazil considering land use changes, GHG emissions and socio-economic aspects, Revue électronique Energy Policy 39 (2011) , p. 5712
86 “Thus, taking into account the three aspects here assessed in details, the general conclusion is that a significant share of ethanol production in Brazil can be considered sustainable.” WALTER et al. p, 5715; “For sugarcane ethanol, the environmental benefits are internationally acknowledged (…) but the uncertainties (due to differences among producing units) must be highlighted: The results of the Monte Carlo analysis show that the 90% confidence interval (i.e. 5th percentile and the 95thpercentile) for anhydrous ethanol emissions in the current conditions is 12 g CO2eq/MJ to 35 g CO2eq/MJ.” MACEDO et al. p. 528 et 529.
54
À tire de conclusion partielle de la première partie, il faut observer tout d’abord les
différences remarquables entre les politiques européenne et brésilienne en matière de
promotion de biocarburants. Bien que la production des sources énergétiques
renouvelables soit encouragée par les deux, les Européens se montrent beaucoup plus
méfiants par rapport aux bénéfices proclamés des biocarburants. Le Brésil, en revanche, est
le grand propagandiste des avantages de la biomasse.
Du fait de cette contradiction, le libre-échange entre les deux partenaires peut être
affecté, car l’Europe est prête à utiliser des arguments d’ordre environnementaux pour
justifier l’entrave à l’entrée de certains produits. D’un autre côté, l’UE ne réussira pas à
accomplir ses objectifs en matière de réduction d’émissions de GES dans le secteur de
transport sans avoir recours à l’importation.
Cette gamme de problématiques nous amène à analyser la situation à la lumière des
normes internationales sur le commerce. Ainsi, dans la deuxième partie de ce travail, nous
analyserons les enjeux qui relient le commerce international et le développement durable,
dans le but de déterminer quel compromis serait le plus souhaitable pour les deux
partenaires.
55
PARTIE II) LES ARGUMENTS ÉVOQUÉS PAR L’UE ET BRÉSIL À LA
LUMIÈRE DE L’OMC
Nous nous intéresserons, tout d’abord, à la manière dont l'OMC essaie de rendre
compatibles les règles du libre-échange avec les contraintes d'ordre environnementales,
tout en abordant le discours officiel de l'institution lorsque le droit à un commerce mondial
libre entre en conflit avec le droit à un environnement sain (chapitre 1).
Ensuite, nous entamerons un travail de confrontation proprement dit, entre la
directive européenne et les règles de l'OMC, afin de savoir si les mesures en cause, bien
qu'ayant un effet restrictif aux échanges, peuvent être justifiées à l'égard d'un motif
d'intérêt général exprimé par la protection des ressources naturelles épuisables (chapitre 2).
CHAPITRE 1) Un discours officiel de recherche d’équilibre entre la
protection environnementale et les intérêts commerciaux
Il faudra s’intéresser à la façon dont l’OMC raisonne en matière d’environnement et
changement climatique, caractérisée par la recherche d’un équilibre inclinée vers le libre-
échange (section A), et par le traitement flou dispensé en termes de classification des biens
environnementaux (section B).
SECTION A) UNE RECHERCHE D’EQUILIBRE INCLINEE VERS LE LIBRE-ECHANGE
L’organisation mondiale du commerce a été créée au 1er janvier 1995. Elle est le
reflet des accords de Marrakech, à la suite d’un cycle favorable de négociations (Cycle de
l’Uruguay). Elle a remplacé et refondé l’ancien Accord Général sur les tarifs douaniers et
de commerce (GATT), de 1947, tout en se consolidant comme l’organisme international
responsable pour gérer les échanges commerciaux entre les États contractantes87.
Son objectif principal est de réaliser une libéralisation maximale du commerce
international, à la base des conditions égales pour tous les participants (principe de la non-
87 CARREAU Dominique et JULLIARD Patrick, Précis de Droit International Économique. Dalloz. 4e édition, 2010.
56
discrimination) et des avantages mutuels (réciprocité). Orientée dans ce but, elle est un
centre permanent de négociations qui organise parallèlement des cycles globaux de
négociations en vue d’atteindre d’objectifs plus spécifiques.
Dans un premier temps, l’objet principal de discussion lors de ces cycles était la
réduction des droits de douane. Progressivement, on s’est rendu compte que les barrières
non tarifaires constituaient des entraves beaucoup plus nocives et difficiles d’être
éliminées. Ainsi, les débats se sont concentrés sur les subsides, les exigences d’ordre
technique, réglementaire, sanitaire et environnementale, lorsqu’elles peuvent constituer un
protectionnisme déguisé.
Les influences réciproques entre les règles commerciales et les politiques
environnementales sont un sujet débattu depuis l’époque du GATT88. L’influence
restrictive des mesures d’ordre environnementales se faisait déjà sentir sur le commerce et
l’impact du commerce international sur l’environnement était manifeste. Dans ce premier
temps, le débat se déroulait autour de la question de savoir si ces mesures
environnementales ne constituaient qu’une nouvelle forme de protectionnisme.
Ce débat s’est transformé au cours des dernières décennies. Au lieu de polariser
commerce et environnement, le nouvel agenda de l’OMC cherche à promouvoir la
protection de l’environnement et la croissance durable à travers la libéralisation des
échanges.
Toutefois, ce n’est qu’à partir du cycle de Doha (Cycle de Doha pour le
développement) lancé en 2011 que les questions environnementales sont incluses
explicitement dans les négociations commerciales multilatérales au sein de l’OMC. Ce
cycle ambitionne de renforcer un soutien mutuel des trois niveaux suivants: l’ouverture de
commerce, le développement et l’environnement. La volonté de renforcer le soutien
mutuel entre commerce et environnement est exprimée dans la déclaration de la
Conférence ministérielle de l’OMC, à Doha, adoptée le 14 novembre 2011.
88 Comme preuve de ses préoccupations, fût crée en novembre 1971 le Groupe sur les mesures relatives à l’environnement et le commerce international, qui n’allait avoir sa première réunion qu’en 1991.
57
Dans le point 31, la déclaration instruit le Comité du commerce de l’environnement
d’accorder une attention particulière aux « effets des mesures environnementales sur
l’accès au marché, spécialement en ce qui concerne les pays en développement, en
particulier les moins avancés d'entre eux, et situations dans lesquelles l'élimination ou la
réduction des restrictions et des distorsions des échanges serait bénéfique pour le
commerce, l'environnement et le développement. »89
Dans ce contexte, le Cycle de Doha poursuit l’objectif de procéder à une grande
réforme de l’OMC, à travers l’accélération de la libéralisation, principalement dans les
domaines de l’agriculture, services et biens environnementaux. Ces mesures visent en
dernière instance à construire un système mondial du commerce plus inclusif pour les
nations en développement, basé sur les prémisses du développement durable. A propos de
ce terme, Alfredo Suarez élabore une définition assez holistique:
« Le développement durable est un processus qui réunit les domaines de l’écologie,
du politique, de l’économique et du social. Il cherche à établir un cercle vertueux
entre ces pôles par la prise en compte des interrelations entre croissance
économique, inégalité, pauvreté, développement industriel et dégradation
environnementale. »90
En synthèse, l’OMC souhaite réaffirmer que la libéralisation des échanges peut
jouer un rôle positif en faveur du développement durable. L’argument derrière cette
affirmation91 est que l’ouverture des marchés faciliterait la répartition efficace des
ressources, la croissance économique, l’augmentation des niveaux de revenus ; facteurs
qui, en retour, ouvriraient de nouvelles possibilités de protection de l’environnement92.
89 Déclaration de la Conférence ministérielle de l’OMC, à Doha, adoptée le 14 novembre 2011. http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm#top 90 SUAREZ Alfredo et SCHNAKENBOURG, Christian. Commerce mondial et développement durable. Editions Hachette supérieur, 2008/2009, p. 87. 91 Présentation de la thématique du commerce et l’environnement à l’ OMC. http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_intro_f.htm 92 Idée basée sur la courbe environnementale de Kusnetz, théorie de l’Économie qui essaie de prouver empiriquement la relation existante entre la réduction de la dégradation de l’environnement et la croissance du revenu par habitant.
58
Toutefois, cet argument du « soutien mutuel » entre commerce et environnement
est l’objet de critiques sévères. Raphaël Kempf, par exemple, affirme que ce discours ne
fait que remplir une fonction idéologique, légitimant le système commercial multilatéral93.
En effet, les dommages environnementaux sont largement attribués au mode de
production et consommation actuel. Alors, comment concilier la croissance économique et
la lutte contre la pauvreté des nations moins développées avec un impact minimal à
l’environnement ? Cela reste une contradiction pour laquelle l’OMC n’offre pas de
réponse. En tout cas, puisque pour l’instant, notre but est d’exposer le discours officiel de
l’institution vis-à-vis la problématique environnementale, nous n’approfondirons pas cette
discussion.
L’OMC ne laisse pas de doutes quant au fait que le développement durable et la
protection de l’environnement figurent parmi ses objectifs principaux. De même, que les
règles commerciales ne s’imposent pas systématiquement sur les normes
environnementales. La difficulté est alors de définir dans quelle mesure l’OMC pourrait
intervenir pour régler les différends relatifs à l’environnement, étant donné qu’elle
constitue un simple instrument de la réglementation commerciale.
Dans ce contexte, un double défi se présente pour l’organisation. D’une part, éviter
que le commerce international ait un impact négatif sur la dégradation environnementale.
À cet égard, puisque l’OMC n’a pas de compétence pour conclure des accords sur la
matière (changement climatique, énergie, émissions de GES, par exemple), il va falloir
qu’elle s’engage à respecter la coexistence de ses règles avec les obligations commerciales
issues des accords environnementaux multilatéraux.
D’autre part, trouver un juste équilibre entre les règles commerciales et les mesures
environnementales des États membres susceptibles d’entraver le libre-échange au nom de
l’intérêt général, le but étant d’éviter une utilisation abusive du mécanisme d’exceptions
prévu par le système OMC.
93 KEMPF Raphael. L’OMC face au changement climatique. Perspectives internationales nº 29. Cerdin Paris I. Éditions Perdone, 2009, p 38
59
Pour certains auteurs, la question peut être analysée à la lumière de la coexistence
de deux ordres internationaux juridiques distincts, celui du commerce et celui du climat.
Dans cette optique, SUAREZ et SCHNAKENBOURG partagent l’opinion selon laquelle
l’OMC ne peut apporter qu’une partie de la solution pour le changement climatique. À leur
avis, il appartiendrait à une institution multilatérale chargée de l’environnement (au sein de
l’ONU, par exemple) de définir comment les nations devraient gérer les externalités
environnementales négatives, y compris dans le domaine commercial. Et il incomberait
ensuite à l’OMC de s’y adapter94. Ainsi, ils affirment que « la réforme du système mondial
multilatéral doit s’accompagner du renforcement de la structure de gouvernance mondiale
relative à l’environnement.»95
En revanche, pour un autre courant, le plus important est de comprendre dans
quelle mesure les règles de l’Organisation mondiale du commerce peuvent contribuer ou
entraver les objectifs en matière d’environnement et changement climatique, sachant que
les liens entre commerce et environnement sont assez vastes et complexes. Il s’agit d’un
courant beaucoup plus critique que celle citée précédemment, car elle part du principe que
la manière dont l’OMC se positionne devant le problème du climat est un fait, une réalité,
que l’on ne peut pas s’empêcher d’analyser. C’est la position défendue par Raphael
Kempf, par exemple.96
Après avoir décrit le discours officiel de l’OMC en ce qui concerne le
développement durable, et les possibles imbrications entre les normes commerciales et
l’environnementales, il va falloir étudier en détail comment les règles et les exceptions
générales prévues par le système OMC tranchent la question environnementale.
Tout d’abord, l’OMC va trancher l’opposition commerce/environnement à la base
d’une recherche de l´équilibre. Elle préconise la mise en balance entre le droit des parties
contractantes de prendre des mesures réglementaires (y compris des restrictions
commerciales), pour réaliser des objectifs de politique générale (par exemple, la
94 SUAREZ Alfredo et SCHNAKENBOURG, Christian. Commerce mondial et développement durable. Editions Hachette supérieur, 2008/2009, p. 103 95 Ibid. 95. 96 KEMPF Raphael. L’OMC face au changement climatique. Perspectives internationales nº 29. Cerdin Paris I. Éditions Perdone, 2009, p. 22.
60
préservation des végétaux) et le devoir de respecter les droits conventionnels des autres
États membres au titre des disciplines commerciales de base.
La recherche de cet équilibre est exprimée dans l’art XX de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui prévoit un cadre d’exceptions permettant aux
États membres de déroger le régime juridique de base (comme la clause de la nation plus
favorisée et le traitement national), sous certaines conditions.
L’article énonce de manière exhaustive la liste de cas qui pourraient justifier
l’adoption d’une mesure affectant la libre circulation, en raison d’un intérêt général majeur.
En ce qui concerne spécifiquement la problématique environnementale, l’art. XX s’en
occupe par le biais des deux alinéas :
- Alinéa b) protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux
- Alinéa g) conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures
sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la
consommation nationales.
Par contre, le seul fait que l’objectif poursuivi par la mesure corresponde aux
intérêts énumérés par ces alinéas n’est pas suffisant. En effet, le chapeau de l’article
énonce les conditions que la mesure restrictive doit remplir pour qu’elle soit considérée
justifiée à l’égard du système d’exceptions. Ainsi, elle ne peut pas constituer un moyen de
discrimination justifiée ou arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. En dernière
instance, il s’agit des mêmes principes fondamentaux qui guident le système OMC de
manière générale, à savoir la non-discrimination, la transparence et la prévisibilité.97
Par conséquent, lorsqu’il est appelé à rendre une décision sur la conformité d’une
mesure restrictive au commerce, l’Organe de Règlement de Différends (ORD) suit un
processus composé de trois étapes: d’abord, il doit constater que la mesure en cause viole
une des règles de l’accord général concernant le libre-échange; ensuite, il observe si la
mesure peut être justifiée (à titre provisoire) à l’égard d’un des intérêts énoncés par les
97 http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_intro_f.htm
61
alinéas de l’art. XX; en cas de réponse affirmative, la troisième phase du processus
consiste à examiner la mesure par rapport aux clauses introductives de l’article; en plus, la
jurisprudence de l’ORD juge la mesure quant à sa nécessité et proportionnalité.
L’interprétation des critères de nécessité et proportionnalité a été expliquée en
détail lors du contentieux des pneumatiques rechapés qui a opposé le Brésil et les
Communautés européennes devant l’ORD. Les juges ont mis en balance la protection du
libre-échange avec une réglementation de l’État brésilien de défense de l’environnement,
« compte tenu de l’importance des intérêts ou des valeurs sous-tendant l’objectif qu’elle
poursuit »98. Ainsi, il faut qu’il en ressorte clairement qu’aucune autre mesure moins
restrictive ne pourrait être aussi efficace en vue d’atteindre l’objectif recherché.
En tout cas, Raphaël Kempf observe que cette recherche d’équilibre tende à
s’incliner vers les intérêts commerciaux en détriment de l’environnement. Quoiqu’il y ait
encore peu de contentieux autour de la question, on peut déjà percevoir cette tendance. En
effet, l’auteur fait remarquer que l’affaire de l’Amiante est le seul, jusqu’à présent, dans
lequel l’Organe d’appel a conclu le balancement en faveur de la mesure d’intérêt général
(dans le cas en question, il s’agissait d’une mesure de protection de la santé)99.
Dans la prochaine section, nous verrons comment l’absence de la classification des
biens environnementaux par l’OMC pose d’obstacles à l’examen de la compatibilité des
politiques en matière de biocarburants vis-à-vis les normes commerciales.
SECTION B) UNE ABSENCE DE CLASSIFICATION DES BIENS ENVIRONNEMENTAUX AU
SEIN DE L’OMC.
Une question préalable à celle de la compatibilité par rapport aux règles de l’OMC
est la classification des biocarburants au sein de l’organisation. Comme on l’a déjà constaté
précédemment, l’OMC s’intéresse aux règles commerciales et aux aspects
environnementaux des réglementations étatiques ayant un effet sur le commerce
98 Brésil – mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés, rapport de l’Organe d’appel, 3 décembre 2007, WT/DS332/AB/R, § 182. 99 Communautés européennes – mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, rapport de l’Organe d’appel, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R, § 175.
62
international. Les accords en matière climatique ou énergétique ne rentrent pas dans sa
sphère de compétence. En plus, le domaine de l’énergie, dont font partie les biocarburants,
n’est pas l’objet d’aucun autre régime international spécifique.
Dans ce contexte, il faut se demander sur quel régime juridique serait applicable
aux biocarburants dans le cadre de l’OMC. Plusieurs possibilités sont envisagées : les
normes de l’Accord général, l’Accord sur les barrières techniques au commerce, l’Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires ou l’Accord sur l’agriculture.
L’application de ces normes, néanmoins, dépend dans une certaine mesure de la
classification qui est faite des biocarburants. La classification ici concerne la question de la
catégorie de produit dans laquelle on peut insérer les biocombustibles (s’il s’agit d’un bien
agricole, industriel ou environnemental, par exemple). Les principaux aspects de ce débat
sont l’objet de vives discussions au sein du cycle de Doha.
Traditionnellement, ils sont placés dans la catégorie de produits agricoles, car ils
proviennent de l’agriculture, à partir de la plantation de canne à sucre, maïs, betterave etc.
En effet, l’éthanol est classifié en tant que produit agricole dans le système harmonisé de
codification de l’OMC. Cela n’est pas du tout avantageux, car il s’agit d’un secteur
fortement protégé, dont les droits de douane sont assez élevés, comme nous l’avons
constaté dans la première partie. En plus et par conséquent, les négociations commerciales
en matière agricole sont habituellement tendues et avancent très lentement, ce qui était
d’ailleurs la principale raison du blocage des négociations au sein du cycle de Doha, qui
redémarrent encore assez timidement.
Le biodiesel, en revanche, est classifié par le système harmonisé en tant qu’un bien
industrialisé, raison par laquelle il bénéficie d’une taxe douanière plus avantageuse que
l’éthanol.
Enfin, certains revendiquent la classification du biocarburant comme un bien
environnemental. Les biens écologiques sont un aspect important du Programme de Doha
pour le développement, qui préconise dans le point 31 de sa déclaration ministérielle
(précitée) qu’il s’agit d’un de ses objectifs « la réduction ou, selon qu’il sera approprié,
l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services
63
environnementaux ». Devant la perspective d’une telle libéralisation, les pays exportateurs
de biocombustibles exercent une forte pression dans le cadre du cycle actuel de
négociations pour faire inclure les biocarburants dans cette classification.
Le Brésil est à la tête de cette réclamation, ce qui semble compréhensible puisqu’il
s’agit du principal exportateur mondial d’éthanol. La libéralisation du marché de
biocombustibles lui serait fortement profitable. Le pays a proposé au Comité du commerce
et de l’environnement, en novembre 2007, que les biocombustibles soient considérés
comme des biens environnementaux soumis à des abaissements des droits de douanes dans
le cadre du Cycle de Doha100.
Le problème est que les membres de l’OMC ont du mal à se mettre d’accord sur
une définition des biens environnementaux et sur une éventuelle liste de ces biens. La
question suscite plusieurs débats au sein du Comité du commerce et de l’environnement de
l’OMC, médiateur des travaux qui œuvrent la conclusion d’un accord sur les biens
environnementaux. Le comité recueille les propositions des Parties contractantes en vue de
l’élaboration d’une liste universellement reconnue101. Pourtant, il reste très difficile à
trouver des paramètres permettant d’identifier ces biens qui soient acceptés par tous.
Par exemple, le critère qui permet identifier comme écologiques tous les biens dont
l’utilisation finale est spécifiquement liée à l’environnement, a été critiqué, car il ne prend
pas en compte que les biens peuvent avoir plusieurs destinations finales102.
D’autres organismes, comme l’OCDE et l’APEC, se sont également concentrés sur
l’élaboration d’une telle définition. En outre, les négociations au sein de l’OMC ont abouti
à une liste provisoire proposée par les États-Unis et l’Union Européenne, qui inclut des
biens tels que panneaux solaires et les éoliennes. Il s’agit de 43 produits identifiés comme
écologiques qui bénéficieraient d’une suppression totale des droits de douane jusqu’en
2013. Les biocarburants n’y sont pas inclus.
100 Website de l’OMC http://www.wto.org/french/news_f/news07_f/envir_nov07_f.htm 101 Synthèse des communications sur les biens environnementaux – Comité sur le commerce et l’environnement de l’OMC, Session extraordinaire, TN/TE/W/63, 17 novembre 2005. http://www.hubrural.org/IMG/pdf/omc_tnte_w63.pdf 102 Ibid., p. 7.
64
Dans tous les cas, l’absence d’une harmonisation quant à la classification des
biocarburants au sein de l’OMC impose d’innombrables inconvénients aux exportateurs.
Malgré le fait qu’il s’agisse des produits similaires, les biocombustibles sont susceptibles
d’être taxés différemment, comme c’est d’ailleurs le cas entre l’éthanol et le biodiesel.
Cela va à l’encontre des règles de l’OMC, notamment les principes de la non-
discrimination et de la nation plus favorisée, selon lesquels les membres doivent appliquer
les mêmes droits de douane à l’ensemble des importations de produits qui sont
substituables.
Face à l’absence d’un régime spécifique, et en attendant la continuation des
négociations dans le cadre de Doha, il ne reste qu’à admettre que les biocarburants doivent
se soumettre au régime général de l’OMC, avec ses règles et exceptions. Et de ce fait, le
lobby international devrait s’intensifier, premièrement en vue d’une uniformisation de la
classification des biocarburants dans le cadre du système harmonisé mais, surtout, dans le
but de l’inclusion de ces produits dans la liste des biens environnementaux.
Néanmoins, cette dernière perspective semble encore loin de se concrétiser, vu que
la position officielle de l’Union Européenne et les États-Unis, les deux géants en ce qui
concerne les négociations commerciales au sein de l’OMC, est dans le sens d’un refus de
l’inclusion des biocarburants dans une telle liste. L’argument est double : d’une part, les
différences entre les divers types de biocarburants (surtout quant à leur réelle contribution
pour la réduction des gaz d’effet de serre) empêcheraient qu’ils soient classifiés de la
même façon ; d’autre part, ils craignent qu’en libéralisant totalement les biocarburants de
première génération (comme l’éthanol maintenant) ceux de deuxième génération qui
deviendront disponible au futur ne bénéficieront pas d’avantages commerciaux103.
Bien évidemment, les principaux pays exportateurs (par exemple, Brésil, Egypte et
Pakistan) font valoir l’inconsistance de ces arguments, en les estimant essentiellement
protectionnistes.
103 http://www.euractiv.com/fr/commerce/biocarburants-commerce-durabilit/article-171967
65
C’est la définition du régime juridique applicable qui va nous fournir les outils
nécessaires pour juger la compatibilité des politiques en matière de biocarburants avec les
règles de commerce.
CHAPITRE 2) Une analyse juridique des enjeux évoqués
Dans le chapitre précédent, nous avons discerné la façon dont l’OMC se saisit des
aspects environnementaux qui peuvent entrer en conflit avec les règles de commerce.
Ensuite, nous avons analysé la problématique de la classification des biocarburants dans le
système harmonisé, question préalable essentielle à la compréhension du régime juridique
applicable à ces produits.
Ces analyses serviront d’outil pour l’examen de la mise en compatibilité de la
politique européenne en matière de biocarburants par rapport aux règles de l’OMC. Cet
examen sera basé d’un côté, par des considérations sur l’octroi des subsides à la production
communautaire (Section A), et d’un autre côté, par la confrontation proprement dite de la
directive européenne 2009/28/CE avec les principes cardinaux et les exceptions générales
du GATT (Section B).
SECTION A) L’ENCADREMENT PAR L’OMC DE L’IMPACT DES SUBSIDES SUR LE LIBRE
JEU DE LA CONCURRENCE
De ce fait, l’examen de la mise en compatibilité de la politique européenne en
matière de biocarburants (notamment, la directive 2009/28/CE) avec les règles du système
OMC va dans une certaine mesure dépendre du régime juridique auquel ces produits sont
soumis. Cela est particulièrement vrai pour l’encadrement juridique des subventions
accordées aux produits nationaux (ou communautaires, dans l’espèce).
Les subsides sont définis par l’article I de l’Accord sur les subventions et mesures
de compensation (ASMC) comme toute contribution financière des pouvoirs publics par
une forme quelconque de soutien de revenus ou des prix, aboutissant ainsi à l’accord d’un
avantage. Le bénéfice accordé à un opérateur économique aura pour effet bien évidemment
de fausser le libre jeu de la concurrence, en détriment des autres opérateurs.
66
En ce qui concerne les biocarburants, puisqu’il s’agit d’une production censée
d’apporter des bénéfices à l’environnement, mais dont le coût est élevé, il n’est pas
étonnant que les gouvernements tendent à encourager les producteurs par le biais des
mesures incitatives, telles que les allègements fiscaux, les subventions et l’imposition de
niveaux obligatoires de mélange avec les combustibles fossiles.
Ainsi, l’article de la directive 2009/28/CE dispose que le respect aux critères de
durabilité sera pris en considération pour l’octroi éventuel des aides financières.
« Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5:
(...)
c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides. »
En fonction du régime juridique appliqué aux biocarburants (bioéthanol ou
biodiesel, par exemple), deux types d’encadrement sont possibles au sein de l’OMC. D'un
côté, il y a les disciplines de l'Accord sur les subventions et mesures de compensation
(ASMC), négocié lors du cycle de l'Uruguay, et d'un autre, les normes contenues dans
l'Accord sur l'agriculture. Faute d'être classés à la fois comme des bien industriels et biens
agricoles, les subsides octroyés aux biocarburants doivent se conformer à la fois à l'ASMC
et à l'Accord sur l'agriculture, le cas échéant.
Ce point exige une remarque supplémentaire : bien que le biodiesel soit classé en
tant que produit industriel, il s'agit à la base d'un produit issu de l'agriculture (notamment,
d'huiles végétales). Un rapport de l’IPC104 fait valoir que beaucoup d'autres produits
industriels ayant d’origine agricole ont été quand même concernés par les dispositions de
l'Accord sur l'agriculture. Pour cette raison, les subventions octroyées à la production ou
consommation de biodiesel peuvent être à la fois réglées par l’ASMC ou l’Accord sur
l’Agriculture.
104 JOSLING Tim, BLANDFORD, David, EARLEY Jane, Biofuel and Biomass subsides in the U.S., EU and Brazil: towards a transparent system of notification. International Food and Agricultural Trade Policy council (IPC) Position Paper, Septembre 2010, p. 19.
67
Ainsi, pour une analyse complète de la politique européenne à l’égard du système
OMC, il serait souhaitable de l’examiner à la fois à la lumière des règles et exceptions
générales du GATT, de l’Accord sur les barrières techniques au commerce, de l’Accord
sur les subventions et mesures de compensation et l’Accord sur l’agriculture, dans le cas
échéant.
La principale question à être tranchée dans ce domaine serait le fait de savoir si la
motivation du subside (relevant de l’intérêt général) devrait être prise en considération afin
d’assouplir la rigueur de l’encadrement légal de ces aides?
Une réponse précise à cette problématique exigerait une analyse minutieuse des
règles encadrant les subventions (par l’ASMC ou l’Accord sur l’agriculture). Cet examen
échapperait au champ d’application de cette recherche, qui par ses dimensions plus
modestes, ne se concentrera que sur l’examen de la conformité de la directive par rapport
aux règles du GATT.
Le sujet relève cependant d’une importance cruciale pour la compréhension des
rapports commerciaux en matière de biocarburants. Étant donné que l’accomplissement
des objectifs contraignants de mélange de biocarburants au secteur de transport semble
irréalisable (au moins, dans un court et moyen terme) sans l’apport d’un soutien financier,
des conflits relatifs aux impacts de ses aides aux échanges devront très probablement
augmenter. En plus, en face de l’absence d’un accord international sur la question, on peut
songer à des débats enflammés à propos de leur conformité au système régulateur du
commerce international105.
Á cet égard, nous partageons de l’avis d’Alan Swinbank, pour qui, idéalement, tous
les pays devraient adopter des subsides pour encourager leur production de bioénergie (ou
au moins, les mêmes moyens de désincitation vis-à-vis les combustibles). Néanmoins,
puisqu’il s’agit d’une utopie difficilement réalisable, l’auteur propose à titre secondaire que
105 In the meantime, the mandates for biofuel use are likely to remain elusive without public financial support. Trade conflicts over the impact of subsidies on trade are likely to increase. In the absence of agreement as to where the impacts of such subsidies fall and their effects on trade, such conflicts are probably going to be heated and disruptive” - JOSLING Tim, BLANDFORD, David, EARLEY Jane, Biofuel and Biomass subsides in the U.S., EU and Brazil: towards a transparent system of notification. International Food and Agricultural Trade Policy council (IPC) Position Paper, Septembre 2010, p. 33
68
l’Union Européenne envisage sérieusement de réduire ses subsides au profit des
biocarburants communautaires106.
Bien que l’on soit d’accord avec la proposition, cela reste très peu réaliste. En tout
état de cause, tous ces enjeux feront très probablement objet des négociations
multilatérales commerciales, par exemple dans le cadre du cycle de Doha.
SECTION B) LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES CRITÈRES DE DURABILITÉ
Afin d’examiner la compatibilité de la directive, nous utiliserons la même technique
décisionnelle de l’Organe de Règlement de Différends de l’OMC, consistant à analyser la
mesure d’abord vis-à-vis les principes généraux du GATT (sous-section i) et ensuite à
déterminer si ces mêmes principes peuvent être dérogés dans le cas concret au nom d’un
intérêt général (sous-section ii).
SOUS-SECTION (i) Une mesure non conforme aux principes généraux du
GATT
La préoccupation de la mise en place d’un cadre d’évaluation de la durabilité des
biocarburants est assez récente, et vient répondre aux inquiétudes concernant le
changement climatique. Dans l’absence de règles internationalement convenues en matière
de certification de biocarburants quant à leur durabilité, chaque pays tende à établir
unilatéralement son propre système de certification.
L’hétérogénéité de critères est susceptible d’entraver le commerce international, car
les exportateurs doivent s’adapter à des normes différentes en fonction du pays
importateur. En plus, il subsiste la crainte que ces règles soient adoptées de façon
arbitraire, de sorte à dissimuler une volonté protectionniste.
L’organisation mondiale du commerce reconnait néanmoins l’importance de
l’établissement de certaines normes visant la protection d’intérêts généraux tels que
106 “Ideally all countries should adopt the same incentives for bioenergy production (or preferably the same disincentives for fossil-carbon emissions), but as the utopia is unlikely to be realized the EU should give serious consideration to reducing its incentives for bioenergy » SWINBANK Alan, EU Policies on Bioenergy and their potential clash with the WTO, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, nº 3, 2009, p. 500.
69
l’environnement. Cette préoccupation est exprimée à la fois par les dispositions de l’art
XX, concernant les exceptions générales, et par l’Accord sur les barrières techniques au
commerce, qui répond à la nécessité d’appliquer les normes techniques tout en évitant un
protectionnisme masqué.
Le défi sera donc de déterminer dans quelle mesure la norme restrictive du
commerce relève exclusivement des intérêts généraux. Concernant les normes européennes
contenues dans la directive 2009/28/CE, on remarque qu’une partie de la littérature
spécialisée garde une certaine méfiance par rapport aux réelles motivations de son
adoption, c’est-à-dire, s’il relève des raisons strictement environnementales sans aucun
intérêt économique sous-jacent, ou si l’on peut constater des traces d’un protectionnisme
vert déguisé.
Avant d’examiner les arguments évoqués par les deux points de vue à la lumière du
GATT, il va falloir, préalablement, rappeler les deux aspects principaux couverts par les
critères de durabilité de la directive : il s’agit de la réduction des émissions de GES
(mitigation minimum de 35% par rapport aux combustibles fossiles jusqu’en 2018 et de
60% à partir de cette date) et de la diminution l’impact issu du changement de l’utilisation
des sols.
Selon l’article 17 de la directive, le respect de ces critères est pris en considération
lorsqu’il s’agit de :
mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux;
mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable;
déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.
Ainsi, les critères énoncés serviront de paramètre pour décider quels types de
biocarburants seront acceptés lorsqu’il s’agit d’accomplir les objectifs contraignants
70
nationaux107. Cela s’appliquant à la fois aux produits internes et importés, seuls les
produits conformes à ces critères seront admis dans le territoire européen.
Tout d’abord, en ce qui concerne le principe du traitement national, selon lequel
aucun produit étranger n’est traité de façon moins favorable qu’un produit national (article
III de l’Accord sur les tarifs douaniers et le commerce - GATT)108, il est possible de faire
un premier constat sans grand effort : les critères imposés par la directive s’appliquent
indistinctement aux biocarburants produits à l’étranger et à ceux d’origine
intracommunautaire. La directive ne fait pas de discrimination directe fondée sur l’origine
du produit.
Par contre, pour quelques auteurs109, ce premier constat est assez superficiel pour
que l’on puisse en tirer des conclusions définitives. En effet, bien que la mesure soit
appliquée indistinctement en principe, il va falloir analyser si, dans la pratique, elle
n’entrainera pas des effets qui seront moins favorables à l’égard des produits provenant de
certains pays membres de l’OMC.
Pour cela, il faut s’interroger sur l’interprétation faite par l’ORD de l’expression
« traitement moins favorable ». Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une différence de
traitement n’est pas forcément prohibée au sens de l’article III:4, sauf si elle entraine un
traitement moins favorable en détriment d’une des parties. Il ajoute, en plus, que ce
caractère de ‘moins favorable’ « devrait plutôt être apprécié en se demandant si une
107 Conformément à ce qu’était exposé précédemment (Partie I :1 :A :ii), les objectifs contraignants correspondent à une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie pour la Communauté et à une part de 10 % de ce type d’énergie destinée au transport, et ce, d’ici à 2020 (considérant 13 de la directive). 108 « Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur ». 109 C’est le cas de MITCHELL Andrew et TRAN Christopher, The consistency of the UE Renewable Energy Directive with the WTO Agreements, Georgetown University Law Center, octobre 2009; et SWINBANK Alan, EU Policies on Bioenergy and their potential clash with the WTO, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, nº 3, 2009, 485-503.
71
mesure modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés sur le
marché en question »110.
De ce fait, la différenciation mise en place par la directive modifie clairement les
conditions de compétition dans le marché en question, dans la mesure où, d’une part, elle
empêche l’accès au marché des produits qui ne répondent pas aux critères établis; et
d’autre part, elle encourage les producteurs locaux à respecter lesdits critères, par le biais
d’aides financières.
D’après MITCHEL et TRAN, le fait d’accorder un traitement moins favorable aux
biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité, affectera davantage un certain
groupe de pays, moins aptes à mettre en place les outils nécessaires pour un tel
accomplissement111.
Dans le même sens, Alan SWINBANK considère que, dans le cas d’un litige
devant l’OMC, les critères de durabilité européens sont susceptibles d’être jugés comme
enfreignant l’article III:4 du GATT112.
Ensuite, l’analyse de la compatibilité avec l’autre principe cardinal du GATT, celui
de clause de la nation plus favorisée, est également très peu aisée. Prévu par l’article I:1 du
GATT, ce principe exige que tous les produits similaires doivent bénéficier d’un même
traitement à la douane indépendamment de son origine113.
L’article en cause prévoit une obligation d’équité. Il empêche l’accord d’un
avantage à un produit provenant d’une partie contractante en détriment d’un produit
110Organisation Mondiale du Commerce, Affaire DS169, Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraiche, réfrigérée et congelée, rapport de l’Organe d’appel (point 137). 111 « It clearly treats certain biofuels and bioliquids differently and unfavorably where they do not meet the land-related sustainability criteria (..) We suggested above that this is likely to be the case, as tropical countries typically produce biofuels and bioliquids that do not meet these criteria, while the EC as a whole, or at the least particular EU members states, are likely to produce biofuels that do.” MITCHELL Andrew et TRAN Christopher, The consistency of the UE Renewable Energy Directive with the WTO Agreements, Georgetown University Law Center, octobre 2009, p. 7. 112 SWINBANK Alan, EU Policies on Bioenergy and their potential clash with the WTO, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, nº 3, 2009, p. 499 113« Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes ».
72
similaire issu d’un autre pays. Ainsi, l’adjectif « similaire » sera la clé pour trancher la
compatibilité.
Si l’on revient à l’analyse de la directive européenne en cause, on remarque que son
texte établit une distinction de traitement des biocarburants, fondée sur leur méthode de
production. En effet, c’est la méthode de production qui va définir en dernière instance les
niveaux d’émissions de gaz carbonique et les impacts sur le changement des sols. La
question est alors de savoir si une distinction ayant pour base la méthode de production
pourrait être suffisamment importante, au point d’affirmer qu’il ne s’agit pas des deux
produits similaires.
Af in de répondre à cela, il faut connaître la définition de similarité telle qu’elle est
retenue par l’OMC. Le texte du GATT ne le présentant pas, la jurisprudence de l’Organe
de règlement des différends procède à une interprétation au cas par cas. L’ORD statue
souvent que deux produits sont considérés similaires lorsque, même en face de méthodes
différentes de production, cette différence n’affecte pas les caractéristiques physiques du
produit final114.
En s’appuyant sur cette définition, les professeurs MITCHELL et TRAN concluent
que les biocarburants se distinguant en fonction du critère d’émission de GES ne seraient
pas des produits similaires, puisque les émissions gazeuses créées à partir de leur
combustion sont des caractéristiques physiques. En revanche, les biocombustibles se
distinguant seulement en fonction de l’impact provoqué sur les sols peuvent être considérés
comme des produits similaires, car la terre d’où ils proviennent n’entraine pas des
modifications dans les caractéristiques physiques du produit final115.
114 “two products are not “unlike” under GATT article III:4 by virtue of different production methods, where that sole difference has no impact on the physical characteristics of the final product”. MITCHELL Andrew et TRAN Christopher, The consistency of the UE Renewable Energy Directive with the WTO Agreements, Georgetown University Law Center, octobre 2009, p. 4 115 Ibid.
73
L’OMC a toujours été peu enthousiaste à admettre que des préoccupations d’ordre
éthique concernant la façon dont le produit est fabriqué puissent être pertinentes lorsque
cela n’entraine pas du tout de manifestation physique dans le produit final116.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit du critère sur les émissions de GES, la directive
serait conforme avec les spécifications du GATT. À contrario, un refus d’importation ayant
pour base le changement des sols provoqué par les biocarburants pourrait être contesté
devant l’OMC. Et cela parce que cette différence de traitement est susceptible d’affecter
davantage certains pays – ceux qui n’ont pas les moyens de respecter ces critères – que
d’autres, situation discriminatoire contraire aux règles du GATT.
Toutefois, malgré la cohérence du raisonnement, il convient d’introduire ici la
critique élaborée par Alan Swinbank : même en admettant que les émissions de GES soient
susceptibles, en principe, de modifier les caractéristiques physiques du produit final,
comment argumenter qu’un biocarburant qui mitige l’émission de GES en 34% (pas
conforme à la directive) n’est pas un produit similaire à un autre qui atteint un taux de
mitigation de 35% (conforme à la directive)? D’après l’auteur, il sera très difficile de
soutenir cet argument lors d’un éventuel litige devant l’OMC.
En plus, l’article I:1 exige encore que les avantages octroyés au produit d’une partie
contractante doivent être étendus « immédiatement et inconditionnellement » à toutes les
autres parties. De ce fait, pour qu’un biocarburant jouisse de l’avantage accordé par la
directive (à savoir, le fait de pouvoir compter pour l’accomplissement des objectifs
contraignants en matière d’énergies renouvelables), il faut respecter les conditions de
durabilité. Ainsi, l’octroi de l’avantage ne remplit pas l’exigence d’inconditionnalité.
D’après ce contexte que l’on vient d’évoquer, on peut conclure que les dispositions
de ladite directive concernant les critères de durabilité imposés ne seraient pas conforme
aux règles générales du GATT. Néanmoins, l’analyse de compatibilité d’une mesure
interne par rapport à l’encadrement juridique de l’OMC va bien au-delà.
116 SWINBANK Alan, EU Policies on Bioenergy and their potential clash with the WTO, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, nº 3, 2009, p. 498.
74
En effet, la prochaine étape sera de déterminer si, malgré la constatation que la
mesure en cause entrave les échanges commerciaux, elle ne relève pas du champ
d’application du système d’exceptions générales prévu par l’article XX. Un tel système
permet de déroger aux règles générales du GATT au nom de certains intérêts généraux,
parmi lesquels se trouve la protection des ressources naturelles épuisables.
SOUS-SECTION (ii) Une mesure potentiellement justifiée à l’égard du régime
d’exceptions générales
Conformément à ce que l’on a vu précédemment (Partie II:1), l’OMC préconise que
la sauvegarde de l’environnement soit un objectif aussi fondamental que le démantèlement
des barrières aux échanges commerciaux. Le discours officiel de l’organe s’oriente vers le
sens d’un soutien mutuel entre la construction d’un système de libre-échange et non
discriminatoire et les défis de la lutte contre la dégradation environnementale.
La solution juridique proposée par le GATT est l’établissement d’un système
d’exceptions générales, sur lequel les parties contractantes peuvent s’appuyer pour mettre
en place des mesures en principe incompatibles avec ses principes, au nom de quelques
intérêts d’ordre généraux.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le système d’exceptions n’entraine pas
un écart automatique des règles générales dès que les conditions de l’article XX sont
remplies. En réalité, la technique utilisée par l’ORD est la recherche d’équilibre entre
l’autonomie des États membres de déterminer leurs propres objectifs environnementaux et
les droits des autres parties contractantes au libre-échange. Ainsi, l’Organe d’appel
rappelle :
« Les Membres de l'OMC disposent d'une large autonomie pour déterminer leurs propres politiques
en matière d'environnement (y compris la relation entre l'environnement et le commerce), leurs
objectifs environnementaux et la législation environnementale qu'ils adoptent et mettent en œuvre.
En ce qui concerne l'OMC, cette autonomie n'est limitée que par la nécessité de respecter les
prescriptions de l'Accord général et des autres accords visés."117
117 États-Unis – Essence, rapport de l'Organe d'appel, RRD 1996, pages 30-31.
75
En fait, cette large autonomie mentionnée dans l’affaire « Essence » est confirmée
par l’affaire « Crevettes », lors duquel l’ORD réitère que les Parties contractantes sont
souveraines pour adopter les politiques nationales qu’elles jugent nécessaires pour protéger
l’environnement118. La seule limite est que la mesure n’entraine pas une discrimination
arbitraire entre les parties contractantes.
L’application de l’article XX par les juges de l’ORD se fait en deux étapes. Tout
d’abord, il faut analyser si la mesure en cause est nécessaire pour atteindre un des motifs
d’intérêts généraux énoncés ; ensuite, il faut que la mesure remplisse les conditions
exprimées dans le chapeau de l’article, à savoir, qu’elle ne constitue pas ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce.
En résume, la mesure sera considérée comme justifiée si elle remplit les quatre
conditions suivantes :
Qu’elle relève d’un objectif légitime (critère de la nécessité);
que la mesure ait un lien de causalité avec l’objectif poursuivi ; que l’application ne soit pas discriminatoire ; que la mesure ne soit pas plus restrictive qu’elle ne devrait pour
atteindre le but (exigence de proportionnalité)
Dans le cas d’un éventuel contentieux concernant la compatibilité de la directive
européenne par rapport aux règles du GATT, le motif d’intérêt général qui pourrait justifier
la mise en place des critères de durabilité serait celui énoncé par le point g), à savoir, la
conservation des ressources naturelles épuisables.
Le dispositif exige que la mesure ait un « rapport » avec la conservation des
ressources naturelles épuisables. La jurisprudence de l’ORD retient un sens assez large
pour l’interprétation de l’expression. Dans l’affaire « États-Unis - Crevettes », l’Organe
d’appel explicite que cela englobe les ressources minérales ou non biologiques qui peuvent
se raréfier, ainsi que les espèces vivantes. Dans une autre affaire119, le sens est étendu pour
118 « Nous n'avons pas décidé que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour protéger les espèces menacées telles que les tortues marines. Il est évident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent ». États-Unis, affaire « Crevettes-tortues », 06/11/98, Rapport de l’organe d’appel, § 185. 119 United States – Standards for reformulated and conventional gasoline. WTO/DS2/AB/R 29, April 1996
76
faire inclure la propreté de l’air. De ces faits, il est fort probable qu’une mesure visant à la
fois, à la protection de certains écosystèmes et à la lutte contre le réchauffement climatique
(comme la mesure en question), rentrerait dans le champ d’application de l’art XX, g).
La prochaine étape dans le raisonnement juridique opéré par l’ORD consiste à
examiner la mesure quant à sa nécessité pour l’accomplissement de l’intérêt protégé, tâche
qui implique un test de proportionnalité conjointement. C’est surtout à ce moment que
l’idée de la recherche d’un équilibre s’exprime, car il s’agit de mettre un place un
processus de mise en balance, définie comme une « opération holistique qui consiste à
réunir toutes les variables de l’équation et à les évaluer les unes en relation avec les autres
après les avoir examinées individuellement, afin d’arriver à un jugement global»120.
L’analyse de la nécessité et de la proportionnalité est assez minutieuse, dans le but
notamment de déterminer s’il n’existaient pas de solutions de rechange moins restrictives
permettant l’accomplissement du motif d’intérêt général. Néanmoins, lors des litiges
opposant les règles de libre circulation à des intérêts généraux non économiques, l’ORD
rarement repousse l’argument d’intérêt général invoqué. En revanche, cette admissibilité
de la mesure n’est que provisoire, car il va falloir encore déterminer si elle n’a pas fait
preuve d’une discrimination arbitraire.
Au regard des critères de nécessité et proportionnalité, il est également probable
que l’imposition unilatérale des critères de durabilité aux biocarburants importés sur le
territoire de l’UE pourrait être justifiée à titre préliminaire. En effet, le fait de subordonner
l’accès au marché par un pays exportateur au respect d’une politique restrictive unilatérale
constitue un élément inhérent des mesures dérogatoires de l’art. XX, et ne doit pas être
considéré comme incompatible avec les normes du GATT.
Ainsi, l’OMC cherche à analyser lors du processus de balancement, si la manière
dont l’application de telles mesures est réalisée, n’entraine pas des discriminations
arbitraires entre les parties contractantes ou s’il ne s’agit pas d’une restriction de caractère
économique déguisée. Ce sont les conditions exprimées dans le chapeau de l’article XX:
120 Brésil – mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés, rapport de l’Organe d’appel, 3 décembre 2007, WT/DS332/AB/R, §182.
77
“Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une
restriction déguisée au commerce international »
Tout d’abord, quant à la discrimination arbitraire, l’Organe d’appel précise dans
l’Affaire « Brésil – pneumatiques réchappés » qu’il faut « procéder à une analyse qui
porte essentiellement sur la cause ou la raison d’être de la discrimination.121» À ce
propos, il va falloir analyser si le fait d’imposer des restrictions basées sur le non-
respect des critères de durabilité entrainera une discrimination à l’égard d’un groupe
spécifique de pays, notamment ceux disposant d’avantages comparatifs pour la
production de biocarburants en raison de leur climat tropical.
Il n’est pas possible d’affirmer avec précision quelle serait la solution retenue par
l’ORD lors d’un tel raisonnement, d’autant plus que cette solution dépendra du recueil
d’informations supplémentaires sur l’application de la Directive. Il faudra rechercher si
l’application concrète de ces normes affectera particulièrement un groupe donné de parties
contractantes. Telle est l’opinion de MICHEL et TRAN, lorsqu’ils analysent la
compatibilité de la directive envers l’OMC122.
D’autres auteurs admettent également que l’article XX pourrait être un moyen de
sortir de l’impasse, sous la condition que les critères de durabilité soient appliqués de
manière non discriminatoire, basée sur des critères scientifiques et dans le cadre de
négociations sérieuses avec des partenaires potentiels. L’opinion est partagée à la fois par
la littérature européenne et brésilienne123.
121 WT/DS332/AB/R, Brésil x Communautés Européennes – cas de pneumatiques réchappés, Rapport de l’Organe d’appel, point 225. 122 “Whether the Directive meets these chapeau requirements requires information on the actual application of the Directive, because the primary focus of the chapeau is on how the measure is applied”. MITCHELL Andrew et TRAN Christopher, The consistency of the UE Renewable Energy Directive with the WTO Agreements, Georgetown University Law Center, octobre 2009, p 10.
123 “At the very least, the package would have to be non-discriminatory, scientifically based and only implemented after serious negotiations with potential suppliers”. Alan Swinbank, p. 501; “A argumentação jurídica pode ser baseada no fato de que configura-se uma violação à exceção prevista pelo artigo XX do GATT, o qual estabelece que poderá haver restrições ao comércio, desde que não sejam aplicadas de maneira que constituam uma discriminação arbitrária ou injustificada”. CORREIA, Bruna de Barros. Requisitos de sustentabilidade para biocombustíveis e as normas do Direito Internacional (titre en anglais: Sustainability requirement for biofuels and the rules of international law). Dissertation soutenu dans le cadre
78
En ce qui concerne la prohibition que la mesure relève d’une restriction déguisée,
l’Organe d’appel a eu l’occasion d’affirmer plusieurs fois que la question pertinente était
celle de savoir si le design, l’architecture et la structure apparente de la mesure révélaient
une intention de dissimuler un objectif commercial d’effet restrictif.
Cela ne semble pas être le cas de la directive 2009/28/CE, dans la mesure où il
existe toute une politique communautaire dirigée vers la promotion des sources
renouvelables, y compris les biocarburants, dans le but principal est de réduire les effets
nocifs du réchauffement climatique. Il serait ainsi extrêmement difficile d’argumenter que
la mesure restrictive était fondée sur des raisons purement économiques.
Dans tous les cas, même si l’examen des règles du GATT et de la jurisprudence de
l’ORD nous permet d’envisager une mise en conformité de la directive basée sur le motif
d’intérêt général qu’elle prétend préserver, une telle affirmation ne peut pas être énoncée
de façon catégorique.
En effet, l’ORD fait peser sur les parties contractantes des contraintes lourdes
lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures de protection de l’environnement ayant pour effet
d’entraver le commerce. À cet égard, la constatation de Raphaël Kempf est intéressant, en
affirmant que la recherche d’équilibre prétendue par l’OMC « se fait le plus souvent au
profit des valeurs commerciales »124. Ce constat est d’autant plus vrai puisque ce n’est que
dans l’affaire Amiante que l’ORD a conclu en faveur des intérêts généraux, à savoir, la
santé.
d’un Master en “Planejamento de Sistemas Energéticos” de l’Université de Campinas, São Paulo, Brésil, 2001 p. 118. 124 KEMPF Raphael. L’OMC face au changement climatique. Perspectives internationales nº 29. Cerdin Paris I. Éditions Perdone, 2009, p 48.
79
CONCLUSION
Le parcours suivi tout au long de ce travail a été caractérisé par une approche
transversale du sujet, en prenant en considération des aspects juridiques, politiques,
économiques, environnementaux et scientifiques qui entourent les relations commerciales
entre le Brésil et l’UE en matière de biocarburants.
Une première constatation ressort claire : les biocarburants offrent une voie
alternative importante aux importations de combustibles fossiles, dans la mesure où ces
derniers, par leur caractère épuisable, présentent des risques à l’approvisionnement
énergétique futur. L’autre danger des combustibles fossiles auquel les biocarburants sont
une alternative concerne les émissions de GES qui sont les principales causes du
réchauffement climatique.
Afin de faciliter la compréhension de l’enchainement des idées conclusives
exposées ci-dessous, nous diviserons cette conclusion en deux sections : la première
concernera l’examen de la mise en conformité des critères environnementaux de la
directive 2009/28/CE avec les règles de l’OMC (a) et une deuxième traitera des solutions
envisageables pour l’avenir, dans les relations commerciales dans le domaine des
biocarburants (b)
a) La mise en conformité des critères environnementaux de la directive
2009/28/CE par rapport aux règles de l’OMC
L’objectif principal établi par ce travail était d’analyser la compatibilité des critères
de durabilité imposés aux biocarburants vis-à-vis les normes de l’OMC. Pour atteindre ce
but, nous avons eu recours au texte du GATT, aux jugements antérieurs de l’ORD et aux
analyses apportées par la littérature spécialisée.
Nous avons suivi la même logique de raisonnement employée par l’Organe de
Règlement des Différends, consistant à déterminer en premier lieu si la mesure en cause
enfreint un des principes généraux du GATT. Comme nous avons pu le constater, le fait
d’imposer unilatéralement des critères de durabilité peut être considéré comme une mesure
affectant les principes cardinaux du GATT, tels que la cause de la nation plus favorisée et
80
le principe du traitement national, même si l’imposition est indistinctement applicable,
indépendamment de l’origine du produit.
Les critères utilisés pour aboutir à une telle conclusion sont au nombre de deux : le
fait que la mesure soit susceptible d’accorder un « traitement moins favorable » à un
groupe spécifique de pays, et qu’elle concerne des « produits similaires ».
Ensuite, en suivant encore le raisonnement de l’ORD, la justification de telle
mesure par rapport à des motifs d’intérêt général a été analysée. À la lumière de l’art XX
du GATT, une mesure restrictive peut être acceptée dans le cas où : a) l’objectif qu’elle
prétend assurer soit légitime, b) il y ait un lien de causalité entre la mesure et l’objectif
poursuivi ; c) elle ne soit pas discriminatoire ; d) il n’y ait pas d’autres moyens moins
rigoureux pour assurer l’objectif.
Cette analyse minutieuse nous a amenés à conclure qu’en vertu de l’objectif
poursuivi, à savoir, les précautions en termes de réchauffement climatique, l’imposition
unilatérale des critères de durabilité par l’UE pourrait être considérée comme une mesure
restrictive au commerce justifiée en raison d’un intérêt général.
Néanmoins, cette affirmation mérite d’être nuancée. En effet, l’ORD a été toujours
exigent lorsqu’il s’agit d’accepter une restriction commerciale au nom d’un intérêt général.
Conformément à ce que l’on a constaté, seulement dans l’affaire « Amiante » une telle
justificative a été retenue, concernant dans l’espèce la protection de la santé des personnes.
Dans tous les autres cas où l’ORD a été conduit à statuer sur la question, bien qu’il
ne repousse pas généralement l’argument de légitimité des objectifs allégués, il procède à
une analyse assez rigoureuse de l‘existence d’une discrimination arbitraire. En réalité, si
l’on vérifie l’historique des décisions de l’OMC concernant des cas similaires, où des
intérêts commerciaux et environnementaux s’opposent, nous pourrions remarquer que
l’institution fait prévaloir les intérêts du libre-échange. Et cela malgré le discours officiel
de l’organe, selon lequel le système OMC est conduit par la recherche d’équilibre entre les
deux intérêts.
Ainsi, pour que les critères de durabilité soient acceptés sans réserve au sein de
l’OMC, il va falloir que leur application soit faite de manière non discriminatoire,
81
basée sur des critères scientifiques et dans le cadre de négociations sérieuses avec les
partenaires en potentiel.
Dans tous les cas, la perspective d’un litige devant l’OMC semble difficile à se
concrétiser. Le Brésil (et d’une façon générale, tous les autres pays producteurs de
biocarburants), même s’il fait preuve d’un mécontentement envers les critères imposés par
la directive, n’a jamais manifesté de manière claire l’intention de porter une plainte devant
l’ORD à ce propos.
Apparemment, le pays a adopté une stratégie plutôt diplomatique. Au lieu
d’attaquer directement la directive européenne, le Brésil s’efforce de convaincre ses
partenaires commerciaux que le biocombustible fabriqué sur son territoire satisfait aux
inquiétudes de la communauté internationale quant aux exigences de durabilité.
Ainsi, le Brésil s’utilise d’autres voies afin de réduire les barrières tarifaires et non
tarifaires imposées aux biocarburants. Il s’agit surtout de la voie diplomatique, par le biais
des négociations menées par exemple, lors du cycle de Doha et au sein du Comité bi-
régional de négociations entre le MERCOSUR et l’UE.
En plus, cet effort (de convaincre l’opinion publique internationale des avantages
du biocarburant national) se concrétise également par l’initiative du secteur privé, comme
le travail de divulgation de l’UNICA (Association Nationale des producteurs de canne à
sucre), ainsi que par l’investissement dans la recherche scientifique destinée à évaluer les
impacts environnementaux de la production de biocarburants telle qu’elle est réalisée dans
le pays.
De toute façon, même s’il est possible d’identifier une volonté protectionniste dans
la directive européenne, surtout dans la mesure où elle permet l’attribution d’aides
financières aux producteurs communautaires, le marché européen de biocarburants ne
pourra pas s’autofournir, et devra avoir recours aux importations.
En effet, l’Europe reste bien au-deçà de ses ambitions quant aux objectifs
contraignants prévus par la directive. Elle n’a même pas réussi à atteindre son but
intermédiaire qui prévoyait une part de biocarburants de 2% dans le secteur de transport en
2005. La part des marchés des biocarburants dans l’UE est parvenue péniblement à 1% fin
82
décembre 2005 et plusieurs pays (dont la Finlande et Danemark) ont reçu des
avertissements de la part de la Commission européenne début 2006 en raison de leur faible
performance125. En plus, au dépit de toute subvention accordée, l’UE ne peut disposer de la
surface de terres arables nécessaire pour atteindre ses objectifs, sans mettre en risque la
sécurité alimentaire.
Par conséquent, s’il est vrai, d’un côté, que l’accès au marché pour le Brésil reste
difficile du fait des barrières tarifaires élevées et des barrières non tarifaires (telles que
l’imposition des critères de durabilité), de l’autre côté, les exportateurs brésiliens peuvent
être convaincus de l’existence d’un marché consommateur européen toujours en
croissance. De plus, le Brésil bénéficie aussi d’un avantage comparatif par rapport à ces
concurrents européens, en raison des conditions des sols et du climat, qui lui permet de
produire le biocarburant, surtout l’éthanol, à un prix très compétitif.
Ainsi, en dehors des solutions par la voie contentieuse, il est possible également de
songer à d’autres alternatives, d‘ordre consensuel, ce que nous exposerons dans la
deuxième section :
(b) Les recours envisageables face aux incertitudes scientifiques et dans
l’attente d’un accord sur l’uniformisation des critères.
Bien que l’OMC affirme que les États sont souverains pour mettre en place des
politiques unilatérales de protection environnementale, la solution idéale serait de retrouver
des alternatives dans un cadre multilatéral de discussion. En effet. Il s’agit d’un défi qui
touche l’ensemble de la communauté internationale.
Si l’UE a l’intention de neutraliser les arguments remettant en cause les critères de
durabilité unilatéralement imposés, il va falloir rechercher une harmonisation de ces
critères qui soit acceptable par tous, sinon pour la plupart des partenaires commerciaux. La
sélection de ces critères pertinents doit être faite de manière multiparticipative, fruit d’une
négociation et non pas imposée.
125 BENANADJI Fadéla, Biocarburants, questions – réponses, E-T-A-I, 2006, p. 9
83
L’OMC elle-même encourage cette prise de décision collective. Dans l’affaire
« Crevettes », l’OMC « a incité ses Membres à renforcer leur collaboration dans le
domaine de l’environnement »126, tout en reprochant aux États-Unis de ne pas avoir
recherché une solution environnementale en concertation avec ses partenaires pour la
protection des tortues de mer.
Quelques initiatives à ce propos ont déjà été développées à l’échelle internationale.
C’est le cas du groupe de travail tripartite dont font partie le Brésil, la Commission
européenne (en tant que représentante de l’UE) et les États-Unis127.
C’est également le cas du « Round Table on Sustainable Biofuels » (RSB), une
initiative mixte ayant la participation directe de quelques États (Pays Bas et Suisse) et des
institutions privées, dont l’objectif est de développer un standard mondial de durabilité
pour la production de combustibles alternatifs, afin d’éviter que la multitude de critères
crée des barrières non tarifaires au commerce international128.
Malgré ces initiatives, les États hésitent toujours à se mettre d’accord sur un
consensus quant aux méthodologies à suivre, en raison des conceptions distinctes du
développement durable et l’existence d’intérêts commerciaux opposés.
Dans le cas de biocarburants, une difficulté supplémentaire s’impose, celle
d’absence de définition scientifique sur la méthodologie d’évaluation du cycle de vie de la
biomasse, des émissions de GES et des impacts sur le changement des sols. Le sujet est
entouré d’incertitudes, car les conclusions doivent être tirées au cas par cas, en fonction des
spécificités de chaque sol, de chaque méthode de production, des cultures qui existaient
avant.
En ce qui concerne la production brésilienne, il est possible d’écarter un certain
nombre de conclusions qui ont été tirées selon des méthodologies et des prémisses pas
spécialement appropriées à la réalité locale. C’est le cas, notamment, sur le fait d’attribuer
la déforestation en Amazonie à l’augmentation de la production de biocarburants. Très
126 http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_intro_f.htm 127 voir note de bas de page 68 128 http://rsb.epfl.ch/page-24898.html
84
fréquemment, on ne tient pas en compte que la forêt amazonienne est située à plus de 1500
km de distance de la zone centrale de production d’éthanol, dans l’état de São Paulo, et que
les conditions climatiques de l’écosystème amazonien ne sont pas du tout appropriées à la
plantation de canne à sucre129.
Dans tout état de cause, il est vrai que cela n’exclut pas le constat que l’extension
de la culture de canne à sucre à des fins énergétique peut avoir des effets négatifs sur le
marché d’aliments et la déforestation en Amazonie, notamment ceux liés à
l’appauvrissement de la biodiversité locale.
Quant à l’exactitude concernant la crainte que la production de biocarburants puisse
entrainer l’augmentation des prix des aliments (et ainsi, favoriser la faim au monde), la
communauté scientifique ne réussit pas à s’en mettre d’accord.
D’une part, une telle conclusion ne peut pas être étendue à toutes les régions du
monde productrices de biocarburants, car des surfaces arables non cultivées existent en
grandes quantités dans plusieurs pays. Au Brésil, par exemple, le Zonage Agro-écologique
de la canne à sucre a constaté l’existence d’un grand potentiel de terres arables à être
exploitées, sans mettre en danger l’approvisionnement des aliments (selon on l’a abordé
dans Partie I:2:B:i).
D’autre part, le lien de causalité directe entre l’utilisation de la terre à des fins
énergétiques et la pénurie des aliments au monde est lui-même objet de critiques. La
hausse des prix des matières lors de la crise économique de 2007 et 2008, par exemple,
habituellement attribuée à l’augmentation de la production de biocarburants, peut en effet
être expliquée par d’autres facteurs130.
129 JANSSEN Rainer et RUTZ Dominik. Sustainability of biofuels in Latin America: Risks and opportunities. Revue Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 24 février 2011, p 5768. 130 Selon BALLERINI, plusieurs raisons ont été prépondérantes, telles que la croissance de l’alimentation carnée au détriment de l’alimentation végétarienne, qui se traduit par une forte croissance de l’utilisation des surfaces agricoles ; la substitution des huiles végétales aux huiles animales en alimentation humaine est de plus en plus apparente ; les mauvaises récoltes régionales, comme en Australie ; et une spéculation non négligeable dans le domaine des matières premières. BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011, p. 26/27.
85
Étant donné ces incertitudes scientifiques dans le domaine, un consensus en matière
de critères de durabilité est très difficile à établir. Il nous reste encore la possibilité
d’analyser la politique de l’Union européenne à la lumière du principe de Droit de
l’Environnement, dit « principe de la précaution». Il a été formulé pour la première fois
lors de la Déclaration de Rio, en 1992, et expose qu’ « en cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte
pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l’environnement»131.
Face à ces hésitations, il ne nous est pas possible d’élaborer une conclusion unique
sur du sujet. N’importe quelle solution, soit par le biais du contentieux devant l’OMC, soit
à travers un processus de négociation multilatérale, doit comporter un nombre divers de
concessions des parties concernées.
Dans tous les cas, il est très vraisemblable que la piste pour résoudre ces
problématiques soit plutôt le développement des recherches en matière de biocarburants de
deuxième génération, de façon à rendre leur exploitation industrielle économiquement
viable. Les biocarburants lignocellulosiques sont réputés de façon presque unanime, pour
être une source renouvelable encore plus propre que ceux de première génération ; ils
échappent également à la plupart des critiques qui touchent le bioéthanol et le biodiesel en
termes de durabilité.
À cet égard, il semble finalement avoir un rare consensus en ce qui concerne les
enjeux de l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques, comme le résume Daniel
BALLERINI : « les biocarburants ne pourront constituer un complément sérieux à la
fourniture d’énergie dans le secteur de transport qu’à la condition de diversifier les
sources d’approvisionnement en matières premières d’origine végétale »132.
131 Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement principes de gestion des forêts. SOMMET PLANETE TERRE Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992. 132 BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011, p.21.
86
BIBLIOGRAPHIE
1) DOCUMENTS OFFICIELS
1.1 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
- Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce
- Accord sur les subventions et les mesures de compensation
- Déclaration de la Conférence ministérielle de l’OMC, à Doha, adoptée le 14 novembre 2011.
- http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm#top
- Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement principes de gestion des forêts. SOMMET PLANETE TERRE Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992.
- Synthèse des communications sur les biens environnementaux – Comité sur le commerce et l’environnement de l’OMC, Session extraordinaire, TN/TE/W/63, 17 novembre 2005. http://www.hubrural.org/IMG/pdf/omc_tnte_w63.pdf
1.2 UNION EUROPÉENNE
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TRAITÉ DE LISBONNE)
- Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
- Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports
- COM(2010) 639 final. Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions - Énergie 2020 : Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre. Bruxelles, le 10.11.2010
- COM(2010) 639 final. Bruxelles, 10/11/2010
- Conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles (8 et 9 mars 2007). http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/93141.pdf
87
- COM 2011(21) final. Communication de la Commission européenne au Parlement Européen et au Conseil. 31.01.2011. Énergies renouvelables, progrès à accomplir pour atteindre l’objectif de 2020.
- COM(2007)2 final. Communication de la Commission du 10 janvier 2007, «Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius - Route à suivre à l'horizon 2020 et au-delà»
- Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC. Commission européenne, SEC(2011) 129 final, Brussels, 31.1.201.
- COM (2006) 848 final
- COM(2006) 0034.
- EU Annual Biofuels Report, 06/11/2010. USDA Foreign Agricultural Service. Disponible à : http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-27_6 11-2010.pdf
- Commission européenne. Les énergies renouvelables font la différence. Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2011.
1.3. DOCUMENTS OFFICIELS DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
- Plan national sur le changement climatique. Document en portugais: http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/169_29092008073244.pdf
- Centre des affaires stratégiques de la Présidence de la République. Cahiers NAE. p 26 et 27. Disponible à http://www.feagri.unicamp.br/energia/cnae_biocombustiveis.pdf
- Biocarburants au Brésil. Document en français, publié par l’Agence Nationale du Pétrole, du gaz naturel et des biocarburants. Février 2010. Disponible à http://www.anp.gov.br/?id=470.
- Zonage Agroécologique de la canne à sucre, Ministère de l’agriculture, p. 29. Document en portugais disponible à: http://www.cnps.embrapa.br/zoneamento_cana_de_acucar/ZonCana.pdf
88
- Règlement instituant le Programme d’évaluation de conformité de l’éthanol
combustible. Proposition du texte définitif (en portugais).
http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-certificacao-etanol081006.pdf
2. LIVRES
- BALLERINI Daniel, Les biocarburants : répondre aux défis énergétiques et environnementaux des transports. Éditions Technip, 2011.
- BENANADJI Fadéla, Biocarburants, questions – réponses, E-T-A-I, 2006.
- CARREAU Dominique et JULLIARD Patrick, Précis de Droit International Économique. Dalloz. 4e édition, 2010.
- KEMPF Raphael. L’OMC face au changement climatique. Perspectives internationales nº 29. Cerdin Paris I. Éditions Perdone, 2009.
- SUAREZ Alfredo et SCHNAKENBOURG, Christian. Commerce mondial et développement durable. Editions Hachette supérieur, 2008/2009.
3. ARTICLES DE REVUES SCIENTIFIQUES
3.1.REVUES EN PAPIER
- HOGOMMAT, Benjamin. Les enjeux de la prise en compte des biocarburants au regard des orientations de la politique agricole commune. Revue juridique de l’environnement, 2010.
3.2 REVUES ÉLECTRONIQUES
- MACEDO Isaias et al. Greenhouse gases emissions in the production and use of ethanol from sugarcane in Brazil: The 2005/2006 averages and a prediction for 2020, Revue Biomass and Energy 32 (2008) 582-595, publié en ligne le 14 janvier 2008.
- WALTER Arnaldo et al. Sustainability assessment of bio-ethanol production in Brazil considering land use change, GHG emissions and socio-economic aspects. Revue Électronique Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 3 septembre 2010, p. 5703 – 5716.
89
- JANSSEN Rainer et RUTZ Dominik. Sustainability of biofuels in Latin America: Risks and opportunities. Revue Energy Policy 39 (2011), publication en ligne le 24 février 2011, p 5717 – 5727, p. 5721.
- SWINBANK Alan, EU Policies on Bioenergy and their potential clash with the WTO, Journal of Agricultural Economics, vol. 60, nº 3, 2009
- MITCHELL Andrew et TRAN Christopher, The consistency of the UE Renewable Energy Directive with the WTO Agreements, Georgetown University Law Center, octobre 2009
4. ARTICLES ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR D’AUTRES INSTITUTIONS
- Nomenclature combinée 2207 10 00. Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff.
- Make certification work for sustainable development: the case of biofuels. United Nations Conference on Trade and Development Making, United Nations, New York and Geneva, 2008.
- JOSLING Tim, BLANDFORD, David, EARLEY Jane, Biofuel and Biomass subsides in the U.S., EU and Brazil: towards a transparent system of notification. International Food and Agricultural Trade Policy council (IPC) Position Paper, Septembre 2010, p. 19.
- Comments by the Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) on the Consultation on Indirect Land Use Change impacts of biofuels. Adressé à la Comission européenne le 29 octobre 2010
- Tripartite Task Force, Brazil et. Al. 2007. Disponible à : http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Meetings%20and%20Events/ANSI%20Biofuels%20Standards%20Panel/Tripartite%20Task%20Force%20Report/Internationally%20Compatible%20Biofuel%20Standards.pdf
- CORREIA, Bruna de Barros et al. The biomass real potential to reduce greenhouse gas emissions: a life-cycle analysis. Universidade Estadual de Campinas, Brésil.
- Rapport d'information n° 52 (2004-2005) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 3 novembre 2004. Sénat français. Disponible à http://www.senat.fr/rap/r04-052/r04-05261.html
90
5. DISSERTATIONS
- TAINO, Fabiano dos Reis. “Tarifas internacionais como barreiras à exportação de biocombustíveis brasileiros” , Dissertation (Master) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, État de Goias, Brésil, 2010.
-
- CORREIA, Bruna de Barros. Requisitos de sustentabilidade para biocombustíveis e as normas do Direito Internacional (titre en anglais: Sustainability requirement for biofuels and the rules of international law). Dissertation soutenu dans le cadre d’un Master en “Planejamento de Sistemas Energéticos” de l’Université de Campinas, État de São Paulo, Brésil, 20111.
6. DOCUMENTAIRE
- Documentaire « Le monde selon Brasilia », disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=MrEHoUbSe14. 06’13’’ à 07’07’’
7. AFFAIRES DE L’OMC
- Affaire DS169, Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraiche, réfrigérée et congelée, rapport de l’Organe d’appel.
- États-Unis – Essence, rapport de l'Organe d'appel, RRD 1996.
- Brésil – mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés, rapport de l’Organe d’appel, 3 décembre 2007, WT/DS332/AB/.
- Communautés européennes – mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, rapport de l’Organe d’appel, 12 mars 2001, WT/DS135/AB/R.
8. SITES INTERNET
- WWW.WTO.ORG
- International Agency of Energy (IEA), World Energy Outlook 2007. Disponible à: www.iea.org/textebase/npsum/WEO2007SUM.pdf
91
- EU rethinks biofuels guidelines, 14 janvier 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7186380.stm
- Banque Centrale du Brésil. http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/PtaxRPesq.asp?idpai=TXCOTACAO
- Site de l’Agence Nationale du Pétrole (Brésil) : http://www.anp.gov.br/?pg=46827&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1337616099368
- Site d’UNICA (Union de l’industrie de cane-de-sucre du Brésil). Cotation dedu prix de la canne à sucre en avril 2012 : http://www.unica.com.br/q10/
- Government Offices of Sweden. http://www.sweden.gov.se/sb/d/10165/a/96322
- Round table on sustainable biofuels. http://rsb.epfl.ch/page-24898.html
- “A verdadeira história do Proalcool” (La vraie histoire du Proalcool), écrit par Luiz Gonzaga proBERTELLI, paru le 16/11/2005 dans le journal « O Estado de São Paulo ». Disponible à http://infoener.iee.usp.br/infoener/hemeroteca/imagens/91040.htm
- revue électronique spécialisée en biocarburants « Biodieselbr.com », disponible en http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm.
- REVUE AGRAPRESSE. http://www.agrapresse.fr/agriculture-societe/vers-une-modification-de-la-classification-douani-re-europ-enne-du-bio-thanol-art326539-13.html
93
TABLE DE MATIE RES INTRODUCTION 1
SECTION A) La biomasse : une alternative appropriée aux combustibles fossiles ................ 1
SECTION B) Des différentes réactions aux critiques émises aux biocarburants .................... 5
PARTIE I) UNE OPPOSITION DE POINTS DE VUE EXPLIQUÉE PAR DES CONTEXTES ET INTÉRÊTS DIVERGENTS ............................................................................................................................ 11
CHAPITRE 1) Uミe politiケue iミtYgヴYe eミ マatiXヴe de Iliマat et d’Yミeヴgie ............................... 11
SECTION A) La difficile conciliation entre le défi énergétique et les contraintes
environnementales .......................................................................................................................... 11
SOUS-SECTION (i) Une politique orientée vers la promotion de sources d’énergie propres
............................................................................... 12
SOUS-SECTION (ii) Le passage d’une politique d’encouragement à une méfiance à
l’égard de la production de biocombustibles. ...................................................................... 18
SECTION B) La ヴeIheヴIhe d’uミ YケuiliHヴe eミtヴe la pヴoduItioミ iミteヴミe et l’iマpoヴtatioミ ................... 26
SOUS-SECTION (i)Une production encore écartée des besoins de la consommation ....... 27
SOUS-SECTION (ii) Un bilan mitigé par le protectionnisme, malgré l’insuffisance de la
production. ............................................................................... 29
CHAPITRE 2) Uミ loHH┞ oヴIhestヴY paヴ le BヴYsil eミ vue d’Yliマiミeヴ les HaヴヴiXヴes IoママeヴIiales contre les biocarburants .................................................................................................................. 33
SECTION A) Brésil : le pionnier et principal promoteur des biocarburants au monde ........ 34
SOUS-SECTION (i) Ethanol : d’une solution provisoire pour la crise pétrolière à une
politique de référence internationale. ............................................................................... 35
SOUS-SECTION (ii) Le cas des biodiesels : un grand potentiel à être exploité. ................ 40
SECTION B) L’uミioミ de la IoマpYtitivitY aveI uミe pヴoduItioミ duヴaHle de l’Ythanol ........... 43
SOUS-SECTION (i) L’effort conjoint des acteurs publics et privés ................................... 44
SOUS-SECTION (ii) Le défi d’évaluation de la durabilité face à l’absence d’un
programme de certification ............................................................................... 48
94
PARTIE II) LES ARGUMENTS ÉVOQUÉS PAR L’UE ET BRÉSIL À LA LUMIÈRE DE L’OMC .. 55
CHAPITRE 1) Uミ disIouヴs offiIiel de ヴeIheヴIhe d’YケuiliHヴe eミtヴe la pヴoteItioミ environnementale et les intérêts commerciaux .............................................................................. 55
SECTION A) Uミe ヴeIheヴIhe d’YケuiliHヴe iミIliミYe veヴs le liHヴe-échange ................................ 55
SECTION B) Uミe aHseミIe de IlassifiIatioミ des Hieミs eミviヴoミミeマeミtau┝ au seiミ de l’oマI.... .......................................................................................................................... 61
CHAPITRE 2) Une analyse juridique des enjeux évoqués ...................................................... 65
SECTION A) L’eミIadヴeマeミt paヴ l’OMC de l’iマpaIt des suHsides suヴ le liHヴe jeu de la concurrence .......................................................................................................................... 65
SECTION B) La mise en compatibilité des critères de durabilité ......................................... 68
SOUS-SECTION (i) Une mesure non conforme aux principes généraux du GATT .......... 68
SOUS-SECTION (ii) Une mesure potentiellement justifiée à l’égard du régime
d’exceptions générales ............................................................................... 74
CONCLUSION ............................................................................................................................ 79
BIBLIOGRAPHIE 86
ANNEXES 92
95
PARTIE I) UNE OPPOSITION DE POINTS DE VUE EXPLIQUÉE PAR DES CONTEXTES ET INTÉRÊTS DIVERGENTS ............................................................................................................................ 11
CHAPITRE 1) Uミe politiケue iミtYgヴYe eミ マatiXヴe de Iliマat et d’Yミeヴgie ............................... 11
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux niveaux de 1990 (ou même de 30% si les conditions le permettent), ....................................................................................................................... 13
améliorer l’efficacité énergétique en 20% .............................................................................................. 13
accroître la part des sources renouvelables à 20% de la consommation totale. ...................................... 13
CHAPITRE 2) Uミ loHH┞ oヴIhestヴY paヴ le BヴYsil eミ vue d’Yliマiミeヴ les HaヴヴiXヴes IoママeヴIiales contre les biocarburants .............................................................................................................. 33
La consommation directe de combustibles fossiles et d’électricité (intrants énergétiques directs) ; ...... 51
L’énergie supplémentaire requise pour la production des matériaux chimiques utilisés (les fertilisants, la chaux, les herbicides, l’acide sulfurique, les lubrifiants, etc) ; ........................................................................ 51
Emissions issues du brûlage des déchets de la canne, émanées du sol en raison de l’utilisation de fertilisants et herbicides, dégagées par les déchets issus de la récolte et de l’industrie qui retournent au sol. 51
PARTIE II) LES ARGUMENTS ÉVOQUÉS PAR L’UE ET BRÉSIL À LA LUMIÈRE DE L’OMC .. 55
CHAPITRE 1) Uミ disIouヴs offiIiel de ヴeIheヴIhe d’YケuiliHヴe eミtヴe la pヴoteItioミ environnementale et les intérêts commerciaux .......................................................................... 55
CHAPITRE 2) Une analyse juridique des enjeux évoqués ...................................................... 65
mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux; 69
mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable; ........................................... 69
déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides. ...................................................................................................................................................... 69
Qu’elle relève d’un objectif légitime (critère de la nécessité); ............................................................... 75
que la mesure ait un lien de causalité avec l’objectif poursuivi ; ............................................................ 75
que l’application ne soit pas discriminatoire ; ........................................................................................ 75
que la mesure ne soit pas plus restrictive qu’elle ne devrait pour atteindre le but (exigence de proportionnalité) .............................................................................................................................................. 75