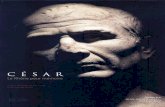(C) 1V74 l>y Les fklitions de Minuit Título original - PhilArchive
Holger Baitinger, L´arivée en Sicile: Sélinonte, l´agora, les sanctuaires et les nécropoles....
Transcript of Holger Baitinger, L´arivée en Sicile: Sélinonte, l´agora, les sanctuaires et les nécropoles....
216
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 4
fréquence dans le sud-est de la France comme le montrent les exemples du dépôt de Montpel-lier, de l’épave de Rochelongue ou de la nécro-pole de Saint-Julien-de-Pézenas.
Il en est de même pour la pendeloque de type crotale, caractéristique du Jura, mais pour laquelle on trouve des parallèles dans le golfe du Lion (dépôt de Rossay, épave de Roche-longue ou tumulus IV du Grand Communal).
La perle en ambre, à défaut d’analyse permettant de déterminer son origine exacte, doit être considérée comme une importation de la Baltique ou des grands centres d’ex-ploitation septentrionaux. Ce type d’objet est un élément totalement exogène en Cata-logne protohistorique et, en regardant la grande concentration d’ambre dans le sud de la France durant le VIIe siècle avant J.-C., il est tentant d’attribuer à cette région le statut d’intermédiaire et de zone de redistribution vers l’ouest. Ainsi, le dépôt met clairement en évidence une relation entre la côte centrale catalane et le midi de la France, en particulier ce que l’on appelle l’aire cultu-relle launacienne.
L’ensemble, en se fondant sur la typolo-gie, peut être daté du HaD1, mais la strati-graphie qui recouvrait le dépôt permet de préciser ce moment et le situer dans le dernier quart du VIIe siècle et le premier
quart du VIe siècle avant J.-C. Sa localisation dans le fond du silo, sur sa base, permet de supposer qu’il s’agit d’un dépôt votif, inter-prétation qui prend tout son sens grâce à deux détails : d’abord le fait que tous les objets ont été déposés à l’intérieur du simpu-lum et ensuite que tous soient entiers (excep-tés les fragments de lingots), fait qui contraste avec la majorité des dépôts launaciens, où la plupart des objets sont fragmentés.
Quoi qu’il en soit, ce dépôt ne doit pas être compris comme un cas isolé dans le golfe du Lion occidental, mais comme un indice de plus qui vient s’ajouter à un catalogue grandissant permettant de définir une dynamique de rela-tions dans le golfe du Lion entre la fin de l’âge du Bronze et le début du Premier âge du Fer.
L’intérêt de ce dépôt, issu d’une fouille stra-tigraphique, est qu’il nous oblige à étendre l’aire géographique de cette toile d’échanges entre le sud de la France et la Méditerranée nord-occidentale en intégrant dans l’analyse historico-archéologique tout le golfe du Lion et ses marges dans le même discours.
(Traduction Mario Marco)
Bibliographie
Graells à paraître a et b ; López et al. à paraître.
Holger Baitinger L’ARRIVÉE EN SICILE : SÉLINONTE, L’AGORA, LES SANCTUAIRES ET LES NÉCROPOLES
Sélinonte – la cité et son histoireSélinonte, située au sud-ouest de la Sicile, près de Castelvetrano, est la plus occidentale des
colonies grecques de l’île ; elle se trouve directement au bord de la mer. D’après Thucydide, Sélinonte fut fondée par des colons doriens venus de Mégara Hyblaea exactement cent ans après sa cité mère, en 628 avant J.-C. Diodore de Sicile, au Ier siècle avant J.-C., mentionne cependant une date de fondation plus ancienne, qui se situerait vers 650.
Ce fut pour les Grecs un grand saut vers l’ouest, puisque Sélinonte se situe à environ 140 km de Géla qui était jusque-là la colonie la plus à l’ouest de la côte méridionale de Sicile. Sélinonte se développe alors loin des autres villes grecques, dans une zone occupée par des peuples indigènes de Sicile : les Sicanes et les Élymes. La cité se trouvait aussi dans le voisi-nage immédiat des sites puniques de Sicile occidentale et nord-occidentale. En ce qui concerne les voies de communication, la situation géographique de Sélinonte était excel-lente, puisque le passage le plus étroit du Canal de Sicile qui sépare l’Europe du continent
4-chapitre 4-mep.indd 216 26/03/13 15:55
217
Du Languedoc à la Sicile CHAPITRE 4
africain ne se trouve qu’à 30 km plus à l’ouest. Le Cap Bon, en Tunisie, n’est qu’à 160 km et facilement accessible en passant par l’île de Pantelleria qui, par beau temps, est visible de Sélinonte. Même la puissante cité de Carthage – qui contrôlait le commerce maritime jusqu’à son conflit avec Rome – était depuis la fondation de Sélinonte à portée des Grecs. Tous ces facteurs devaient jouer un rôle important dans l’histoire de la cité.
En 409 avant J.-C., Sélinonte est attaquée par les Carthaginois, assiégée et détruite – un événement de grande importance. Par la suite, le destin de la cité est relativement changeant, sans qu’elle n’ait jamais pu retrouver son importance initiale. Le repeuplement aux IVe et IIIe siècles avant J.-C. se concentre sur l’acropole, dans la partie méridionale de l’ancienne ville jusqu’à l’abandon définitif du site vers 250 avant J.-C., pendant la première guerre punique.
Plan reconstitué de Sélinonte.
4-chapitre 4-mep.indd 217 26/03/13 15:55
218
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 4
L’acropole de Sélinonte s’élève sur un éperon au-dessus de la mer ; ses flancs sont très raides sur trois côtés et donc faciles à défendre. En bas coulent deux fleuves, à l’ouest le Modione, l’antique Selinos, et le Gorgo Cotone à l’est. À leur embouchure, deux baies profondes, à l’abri du vent, avancent dans l’intérieur du pays, formant un port idéal pour les bateaux en route pour la Médi-terranée occidentale. Sélinonte était alors pour les commerçants grecs un passage obligé pour les zones situées au-delà des « Colonnes d’Hercule », le détroit de Gibraltar.
Au VIe siècle avant J.-C., la jeune ville coloniale se développe de manière fulgurante et gagne vite en prospérité. Celle-ci se manifeste par la construction de temples monumentaux et d’un trésor dans le sanctuaire panhellénique de Zeus à Olympie. La zone d’habitat mesurait plus de 100 ha et était délimitée par un rempart ; la structure régulière du réseau routier est presque entiè-rement connue grâce à des prospections géophysiques et à des fouilles ciblées. Au centre de la cité, dans une légère dépression du terrain, se trouvait l´agora, une place trapézoïdale où le départe-ment de Rome de l´Institut archéologique allemand mène de vastes fouilles sous la direction de Dieter Mertens depuis le milieu des années 1990.
De grandes nécropoles et des sanctuaires sont implantés tout autour de la ville, et cela dès l’époque de la fondation de la cité. À l’ouest se trouvait la nécropole de Manicalunga et, au nord et au nord-est, celles de Galera-Bagliazzo et de Buffa. Dans la vallée du Modione, au pied d’une pente, se trouvaient plusieurs sanctuaires, dont celui de Déméter Malophoros – une déesse de la fertilité – est le plus important. Les fouilles de ce site cultuel ont fourni une très grande quantité d’offrandes (surtout de la céramique et des statuettes de terre cuite, mais aussi de nombreux objets en métal).
Si les sanctuaires à l’ouest du Modione sont toujours demeurés relativement modestes quant à leur équipement, trois temples périptères monumentaux sont érigés sur le plateau à l’est de la cité vers la fin du VIe et au Ve siècle avant J.-C. Ils offraient certainement un décor impressionnant
Vue de l’acropole vers la colline orientale avec les temples G, F et E.
4-chapitre 4-mep.indd 218 26/03/13 15:55
219
Du Languedoc à la Sicile CHAPITRE 4
pour les marins s’approchant de la cité par le sud. Édifiés parallèlement d’ouest en est, ils formaient un contrepoids monumental à la ville au-delà de la vallée du Gorgo Cotone. Aujourd’hui, le temple E reconstitué, érigé vers 470/60 sur des constructions plus anciennes et probablement dédié à la déesse Héra, accroche le regard lorsqu’on se tourne vers la colline orientale. Le temple G, qui se trouve plus au nord, est, après l’Olympiéion d’Akragas, le plus grand de tous les temples grecs occidentaux ; on ne peut comparer ses dimensions qu’aux temples ioniques géants de la côte occidentale d’Asie Mineure et de l’île de Samos. Le périptère nord du temple C, du milieu du VIe siècle, et les puissants remparts de la période tardive, vers la fin du Ve et au IVe siècle, dominent l’acropole. De l’habitat archaïque et classique des VIe et Ve siècles, il n’y a que peu de traces visibles en dehors de l’acropole.
Au centre de la cité se trouvait l’agora, la place du marché trapézoïdale, qui était encadrée au nord et à l’ouest par des portiques, alors que du côté oriental s’étendait une zone de construc-tions dense. À l’occasion des fouilles du département de Rome de l´Institut archéologique alle-mand, on y a trouvé beaucoup d’objets métalliques ; c’est actuellement le plus grand complexe de ce genre d’une ville grecque d’époque archaïque.
Plan de l’agora de Sélinonte.
Double page suivanteVue sur l’acropole avec le temple C et les remparts de la fin du Ve et du IVe siècle avant J.-C.
4-chapitre 4-mep.indd 219 26/03/13 15:55
222
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 4
Les objets métalliques de l’agora et du sanctuaire de Déméter MalophorosLa diversité des objets métalliques de Sélinonte est très grande ; on y trouve des armes
et des pièces de harnachement, des outils et des ustensiles, de la parure et des éléments de costume, des récipients en bronze, et beaucoup d’autres choses. À la différence des objets provenant des sanctuaires en Grèce, il s’agit dans la plupart des cas de petits objets d’appa-rence modeste et souvent intentionnellement réduits en morceaux, parfois trop légers pour être pesés avec une balance ménagère. Le fait que la plupart des objets sont fragmentés rend leur identification et leur classement difficile, et pourtant c’est la condition indispensable pour leur classement et leur interprétation historico-culturelle.
Contrairement à ce qu’on pouvait imaginer initialement, les objets venant de Grèce ne jouent qu’un faible rôle parmi les objets métalliques de l’agora. Et ceci malgré le fait que le plan, l’architecture et les autres objets trouvés à Sélinonte – surtout la céramique fine – montrent clairement une appartenance au monde grec. Si l’on étudiait ces objets métalliques sans connaître leur contexte de découverte, on les mettrait toutefois difficilement en lien avec une colonie grecque. C’est par exemple le cas d’éléments de casques – comme le nasal d’un casque corinthien –, d’objets de parure et de fragments de récipients. Du type d’épingle le plus connu de la Grèce archaïque – l’épingle à disque sommital – on ne trouve à Sélinonte que quelques exemplaires dans le sanctuaire de Déméter Malophoros et dans la nécropole de Buffa ; ce type d’objet est absent du lot qui en comporte plus de mille, trouvé sur l’agora. Au contraire, les fibules d’origine italique dominent les accessoires vestimentaires. La part d’objets métalliques d’origine indigène sicilienne est nettement plus grande que celle des objets de provenance grecque. Dans quelle mesure ce fait permet-il de connaître la composi-tion ethnique des habitants de la ville ? Il s’agit d’une question difficile à résoudre d’un point de vue méthodologique et on ne peut y répondre que dans un contexte plus large.
À Sélinonte, la part des objets étrangers d’origine parfois très éloignée, du bassin méditer-ranéen ou de la mer Noire est aussi étonnamment grande. La zone d’origine qui se dessine ici peut concurrencer des sanctuaires importants de la mère patrie grecque, car elle va du sud et du centre de la France à l’ouest jusqu’au Caucase et à Chypre à l’est. Le chemin le plus lointain a été parcouru par un petit fragment en bronze avec un décor de bandeaux en reliefs paral-lèles qui porte en alternance des décors en forme de barbelé ou foliacé : il appartenait à une cloche qui, dans le Caucase et rarement aussi en Transcaucasie, faisait partie d’un harnais de cheval.
Les objets de bronze venant du sud et du centre de la France sont particulièrement nombreux sur l’agora (environ 150). Il s’agit surtout de fragments de bracelets et d’anneaux de jambe, dont un seul est complet, et, beaucoup plus rarement, de petites haches ou penden-tifs. Un anneau creux coulé avec un décor cannelé appartient par exemple au « groupe Mois-sat » du centre de la France ; on en trouve des parallèles exacts dans le dépôt de métal ancien de Carcassonne (Aude) et dans une tombe du site éponyme de Moissat dans le Massif central (Puy-de-Dôme). Un anneau en tôle décoré de section en C correspond à tel point à un exem-plaire du dépôt « des environs de Montpellier » (Hérault) qu’on est tenté de supposer qu’ils furent fabriqués dans le même atelier. Par ailleurs, une hache en bronze rappelle, en forme et en taille, tellement les haches à ailerons du dépôt de Roque-Courbe à Saint-Saturnin (Hérault) et d’Espéraza/Castellas (Aude) que leur provenance du sud de la France ne fait aucun doute. Presque tous les objets étrangers venant de Gaule datent du dernier tiers du VIIe et de la première moitié du VIe siècle avant J.-C. ; il n’y a pour ainsi dire pas d’objet plus ancien et aucun plus récent.
Les objets gaulois de l’agora de Sélinonte trouvent leurs meilleurs parallèles dans les dépôts launaciens du Languedoc et dans le complexe de l’épave de Rochelongue découverte en mer dans les années 1960, près du Cap d’Agde. Dans la tradition des dépôts de l’âge du
4-chapitre 4-mep.indd 222 26/03/13 15:55
223
Du Languedoc à la Sicile CHAPITRE 4
Bronze final, on trouve surtout dans ces dépôts launaciens des objets en bronze fragmentés et quelques haches à douille dont la coulée était de médiocre qualité, typiques des dépôts du Premier âge du Fer. Dans quelques dépôts launaciens – comme à Sélinonte –, la parure annu-laire domine (par exemple à Roque-Courbe et à Launac). Toutefois, si les trouvailles de Séli-nonte ne correspondent pas seulement d’un point de vue formel à celles de dépôts launaciens, ni à leur état fragmentaire, on peut cependant supposer qu’elles ne sont pas arrivées intactes en Sicile, mais déjà fragmentées.
1. Nasal en bronze d’un casque corinthien.
2. Fragment d’une cloche en bronze caucasienne.
3. Fragment d’un anneau en bronze à bossettes à décor cannelé provenant du centre de la France.
4. Lame d’une hache à ailerons en bronze du sud de la France.1
2
3
4
4-chapitre 4-mep.indd 223 26/03/13 15:55
224
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 4
L’importance des objets métalliques de SélinonteLa vaste zone d’origine des objets en bronze de Sélinonte ressemble énormément à celle
des objets métalliques du sanctuaire de Déméter de Bitalemi, près de Géla, qui sont également dans un état très fragmenté. Les deux complexes attestent des mêmes régions d’origine : la Sicile, la France, l’Étrurie, la zone adriatique, la Macédoine, l’Anatolie, Chypre et le Caucase. La convergence s’étend jusqu’au fait qu’à Sélinonte et à Bitalemi, il y a des objets en bronze d’origine sicilienne qui sont plus anciens que les dates de fondation des deux colonies histo-riquement transmises (628 avant J.-C. pour Sélinonte et 689 avant J.-C. pour Géla). Ainsi, on a trouvé des fibules serpentiformes du Premier âge du Fer (VIIIe siècle avant J.-C.) sur l’agora et sur le sanctuaire de Déméter Malophoros – un rasoir en bronze date même de la fin de l’âge du Bronze (début du dernier millénaire avant J.-C.). Parmi les fibules en bronze publiées du sanctuaire de Déméter Malophoros, il y en a au moins trois qui ont été fabriquées avant la fondation de la cité et du sanctuaire ; de même pour l’agora d’où proviennent aussi divers objets plus anciens.
Les ressemblances entre les ensembles de Sélinonte et de Bitalemi sont d’autant plus remarquables qu’il s’agit dans un cas d’un habitat et dans l’autre, d’un sanctuaire. À Séli-nonte, il n’y a qu’une seule situation avec des indices évidents d’un dépôt rituel d’objets en bronze : il s’agit d’un dépôt découvert dans la zone d’un petit sanctuaire de la parcelle 5 des constructions en bordure orientale de l’agora, qui rappelle des dépôts comparables de Bita-lemi. Parmi les fragments de tôle en bronze, on peut y identifier des fragments de bassins à bord perlé, de râpes à fromage, d’un chaudron et d’une situle probablement d’Italie centrale ; il s’agit là de vaisselle de symposion. Les autres objets métalliques sont dispersés dans les couches d’habitat, notamment dans les strates les plus profondes des VIIe et VIe siècles avant J.-C. dans la zone de construction orientale.
La présence fréquente d’objets en bronze, leur caractère souvent fortement fragmenté, les traces de destruction volontaire, le grand nombre d’objets étrangers et l’apparition d’objets anciens antérieurs à l’occupation du site, tout ceci est inhabituel pour un site d’habitat et rappelle fortement les dépôts de métal ancien de l´âge du Bronze. Même si pour certaines zones de l’agora de Sélinonte une interprétation des objets métalliques comme « offrandes de fondation » dans un sens large ne peut pas être exclue, leur omniprésence suppose plutôt une interprétation économique du phénomène. Le métal ancien haché dont la « boomtown » de Sélinonte fut friande devait être importé de partout, y compris de l'arrière-pays indigène ; il pouvait servir de moyen d’échange et de thésaurisation, mais également comme métal brut pour la coulée de petits objets en bronze dans la zone de l’agora. L’apparition de fragments d’objets en bronze tout à fait similaires dans des sanctuaires comme Bitalemi et dans un contexte d’habitat comme à Sélinonte, voire parfois dans des sépultures siciliennes, prouve l’importance et la large extension de ce phénomène, d’une durée relativement courte, car il s’éteint déjà pendant la deuxième moitié du VIe siècle avant J.-C. Les couches d’habitat de l’agora de Sélinonte datées entre les Ve et IIIe siècles avant J.-C. ont livré beaucoup moins d’objets en métal que celles antérieures.
(Traduction Anke Müller-Depreux)
Bibliographie
Gàbrici 1927 ; Dewailly 1992 ; Dehl-von Kaenel 1995 ; Meola 1996-98 ; Kustermann Graf 2002 ; De Angelis 2003 ; Mertens et al. 2003a ; Mertens et al. 2003b ; Mertens 2006 ; Helas 2012 ; Baitinger à paraître.
Fibule serpentiforme en bronze.
4-chapitre 4-mep.indd 224 26/03/13 15:55