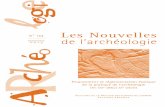QU'EST-CE QUE 'BIEN VIEILLIR' ? » Médecine de soi et prévention du vieillissement
L’« expérience » du vieillissement. Les écrits quotidiens d’un octogénaire au prisme de...
Transcript of L’« expérience » du vieillissement. Les écrits quotidiens d’un octogénaire au prisme de...
L'« EXPÉRIENCE » DU VIEILLISSEMENTLes écrits quotidiens d'un octogénaire au prisme de leurs cadres sociauxSolène Billaud et Baptiste Brossard Belin | Genèses 2014/2 - n° 95pages 71 à 94
ISSN 1155-3219
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-geneses-2014-2-page-71.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Billaud Solène et Brossard Baptiste, « L'« expérience » du vieillissement » Les écrits quotidiens d'un octogénaire au
prisme de leurs cadres sociaux,
Genèses, 2014/2 n° 95, p. 71-94.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 71
VA
RI
AL’« expérience » du vieillissement.Les écrits quotidiens d’un octogénaire au prisme de leurs cadres sociaux
Solène Billaud et Baptiste Brossardpp. 71-94
Que signifie « être vieux » ? Dans les sociétés contemporaines, l’accroisse-ment de la part des personnes âgées dans la population – le vieillisse-ment démographique – donne à cette question une acuité particulière, et justifie l’attention des sciences sociales à son égard. Au cours du dernier
siècle, les pyramides des âges de ces sociétés ont vu s’élargir leur partie supérieure et, de ce fait, la place sociale donnée aux personnes âgées se trouve modifiée : la figure du vieillard, auparavant centrée sur l’invalidité liée à l’incapacité de tra-vailler (Lenoir 1979 : 58), ne suffit plus à rendre compte des situations sociales engendrées par le système de retraite et l’allongement de l’espérance de vie. La nécessité de décrire la vieillesse autrement s’est incarnée dans de nouvelles expres-sions (« troisième âge », « quatrième âge », « seniors ») visant avant tout à désen-claver la pensée du vieillissement du prisme du non-travail et de la sénilité. Il y a une vie après le passage à la retraite, une vie qui peut sous certaines conditions se construire autour de loisirs et de distractions, et qui par conséquent rendrait pos-sible un « bien vieillir », voire un « vieillissement réussi » (Gognalons-Nicolet 1994).
À contrecourant des approches institutionnelles, démographiques ou macro-sociales, plusieurs auteurs ont souhaité renverser l’échelle de leurs analyses : ce n’est pas seulement en termes de classes d’âge, de positions sociales, de modes de consommation que l’on peut comprendre le vieillissement, mais également en interrogeant son versant subjectif, c’est-à-dire la manière dont les personnes âgées construisent leur expérience. Autrement dit, le vieillissement de la popula-tion n’engage pas qu’une modification de l’organisation sociale, politique et éco-nomique, mais aussi le fait qu’une partie croissante de la population soit amenée à connaître l’« expérience de la vieillesse ».
8990_gen95.indd 71 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s « L’entreprise de soi »72
Dans cet article, nous explorerons également cette expérience sous son aspect individuel et à travers sa mise en mots subjective, ne serait-ce que par le matériel d’enquête choisi : l’agenda/journal intime d’un homme de quatre-vingt-sept ans, décrivant de janvier 2011 à juin 2012 son quotidien à domicile puis en maison de retraite. Certaines conclusions formulées en sociologie et en anthropologie sur les écrits ordinaires constituent pour nous un point de départ : l’inscription des écrits dans les univers sociaux de leurs auteurs et de leurs destinataires (Fabre 1997), la forme écrite comme type d’interaction différente de la forme orale (Weber 1993) et l’expression écrite comme inévitable positionnement face à des normes scolaires et professionnelles (Lahire 1993a). Par ailleurs, les historiens discutent depuis longtemps le statut de l’écrit en tant que « source » et le rapport entre le contenu des textes et la situation historique dans laquelle ils ont été écrits (voir par exemple Godicheau 2002).
Pourquoi se limiter à un matériel si réduit ? En partant du témoignage écrit d’une seule personne, produit de son initiative dans un laps de temps déterminé, nous souhaitons montrer qu’une expérience individuelle ne peut être comprise en tant que telle, comme un objet autonome. Cette expérience n’a de valeur sociolo-gique – comme expérience individuelle mais aussi comme cristallisant des traits d’une expérience plus collective – que si l’on relate dans un même mouvement l’interaction entre les conditions concrètes de son élaboration écrite ou orale, son contexte socio-historique, les conditions matérielles d’existence de l’individu concerné et la méthodologie des chercheurs : non pas les structures sociales, ni l’expérience individuelle, mais leur imbrication permanente.
Nous développerons cette position à partir d’une relecture critique des travaux effectués jusqu’à présent dans ce domaine, que nous exposerons dans un premier temps avant de présenter plus en détail notre matériel d’enquête. Ensuite viendra l’analyse de ce dernier. Elle conduira à étudier les écrits de l’enquêté en les repla-çant dans leurs contextes sociaux et en les rapportant à la situation d’enquête, afin de comprendre ses marges de manœuvre au regard des cadres qui les contraignent. Dans un deuxième temps, nous montrerons que la routinisation des écrits de M. Lautrec témoigne d’ajustements face aux configurations d’aide qui l’entourent. Dans un troi-sième temps, nous présenterons l’évolution conjointe de la configuration matérielle autour de l’enquêté et les jugements moraux qu’il élabore à propos de sa situation.
Peut-on approcher sociologiquement l’« expérience » ?
Les sociologies phénoménologiques du vieillissementL’expérience subjective du vieillissement est une thématique relativement
explorée en sociologie, en psychologie et dans le domaine du nursing. Ces travaux sont parfois recoupés sous l’appellation de phenomenology of aging (Longino et
8990_gen95.indd 72 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 73
VA
RI
APowell 2009) car ils ont pour point commun d’étudier le vieillissement au prisme de la signification subjective que prend ce processus pour les personnes qui le vivent. Nous en présenterons ici les principales tendances selon la méthodologie utilisée.
– Les méthodes qualitatives protocolaires. La littérature anglophone dispose de plusieurs protocoles de recherche qualitative se définissant comme phenomenologi-cal analysis method (Shin et al. 2003), phénomenological study (Futrell, Wondolowski et Mitchell 1993) ou encore phenomenological-hermeneutic study (Caldas et Berterö 2007). Il s’agit d’un ensemble de méthodes reposant sur la codification des entre-tiens. Leur résultat prend parfois la forme d’une « définition structurale » (Parse 1981) censée résumer un type d’expérience en une phrase. Ainsi, May Futrell, Catherine Wondolowski et Gail Mitchell (1993) écrivent que la vieillesse, parmi les personnes âgées écossaises, peut être subjectivement définie comme une « inten-sification des engagements, tandis que les transfigurations signifient la maturité, tempérant l’inévitable par une sérénité porteuse ». Kyung Rim Shin et ses collabo-rateurs (2003) ont quant à eux interrogé des Coréens de 40 à 80 ans. Ils concluent que le vieillissement est perçu au prisme des changements corporels, des sentiments naissants de nostalgie et d’espoir, de l’acceptation des limites inhérentes à l’âge. Celia Caldas et Carina Berterö (2007) expliquent que les personnes âgées vivant à Rio de Janeiro, malgré la conscience que leur vie touche à sa fin, restent attachées à cette existence, cherchant à maintenir une utilité dans leur entourage.
– Les méthodes qualitatives non-protocolaires. Du côté des publications fran-cophones, plusieurs recherches qualitatives ont été conduites sans que soit mis en place un protocole de codification. Benoit Fromage (2007 : 230) en exemplifie le versant post-moderne, entendant « faire découvrir la structure implicite du vieillis-sement » par des métaphores (un sablier, un fleuve, une voiture). D’autres travaux, notamment anthropologiques, décrivent la vieillesse par le biais de l’expérience corporelle (Ameisen, Le Blanc et Minnaërt 2008). Enfin, des chercheurs ont étu-dié la manière dont les personnes âgées se perçoivent elles-mêmes. Frédéric Balard (2011) remarque par exemple que ses enquêtés nonagénaires ou centenaires nient le fait d’être « vieux », car pour eux cette qualification désigne des infirmités telles que l’incapacité à marcher. Ils disent, par contre, se « sentir vieillir » face à l’accu-mulation de problèmes de santé et des pertes de capacité qui, sans être totalement invalidants, complexifient le quotidien. Caradec (2004) propose une approche attentive aux transformations identitaires survenant au cours de la vieillesse. Il prolonge le travail de Cumming et Henry (1961) définissant la vieillesse comme marquée par une tendance au désengagement vis-à-vis de la société, mais cherche à prendre en considération les ajustements individuels face à ce désengagement. Il distingue trois formes de « rapport au monde » (Caradec 2004 : 108) : le « rap-port pratique » – se détacher des objets par le biais de stratégies d’adaptation, de substitution, de délégation ou d’abandon –, l’« intérêt pour le monde » – se dire de moins en moins concerné par ce qu’il s’y passe – et le déclin du « sentiment
8990_gen95.indd 73 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement74
d’appartenance à la société ». La façon dont les personnes âgées se représentent leur place dans le monde devient plus distante, notamment lorsqu’ils décident à un moment de leur trajectoire d’arrêter d’évoluer, qu’ils « cristallisent leur iden-tité » (ce qui suggère que l’âge adulte serait au contraire une période de constante évolution « identitaire »). Cette approche est partagée par de nombreux chercheurs francophones (Membrado 2010 ; Mallon 2007 ; Clément 2003).
– Les méthodes longitudinales. Quelques recherches ont pour spécificité de se mettre en place sur un temps plus long, telle que celle menée en Finlande par Heikkinen (1993, 2000, 2004). Celle-ci fait passer un questionnaire à une cohorte de 286 personnes de 80 ans en 1990, conduisant par ailleurs des entretiens avec vingt d’entre elles, réitérés en 1995 puis en 2000. Cette recherche montre qu’en 1990, si les enquêtés refusent de se désigner comme vieux, ils décrivent leurs boundary conditions : toute l’expérience quotidienne est structurée par la conscience de limites liées à la détérioration de la santé, aux problèmes de mobilité, à la dou-leur, etc. (Heikkinen 1993). En 1995, les enquêtés se disent plus volontiers être « vieux », étant donné leur conscience accrue des limites du corps qui le font deve-nir omniprésent dans l’expérience quotidienne. On passe de « j’ai un corps » à « je suis mon corps » (Heikkinen 2000 : 481). Ces mêmes enquêtés, revus en 2000, ont changé. Ils se montrent quelque peu « en dehors du temps ». L’auteure relève un changement général d’attitude face au monde qui les entoure, comme s’ils « n’habitaient » plus ici et que seules leurs routines quotidiennes leur donnaient l’impression d’être chez eux (Heikkinen 2004).
– Les méthodes quantitatives non longitudinales. Certaines recherches de ce type doivent enfin être signalées. À partir d’un échantillon de 4034 Allemands âgés de 40 à 85 ans, Nardi Steverink et al. (1998) identifient les trois dimensions du vieillissement qui influencent le plus le « bien-être » des personnes âgées : le « déclin physique », une « croissance continue » (poursuivre ses activités et envisa-ger l’avenir) et la « détérioration des liens sociaux ». À partir d’une enquête statis-tique menée auprès d’un échantillon mêlant des Américains et des Norvégiens, James Gross et al. (1997) concluent qu’avec l’âge, les individus manifestent un meilleur contrôle émotionnel et aussi une moindre expressivité.
Retour critique sur la notion d’expérienceCes travaux nous permettent de mieux comprendre la dimension subjective
du vieillissement, notamment au regard des traits récurrents qui parcourent les recherches précitées : omniprésence des limites corporelles dans le quotidien, détachement vis-à-vis du « monde », ambivalence face à l’auto-désignation comme « vieux », etc. Nous retrouverons ces processus dans notre matériau d’enquête. Néanmoins, un retour critique sur ce que signifie effectivement la notion d’expé-rience permettra d’en proposer une approche différente.
Nous reprendrons à notre compte la critique que Pierre Bourdieu adresse à la phénoménologie. Selon lui, enregistrer par le langage ordinaire le « donné tel qu’il
8990_gen95.indd 74 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 75
VA
RI
Ase donne, […] sans restituer les fonctions qu’il remplit et les conditions sociales de son efficacité, c’est faire exister scientifiquement et, par là, légitimer une construc-tion de la réalité sociale qui n’est jamais une simple expérience intime et person-nelle, mais la représentation du réel la plus conforme aux intérêts d’un groupe déterminé » (Bourdieu 2000 : 239). Cela implique que les discours pris comme tels ne permettent pas d’accéder à ce qui serait une « expérience ». Plus encore, qu’elle soit formulée à l’écrit ou à l’oral, l’« expérience » telle que l’étudie la plupart des auteurs cités plus haut, c’est-à-dire considérée comme le vécu authentique d’un individu face au monde, pourrait relever d’une fiction normative. Stricto sensu, ce qu’on appelle l’expérience consiste en un travail réflexif ayant pour base non pas tant la subjectivité d’une personne que la mise en mots de ses conditions de vie au cours d’une relation d’enquête socialement située.
À cet égard, il est intéressant de questionner la notion de « rapport au monde », fréquemment utilisée comme quasi-synonyme de celle d’expérience. Cette notion reflète en réalité la manière dont un individu présente rétrospectivement sa place dans son environnement social sous la forme d’une posture abstraite face à la vie en général. L’importation de la notion de « rapport au monde » en sciences sociales traduit dans ce cas une posture intellectualisante appliquée postérieurement aux discours des individus mais présentée comme préalablement pensée par eux. Enfin, l’étude en termes de « rapport au monde » est d’autant plus problématique qu’elle postule un « monde » cohérent et identifiable face auquel il serait possible de se positionner de façon unifiée, laissant de côté les différenciations et rapports de force qui traversent l’espace social. Des travaux récents ont d’ailleurs montré combien les conflits et les clivages familiaux sont avivés par les décisions de prise en charge au cours des trajectoires de vieillissement (Weber, Gramain et Gojard 2003 ; Béliard 2010 ; Billaud 2010). Les discours des personnes âgées doivent donc être analysés en référence à la pluralité des cadres auxquels celles-ci sont confron-tées : il n’y a pas de rapport « au monde ».
Par ailleurs, tout en postulant que l’expérience du vieillissement se caracté-rise par certaines idées, telles que le fait de ne pas se sentir vieux ou de chercher à maintenir une utilité dans sa communauté, les travaux précités laissent penser que ces idées suffisent à révéler une dimension de l’existence (le vieillissement), et que ce lien idées/expérience est en lui-même un résultat. Il reste cependant à se demander pourquoi les personnes interrogées émettent ces idées. Par exemple, les enquêtés de C. Caldas et C. Berterö (2007) déclarent-ils chercher à maintenir leur utilité parce qu’ils font l’expérience du vieillissement ou bien pour réagir à un contexte, celui d’une dévalorisation symbolique des personnes âgées, celui d’une difficulté matérielle à subvenir à leurs besoins ou celui d’une relation d’enquête où il est nécessaire de garder la face ?
Nous proposons pour notre part d’approcher l’expérience du vieillissement en analysant les données d’enquête au prisme de leurs contextes sociaux et des conditions de leur recueil. La mise en relation des discours individuels et des
8990_gen95.indd 75 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement76
conditions de vie des individus (incluant leur situation économique, leurs appar-tenances sociales, l’environnement politique, juridique, culturel, etc.) a montré son efficacité explicative dans la plupart des domaines des sciences sociales. Chercher les clefs de compréhension de l’expérience hors de l’expérience, chercher les clefs de compréhension du vieillissement hors du vieillissement : cette démarche ren-drait d’autant mieux compte des marges de manœuvre des personnes âgées qu’elle les réinscrirait dans les cadres qui les contraignent. Concrètement, cela passe par des allers-retours réguliers entre les matériaux d’enquête et les données dont on dispose quant aux contextes sociaux dans lesquels ils prennent sens. La situation d’enquête est également à prendre en compte. Les chercheurs participent à la pro-duction et/ou à la sélection des matériaux qu’ils considèrent comme révélateurs d’expériences individuelles. Ce processus de production intellectuelle contribue à construire, en amont de l’analyse des données produites, ce qu’on appelle l’expé-rience. La posture réflexive du chercheur, qui consiste à intégrer les conditions du recueil des données dans les matériaux à analyser (Beaud et Weber 1998), nous semble donc indispensable.
Ces principes – que nous devons à la démarche ethnographique – peuvent être mis en pratique, sur le plan de l’écriture sociologique, par la présentation imbri-quée des matériaux et données collectés, de la situation d’enquête et d’éléments contextuels. Ils s’accompagnent de précautions de langage consistant à présenter les propos (écrits ou oraux) des enquêtés comme des propos, non pas comme des marques de leur personnalité, ce qui permet d’en examiner plusieurs possibili-tés de compréhension : dans quelle mesure ces propos s’expliquent-ils par l’âge de l’enquêté, sa situation résidentielle, sa position professionnelle, ses revenus, sa configuration familiale, etc. ? Nous proposons ici d’appliquer ces principes à notre questionnement sur le vieillissement et son expérience.
Le journal de M. LautrecNous avons rencontré M. Lautrec1, quatre-vingt-sept ans, ancien employé des
ressources humaines dans une grande entreprise publique, dans la continuité d’une recherche portant sur les configurations d’aide mobilisées autour de personnes âgées dépendantes (Billaud 2010). Au fil des trois entretiens semi-directifs menés avec lui, alors qu’il vit depuis quelques mois en maison de retraite, un élément inhabituel a suscité notre intérêt : deux carnets, dans lesquels cet homme consigne presque tous les jours des détails de sa vie quotidienne accompagnés de réflexions personnelles (figure 1). Il cache précieusement ces carnets dans le tiroir de son bureau, de peur qu’ils soient découverts par sa famille avant sa mort, ou bien par le personnel de l’établissement. Après avoir obtenu l’autorisation de les empor-ter brièvement pour les étudier, nous avons effectué un dernier entretien en vue d’obtenir quelques précisions.
Les entretiens, peu directifs, ont surtout pris la forme d’un monologue : l’en-quêté parle de sa trajectoire professionnelle, de ses relations avec ses enfants, de ses
8990_gen95.indd 76 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 77
VA
RI
Avoyages passés, de la situation politique et, comme dans son carnet, de son entrée en maison de retraite. Nous nous en servirons ici comme des données de cadrage explicitant qui sont les personnes citées (membres de la famille notamment) et quelle a été sa trajectoire – sujets sur lesquels il n’écrit pas. Dans le cadre de cet article, notre analyse se centrera néanmoins sur ses écrits.
Figure 1 : Exemple de pages du carnet – les 11 et 12 mars 2011
Comment se présentent les carnets de M. Lautrec ? Il s’agit, matériellement, d’agendas de taille moyenne à couverture cartonnée, comprenant une page par jour sur la période d’une année civile. Nous disposons de celui de l’année 2011 (janvier-décembre) et de celui de l’année 2012 (rempli de janvier jusqu’au 30 juin, date à laquelle M. Lautrec nous a confié ses écrits2). En une année et demie, de nombreux rebondissements se produisent. L’enquêté réside initialement à son domicile avec sa femme, ancienne secrétaire dans l’administration publique de quatre-vingt-cinq ans. Celle-ci souffre, selon le diagnostic posé, de la maladie d’Alzheimer. Les six premiers mois des carnets racontent donc leur vie dans la grande maison dont ils sont propriétaires depuis 1975, en banlieue d’une ville de province française. Le 14 juin 2011, M. Lautrec chute dans sa chambre et est hos-pitalisé. Un mois après, sa femme est placée en institution loin de leur domicile,
8990_gen95.indd 77 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement78
près du lieu de vie de la plus jeune de leurs trois enfants, qui résident tous dans d’autres régions (figure 2). Les carnets de M. Lautrec décrivent alors presque trois mois d’hospitalisation durant l’été 2011, jusqu’au 6 septembre où il se voit à son tour placé en maison de retraite contre sa volonté, dans la même ville mais dans un établissement différent de celui où vit désormais sa femme. Ce placement, que M. Lautrec ne cesse de dénoncer, survient dans un contexte de conflit familial : selon lui, ses enfants considèrent que leur père n’est plus apte à résider seul3, alors que lui-même exprime l’opinion l’inverse. Il considère même être tout à fait capable de continuer à s’occuper de sa femme malgré sa maladie.
Figure 2 : Schéma de parenté de M. Lautrec
La retranscription des carnets fait apparaître des variations du volume d’écriture (voir figure 3) ainsi que des évolutions importantes dans le statut de ce qui est écrit. Dans les premières pages, les agendas semblent n’être que des pense-bêtes utiles à la gestion du quotidien. M. Lautrec s’en sert surtout pour organiser sa prise en charge et celle de sa femme, incapable de s’en occuper elle-même. Numéros de téléphone, adresses administratives, visites à domicile et rendez-vous médicaux s’accumulent dans les premières pages de janvier 2011. Mais dès le mois suivant, un changement s’opère : M. Lautrec se met à rapporter ses émotions, ses douleurs, ses opinions. Ses problèmes de santé (difficultés à voir, à se déplacer, etc.) et une chute survenue le 22 février affectent à la baisse son débit d’écriture, qui connaît néanmoins un pic à la mi-mars, lorsqu’il insiste sur les soins qu’il apporte à sa femme. Au cours des mois suivants, ses prises de notes se font moins denses alors que sa santé faiblit, jusqu’à sa chute du 14 juin qui marque la fin de sa vie à domicile. Après une période de
∆ Arsène
Ancien receveur des postes (décédé)
О Agathe
Ancienne femme au foyer (décédée)
∆ Gustave LAUTREC
(87 ans) Employé ressources
humaines EDF retraité
О Ginette (85 ans)
Employée comptabilité puis femme au foyer
О Josiane
(66 ans) Employée EDF
retraitée
∆ François (66 ans)
Cadre informatique EDF retraité
∆ René
(63 ans) Cadre Air France
retraité
О Rafaela (47 ans)
Femme au foyer
О Thérèse (59 ans)
Femme au foyer (dipl. assistante sociale)
∆ Michel (63 ans)
Ingénieur retraité
2 enfants 4 enfants 2 enfants
8990_gen95.indd 78 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 79
VA
RI
Asilence au début de son hospitalisation, l’enquêté accélère son débit d’écriture alors qu’il tente de regagner la maîtrise de son quotidien à l’hôpital (en notant les rendez-vous, des indications sur les personnels…). La quantité d’écriture atteint son maxi-mum dans les jours qui suivent l’entrée en maison de retraite, début septembre 2011 : l’agenda, déjà promu journal intime, devient également un cahier de doléances et de dénonciations parsemé de problèmes de santé et de soucis de famille. Là encore, le volume de texte dans le carnet révèle les variations de l’état de santé de son auteur, même si l’écriture de ce dernier se fait globalement plus constante.
Figure 3 : Nombre de caractères par jour en rapport avec les tournants biographiques de 2011-2012
C’est parce que M. Lautrec construit progressivement son agenda comme une recension de ses difficultés et de leurs origines qu’il saisit notre intérêt pour ses carnets comme une opportunité. Valorisant la réussite professionnelle acquise par la voie scolaire, il nous attribue une légitimité sociale (universitaire) qui fait de nous des alliés potentiels face à l’injustice de sa situation. Il considère de plus notre provenance parisienne comme une chance de porter son témoignage au-delà du local, voire même à un niveau national. Tout cela justifie pour lui, malgré son application à garder ses carnets secrets, leur abandon entre nos mains pour un soir. Il exige en échange notre stricte discrétion vis-à-vis de son entourage familial et
8990_gen95.indd 79 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement80
des professionnels de l’établissement afin d’éviter les conflits immédiats qui pour-raient résulter de leur découverte. Notons malgré tout que le texte montre, à partir de l’entrée en institution, que M. Lautrec envisage une lecture posthume par ses enfants. L’utilisation fréquente du « vous » à leur attention exclusive en témoigne, comme le 8 mai 2012 : « Tout ce qui peut arriver dans l’avenir, vous en porterez […] toute la responsabilité. Gardez agendas 2011 et 2012, vous les relirez plus tard peut-être. »
L’écriture répétitive comme adaptation secondaireDe nombreuses répétitions apparaissent très rapidement à la lecture du jour-
nal de M. Lautrec. Plusieurs informations y sont écrites puis réécrites, méticu-leusement, inlassablement. Par exemple, les 4 et 5 mai 2011, le numéro d’Arlette, une infirmière qui se rend presque quotidiennement au domicile de l’enquêté, est inscrit à deux reprises sur des pages en vis-à-vis. Le 30 juin 2011, M. Lautrec note deux fois le numéro de téléphone de sa fille sur la même page, ainsi que celui d’Agnès, une employée de maison très souvent présente, dont le numéro sera répété deux fois le 5 juillet 2011 aux côtés, encore une fois, du numéro de sa fille. De la même manière, son numéro de sécurité sociale apparaît six fois en 2011 (1er janvier, 30 juillet, 31 juillet, 29 août, 8 septembre, 20 septembre). Lors de nos retranscriptions du journal, l’entassement de ces répétitions nous transmettait un sentiment d’aliénation, notamment à la lecture de ces passages où de nombreux détails du quotidien semblent consignés :
« [18 mars 2011] 11 h 15 cuisinière aide pour repas. 11 h 15 Mme HIROTO TB café. 10 h 15 Donné café + 2 gaufrettes à mon épouse. 15-17 [heures] Agnès. Cette nuit mal bas du dos. J’ai pris 1 Zaldiar à 2 h 45. Frisbee [la chatte de son épouse] n’est pas dans la maison. Pas vue aujourd’hui. Enfermée ? Frisbee rentrée après 14 h vendredi 21 heures. Mme Levy 22 h 15 – 22 h 25. »
Les carnets servent, d’une part, à s’attacher au respect des programmes et à prévoir. Sans cette feuille de route, l’homme paraît perdu. Le jour où nous les lui empruntons le temps d’une soirée, il recopie d’abord scrupuleusement sur une autre feuille toutes les notes qu’il avait prises pour la semaine suivante : qui vien-dra le lever, les rendez-vous avec le kinésithérapeute… D’autre part, la notation méticuleuse lui sert à mettre en place une surveillance rapprochée de certains indi-cateurs de sa santé et de celle de sa femme. Il liste tous les médicaments que l’un ou l’autre prend et reporte toutes les boissons et la nourriture qu’il donne à son épouse, par exemple le nombre de gaufrettes au goûter.
Ces répétitions traduisent l’attachement de M. Lautrec à une certaine maî-trise de son quotidien – un usage relevé dans d’autres groupes sociaux tels que les agriculteurs, dont Nathalie Joly (1997) étudie les agendas professionnels. Elles
8990_gen95.indd 80 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 81
VA
RI
Apourraient toutefois suggérer une analyse fondée sur la notion de routine. L’idée que les personnes âgées adoptent des routines en vieillissant est en effet répandue dans la littérature sociologique et psychologique. On entend généralement par routines la répétition d’actes qui, entre autres, stabilisent les activités quotidiennes en les rendant prévisibles. Pour résumer, ces routines sont interprétées soit comme un processus de repli sur soi ou sur le domicile, soit comme un processus de reprise de contrôle sur le quotidien (Barthe, Clément et Drulhe 1988). De tels processus découleraient d’une anxiété liée à la vulnérabilité des personnes âgées (Reinhardt et Bouisson 2001) ou d’une volonté de sécuriser la marche temporelle du quoti-dien (Membrado 2010). Nous proposerons pour notre part une lecture en termes d’adaptation secondaire au contexte de dépendance.
À domicile : noter pour s’organiserFocalisons-nous d’abord sur la période où Monsieur Lautrec vit à son domi-
cile, de janvier à juin 2011. Les informations qu’il y note de façon répétitive sont essentiellement d’ordre administratif : numéros de sécurité sociale, de téléphone, rendez-vous, noms et adresses de personnes intervenant dans sa prise en charge. Plusieurs services d’aide à domicile interviennent pour lui et sa femme, ce qui implique le passage de multiples professionnels (femmes de ménage, aides-soi-gnantes, infirmières, etc.). Ces passages sont anxieusement minutés dans son jour-nal. Par exemple, il écrit le 7 avril, à propos des deux personnes qu’il emploie directement pour l’entretien de la maison et les repas : « 10 h 1/2 Agnès départ 11 h 55 12 h 1/2 AR Françoise départ 13 h 30 ». Une grande partie des répétitions concernant les professionnels de l’aide, nous avons cherché à restituer la configu-ration déployée autour du couple. En souhaitant démêler les statuts, horaires et employeurs des personnes citées – personnes que l’enquêté peine parfois à recon-naître et désigne de différentes manières –, nous avons dû « ficher » chacun des intervenants, la tâche s’avérant difficile malgré les compléments d’information apportés par les entretiens. Autrement dit, nous avons fait la même chose que M. Lautrec : tout noter pour rendre la situation intelligible. La figure 4 synthétise la configuration d’aide telle qu’elle apparaît dans le carnet de l’enquêté.
En six mois, une trentaine de personnes s’affairent, à distance ou en face à face, autour de M. Lautrec. Le nombre d’institutions mobilisées et la succession des personnels produisent un foisonnement de contacts à gérer. Les répétitions de l’enquêté découlent donc en partie de l’organisation de son quotidien de personne aidée. Cette organisation reflète elle-même la structuration et le fonctionnement du secteur de l’aide à domicile, dans un contexte réglementaire et socio-écono-mique favorisant le turn-over des employés qui y travaillent (Trabut 2011). Si l’on en croit les statistiques disponibles, être entouré par un tel nombre de pro-fessionnels est rare : 74 % des personnes âgées de plus de soixante ans qui bénéfi-cient d’aides professionnelles n’ont a priori affaire qu’à un seul intervenant (Soul-lier et Weber 2011 : 5). Cependant, ces chiffres ne prennent pas en compte les
8990_gen95.indd 81 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement82
changements de personnel : si statistiquement une infirmière vient tous les matins, rien ne dit qu’elle est une seule et même personne. De plus, l’aisance financière de M. Lautrec lui donne les moyens de payer du personnel en plus de celui financé par les fonds publics (notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie). Cela contribue à le placer dans la minorité (30 %) de personnes âgées qui reçoivent des aides au moins une fois par jour (Soullier et Weber 2011 : 7).
En maison de retraite : décrire pour dénoncerL’avis de M. Lautrec concernant son entrée en maison de retraite est sans
appel : pour lui, cet établissement est un « mouroir ». Il emploie cette expression vingt-huit fois durant ses huit mois en maison de retraite et l’associe parfois à des métaphores le désignant lui-même sous un jour péjoratif (« chien », « colis », « paquet », victime de « déportation », « dépouillé »). Ainsi, le 17 septembre 2011, il écrit à destination de ses enfants : « Vous m’avez déposé comme un chien dans un mouroir ». Il leur reproche d’avoir décidé de son entrée en institution sans son
Infirmières
• Catherine
• Mme Marcoccia
A i d e s p r o f e s s i o n n e l l e s
Mr Reims •
• Arlette
• Mme Dumoulin (direction)
• Chef antenne Mme Pécot
• Jean-Louis • Emilia
• Julie • Lydia • Pascale • Mme Ladure
• Martine Doucis
• Dr Perrochet (dentiste)
• Dr Pichon (généraliste)
• Dr Rodriguez (remplaçant)
Mairie • Françoise
• Kinésithérapeute
• Sophie
• Viviane
Voisins
Professionnels
• Mme Blondez (Assistante sociale) • Bérénice
• Yvette
• Mme Hiroto • Agnès
A i d e s i n f o r m e l l e s h o r s - f a m i l l e
M. et Mme
Lautrec
A i d e s f a m i l i a l e s
• Thérèse
• Josiane • René
F i n a n c e m e n t s p u b l i c s
• Mme Sabi (coordinatrice) • Mme Ben Barka (Assistante Sociale)
• Mme Lemay (infirmière visiteuse)
Figure 4 : Cette figure rend compte des personnes citées dans le journal de M. Lautrec du 1er janvier au 14 juin 2011 – c’est-à-dire lorsqu’il vit à domicile. Nous y avons disposé les différentes aides qu’il reçoit (professionnelle, familiale, etc.) selon le cadre dans lequel il y recourt (voisins, enfants, personnes con-tactées via la mairie, etc.). Puis nous avons représenté le nombre d’occurrences de chaque personne dans le journal – les cercles concentriques indiquent des écarts de cinq occurrences. Par exemple, dans le secteur des aides professionnelles, trois infirmières libérales sont citées, Sophie apparaissant treize fois tandis que Viviane quatre.
8990_gen95.indd 82 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 83
VA
RI
Aconsentement et écrit vivre très mal son installation4. Il n’est jamais repassé à son domicile depuis son hospitalisation brutale consécutive à sa chute en juin 2011, n’a pas participé à la sélection de l’établissement et a dû changer de département à cette occasion. Sur ces points, M. Lautrec se trouve dans un cas de figure minori-taire par rapport à l’ensemble des résidents en maison de retraite5.
Dans ce contexte, il donne à ses carnets une nouvelle mission : la dénonciation. En consignant scrupuleusement la routine institutionnelle, il critique sa famille, qu’il juge coupable de son entrée en établissement, et le fonctionnement de ce der-nier. Il en vient à cacher ses carnets dans les tiroirs de son bureau lorsqu’il n’y écrit pas, par peur que leur dimension subversive ne conduise les professionnels à les lui retirer. Les répétitions acquièrent alors un sens supplémentaire : témoignages sys-tématisés de la vie en maison de retraite, elles deviennent les preuves accumulées de ce qu’il observe jour après jour.
M. Lautrec dénonce par exemple son « réveil en fanfare » par les profession-nels, un terme qu’il répète à plusieurs reprises (dix-huit fois en 2011 et cinq fois en 2012). Il note également son impuissance face aux horaires de lever, de repas et de coucher, dont il ne peut pas décider et qu’il ne peut anticiper, car ils sont à la fois imposés et irréguliers. C’est d’autant plus contraignant qu’il est incapable de sortir du lit ou de s’y coucher seul, ainsi que de débarrasser la petite table sur laquelle il prend ses repas. Parfois, il doit attendre plusieurs heures que l’on récupère son plateau pour pouvoir écrire dans ses carnets.
L’écrit conserve néanmoins une fonctionnalité qu’il avait déjà à domicile, celle de lui permettre de se repérer parmi les nombreux professionnels qui gravitent autour de lui. Les répétitions dans le journal de M. Lautrec, en plus de nous ren-seigner sur son mode d’organisation quotidienne, nous permettent de suivre la manière dont il personnalise les employés de l’établissement. La prise en note des caractéristiques de certaines personnes, répétées et cumulées au fil des pages, est un moyen de reconnaître qui vient l’aider et de préparer la conversation. De la même manière qu’il le faisait chez lui, il relève les traits physiques, le nombre d’en-fants, la ville d’origine des professionnels. Il note aussi son appréciation de leurs prestations, à la fois sur un mode scolaire (« B », « TB ») et en fonction d’un degré de « sollicitude » (« souriant », « aimable », « dévoué »), reprenant alors à son compte l’une des normes les plus prégnantes dans les métiers de l’aide (Avril 2008).
M. Lautrec s’engage peu à peu dans une critique sans concession de la maison de retraite. Anciennement associatif, l’établissement relève du secteur privé à but lucratif depuis son rachat par un grand groupe parisien, quelques années aupa-ravant. Si le tarif mensuel du séjour (2800 euros), rapporté au contexte régional, laisserait supposer un accueil haut de gamme, l’enquêté estime que les conditions de vie n’y sont pas du tout satisfaisantes. Dans l’espoir que sa famille lise ce jour-nal après son décès, il y construit une accusation méthodique de l’établissement. Il critique aussi bien les conditions sanitaires – des araignées se promènent sur sa télévision le 13 septembre, des économies sont faites sur ses couches que l’on
8990_gen95.indd 83 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement84
refuse de lui changer aussi régulièrement qu’il le souhaite – que les conditions de travail des employés, conduits selon lui à faire des toilettes approximatives et des écarts aux prescriptions médicamenteuses. Le carnet permet à M. Lautrec de tenir un compte strict des cachets qu’on lui donne au regard de ses prescriptions, donc de réclamer ceux qu’il manque ou de dénoncer les surdoses : « [15 septembre 2011] Par erreur on m’a fait absorber au repas du soir 1 Imovane en entier au lieu de ½ prescrit. Résultat après repas Gd risque de chute ».
Mais l’enquêté s’inquiète avant tout de la disponibilité du personnel, souvent débordé. Il s’insurge du délai nécessaire pour voir son médecin. « En attendant il y a le SAMU et la morgue à ma disposition », commente-t-il le 27 avril 2012. Son inquiétude se focalise sur le bouton d’alarme qui, au-dessus du lit de chaque résident, permet d’appeler les professionnels. M. Lautrec s’aperçoit très vite que les employés ne réagissent pas toujours, ou pas assez rapidement, et qu’il est plus effi-cace d’interpeller directement ceux qui passent dans le couloir. Le 18 septembre 2011, il écrit : « impossible manger ce qui est servi […] petite cuiller oubliée - j’appelle plusieurs fois au BIP, j’interpelle un employé qui va m’en porter une (j’espère) ». D’ailleurs, au cours d’un entretien, l’enquêté nous explique fièrement le stratagème qu’il a mis en place : un sifflet, qu’il garde nuit et jour autour du cou, lui permet de faire suffisamment de bruit pour obliger les employés à se déplacer. Il organise en quelque sorte une « économie de la menace » (Memmi 1998), à la manière de ce 25 mars 2012 où il menace d’appeler les pompiers car l’institution ne s’occupe pas assez vite de réparer une fuite d’eau dans sa chambre.
S’il critique presque quotidiennement les professionnels, M. Lautrec note que la faible qualité de leur travail et leur indisponibilité ne sont pas dues à leurs com-pétences individuelles. Dès le 12 septembre 2011, soit dix jours après son arrivée, il inscrit en haut des pages la mention suivante : « je ne mets pas en cause le person-nel et je le plains d’être obligé de travailler dans les conditions qui lui sont impo-sées ». Il attire l’attention sur les pressions exercées vis-à-vis des employés pour faire des économies au quotidien, sur leur faible effectif en rapport au nombre de résidents, sur les conséquences du turn-over (les nouveaux connaissent moins bien les spécificités de prise en charge de chaque personne) et sur le statut précaire des stagiaires et des jeunes en formation. En replaçant ce qu’il vit au quotidien dans le cadre d’une organisation de travail, il sort ses écrits du registre du journal intime (lisible pour lui-même) pour les placer dans le registre du témoignage (éventuel-lement lisible par d’autres). Il cherche donc à éviter les malentendus, dirigeant sa critique vers l’établissement et non vers les employés pris individuellement, qu’il apprécie pour la plupart.
Cette sensibilité aux conditions de travail doit, nous semble-t-il, être mise en perspective avec la trajectoire de l’enquêté : il a passé la majeure partie de sa vie pro-fessionnelle dans l’administration des ressources humaines. Cette carrière induit, d’une part, un certain rapport à l’écriture, qui lui permet d’organiser l’agenda de cette manière. Une telle forme d’organisation par l’écrit fait en effet intervenir des
8990_gen95.indd 84 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 85
VA
RI
Acompétences liées à une certaine socialisation professionnelle. Ce lien a déjà été formulé par Bernard Lahire (1993b, 1997) qui remarque que cet usage est surtout masculin et associé aux classes moyennes et supérieures. D’autre part, la carrière de M. Lautrec oriente largement son intérêt pour l’organisation de l’entreprise, les fonctions et les conditions de travail des salariés.
Le journal de M. Lautrec nous offre donc un point de vue, socialement situé, entre autres sur le fonctionnement du secteur de l’aide à domicile (Trabut 2011) et sur la « modernisation gestionnaire » en cours dans les maisons de retraite (Det-chessahar et al. 2010). Autrement dit, il n’a pas été directement question d’une expérience du vieillissement comme phénomène individuel, mais de la manière dont un individu interprète et formule les conditions matérielles de son vieillis-sement dans un contexte spécifique. La prise de note systématique de M. Lautrec révèle un ensemble d’« adaptations secondaires » - traduction usuelle de l’expres-sion originale secondary adjustments - au sens de Erving Goffman (1961 : 199) face à sa situation de dépendance à domicile puis en établissement. E. Goffman emploie cette notion pour désigner les appropriations par les reclus, qu’elles soient consensuelles ou subversives, des impératifs fixés par l’institution totale dans laquelle ils vivent. Le journal de l’enquêté, tant à domicile qu’en institution, révèle cette intention de maîtriser un cadre de vie perçu comme totalisant.
Un sens pratique de la dépendanceNous chercherons désormais à comprendre comment se modifie la configura-
tion spatiale dans laquelle évolue l’enquêté, son rapport au corps et les jugements de valeur qu’il produit tout au long de ses carnets. Il est fréquent, dans la sociologie du vieillissement, de parler de « déprise » : cette notion vise à rendre compte des manières individuelles dont les personnes âgées délaissent certains objets, activités ou lieux pour en privilégier d’autres, s’adapter à leur vieillissement physique et ajuster leur identité selon ces adaptations (Mallon 2007, Caradec 2004, Clément 2003). Le journal de M. Lautrec s’interprète aisément au prisme de ce mécanisme. L’enquêté, en effet, abandonne certains objets pour en conserver d’autres et sélec-tionne les activités qu’il préserve (par exemple l’écriture). Aussi, il « reformule son identité », dans la mesure où il fait évoluer les expressions qui le désignent lui-même ainsi que son rapport à son environnement.
Cependant, l’analyse en termes de déprise ne rend compte que de la partie émergée de l’iceberg, c’est-à-dire la mise en mots (qui est souvent une mise en cohérence a posteriori) par un individu. S’il est essentiel de prendre au sérieux le sens attribué au vieillissement par ceux qui le vivent, il nous appartient d’en comprendre ce qui n’est pas dit – la partie immergée de l’iceberg – et les cadres de production – pour filer la métaphore, le réchauffement climatique. Les personnes âgées développent certes des stratégies individuelles de déprise, mais celles-ci
8990_gen95.indd 85 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement86
prennent plus globalement sens dans ce que nous appellerons un « sens pratique de la dépendance », c’est-à-dire une façon de faire face et de prendre position vis-à-vis de contraintes matérielles et symboliques socialement constituées (politiques de la dépendance, cadres législatifs et institutionnels, contexte économique, normes familiales, rôles sociaux liés à l’âge, etc.) en fonction des ressources qu’on peut mobiliser.
La réduction des marges de manœuvre spatiales et corporellesEn relevant systématiquement les mots qu’emploie M. Lautrec afin de dési-
gner les parties de son corps, les espaces et les objets qui l’entourent, on peut se rendre compte qu’à tous ces niveaux, ses marges de manœuvre se restreignent au fil du temps. Mais surtout, l’énonciation de ces marges joue différents rôles dans ses écrits. Commençons par la dimension corporelle. Le 18 février 2011, à la suite d’une grande douleur physique, l’enquêté se plaint :
« Aucune force - aucun muscle pour se lever d’un siège ou du lit. Gde douleur arthrose bas des reins j’en pleurerai abcès qui revient entre œil droit et mâchoire avec Stylnox je dors de 3 h à 8 h. Mais vessie m’oblige dangereusement à aller au WC 1 ou 2 fois. Je me rendors avec ½ Stylnox. Françoise dit de parler au Dr Pichon il existe des cachets légers morphine - gros problème mâchoire abcès côté droit sous l’œil. »
La description des problèmes de santé « déclenche » la superposition d’un registre émotionnel au registre administratif privilégié jusque-là. Dès lors, la mise par écrit récurrente des problèmes corporels occupe une large part du journal, soit en faisant l’objet de nombreuses plaintes, soit en creux, parce que ces problèmes empêchent M. Lautrec d’écrire – comme en janvier et février 2012 où il reste sous oxygène la plupart du temps et ne tient plus ses carnets à jour (voir figure 3). On distingue deux formes de plainte. L’une désigne l’incapacité à effectuer des gestes courants de façon autonome, notamment se déplacer. L’autre renvoie à des pertes d’activité, notamment la lecture et l’écriture. À domicile, ces pertes engagent l’image sociale que l’enquêté cherche à maintenir au moins pour lui-même et sa femme. En établissement, cet enjeu perdure. Par exemple, écrire sur son carnet plutôt que regarder la télévision « distingue » doublement l’enquêté : il cherche, par sa pratique de l’écriture, à rendre visible à la fois un certain capital culturel et une aptitude physique et mentale préservée en comparaison aux autres résidents6.
De toutes les parties de son corps décrites dans les carnets, seuls les cheveux ne sont jamais négativement connotés, sûrement parce qu’ils ne provoquent pas de douleur et parce que l’enquêté s’attache à leur entretien, qu’il considère comme un signe de respectabilité maintenue. C’est également cette respectabilité qui est en jeu dans son refus d’utiliser le fauteuil roulant. Incapable de marcher, il se déplace assis sur une chaise de bureau, poussant sur ses pieds et s’agrippant aux meubles pour avancer. L’un des enjeux de ce refus est de ne pas « pouvoir » se rendre aux repas collectifs au rez-de-chaussée alors que sa chambre se trouve à l’étage. Il tient à
8990_gen95.indd 86 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 87
VA
RI
Amanger seul, à ne pas être associé aux autres résidents. L’ensemble de ses problèmes corporels accroît la dimension dénonciatrice des carnets. D’un côté, M. Lautrec montre à ses enfants (anticipant leur lecture posthume) à quel point il souffre dans ces circonstances. D’un autre côté, il décrit en maison de retraite une insécurité jugée préoccupante, voire scandaleuse, jouant de sa vulnérabilité physique comme d’un facteur aggravant la responsabilité de ses enfants et de l’institution.
Quant à la configuration spatiale, les écrits de M. Lautrec y font référence de manière plus indirecte. Si l’enquêté ne s’en plaint pas, comme il le fait avec son corps, il évoque à travers ses descriptions du quotidien un ensemble de lieux. À son domicile, il mentionne des espaces où il indique s’être rendu, majoritairement cantonnés aux pièces fonctionnelles de sa maison (bureau, toilettes, séjour/salon, chambre, cuisine), et des espaces auxquels il fait référence sans toutefois y aller. Ces derniers se composent de trois sous-types : les lieux de gestion de son quotidien où se rendent, pour lui, ses aidants (tels que le grenier, le garage, le supermarché) ; les lieux relatifs à son suivi médical et social, souvent des institutions avec lesquelles il communique par téléphone ou par courrier (Sécurité sociale, URSSAF, etc.) ; les lieux désignant la provenance des personnes qu’il côtoie, leur habitation ou leur destination (« mon gendre part en Bourgogne »).
Cette configuration change en maison de retraite. L’espace vécu par M. Lau-trec se restreint désormais à sa chambre. Les espaces qu’il mentionne sans s’y rendre se réduisent également, puisque ses écrits n’évoquent plus que les lieux de provenance des personnes qu’il côtoie (sa famille essentiellement) et les lieux annexes à sa chambre (tels que le couloir). Son entrée en maison de retraite a donc entrainé une réduction des espaces où il se rend et au sujet desquels il écrit sans s’y rendre. Précisons cette reconfiguration. Tout d’abord, la zone dans laquelle l’enquêté se déplace physiquement se modifie. On passe d’une zone de déplace-ment dont l’unité est la pièce (salon, chambre, etc.) à une désignation mixte entre des pièces (la chambre et les WC) et des objets (lit, fauteuil, bureau). Les objets deviennent des lieux à part entière. Ensuite, il s’opère une modification de ces lieux frontaliers de la zone de déplacement où l’enquêté ne se rend qu’exceptionnelle-ment : nous les appellerons « espaces limites ». À domicile, il s’agissait surtout du jardin, mentionné lorsque des proches y tondaient la pelouse. M. Lautrec n’y va lui-même qu’une seule fois, à l’occasion d’une visite familiale, à la fin du mois de mars 2011. Il y a également le garage, où ses aidants allaient mettre des produits au congélateur. En maison de retraite, deux types d’espaces limite sont mentionnés. Le couloir et les chambres attenantes représentent une interface avec l’institution. Ils sont parfois énoncés comme lieux de ressources pour aller chercher de l’aide ou de la compagnie, parfois comme lieux de nuisances, en particulier sonores. La fenêtre de la chambre, quant à elle, marque l’interface avec l’extérieur de l’établis-sement. L’enquêté se plaint d’avoir physiquement du mal à y accéder et s’en sert principalement pour tromper l’ennui en observant le paysage. Enfin, les espaces de gestion à distance, auxquels M. Lautrec faisait appel par téléphone (les bureaux de
8990_gen95.indd 87 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement88
l’URSSAF, du conseil général, etc.), disparaissent du journal : la maison de retraite gère maintenant son suivi médical et social. Concrètement, il n’appelle plus que l’accueil de l’établissement, qui se charge des relations avec l’extérieur et, ponctuel-lement, le bureau du médecin qui le suit.
De façon transversale, on remarque à la fois une médicalisation de l’environ-nement matériel – c’est-à-dire une proportion croissante d’objets à connotation médicale – et une aliénation du rapport aux objets – l’enquêté choisit de moins en moins la provenance des objets et services qui lui permettent de vivre. Sur ce der-nier point, les listes de nourriture offrent un bon exemple : à domicile, M. Lautrec établissait régulièrement des listes de courses à faire. En établissement, il liste ce qu’on lui a donné à manger.
Un tribunal imaginaireParallèlement à cette restriction des marges de manœuvre spatiales et corpo-
relles, on constate une amplification des élaborations morales, c’est-à-dire l’inté-gration de jugements péjoratifs ou mélioratifs aux descriptions du quotidien. Par exemple, l’utilisation de guillemets exprime un décalage entre les attentes de l’en-quêté et ce qu’il se passe effectivement d’après lui. La visite trop courte de sa fille, le 29 septembre 2011, est ainsi une « visite ». Sa famille trop peu présente devient, le 13 novembre 2011, sa « famille ». Le 1er octobre 2011, le veilleur de nuit est dési-gné comme un « infirmier ». Et une professionnelle dont il doute des compétences lorsqu’elle vient prendre sa température se voit qualifiée de « serveuse » le 7 octobre 2011. À partir de son entrée en maison de retraite, M. Lautrec se radicalise dans la mesure où il répartit son entourage en deux camps, les alliés et les ennemis. Le 15 octobre 2011, il raconte : « Sébastien [petit fils] me Tel. […] c’est gentil. On ne lui avait pas dit que j’étais dans 1 mouroir ». Sébastien est un allié par défaut. N’étant pas au courant de l’entrée en maison de retraite de son grand-père, il ne peut pas être complice de ce que M. Lautrec nomme parfois sa « déportation ».
Mais les élaborations morales procèdent surtout par répétition et remanie-ment d’évènements tout au long du journal, en augmentant leur degré de précision (par exemple en ajoutant des dates) et en mettant en évidence les implications morales des actions des protagonistes. Lorsque M. Lautrec vivait à son domicile, le récit de sa relation avec sa femme a par exemple fait l’objet de tels remaniements. Le 7 mars 2011, il écrit pour la première fois :
« Chat me coûte beaucoup. Besoins chaque nuit dans couloir, pipi dans la cuisine. Je le sors pourtant chaque soir et le rentre pour que Mamie « couche » avec. De plus il renverse souvent timbale sur table roulante. »
Cet extrait est le premier d’une série de remarques par lesquelles l’enquêté cherche à montrer la qualité des soins qu’il apporte à son épouse, qualité illustrée par l’attention au chat (que sa femme affectionne), les médicaments donnés et les petits déjeuners qu’il prépare. Par exemple, le 15 mars 2011, « mamie ne peut
8990_gen95.indd 88 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 89
VA
RI
As’endormir sans son chat. Heureusement que je le lui rentre en fin de soirée ». Le 20 mars 2011, l’auteur se justifie de cette apparente fixation :
« Comme chaque jour Frisbee a fait ses crottes au bord du couloir, à côté de sa caisse c’est mon cadeau au lever. Elle dort chaque nuit [dans la] chambre [de] Mme, je suis le seul qui peut lui rendre ce service, sa satisfaction me récompense de mes efforts. »
Porter attention au chat, médiateur conjugal malgré lui, et conter cette atten-tion jour après jour permet de laisser une trace, donc de créer une preuve, de sa capacité à bien s’occuper de sa femme : « Je suis récompensé de mes efforts pour mon épouse et je continuerai malgré des “interventions” qui posent beaucoup d’interrogation sur la prise en compte des souhaits et de l’intérêt des malades », précise-t-il le 22 mars. Par ces « interventions », il désigne les mises en cause de ses entourages familiaux et professionnels, qui doutent de son aptitude à gérer ce quotidien conjugal. C’est d’ailleurs l’un des motifs mobilisés par ses enfants pour justifier son placement en maison de retraite séparément de sa femme. Face à ces menaces qu’il dit « sentir venir » dès les débuts du premier carnet, M. Lautrec prépare sa défense.
Il prépare également un réquisitoire : la deuxième série d’histoires répétées a pour point de départ la chute qui, le 14 juin 2011, fait basculer sa vie et celle de son épouse. L’enquêté récapitule onze fois les éléments suivants sous des formes différentes, entre le 14 juin et le 8 octobre [extrait du 14 août 2011] :
« 14 juin 21 h chute avec Mme23 h ½ pompiers15 juin 0 h 30 clinique l’Alliance »
Les deux derniers jours de cette période, il met pour la première fois en cohé-rence l’ensemble de son histoire depuis sa chute :
« [7 octobre 2011] Récapitulatif. 14 juin, 21 h chute dans ma chambre avec Mamie. 23 h SAMU appelé vient enfin = recouche Mamie et me prendra [en] charge – à 0 h 30 me dépose urgences clinique de l’Alliance. Je ne reviendrai jamais chez moi où j’ai vécu 36 ans. 17 juin broche épaule après […]. 18 juin Thérèse vient, se charge de tout. En état d’une incapacité physique et morale j’ai été abusé. On a voulu depuis longtemps me faire passer pour un Alzheimer décider pour moi. 8 août je passe avec spécialiste un nouveau [test] Alzheimer à la clinique de l’Alliance résultat 26/307. 6 septembre à 16 h on me prend à l’Alliance. 17 h on me dépose comme un colis. »
« [8 octobre 2011] Résumé. 14 juin après double chute dans ma chambre avec mon épouse à 21 h – à 23 h 50 SAMU relève mon épouse, la recouche dans sa chambre et me transporte à 3 kms clinique de l’Alliance. Je ne reviendrai jamais chez moi. En incapacité physique et morale. Ma fille Thérèse « prend » tout en main et le 6 sep-tembre me dépose dans un mouroir. »
8990_gen95.indd 89 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement90
Il prépare ainsi une plaidoirie en sa faveur (lorsqu’il s’occupe de sa femme à domicile) et un réquisitoire à la fois contre ses enfants (qui l’ont placé en insti-tution et qu’il soupçonne de vouloir récupérer prématurément son héritage) et contre l’établissement (à cause des mauvais traitements qu’il estime y subir). Au passage, il règle ses comptes passés, mettant en opposition son style de vie, « sain » et « travailleur », et celui de ses enfants. Il revient notamment sur la scolarité qu’il juge catastrophique de certains d’entre eux :
« [20 novembre 2011] René [oublie] qu’il n’a rien foutu à l’école même en pension et que je lui ai payé 2 ans école privée à son retour du régiment + 2 ans IUT (sans jamais de bourse) il a pu avoir le bac et continuer les études – normalement à 14 ans il aurait dû passer 1 CAP et devenir ouvrier et Thérèse aussi. Seule Josiane a bien travaillé. »
Au fil des accusations concernant son placement en maison de retraite se rejouent les conflits familiaux antérieurs, comme le montrent d’autres recherches (Billaud 2010). Les jugements moraux ne s’appuient donc pas uniquement sur un passé récent. Pour les comprendre, il faut les replacer dans l’histoire des rela-tions familiales. La formulation de ses réquisitoires permet d’en saisir une dernière dimension. À plusieurs reprises, surtout à son entrée en maison de retraite, M. Lautrec s’insurge :
« [16 septembre 2011] L’acharnement que vous avez mis à m’isoler pour mieux me dépouiller, à me traiter pire qu’un chien, à tromper votre entourage qu’à me livrer comme 1 colis dans une boutique près de chez vous en faisant croire à un rapproche-ment familial vous ne pouvez pas longtemps tromper tout le monde. »
Lors de ces accusations virulentes, deux aspects sont mis en avant. D’une part, il s’adresse à ses enfants (supposant qu’ils liront ses écrits après sa mort) et leur souhaite de connaître sa situation quand ils seront vieux pour pouvoir enfin le comprendre. D’autre part, il anticipe son décès en espérant que ses enfants se sen-tiront coupables a posteriori. Le 23 juillet 2011, l’enquêté écrit : « Me mettre dans grand sac noir, j’y suis déjà moralement, vous m’y avez mis volontairement, [à mon enterrement] pas de cinéma après, ni voisin - ni famille. » Il organise une mise en scène de l’approche de sa mort jusque dans la relation d’enquête, par exemple en nous donnant à la fin du dernier entretien une enveloppe de la Croix-Rouge sur laquelle est imprimé : « Mourir de solitude n’est pas qu’une expression ». Égale-ment, accrochée à la lampe de son bureau, bien en évidence, une petite feuille qu’il a rédigée stipule quelques recommandations à suivre après son décès.
À mesure que ses marges de manœuvre spatiales et corporelles se restreignent, M. Lautrec utilise de plus en plus son carnet pour mettre en scène un véritable tribunal imaginaire. L’ensemble de ces dimensions – corporelles, spatiales, morales – ne peuvent être seulement interprétées comme des marques de l’expérience du vieillissement. Nous avons montré que l’accroissement des contraintes corpo-relles qui accompagnent le vieillissement gagne à être compris dans son contexte
8990_gen95.indd 90 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 91
VA
RI
Ad’énonciation. Dans le cas de M. Lautrec, la formulation même de ces contraintes s’explique à travers sa dénonciation des conditions de vie en maison de retraite et les enjeux de respectabilité associés. Nous avons également observé la restriction progressive des espaces fréquentés par M. Lautrec. L’analyse de cette restriction en termes de repli sur soi serait insuffisante, puisque ce processus dépend inti-mement du logement auquel l’enquêté a accès (à domicile, une maison, puis en maison de retraite, une chambre), des personnes mobilisées autour de lui (qui se rendent dans certains espaces à sa place) et des moyens de communication légitimes existant entre lui et les institutions dont il dépend (par exemple, une fois en maison de retraite, l’établissement contacte pour lui le Conseil général, la Sécurité sociale, etc.). Enfin, plutôt que d’analyser le vieillissement au prisme d’un désintérêt progressif pour le monde, on a privilégié une approche en termes de jugements moraux dont l’élaboration prend appui sur les conditions de vie, les relations familiales passées (elles-mêmes cristallisant des enjeux plus vastes, par exemple de positionnement de classe ou d’ascension sociale) et plus largement les normes sociales relatives aux comportements familiaux.
* * *
Le matériau d’enquête présenté et la manière dont nous proposons de l’analy-ser apportent une contribution à la sociologie du vieillissement, qui prend souvent comme objet l’expérience des individus. Sans faire de M. Lautrec un représentant des personnes âgées dans la France actuelle – nous avons montré la spécificité de sa situation –, son journal nous a permis d’éclairer des mécanismes qui traversent plus globalement le processus de vieillissement. Pour mettre au jour ces méca-nismes, nous avons étudié nos matériaux d’enquête en les rapportant aux contextes sociaux du vieillissement de M. Lautrec (par exemple l’organisation de la maison de retraite) et aux conditions du recueil des données (il nous voit par exemple comme les portes parole potentiels des injustices qu’il estime vivre). Ce décentre-ment du regard du chercheur a été facilité par l’enregistrement au jour le jour des mises en mots par l’enquêté de ce qu’il vit – mais il aurait également été possible à partir d’autres données, par exemple des entretiens. Parler du vieillissement à une échelle individuelle nécessite dans tous les cas une prudence théorique et métho-dologique consistant à s’interroger sur les cadres de production des « expériences » saisies à partir de leur formulation orale, écrite ou sous toute autre forme.
Plus largement, nous avons abordé la question des conditions méthodolo-giques qui permettent aux sciences sociales de pouvoir rendre compte de manière rigoureuse des « expériences » individuelles associées à une catégorisation spé-cifique – l’« expérience » d’être un homme ou une femme, d’être jeune ou vieux, d’appartenir à un certain milieu social, etc. Que l’on prenne pour matériaux les énonciations orales ou écrites d’un individu, de plusieurs ou d’un grand nombre, la mise en forme des discours des enquêtés n’est pas suffisante. Ce n’est pas produire une sociologie compréhensive des individus que de souligner leurs « marges de
8990_gen95.indd 91 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement92
liberté », de retranscrire leurs opinions et émotions concernant leur quotidien ou les « mondes » qui les entourent, sans analyser conjointement ces « marges », opinons, émotions, quotidiens et « mondes » au prisme de leurs conditions d’énonciation et des cadres qui les contraignent. En d’autres termes, dans l’analyse du vieillisse-ment ou d’autres domaines, ce qu’on appelle l’expérience devrait moins constituer une clef de compréhension des individus à l’échelle individuelle qu’un processus dont la production indissociablement micro- et macrosociale est à comprendre.
ÉpilogueM. Lautrec est décédé le 3 mars 2014, à la maison de retraite. Nous avons
appris qu’il avait donné son corps à la science, un geste impliquant un coût finan-cier à sa charge (celui du transport du corps), voire à celle de sa famille. Ce don interdit toute cérémonie funéraire et lieu de recueillement individuel.
Ouvrages cités
Ameisen, Jean-Claude, Guillaume Le Blanc et Éric Minnaërt. 2008. Anthropolo-gies du corps vieux. Paris, Puf.Avril, Christelle. 2008. « Les aides à domicile pour personnes âgées face à la norme de sollicitude », Retraite et société, n° 53 : 49-65.Balard, Frédéric. 2011. « Vivre et dire la vieillesse à plus de 90 ans, se sentir vieillir mais ne pas être vieux », Gérontologie et société, vol. 138, n° 3 : 231-244.Barthe, Jean-François, Serge Clément et Marcel Drulhe. 1988. « Vieillesse ou vieillissement ? Les processus d’organisation des modes de vie chez les personnes âgées », Les Cahiers de la recherche sur le travail social, n° 15 : 11-31.Beaud, Stéphane et Florence Weber. 1997. Guide de l ’enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques. Paris, La Découverte.Béliard, Aude. 2010. « Des familles bouleversées. Aux prises avec le registre diagnostique Alzheimer », thèse de sociologie, université Paris VIII.
Billaud, Solène. 2010. « Partager avant l’héritage, financer l’hébergement en institution. Enjeux économiques et mobilisations familiales autour de personnes âgées des classes populaires », thèse de sociologie, EHESS.
Bourdieu, Pierre. 2000 [1972]. Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de Trois études d’ethnologie kabyle. Paris, Seuil.
Caldas, Celia P. et Carina Berterö. 2007. « Living as an oldest old in Rio de Janeiro : the lived experience told », Nursing science quarterly, vol. 20, n° 4 : 376-382.
Caradec, Vincent. 2004. Vieillir après la retraite. Paris, Puf.
Clément, Serge. 2003. « Le vieillissement avec le temps et malgré le monde », Empan, n° 52 : 14-22.
Cumming, Elaine et William E. Henry. 1961. Growing Old : The Process of Disengagement. New York, Basic Books.
Detchessahar, Mathieu, Michel Devigne et Arnaud Stimec. 2010. « Les modes de
8990_gen95.indd 92 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
Genèses 95, juin 2014 93
VA
RI
Arégulation du travail et leurs effets sur la santé des salariés : deux établissements d’accueil des personnes âgées en quête de management », Finance, Contrôle, Stratégie, vol. 13, n° 4 : 39-74.Fabre, Daniel. 1997. « Introduction. Seize terrains d’écriture », in Daniel Fabre (éd.). Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes. Paris, Éditions de la MSH : 1-56.Fromage, Benoît. 2007. « Approche du vieillissement à travers l’expérience subjective », L’Information Psychiatrique, vol. 83, n° 3 : 229-233.Futrell, May, Catherine Wondolowski et Gail J. Mitchell. 1993. « Aging in the oldest old living in Scotland : a phenomenological study », Nursing science quarterly, vol. 6, n° 4 : 189-194.Godicheau, François. 2002. « Militer pour survivre. Lettres d’anarchistes français emprisonnés à Barcelone (1937-1938) », Sociétés & Représentations, n° 13 : 137-150.Goffman, Erving. 1961. Asylums. Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Chicago, Aldine.Gognalons-Nicolet, Maryvonne. 1994. « Du vieillissement normal au vieillissement réussi. Aspects culturels, sociaux et psychologiques », Cahiers psychiatriques genevois, n° 17 : 11-36.Gross, James J. et al. 1997. « Emotion and aging : experience, expression, and control », Psychology and aging, vol. 12, n° 4 : 590-599.Groult, Séverine et Joëlle Chazal. 2011. « La vie sociale des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées », Dossier Solidarité et Santé, n° 18 : 52-59.Heikkinen, Riitta-Liisa. 1993. « Patterns of Experienced Aging with a Finnish Cohort », International Journal of Aging and Human Development, vol. 36, n° 4 : 269-277.— 2000. « Ageing in an autobiographical context », Ageing & Society, vol. 20, n° 4 : 467-483.— 2004. « The experience of ageing and advanced old age : a ten-year follow-up », Ageing & Society, vol. 24, n° 4 : 567-582.
Joly, Nathalie. 1997. « Écritures du travail et savoirs paysans. Aperçu historique et lecture de pratiques. Les agendas des agriculteurs », thèse en sciences de l’éducation, université Paris-X Nanterre.Lahire, Bernard. Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de l ’« échec scolaire » à l ’école primaire. Lyon, Presses universitaires de Lyon.—. 1993b. La Raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques et lectures en milieux populaires. Lille, Presses universitaires de Lille.—. 1997. « Masculin-féminin. L’écriture domestique », in Daniel Fabre (éd.). Par écrit. Ethnologie des écritures quotidiennes, Paris, Éditions de la MSH : 145-161.Lenoir, Rémi. 1979. « L’invention du “troisième âge” », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 26-27 : 57-82.Longino, Charles F. and Jason L. Powell. 2009. « Toward a Phenomenology of Aging », in Coll., Handbook of theories of aging, New York, Springer : 375-387.Mallon, Isabelle. 2007. « Le “travail de vieillissement” en maison de retraite », Retraite et société, n° 52 : 39-61.Marquier, Rémy. 2011. « Les résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées et leurs proches : des opinions pas toujours identiques », Dossier Solidarité et Santé, n° 18 : 65-74.Membrado, Monique. 2010. « Les expériences temporelles des personnes aînées : des temps différents ? », Enfances, familles, générations, n° 13 : i-xx.Memmi, Dominique. 1998. « Le corps protestataire aujourd’hui : une économie de la menace et de la présence », Sociétés contemporaines, vol. 31, n° 1 : 87-106.Parse, Rosemarie R. 1981. Man-living-health : a theory of nursing. New York, Wiley.Prévot, Julie. 2011. « La satisfaction des personnes âgées vivant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en maison de retraite en 2007 », Dossier Solidarité et Santé, n° 18 : 28-36.
8990_gen95.indd 93 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin
94 Solène Billaud et Baptiste Brossard s L’« expérience » du vieillissement
Reinhardt, Jean-Claude et Jean Bouisson. 2001. Vieillissement, rites et routines. Paris, L’Harmattan.Shin, Kyung Rim et Mi Young Kim. 2003. « Study on the lived experience of aging », Nursing & health sciences, vol. 5, n° 4 : 245-252.Soullier, Noémie et Amandine Weber. 2011. « L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile », Études et Résultats, n° 771 : 1-8.Steverink, Nardi et al. 2001. « The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being », The Journals of gerontology, vol. 56, n° 6 : 364-373.Trabut, Loïc. 2011. « Nouveaux salariés, nouveaux modèles : le maintien à domicile
des personnes âgées dépendantes », thèse de sociologie, ENS/EHESS.Weber, Amandine. 2011. « Regards sur les conditions d’entrée en établissement pour personnes âgées », Dossier Solidarité et Santé, n° 18 : 17-27.Weber, Florence. 1993. « L’ethnographe et les scripteurs populaires ». Enquête, n° 8 : 159-189. Weber, Florence, Séverine Gojard et Agnès Gramain. 2003. Charges de famille : dépendance et parenté dans la France contemporaine. Paris, La Découverte.
Notes1. Tous les noms de personnes et de lieux ont été modifiés.2. M. Lautrec nous dit en entretien avoir tenu d’autres agendas avant 2011. Il soupçonne son gendre de les avoir mis « dans la benne » avec beau-coup d’autres affaires à son entrée en institution. Nous ne savons pas quelle était la teneur de ces précédents écrits : pendant les entretiens, l’enquêté élude la question malgré notre insistance. On peut soupçonner que les pratiques d’écriture sur agen-das de M. Lautrec avaient déjà cours avant 2011 et qu’elles prennent racine dans sa socialisation pro-fessionnelle de planification du quotidien par l’écrit. Notre doute porte surtout sur le contenu : à partir de quel moment les agendas ont-ils servi également de journaux intimes ?3. Pour autant, ses enfants n’ont apparemment pas manifesté le désir qu’il fasse l’objet d’une mesure de protection juridique.4. Julie Prévot écrit qu’« un résident qui déclare avoir bien vécu les premiers moments dans l’éta-blissement a une chance presque 6 fois (5,8) supé-rieure de déclarer bien vivre aujourd’hui dans cet
établissement qu’un résident qui a mal vécu son arrivée » (Prévot 2011 : 33).5. Dans l’enquête sur les résidents en Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA) 2007, 22 % des répondants déclarent ne pas avoir participé au choix de l’établissement (Marquier 2011 : 68), 20 % déclarent avoir dû changer de département (Weber 2011 : 23) et 23 % déclarent être passés de l’hôpital à la maison de retraite sans retourner à leur domicile (Weber 2011 : 19).6. Dans la même enquête, à la question « que font les résidents, en général, l’après-midi ? », seuls 4 % des répondants déclarent écrire ou faire leur cour-rier (Groult et Chazal 2011 : 58).7. Il s’agit du score au Mini-Mental State Examination, un test neuropsychologique visant à produire une évaluation courte mais globale de l’ensemble des fonctions cognitives d’un patient. 26/30 est généralement considéré par les médecins comme un score plutôt correct mais à surveiller.
8990_gen95.indd 94 12/06/14 16:30
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 16
/09/
2014
16h
54. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Biblio S
HS
- - 193.54.110.35 - 16/09/2014 16h54. © B
elin