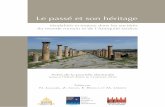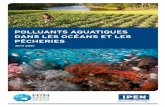« La sorcière en son milieu naturel. Démon et vetula dans les écrits sur le pouvoir des...
Transcript of « La sorcière en son milieu naturel. Démon et vetula dans les écrits sur le pouvoir des...
Béatrice Delaurenti
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATURELDÉMON ET VETULA DANS LES ÉCRITSSUR LE POUVOIR DES INCANTATIONS
Le débat intellectuel qui s’est cristallisé au Moyen Age sur la ques-tion des incantations peut apporter une contribution à l’étude de lasorcellerie. Théologiens, philosophes et médecins se sont interrogéssur le statut des formules incantatoires, plus précisément sur l’originede leur pouvoir. Pour certains auteurs, l’efficacité des incantationsétait d’origine démoniaque; pour d’autres, il était possible de recon-naître des situations où la puissance des mots, virtus verborum, était duressort de la parole humaine, un ressort entièrement naturel qui nedonnait aucune prise au soupçon d’une influence démoniaque. Auxtenants traditionnels de l‘interprétation démoniaque s‘opposent ainsiles artisans d’une interprétation des incantations par les seules forcesd’une action naturelle. Cette opposition apporte un éclairage latéralà la question des relations entre sorcellerie, magie démoniaque etdémonologie à l’époque médiévale.
La mise en question du pouvoir des incantations et de ses causesa suscité, en marge des condamnations théologiques qui dénonçaientun pacte démoniaque, une interprétation naturaliste de leur prodi-gieuse efficacité. Les discussions sur la possibilité d’une incantationnaturelle ont été amorcées dans les années 1230 avec les écrits deGuillaume d’Auvergne. Elles se sont arrêtées au tournant du XIVeet de XVe siècle, lorsque s’est dessiné au contraire un mouvementunanime de rejet des incantations, poussé à la fois par le dogmatismedes théologiens et par le scepticisme des médecins. Entre ces deuxjalons chronologiques, depuis les années 1230 jusqu’aux années 1380,les débats doctrinaux sur les incantations ont tracé une parenthèsenaturaliste dans l’histoire de la réprobation des pratiques supersti-tieuses. Pendant cette parenthèse, on a tenu la virtus verborum pourune force naturelle. Ce que nous appelons ‘parenthèse naturaliste’
367
désigne un ensemble de réflexions isolées qui se sont développées àla marge, dans une société d’abord préoccupée par le démon. Dansune perspective plus large d’histoire intellectuelle, la parenthèse desannées 1230-1370 apparaît comme un moment à part, une séquenceisolée et précaire dans laquelle se déploie un naturalisme médiévalbien différent du naturalisme de l’époque moderne 1.
La mise au jour de cette parenthèse naturaliste suscite quelquesquestions sur les rapports intellectuels entre deux groupes d’auteurs:d’un côté, ceux qui interprètent la parole incantatoire comme unemanifestation des forces de la nature et de l’homme; de l’autre, ceuxqui participent à l’élaboration d’une démonologie chrétienne. Deuxdiscours sont en présence, l’un explore les limites de la natura,l’autre est attentif aux manifestations démoniaques. Il s’agit pournous d’évaluer quelles ont été les interactions entre ces deux dis-cours. Le discours démonologique a-t-il récupéré à son profit lesarguments qui prétendaient délester le pouvoir des incantations detout poids démoniaque? Inversement, le discours naturaliste a-t-ilrecyclé certains thèmes de la démonologie naissante? Autrement dit,quels sont les points de rencontre et de friction entre ces deux dis-cours? Quels échos, quelles réverbérations pouvons-nous percevoird’un champ à l’autre?
Les sources de cette étude ne relèvent ni d’une histoire de lamagie, ni d’une histoire de la sorcellerie. Ce sont les débats philoso-phiques, théologiques et médicaux sur les causes des incantationsqui en constituent le socle; ils fournissent un excellent observatoirepour tester la frontière qui sépare le pôle démoniaque et le pôlenaturel. Cette frontière demeure un repère implicite, mais perma-nent dans les textes doctrinaux que nous avons étudiés, y comprislorsque l’interprétation démoniaque est explicitement mise à l’écart.La question des causes des incantations, telle qu’elle est évoquéedans les débats doctrinaux, permet de contourner la question de lasorcellerie et de la démonologie afin de l’aborder de façon latérale,par le prisme de la parenthèse naturaliste du XIIIe-XIVe siècle.
Nous avons choisi de limiter notre corpus aux trois auteurs lesplus caractéristiques de ces débats doctrinaux: le franciscain RogerBacon, le médecin Pietro d’Abano et le théologien séculier Nicole
368
BÉATRICE DELAURENTI
1. Cf. B. Delaurenti, La puissance des mots, «Virtus verborum». Débats doctrinauxsur le pouvoir des incantations au Moyen Age, Paris 2007.
Oresme. Ces auteurs occupent une place majeure dans la parenthèsenaturaliste que nous avons évoquée. Leur stratégie de discours excluttout appel au démon pour expliquer le pouvoir des incantations.Leurs argumentations se distinguent par leur cohérence, par leurrichesse, par la finesse des nuances. Ils représentent trois paliers suc-cessifs dans la défense d’une virtus verborum naturelle.
Étudier conjointement Roger Bacon, Pietro d’Abano et NicoleOresme présente un intérêt supplémentaire: ces auteurs ont vécu etécrit à trois moments clés de l’histoire de la démonologie et de lasorcellerie. À l’époque où Roger Bacon développe le concept devirtus verborum dans l’Opus Maius et l’Opus Tertium, dans les années1266-1268, la démonologie chrétienne est encore balbutiante. C’estle moment où les fondements idéologiques de la répression des sor-cières se mettent en place. Bacon est contemporain de l’interpréta-tion des incantations par Thomas d’Aquin en fonction d’un pactedémoniaque. Pietro d’Abano écrit quarante à cinquante plus tard. Ilachève en 1310 son encyclopédie médicale, le Conciliator. C’estl’époque où prennent forme les thèmes démonologiques qui carac-térisent la fin du Moyen Age. Les démons, jadis intégrés au mondenaturel, gagnent alors une sorte d’autonomie dans la pensée occi-dentale 2. Les procès pour magie et sorcellerie, en revanche, sontencore peu nombreux dans les premières décennies du XIVe siècle.Nicole Oresme écrit dans la seconde moitié du XIVe siècle, à nou-veau cinquante ans plus tard. Le nombre des procès pour magie etsorcellerie a encore diminué, alors que la magie et l’astrologieconnaissent un succès grandissant dans les milieux lettrés. Oresmerédige son traité De configuratione, dans les années 1351-62, puis sesQuodlibeta en 1370. Après 1375, le nombre de procès de sorcelleriecommence à augmenter; sa croissance est spectaculaire jusqu’en1435 3. On sait que le moment décisif se situe dans les années 1435-1440: ces années-là sont marquées par l’élaboration d’un discoursconstruit et abouti sur les sorcières et sur le sabbat 4. Le véritable
369
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
2. Cf. A. Boureau, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Europemédiévale (1260-1350), Paris 2004.
3. Pour une chronologie de la genèse de la chasse aux sorcières, cf. J. P.Boudet, Entre science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occidentmédiéval (XIIe-XVe siècle), Paris 2006, 449-68.
4. Sur l’émergence du sabbat, cf. notamment L’imaginaire du sabbat. Editioncritique des textes les plus anciens (1430c.-1440 c.), réunis par M. Ostorero, A. Para-vicini Bagliani et K.Utz Tremp, en collab. avec C. Chène, Lausanne 1999.
démarrage des procès en sorcellerie se situe donc après la périoded’activité d’Oresme, au tournant du XIVe et du XVe siècle.
Roger Bacon, Pietro d’Abano et Nicole Oresme ont ainsi étudiéles incantations à trois moments qui ponctuent la genèse de ladémonologie et de la sorcellerie. Nous voudrions analyser commentils ont traité, chacun à son tour, deux thématiques caractéristiquesde cette genèse: le rôle du démon et la place de la sorcière.
I. La nature et les démons
Lorsque Roger Bacon, puis Pietro d’Abano, et enfin NicoleOresme s’intéressent à la question du pouvoir des incantations, ilscombinent chacun à leur manière plusieurs axes interprétatifs. Leursexplications font intervenir la puissance de l’âme humaine, l’in-fluence des astres, la matière sonore et verbale des formules.
L’idée que les mots ont un pouvoir, un pouvoir naturel, apparaîtexplicitement chez Roger Bacon: c’est la première fois que lanotion de virtus verborum est soutenue et argumentée. L’approche deBacon est large et englobante, elle fait feu de tout bois: chaque fac-teur causal trouve une place dans un schéma explicatif. Le langage,affirme-t-il, possède un pouvoir plus puissant que la magie, unevirtus qu’il rapporte aux astres, à l’âme et l’émission verbale elle-même. La parole est conçue comme un processus dynamique: lesmots, porteurs des impressions de l’âme, agiraient par contact, enprovoquant une altération de l’espace aérien. La notion de virtus ver-borum acquiert là une épaisseur conceptuelle sans précédent. Il estdésormais possible de penser l’incantation en termes naturels 5.
L’idée de virtus verborum élaborée par Roger Bacon trouve unrelais puissant en la personne de Pietro d’Abano. La differentia 156 duConciliator, qui porte sur les incantations thérapeutiques, constitue laplus importante étude doctrinale sur le pouvoir de l’incantation; ellen’a pas d’équivalent dans la littérature médicale du Moyen Age. Pourle médecin Pietro d’Abano, l’interaction entre le malade et le prati-
370
BÉATRICE DELAURENTI
5. Cf. Delaurenti, La puissance des mots, 157-200. Sur la théorie du langage deRoger Bacon, cf. B. Grévin, «Systèmes d’écriture, sémiotique et langage chezRoger Bacon», Histoire Epistémologie Langage, 24/2 (2002), 75-111; I. Rosier,«Grammaire, logique, sémantique: deux positions opposées au XIIIe siècle, RogerBacon et les Modistes», Histoire Epistémologie Langage, 6/1 (1984), 21-34; I. Rosier,La parole comme acte, Paris 1993, 207-31.
cien importe au premier chef, d’où une insistance particulière sur lerôle de l’âme, soutenue par les astres. L’accent est mis sur l’intentiondu locuteur, ses bonnes dispositions, sa force d’âme, mais aussi sur laconfiance du malade, une confidentia qui est à la fois une confiancedans l’art du médecin et un espoir de guérir. Le discours de Pietrod’Abano porte en outre la marque d’un certain scepticisme vis-à-visdes incantations: le pouvoir des mots y est présenté comme uneforce naturelle, non démoniaque, mais peut-être accidentelle 6.
La position de Nicole Oresme est encore différente. Il s’agit pourlui de lutter contre les pratiques magiques et astrologiques. Leregard qu’il porte sur les incantations est globalement négatif. Lacausalité astrale est écartée. Oresme concède un pouvoir à l’âmehumaine, celle du locuteur et celle de l’auditeur, mais il ne faitaucune relation entre le pouvoir de l’âme et l’énonciation de la for-mule. C’est aux effets des sons qu’il accorde toute son attention endéfendant l’idée que la matière sonore des mots, l’énergie vocalequ’ils mettent en œuvre leur confère un pouvoir à la fois naturel etprodigieux. D’un texte à l’autre, la position d’Oresme évolue versun naturalisme strict qui fait de la virtus verborum un phénomèneprobable, ordinaire, banalement naturel. L’idée de merveille liée auxmots est progressivement abandonnée 7.
371
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
6. Cf. Delaurenti, La puissance des mots, 273-398 et Ead., «Pietro d’Abano etles incantations. Présentation, édition et traduction de la differentia 156 du Conci-liator», dans Actes du colloque ‘Médecine, astrologie et magie entre Moyen Age etRenaissance: autour de Pietro d’Abano’, Paris, 28-29 septembre 2006, Sismel, àparaître. Sur les conceptions de Pietro d’Abano concernant la magie et l’astrolo-gie, cf. G. Federici Vescovini, «Pietro d’Abano and Astrology», dans P. Curry(éd.), Astrology, Science and Society: Historical Essays, Woodbridge 1987, 19-39;Ead., «La place de l’astronomie-astrologie chez Pietro d’Abano», dans HistoriaPhilosophiae Medii Aevi: Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, I,1991, 259-69; Ead., Medioevo magico, La magia tra religione e scienza nei secoli XIII eXIV, Turino 2008, 347-68; D. Jacquart, «L’influence des astres sur le corps humainchez Pietro d’Abano», dans B. Ribémont (dir.), Le corps et ses énigmes au MoyenAge. Actes du colloque d’Orléans, 1992, Orléans 1993, 73-86; E. Paschetto, Pietrod’’Abano, medico e filosofo, Firenze 1984 et Id., «Witelo et Pietro d’Abano à proposdes démons», dans L’homme et son univers au Moyen Age. Actes du 7e congrès inter-national de philosophie médiévale, 1982, II, Louvain-la-Neuve 1986, 675-82. Cf. aussiMédecine, astrologie et magie.
7. Cf. Delaurenti, La puissance des mots, 405-78. Sur la position de NicoleOresme (1320-1382) concernant la magie, les démons, la nature, cf. M. Clagett,Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions. A Treatise on theUniformity and Difformity of Intensities known as Tractatus de configurationibus quali-tatum et motuum, Madison 1968, 1-120; B. Hansen, Nicole Oresme and the Marvelsof Nature. A Study of his De causis mirabilium with a Critical Edition,Translation andCommentary, Toronto 1985, 1-85; E. Paschetto, Demoni e prodigi. Note su alcuni
Un positionnement naturaliste
Au-delà des différences d’époque et de point de vue, ces troisinterprétations se rencontrent sur deux points essentiels, deux refus.
Premièrement, le refus de rapporter le pouvoir de la formule à lasignification des mots. La signification n’est pas un principe d’ac-tion, il ne faut pas confondre la valeur sémantique et la valeur per-formative d’une formule incantatoire. Réfuter le pouvoir de lasignification trace une limite par défaut à l’interprétation: quelquesoit l’explication qui est donnée au pouvoir des incantations, celui-ci ne tient pas au sens des mots prononcés. Dans les écrits de Pietrod’Abano ou de Nicole Oresme, la question de la signification desmots est abordée de manière frontale: ces deux auteurs refusentexplicitement que la signification des mots puisse être un facteurcausal dans la virtus verborum 8. La position de Roger Bacon est plusdifficile à déceler. Bacon accorde manifestement un intérêt aux idéesdu penseur arabe al-Kindı̄ qui, dans son De radiis, considère que lasignification des mots redouble le pouvoir de la formule et luiconfère un supplément de virtus 9. Mais les condamnations desannées 1260-1270 ont fait du De radiis une référence interdite dansles débats scolastiques 10. Si Roger Bacon reprend certaines analyses
372
BÉATRICE DELAURENTI
scritti di Witelo e di Oresme, Turino 1978, 7-80; J. Quillet, «L’imagination selonNicole Oresme», Archives de philosophie, 50 (1987), 219-27; Id., «Enchantements etdésenchantement de la Nature selon Nicole Oresme», dans Mensch und Natur imMittelalter, Berlin-New-York I, 1991, 321-29; J. Quillet (éd.), Autour de NicoleOresme. Actes du colloque de l’Université de Paris XII, Paris 1990; P. Souffrin et A.Segonds (éd.), Nicolas Oresme, tradition et innovation chez un intellectuel du XIVe
siècle, Paris 1988.8. Pietro d’Abano, Conciliator, 156, § 2 et § 19, éd. Delaurenti, «Pietro
d’Abano et les incantations. Présentation, édition et traduction de la differentia156 du Conciliator»; Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 33, éd. Cla-gett, Nicolas Oresme and the Medieval Geometry, 368. Cf. Delaurenti, La Puissancedes mots, 334-47 et 469-70.
9. al-Kindı̄, De radiis, éd. M. T. d’Alverny et F. Hudry, Archives d’Histoire Doc-trinal et Littéraire du Moyen Age, 41 (1974), 235-38. Cf. I. Rosier, La parole commeacte, 215-23; N. Weill-Parot, Les «images astrologiques» au Moyen Age et à la Renais-sance. Spéculations intellectuelles et pratiques magiques (XIIe-XVe siècle), Paris 2002,155-62.
10. Dès les années 1260, la pensée d’al-Kindı̄ a fait l’objet des attaques deThomas d’Aquin, dans le Contra Gentiles, III, 104-105: cf. N. Weill-Parot, Les«images astrologiques», 228-32. Son déterminisme astral était sanctionné par lescondamnations parisiennes de 1277: cf. R. Hissette, Enquête sur les 219 articlescondamnés à Paris le 7 mars 1277, Louvain 1977 et D. Piché, La condamnation pari-sienne de 1277, Paris 1999.
d’al-Kindı̄, il ne le mentionne jamais et ne défend pas explicitementle pouvoir de la signification. Alors que ses développements sur lescauses du pouvoir des mots sont précis et argumentés, il reste flousur cette question pourtant essentielle. La prudence de RogerBacon, le rejet explicite de Pietro d’Abano et de Nicole Oresme ontune même explication. Accorder une importance à la significationd’une formule reviendrait à accorder trop d’importance à l’interlo-cuteur à qui s’adresse l’incantation: cela supposerait que le destina-taire de la formule joue un rôle dans la réalisation de l’effet. Cetteposition ouvrirait la voie à une suspicion de causalité démoniaque.Pour les auteurs qui recherchent les causes naturelles de la virtus ver-borum, il est donc nécessaire de mettre à distance le pouvoir de lasignification pour mettre aussi à distance celui des démons.
Ceci conduit au second refus que partagent nos auteurs: le refusd’accorder un pouvoir aux démons dans les effets d’une incantation.L’interprétation démoniaque de l’incantation était l’interprétationthéologique dominante au XIIIe siècle. Dès les années 1230, Guil-laume d’Auvergne prenait appui sur le traité De doctrina christianad’Augustin pour affirmer que l’efficacité des incantations découled’un pacte passé avec les démons. Les arguments de Thomas d’Aquin,dans les années 1260-1270, ont consolidé cette interprétation: lepouvoir des incantations est rapporté à un pacte, explicite ou impli-cite, conclu avec les démons 11. Cette position a fourni un supportthéologique à la construction de la démonologie comme systèmephilosophique 12. Pourtant, une forme de résistance vis-à-vis de cecadre théologique se manifeste à travers les discussions médiévalessur la virtus verborum. L’interprétation fondée sur le pacte démo-niaque a été régulièrement écartée par les auteurs qui ont étudié lepouvoir des mots, et le débat s’est focalisé sur les causes naturellesdes incantations. La nécessité d’argumenter et de défendre uneconception nouvelle lançait un débat et sollicitait les auteurs pourqui l’explication démoniaque n’était pas satisfaisante. Ce fut le casde Roger Bacon, de Pietro d’Abano et de Nicole Oresme, dans uneoption naturaliste qui fait leur originalité.
373
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
11. Augustin, De doctrina christiana, II, 20 (30), dans J. Martin (éd.), Œuvres deSaint Augustin, 11/2, La doctrine chrétienne/De doctrina christiana, Paris 1997, 182-86; Guillaume d’Auvergne, De legibus, 27, Opera omnia, Orléans-Paris 1674, repr.Frankfurt am M. 1963, I, 89bBC; Thomas d’Aquin, Summa theologiae, IIa IIae, 96,art. 2, Opera omnia (éd. ‘Léonine’), Rome 1888-1906.
12. Cf. C. E. Hopkin, The Share of Thomas Aquinas in the Growth of the Witch-craft Delusion, Philadelphia 1940.
Quelques remarques s’imposent sur l’adjectif ‘naturaliste’. Un telqualificatif ne va pas de soi au Moyen Age, il n’a pas le sens exclusifqu’il a pris à l’époque moderne. La pensée médiévale conserve àDieu la possibilité d’intervenir à tout moment en tant que premierprincipe de l’action naturelle. Mais la collaboration des causes agis-santes de la virtus verborum avec la cause première ne préoccupe nul-lement les auteurs, elle n’est pas un objet de débat. En outre, lanotion de naturalisme n’est pas vraiment univoque: dans les écritsqui nous occupent, sa cohérence repose sur le rejet de la causalitédémoniaque comme facteur d’explication des mirabilia. C’est le refusrépété de considérer les démons comme une cause de l’incantationqui justifie de parler de naturalisme pour qualifier les écrits de RogerBacon, Pietro d’Abano ou Nicole Oresme sur la virtus verborum. Leurréflexion est soutenue par la volonté de tester la possibilité d’unpouvoir naturel des mots. D’où l’intérêt, dans le cadre d’uneréflexion d’ensemble sur les interactions entre philosophie naturelle,magie et sorcellerie, de saisir comment ces auteurs se situent vis-à-visde la démonologie chrétienne et de quelle manière se fait chez euxl’articulation des deux pôles, le démoniaque et le naturel.
Les démons comme dernier recours
Roger Bacon fait peu de place aux démons dans son interpréta-tion de la virtus verborum. Dans l’Opus Maius, il donne l’exempled’un épileptique guérit par une amulette portant le nom des troisrois mages. L’homme demeure à l’abri des crises épileptiques aussilongtemps qu’il porte l’amulette autour de son cou. La puissance del’amulette est à la fois immédiate et inscrite dans la durée, puisquele malade bénéficie encore de sa protection plusieurs années après lapremière crise. Bacon envisage trois façons d’expliquer ce prodige,en faisant appel soit aux démons, soit aux œuvres de la nature, soità la grâce de Dieu. Il prend tout de suite ses distances avec l’inter-prétation démoniaque: faire appel à une causalité démoniaque seraitun réflexe de sots et d’ignorants (insipientes et inexperti), dit-il 13. Lerecours au démon ne doit venir qu’en dernière instance; les causali-
374
BÉATRICE DELAURENTI
13. Roger Bacon, Opus Maius, III, 14, éd. Bridges, III, Oxford 1897, 123-24:Qui erit ausu interpretari hoc in malum, et daemonibus ascribere, sicut aliqui inexpertiet insipientes multa daemonibus ascripserunt quae Dei gratia aut per opus naturae etartium sublimium potestatem multoties facta sunt?
tés divine et naturelle suffisent généralement pour interpréter lesprodiges. La causalité démoniaque vaudrait comme argument ultime,faute de mieux. Cette mise à distance de la causalité démoniaqueparticipe de la volonté de Bacon de favoriser l’étude des sciencesprofanes et la connaissance de la nature. Dans ses écrits, il manifesteun intérêt marqué pour les sciences et la philosophie naturellegréco-arabes. S’il ne nie pas l’existence des démons ni la réalité deleur pouvoir, l’interprétation démoniaque ne l’intéresse pas. Iln’éprouve pas d’inquiétude particulière vis-à-vis des démons: leursréalisations s’effacent selon lui devant les opérations prodigieuses del’art et de la nature.
Pietro d’Abano a une attitude comparable à celle de RogerBacon. Il prend en compte l’agent démoniaque tout en le tenant àdistance. Son point de vue diffère cependant dans la mesure où sonoptique est thérapeutique. Seule une incantation qui fait appel auxpouvoirs de la nature pourra être admise comme une pratiquemédicalement légitime. Les démons sont donc mis à l’écart. C’est laqualité du locuteur qui permet à Pietro d’Abano de disqualifier lacausalité démoniaque: il considère que la puissance des démons nes’exerce que sur certaines catégories de personnes.
Les démons inutiles
L’analyse de Nicole Oresme témoigne d’une approche renouveléede la question des démons. Il écrit quarante années après Pietrod’Abano; les enjeux sont différents. Oresme était un proche du roiCharles V, qui entretenait des astrologues à la cour et manifestait lui-même un grand intérêt pour la science des astres. C’est dans cecontexte que le théologien combat l’astrologie, les sciences divina-toires, la magie et les magiciens 14. Le regard qu’il porte sur lesincantations est sévère: à ses yeux, elles n’ont aucune efficacité. Leurmise en œuvre est une imposture. Les pratiques magiques ne peu-
375
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
14. Sur les relations entre Oresme et Charles V (1338-1380, roi en 1364), cf.E. Grant, «Nicole Oresme, Aristotle’s on the Heavens, and the Court of CharlesV», dans E. D. Sylla et M. Mc Vaught (éd.), Texts and Contexts in Ancient andMedieval Science. Studies on the Occasion of John E. Murdoch’s Seventhieth Birthday,Leiden 1997, 187-207; J. Cadden, «Charles V, Nicole Oresme and Christine dePizan: Unities and Uses of Knowledge in Fourteenth-century France», dansTexts and Contexts, 208-44; J. Quillet, Charles V, le Roi lettré: Essai sur la penséepolitique d’un règne, Paris 1984, 105-14.
vent tirer leur puissance des démons pour la simple raison qu’ellesn’ont aucune sorte de pouvoir.
De démons, dès lors, il est très peu question. Dans le traité Deconfiguratione qualitatum, Oresme consacre six chapitres à la magie. Ilenvisage dans le premier chapitre la question des relations entre leshommes et les démons. Ces derniers, affirme-t-il, ne peuvent êtrecontraints par une formule. La musique a bien un effet sur eux, ellepeut les détendre ou les tourmenter. Mais les incantations n’ontaucun pouvoir comparable: aucun mot n’a le pouvoir de com-mander aux mauvais esprits 15. Cette analyse opère un renversementde perspective. Oresme ne cherche pas à déterminer si les démonssont la source du pouvoir de l’incantation, il examine s’il est pos-sible que les incantations exercent un pouvoir sur les démons. Laréponse est négative: les formules n’ont aucun pouvoir.
Dès lors, la démonstration centrale ne porte pas sur l’agent actifdans l’incantation, elle porte sur l’imposture d’une telle pratique.Dans la magie, affirme Oresme, l’incantation fonctionne à vide, sansla présence réelle du démon, celui-ci n’est qu’un argument formelpour se jouer de la crédulité du public. L’art magique serait un artdu mensonge, une entreprise gigantesque d’affabulation qui s’exer-cerait sur les hommes naïfs ou peu instruits, en s’appuyant sur leurcrédulité 16. Cette analyse engage une mutation décisive des argu-ments sur la virtus verborum: en soutenant que les incantations sontdes pratiques inefficaces, Nicole Oresme affirme en même tempsque les démons n’y sont d’aucune utilité. L’agent démoniaque estcomplètement éliminé du débat. La position de Nicole Oresme surles démons marque ainsi un durcissement par rapport aux prudentesmises à l’écart de Roger Bacon et de Pietro d’Abano. Le discoursd’Oresme est plus radical: la causalité démoniaque est mise hors jeu.
376
BÉATRICE DELAURENTI
15. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum et motuum, II, 25, 336: Aliiquoque dicunt tales spiritus quadam verborum compositione seu configuratione posseinvocari, coniurari vel cogi, et multa similia aliena a philosophia naturali et a vera doc-trina. Debet enim unicuique certum esse demones non posse ab hominibus per talia alitercoartari nisi quia divinitus permissi quedam possunt facere ad deceptionem ac captionemmiserabilis anime que se sponte ponit in manibus inimici.
16. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 27-30.
II. Les silhouettes multiples de la vetula
A côté du démon, l’autre personnage important dans les écrits surla sorcellerie est évidemment la sorcière elle-même. Or il n’est pasquestion de sorcière dans les débats naturalistes sur l’incantation, etpour cause: le stéréotype de la sorcière émerge au début du XVe
siècle en même temps que celui du sabbat. La sorcière de RogerBacon, Pietro d’Abano ou Nicole Oresme n’est pas exactement unesorcière: c’est une vetula. Elle incarne l’archétype de la vieille femmepratiquant la magie et dotée de pouvoirs occultes et néfastes.
Les représentations médiévales de la vetula ont été étudiées parJole Agrimi et Chiara Crisciani dans un article paru en 1993 17. Àpartir d’une analyse des traités de médecine et de pastorale, lesauteurs ont montré que la vetula se trouvait à l’intersection de cestrois traits supposés négatifs au sein de la condition humaine: lavieillesse, la féminité et la simplicité d’esprit. L’article mettait enévidence l’ambivalence du personnage, parfois bénéfique, le plussouvent maléfique. La vetula était présentée comme une figure detransition avant de se transformer, au XVe siècle, en un personnageglobalement négatif, réinvesti dans la représentation de la sorcière.
Il importe aujourd’hui de situer la vetula telle qu’elle se présentedans l’argumentation de Roger Bacon, de Pietro d’Abano et deNicole Oresme et de saisir, chez ces auteurs, comment le motif s’ar-ticule avec celui des démons. La vetula apparaît par petites touchesdans les discussions sur le pouvoir naturel des mots. Ce n’est jamaisun thème central, mais nos trois auteurs en font mention. Elleappartient à l’univers de la nigromancie; ses agissements sont, d’unemanière ou d’une autre, liés aux démons. C’est un personnage del’autre bord, un personnage suspect. Il permet de distinguer com-ment la silhouette de la sorcière s’invite dans des argumentationsqui, a priori, l’excluent. Derrière le portrait simpliste de la vieilleinvoquant les démons se cache une multitude de nuances concer-nant la nature et la portée réelle de ses agissements.
377
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
17. J. Agrimi, C. Crisciani, «Savoir médical et anthropologie religieuse. Lesreprésentations et les fonctions de la vetula (XIIIe-XVe s.)», Annales Economies,Sociétés, Civilisations, 48/5 (1993), 1281-308.
La vetula comme faire-valoir
Pour Roger Bacon, la vetula est l’archétype de l’utilisateur demagie démoniaque. Les pratiques des petites vieilles et celles desmagiciens sont associées pour être dénoncées. Les unes et les autresfont usages de caractères, de charmes, de conjurations pour s’adres-ser aux démons. L’auteur précise que les vetule ont appris leurs mau-vaises pratiques des démons eux-mêmes: la petite vieille serait ainsiun personnage retors, vendu à l’ennemi et complotant avec lui 18.Bacon n’en dit pas davantage: son portrait de la vetula a peu deconsistance. Elle lui importe uniquement en raison de la ressem-blance qu’il voit entre ses pratiques et les opérations de l’art et de lanature. Dès lors, il y a un risque de confusion. La reconnaissance dela virtus verborum pourrait être menacée par la confusion possibleentre les bonnes pratiques et les mauvaises.
Roger Bacon est bien conscient de la difficulté de distinguer lesopérations magiques et celles qui sont réalisées par le pouvoir natu-rel des mots. Ce que l’homme ordinaire considère comme magiquerelève, pour le savant, des pouvoirs de la nature. Cette ambiguïté estinévitable:
La même chose peut devenir bonne et mauvaise, et par la même choseon peut faire des choses bonnes ou mauvaises. Le juge fait pendre unhomme selon la justice, et un autre tue contre le droit. À l’aide d’un cou-teau, je peux couper le pain ou blesser un homme. Et de la même manière,le sage peut agir sagement, le magicien magiquement. Mais chacune de cesopération relèvent de raisons différentes. Car l’un agit en vertu d’un pou-voir naturel alors que l’autre ne fait rien, ou alors c’est le diable qui estl’auteur de son œuvre 19.
378
BÉATRICE DELAURENTI
18. Roger Bacon, Opus Maius, IV, éd. Bridges, I, 395-96: Sed magici maledictiinduxerunt summam infamiam in hac parte, quum non solum in malis abusi sunt cha-racteribus et carminibus scriptis a sapientibus contra nociva, et pro utilibus maximis, sedadjunxerunt mendosa carmina et characteres vanos et fraudulentos quibus homines sedu-cuntur. Insuper daemones temptaverunt multos et tam mulieres quam daemones docueruntmulta superstitiosa, quibus omnis natio plena est. Nam ipsae vetulae ubicunque faciuntcharacteres et carmina et conjurationes, ac ipsi magici utuntur invocationibus daemonumet conjurationibus eorum, et sacrifiia eis faciunt.
19. Roger Bacon, Opus Tertium, 26, éd. J. S. Brewer, Opera quaedam hactenusinedita, I, London 1859, 95-96: Eadem enim res potest fieri bene et male; et per eandemrem possunt bona et mala fieri. Et judex suspendit hominem secundum judicium, et aliusinterficit contra jura. Et per cultellum possum scindere panem et hominem vulnerare. Sicsimiliter per verba potest sapiens sapienter operari, et magicus magice. Nam unus facit perpotestatem naturalem; alius aut nihil facit, aut diabolus auctor est operas.
Pour distinguer une opération démoniaque d’une opération natu-relle, il convient donc d’évaluer le but de l’incantation et la person-nalité de celui qui l’énonce. C’est là que le personnage de la vetulaintervient: elle incarne le risque d’amalgame qu’il est nécessaire degarder à l’esprit. Si la sorcière, chez Roger Bacon, est réduite àn’être qu’une silhouette, sa présence est cependant nécessaire à l’ar-gumentation. En agitant le chiffon rouge de la vetula, l’auteur montrequ’il est conscient de la proximité de ce qu’il propose avec certainesopérations défendues et dangereuses. Ce personnage joue le rôle defaire-valoir dans un discours qui met en avant le savant, le philo-sophe, le manipulateur éclairé des forces de la nature.
La vetula comme femme trompée
Pietro d’Abano ne consacre pas de développement particulier à lavetula lorsqu’il discute des incantations thérapeutiques. Celle-cioccupe néanmoins une place dans la réflexion à travers trois couplesde personnages antinomiques: la vetula s’oppose au médecin, au nobleet au savant.
L’opposition entre la vetula et le médecin apparaît dans un argu-ment contre l’usage des incantations que Pietro d’Abano tire deGalien. Dans l’un de ses écrits médicaux, Galien dénonce en effetl’utilisation d’incantations, de phylactères ou de fumigations à viséesthérapeutique: ces pratiques sont qualifiées de fables (fabulae) 20.Pietro d’Abano reprend le terme et le complète: ce sont, dit-il, desfables des petites vieilles (fabule vetularum) 21. Elles représenteraient lependant négatif de la pratique médicale galénique. Dans ce passage,la vetula n’est qu’une simple allusion. C’est elle pourtant qui apporteune limite par défaut à l’art médical du bon médecin.
379
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
20. Galien, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, VI, proe-mium, éd. Kühn, Opera Omnia, Paris 1826, XI, 791-92: Caeterum quoniam medica-menta omnia partim sunt partes animalium, aut plantarum, aut fructuum, aut horumliquores, aut succi, partim vero ex metallis sumuntur, melius mihi visum est de plantisante omnia differere, tum quod numerosissimum illarum est genus, tum quod viriumrobore praecellentissimum, inde de metallicis tractare, atque hinc ad animalium partestransire. Verum id ad fabulas versus aniles est, simulque praestigias quasdam delirasAegyptias, junctis nonnullis incantationibus, quas quum herbas colligunt admurmurant.
21. Pietro d’Abano, Conciliator, 156, § 16, éd. Delaurenti, «Pietro d’Abano et lesincantations»: … Galenus in 6 prealegato, detestans Chamachirum et Bamachirum, cunc-tis Dyascoridem preferens, eo quod scripsissent superstitiosa verba et fabulas quas narrareconsuerant muliercule ac vetule ad modum stultorum egyptiorum fascinationes dicentium.
Le personnage de la vetula a plus de consistance lorsqu’elle estopposée au savant. Il s’agit pour Pietro d’Abano d’expliquer dequelle manière les démons peuvent intervenir dans la pratiqueincantatoire. Son argumentation est la suivante: les démons s’atta-quent principalement aux hommes ordinaires et aux vetule, parceque les savants sont plus difficiles à tromper et qu’ils savent manierle pouvoir naturel des mots. L’intervention des démons serait doncdépendante de la personne qui énonce la formule. Le mode d’actionde la formule, diabolique ou naturel, dépendrait du statut social etde l’éducation du locuteur, ainsi que de sa force d’âme 22.
Pietro d’Abano engage de cette manière une réflexion sur le rôledu public dans l’efficacité des pratiques magiques. L’interprétationqu’il propose ne nie pas complètement le rôle des démons; le soup-çon d’une intervention démoniaque est réservé aux cas les plus sus-pects. La mise en œuvre savante du pouvoir des mots est considéréecomme une opération naturelle, donc licite, tandis que les opéra-tions de la vetula sont évidemment illicites. L’usage médical et astro-logique de l’incantation trouve ici sa justification. L’analyse de Pietrod’Abano reflète une conception stéréotypée de la vetula, qui apparaîtcomme un personnage faible et naïf, soumise à la tromperie desdémons. Les opérations de magie démoniaque lui sont réservées. Lesavant, à l’inverse, est crédité de pouvoirs élevés. Sa personnalité, sesintentions et son savoir sont importants pour la mise en œuvred’une formule thérapeutique, ce qui rappelle les conceptions deRoger Bacon sur l’importance de la noblesse et de la dignité del’âme du locuteur 23. On peut y voir, de la part de Pietro d’Abano,une certaine conscience de sa profession et de la valeur scientifiquede la médecine et de l’astrologie.
Le personnage de la vetula fait une troisième apparition dans letexte de Pietro d’Abano: elle s’oppose non seulement au médecin etau savant, mais aussi à l’homme noble. Un petit exemplum met en scèneun homme noble qui se moque des pratiques d’une vieille femme:
380
BÉATRICE DELAURENTI
22. Pietro d’Abano, Conciliator, 156, § 27: Si vero depravata, ita demon vel spiri-tus, cuius efficacia permaxima cum «non sit in terra potestas que sibi valeat comparari»[Jb, 41, 24], hic quidem multum incantationibus et sacrificiis obedit ut decipiat concitatusvehementer, aut appareat multa perficiens, et precipue mulierculis obediens simplicioribus,quia eas enim celerius sapienter fallere valet. Quare has video votum et effectum conse-qui ex earum incantatione seu coniuratione quamplurime, quod sapientiori non acciditquantumcunque illis operetur perfectius. Est etiam, ut expertus, vigoris amplioris et fami-liaritatis in locis in quibus cultus celebratur divinus.
23. Cf. Roger Bacon, Opus Maius, III, 14, 124 et Opus Maius, IV, 396.
Un certain noble avait appris à une pauvre petite vieille cette incanta-tion: «deux et trois font cinq, trois et deux aussi». Un jour, une arête depoisson enfoncée dans la gorge de cet homme le fit souffrir. Il finit par lafaire appeler, elle vint auprès de lui et lui dit qu’elle ne connaissait aucunautre remède que celui qu’il lui avait appris. Il fut alors secoué par un grandéclat de rire et rejeta l’arête avec du sang 24.
Cette anecdote tente de ridiculiser la petite vieille: elle est cellequi ne sait rien, qui n’a rien à dire, qui ne peut que confesser sonignorance en ce qui concerne les pratiques incantatoires. Mais le récitn’est pas dépourvu d’ambiguïtés: le personnage de la vetula n’existeque par la représentation que s’en fait l’homme noble, elle-même nerevendique aucune pratique d’incantation. Les démons non plus n’in-terviennent pas. L’apparition de la petite vieille permet de dénoncersubrepticement l’inutilité et l’inefficacité des pratiques magiques.
Dans ces trois couples d’opposition, la vetula apparaît avant toutcomme un être négatif. Elle n’est ni médecin, ni astrologue; elle nepeut se prévaloir d’aucune sorte d’expertise; elle relève des couchesles plus simples et les plus vulgaires de la population. Ces aspectssociologiques entraînent une évaluation péjorative du personnage: sonmanque d’instruction, sa naïveté en font une proie facile et le jouetdes démons. La vetula de Pietro d’Abano se rapproche ainsi de cellede Roger Bacon. Elle représente la limite par défaut de toute opéra-tion naturelle: en dessous de ce seuil intellectuel et social, nos auteursconsidèrent qu’il n’est plus possible de réaliser un prodige naturel.Mais le texte de Pietro d’Abano apporte aussi une tonalité différenteau personnage. La vetula, pour lui, n’est pas un personnage craint oudétesté: elle est surtout moquée en tant que femme trompée. Le per-sonnage, quoique discret, en retire une complexité inédite, le reliefd’un être féminin dans une situation de mépris et d’humiliation.
La vetula, sorcière aux deux visages
Le paysage que décrit Nicole Oresme laisse également apparaître,en arrière-plan, la silhouette de la vetula. En arrière-plan, c’est-à-
381
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
24. Pietro d’Abano, Conciliator, 156, § 32: Nobilis quis pauperculam docuerit vetu-lam precantare, dicendo «duo et tria constituunt quinque, et tria similiter et duo». Dumautem hic spina piscis gutturi eius infixa cruciaretur. Eaque tandem vocata, perveniens adeum, dixit se aliam nescire medelam, nisi eam quam ab eo didicerat; is autem in vehe-mentiorem risum concitatus, spinam cum sanguine foras mandauit.
dire de façon fugitive, sous la forme de l’expression fabulae vetula-rum: Oresme qualifie les opérations des magiciens de contes devieilles femmes 25. Cependant la vetula selon Oresme est plus com-plexe que cette mention un peu vague. Ses arguments permettent dedistinguer deux sortes de vetule: la première est une victime craintiveet crédule, la seconde est plus forte et sait exploiter les pouvoirs dela nature.
Facile à tromper, parce que crédule et craintive, voilà les traits quicaractérisent au premier abord la vetula dans le De configuratione qua-litatum. Elle appartient à cette population qui attribue aux incanta-tions des pouvoirs qu’elles n’ont pas. Oresme la convoque lorsqu’ilentreprend de dénoncer l’imposture des pratiques magiques. Elleillustre la crédulité du public, une crédulité qui est rapportée à l’âge:les jeunes gens sont plus faciles à tromper, de même que les per-sonnes âgées 26. Déjà pour Pietro d’Abano, la distinction entre vetulaet expertus était une des clés pour expliquer les pratiques incanta-toires en fonction du public. Chez Oresme, le même argument sefait plus radical: la présence d’un public peu instruit vaut commepreuve de l’imposture de la magie. Pour lui, la vetula n’est pas trom-pée par le démon comme l’affirmait Pietro d’Abano: elle est trom-pée par le magicien lui-même, c’est cet imposteur qui lui fait croireà l’efficacité de pratiques douteuses et inefficaces 27.
On retrouve cette vetula crédule dans la question 44 des Quodli-beta, dans laquelle Oresme rapporte une discussion qu’il aurait eueavec une vieille femme accusée de magie. Aux interrogations duthéologien sur les pratiques dont on l’accuse, la femme répond «à lamanière d’une femme timide (timida)» et avoue qu’elle «ne sait pasce qu’[elle] dit, ni ce qu’[elle] a dit» 28. Oresme met en évidence que
382
BÉATRICE DELAURENTI
25. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 35, 372: Huiusmodi divina-tores aut magi fingunt et mentiuntur se multa posse facere que non possunt et iactant sefecisse que non fecerunt (…). Plurima etiam de talibus factis narrantur que simpliciterfalsa sunt et similia fabulis vetularum.
26. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 28, 342-4: Hoc idem proba-tur rationis sumptis ex parte etatis. Pueri namque et adolescentes seu iuvenes propteranimi levitatem et facilem credulitatem magis et citius possunt per ista seduci. (…) Adhoc etiam est argumentum de etate senili. Ad quedam namque maleficia peragenda suntapte vetule.
27. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 27, 340: Magi in variis sectisaut legibus et in diversis temporibus et regionibus utuntur aliis et aliis coniurationibus.Confingunt enim suas invocationes et sacrificia iuxta opinionem et credulitatem hominumquos intendunt decipere et vocant demones aliter et aliter.
28. Nicole Oresme, Quodlibeta, 44, Ms. Napoli, Bibl. Nazionale VittorioEmmanuele III, XI C 84, fol. 118-119v (éd. B. Delaurenti en cours de publica-
la menace, la peur et la crédulité ont une influence sur les personnesaccusées de pratiquer la magie. Il souligne la responsabilité des jugesdans les récits obtenus sous la torture. Leurs manigances s’ajoutent àcelles des magiciens: les uns comme les autres tirent profit de la cré-dulité des victimes 29. Ce sont les éléments d’une immense fumiste-rie tournée vers un seul but: créditer les formules d’un pouvoirqu’elles n’ont pas. Dans ce récit, la vetula est un personnage faible etpeu redoutable, une femme craintive, timide, manipulée par lesjuges, dépassée par les accusations qu’on lui impute. On note unecertaine parenté avec la vetula raillée par l’homme noble selon Pietrod’Abano. Néanmoins le personnage campé par Oresme touche aupathétique, et l’auteur manifeste quelque compassion à son égard. Saréprobation vise d’abord les hommes influents quand ils sont malfai-sants, les imposteurs qui pratiquent la fausse persuasion et abusentde la confiance qui leur est accordée.
La vetula d’Oresme ne se limite pas à tenir le rôle de public com-plaisant. Elle prétend réaliser elle-même des prodiges et faire usaged’incantations. C’est sous cet autre visage qu’elle apparaît dans laquestion 43 des Quodlibeta, en tant que femme agissante et malfai-sante 30. Dans ce cas aussi, estime Oresme, la vetula demeure unepauvre femme, une sorcière dépassée par son art. Elle est trompée aumême titre que ceux qui lui font crédit, car elle se laisse prendreaux illusions qu’elle a mises en œuvre. «Il existe certains moyens parlesquels les agents et les patients sont trompés, de telle sorte quecelui qui fait un sortilège est trompé de la même façon que celuipour qui ou à qui il est fait» 31: c’est le topos du trompeur trompé.
383
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
tion): Dico quod ex magno timore nesciunt quid dicunt, et etiam non ita clare confiten-tur. (…). Et ego hoc vidi quia de una dicebatur quod faciebat et quod ipsa fueratconfessa. Et ego rogavi prepositum quatinus promitteret me alloqui illam; qui mihiconcessit. Sed cum in presentia prepositi et aliorum sim locutus etc. et petiuissem etc.,sicud timida respondit: ‘vero nescio quid dico nec quid dixi et multa alia’, et quilibet per-cepit quod non esset nisi truffa.
29. Nicole Oresme, Quodlibeta, 44: … Dico etiam quod per tormenta fatentur etc.Dico etiam quod aliqui miseri uel misere quandoque credunt aliqua facere et tamen in reiveritate nichil faciunt, quamvis quandoque concurrat quod accidat sicut intendunt saltimin parte. Et tunc imponitur: ‘ecce hoc fecerunt’, etc.
30. Nicole Oresme, Quodlibeta, 43, Ms. Paris, BnF, lat. 15126, fol. 153r (éd. B.Delaurenti en cours de publication): Exemplum: quandoque uetula facit aliqua car-mina seu dicit et ligat aliquas herbas uel aliquas res ut alios prouocet ad odium autamorem, aut ad sanitatem aut egritudinem, aut ut sibi appareat uel tali, aut tali appa-reat de furto quis cepit, uel etc.
31. Nicole Oresme, Quodlibeta, 43, fol. 153r: Dico igitur quod aliqui sunt modiquibus decipiuntur agentes et patientes, ita quod ille qui sortilegium facit decipitur etetiam ille pro quo seu cui facit.
Sur ce point, Oresme innove et va beaucoup plus loin que RogerBacon ou Pietro d’Abano. Il considère que la présence du démonn’est pas nécessaire pour expliquer les opérations de la vetula. Si lavetula se trompe elle-même en pensant agir avec le soutien dudémon, c’est que la véritable cause de ses prodiges est naturelle plutôtque démoniaque. Les dispositions naturelles de la vetula lui permet-tent parfois de réussir ses opérations, sans aucun appui démoniaque.Cette interprétation est étayée sur certains arguments concernant lepouvoir de la voix. Oresme affirme en effet que les opérations desmagiciens résultent fréquemment d’une illusion des sens, de la crédu-lité du public ou de la manipulation habile de certains objets, mais iladmet aussi que des prodiges puissent être réellement produits par lepouvoir des sons, des mots et de la voix. Ce sont là des causes natu-relles et l’un des fondements du pouvoir magique 32. Cette idée, pré-sentée dans le De configuratione qualitatum, est illustrée par une citationdu poète romain Lucain qui, dans son épopée sur la guerre civile,met en scène une prophétesse à la voix très particulière:
Et alors sa voix, plus puissante que toutes les herbes pour évoquer lesdieux du Léthé, murmure d’abord des sons discordants et bien différents dulangage humain. Elle a l’aboiement du chien et le hurlement des loups, laplainte du hibou tremblant, de la strige nocturne, le grincement ou le gro-gnement des bêtes sauvages, le sifflement du serpent, elle rend les batte-ments de l’eau qui se brise sur les écueils, le bruissement des forêt et le ton-nerre de la nuée qui crève: tant de choses ont formé une seule voix 33.
La voix de la prophétesse s’apparente à des cris d’animaux et àtoutes sortes de bruits naturels; elle est composée de sonoritéseffrayantes et peu harmonieuses. C’est cette discordance qui intéresseOresme: pour lui, la voix porteuse d’une telle puissance est une voix
384
BÉATRICE DELAURENTI
32. Nicole Oresme, De configuratione qualitatum, II, 33, 366-8: Tertium funda-mentum artis magice consistit in sonorum seu verborum virtute. (…) Non est difficilevidere – ymmo probabile est – quod naturaliter vel artificiose possit alicuius soni diffor-mitas taliter figurari quod habebit potentiam aliquid ad extra mutandi, et precipue inanimali illo quod afficitur per auditum ab huiusmodi sono. (…) Ad hanc autem effica-tiam potissime aptus est sonus vox et maxime vox humana.
33. Lucain, De bello civili (Pharsalia),VI, 685-88, éd. et trad. A. Bourgery, Paris,19765, 35: Tunc uox Lethaeos cunctis pollentior herbis / excantare deos confundit mur-mura primum / dissona et humanae multum discordia linguae. / Latratus habet illacanum gemitusque luporum / quod trepidus bubo, quod strix nocturna queruntur / quodstrident ululantque ferae, quod sibilat anguis / exprimit et planctus inlisae cautibusundae / siluarumque sonum fractaeque tonitrua nubis. / Tot rerum uox una fuit; NicoleOresme, De configuratione qualitatum, II, 33, 368.
inhumaine, bestiale. Ce sont les dissonances et les déformations duson qui lui donnent cette puissance. Le démon n’y est pour rien.
Erictho, la devineresse du texte de Lucain, n’est pas exactementune vetula. Oresme ne la désigne pas ainsi. Elle s’apparente néan-moins à cette vetula malfaisante qu’il décrit par ailleurs: elle a lamême ambivalence et exploite, sans le savoir, le pouvoir naturel dessons. Dans l’argumentation d’Oresme, le personnage de la vetulaintervient ainsi à contre-emploi. Les véritables ressorts de son pou-voir sont les forces naturelles qui se manifestent par sa voix 34. Laprophétesse de Lucain constitue ainsi un cas-limite de mise enœuvre du pouvoir naturel des mots.
La vetula de Nicole Oresme est donc un personnage à doubleface, à la fois femme victime, crédule, bernée par les hommes, etmagicienne réalisant elle-même des prodiges. Les deux aspects semêlent sans que jamais Oresme ne les distingue clairement. La vetulaest trompée et trompeuse; elle se trompe elle-même et trompe lesautres dans le même temps. Elle est paradoxalement crédule et effi-cace, naïve et experte. Elle incarne la complexité des pratiquesmagiques dont Oresme entend révéler l’imposture, et qui pourtantparaissent reposer sur une utilisation pertinente et bien comprise desressources de la nature et des capacités humaines. Le projet para-doxal d’Oresme confère ainsi à la vetula une forme d’ambivalencenouvelle, que l’on ne percevait pas dans les représentations de RogerBacon ou de Pietro d’Abano.
L’analyse du rôle du démon et de la vetula dans les écrits deRoger Bacon, Pietro d’Abano et Nicole Oresme à propos des incan-tations nous a permis d’esquisser un portrait de sorcière qui n’estpas encore prise pour une sorcière, de la cerner «en son milieunaturel», et non dans les stéréotypes de l’image qu’on s’en fait. Ilnous reste à conclure en fonction de notre projet de départ, quivisait à saisir les interactions entre magie naturelle et démonologie àl’orée de la grande vague de procès en sorcellerie. Nous avonsévoqué une parenthèse naturaliste entre 1230 et 1370, autour desdiscussions sur la virtus verborum. Cette parenthèse était-elle per-méable aux préoccupations de l’époque? Quelles furent ses relationsavec les doctrines démonologiques de son temps?
385
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
34. Sur cette question, cf. aussi B. Delaurenti, «Oresme, Lucain et la ‘voix desorcière’», Cahiers de Recherches Médiévales, 13 (2006), 169-79.
Le discours démonologique a pesé sur les écrits d’inspirationnaturaliste. La philosophie naturelle a été sensible à une crispationcroissante des arguments à propos des démons. Roger Bacon et plusencore Pietro d’Abano se sont efforcés de mettre à l’écart la causa-lité démoniaque qui reflétait ces inquiétudes. Pour eux, démons etvetula sont avant tout des pôles négatifs dans la réflexion sur lespouvoirs de la nature. L’attitude de Nicole Oresme est différenteparce qu’il fait face à une menace réelle, celle des magiciens et desastrologues dont le poids à la cour va grandissant. Il est bien informédes croyances et des pratiques de son temps, comme le montrent lesnombreux détails qu’il emprunte aux pratiques magiques. Face à cedanger qui pour lui est tangible, son attitude est double. D’un côté,il met le démon hors d’état de nuire et le rend inutile à la réflexion,au prix d’un renversement de l’argumentation. De l’autre côté, ilattribue à la vetula une certaine ambivalence. Son portrait de lavetula inclut discrètement les procès en sorcellerie et la question del’aveu, d’une façon tout à fait nouvelle.
Il faut néanmoins relativiser ces mises en perspective. Les argu-ments de nos trois auteurs sont soutenus d’abord par la volonté demaintenir à distance l’interprétation démoniaque. Leurs écrits sontguidés par un désir de rénover l’approche de la natura. C’est pour-quoi ils expriment, chacun à sa manière, des réticences vis-à-vis dela démonologie et de la sorcellerie. Cet esprit de résistance passe parle refus du pacte démoniaque. Roger Bacon, Pietro d’Abano puisNicole Oresme se distinguent de l’interprétation théologique domi-nante telle que l’avait élaborée Thomas d’Aquin. C’est avec JeanGerson, au début du XVe siècle, que l’interprétation faisant appel aupacte devient la seule interprétation tolérée 35. Nos trois auteurs setrouvent en retrait par rapport aux appréciations des théologiens etdes inquisiteurs sur la pratique superstitieuse.
On peut aussi parler de résistance à propos de la vetula. Dans lesécrits de Roger Bacon et de Pietro d’Abano, cette figure est avant
386
BÉATRICE DELAURENTI
35. Jean Gerson, Sermo V de festo omnium sanctorum, «Regnum coelorum vimpatitur» et Sermo a devotissimus de Christi nativitate, «Puer natus est nobis», éd. L. E.Du Pin, Opera omnia, III, Anvers 1706, repr. Hildesheim-Zurich-New York 1987,1547D et 942AB; Jean Gerson, De erroribus circa artem magicam, éd. P. Glorieuxdans Jean Gerson, Œuvres complètes, 10: l’œuvre polémique, Paris 1973, 77, n° 500;«Determinatio solennelle de la Faculté de Théologie de l’Université de Pariscondamnant vingt-huit articles relatifs à la magie (19 septembre 1398)», éd. J. P.Boudet, «Les condamnations de la magie à Paris en 1398», Revue Mabillon, n.s.12, t. 73 (2001), 147-54. Cf. Delaurenti, La Puissance des mots, 479-99.
tout un archétype, un motif construit pour les besoins de l’argu-mentation, un être de discours sans existence réelle. Elle a une fonc-tion rhétorique, elle soutient l’argumentation en imposant une limitenégative au champ des opérations naturelles. Avec Nicole Oresmeen revanche, la vetula acquiert une stature plus complexe. JoleAgrimi et Chiara Crisciani ont montré que le motif de la vetulaavait fait l’objet, au XVe siècle, d’une «assimilation démonologique»accompagnée d’une réduction progressive de son ambivalence auprofit de la construction d’un ennemi unique en connivence étroiteavec le démon 36. Le mouvement ici est inverse: la vetula de RogerBacon, celles de Pietro d’Abano et, plus encore, celles de NicoleOresme sont loin de cette assimilation et de cette homogénéisation.
Qu’en est-il de la postérité des réflexions de Roger Bacon, Pietrod’Abano ou Nicole Oresme dans les écrits du XVe siècle sur la sor-cellerie? Elle est difficile à déceler. Il semble que les thèmes déve-loppés en philosophie naturelle à propos du démon ou de la vetulaont eu peu d’écho dans les constructions démonologiques contem-poraines ou postérieures. On a plutôt l’impression d’un évitement,et pour cause: la virtus verborum faisait peu de cas du démon, désor-mais objet majeur des obsessions doctrinales.
Un exemple de ce manque de postérité serait la question dupouvoir de la voix, telle que la développe Nicole Oresme. En1486/1487, le célèbre Malleus maleficarum fait mention de la voix desorcière. Une des questions du manuel demande «pourquoi plusd’hommes que de femmes sont engagés dans la superstition». Laréponse est l’occasion de souligner les mauvais effets de la voixféminine: «Menteuse par nature, [la voix de la femme] l’est dans sonlangage: elle pique tout en charmant» 37.Vient ensuite la mention dela légende des sirènes, telle qu’elle est exposée par Homère dansl’Odyssée et par Ovide dans les Métamorphoses 38. Pour les deux inqui-
387
LA SORCIÈRE EN SON MILIEU NATUREL
36. Agrimi, Crisciani, «Savoir médical et anthropologie religieuse».37. Henri Institoris, Jacques Sprenger, Malleus Maleficarum, I, VI, Göttingen
(fac. sim. Lyon, 1620), 64: Cur in maiores multitudines reperiantur magis foeminasuperstitiosa quam viri? (…) Audiamus et aliam proprietatem per vocem. Nam sicut estmendax in natura, sic et in loquela. Nam pungit et tamen delectat. Unde et earum voxcantui Syrenarum assimilatur, quae dulci melodia transeuntes attrahunt et tamen occi-dunt. Occidunt quidem, quia ex marsupio evacuant, vires auserunt, et Deum perderecogunt. Trad. A. Danet, Grenoble 1990, 176.
38. Homère, Odyssée, Chant XII, v. 39-55 et v. 165-200, Paris 1924; Ovide,Métamorphoses,V, v. 551-71, Paris 1925.
siteurs du Malleus maleficarum, la sorcière est avant tout une femme.La voix est un de ses atouts. Elle n’est pas vraiment terrifiante, maisc’est une voix féminine qui séduit l’auditeur et qui l’ensorcelle. Lavoix de la sorcière n’est rien d’autre qu’une voix féminine, char-mante et enjôleuse.
Les analyses d’Oresme et la référence à Lucain sont restées lettremorte au XVe siècle. L’idée que la sorcière puisse agir par sa voixn’avait plus de consistance à l’époque des procès en sorcellerie. Dansla construction de la démonologie et de la sorcellerie à la fin duMoyen Age, la vetula d’Oresme, ce personnage ambigu, sachantmanier les forces de la nature, n’aura pas eu de postérité, pas plusque la notion hardie de virtus verborum.
EHESS (Groupe d’Anthropologie Scolastique) / K.U. Leuven
388
BÉATRICE DELAURENTI