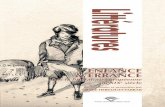QU'EST-CE QUE 'BIEN VIEILLIR' ? » Médecine de soi et prévention du vieillissement
-
Upload
sorbonne-universite -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of QU'EST-CE QUE 'BIEN VIEILLIR' ? » Médecine de soi et prévention du vieillissement
« QU’EST-CE QUE ‘BIEN VIEILLIR’ ? »
Médecine de soi et prévention du
vieillissement
Claire Crignon-De Oliveira
Depuis le cri d’alarme adressé par Simone de
Beauvoir dans les années 1970 au sujet de la
situation des personnes âgées reléguées dans des
hospices1 de nombreuses tentatives ont été
réalisées pour proposer un autre regard sur le
vieillissement ainsi que des moyens permettant
d’améliorer la qualité des soins proposés aux
personnes âgées. Les réflexions menées autour de la
notion de « care », entendu comme « prise en charge
d’un autrui vulnérable »2, ont contribué à mettre
l’accent sur les besoins spécifiques des personnes
âgées. Tout le problème étant de tenir compte de
cette fragilité propre aux personnes âgées tout en
les reconnaissant comme des personnes à part
entière et non comme des choses qui constitueraient
simplement une charge pour la société ou une
population compromettant les principes solidaristes
1 Simone de Beauvoir, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970.2 Voir en particulier : Le souci des autres, éthique et politique du care,dir. P. Paperman et S. Laugier, ed. de l’école des HautesÉtudes en Sciences Sociales, Paris, 2005. Les expressionscitées renvoient à l’article de L. Pattaroni, « Le care est-il institutionnalisable », p.179. Voir aussi l’article de P.Meire, « La vulnérabilité des personnes âgées », Louvain Med.119, 2000, pp. 221-226.
sur lequel est fondé notre système de sécurité
sociale.
Pourtant, malgré la volonté de s’emparer du
phénomène de vieillissement, malgré une prise de
conscience de la nécessité de penser les
implications éthiques et politiques du phénomène de
la prolongation de la vie humaine3, les changements
dans les modes de perception et de représentation
du vieillissement ne sont pas nécessairement très
visibles. Comme le souligne Jean-Claude Henrard
dans Les défis du vieillissement, ce phénomène continue à
être « considéré comme une véritable épidémie,
génératrice d’une demande d’aide et de soins sans limites »4.
Parallèlement à cette tendance à ne voir dans
la personne âgée qu’un consommateur de soins
coûteux qui met en danger l’équilibre du rapport
cotisant - pensionné sur lequel repose nos systèmes
de retraites, on insiste aussi beaucoup sur le rôle
de la prévention comme moyen de responsabiliser les
individus et de faire face aux problèmes
économiques posés par le vieillissement. Il y a là
un paradoxe certain dans la mesure où l’on veut
bien voir en la personne âgée une personne
dépendante, vulnérable, à laquelle il faut proposer
3 Voir sur ce point la réflexion de Hans Jonas, « laprolongation de la vie humaine », dans Le principe responsabilité,ed. Champs Flammarion, Paris, 1998, pp.51-54.4 Jean-Claude Henrard, Les défis du vieillissement, La Découverte,Paris, 2002, introduction, p. 11 (nous soulignons).
une aide et des soins adaptés5 et où, en même
temps, on présente comme contrepoids à cette vision
du vieillissement un idéal qui serait celui de
personnes âgées capables de rester autonomes, de
s’occuper de leur santé, de prendre soin d’elles-
mêmes, de se fixer des règles de vie et d’hygiène
qui leur permettront de rester le plus longtemps
possible en bonne santé6.
L’objectif de cette action préventive que
chacun devrait exercer n’est par ailleurs pas
seulement de rester en bonne santé ou de vivre le
plus longtemps possible, mais de vieillir le mieux
possible, ou de bien vieillir7, en gardant - malgré
l’apparition de pathologies liées à l’âge - le
maximum de ses capacités physiques,
intellectuelles, et de son activité sociale.
Il s’agira d’examiner ici la manière dont est
présenté ce concept de « vieillissement réussi »
dans la littérature spécialisée sur les questions
5 C’est un point sur lequel insistait déjà beaucoup lerapport sur le vieillissement produit par le ComitéConsultatif National d’Ethique en 1998 dans son secondpoint : « Prévenir et prendre en charge la dépendance ».CCNE, Rapport sur le vieillissement, avis n°59, 25 mai 1998.6 Pour Rowe et Kahn, la responsabilisation des individus,l’insistance mise sur leurs performances et leur autonomiepermettent justement de s’opposer à une approche duvieillissement fondée sur le care qui a dominé selon eux lagérontologie pendant trop longtemps. 7 Cette injonction à « bien vieillir » est à rapprocher decelle d’un « bien mourir » analysée par Michel Castra dansBien mourir, sociologie des soins palliatifs, « le lien social », Paris,Puf, 2003.
de gériatrie, en corrélation avec l’insistance mise
sur la prévention et sur l’idée de la
responsabilité individuelle des patients âgés eu
égard à leur état de santé et à leur longévité.
Nous verrons que le concept de « vieillissement
réussi » renvoie à l’image idéalisée d’un corps
autonome, capable (physiquement et
intellectuellement), image très présente dans la
presse de vulgarisation scientifique, qui fait de
la santé et de la longévité des normes auxquelles
tout un chacun devrait se conformer. Que ce soit
dans la littérature médicale spécialisée ou dans la
littérature de vulgarisation scientifique, nous
montrerons que cette approche du vieillissement,
qui se veut positive, n’est pas dénuée d’ambiguïtés
et qu’elle traduit un certain déni du
vieillissement.
Elle conduit certes à mettre la personne âgée
au centre du dispositif de soins en insistant sur
son rôle actif dans le processus de vieillissement
et en montrant que la réussite de ce processus
n’est pas seulement entre les mains de la médecine,
mais elle tend en même temps à faire de la santé et
de la longévité une affaire de devoir et de
responsabilité individuels en renouant avec la
thématique du « médecin de soi ».
Le discours contemporain sur le vieillissement
et sa prévention
Selon les auteurs de l’article « vieillesse »
dans le Dictionnaire du corps, c’est en 1747 que l’on
trouve la première mention de la notion de
prévention appliquée au vieillissement. Le
Dictionnaire universel de médecine définit le « gérocomie »
comme cette « partie de la médecine qui prescrit un
régime aux vieillards »8. L’objectif de cette
prévention est d’allonger la vie le plus possible
tout en maintenant le corps en forme. Pourtant,
appliquer la notion de prévention à la vieillesse
ne va pas de soi. Que s’agit-il en effet de
prévenir quand on parle de vieillissement ? Non pas
le vieillissement en tant que tel puisque, qu’elle
soit saine ou maladive, la vieillesse reste un
processus naturel, mais les incidences graves que
peuvent avoir sur une personne âgée des accidents
ou des maladies dont les effets seraient moindres à
un âge moins avancé et dont on pense qu’ils
pourraient être évités.
Dans la littérature spécialisée sur le
vieillissement, la prévention est présentée comme
un moyen important de diminuer le risque
d’accidents invalidants ou susceptibles de
provoquer des pathologies graves. « Le recours à la
8 B. Puijalon & J. Trincaz, « vieillesse », dans Dictionnaire ducorps (dir. M. Marzano), Paris, Puf, 2007, p.956.
médecine préventive permet d’éviter ou de retarder
la survenue d’accidents de santé dont la
probabilité augmente au fur et à mesure qu’on
vieillit », déclare par exemple Georges Arbuz dans
Le grand âge : chance ou fatalité ?9. L’action préventive est
par ailleurs présentée comme contrepoids aux
limites de la médecine curative et comme un moyen
d’améliorer la qualité des filières de soins dans
le domaine de la gériatrie : « à défaut de pouvoir
guérir, il faut prévenir »10. Dans la mesure où la
médecine ne peut guérir toutes les maladies
associées au grand âge, prendre des mesures de
précaution pour empêcher des hospitalisations non
préparées, en urgence, apparaît indispensable.
La prévention en gériatrie peut prendre au
moins trois formes : la « prévention primaire » qui
vise à éviter l’apparition d’une maladie par des
mesures d’hygiène prises au niveau de la
population, qu’il s’agisse de contrôler la qualité
de l’air, de l’eau, de la nourriture, de pratiquer
des vaccinations, de prévenir le risque de
l’hypertension ou du cholestérol. La « prévention
secondaire », qui intervient quant à elle au tout
début de l’apparition d’une déficience ou d’une
maladie et comprend les actions de dépistage et de
traitement précoces (cancers, troubles cardiaques,
9 G. Arbuz, Le grand âge : chance ou fatalité ?, Paris, ed. S. Arslan,2003, ch. 13, « se prémunir contre la dégradation de son étatde santé et la perte de son autonomie », p.287.10 Ibid.
troubles auditifs ou visuels). Enfin la
« prévention tertiaire [qui] vise à limiter les
conséquences des maladies patentes et à réduire le
handicap social et psychoaffectif qui en
résulte » : on préviendra par exemple le risque
d’une rechute résultant d’une insuffisance
cardiaque avérée, on prendra en charge le risque de
dénutrition post-opératoire11.
Si certaines de ces actions de prévention sont
du ressort de la collectivité et dépendent de la
mise en place de politiques de santé publique, les
auteurs d’ouvrages spécialisés en gérontologie et
en gériatrie insistent aussi beaucoup sur la
responsabilité individuelle de chacun dans la
prévention. Responsabilité qui incombe à chacun non
seulement de prendre soin de son corps en se
conformant à des règles d’hygiène élémentaires,
mais aussi responsabilité de connaître et de faire
les démarches nécessaires pour bénéficier des soins
préventifs que la médecine met à leur disposition
(vaccinations, dépistages). La promotion de
l’action préventive passe par l’idée que les
facteurs qui jouent sur l’état de santé au grand
âge ne dépendent pas tant des gènes ou de l’action
médicale que « du mode de vie de chacun depuis
l’enfance »12.
11 Ibid, « Les différents types de prévention », pp.289-293.12 Ibid, p.287.
Cette insistance sur la responsabilité
individuelle de chacun est par ailleurs
caractéristique du discours relatif au
« vieillissement réussi ». On trouve par exemple
cette expression dans le rapport du CCNE sur le
vieillissement du 25 mai 199813. Plus récemment, on
le retrouve, sous une forme un peu différente (« le
bien vieillir », ce qui implique qu’on pourrait
« mal vieillir » donc rater son vieillissement) au
cœur des objectifs affichés par l’État dans la mise
en œuvre d’une politique spécifique visant les
personnes âgées, puisqu’il donne son titre au plan
national 2007-2009 : Plan national Bien vieillir.
Le concept de « vieillissement réussi » a été
proposé en 1987 par deux chercheurs en
gérontologie : John W. Rowe et Robert L. Kahn, avec
l’intention de s’opposer à la tendance qu’ont eu
les chercheurs américains en gériatrie dans les
années 1980 à insister sur la fragilité et la
vulnérabilité des personnes âgées ainsi que sur
leur dépendance14. Rowe et Kahn proposent de
distinguer trois types de vieillissement : un
13 Les auteurs du rapport indiquent que les recherches menéessur le vieillissement (ménopause, ostéoporose, hypertension,diabète, fonctionnement cérébral) laissent espérer que« plusieurs composantes du vieillissement, qu’il soit normalou pathologique, peuvent être prévenues ou traitées pouraboutir à de plus nombreux cas de vieillissement réussi ». 14 « Their literature has been preoccupied with concernsabout frailty, nursing home admissions, and the social andhealth care needs of multiply impaired elders ». John W. Rowe& Robert L. Kahn, Successful Aging, Dell Publishing, New York,1999, Introduction.
« vieillissement pathologique » (pour désigner les
pathologies qui accompagnent l’avancée en âge), un
« vieillissement usuel ou habituel » (catégorie qui
évite d’avoir recours à la notion ambiguë de
« vieillissement normal ») défini par une
« réduction des réserves adaptatives, conduisant à
un risque de déséquilibre ou à un syndrome de
fragilité », et un « vieillissement réussi »,
c’est-à-dire « à haut niveau de fonction, avec
maintien des capacités fonctionnelles ou atteinte
très modérée de celles-ci, absence de pathologies »
ou capacité à s’adapter à ces pathologies15.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont
conduit les chercheurs en gérontologie à proposer
ce concept de « vieillissement réussi ». Tout
d’abord, on peut remarquer qu’en donnant pour but à
l’action préventive la réussite du vieillissement,
on dissipe une ambiguïté possible concernant les
objectifs que l’on se fixe. La prévention ne vise
pas à empêcher le vieillissement, processus naturel
et inévitable sur lequel nous n’avons pas de prise
en tant que tel, elle vise à le réussir, au lieu de
le vivre comme une fatalité ou une échec. Le
concept de « vieillissement réussi » semble avoir
été proposé pour permettre à la gérontologie
d’échapper à l’image négative véhiculée par le
15 Ces formulations sont empruntées à Paule Le Deun etArmelle Gentric, « Vieillissement réussi », dans Médecinethérapeutique, vol. 13, n°1, p.3-16, février 2007.
vieillissement dans nos sociétés, tout en remédiant
à la dévalorisation dont les services de gériatrie
souffrent à l’hôpital16.
D’autre part, l’usage de ce concept traduit la
volonté de mettre la personne âgée au cœur du
dispositif de soins, de la faire participer à
l’action préventive, en montrant qu’il y a certes
dans le processus de vieillissement des facteurs
indépendants de notre volonté, mais aussi des
facteurs qui dépendent de nous et sur lesquels nous
pouvons intervenir. Parler de « vieillissement
réussi », c’est dire que cette réussite n’est pas
simplement une question de chance17 (le fait d’être
né avec une constitution robuste, ou des gènes
prédisposant à la longévité), et qu’elle ne dépend
pas non plus seulement du pouvoir médical (ni du
pouvoir de l’État). Le vieillissement réussi est
d’abord affaire de choix d’un « style de vie » et
relèverait donc de la responsabilité individuelle
de chacun18.
16 Cf. à ce sujet D. Vrancken, L’hôpital déridé, action organisée etcompétence éthique en gériatrie, L’Harmattan, 1995.17 Contrairement à ce que suggérait par exemple Aristote :« Une belle vieillesse […] résulte des vertus corporelles etde la chance ; car si l’on n’est pas sain et vigoureux, l’onne sera pas à l’abri de la souffrance ; l’on sera à chargeaux autres et l’on ne saurait vivre longtemps, si l’on n’estpas favorisé par la chance ». Aristote, Rhétorique, I, 5, 1361b26, Les Belles Lettres, Paris, 1991.18 Voir par exemple la page de titre de l’ouvrage de Rowe etKahn : « Find out how the way you live, not the genes youwere born with – determines health and vitality ». Voir aussila quatrième de couverture qui précise que l’ouvrage délivre« important information about lifestyle choices, which, morethan genes, determines how well we age ».
Enfin, le but de la prévention apparaît bien
ici comme spécifique par rapport à une approche
curative. Il ne s’agit pas de se fixer pour
objectif de guérir les pathologies liées à
l’avancée en âge mais bien de se situer dans une
approche plus large de la santé qui tienne compte
de la qualité de vie des personnes plutôt que de la
quantité (durée de vie en nombre d’années19), de leur
degré d’épanouissement et d’autonomie, de leur
capacité à garder « confiance et estime de soi, et
vivant en harmonie avec leur environnement
social »20.
Une conception normative de la santé au grand
âge : du champ médical au champ moral et politique
Si l’on comprend bien les motivations qui ont
pu conduire à proposer ce concept, il n’en demeure
pas moins que l’on peut s’interroger ici sur son
ambiguïté et souligner le fait qu’il renvoie à une
conception normative de ce que devrait être la santé
des personnes âgées. Le recours à ce concept
s’accompagne souvent d’une « rhétorique de la santé
qui ne conduit pas uniquement à un refus de la
maladie et de l’infirmité [ou de la vieillesse],
mais aussi à leur stigmatisation, celles-ci étant
19 « La qualité fonctionnelle des années de vie compte plusque la recherche d’une longévité maximale ». G. Arbouz, op. cit.,4e partie : comment se préparer au grand âge ?, p.289.20 Ibid, p.289.
de plus en plus perçues comme des déviations par
rapport à la normalité naturelle (Canguilhem, 1966)
ou aux normes socioculturelles (Parsons, 1965) »21.
Le « vieillissement réussi » est en effet présenté
par les auteurs qui le défendent comme un
« paradigme », un « objectif à atteindre » pour
l’individu, une norme à l’aune de laquelle chaque
individu pourra évaluer les écarts qu’il commet :
« […] dans ce modèle [de vieillissement
réussi] l’individu est son propre témoin, sa propre
norme par rapport au maintien dans le temps de ses
compétences et de ses aptitudes. Toute déviation,
modification, changement par rapport à cette norme
a valeur d’alerte, de signal, face à l’émergence
d’une déficience ou d’une incapacité non encore
visible »22. Ce concept suggère en outre que non
seulement il faut vivre longtemps et en bonne santé,
mais qu’il existe de bonnes façons de vieillir.
Cela implique, comme pour la notion de « bien
mourir » analysée par le sociologue Michel Castra,
qu’en ce qui concerne le vieillissement et la mort,
on « se situe toujours par rapport à la
représentation d’une attitude acceptable et
convenable » que chacun devrait adopter23.
21 M. M. Marzano-Parisoli, Penser le corps, « Questionsd’éthique », Puf, Paris, 2002, ch. 2 : « corps, infirmité etmédecine », p.48.22 Vieillir au XXIes, dirigé par C. Jeandel, Le tour du sujet,universalis, 2004, p.26.23 Michel Castra, Bien mourir, sociologie des soins palliatifs, « le liensocial », Puf, Paris, 2003, introduction, p.6.
Quels sont précisément les critères proposés
pour vérifier que le type de vieillissement auquel
on a affaire est bien conforme à la norme d’un
« vieillissement réussi » et que l’on a adopté
l’attitude correcte pour y parvenir ? Outre la
longévité et l’expression chez la personne âgée
d’une certaine satisfaction quant à son existence
actuelle, Rowe et Kahn mentionnent « l’absence
d’incapacités, l’engagement actif dans la vie,
l’autonomie et l’indépendance, la maîtrise, la
capacité d’adaptation ». On peut lire aussi dans un
ouvrage collectif sur le grand âge qu’« un sujet
est considéré en bonne santé, s’il est capable
physiquement et psychiquement de rester autonome,
s’il remplit les rôles qu’on attend de lui.
Inversement, un sujet est handicapé si la maladie
lui interdit l’accomplissement d’un rôle normal,
compte tenu de son âge, de son sexe et de ses
habitudes sociales et culturelles »24.
Cette définition du vieillissement pose de
nombreux problèmes. D’abord, elle met l’accent sur
les capacités de l’individu - capacités physiques et
intellectuelles - et établit une corrélation entre
ces capacités et l’autonomie de la personne
(suggérant ainsi qu’une personne atteinte dans ses
capacités physiques et intellectuelles ne serait
pas capable de rester autonome). Ensuite, elle
24 G. Arbuz, La santé au grand âge, « qu’est-ce qu’être en bonnesanté au grand âge », p.289.
établit un lien étroit entre la santé au grand âge
et l’idée d’un « rôle normal » à remplir dans la
société, comme si l’individu vieillissant devait à
tout prix chercher à garder le rôle qui était le
sien dans la société pendant sa vie active, alors
que l’on pourrait au contraire s’interroger sur la
nécessité d’une redéfinition du rôle social de la
personne âgée qui tiendrait compte de la diminution
de ses capacités antérieures mais aussi du
développement d’autres types de capacités liées à
l’avancée en âge. Enfin, elle associe de manière
étroite vieillesse et handicap, comme si le fait de
ne plus répondre à ce rôle assigné par la société
pouvait d’emblée être considéré comme une
infirmité.
Cette manière d’assigner à la personne âgée un
« rôle social » ou de définir le vieillissement
réussi par le maintien des capacités physiques et
intellectuelles de la personne âgée se traduit
aussi souvent par le recours à la notion de
« performance ». C’est le cas chez Rowe et Kahn qui
définissent le vieillissement réussi comme « à haut
niveau de fonction, avec maintien des capacités
fonctionnelles ou atteinte très modérée de celles-
ci […] ». Le concept de « vieillissement réussi »
participe, nous semble-t-il, de ce « culte de la
performance » analysé par Alain Ehrenberg - qui se
traduit par « la valorisation de l’individu souple,
mobile, autonome, indépendant, qui trouve par lui-
même ses repères dans l’existence et se réalise par
son action personnelle » - et qui caractérise nos
sociétés depuis le milieu des années 198025. On peut
donc se demander si, alors même qu’il a été pensé
comme une réponse à l’exigence de prendre la mesure
des défis posés par le vieillissement, ce concept
de « vieillissement réussi » ne traduit pas encore
une fois un déni de ce phénomène, ainsi que la
difficulté que nous pouvons avoir à accepter la
« fragilité du corps, sa vulnérabilité à la maladie
et son impuissance face au vieillissement »26.
Comme le soulignent fort justement Paule Le
Deun et Armelle Gentric dans un article consacré à
ce concept de « vieillissement réussi », « définir
la réussite comme l’absence de maladies, un
fonctionnement intellectuel et physique performant
et par la poursuite de l’engagement social, revient
à dire que la personne qui vieillit le mieux est
celle qui vieillit le moins »27.
Ce soupçon est confirmé lorsque l’on se penche
sur la manière dont ce discours est relayé sur le
plan moral (conduites individuelles) par la presse
de vulgarisation scientifique et les magazines de
santé qui font de la question du vieillissement et
25 A. Ehrenberg, Le culte de la performance, Paris, Hachette,Pluriel, 1991 (réed. 2003), introduction, p.15.26 M.M. Marzano Parisoli, Penser le corps, ibid, p.47. 27 Cf. P. Le Deun et A. Gentric, article cité en ligne :http://www.jle.com/fr/revues/medecine/met/e-docs/00/04/30/7F/article.md.
de sa prévention un de leur sujet de prédilection.
La question du vieillissement et de sa prévention
constitue en effet un des sujets de prédilection de
ce type de presse (les demandes liées à la prise en
charge du vieillissement génèrent en effet un
important marché de la santé) qui prodigue une
multitude de conseils pour vivre en bonne santé
pendant longtemps et qui mettent au cœur de leur
discours les objectifs de la réussite et de la
performance. Parmi la masse de numéros spéciaux
parus sur le sujet, relevons simplement deux
titres : un numéro de juin 2006 de Sciences et Avenir
intitulé « Programmés pour vivre longtemps » et un
numéro de Science et Vie datant de décembre 2007
intitulé : « Vivre sans vieillir, les nouvelles
réponses de la science, les clés du vieillissement,
les règles pour bien vivre longtemps ». Au-delà du
rôle des avancées scientifiques et des espoirs
qu’elles suscitent pour la prolongation de la vie,
cette littérature insiste beaucoup sur l’idée de
responsabilité individuelle et sur le fait que la
réussite du vieillissement dépend moins de la
médecine ou des gènes que du soin que chacun
apporte à son corps et à sa santé en contrôlant son
alimentation. Un exemple revient de manière
privilégiée dans ces articles : celui des
centenaires de l’archipel d’Okinawa au Japon, où
« dès l’enfance les autochtones prennent l’habitude
de s’arrêter de manger avant d’être rassasiés »
(pratique du « hara-hachi-bu » qui consiste à
quitter la table lorsqu’on est rassasié à 80 %28).
L’importance de la stimulation des fonctions
intellectuelles par des exercices de mémoire ou des
activités sociales (lectures, échange d’idées,
bricolage, jeu) ainsi que la pratique d’une
activité physique régulière font partie des autres
facteurs les plus fréquemment mentionnés parmi ceux
qui sont de notre ressort pour retarder les effets
négatifs du vieillissement. La modération (ou
sobriété), l’usage de la raison et un corps actif
apparaissent ainsi comme les clés de la prévention
et du vieillissement réussi.
L’analyse proposée par la sociologue Sylvie
Giet des rubriques santé dans la presse féminine et
masculine s’applique parfaitement à la question qui
nous occupe. La manière dont la question du
vieillissement est abordée dans la presse
spécialisée sur les questions de santé est
étroitement liée à la manière dont elle célèbre les
vertus d’un corps jeune et beau. Ici aussi, on
constate que le discours hygiéniste sur le corps a
pris le relais du discours religieux sur l’âme29 et
que les normes diffusées dans ce type de
28 Science et vie, novembre 2007, pp.62-65.29 « Tout témoigne aujourd’hui que le corps est devenu objetde salut. Il s’est littéralement substitué à l’âme dans cettefonction morale et idéologique ». S. Giet, Soyez libres, c’est unordre, le corps dans la presse féminine et masculine, « Le corps plus quejamais », éd. Autrement, Paris, 2005.
littérature (celles d’un corps mince, jeune, beau)
se sont transformées en de véritables prescriptions
morales, l’objectif de prolonger la vie se
transformant en un véritable devoir pour
l’individu, si ce n’est en une voie de salut.
Nous avons aussi signalé le fait que ce
discours était relayé sur le plan politique de la
définition des normes de l’action collective
puisque l’objectif de « bien vieillir » donne
désormais son titre au plan national mis en place
depuis 2007 et programmé jusqu’en 2009. On retrouve
dans la présentation de ce plan par le Ministère du
Travail, des Relations Sociales de la Famille et de
la Solidarité, la notion de « vieillissement
réussi » et l’idée que cette réussite dépend
d’abord de la mise en œuvre « d’actions de
prévention adaptées »30. Le rôle primordial donné à
la prévention et l’insistance mise sur la
responsabilité de chacun dans la réussite du
vieillissement constituent des outils permettant de
sensibiliser la population à la question du coût
économique de la prise en charge par l’État des
pathologies liées au vieillissement et de l’inciter
30 « Dans ce cadre, le plan national ‘bien vieillir’ présentéici a pour ambition de proposer les étapes d’un chemin pourun ‘vieillissement réussi’ tant du point de vue de la santéindividuelle que des relations sociales, en valorisantl’organisation et la mise en oeuvre d’actions de préventionadaptées ».http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees/grands-dossiers/programme-national-bien-vieillir/presentation-du-plan-national-bien-vieillir-2007-2009-.html.
à limiter la demande de soins en faisant du
vieillissement une affaire de responsabilité et de
liberté individuelles. Le succès de cette notion
apparaît bien comme un des effets de ce
gouvernement libéral des conduites et des corps et
de la promotion de l’autocontrôle comme idéal
encouragé par les instances représentatives de
l’État tels qu’ils ont été analysés et décrits par
la sociologue Dominique Memmi dans la lignée des
travaux de Michel Foucault31.
Effets possibles de cette conception normative
de la santé au grand âge sur les pratiques de soin
Il apparaît indispensable de s’interroger, pour
conclure notre réflexion, sur les effets pratiques
de cette conception normative de la santé au grand
âge. Quels sont les effets possibles de la
prégnance de ce modèle du « vieillissement réussi »
sur les pratiques de soin ? Un des risques majeurs
du succès de cette conception du vieillissement
n’est-il pas de tendre à exclure32 des soins toutes
les personnes qui ne seraient plus en possession de
toutes leurs capacités physiques, intellectuelles
31 D. Memmi, Faire vivre et laisser mourir – Le gouvernement contemporain dela naissance et de la mort, Politique et société, « textes à l’appui », LaDécouverte, Paris, 2003.32 Sur ce risque d’exclusion généré par la construction de lasanté ou de la longévité comme normes, voir Penser le corps, op.cit., p.50.
voire toutes les personnes âgées qui ne seraient
plus en mesure de « répondre au rôle » que l’on
attend d’elles : pour ces personnes âgées là, le
traitement ne serait-il pas par avance voué à
l’échec ou réduit à des ambitions très modestes ?
C’est là un risque que les travaux menés par la
sociologue Nathalie Rigaux au sein des institutions
prenant en charge des personnes âgées démentes
(démence sénile, maladie d’Alzheimer) permet de
mesurer33. Le critère de la performance est en effet
au cœur de ce qu’elle qualifie d’« approche
dominante » dans le traitement des personnes âgées
démentes. La stratégie le plus couramment adoptée
dans ces institutions pour enrayer le déclin des
fonctions cognitives et comportementales des
patients âgées déments (qui n’adoptent pas les
attitudes que l’on pourrait attendre
« normalement » d’eux et qui en cela nous
dérangent) est celle de la « stimulation ». Elle a
pour effet de « focaliser l’attention des patients
et des soignants » sur les incapacités de la
personne âgée, au lieu de tenter de faire avec les
facultés qui lui restent, avec par exemple ses
facultés affectives qui demeurent très vivaces dans
le cas de la maladie d’Alzheimer.
33 N. Rigaux, Le pari du sens, une nouvelle éthique de la relation avec lespatients âgés déments, Institut Synthélabo, Le Plessis Robinson,1998.
En se référant à une approche alternative -
celle mise en œuvre par le Pr. Louis Ploton à Lyon
- Nathalie Rigaux propose de penser la pratique de
soins à partir de ces capacités qui demeurent même
dans les cas de démences séniles graves : la
capacité du corps du patient âgé dément à
communiquer, ses affects, son imagination, sa
capacité à s’adapter à des capacités physiques ou
intellectuelles réduites peuvent être mis à profit
pour élaborer un nouveau type de relation entre le
soignant et la personne âgée démente. On le voit,
une telle perspective implique de remettre en cause
la validité des critères qui fondent l’idée même
d’un « vieillissement réussi ». Dans cette optique,
le problème n’est pas tant de faire en sorte que la
personne âgée conserve les mêmes capacités que
celles dont elle était pourvue auparavant, ni
qu’elle réponde au rôle que l’on attend d’elle. Il
s’agit bien plutôt de s’interroger sur le sens du
décalage qui peut exister entre les attentes que
nous pouvons avoir à l’égard de la vieillesse, les
rôles que nous lui assignons (la sagesse,
l’expérience, la transmission des règles sociales)
et l’image de l’inconduite, du retrait, de la
déraison, de la mort que nous renvoient certains
vieillards déments.
Nous voudrions, pour conclure cette réflexion,
reprendre le titre de l’ouvrage de Nathalie Rigaux
(Le pari du sens, une nouvelle éthique des relations avec les patients
âgés déments) pour nous demander si ce n’est pas
vers cette recherche d’un sens à donner à la
prolongation de l’existence humaine que devrait
s’orienter la réflexion et la définition
d’objectifs à atteindre pour l’individu et pour la
collectivité, en lieu et place de l’objectif de
performance qui sous-tend l’idéal d’un
« vieillissement réussi ». Quel sens peut avoir une
vie rendue plus vulnérable, plus fragile, moins
active et plus solitaire ? La diminution des
facultés rationnelles ou des capacités physiques
est-elle nécessairement un obstacle à la mise en
œuvre des soins ou bien peut-on définir de
nouvelles pratiques dans les services de gériatrie,
dans les maisons de retraite, qui se fixeraient
pour objectif de faire fonds sur la modification et
la transformation des facultés et des capacités de
la personne âgée ? Quel parti peut-on tirer des
facultés sensorielles qui demeurent vivaces chez la
personne âgée (que l’on songe au toucher par
exemple), ou encore du développement de strates de
la mémoire beaucoup plus profondes aux détriments
de celles qui renvoient à des événements plus
récents ? Le fait d’oublier sa langue natale à la
toute fin de sa vie pour ne plus parler que dans la
langue de Shakespeare doit-il nécessairement être
interprété comme une perte de notre capacité
langagière, de la disparition de notre identité, ou
comme la preuve qu’à l’approche de la mort l’être
humain est capable de faire preuve de créativité et
d’inventivité ? Ces questions ne visent encore une
fois qu’à ouvrir le débat en se demandant quels
effets pourrait avoir sur la pratique des soins le
fait de ne plus définir le vieillissement à partir
de l’idéal de la performance ou de la réussite.

























![Qu'est-ce que la propriété ? Une approche reinachienne [What is ownership? A Reinachian approach]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63307ecbebc01eab2101585a/quest-ce-que-la-propriete-une-approche-reinachienne-what-is-ownership-a-reinachian.jpg)