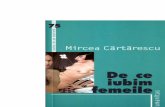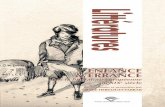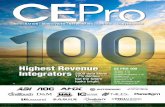Ce qu'écrit la poésie d'aujourd'hui, qu'est-ce-que c'est pour Haïti ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ce qu'écrit la poésie d'aujourd'hui, qu'est-ce-que c'est pour Haïti ?
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
Ce qu’écrit la poésie d’aujourd’hui, qu’est-ce que
c’est pour Haïti ?
Dialogues
2009
Evains WECHE & Duckens CHARITABLE (DUCCHA)
Ce qu’écrit la poésie d’aujourd’hui,
qu’est-ce que c’est pour Haïti ?
Rares sont les écrivains haïtiens n’ayant pas écrit de poèmes. À
quelques exceptions près (Gary Victor, entre autres), tous sont entrés en
littérature par la fantaisie de faire des vers à leurs belles (le plus souvent
idéalisées) ou à leur Patrie (ô Haïti chérie). D’où une conception tout à fait
fantaisiste de ce métier qui demeure un passe-temps, rarement un gagne-
pain, mais toujours un moyen de se montrer cultivé. Avec tous ces
analphabètes dans le pays, n’est pas poète qui veut ; est poète qui le déclare
malheureusement. Il va sans dire qu’à ce moment on dit n’importe quoi ! Si
on n’a pas été Rimbaud à 17 ans, on se rattrape vers 25 ans et l’on joue à la
Saint-Aude, le plus grand surréaliste haïtien. Et c’est là où le bât blesse…
Il y a une manière traditionnelle d’être poète, en Haïti du moins.
Quand cet artisan du verbe ne se prend pas pour un philosophe à la
Rembrandt, sorte de mage mystérieux transcendant les vicissitudes de la vie,
il se croit un travailleur du mot fourbant le langage, son instrument, son
arme de pointe dans cette chasse gardée qu’est la poésie. Le romantisme et
ses avatars ont inventé ces types (Goethe et Lamartine d’une part ; Leconte
de Lisle et Mallarmé d’autre part). Nous les avons surement hérités. Ici, le
poète regarde ailleurs ou en lui-même mais jamais le lieu qu’il habite ni ses
voisins. Certains appellent cela de l’universalisme. Être de nulle part pour
mieux habiter le monde. D’ailleurs entre un drap et un drapeau, certains
choisissent le drap (James Noël).
Dès qu’on peut faire une métaphore, on se prend pour l’inventeur du
genre. Georges Castera fils fut l’un de nos meilleurs poètes avant de
concevoir la poésie comme une production. En fait tout le monde peut faire
des métaphores, des chiasmes, autres tropes et non-tropes. Les poèmes
d’aujourd’hui sont bien sculptés, bons pour les musées. Mais une production
peut-elle être source d’émotion ? Peut-elle vivre et faire vivre ? Comment y
sentir profondément et le poème et le poète ? La poésie n’est pas cet accouplement
sans passion des mots qu’on nous donne pour inédit. Ce n’est pas cette fictio
rhetorica musicaque posita (fiction créée par la rhétorique et la musicalité des
mots) qu’on nous fait accroire. En fait, tout est rhétorique dans le langage
(on se rit des auteurs qui prétendent écrire sans figures de style !) Tous les
mots sont musicaux, tout comme les bruits. Sur ce chapitre, c’est son goût
qui distingue le poète. On oublie trop souvent que les mots signifient. « C’est
aux meilleurs concepts que pourra convenir le meilleur parler », nous dit
Dante. Alors que dit le poète d’aujourd’hui avec sa langue parée ? Voilà ce
qui me chagrine…
L’amour
L’amour est sans conteste le thème de prédilection de nos poètes. Le
sexe (opposé ou pas) attire et se prête au lyrisme. Le poète dit, chante, crie
son amour. Mais, après analyse, on constate que cet amour n’est pas l’amour.
Chez le poète d’aujourd’hui, cet amour prend naissance dans la
contemplation du corps de l’autre, objet de ses fantasmes, voie royale de sa
quête d’absolu. Le poète se cherche en sa bien-aimée, aime pour se retrouver.
Voilà pourquoi cet amour est le plus souvent ravageur, sauvage. Passionné
et inquiet. Hésitant à passer à l’acte (sauf dans le cas où le poème n’est qu’un
moyen d’aboutir à cet acte, qui est alors considéré comme une fin en soi).
L’amour, pour le poète, est tout à fait cathartique. Plus cérébral que
physique (la majeure partie de ce qu’il en dit n’est réalisée que sur la feuille
blanche). Parfois, pour ne pas se perdre et être sûr de réaliser son objectif, le
poète dicte à son partenaire les gestes qu’il lui faut en plein ébat ! Il est le
guide, le maître. Amour pour soi. Pour se retrouver. Amour expérience de
laboratoire. Amour de soi. Parfois, il daigne rapporter la conclusion de
l’expérience sous forme de poèmes-remerciement dédiés à l’autre. Mais, a-t-on
pensé à rejoindre cet autre dans ses fantasmes à lui ? ou mieux, à l’aimer à sa
façon afin de trouver une hybride façon, qui serait le carrefour où se
rencontrent nos fantasmes, un lieu commun où vivre ensemble ? Souvent les
poètes laissent cet effort à l’autre (ils revendiquent leur droit d’être par et
pour eux-mêmes), c’est un engagement dont ils ne sont pas capables (voguer vers
l’inconnu, tel est le maître mot). Souvent ils n’y croient pas. Disons-le une fois
pour toutes, ils ne croient plus en l’amour, nos poètes ! Ils proposent de
nous aimer comme si c’était vrai (Duccha)… Naïf, l’auteur qui s’engage à vivre
l’amour et non à en rêver. Ce sentiment pourtant si simple (non simpliste)
qui nous joint à l’autre pour le projet de vivre ensemble, pour le don gratuit
de soi, parce qu’on lui veut du bien et qu’on sait que c’est réciproque. Ce
besoin de l’autre pour nos sexes affamés, gourmands, insatiables, goutant à la
même table, ensemble ou à tour de rôle, peu importe, pourvu que l’on
trouve là où l’on donne. Cette confiance absolue, jamais démentie ; ce pacte
tacite entre nos corps, entre nos cœurs…
Voilà pourquoi malgré l’acharnement de nos poètes à traiter de
l’amour, le monde en est malade.
La Solitude.
On naît seul. On meurt seul. Vit-on seul ? Les romantiques ont
inventé pas mal de chose, surtout des sentiments. Le mal du siècle, le spleen
et autres niaiseries qui nous accablent encore aujourd’hui. On n’est pas seul.
On se crée seul. On n’a qu’à tourner la tête pour voir le sourire ou les larmes
de l’autre. Nous sommes plus de 8 milliards sur cette planète, qui
dépérissent. Nous sommes plus de huit millions sur ce bout d’île, qui se
meurent. Nous sommes trois, quatre, six, dix dans cette famille en mal de
vivre. Nous sommes au moins deux à s’aimer. Vit-on seul ? On est seul, si
on le veut.
On est seul quand on ne communique pas. La plupart de nos poètes se
vautre dans cette solitude parce qu’ils minimisent la capacité de l’autre à
accéder à leur discours. Un discours, ô combien ennuyeux, fruit d’une
« masturbation intellectuelle » perverse, exercice de style pour apprentis
écrivains ou paroles éthérées pour cerveaux « supérieurs » ! Mais mon Dieu,
ne pourrait-on interpeller tout le monde simple, envoyer des signaux à
hauteur d’homme, bref atterrir le discours ? Non, ils ne le feront pas. Les
poètes aiment être seuls. En quête de la quintessence du vers, ils aiment
s’accrocher à leurs pages blanches, en se gavant de musiques psychédéliques,
d’alcool et même de drogues. Ils préfèrent les mots aux hommes. Mais que
veut dire un mot qui ne s’adresse à personne ? Est-on poète sans sensibilité,
sans réceptivité ? Haut les yeux, poète !
Le langage
Il y a toujours eu des écrivains à questionner le langage. Le texte est
un travail sur le langage, pris comme matériau et comme thématique. À
chaque ligne, le poète le transgresse, le détruit et le reconstruit. Ce travail
heureusement se fait de lui-même, dès qu’on se met à penser au premier
mot du texte. Ce n’est pas nouveau dans la littérature, c’est le propre de
l’écriture. Point n’est besoin de se torturer les méninges pour forniquer avec
le langage, il suffit d’écrire. Dans le Kâma-Sûtra toutes les positions mènent
au coït. Certains se donnent un mal fou pour varier à chaque minute : parce
qu’ils savent qu’ils n’ont pas beaucoup de temps, il leur faut masquer leur
maladresse. Ainsi fait le poète stérile qui se tue à dire la même chose en mille
et une tournures plates.
Nommer est le propre du langage. Mais, bon sang, pourquoi toute
une nuit blanche pour trouver des mots pour dire la Lune et des jours
entiers pour expliquer le Soleil ? Et surtout pour quoi ne faire que ça ?
Pourquoi faut-il ça ? Est-ce pour dire de « beaux » mots que le poète parle
des « belles » choses ? Ce serait autrement intéressant de nommer les
éléments terrestres et humains de la vie, leurs particularités, notre (nos)
quête(s) du bonheur, nos malheurs, nos chutes et nos victoires, nos espoirs,
nos silences, nos corps largués là dans la marée de la vie (ce mouvement
perpétuel), l’ici et maintenant, l’hier et le demain, etc. Le poète gagnerait à
nommer les objets et les sentiments qui nous interpellent vraiment, qui nous
permettent de le voir et de répondre à son signal, lui, le voyant, le porteur de
lumière.
L’engagement
Ah ! On y revient. On ne croit plus en rien de nos jours. La
conviction est un bien grand mot dans ce pays (Rodney Saint-Eloi). Sont-ce
les désenchantements ? 1986. 1991. 1994. 2004. Hier. Aujourd’hui. Il y a de
quoi en avoir ras le bol de l’espoir. Le peuple en a marre. Les beaux
discours, les grands systèmes. Tout cela n’a rien donné, sinon le sentiment
que rien ne va plus, un gout amer au fond de la gorge. L’inflation, le
chômage, l’insécurité, l’instabilité menaçante, les ouragans, les bidonvilles,
bref, le sous-développement qui s’accélère, c’est tout un programme pour
éteindre l’élan vital de tout un peuple. Mais ça n’est pas le cas ! Le cœur
du peuple palpite. Il veut vivre. Le peuple des bas-fonds cherchent la vie.
S’est-on suicidé malgré la misère ? Non, au contraire. On envoie sa
progéniture à l’école. On se fait boat-people. On se putanise. On se sentanise.
On se fait arnaquer. Mais on encaisse. On continue d’être ce peuple qui rit et
qui danse dont parlait l’Oncle. On s’accroche. Malgré le chant désespéré du
poète, sa parole-mutisme. Là où il reviendrait au samba d’allumer la flamme,
il faillit et ne répond pas à l’appel. Le peuple se bat pour vivre et nous crie :
« Nous ne sommes pas frappés de fatalisme. Tiens bon, poète. Aide-nous à
relever la barre. » Pourquoi alors cette poésie de l’impuissance ? Ce parti-pris
contre l’espoir ? En privilégiant la démarche personnelle contre l’action
collective, cette génération de poètes a abandonné le peuple dans sa quête de
lendemains qui chantent. L’a-t-elle par là condamné ? L’individualisme n’a
jamais été un humanisme. Comme le disait un ami sartrien, « toute écriture
est prise de position » et qui ne dit rien consent.
Est-ce pour faire universel que nos jeunes poètes boudent la réalité
quotidienne ? Toute écriture est d’époque. Personne ne pourra dire plus qu’il
n’a vécu (Frankétienne). Nous aimerions lire les particularités de la vie de
nos poètes. Comment aime-t-on sur une pile d’immondices ? Comment vit-
on dans les ruelles empuanties de Martissant ? Comment est un baiser sans
dentifrice ? Est-ce de l’argent sale que rapporte un père qui travaille à la
voirie ou une mineure sur la place Saint-Pierre à 22 heures ? Qu’est-ce qu’un
Ti-Pouchon qui tremble de peur d’être kidnappé ? Oui, la vie est absurde et
les grands systèmes ont tort. Mais ce peuple a-t-il tort de vouloir vivre ?
Après le constat de l’absurdité, la révolte (L’homme révolté, Albert Camus).
Comment comprendre que nos poètes, fils de ce peuple, embrassent cette
littérature linguistique de pure forme face à ses origines ? Nos romanciers,
sont-ils les vrais poètes d’aujourd’hui ?
L’identité
Nous l’avons déjà dit nos poètes sont universels. Ne leur cherchons
pas noise, de ce côté. Ils ne sont ni noirs, ni jaunes, ni blancs, ni quoique ce
soit, juste des poètes. Leur patrie ? Le monde, quand ce n’est pas le mot.
Leur mère ? La terre. Leur maître ? Tous et Personne. Leurs origines ? Ils
sont une génération spontanée. Voilà le mot lâché.
« Les livres poussent sur les livres », dit un vieux slogan. Comment
d’un coup de balai effacer tout le paysage littéraire construit peu à peu par
nos honorables ainés sous prétexte qu’on n’est le réceptacle de personne ?
Sommes-nous les fils du/de rien ? Ce n’est pas de rejeter Paul Laraque par
exemple, mais de savoir qui on embrasse. Oui, on est éclectique, universel,
cosmopolite, comme vous voulez, mais après qui ? Etzer Vilaire, ce vieillot
que tous les poètes haïtiens exècrent et envient. Oui, on est surréaliste. Sur
quelle épaule d’ombre s’appuie-t-on ? Oui, on est révolté. Quelle étincelle suit-
on ? Est-on folkloriste ? Carl Brouard. Présente-t-on son pays que voici ? son
pays délabré ? Est-on post-moderne/nihiliste ? Avons-nous mal à l’histoire ?
Pourquoi les poètes d’aujourd’hui ont-ils si peur de se découvrir des racines
(surtout haïtiennes) à l’heure du triomphe de la littérature comparée ? Les
réponses à la Freud pourraient être intéressantes. Mais c’est encore pire. Il y
a une hypocrisie qui veut qu’on cache ses origines pour que le sorcier ne
nous jette des mauvais sorts…
En fait, le gros mensonge, c’est qu’on pense toujours que la littérature
haïtienne n’existe pas encore (c’est ce qu’on apprend à l’école) parce qu’on
ne se donne pas le plaisir de la lire. Chacun pense l’inventer. Et on s’y prend
mal puisqu’on veut la faire à la manière des autres. Exactement comme nos
premiers écrivains. Il y a une manière traditionnelle d’être poète ici.
Conclusion
Les poètes d’aujourd’hui semblent répéter avec Sade : « Je veux bien
faire des crimes pour favoriser mes passions, aucun pour servir celle des
autres. » Les « quelque chose à servir ou à dire » sont bannis. Vive
l’expression du moi suprême, mythique et plurielle ! Vivent le
désintéressement et l’indifférence ! À bas l’histoire ! Dessalines ? Connais
pas. Les aînés ont échoué. Faisons comme bon nous semble. Et c’est
l’anarchie.
Mais nous gardons espoir, nous, peuple-souverain qui souffrons et
nous débattons pour survivre. Nous attendons impatiemment ce fils-poète
qui nous dira sans honte ni fioritures inutiles. Nous croyons avec Paul
Claudel que la poésie « ne plonge pas dans l’infini pour trouver du nouveau
mais au fond du défini pour y trouver de l’inépuisable. »
Évains Wêche
Existe-il une poésie d’aujourd’hui en Haïti ?
Il ne fait aucun doute que dans ces derniers jours de débandade
généralisée de la pensée et des valeurs, la poésie perd de ses lettres de
noblesse, de ses atouts et de ses lecteurs. D’autant plus que la publicité et les
autres arts de la parole se sont accaparés ses techniques. Cette situation vient
donner force au propos de celui qui arrive à pouvoir questionner l’activité et
les résultats poétiques dans une perspective de promotion de la poésie et de
réhabilitation de la place des poètes dans la cité (contrairement à Platon qui
n’y voyait pour ces derniers que la mise à la porte). Toutefois, même si à
mon avis la poésie est tout aussi un phénomène de pensée que d’émotions,
ou de partage d’émotions par des médiums diversifiés, dont les mots dans la
parole écrite, il sera toujours difficile de classifier (classer) les poètes, leur
poésie ou leur authenticité, s’il en est. Pourquoi voudrait-on les faire asseoir
sur un même banc de classe ?
Ce n’est pas parce qu’on passe tous par un même chemin qu’on
effectue le même nombre de pas avec la même cadence, le même rythme
pour qu’on ressent le même plaisir à le faire ou qu’en le racontant, on suscite
les mêmes émotions chez celui qui nous écoute. J’ai horreur du pullulement
du même. Même si ce n’est jamais parfaitement le même. Personnellement,
je n’estime pas heureux les romanciers haïtiens qui n’ont jamais écrit de
poèmes. Il faut que j’avoue que je ne les connais pas non plus, que je n’ai
pas besoin de les connaitre avec cette caractéristique non avenue. De toute
façon, je ne m’attaquerai point à l’inutilité de cette caractéristique s’il en est
car n’avoir pas publié de poème ne signifie point qu’on n’en a jamais écrit.
Et qui pourrait vérifier si oui ou non ils ont écrit des poèmes quand ils
étaient plus jeunes ? A leurs belles pour les amuser ou recevoir quelque
grâce d’elles. Pourquoi pas non plus ils n’en écriraient pas ?
Puisque la littérature et la poésie participent de l’imaginaire, donc du
mensonge paré, du beau défrichage de l’imaginaire, la réalité qui elle aussi
relève de l’imaginaire, est expérimentée sous une forme qui permet de
questionner le réel sans en souffrir. Le mensonge est dans la forme dirait
certains, mais elle est bien dans le fonds aussi si on part d’un principe
d’intentionnalité pour aboutir à un système textuel. L’écriture poétique est
fondée monde sur la démarche ludique (donc individualiste parce que le jeu
n’a de règles que pour soi et subséquemment pour le plaisir de soi). C’est
vrai il faut aller dire des choses qui vont faire pleurer, ou rire ou réfléchir
tout simplement. Mais, tout en étant seul, en écrivant, je crois j’écris toujours
en présence de ceux que j’ai lu ou en présence de ceux que je vais lire. Et la
solitude du vécu ne peut en aucune façon se confondre avec la solitude
(l’angoisse) au moment de l’écriture qui peut être uniquement passagère. En
effet, quelle chanson disait qu’on peut être seul même dans la foule. Et
n’allez pas penser que c’est une solitude dans la tête, non, on est au milieu de
plein de gens qui sourient, ou qui pleurent, mais rendez leur le sourire,
attristez-vous avec eux et tentez de leur sécher les larmes et étonnez-vous de
voir comment ils n’avaient pas si besoin de vous. Je ne crois pas que la
poésie va sauver le monde, que la poésie va faire vivre ce peuple qui a tant
besoin de vivre. La beauté peut-être, comme le voudrait bien un
Dostoïevski. Mais quoi ! Ce n’est point encore le cas…Pourquoi ne se
rattraperait-on pas pour devenir Rimbaud à 25 ans, si on peut par là détenir
un bonheur, le seul qu’on se serait octroyé, depuis la naissance ? Pourquoi se
cacherait-on derrière le flou de toute une foule, dont on ne peut ni avoir la
pensée ni concevoir qu’elle puisse en avoir une, unique et réelle ?
Il y a une manière traditionnelle d’être tout ce que l’on veut être dans
ce monde, psychologue, publiciste, odontologue et poète aussi. Il n’y a
aucune vérité dans ce qui précède. J’en doute fort parce que la certitude n’est
pas le bien de tous. Bien que j’adore l’idée nietzschéenne de surmonter
l’homme en nous, je ne suis pas d’avis que les hommes supérieurs sont dans
ce monde. On est tous des individualistes, égoïstes pourquoi pas, pour le
bonheur de tous, si on est heureux seuls le malheur vite siégera. Mais si on
est heureux en faisant le bonheur de qui on veut et qui veut bien, on peut
garder le bonheur dans les fourchettes de la courte vie à faire ici. Je ne crois
pas non plus que le poète soit supérieur à quiconque, il doit manger pour
vivre, travailler, et chier. Il doit même vendre sa force de travail s’il le faut
pour ne pas finir dans les pus et les vers. Il va recevoir de grandes secousses
dans sa vie, comme tout le monde, il devra surmonter quelques-uns et
succomber à d’autres. Il sera content avec des amis, abandonnera d’autres. Il
voudra faire des sacrifices pour ceux qui souffrent mais se trouvera face à
l’ordre socio-historico-structurelle et aura conscience de sa petitesse et son
impuissance. Tôt ou tard. Il fera alors ce qu’il peut, il fera alors aussi pour lui
–même. Il y une manière traditionnelle d’être et de vivre, surtout en Haïti.
Dès qu’on sent qu’on peut dire des choses qui plaisent, dans l’urgence
de se vouloir et de se sentir aimé, on peut dire. Et nul ne peut interdire à
quelqu’un de dire. On n’a nul besoin de savoir faire des métaphores, ou des
tropes. Dans une perspective mégalomane, on se voudrait le plus grand
poète de tous les temps qui eut fait quoi. Dans ce monde marchand, si
quelque poète entre dans la logique de production, je ne poserai aucune
question philosophique même si c’était possible. Si on est disposé à sentir
des émotions n’importe quoi peut les faire surgir au fond de nous. Je n’ai pas
lu tous les poèmes d’aujourd’hui (tellement la vertu du nombre nous
engouffre tous) ce qui me limite clairement dans ce que je dis. Mais une
production d’un nous dans le discours personnel peut-être pourrait faire une
différence. Mais la nature de cette différence ne change pas grand-chose
dans les enjeux concrets de la vie quotidienne des peuples. Un nous pour
l’histoire, un nous pour les civilisations et la progéniture. C’est à ce
niveau que je pense qu’il faut laisser à leur place le travail de l’écriture
(poétique) et celui de l’engagement (une sorte de praxis) et de la militance.
Soit ! S’il ne faut pas parler pour un nous qui veut vivre
(dépendamment de la perception du poète car il en a) quand on ne peut rien
faire pour que cela advienne, il ne peut être mal aisé de parler pour soi,
quitte à satisfaire des pathologies mentales. Et sur ce point oui, tout le
monde en bénéficie. Dans un environnement (entendez ici les groupes
sociaux) marqués par l’incertitude et l’incapacité de vivre comme on rêve
(rêve souvent infecté par des images venant des ailleurs), les affects mentaux
peuvent bien encourager des paroles apparemment nihilistes. Mais n’est pas
nihiliste qui ne veut pas. La passion des mots est un souvenir romantique.
Et, vouloir dire quelque chose dans la poésie ne peut dépendre d’une simple
commande. Pourquoi voudrait-on que j’aille chercher des images dans les
dépotoirs à chaque carrefour pour faire de la poésie ? C’est vrai on parle
d’un lieu physique, lieu vécu avec ses caractéristiques spatio-temporelles.
C’est vrai il y avait une littérature et une poésie de défense des valeurs et de
la culture haïtiennes après l’indépendance. Certes, il y a eu une poésie contre
l’occupation américaine, mais aujourd’hui pourquoi voudrait-on qu’il y ait
une poésie d’aujourd’hui pour une Haïti qui n’a pas si changé que cela ?
Voudrait-on entrer dans un passéisme désuet et inutile ou un folklorisme
fébrile qui n’a pas de pertinence évolutive ?…Je ne postule aucune vision de
la poésie qui empêcherait d’affirmer comme toi, quoique avec quelque
hésitation, que les romanciers sont les meilleurs poètes d’aujourd’hui. Enfin,
pas tous ! Bref, je crois que l’histoire de la poésie occidentale a octroyé un
large espace à l’individualité, et le roman aussi n’en sort pas intact (littérature
du je). Mais le je est un autre, et l’autre est assis dans/devant le je.
De quoi parlent les poètes aujourd’huii ? De ce qu’ils veulent, cela a
toujours été le cas. Surréaliste, je crois qu’ils ont été piégés, mais pas pour
leur malheur. Ils pourront grâce à cette démarche se démarquer de la parole
facile, expérimenter les limites du sens commun et traditionnel, et par là
s’échapper (s’ils en ont l’opportunité) pour s’offrit une parole plus saine et
plus propre (entendez personnel) qui puisse participer d’un mouvement de
soi à autrui. La masturbation intellectuelle peut-être identifiée partout dans
les modes de penser. Mais elle n’est jamais évidente ni intentionnelle. Là où
l’on croit qu’elle y est, elle peut bien ne pas y figurer. Dommage serait à ceux
qui ont trop lu !
Je n’ai pas pu m’empêcher de créer un paradoxe heureux dans l’idée
d’exprimer l’oubli de l’autre dans l’expression de l’amour de l’autre. On parle
de ses fantasmes avec l’autre, de ses volontés même, sans que l’autre y soit ?
Je ne suis pas d’avis qu’il ne soit pas donné à tous d’être poète, rien que pour
dire pourquoi l’autre ne parle pas de ses fantasmes à lui. Rien ne dit non plus
qu’en exprimant ses fantasmes réels ou irréalisables, l’autre n’avait pas
préalablement donné son aval (ou avis). Mais pour passer de ce désir du
corps et du plaisir à l’amour de l’autre restera toujours problématique.
L’amour, même si ce n’est pas le vrai, est toujours possible dans la recherche
du plaisir. Et si le poète ne cherchait point l’absolue confiance entre des
cœurs et des corps ! En tout cas, j’aime beaucoup ce Benjelloun qui pense
que tout poète a dans sa tête une femme qu’il ne rencontrera jamais, même
pas dans ses rêves.
La solitude, j’y reviens en particulier, n’est pas réellement un
problème à résoudre, car elle est toujours proactive, dans la perspective de
l’expérience personnelle. Communiquer, on ne le fait plus, on le fait d’une
autre façon. Il y a des sociologues qui pensent, en termes de problèmes, le
fait que les gens en transport en commun ne se parlent pas de visu, mais
attendent un appel. Moi, je ne le vois pas ainsi, les émotions sont distribuées
dans le temps vécu en intérieur. Pourquoi vouloir que les gens se partagent
des sourires quand ils n’en ont pas envie ? Aller vers l’autre c’est toujours
d’une certaine façon voguer vers l’inconnu. Dans la solitude de ses envies,
peurs et challenges. La solitude n’est pas non plus un état absolu et
irrémédiable.
L’identité et l’engagement, je ne m’y prononcerais pas ici, car ces
concepts me nécessiteraient un temps que je n’ai pas en ce moment et un
effort plus grand que celui que je ne peux consentir à l’instant. En tout cas,
le poète n’est pas dans une bulle de poésie. C’est un être vivant dans un
écosystème, mais plus dans une économie et une société.
Alors, le langage. C’est la poésie même. Non ! Si on ne me comprend
pas aujourd’hui, on me comprendra dans cinquante ans, quel est mon
mérite ? Sur quels critères juger de la réussite d’un poète ? Pas d’un poème,
d’un poète. Je ne sais. Alors mieux vaut ne pas non plus s’y aventurer pour
rien. Toutefois, il demeure certain que faire de la poésie participe d’un désir
de satisfaction d’un certain lectorat. La plupart du temps et de nos jours, il
s’agit pour le poète de trouver une poétique, laquelle peut changer au fil du
temps. Les romanciers le font aussi. Entendons que si celui qui écrit crée sa
propre langue, est-ce uniquement pour lui-même ? J’en doute fort. Et ceux
qui se greffent sur la langue des autres pour l’orner, le peaufiner et y trouver
leur lieu de vérité, pourquoi en avoir après eux, les classer ? Je ne voudrais
point banaliser le processus de création poétique mais un poète américain
traditionnel ou un slameur moderne au Brésil ou à Paris ne se ressemblent
pas entre eux, ni ne correspondent au profil d’un Rimbaud ou d’un
Mallarmé, soit.
La conclusion, qui n’en est pas une, c’est que la critique a une bonne
place pour faire avancer les choses. C’est le mieux que l’on puisse espérer
pour comprendre la marche et la manière d’être poète dans ce monde, la
tradition n’étant pas une malédiction. Mais il y aura des poètes toujours qui
écrivent, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Tans pis pour ceux qui
n’aimeraient pas leur poésie. Les structures d’études de textes poétiques dans
les universités pourraient avoir du pain sur la planche si elles existaient en
tant que telles, ce qui affermirait un peu la place des poètes dans la cité
nôtre, parce que les poètes, s’ils n’ont pas le monde, n’ont pas que la poésie
pour cité.
En guise de réponse…
J’ai une conception vieux jeu de la poésie. Elle est du côté des valeurs
et de leur sauvegarde, comme tu dis ? Je ne sais trop. Toujours est-il que je
crois encore que l’on sort toujours gagnant de l’écriture. Catharsis ou pas.
« Linguistique » ou pas. Si la poésie ne peut changer le monde (qui sait,
pourtant ? « Je crois que le monde sera sauvé par une meilleure littérature »,
aurait dit Mallarmé), elle peut au moins la faire rêver. Si tu n’en es pas
convaincu, réponds à cette question : sont-ce les beats et le talent (don et
maitrise des techniques) des chanteurs eux-mêmes qui ont fait le succès du
premier album du groupe Barikad Crew ? Je la crois pertinente, cette
question.
Nos démarches se rejoignent sur certains points qu’il faudrait peut-
être énumérer si l’on voudrait être objectif. Mais heureusement, on est
plutôt à couteaux tirés. Cela me rappelle le bon vieux temps (encore vieux
jeu, hein ?). Les discussions autour du concept labyrinthe. Nos (d)ébats.
DJAB. Sentimentalisme ? Non. Nous rappeler peut-être qu’il y a eu un/du
bonheur à faire ça… Dans l’affreuse solitude où l’on se cache, il y a encore
un chrétien-vivant contre/avec qui se prendre.
J’ai horreur du pullulement du même. Et je répète, surement après une
affiche, que « le nouveau n’est plus nouveau. » Conviendrait-il de n’en pas
faire pour autant, du nouveau ? Au poète de savoir. Surtout qu’il n’aille pas
se salir dans les dépotoirs des coins de rue du pays, il est trop précieux pour
cela.
Je suis d’avis que la masturbation intellectuelle n’est pas toujours
intentionnelle et qu’elle est dans tous les modes de pensée (d’expression, je
préfère). N’est-ce pas par elle que l’on s’éjacule ? Si l’on arrive à écrire à deux
mains, à deux plumes, entre confrères consentants, l’on réussit mal à écrire
ensemble. C’est pas comme l’amour (même dans l’amour, il est difficile
d’être deux, selon Sollers). Mais comme tu le dis justement, la solitude
pourrait ne pas être un état absolu. Si on le veut bien. Cette masturbation
m’intéresse par sa production. Si elle est stérile, l’on peut se couper les
veines, on sera toujours Gros Jean comme devant, pour parler comme un
classique que j’aime.
Le langage n’est pas la poésie. C’est plutôt ce qu’on veut nous faire
accroire. Le langage, c’est juste un matériau, un outil même pour certains.
C’est, de préférence, ce qu’on y dit et comment on le dit qui feraient poésie.
Sa langue, chacun la crée au jour le jour, pour le bien de tous. Les poètes ne
se ressemblent pas mais travaillent tous le même matériau. Le poète
américain traditionnel et le slameur français ou brésilien rejoignent par là
Mallarmé et Rimbaud. Sur le même pied d’égalité (ou au même carrefour,
c’est selon) : dire autrement.
Il est vrai que l’on ne bat pas sa bouche de la même façon que X ou Y
dans la poésie (X, Y étant poètes). On veut surtout ne pas savoir qu’on le
fait (il y en a qui préfèrent ne pas lire les autres pour ne pas le découvrir !)
D’où cette peur des rapprochements, des familles, du catalogage (les
bibliothécaires, du moins, y sont forcés ; pardonne-les). On n’assoit pas les
poètes sur le même banc, on les a trouvés là. On ne fait que le leur dévoiler.
Je ne peux savoir s’ils sont heureux les quelques romanciers haïtiens
qui n’ont pas écrit de poèmes. Il faudrait le leur demander (tout comme les
poètes qui n’ont écrit qu’une seule nouvelle durant toute leur carrière
d’écrivain). Cela n’a aucun intérêt pour moi. À chacun son médium.
Ce n’est pas parce qu’ « on aimerait ne pas avoir (ne pas sentir le)
besoin de l’autre » pour que cette position se généralise. Comment savoir si
l’autre répondra à son appel si on ne lui tend pas la main ? Essayons
toujours. « On peut être seul, même dans la foule. » On peut, si on veut bien.
D’ailleurs qu’est-ce qui fait la foule sinon des individualités qui se
cherchent (un jour meilleur, peut-être) ?
Qui parlait de flou de la foule ? Qu’est-ce que c’est que cette
expression ? La foule n’est pas à une photographie à traiter… La foule ne
saurait être floue, pour moi, puisque pour y accéder il faut accepter ses
conditions et endosser ses idées, être dans son système. Cela n’a rien de flou,
tout est net, précisé (La bête qui sommeille, Don Tracy). Par contre, on
parlerait plutôt du flou des poètes. Des contours indistincts de la poésie. De
la position jamais une du poète. De son parti pris contre tout ce qui est clair,
non nuancé, peu compliqué, distinct…
Pour ne pas être dans la foule, à laquelle on ne s’identifie pas, on se
ferme. Barricade. Le poète habite la/sa poésie. Il ne tient surtout pas à ce
que son lieu patauge dans la masse de la foule. Quel sens donner à son
écriture alors ? Pourquoi écrit-il ? Le sens de l’écriture est dans le mystère du
cœur (de l’être) écrivant. Néanmoins, personne ne niera que le poète est un
être humain comme les autres (toi-même l’as dit), ni supérieur ni inférieur.
Un homme dans la mêlée. Ni au-dessus ni au-dessous. Surtout pas en-
dehors. « Nul n’est une île, » pour citer un slogan à la mode.
Est engagé « l’intellectuel et ou l’artiste qui, prenant conscience de son
appartenance à la société de son temps, renonce à une position de simple
spectateur (je pense à Césaire) et met sa pensée ou son art au service d’une
cause. » Ne sommes-nous pas tous engagés dans quelque chose (Ça engage
donc, ce qu’on écrit ? constatait Sartre)? Ne serait-ce que dans la défense (si
besoin est) de sa conception de soi et du monde ? Ne faudrait-il pas que le
poète définisse ce à quoi il s’engage en (s’)écrivant ? C’est peut-être trop lui
demander. Mais au moins, puisse-t-il avoir la complaisance d’identifier la
voie où il s’engage (ô horreur, n’est-ce-pas ?). On est mal placé pour choisir à
sa place. Encore une fois, on propose. Mon texte propose. L’engagement
n’est pas absolu. Sartre parlait de ce grand écrivain qui s’engagea et se
dégagea plus souvent encore…
Bref ! Tout cela pour ne rien dire en fait si l’on ne comprend qu’il
revient au poète de devenir Rimbaud, Saint-Aude, Sony Labou Tansi, ce
qu’il voudra, merde ! Il a même le droit de toiser le monde, de s’en foutre, et
même de le foutre en l’air. Kamikaze contre lui-même et les autres. Moi, je
garde et propose ma conception vieillotte de la poésie. « Dans l’encre et
l’amertume, une arme trempée peut encore servir les humains, » disait
l’autre. Je crois que l’homme (sans être ce surhomme, qui manquait tant à
Nietzsche) est assez grand pour se mesurer à la monstruosité, fut-elle
mondiale. On peut toujours plus. On est impuissant quand on
(s’)abandonne. Le fatalisme s’use et pue face à un homme qui a un rêve.
Le monde n’est pas fait d’argile
La réponse dont j’ai eu le plaisir de prendre connaissance m’a plu de
multiples façons. D’autant plus que l’auteur, mon cher ami, l’a
confectionnée rapidement, tout en mettant dans sa tête que mon propos
était fabriquée dans une atmosphère de couteaux tirés. Loin de là, pour te
rassurer. Et, je crois que ton intention n’est même pas de rendre la pareille
s’il en était fait comme pensé.
Si je veux jouer un peu sur le discours que j’ai tenu dans ma première
réponse, je peux dire que l’impuissance se trouve dans les manifestations
même de la puissance. L’inverse est tout aussi particulièrement vrai. Je ne
parle pas de physique, ou d’impuissance sexuelle. Et même là encore ! N’est-
il pas vrai que les plus petites particules portent des énergies infinies. Tout
est énergie, disent les derniers biophysiciens. Si l’on définit la puissance
comme étant la capacité ou le pouvoir d’utiliser à profit l’énergie dont on est
le dépositaire, la notion d’impuissance est indissociable alors de la puissance.
Un petit rien peut ouvrir une occasion en plus pour utiliser l’énergie. Une
petite erreur peut boucher l’expression d’une puissance. Les pannes ! Les
petits défauts de fonctionnement !
Ceci pour exprimer mon accord avec la conclusion qui fait de
l’impuissance une conséquence (parmi d’autres bien sur) de l’abandon de
soi. Mais ce n’est pas totalement vrai, il existe des corps qui même dans une
condition d’abandon, gardent une capacité de faire des choses de façon
spontanée ; ils peuvent appeler l’énergie en eux, qu’elle se manifeste, et sont
toujours dans cette condition. Toujours est-il que ce n’est pas un abandon
total. Mais le fatalisme est un peu salutaire si on le cultive comme une
lentille proactive, telle une démarche de prophétie autodestructive.
L’individualisme revient en force, dans ces circonstances. Il faut croire que
l’on peut être heureux, et que l’on a la capacité de faire soi-même ce
bonheur, pour ce croire capable de le mettre à la disposition d’autres
personnes (quoiqu’il peut s’avérer indispensable que les autres participent à
la quête de ce bonheur). L’individualisme est un humanisme, au-delà de
toutes les vérités qui viennent nous dire le contraire. On pourrait penser au
personnalisme, et rapprocher ce concept de Mounier à l’individualisme, mais
je crois que ce concept fait de l’individu un élément très passif dans la
société de laquelle il attend qu’elle lui procure le bonheur. Au contraire,
l’individualisme pousse l’être humain à la recherche personnelle. Pour
certains philosophes de la fin du XVIIIème, le bonheur collectif se réalisera
si tous cherchent leur bonheur individuel. Je ne crois pas mais le principe
reste quand même à la base de toute action pour soi ou pour tous.
Pour cela, l’engagement ? Joli mot qui entraine tant de maux. Surtout,
quand l’injustice et la douleur font rage et que la foule (j’y reviendrai), dans
l’urgence de vivre mieux, se met attentive et réceptive à toute action ou
parole qui va dans le sens de ses désirs. Mais que de fois se sont-ils retrouvés
bafoués ! Que de ressentis ont-ils éprouvé après avoir remarqué qu’ils
n’avaient rien compris des rouages sociaux et des conditions du changement
social ! Mon propos, comme aucun, n’est pas du tout absolu. Il participe
d’une approche qui privilégie la structure sociale, les matériaux de la
production et les institutions établies, au détriment de l’individu pris comme
entité de faible poids, parfois isolé et dont les actes n’ont pas grand impact
sur la marche des relations sociales. Les imperfections sociales ont la vie
dure. Et n’allez pas croire que la jungle n’est pas la société.
Le poète engagé, dans le discours, aura pour vocation de convaincre.
C’est sûr. La voix des sans-voix, je voudrais mieux qu’il donne la voix aux
sans voix, afin que tous puissent comprendre les fondements de la cause.
Etre la voix des sans voix, quoi de plus individualiste, et même, quelle
prétention mégalomane ! Je sais que mon propos paraitra tumultueux, mais
que veux-tu ? Tant que la population locale (et mondiale) ira grandissant, il
sera de plus en plus difficile de résoudre les problèmes du genre humain. Je
vais trop loin ! Mais c’est une loi mathématique ! Si les problèmes n’ont pas
pu être résolus quand il y avait peu de gens, ce n’est pas quand le nombre
vient trop lourd qu’ils vont s’estomper, même si leur appréhension devient
de plus en plus claire (ce qui peut aussi bien être une illusion). La tendance
des problèmes sociaux à en faire émerger d’autres devient plus dynamique
avec le nombre et le temps. Le poète dans ces conditions se proposerait de
parler pour des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne savent même pas
qu’il parle pour eux. Et personne ne s’occuperait de lui. Admettons qu’il
parle leur langue, qui ne serait pas le langage de la poésie, quelle serait la
finalité de cette parole ? Leur montrer qu’il faut changer la vie. Mais
comment ? L’éducation de ces gens est très difficile pour le poète. D’autant
plus que, comme je l’avais soutenu quelque peu dans l’introduction de mon
texte précédant, il y a une sorte de banalisation de certaines valeurs,
expressions, formes de pensée aussi. Qu’un poète (un peu ambigu
aujourd’hui) chante (s’il chante !) la liberté, la justice, le changement…Il n’y
a aucun problème, on le classe, c’est beau, c’est un poète engagé, on
applaudit, c’est tout. Que veux-tu ? J’ai écouté, avec énormément de plaisir
les albums, de Manno Charlemagne, de la poésie et du chant, à mettre tout
le monde dans la rue littéralement, et à voir changer des choses. Mais a-t-on
quelque chose à signaler, il ne faut pas abandonner la bataille. Il y a là moyen
de classer les poètes ou de les retrouver sur le même banc. Et sois-en sûr,
mon cher ami, ils savent bien qu’ils sont sur ce banc là. La cause, elle est
dans la tête ; les conditions de vie, elles sont là. Et les approches de ceux qui
tirent le meilleur parti de la situation iront toujours à l’encontre de
l’expression de la cause telle qu’elle sera vue par les poètes-éducateurs,
poètes-serviteurs-sociaux ou tout simplement poètes-vigies.
Je pourrai prendre le cas d’un de nos poètes bien connus et dont tu
avais signalé son turnover dans la production. C’est un poète-rentier (proche
de la notion de poète-bourgeois), cela ne dépend pas de lui, ce n’est pas sa
faute. Il voulait du mieux être pour ceux qu’il ne connait pas. Cela n’est pas
grave. Il n’a pas renoncé aux faveurs liées uniquement à sa condition
d’héritier. Non, pourquoi le devrait-il ? Pour aller se trouver le cul déchiré
par la misère ! Il aurait pu embobiner (mauvais mot) quelques amis et les
mettre dans la bataille, mais s’il n’a pas le charisme, tant pis. Il n’est que
poète, ou musicien ou critique, bref ! Ah ! L’histoire, j’allais oublier, il était
rentré combattre sous le régime dur des Duvalier, heureusement, ils ne sont
plus là ! Voila donc leur mérite, cette classe de gens ! Je sais que mes mots
tournent un peu au jaune, mais ce n’est pas de sentiment que je m’exprime,
c’est ma vision de la réalité. Je ne prends aucun plaisir à ces gens qui se
cachent derrière l’histoire.
S’engager puis se dégager : le libre arbitre. La possibilité de voir qu’on
s’était trompé : c’est le mieux qui puisse arriver à un être humain pendant
qu’il est temps. Je ne vois aucune mésaventure ou malhonnêteté dans ce
comportement. D’autant plus que quoiqu’on écrive ça engage. Ça engage donc,
ce qu’on écrit. Mais il y a bien également les poètes, qui vivent dans le mirage
de ces grands espaces sociaux, remplis de belles femmes et de bon vin, qui
ne rêvent qu’à participer à une de ces soirées qui finissent comme ils se
mettent dans la tête, en orgie super-sensationnelle.
La foule, les populations, le peuple, ces mots quelque part synonymes,
renvoient bien à quelque chose de supérieur à la somme d’individus qui les
composent. La foule peut être floue, une foule foulée aux pieds. Les
conditions de la foule viennent de qui ? La majeure partie des composantes
de la foule ne savent pas trop où ils vont. Ils n’ont que ce qu’ils peuvent
avoir, des slogans à la bouche, pour aller à la boucherie. On connait tous les
histoires d’auteurs intellectuels d’action, de main cachée et de manipulateurs
riches. Alors parlons du flou des poètes. Je n’en sais rien. Mais il y en a qui
sont floués aussi par leur attachement à quelque conception circonstanciée
dans des situations historiques. Des poètes qui viendront changer le monde
avec leur centaine de poèmes qui ne seront lus qu’au plus par de quelque
centaines de milliers de gens. Ce n’est pas rien, je dois l’avouer. Mais ceci ne
va en rien changer le monde. Le sens donné à (ou pris par) l’écriture dépend
du poète et pas de la foule qu’il voit venir. Nul n’est une île parce que nulle
île n’est indivisible. Parce qu’on ne saurait vivre comme si on était une île
(en autarcie). Mais en relation avec qui ? Les interrogations socratiques sur la
vie commune ne perdront jamais leur pertinence.
Le nouveau, qu’est-ce que c’est ? Par rapport à quoi fait-on du
nouveau dans l’écriture? L’imagination participe au domaine de l’infini (des
possibilités). On peut faire ce qu’on veut. On peut décider de tout refaire
autrement, mais fera-t-on du nouveau en refaisant. Ce n’est pas évident.
Posons la question d’un autre point de vue ? Qui est autorisé à nommer le
nouveau nouveau ? Je ne puis m’empêcher de rire face à cette nouvelle
interrogation car elle est en même temps le résultat de la première question
et une démarche bien assise dans l’histoire littéraire. Rimbaud s’est fait
maltraité par sa voyance pour trainer après un Verlaine qui ne le dépassera
pas ; eux deux seront dos à dos après avec la communauté. Saint-Aude ne
dialoguera plus avec ses lampes (pour lui-même) jusqu'à ce qu’un poète
malhabile vienne dire à tous qu’il fait du surréalisme à l’état sauvage.
Davertige ne sera plus idem après qu’un éditeur alertera le monde qu’il y a
un poète génial sur cette terre d’Haïti. Qui est-ce qui fait l’écrivain, ou le
poète ? L’éditeur ou l’écriture (la poésie) ? Pourquoi faut-il que je fasse du
nouveau pour ceux qui ne savent rien de ce que je fais ? Du nouveau pour
moi-même pour échapper à la masturbation intellectuelle ou poétique ? Mais
je dois avouer que cette activité plaît à beaucoup de gens (ils ont des
avantages à la pratiquer) et que tous n’auront pas le temps pour faire du
nouveau. Ce qui ne résout en rien la question.
Bien que je ne mêlerais pas la poésie dans les termes qu’on discutait
avec l’affaire du rap, je ferai ce petit retour sur Baricad Crew pour ne pas
laisser triomphant ce vieil argument (maitrise des techniques). D’abord, avec
quoi mesure-t-on le succès d’un groupe de rap qui fait du commercial? Je ne
crois pas que le monde a besoin de rêver (mais comme tu as dit, de vivre ou
de vivre autre chose) et Barikad Crew n’a pas fait rêver les gens. La plupart
des textes étant partis sur un ton impératif. En premier lieu, le succès des
BC participe des beat, bien sur et d’un héritage. L’underground d’est
développé depuis la fin de la fausse bataille ORS/ King Posse. Tout le
monde attendait le nouveau. Les beat d’abord hot de BC ont touché plus
d’un. Les référents faisant appel au patriotisme pur sont les seconds piliers
de ce succès dont tu parles. En écoutant La Dessalinienne, tout haïtien
moyen sent palpiter un peu plus vite son cœur (faudrait faire une étude sur
cela). Et ils ont pris les propos de la révolution chère aux jeunes, dits
bredjenn aujourd’hui, de la violence latente, et du vouloir adopter/adapter le
black american attitude. Et enfin, sur le plan du travail de ces rappeurs, ils
ont misé sur le concept, voilà ce qui compte dans le commercial, le concept.
Rien que le concept et le succès partout ici est une affaire de concept. Ils
trouvent des petits bouts de phrases que les gens peuvent retenir/ répéter.
On n’a nul besoin de dire quand on a un concept. C’est ce qui donne lieu de
questionner la profondeur de ces messieurs et d’autoriser du même coup la
méfiance de quelques gris à la mouvance dont ces rappeurs sont l’auteur.
Les textes viennent juste après et, d’un point de vue personnel, ce ne sont
pas les meilleurs rappeurs haïtiens que j’ai eu le plaisir de rencontrer ou
d’écouter.
Duckens Charitable
06-08-09
I
Mon couteau est une prairie verte
Couteaux tirés. Plumes tirées. De ces deux énoncés, on peut tirer que
les plumes peuvent être des couteaux. Disons donc : à plumes tirées. Veuille
excuser ce parler cavalier, produit assurément d’un héritage, de certaines
réminiscences (Don Quichotte de la Manche, Les trois Mousquetaires, Le
hussard sur le toit…) Parler utilisé pour te mettre sur tes éperons (ou si tu
préfères la sellette ou au pied du mur –cela a commencé dès le début, la
phrase nominale: contre ces poètes-là) et voir comment ta plume aiguillonnée
montera-t-elle à l’assaut de ces vieilles forteresses que sont l’engagement, les
traditions littéraires, la solidarité ( ?)… Et il n’a pas échoué, ce parler.
J’ai beaucoup apprécié ton dernier texte. Tu pourfends, à juste titre,
les imposteurs, ceux qui se cachent derrière l’histoire. Ta sincérité, merci. Je n’ai
rien contre le jaune, c’est la couleur de ceux qui s’affirment. Sache qu’il y
aura toujours des traitres dans nos rangs. Ils chercheront à tirer parti de, et
même à détourner tout à leur profit (il leur faut bien vivre leur quotidien,
surtout que rien n’assure l’aboutissement heureux du projet commun). On
ne peut juger de leur franchise, de leur engagement réel. Leurs intérêts sont
personnels (Duvalier gênait, tout comme Attila –JBA–, une certaine classe
sociale privilégiée). Mais puisqu’ils sont là autant profiter de ce qu’ils
peuvent apporter tout en les ayant à l’œil (chat échaudé est si intelligent qu’il
craint même la vapeur d’eau) –mais de quel droit ? demanderait-on. On ne
les connait pas ? Ils se compromettront tôt ou tard. Il importe qu’on se donne
une vérité « une idée pour laquelle on puisse vivre ou mourir » (Kierkegaard)
mais surtout une idée pour trouver son bonheur. Son bonheur qui participe
de celui des autres. Des gens, des poètes (la poésie est aussi un mode de vie),
ont essayé. Je crois que ce n’est pas toujours que les Manuel doivent mourir
et que Moïse ne foule Canaan. Les petits bourgeois réactionnaires,
tributaires du Depès de Maurice Sixto, n’ont pas vu les Sentaniz dans leurs
gros livres. Il nous faut de nouvelles vérités…
Les conjonctures ont la tête dure, hélas. Elles cassent les meilleurs
élans. Les formules, les meilleures, s’y cassent les dents. Surtout celles qui ne
se sont pas adaptées. Importées qu’elles sont en général, ces formules
farfouillent et s’emmêlent dans leurs propres termes. Sur beaucoup de
territoires exportateurs de formules salutaires, les chances (préparation +
opportunité) sont égales. Une structure éprouvée y veille. Ainsi chacun peut
n’être responsable que de soi (ce n’est pas si sûr), que de son choix. On se
fout de celui qui « végète », car le système lui donne les moyens adéquats
pour qu’il se réalise. « Végéter » est alors un choix ; peut-être même bonheur
de celui qui s’y laisse choir.
Par contre, pour nous, les opportunités sont rares. Même les mieux
préparés sortent parfois bredouilles. La réussite (aboutissement heureux
d’une quête de bonheur) est une exception qui confirme la règle. Quand elle
arrive, elle est une insulte à la foule agressive et flouée. Le bonheur
individuel est fragile parce que menacé –il peut se retourner contre soi.
Couteau à double tranchant. L’envie, mon cher, la convoitise (conséquence
d’une faim). Ici, rares sont ceux qui ont leurs chats à fouetter…
L’humanisme de l’individualisme n’est pas si évident que ça. « Que chacun
balaie devant chez soi et la rue sera propre », disent les chinois (ou les
japonais). Tout le monde n’a pas de balai, malheureusement. Mais on a
chacun un couteau pour trancher des fruits ou des carotides, au gré des
soubresauts de la vie. Celui qui veut faire son bonheur se trouve ipso facto
confronté à cette conjoncture qui s’aggrave, dont se gavent certains tandis
que d’autres s’en lavent les mains.
Que faire ? Il revient aux ayant droit de tout mettre en branle pour
créer les conditions indispensables au bonheur individuel. Et les ayant droit
c’est le gouvernement, la société civile, les privilégiés. Toi, moi, tout ceux qui
ont reçu un balai ou ont pu se le procurer par prouesse personnelle. Société
civile, bourgeoisie, intellectuels, classe moyenne, investisseurs étrangers se
trouvent alors dans l’obligation de compter (avec) les aspirations du peuple.
Sinon, je ne donne pas cher de notre peau.
De la conjoncture, l’on est tous responsables, surtout à cause de notre
indifférence. C’est mégalomane de s’octroyer le titre pompeux de
Voixdessansvoix, mais l’on peut toujours montrer du doigt un homme qui
crie (à moins d’être aveugle !) L’on peut toujours aller vers lui et lui donner
la parole (aujourd’hui le peuple se fait entendre par la violence du grand
nombre). Donner la voix aux sans-voix, comme tu disais justement.
Certains sociologues croient que l’on se réfugie dans la littérature
(surtout la poésie) par déception. L’écrivain (le poète) s’escrime à exprimer
cette déception ou (par bovarysme ?) créerait son monde à lui où cette
déception n’existerait pas. Je ne crois pas que nos poètes puissent se payer
ce dernier luxe. « La poésie porte (a toujours porté, je dirais) le poids de
l’attente du monde » (Alquié). Il appartient au poète de nous ouvrir une voie
« vers le plus-être. » L’art, loin de nous divertir, nous apprend à exister pour
soi et pour les autres.
II
Je tire mon couteau. C’est avec que je
m’immisce dans le monde.
Pourquoi la poésie ?
La poésie se veut « parole vitale. » Michaud croyait que certaines
phrases feraient pousser des feuilles et des racines à un vieux bâton. Le
poète est une source d’inspiration. Il peut aussi être le couteau qui dit le
cœur de l’igname, sa plaie, ses beautés...
Le poète est, je crois, plus proche de la réalité que ceux qui pensent la
vivre, puisqu’il la sent, lui. Ayant appris à ouvrir ses pores/portes à la vie, il
est mieux placé que les sociologues, les philosophes (y compris les
économistes), les psychologues, les sciences, pour le comprendre. Moi, je
fais confiance à la connaissance du poète, pluridimensionnelle, subjective,
profonde. Parce que je sais que ces grands enfants sentent au-delà des
apparences et ont assez de ressources (acquis de leur pratique du langage)
pour exprimer le monde et les nuances les plus infimes. Aux meilleurs
concepts, le meilleur parler (Dante) ; la réciproque peut être vraie aussi.
Heidegger voyait bien que la poésie n’est pas si jeu que ça. « Dans la poésie
au contraire, écrit-il, l’homme est concentré sur le fond de la réalité-
humaine. » Le rôle de jongleur de mots qu’on confère au poète est tout à fait
secondaire. Le poète dit. Pourquoi ne dirait-il pas le malaise, l’attente, la vie,
les déceptions, les larmes du peuple ; malaise, attente, vie, déceptions, larmes
qui lui sont quotidiennes, siennes ?
Et je crois dans le poids des mots. Ça personne ne peut le récuser. Si
l’on croit les chrétiens, le monde est né « de la parole et de la magie. » « Dieu
dit que la lumière soit et la lumière fut. » Le mot peut. Et le poète, dit-on,
« parle la parole essentielle. » L’humanité entière a soif de poésie. Poésie
pour la tragédie récurrente de la misère.
(La plupart de ces idées ont été empruntées à J. Onimus, auteur de La
Connaissance poétique. Introduction aux poètes modernes)
Il est vrai que devant la multitude de choix qui s’imposent au poète, il
se sent confronté au néant du monde. Quelle est LA bonne voie ? Où planter
son couteau ? On cherche. D’où la quête que semble revendiquer plus d’un.
Cependant, on sera forcé un jour ou l’autre de choisir quelque chose à faire de
soi. Absurdement peut-être. Là, je me dis que le poète saura toujours trouver
sa voie : celle de son parti-pris pour la vie, la fête, les fleurs, l’amour, le
bonheur… Alors tous les yeux (même ceux qui ne le savent pas) cherchent
le poète ; sera-t-il reconnu dès son avènement : il portera le couteau qu’il
faut. Et pourquoi faut-il que les autres savent qu’on se bat pour eux, qu’on
leur donne la parole puisque ce combat, cette parole est nôtre ? Nos parents
sont ouvriers, commerçants, paysans ; fils du peuple, nous sommes. Notre
lieu est un grand bidonville. Contrairement aux « petits bourgeois », notre parole
sera sincère…
C’est naïf, puérile et tout, donc poétique. Comment vivre sans rêver ?
L’on perdra, à coup sûr, si l’on se trompe sur le poète. Peut-être
qu’alors tu aurais raison de penser que « mon programme » n’est plus de
mise. Les poètes « sociaux » (comme on disait autrefois barde nationale)
doivent-ils mourir ? Un critique a parlé de ces auteurs, dont on attend trop,
qui sont devenus des chevaux repus. Plus bons pour la course. Les vieux
auteurs engagés font sourire la critique occidentale aujourd’hui et il y a un
système qui en profite et qui veut qu’il en soit ainsi. Toujours. Le monde est
plus à droite qu’à gauche, chacun tient à garder ses acquis. Ces
imperfections, comme tu dis…
III
Couteaux neufs. Couteaux usés.
Qui a le droit de nommer le nouveau nouveau ? J’avoue ne pas savoir.
Mais l’on peut avancer prudemment que le nouveau est peut-être de l’inédit.
Il est dit nouveau par rapport à un ancien, un déjà là (fait). Il tient de
l’histoire littéraire plutôt que de la littérature. Mais on finit par constater que
le nouveau n’est pas si nouveau qu’on le pense. Il tient toujours de l’ancien,
qu’il continue. C’est vrai que le nouveau peut être tout simplement fabriqué
ou présenté comme tel. On peut tout dire de n’importe quoi. Le concept fait
le reste, comme tu dis. Donc, le nouveau n’est plus nouveau. Ne pas en
faire, serait-ce nouveau ? Là encore, on ne peut répondre catégoriquement.
Peut-être que c’est au critique de savoir. Tout tient de l’histoire littéraire. La
morale de la fable : le génie a horreur d’avoir la grosse tête.
Ton analyse du succès de BC est juste. Fondé sur une connaissance
du marché, un travers (lol) professionnel. C’est vrai que les beats, le concept,
le style, blablabla. Mais ton argument perd de sa pertinence quand tu parles
de « petits bouts de phrase que les gens peuvent répéter. » Cela ne te
rappelle rien ? Un certain président populiste qui parlait de « ti minorite
zuit » ? Petits bouts de phrase, dits avec intention de se faire un succès (ce
n’est pas à moi de juger), mais qui interpellent les gens, charrient un peu de
leurs revendications, qui parlent d’eux-mêmes, où ils se retrouvent. Qu’ils
répètent. Petits bouts de phrases qui deviennent grands alors… Et pourquoi
le poète ne veut pas en faire autant (j’ai en tête l’idée saugrenue qu’il aurait
pu faire mieux) ? Partir d’un concept, des métaphores, des petits bouts de
phrases qui parlent de/pour/en tout le monde. Aurait-il peur du succès ou
pour sa peau (lui, on l’aurait pris au sérieux, ah, ah, ah, la bonne blague ;
mais, non, on a pris au sérieux les Masters, à un certain moment)?
Les rappeurs, toi, t’as la chance de les rencontrer. Moi, dans le bout
de l’île (supposons qu’elle est une tête –géopolitique), j’écoute ce qui
m’arrive. Un peu de tout ce qui me plaît bien. Mais tu as peut-être raison de
penser que ce ne sont pas les meilleurs rappeurs haïtiens. Moi, je n’y vois
que dalles. Ils n’ont peut-être pas de métier, pourtant, tu admets que les BC
ont apporté du nouveau (par rapport à l’ancien ; histoire musicale), et ça, je
pense que c’est méritant. Quand ma mère écoute Nou pap lage, Nou di non, elle
crie : « Ba yo ! Men bagay la !», heureuse d’entendre dire ce qu’elle aimerait
dire. BC m’a fait rêver à une jeunesse qui se serait engagée dans/à…
Fermons la parenthèse, veux-tu ?
Toute littérature est conjoncturelle.
Ta plume tirée a reconnu son ami dans les mains qui frappent ces
lettres.
Évains Wêche
i Je ne sais pas s’il existe un concept “poètes d’aujourd’hui”.