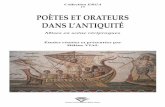La poésie postmoderne et l'histoire. István Kemény
Transcript of La poésie postmoderne et l'histoire. István Kemény
ÉTUDES ET RÉFLEXIONS
ISTVÁN KEMÉNY ET L’HISTOIRE OU L’ÉTERNEL RETOUR DUMYTHE
■ GUILLAUME METAYER ■
n pourrait, à une première lecture de son œuvre, marquéepar de nombreuses références au passé collectif, européensurtout, et pour paraphraser la formule de Gautier, qui se
disait un homme « pour qui le monde extérieur existe », appelerIstván Kemény (1) un poète pour qui l’Histoire existe : ceci en feraitd’emblée une figure singulière dans la génération postmoderne,habitée par la conviction de sa post-historicité et de son éloigne-ment de l’histoire. Sans doute n’est-il pas indifférent que les nocesobscures de l’histoire et de la nation aient été révélées dans leur« fabrique », « fabrication », « invention », « construction », comme desfictions inauthentiques et dangereuses, dans les années mêmes oùécrit le poète. Nombre de travaux historiques n’ont peut-être pasd’autre visée intellectuelle, morale et politique que d’inscrire àjamais dans le marbre cette même idée-force de l’inauthenticité– du caractère « construit » – de ce qui se croyait naturel, national.La notion de « construction » est donc liée à un contexte idéolo-gique plus vaste, celui de l’après-guerre antinationaliste ; elle sefonde sur les acquis épistémologiques de la notion nietzschéennede « généalogie », qui étudie, littéralement, les « naissances » (2).
O
44
Pour Nóra Milótay
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 44
Face aux efforts répétés de déconstruction des notions appa-remment les plus naturelles et des nations aux identités apparem-ment les plus stables et les moins interrogeables – bref, face à cetélan d’« histoire critique », pour reprendre une autre terminologienietzschéenne (3), des dernières décennies, quelle place reste-t-ilpour l’histoire dans la poésie ? La poésie se met-elle à son tour, àl’instar de ses consœurs plus intellectuelles, à déconstruire ? S’agit-il d’un mouvement conforme ou contraire à son essence, quiserait, selon l’étymologie, de « faire », de « fabriquer » (poïein) ?Sans doute une nature artistique peut-elle être excitée un tempspar ce défi de « faire » avec de la déconstruction. Un tel paradoxecréatif ne ferait que rejoindre tous les paradoxes qui jalonnentl’histoire des arts : l’art se plaît singulièrement à s’imposer lacontrainte de son contraire. Dans la tragédie, le dionysiaque seformule dans la sérénité de la forme apollinienne ; la passion, nor-malement muette ou bégayante, se trouve une langue déliée (4) ;la langue la plus pauvre sert la plus grande finesse (Racine, lesGrecs classiques) : nombreux sont les exemples d’un art qui sedéploie dans son contraire, sous la pire des contraintes. Peut-êtrecette tendance est-elle à mettre en relation avec ce penchant desartistes à mépriser ce pour quoi ils sont naturellement le plusdoués : ainsi que Nietzsche encore l’affirme pour Wagner, dont letalent serait surtout caractérisé par le sens du détail (5) ! Bref, si lapoésie se met souvent au service d’une philosophie, quel bénéficel’actuelle peut-elle tirer de « l’archéologie » et de la« déconstruction », de surcroît dans une vulgate simplifiée ? Car lelien est évident entre l’archéologie au sens foucaldien et ladéconstruction et fragmentation postmodernes. L’analyse, c’est-à-dire la dissolution des formes historiquement données, en tant quemouvement d’« histoire critique », n’est qu’un avatar de cet usagede l’histoire comme méthode de sape du présent, déjà en marchesous les Lumières. La destruction des formes du présent est laconséquence logique de la déconstruction de celles du passé. Ils’agit d’une forme de radicalisation anti-essentialiste de l’historicismedu XIXe siècle, dont le mouvement s’enracinait déjà dans la pra-tique historique des Lumières. Il s’agit aussi d’une entreprise quisème le doute dans les consciences historiques, les renvoie sanscesse à une complexité qui frise la régression à l’infini, révèle tou-
45
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 45
jours la diversité et l’arbitraire derrière l’unité construite, patinée etcimentée a posteriori, et naïvement vécue comme authentiquevoire autochtone. La poésie ne peut que subir de plein fouet cemouvement, trop critique et trop analytique sans doute pour êtreelle-même à son origine. Toute une poésie se priverait doncdésormais des « grands récits » historiques, après avoir été frappéepar la sécularisation et la fin des « grands récits » religieux. Il ne luiresterait plus qu’à tenter le grand saut dans l’ironie, qui lui a si malréussi au XVIIIe siècle, ou à mourir.
Le postmoderne, ère de la fin des « grands récits » selon l’ex-pression de Lyotard (6), doit aussi être celui de la « fin del’Histoire » (7), dans la mesure même où l’historiographie, endémontrant l’aspect construit des réalités historiques héritées, necherche pas, contrairement au fond du projet nietzschéen, à inciterl’homme postmoderne à devenir lui-même un nouvel artiste del’Histoire, assumant parfaitement l’arbitraire apparent des construc-tions personnelles, refusant de fuir dans l’auto-étourdissementd’une révélation céleste (8), ou « l’épilepsie » (9), bref capable deconstruire en toute conscience, de dépasser, précisément, lesentraves à la création inhérentes à la conscience. Non, le post-modernisme, animé par la posture morale et presque religieuse del’après-guerre, ne déconstruit l’histoire que pour la désarmer. Il necherche pas à s’imposer la contrainte de la conscience comme unexcitant paradoxal et une expérience limite. Il vise au relativismehistorique : « Tout cela n’est que construction » est la versionmodernisée, complexifiée de « La vie est un songe » ou de « Vanitédes vanités » : « Paradigme en deçà du XXe siècle, autre paradig-me au-delà », en somme. Pour autant, la construction postmoderne– car de même que l’absence d’idéologie est une idéologie, lathéorie de la construction est, elle aussi une construction théo-rique – ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle aperçoit le dangerde son relativisme, comme de tout effort pour contraindre l’huma-nité à un tournant moral (passer de « Tu ne tueras point » à « Plusjamais ça ») : la tristesse. La moralisation postmoderne craint d’occa-sionner, à l’instar des autres morales, une tonalité élégiaque face àla nature perdue. Or, même si elle dénonce cette nature commecréation artificielle, elle sait qu’elle va créer un manque doulou-reux, celui de bien des repères, nationaux par exemple : en aban-
46
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 46
donnant la foi en la réalité et l’authenticité de la nation, une partiedu monde habité par les hommes du XXe siècle leur devientcomme interdit, inatteignable, ce qui les plonge dans l’hébétude etl’amertume, et les prive d’un important excitant à l’action, celui deleurs ancêtres et peut-être du début de leur vie. Aussi, pour amortirla nostalgie liée à l’abandon des identités déconstruites, la cons-truction postmoderne offre une compensation : la jouissance. C’estsa compensation à cette déperdition de sens. Ce ne peut être dedevenir soi-même un grand fabricateur (10) car elle a appelé« fabrication » et « construction » ce que Nietzsche appelait « législa-tion » et « création », signe qu’elle n’en a gardé de lui qu’un pro-gramme négatif. La jouissance offre d’ailleurs à la perte de sensune compensation bien commune, qui, segmentée et répétée,conduit à une accélération générale des sociétés. Que peut bienapporter à la poésie la conversion de l’ethos nostalgique en vivacitéérotique ? Il pourrait la conduire à fleurir dans des genresimpromptus, sensuels et festifs comme les créations préislamiques,si cette joie imposée n’était la réversion d’une contrainte morale, sice libertinage n’était le revers du politiquement correct. La poésiese trouve donc peut-être dans l’une des situations les plus redouta-bles de son histoire : on lui a coupé ses sources traditionnellesd’inspiration, et, à moins de chanter, avec une ironie empruntée, lamort des identités fabriquées, elle ne peut ni déployer son ethosnostalgique, ni son éros naturel, enfoui sous plusieurs couches deréversions morales.
intertitre
Nous avons décrit à grands traits notre vision de la crise dela conscience poétique européenne à la fin du XXe siècle et audébut du XXIe ; mais nous tentons l’hypothèse qu’il en va autre-ment dans les pays d’Europe centrale autrefois soumis au jougcommuniste. Soit que la nouvelle de la « mort de Dieu » n’ait pasd’abord frappé les oreilles de ces peuples et que l’aspect de répé-tition parodique des Lumières du libertinage post-moderne et deson nomadisme officiel n’y ait pas rencontré de précédent pour
47
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 47
s’inscrire en douceur dans les consciences, soit que la dictaturemarxiste ait provoqué la résurrection de tous les « grands récits »conjurés contre celui du marxisme-léninisme, soit que la « fin del’Histoire » n’ait pu être chantée à des peuples trop proches de sonévidente vitalité, il semble que ces pays aient pu tenter la formeinédite d’une nostalgie postmoderne et d’un « jeu » avec l’histoiredont l’ironie signale plutôt le deuil que la joie, refuse les consola-tions de la légèreté, bref obéit à un modèle bien différent dumodèle français. Le paradoxe de ce modèle centre-européen – oule signe de l’énergie qui l’anime encore (11) – réside dans le faitqu’il a la capacité d’intégrer le postmoderne à la nostalgie, d’en-glober le fragment dans le tout d’un « grand récit », d’une manièrecomplexe et sinueuse que nous chercherons à décrire ici. Ainsi,l’ironie ne vise pas à refouler l’histoire pour éviter une nouvellecatastrophe (12). En Europe centrale, elle n’est pas le seul rapportdistant que l’homme post-historique s’autorise à son passé. Il ne seplaît pas à l’exaltation excessive et antiphrastique du passé, souscette forme d’éloge paradoxal modernisé qu’est le kitsch, ni à larécupération ironique de fragments historiques pour produire unanachronisme d’un comique attendu, création facile d’un violent« sentiment de distance » (13) entre les époques. Cette poésie railleplutôt notre aveuglement à ne pas voir la vieille Histoire en mar-che derrière ses travestissements et ses prétéritions.
Dans le monde postmoderne, le seul rapport possible àl’Histoire serait donc le jeu. Le jeu (Játék en hongrois) est unenotion très présente chez Kemény. Elle figure dans le titre d’un deses recueils Jeu avec le poison et le contrepoison (14) et, en sonsein, dans celui de deux poèmes dont l’un joue, précisément, avecl’histoire, en télescopant les époques révolutionnaires françaises, lamonarchie austro-hongroise et la mort annoncée du communisme,mêlant indistinctement « la révolution et la contre-révolution » (15),selon une pratique postmoderne, du point de vue formel.
Pour autant, tout jeu n’est pas le vecteur d’une ironie post-historique ; il peut même être utilisé pour suggérer une consciencehistorique, voire reconstruire un « grand récit » – restaurer le mythe(116). Nous lisons chez Kemény la tentative de dépasser le post-moderne en reconstruisant le mythe, du moins son manque nostal-gique, sa Sehnsucht. Nous avons donc affaire à un jeu à triple
48
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 48
niveau, jeu avec l’histoire, avec le mythe, mais surtout avec lepostmoderne et contre le postmoderne.
intertitre
L’histoire est omniprésente dans l’œuvre de Kemény. Il y ad’abord le Moyen Âge, histoire par excellence tant cette période aété éloignée de nous par la rupture moderne, au point de devenirle lieu de prédilection des nostalgies romantiques et d’abâtardir lemédiéval en moyenâgeux. Au sein du Moyen Âge, on perçoit chezKemény le retour fréquent de la Grande Peste, qui renvoie peut-être aussi symboliquement à l’histoire contemporaine. « Presquenoir » (17) représente un ange peint au temps de la Grande Peste.Le sous-titre de « Place des Rétros » (18) précise qu’il s’agit de« Rondeaux sur les mélodies qui ont survécu à la Grande Peste »(19). Ce poème renverse la distance postmoderne vis-à-vis du pas-sé par la mise en musique en couplets capricants de l’attachementobsessionnel à l’histoire :
Versailles, Venise,Toujours l’histoire,Me rétrovise ?Versailles, Venise,
Lumière jocrisse,Salle aux miroirsVersailles, VeniseToujours l’histoire (20).
L’Histoire est un « jocrisse » qui danse dans cette « salle auxmiroirs » qui est aussi la « galerie des glaces » ; elle regarde sanscesse en arrière (« rétrovise » (21)) et le poème se clôt sur unembouteillage où la suite de rétroviseurs crée une « galerie desglaces » :
Galerie des glaces,Place des Rétros,Devant moi auto,Auto dans mon dos (22).
49
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 49
Que ces quelques vers et ceux qui closent le poème aientété choisis par Kemény comme devise sur le site du musée Petöfisignale son sentiment non seulement d’y enchâsser en virtuose desimages narquoises dans des rythmes rapides aux rimes récurrentes,mais d’inverser l’ironie postmoderne en indiquant la prégnanceobsessive de la rétrospection historique. Dès ce poème apparaîtune figure qu’il a créée, l’« évêque du diable », être infernal etecclésial d’un Moyen Âge fantasmé. Il n’est ici qu’un personnagesecondaire et furtif (23), simple « rejeton de moire », né de notrefascination pour l’histoire, mais il joue le premier rôle dans« Aurore » :
Mois de mai de l’an 1000 et 1,Dans la Ville Miraculeuse,vers l’aube, à l’heure la plus creuse,quand le temps va son lent chemin,que tous les cabarets sont clos,qu’il pleut – signe apaisant plutôt –alors qu’encore un jour nouveaumet un nouveau jour au berceau,à sa croisée peu respectableépiait l’évêque du diable. (24)
Kemény fait encore du Moyen Âge le point de départ deson magnifique « Grand monologue » (25). Kemény sait rendre àmerveille la puissance évocatrice que concentre l’Histoire enpleine « fin de l’Histoire », en distiller la substance poétique jusqu’àcréer ce que Gracq appelait « l’esprit-de-l’histoire » (26). Le coupde maître consiste à ouvrir le poème comme un poème épique,avec des références géographiques et nationales assez claires pourévoquer les croisades (27), tout en se gardant de toute précision eten encadrant cette rêverie historique d’un protocole de doute, deflou, de distance : distance introduite d’abord par le titre (« GrandMonologue » sous-entend que cette parole apocalyptique estproférée par un acteur). Cette brillante prophétie s’enroule ensuiteen de nombreuses gloses, qui sèment le doute sur la validité dupropos. La première glose météorologique semble elle-même miseà distance par le poème : alors que « revient le règne desFrançais » :
50
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 50
Ici-bas, cependant, on apprend simplementQu’il a fait tonnerre et qu’il a plu, pendantLa nuit.
Le retour annulaire du premier vers à peine altéré vientboucler le premier mouvement du poème (28) et le deuxièmemouvement s’enclenche par l’abandon du ton épique. C’est ledébut d’une nouvelle glose de ce grand événement historique, dece grand fait métaphorique du retour de l’Histoire, ou plus préci-sément, du « passé », comme le poème le précise aussitôt (29). Lesréférences historiques s’élargissent, dépassant les Croisades jusqu’àcirconscrire « Le Gothique, l’Ancien Régime, la Terreur ». Le« Grand Monologue », d’abord parti dans une furia francese pourépouser l’émotion épique de « l’esprit-de-l’histoire », s’enlise dansdes gloses à répétition, imite les méandres de la méditation et l’en-lisement de l’épopée dans la postmodernité alexandrine, rendupar le piétinement anaphorique (30) :
« Le Gothique, l’Ancien Régime, la Terreur :Par là, nous entendons l’Église, les JardinsDe la Cour, et les monstrueuses chambres à gaz.
L’élargissement se fragmente lui-même et brise le vers : aumouvement de ruée de l’histoire se substitue un désordre d’arrêtssur images :
Les jardins, l’Église, et la chambre à gaz, toutd’un coup dans la lumière d’un dimanche midi bien chaud,Deviennent inaccessible maison dans la plaine du Pô :Dans sa cour, une vieille voiture à visage de prêtreEt 1938, à jamais,L’année de naissance de notre mèreLa grande louche dans le bouillonAvant le déjeuner a disparu une longue minute.
Le poème offre une réflexion sur l’Histoire à sa manièrecomplexe, par ses formes, notamment la glose, autant que par sonpropos. Il nous montre un retour avorté de l’Histoire, dont la vio-lence épique s’annule d’elle-même (31), avant d’être engloutiedans l’oubli condescendant d’un communiqué météorologique qui
51
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 51
rappelle la désinformation soviétique. Que le mouvement deretour de l’histoire, dans ses boucles successives, arrive jusqu’à la« chambre à gaz » est fondamental : tout se passe comme si la« chambre à gaz » était l’aboutissement de l’Histoire, selon la visionqui a animé tant d’historiens de l’après-guerre. Or si l’épopées’aplatit et s’aligne sur le meurtre, le sujet épique frustré devientsujet lyrique, qui égaré dans une « forêt obscure » (32).
L’échec du retour de l’Histoire, fût-ce dans sa quintessence,son « esprit » amène l’individu à un retour sur soi, à l’expérienced’une douloureuse désorientation marquée par l’absence designes, remplie par le bourdonnement d’un écran vide, image dela société du spectacle, qui évoque aussi l’insomnie levinassiennede l’« Il y a » (33) et, se clôt sur « une grande, obscure allée et lerien ». La conscience est prise en tenaille entre deux aspirationscontraires : l’attirance pour le souffle épique de l’Histoire et lachape de plomb de la mauvaise conscience européenne grossed’un nouveau néant, un nouveau nihilisme. Les allers-retours dupersonnel à l’historique peuvent être compris comme des aban-dons forcés du champ historique pour le champ personnel, lessauts et décrochages qui affectent le flux d’une conscience quivagabonde dans l’interdit de l’épique et ne trouve son assiette quedans l’aveu lyrique de sa désorientation. C’est la qualité rare de cepoème de réussir à la fois à peindre avec force le sens de l’eposhistorique toujours vivace, et, sur un ton de douleur authentique,la puissance de réfrènement de la mauvaise conscience et ledésarroi qu’elle provoque. Lyrisme personnel et arrière-plan histo-rique se nourrissent l’un l’autre dans une sorte de courant alterna-tif. De l’évangile du messager à une tirade sur l’impuissance à laHamlet, le poème met en scène le passage douloureux de l’histoireà la post-histoire.
Or, la post-histoire n’existe pas, comme le montre l’éternelretour de la guerre, évoquée dans un cycle consacré aux bombar-dements du Kosovo de mars 1999. Kemény est choqué, comme ill’avait été par la campagne des Malouines (34), par cette interven-tion et par la complaisance de son pays qui ouvre son espaceaérien à l’Otan.
« 999 » (35) s’ouvre bien sur une date contemporaine trèsprécise (36), mais elle est immédiatement ramenée à un temps
52
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 52
plus ancien, la Seconde Guerre mondiale. Le poème brosse unecomparaison avec un souvenir douloureux de la mémoire hon-groise, l’abandon forcé des engagements de non-agression avec laYougoslavie en 1941, qui contraint le pays à laisser passer lestroupes allemandes sur son territoire, un manque de parole quientraîna le suicide du Premier ministre Teleki, cité dans le poème :
Avril 1999, bien des années après que le Premier Ministre eut,dans sa lettre d’adieu, nommé dépouilleur de cadavres sa propre nation,un avion lent et noir apparaît au-dessus de Budapest. Plus lent, maisguère plus noir que tous les précédents.
[…] Je sais que l’appareil livre son carburant aux bombardiers.Je sais que je rêve. J’essaye de me réveiller. J’ouvre grand les yeux.
Je ne me réveille pas […]
Nous voici donc, même si cela suscite l’incrédulité du poètequi croit rêver éveillé (37), revenus en arrière de cinquante-huitans. Les répétitions de l’histoire, comme le phénomène de déjà-vu(38), suscitent une incrédulité de somnambule. Cette structures’élargit encore, car le titre, « 999 », allège la date d’un millénairemoins par coquetterie calligraphique que pour nous ramenerencore au Moyen Âge, vers l’an mil, époque de fondation del’État hongrois – ironie peut-être vis-à-vis de cet État bien fragilequi laisse passer les avions étrangers aussi facilement que les nua-ges (39). L’histoire contemporaine est donc déjà doublement filtréepar des références à la Seconde Guerre Mondiale et au MoyenÂge : la mise en évidence de ces répétitions n’est-elle pas le signed’une tendance à simplifier l’histoire en mythe, en un « mythe del’éternel retour », pour citer Eliade (40) ? L’usage keményen del’histoire, ses télescopages hérités du surréalisme, ne conduiraient-ils pas à des parallélismes et des analogies renforçant l’idée d’unerécurrence mythique anhistorique, loin d’une écriture poétique del’histoire attentive à sa particularité et l’unicité temporelle de l’évé-nement (41) ?
Ce retour mille ans en arrière, jeu avec le millénarisme, estun grand thème de cette poésie. « Aurore » s’ouvre non sur le moisd’« avril 1999 » de « 999 », mais le « mois de mai de l’an 1000 et 1 ».Plus loin, l’« évêque du diable » regarde « en arrière de 1000années, / et en avant de 1000 années » (42). C’est aussi « tous les
53
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 53
mille ans » que dans le paysage du « Massif métallifère oublié »revient « un photographe pâle comme la mort » (43). Kemény seplaît à jouer avec les vertiges historiques que portent les chiffres etles dates. Dans « Moyen Âge tardif » (44), le héros est « couchédepuis 7999 ans » et « Nous sommes en dix mille après Jésus-Christ ». Dans « Quartier magique », le recours obsessif à la paren-thèse entrechoque avec une étrangeté surréelle la steppe et leSinaï, le XVe et le XXIe siècles (45). Par un reste de superstitionnumérique ou une révérence conservée envers la comptabilisationchrétienne, l’histoire apparaît comme « chiffrée », le nombre est un« signe » (46). Cette fascination se retrouve dans un joli conte pourenfants de son dernier recueil (47). Ce bref « roman-poème » (48)raconte l’histoire des chiffres qui s’ennuient et décident de s’enfuirvers « l’infini », oubliant derrière eux le « pauvre zéro ».
Les télescopages historiques visent plus que la surprise poé-tique : ils révèlent un message par superposition, font surgir, parcomparaison, un squelette, une structure communs : le mythe.Ainsi, dans « Jeux avec la révolution et la contre-révolution », appa-raissent au moins quatre strates historiques : le communisme et sagérontocratie (49), l’époque révolutionnaire française (50), l’héri-tage de la monarchie austro-hongroise (51), sans oublier la peste(52), mais là encore l’apparition du « diable » signale le « grandrécit » biblique, résultante paradoxale, par décantation, de la multi-plication des références historiques, comme le « remède dans lemal » (53) postmoderne de l’extrême diversité. Les télescopagescréent du sens, stimulent la réflexion : la gérontocratie est unearistocratie, une révolution peut être appelée contre-révolution(54), mais ces rapprochements tendent à escamoter l’unicité duphénomène historique au profit du mythe. Cette poésie n’est doncpas historienne, si l’on entend par là l’établissement des faits dansleur unicité et leur déroulement causal.
Ce désintérêt de Kemény pour l’histoire historienne est trahipar son goût d’une longue durée, qui excède l’histoire pour rejoin-dre la préhistoire, comme dans ce poème où des archéologuessuédois sont à la recherche d’un australopithèque qui n’est autreque le narrateur (55). « L’apiculteur » (56) propose aussi de ressai-sir le devenir de l’humanité dans des dimensions qui dépassentl’histoire. Le poète commente lui-même son texte : « This poor little
54
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 54
poem wants to be about the whole history of human kind. It’s not ajoke, but it’s a joke, of course. » (57) Chacun de ces mots simplesnous ramène aux termes mêmes de notre problématique, l’histoireet le « jeu » (58) :
Pendant six mille ans j’ai été apiculteurdepuis cent ans je suis électricien.Quand je prendrai ma retraite, j’élèverai à nouveau des abeilles.Que toujours quelque chose me bourdonne, me bourdonne,me bourdonne, me bourdonne,me bourdonne(59).
La particularité historique est niée au profit d’une définitiona minima de l’humanité autour de ce goût insolite du bourdonne-ment, ce vrombissement incessant qui est comme le bruit de fondet la métaphore de l’existence, et dont on retrouve des variationsdans « l’écran vide » du « Grand monologue », l’avion qui passedans le curieux « autre ciel » d’« une journée de vie » (60), le bour-donnement obsessionnel du « petit singe » (61).
Ce n’est donc pas tout à fait la « fin de l’Histoire » dont traitecette poésie, mais plutôt, si l’on suit le récit de l’apiculteur, sonvieillissement cyclique, comparable à l’existence humaine (62) etsa réduction à un vrombissement d’insecte ou de fil électrique. Lecycle qui confond l’avant et l’après est une réponse au progressismemarxiste qui pesa sur la génération du poète.
Pourtant nous sommes peut-être déjà dans l’« après », l’aprèsd’une catastrophe. La récurrence de l’image du déluge semble lesignaler. Dans « Tu sais que je me trompe » (63), un de ses poèmesles plus célèbres (64), il est déjà question de déluge. Il ne s’agit pasde celui de la Bible, mais du texte le plus ancien de l’humanité quiait survécu à la grande peste du temps, l’épopée de Gilgamesh.Toutefois, un détail attire l’attention : ce déluge est censé durer qua-rante jours (65), tandis que, dans l’épopée, il ne dure que sept jours(66). C’est dans la Bible que le déluge dure quarante jours (67).Ainsi, si la multiplicité des histoires nous avait déjà paru se désépais-sir en se superposant jusqu’à dessiner les grandes lignes d’un mythe,une fusion des mythes est aussi à l’œuvre ici, qui profitera sans douteau regain du « grand récit » chrétien, le plus profond de nos cons-ciences européennes, même postmodernes, surtout dans le monde
55
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 55
postcommuniste. Aussi, l’appartenance de Kemény au postmoderneest-elle rendue ambiguë par sa capacité à déployer une pléiade deréférences dans un jeu virtuose et à suggérer, dans ce déploiementmême, la possibilité d’un ordre, à établir, au sein de cet éclectisme,le désir d’un syncrétisme. Ce thème du déluge revient dans « Lesamis de papa » où une famille moyenne de la banlieue de Pest rêvesans cesse de construire une arche (bárka, riche polysémie, signifie àla fois « barque » et « arche ») et s’interroge sur tout ce qu’il lui seranécessaire, dans un inventaire à la Prévert qui confine à l’absurdequand il s’agit d’y mettre aussi un « océan » (68). Dans l’épopée deGilgamesh, il s’agit de construire un bateau à partir de la maison,pour rencontrer une sagesse itinérante (69). Ici, la maison et l’archesont également inachevées (70). À la fin d’« Une journée de vie », leverbe employé (kifutni) suggère de même un « démarrage » :
« Et dès qu’ils [les enfants] dormiront, après neuf heures, partir, pieds nus et
sans bagages,Démarrer enfin, comme ces vieillards que
l’on croit sages. (71) »
Dans une bonne partie de la culture européenne tradition-nelle, c’est presque la définition du travail du poète de transfigurerla vie quotidienne à l’aide des mythes bibliques, et de les intégrerà la vie quotidienne, d’utiliser les références au Livre pour établirune cohérence imaginaire et une connivence culturelle. Dans Le Hmuet, recueil dont le titre renvoie à l’enseigne de l’hôpital, centrésur la maladie et la mort annoncée du père, « La chute » (72) estsignificatif de cette pratique. Le poème évoque l’âge d’or del’époque de « l’esprit d’enfant », période d’« avant l’archange », sansdoute le chérubin qui barre d’une épée de feu l’entrée du paradisdans la Génèse (73). Le poème mêle Bible, « roman familial » etréférences historiques. Il s’ouvre sur un tableau historique enextérieur de l’émigration aux États-Unis (74), puis pénètre l’inté-rieur du « petit-bourgeois » d’alors auprès d’un poêle dans la nuitde Noël, histoire privée centenaire qu’il ramène à des souvenirsd’enfance et à une autre histoire de feu, de père, et d’archange. Au« péché » importé en Amérique par les bateaux répond la faute des
56
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 56
enfants pardonnée par leur père, parce que, dans cette deuxièmeséquence c’est aussi Noël, moment de clémence. Les procédés dejuxtaposition tendent à la superposition : l’historique, le mythiqueet le personnel s’entremêlent, comme dans le « Grand monologue »(75). Ici, ce qui traverse et transcende ces différentes époques his-toriques et ces souvenirs d’un père mourant, c’est un mythe dupéché et une morale du pardon, celle du « Père » peut-être.
L’histoire est donc surtout exaltée en épiphanies du mythe,du « grand récit » biblique, à la manière de la série de travestisse-ments historiques d’Adam et Ève dans la Tragédie de l’Homme deMadách (76). Cette histoire incomplètement sécularisée ne peutêtre tout à fait particularisée et reste sous la coupe de « grandsrécits » religieux. Elle ne peut être que la métonymie du mythe.
Il semble que Kemény, au vu de son dernier recueil, tende àdélivrer de plus en plus le « mythe judéo-chrétien » de sa ganguede références historiques cryptiques et à le présenter plus directe-ment, délivré de la compétition érudite avec le marxisme quil’amenait à poser un masque historique à son propos mythique. Lachute du Mur et l’ère post-historique le conduisent à assumerdavantage le caractère mythologique de son propos. Dans Élöbeszéd,la figure de Caïn anime un cycle entier (77), ouvert par « Lemythe » (78) et décliné en sept poèmes, chiffre biblique par excel-lence.
Le « Je lyrique postmoderne » a donc découvert, au plus pro-fond de lui-même des restes de mythe, des vieilles tablettes quiont survécu au déluge, comme les « rondeaux » de la « place desrétros » à la « grande peste », les inscriptions cunéiformes d’un« inconscient collectif ». Le « fondu enchaîné », héritage de l’implo-sion multicolore surréaliste est mis au service d’une écriture de lafusion et d’une réponse à la fragmentation. Après le déluge, il nereste qu’à fouiller dans les fragments du moi, à s’affairer parmi lesidentités effacées, métaphores fréquentes chez Kemény : Caïn« fouille toute la maison à la recherche de son nom » (79).
C’est pourquoi souvent les fins n’en sont pas : « Ce serait la fin »(80), dit « Une journée de vie », tandis que le « Grand monologue »avoue « Puis nous les oubliions (81). C’est la fin. ». Quelque choserepart, sur un mode boiteux et piteux, comme un approfondissementde la douleur même. L’anéantissement du déluge n’est pas total.
57
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 57
Ce thème de la fin avortée est modulé, dans Élöbeszéd, enun motif du suicide jamais accompli et de la trahison de vivre.« Tristement » (82) évoque « le suicidé qui revient à la vie » et nenote plus que « Lait, pain. Lait, pain ». Les « Ruines opportunes »terminent le recueil sur l’idée que le « changement est un suicide »(83). L’idée de la lâcheté devant la mort, volontaire ou non, estcentrale : la longue fable éponyme, « Élöbeszéd » relate la visite dela Mort au narrateur (84).
Le postmoderne confond volontiers vie, vitalité et vivacité etassimile la nostalgie à une régression funèbre. Une histoire d’inspi-ration « critique » doit voir dans la nostalgie son pire ennemi etnier drastiquement ses réserves actives (monumentales) et conser-vatrices (antiquaires). Le retour du souvenir appartient pourtantaux fonctions de cicatrisation et de stimulation de la vie. Aussi, leplaisir particulier que procure cette poésie réside peut-être dans lamise en scène de la satisfaction éprouvée à constater la survie dela structure mythique, par-delà le désastre. Cette satisfaction se ditsur une tonalité désabusée, ambiguë ; mais l’affirmation de cetteSehnsucht de l’unité délivre le sujet postmoderne de l’obligationde jouir du fragment, et lui ouvre à nouveau l’espoir de l’unité.
La poésie retrouve dans le reflux du déluge les ruines desunités englouties. Un leitmotiv parcourt Élöbeszéd :
Deux fois deux font quatre.Si tu n’en dis mot – tous l’oublient.Si tu le dis trop : nul n’y croit (85).
Ce proverbe est un art poétique : ce qui faisait la seulecroyance du libertin de Molière, indique une voie poétique étroitede restauration de la vérité entre hypermnésie logorrhéique etamnésie de l’indicible, abondance et silence, lyrisme et dépouille-ment, une « voie étroite » qui « sauve le sauvable » dans ce paysagede « ruines opportunes ».
Dépassée par la « longue durée » de la préhistoire et desdistorsions temporelles violentes, ramenée à servir l’imagerie per-sonnelle du poète qui lui confère, en retour, sa charge émotive,débordée par un mythe éclectique à fond chrétien, l’histoire estquasiment absente, dans sa particularité, de l’hallucination poé-
58
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 58
tique de Kemény. Nous pourrions presque contredire notre affir-mation liminaire et affirmer que Kemény est un poète pour quil’histoire n’existe pas. C’est qu’elle est l’un des brillants relais d’unmythe à déchiffrer ; elle est, comme le présent, un réservoir destraces et des fragments à interpréter pour reconstituer la vérité desmythes que le flux du devenir et les flots du déluge emportent,comme le Danube d’« Au loin » (86) et sa « déambulation » (ballagás)infinie.
Soumise au flux du devenir, la restauration n’est jamaisaccomplie qu’à la faveur des rares épiphanies de l’« économie deparoles » poétique. Cette poésie sincère renvoie donc à une attitudeprofonde et presque clandestine de la conscience contemporaine,penchée sur les restes de l’Histoire, et dont la crispation commu-nautaire n’est que la grimace. Elle renvoie aussi à un platonismefondamental du poète qui déchiffre ici-bas les ombres des véritésd’ailleurs et nous offre une nouvelle réponse au bannissement dessiens de la cité idéale.
1. Né à Budapest en 1961, István Kemény s’impose très tôt comme la voix la plusoriginale de la génération postmoderne. Il a publié huit recueils de poèmes depuis1984, un essai, un roman, un ouvrage en collaboration avec Attila Bartis, et a reçude nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix József Attila (1997). Outre denombreuses études sur son œuvre en hongrois, des traductions sont disponiblesdans la plupart des langues européennes, dont le français, dans des revues (Actionpoétique, Le Nouveau Recueil, Prétexte), des anthologies ou sur Internet. Unrecueil est en cours de publication aux éditions Caractères (juin 2008).2. La première d’entre elles était celle du genre artistique de la tragédie, mais Nietzscheélargit le procédé à d’autres notions et de vastes ensembles comme « la morale ».3. Dans De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie (1874), Nietzschedéfinit trois types d’histoire : monumentale (qui exhume les grandeurs du passépour stimuler le présent), antiquaire (qui choie les détails locaux par reconnaissanced’exister) et critique (qui sape les puissances du présent en montrant leurs originesvicieuses).4. Nietzsche, le Gai Savoir, II, § 80.5. Le Cas Wagner, §7, Kritische Studienausgabe (KSA), vol. 6, p. 26.6. Lyotard, la Condition postmoderne : rapport sur le savoir, collection « Critique »,Minuit, 1979.7. « The End of History ? », The National Interest, 1989.8. Les grands législateurs de l’histoire se sont cachés à eux-mêmes le caractère per-sonnel de leurs réformes. Voir le fragment posthume, Été-automne 1884, 26 [406],
59
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 59
KSA, 11, p. 257.9. Voir Aurore, V, § 549, « Fuite de soi », KSA, 3, p. 318. Nietzsche remarqueque les grands hommes (Alexandre, César, Mahomet, Napoléon) étaient épilep-tiques.10. Cette tendance progresse peut-être, nuitamment, dans la société postmoderne,mais nous pouvons nous demander si l’énergie y sera suffisante et si elle n’ira pasrechercher dans des modèles extérieurs la construction arbitraire à laquelle sesoumettre.11 Les marges de l’Europe, l’Amérique du Sud de Borgès et Bioy Casarès, maisaussi l’« Occident kidnappé » cher à Milan Kundera, seraient de telles réservesd’énergie culturelle.12. Le caractère superflu – voire dangereux – de cette opération pavée de bonnesintentions apparaîtrait d’ailleurs immédiatement à toute étude un peu attentivedes rythmes et des cycles historiques, à toute écoute un peu fine de leur successionordinaire, à toute conscience plus aiguë et plus apaisée de la psychologie descollectivités et de la récurrence des crises que ne peut l’être celles qu’anime lacrainte.13. Nous appliquons librement ici la notion nietzschéenne de « Pathos derDistanz ».14. 1987. C’est aussi le titre de la première section de l’anthologie personnelle, dupoète, Valami a vérröl, p.5-69. Le principe du « jeu » s’applique à la compositionpuisque les deux poèmes « Jeu avec le poison et le contrepoison » et « Jeu avecla révolution et la contre-révolution » se font face de chaque côté de la première etde la deuxième partie.15. « Jeu avec le poison et le contrepoison » et « Jeu avec la révolution et la contre-révolution ». Voir le dossier « Hongrie : nouveaux poètes » de la revue Action poé-tique, n° 187, mars 2007, p. 47. La notion de jeu se retrouve aussi dans le poème« Fin de partie » (« Végjáték »), qui fait référence, cette fois, au jeu d’échecs, àl’instar de la pièce de Beckett du même nom.16. On trouve chez Kemény les termes « légende » (par exemple dans le poème« Tardive légende d’automne ») et « mythe » (c’est le titre d’un poème du cycle deCaïn dans Elöbeszéd).17. Hideg, p. 26.18. A Néma H, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1996, p. 39.19. Le poème évoque Venise, atteinte par la Peste noire en 1348. Peut-être le faitque les guerres entre Mongols – ce peuple qui renvoie à l’inconscient hongrois d’u-ne origine orientale – et Chinois ont sûrement déclenché l’épidémie a peut-être sapart d’influence dans la fixation de Kemény sur cette période – à moins qu’il nes’agisse d’une ombre de l’empire soviétique, perçu souvent comme asiatique, com-me la description des soldats russes dans les Mémoires de Hongrie de Márai (enfrançais chez Albin Michel, 2004).20. A Néma H, p. 39.21. Nous avons tenté ce néologisme pour imiter ceux du texte originel.22. Op. cit., p. 40. Nous traduisons « Place des Rétros » en jouant sur« rétroviseur », « rétro » et la place des Héros, symbole de l’historicisme monu-
60
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 60
mental du millénaire hongrois, au nord de Pest.23. Il passe un instant et « bâille au miroir ». Op. cit., p. 40.24. A Néma H, p. 49.25. A Néma H, p. 54-55. Il s’agit du dernier poème du recueil, ce qui ajoute aupathétique de sa fin déroutante. Voir notre article sur ce poème dans János Szávai(dir.), Problématique de la littérature européenne, L’Harmattan, 2004.26. « Ce que j’ai cherché à faire, entre autres choses, dans le Rivage des Syrtes,plutôt qu’à raconter une histoire intemporelle, c’est à libérer par distillation unélément volatil “l’esprit-de-l’Histoire”, au sens où on parle d’esprit-de-vin, et à leraffiner suffisamment pour qu’il pût s’enflammer au contact de l’imagination. Il y adans l’Histoire un sortilège embusqué […] », Julien Gracq, En lisant en écrivant,Corti, Paris, 1980, p. 216.27. « Les Français », « Grande Chevalerie », « la Terre Sainte », « mauvais Roi ».28. « le mardi annoncé dans les prévisions, / Revint le règne des Français ».29. « Par les Français, nous entendons le passé ». Ici, comme dans un certain nom-bre de poèmes, en raison notamment des parallèles historiques entre lesrévolutions de 1789 et de 1917, mais sans doute aussi pour d’autres raisons plusprofondes, l’inscription de Kemény dans l’héritage symboliste dont Ady avait cher-ché en France la formule, la poésie de Kemény se plaît dans des références à laFrance, figure d’un « style inimitable » et du « passé ». Ainsi : « Jeu avec la révolu-tion et la contre-révolution » (qui ouvre le deuxième cycle, intitulé « L’art de l’enne-mi », dans l’anthologie personnelle du poète, Quelque chose sur le sang, p. 73, enfrançais dans Action poétique, n° 187, mars 2007), « La grande révolution fran-çaise » (op. cit., p. 79), « Le doux style, équivalent à la révolution » (op. cit., p. 77).C’est une toute autre France qui apparaît dans « Pluie française » (op. cit., p. 46),celle de l’opéra de quatre sous Technicolor de Jacques Demy, les Parapluies deCherbourg. Que la pluie soit ici légèrement raillée comme « rosée mécanique » està rapprocher de son rôle de « signe » et de ses possibilités métaphoriques dumythe du Déluge.30. Ce procédé joue le rôle d’une compensation de la quasi-disparition de la rimeen même temps qu’un rappel lointain de l’usage des répétitions chez Ady.31. « Et dans l’Imperdable Bataille, / Tout le monde succombe, eux et leurs enne-mis ».32. La référence à Dante (« Au lieu du chemin de notre vie », pour le fameux « Aumilieu… » qui ouvre l’Enfer), est si transparente que le traducteur anglais, le pro-fesseur de Cambridge George Gömöri, a interpolé ici, au lieu du vers hongroisanglicisé, le vers italien (voir le site Internet Pimmedia.hu).33. Emmanuel Levinas, Ethique et infini, Livre de Poche, 1984.34. « Associations en liberté conditionnelle ». Le poème s’ouvre sur une exclama-tion lugubre « O lourds morts argentins – au-dessus d’eux la mer, et au fond deleur cœur un caillot », tandis que la suite du texte semble presque assimiler à cetteintervention des « tanks » soviétiques devenus ici littéralement des « billets debanques soviétiques », dont la couleur se dépeint sur les roses du matin. C’estpourquoi nous avons traduit par « empreintes russes » pour rappeler nos déboiresfrançais avec les « emprunts russes » au moment de la révolution soviétique.
61
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 61
Valami a vérröl, p. 47.35. Hideg. Traduction disponible sur le site Pimmedia.hu.36. « Avril 1999 ».37. L’impossible « réveil », la fatalité de la somnolence, est un de ses thèmes deprédilection, comme le montrent les réveils en cascade de « L’éveil ». Valami avérröl, p. 143-144. En français dans Nouvelle Poésie hongroise, Éditions Caractères,Paris, 2001, p. 233-234.38. « Déja [sic] vu ! » s’exclame-t-on par deux fois dans Valami a vérröl, p. 59.39. « Des brumes matinales s’élèvent des cumulus pour toute l’après-midi.L’appareil est un appareil étranger, mais les cumulus ne sont pas plus étrangers. »,Hideg, p. 25. Notons que « 999 » est le titre du deuxième cycle du recueil.40. Mircea Eliade, le Mythe de l’Eternel retour. Archétypes et répétition, Gallimard,1969.41. Deux autres poèmes du cycle du Kosovo fonctionnent sur le même modèle, endéveloppant des comparaisons historiques : « Lointaine alerte aérienne » (Hideg, p.33-34) est la réécriture macabre, faite de bombes lâchées sans risque, de la célèbreballade de Marlène Dietrich « Sag mir wo die Blumen sind » dont elle épouse lerythme et la thématique pacifiste. L’« ange presque noir » toise toujours avecautant de sévérité qu’« il y a six cents ans / au temps de la peste ». Le mythe del’angélisme du Nouveau Monde est la mauvaise conscience de l’interventionnismeclintonien. La réalité génocidaire fondatrice ressurgit avec la référence au « dernierdes Mohicans / avant qu’ils le tuent, à son tour ».42. A Néma H, p. 50.43. Valami a vérröl, p. 12-13.44. Sous-titré (« Si je meurs à l’âge de 40 ans »), signe d’un jeu entre le personnelet l’historique sur le « middle age », in Valami a vérröl, p. 28.45. Valami a verröl, p. 25.46. Le « Grand Monologue » disait bien : « à présent plus de signes ».47. Élöbeszéd, dont le titre intraduisible se situe quelque part entre « Langue cou-rante » et « Langue vivante ». Le poème « A semmieset » pourrait être traduit par« L’Affaire zéro » p. 65-72.48. « Versregény ». On peut comparer, de ce point de vue, ce texte avec des pra-tiques contemporaines semblables comme le « De l’autre côté du MontBarbouillé » du jeune Daniel Varró, dans l’excellente traduction de Juliette Campssur le site Pimmedia.hu.49. « Ceux qui n’ont pas soixante-dix ans sont ostensiblement jeunes », Valami avérröl, p. 73.50. Marie-Antoinette, Saint-Just.51. Zita.52. « Bientôt une peste d’une demi-heure traverse les villages, le metteur en scène,c’est moi ». Voir Action poétique, mars 2007, p. 47.53. Pour reprendre l’expression de Jean Starobinski sur les Lumières.54. Les événements de 1956 et dans une moindre mesure les changements de1989 ont été affublés des deux dénominations.55. « Je ne pouvais comprendre pendant que nous creusions / Que c’était sur moi
62
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 62
que les Suédois chuchotaient. », « Un Australopithèque », Játék méreggel és ellen-méreggel, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987, p. 15.56. Valami a vérröl, p. 201.57. Interview vidéo publiée sur .58. Ici la « joke », tiré du latin « joca » ou « joci », « les jeux en paroles ».59. Nous donnons ici une traduction différente de celle de Pimmedia.hu.60. A Néma H, p. 52.61. Les huit premiers vers se terminent sur le même verbe « vrombit ». Élöbeszéd,p. 61. Poème publié en traduction allemande par Die Zeit.62. « Quand je prendrai ma retraite ».63. Poème inaugural de son anthologie personnelle, Valami a vérröl, p. 7.64. Écrit sur le modèle du fameux poème de József, « Cœur pur ». Voir AttilaJózsef, Aimez-moi, Georges Kassaï et Jean-Pierre Sicre, Présentation de JeanRousselot, Phébus, 2005. Ce poème, qu’Attila József écrivit à vingt ans, fit scandaleet causa son départ de l’université de Szeged. Kemény a voulu faire de son « coupd’essai » un « coup de maître ». Voir Élöbeszéd, son interview par Attila Bartis dansla Lettre internationale, hiver 2006-2007, p. 1-2 : « Vivait dans ma tête une imageidéale, selon laquelle un poète de 20 ans devait écrire un vers comme le “Avec uncœur pur”. Et qu’il n’est pas poète tant qu’il n’a pas écrit un tel poème. […] ilcontient un aspect programmatique de la jeunesse aussi. Tout à fait comme dans lepoème “Je n’ai ni père” [incipit du poème en question]. […] Ensuite, de manièrepresque inattendue, j’ai écrit un poème que j’ai trouvé bon, du début à la fin…peut-être tient-il la route comme mon je-n’ai-ni-père. Ce fut le texte intitulé “Tusais que je me trompe”. »65. « Des déités colossales / Mais des déités en larmes / Sur mon cœur déverseront/ Quarante journées de pluie ».66. L’épopée de Gilgame ?. Le grand homme qui ne voulait pas mourir, traduit del’akkadien par Jean Bottéro, NRF, L’Aube des Peuples, Gallimard, 1992, p. 192 :« Six jours / Et sept nuits durant / Bourrasques, pluies battantes / Ouragans et déluge/ Continuèrent de saccager la terre. » (11e tablette).67. L’image du déluge se décline en versions plus discrètes : il y a le « il a fait ton-nerre et il a plu » du « Grand monologue », la pluie apaisante (« il pleut, signeapaisant plutôt »), puis argentine et presque magique (« une pluie fine / répanditson trésor de bruine ») et l’« antique averse » (vraie figure du déluge)d’« Aurore » qui ranime « l’évêque du diable ». A néma H, p. 49.68. A Néma H, p. 13-14. Traduction française dans Nouvelle poésie hongroise,Caractères, 2001. 69. « Démolis ta maison / Pour (te) faire un bateau / Renonce à tes richesses / Pourte sauver la vie », dit Enki à Utanapistî, éd. cit., p. 185.70. « Cette /maison depuis n’est toujours pas finie, / dans une maison pareille ilvous faut habiter », A Néma H, p. 13.71. A Néma H, p. 53. La longue construction du radeau dans Gilgamesh peut, deson côté, rappeler le récit technique de la fabrication du radeau d’Ulysse, longue-ment détaillée dans l’Odyssée.72. Littéralement : « la chute dans le péché ». En français dans le numéro d’Action
63
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 63
poétique cité.73. Genèse, 3, 24.74. « Voici cent ans, lorsque les grands bateaux d’acier / Jusqu’aux États-Unis por-tèrent le péché [...]».75. L’année 1938 – chiffre qui occupe presque tout un vers – n’y est pas celle quiprécède la guerre mondiale et voit la conférence de Munich de triste mémoire,mais simplement « l’année de naissance de notre mère ».76. Procédé repris à sa manière par Kun Árpád (« Une semaine de mariage »raconte l’histoire d’Adam et Ève, voir notre traduction in revue l’Archipel,Lausanne, 1999).77. « Une semaine avec le vieux Caïn », p. 46-58.78. Idem, p. 47.79. Idem, p. 47.80. Idem, p. 52.81. Il s’agit de « l’Église, les Jardins / De la Cour, et les monstrueuses chambres àgaz ».82. Idem, p. 11.83. Idem, p. 75.84. Idem, p. 29-40.85. On retrouve ce texte ou des fragments non seulement sur la quatrième de cou-verture, mais dans « Ruines opportunes », et, de manière amusante, dans « Unmariage qui a subsisté ». p. 22. Dans ce poème, le mari erre dans un décor déla-bré, obsédé toute la journée par le « deux fois deux » ; un peu plus loin sa femmedit « quatre », réponse symbolique qui sonne comme la solution solide, quoiqueterre-à-terre, à des divagations psychologiques illégitimes.86. Valami a vérröl, p. 153. Pour une version française, voir Action poétique,numéro cité, p. 51-52.
■ Guillaume Metayer, université Paris-IV (notice bio à compléter)
64
ÉTUDES ET RÉFLEXIONSIstván Kemény et l’histoireou l’éternel retour du mythe
0803et&refl 8/02/08 13:16 Page 64