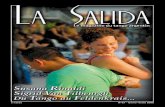Un ancêtre du phylactère : le pilier inscrit des vases italiotes
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Un ancêtre du phylactère : le pilier inscrit des vases italiotes
UN ANCÊTRE DU PHYLACTÈRE :
LE PILIER INSCRITDES YASES ITALIOTES
Un certain nombre de vases italiotes - tous de style lucanien ou apulien - présententune particularité qui permet de les grouper en une série cohérentel : l'image s'accompagned'une inscription, et celle-ci figure sur un pilier qui est un des éléments constitutifs de lareprésentation. L'intérêt iconographique de ces vases réside dans le fait qu'aucune des
trois composantes (l'inscription, le pilier qui en est le support et la scène dans laquelle elles'insère) n'a une valeur donnée a priori. I1 s'agit de variables, et le sens du tout résulte,chaque fois, de la combinaison des parties et de leur action réciproque.
Plusieurs de ces documents sont connus depuis longtemps, mais ils n'ont jamais été
étudiés du point de vue qui nous occupe. L'inscription elle-même, sans intérêt littéraireni épigraphique, n'était pas de nature à retenir l'attention des historiens ou des philologues2.
Quant aux archéologues, ils semblent avoir été rebutés par cette intrusion du mot écritdans une catégorie de documents qu'ils préfèrent interpréter sans recourir à des critèreslinguistiques. Cette association, quelque peu déconcertante, du texte et de l'image, est
précisément ce qui a éveillé notre curiosité et notre intérêt. Au travers de ce groupe restreint<ie représentations, c'est un problème de méthodologie iconographique qui se pose. Lesrésultats, même limités, auxquels nous aboutirons, pourront peut-être s'étendre à d'autresséries d'images, d'époque et de contenu très différents.
RVA2 | : A. D. TRENDALL, A. CAMBrrocLou, The Red-Figured Vases of Apulia I (1978).Pour les autres ouvrages et pubücations de TRENDÀLL, nous avons utiüsé le système d'abréviations que l'auteur
a lui-même proposé : The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily (rS6Z), pp. xxr-xxÿ.r. SignalésparO.leuN,BeschreibungderVasensarnmlung(1854),Einleitung,pp.cxxrrl-cxxxrv,ilsontétécommentés
à plusieurs reprises par H. HETDEMANN : BdI, 1868, p. 156 ; Heroisierte Genrebilder auf bemalten Yasen,in Commentationesphilologicae in honorem Th. Mommseni (1877), pp. 163-179, notamment p. r74; Pariser Antiken, n. HlYPr, 1887, p. 74.P. JAcoBsrHAL, Die melischm Reliefs (r93r), pp. r8r-r82, a dit I'essentiel à leur sufet. A diverses reprises, K. ScHÂuENBURca souligné leur importance : Perseus in iler Kunst des Abettums (196o), p. 64 ; Achilleus in der unteritalischen Vasenmalerei,Bjbb fir, 196r, p. zr8; Die nackte Erinys, FestschriJt für F. Brotnrner (1977),pp.248-249. Cf. aussi A. D. TnrNoarr,SIVP, p. 14, et LCS, p. 52.
z. ÏJne exception : P. KRErscHMEn, Die griechischen Vaseninschriften (1894), en a étudié plusieurs (notamment:Cat. r, 6, 7 , 12, 15, r 8, r 9 et zr), Mais F. Lonnrn, Vaseninschriften, in Das Studium der griechischen Epigraphik (1977), neleur accorde aucune attention. E. Prutr, Malerei und Zeichnung der Griechen,l (rg4), pp. 33-38, qui s'est intéressé à laquestion, n'a pas pris en considération le domaine italiote. Elles n'entrent pas non plus dans le cadre du Corpus proietépar H, R, IMuEnwAm, A proiected Corpus of Attic Vase Inscriptions, Acta of the 5th Int. Congress oJ Greeh and Latin Epi-graphy (Cambridge,ry67 [r97r]), pp. 53-6o. Cf. F. Lonnrn, loc.cit.,p.32 etp. r13. M. Guan»uccr n'en parle pas dansson chapitre consacré à l'épigraphie des vases peints : Epigrafia Greca,Ill (tg7à, pp. 456-495.
REv, ARCH., r/r979
a)
Cat. r. Cratère en cloche lucanien de Naples IJ2869 (inv. 82298) : TEPIIONsuT pilier à droite de
deux éphèbes drapés (: face B) (fig. 5 et 6).
Peintre d'Amykos. Fin du ve siècle (ZCS, p. 49lz6o).Cat. z. Skyphos lucanien de Bari, collection Lagioia : TEPMON sur pilier près d'un athlète nu
portant un strigile (: face A) (fig. z).
Peintre d'Amykos. Fin du ve siècle (l, Cü p. 4zlr89 a).
Cat. 3. Fragment de skyphos lucanien de Métaponte : TEPMQN sur pilier à côté d'une femme
tenant une couronne (: face B ?).
Proche du peintre d'Amykos. Fin du ve siècle.
Cat. 4. Amphore à col lucanienne de Gôttingen F 18 : TEPMQN sur pilier entre Niké, qui joue à
la balle, et éphèbe tenant un bâton (: face A) (flg. +).Peintre d'Àrnô, 4oo-39o.
Cat. 5. Péliké apulienne de Naples, collection privée : TEPMOT{ sur pilier à droite de trois éphèbes
draPés (: face B).Peintre de Dechter. Env. 35o (RVApI, rofTr; A.D.TnnN»ett, in Festschrift für FrankBromm.er ltg77), p. 285/IV, pl. 16lZ-ù.
Cat. 6. Cratère en cloche apulien du British Museum F 6z : TEPMOI'{ sur pilier contre lequel
s'appüe un éphèbe nu; en face de lui, une femme assise avec coupe d'offrandes (: face A)(fig. 7 et 8). Peintre de Graz. Env. 36o (RVAp l, 6lzt5, pl. Szlù.
Cat. 7. Cratère en cloche apulien de Naples SA 657 : TEPMON sur pilier entre deux éphèbes drapés
(: face B) (fig. :).Apparenté au peintre de Graz. Env. 36o (RVAp 1, 6fzt7, pl. Szlù.
La première série de documents met d'emblée en évidence les difficultés auxquelles
nous faisions allusion, à commencer par l'inscription. TEPMONI, selon toute vraisem-
blance, ne désigne ni un hommes, ni une divinité. Son apparition est trop fréquente pour
qu'il puisse s'agir d'un quelconque individua; quant au dieu Terminus, que Plutarque
transcrit précisément par le grec Tépp<ov, il n'était l'objet d'adoration ou de culte dans
aucune partie du monde hellénique5. À l'époque classique, réppLrov a un sens bien défini :
tout comme le neutre 4,p,p.a, d'un usage beaucoup plus fréquent que le masculin, il désigne
3. C'était l'interprétation d'O. IAHN, op. cit. (supra, n. r), p. cxxrrl. Cf. aussi E. Ganruxo, Th. PANoFKA, Neapefu
antike Bilduerke (rBzB), p. 348. Contra .' G, MTNERVINT , BullNap I, 1843, p. r ro, et H. HTYDEMANN ' BdI' t868 ' p. 156.L'abondance du matériel de référence garantit qu'il ne s'agit pas d'une confusion avec Tépricov, attesté sur rme inscriptiond'Antipolis (.fG XIV z4z4; M.P. Nrrssox, Geschichte der griechischen Religions 11967l, p.525' pl. Zzlz)' et, comme nom de
satyre, sur plusieurs vases attiques (entre autres : ARVZ,p,6o166 ;p. 146lz ;p.37o1:,3 , p. 456. Cf. aussi Ch. FnÀrxll, Saryr-und Bacchantennamen lrgrzl, p. 3o).
4. Les autres noms propres, sur pilier, ne sont guère attestés que sur un seul vase. Ex. : ATL\ (Cat. z6),ETTTXIA (Cat. z7),II^ANON (Cat. z6), >OOON (Cat. z8).
5. PLUr., Nurn., 16. Aillet:rs (Aetia Rom.,267 C), Plutarque donne l'équivalent Téppuvo6. La différence entre Ia
"ot c"ption g."cque et la conception romaine est soulignée par DroN. HAL., II,74,4 : 0eoÜq ce yàp iyoüvcar, [scil. oi'P<opaÏo,.]
coùq tépçr,ova6 xai Oüououv aùroïç ôoér1. VARRoN, De ling. Lat.,Y, zr, rapproche tépptc'rv de termen et terminus, Cf. aussi
P. Knaiscsurn, Glotta, 13, 1924, p. ro4, d'après qri. Terminus dérive de termen (: céppa grec;. Sur Zeus 6puo6 (Prer.,Leg.,Ylll,84zF)etApollon6pr,oq(Paus.,II ,35,2):M.P.Nrr.ssoN,op.cit.(sutrtra,n.:),p.zo5;A.B.Coor, Zeus,IIl,z (r94o), p. rr83.
4
1. Amphore de Nole. Bu-dapest, inv. 5rzz6. Détail.
la fin, l'extrémité6. Mais rê,pp"t", c'est d'abord, et très concrètement, la borne du stade,celle que les coureurs devaient contourner pour revenir à la ligne de départ?. Le mêmepoteau, bien sûr, a pu servir de témoin dans d'autres compétitions, notamment le lancer dudisque ou du javelot. Prenons garde, pourtant, de ne pas interpréter l'iconographie à lalumière de ce qu'on a, précisément, déduit de l'iconographie. Les spécialistes du sportantique tirent la plus grande partie de leur information des scènes de vases, et il faut, aumoins momentanément, faire abstraction de leurs conclusions, si l'on ne veut pas s'enfermerdans un cercle vicieuxs. Dans l'iconographie, le téppæ - ou le pilier TEPMON - apparaîtcomme l'emblème du stade ou de la palestree I c'est un symbole iconographique, quellequ'ait pu être sa fonction réelle dans l'aménagement des gymnases antiques. La céramiqueattique oflre d'innombrables exemples d'un tépp« se dressant à côté d'un lanceur de javelot,entre des coureurs à pied ou des athlètes s'entraînant au disque et aux haltèreslo. Une
6' D'après H. Fnrsx, Griechisches etymologisches W'ôrterbuch,ll (rg7o), p, 88o, cépp<ov s'est formé sur réppr.a commepr,vdpcov sur pr,v!çr,ct, téppt«»v est attesté principalement chez les tragiques er dans la prose tïrdive : H. Fnrs«, op. iii.;8. Bor-stcq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque (r9t6), p. g57.
7. E. N. GanorNun, Athletics of the ancient World (t93o),passy'z, notamment pp. r z8-r43 ; H. M. Lrr, The TEPX,IAand the javelin in Pindar, THS 96, 1976:pp.7o-7g.Âpp.an dans le sens concret de 6poç : Tables d'Halaesa, en Sicile,d'époque romaine (/G XIV 352; V. ARÀNcro-RuIz, A. Olrvrrnr, Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae ltaliae ad jus per-tinentes(r925)rp.48). De même pour 1a Grèce continentale et 1'Asie Mineure : SIGIi 4zr (traité entre Etoliens et.Acarnaniens,du rIIe s. av. J.-C.) er CIG 7I zro4 (de Panticapée).
8' VoirnotammentE.N.GARDINER,op.c,'t.(su.pra,n,7);Io.,GreekAthleticsportsandFestixals(tgro);B.Scunôorn,Der Sportim Altertum (rgzl); C. BRENDEL, Sport der Hellenen (rq:6); B. NEUTscH, Der Sport im Bilde griechischer Kunst(ts+ù.
9, BF,/.zrxr a plusieurs fois attiré l'attention sur ce point : The pillar is the terma in the stadion (ARVI,p.65o19 bis),et A small pillar on a base indicates the palaestra (Some AtticVases inthe Cyprus Museum [rq+8], p.47).DemêmeA. F.rrn-BANKS, l7Z 6' r9o2' p. 4rr : « '.. this type of pillar on vases ordinary denotes the meta or goal.post ofthe race-course »,etp.413:uSymbolofthepalaestra.»Pourl'ensembleduproblème:F.CHaivtoux,L,Athénamélancolique, BCHh,1957,pp. r4r-r59; I»., L'Athéna au termâj RA,r97z,ll,pp.263-266; J. FREL, Sbornik ry, 1959, pp. 264_265. Cf.aussiC. Q. Grcr.ror.r, ArchCl 2, rg5o, p. 3r; D. ARNoLD, Die Polykletnachfotge (1969), p. 69, et S. HTLLER, Statuenstützen imfünften Jahrhundert v. Chr., AntK rg, 1976, pp.3o-4o ; F. LoRBER, loc. cit. (supra, n. z), p. ro9.
ro. Voir notamment: lécythe pansu de Chypre C 756 (ARV2,p. rz48l7; J. D. BEAZLEy, Some AtticVases inthecyprus Museum [rs+8], pp. 46-49, p|. 7/r) et coupe de la vilia Giulia 5993 (ARVI, p. 6z5lroz; c. e. Grcuo tr, Ioc. cit.[n. préc.], pp. 3r-3z,pl. A-8, pl. 6 et pI. 7/r). Autres exemples : F. Cnauoux, R e, ry7z,tt,pp.263-264.
2. Skyphos deBari. Lagioia.
(Cat. z.)
amphore de Nolelt, conservée au Musée de Budapest, peut être considérée comme l'anté-
cédent direct des images italiotes. Le pilier porte l'inscription JnAÂl/O, qu'on doit inter-
préter comme un génitif dépendant d'un mot réppa sous-entendulz. Le peintre a voulu
dire, tout simplement, qu'il s'agit de Ia borne du stade. Le rapprochement avec nos piliers
TEPMOI{ s'avère d'autant plus légitime que le contexte figuratif est le même dans les deux
cas. On a aflaire non pas à des scènes d'action, avec des athlètes en plein exercice, mais à
des scènes de rencontre, dont 1es participants sont représentés immobiles, à côté du pilier.
L'unique personnage de l'amphore de Nole, que sa barbe et son himation désignent comme
le pédotribe, préfigure les éphèbes semblablement vêtus qu'on retrouve au revers d'innom-
brables vases italiotesls.
La relation avec le monde gymnique est évidente aussi sur les autres documents.
L'un des éphèbes drapés du cratère de Naples (Cat. 7) porte le bâton traditionnel, mais le
rr. Inv. 5rzz6, du peintre de Nikôn (lRll'z, p. 6;olg àis; J.-G. SzILÂcYr, L. Casrrcr,roNr, Griechisch-rômische
Sammlung [rSSZ],p1. nlr;!. Fnrr-, /oc. cit.lsu7ra, n.9l,pp. 264-265,p1. r/r; F. Cnainoux, RA,r97z'II,p.z66:frg. r).rz. L'alrernance or-lo1,- a pour garants HEsycH., s.z. oæd8tov et Et, Magn 743,25,Cf. aussi IG IY 56t.ra. Cf. J. Fnrr, loc. cî.t. (supra, n. 9), p. 265 : n L'inscription xa),6q, devant la bouche du pédotribe, suggère qu'il
rêve d'un bel éphèbe. , IJn autre vase attique, plus tardif puisqu'il est contemporain des plus anciens vases italiotes qünous intéressent ici, permet de mettre en évidence les particularités de chaque gxoupe. Il s'agit d'une oenochoé attiquer'l'uechez Donati : la borne ressemble davantage à une colonne, et elle ne potte pas d'inscription ; l'athlète au strigile, en revanche,
est semblable à ceux qu'on voit sur les vases italiotes, Un tel rapprochement confirme l'assimilation du pilier TEPNION au
mond.e de la palestre. Le mot xcr).6q apparaît fréquemment sur un pilier dans f iconographie attique : ARVZ, p. 336114'p.356lÿ,p.5oolzr,p.fi4l7,p.65rl:l7, p.r565, p.r589, etc. Sur l'amphore de Nole de New York, Gallatin, dupeintred'Alkimachos (ARV!, p. 5z9lro et p. r658 ; CVA, pl. 54lr , D . von Boturarn, Ancient Art in New York Prioate Collections
Ir 96 r], pl. 8zI zz7 et pL, 84), l'inscription st:r le terma est dépourvue de sens.
6
3. Cratère en cloche.Naples SA 657. (Cat, 7).
pelntre a pourvu son compagnon d'un javelot. Cet instrument, planté tout droit derrièrelui, est dessiné de manière schématique : la pointe est bien visible, de même que les deuxcordelettes nouées autour de la hampe, indispensables à la manipulatioila. Ce mode dereprésentation quelque peu elliptique montre qu'on est en présence d'un signe, non de lareproduction fidèle de l'objet.
L'apparition d'Eros (Cat. r) et de Niké (Cat. 4) ne nous éloigne pas de ce conrexre :
l'un et l'autre sont des familiers du gymnasels. Niké ogo"tptorilç patronne, en quelquesorte, Ies jeux de la palestre. Elle se trouve en contact direm avec le pilier TEPMON,au-dessus duquel elle fait rebondir sa balle. Un éphèbe lui fait face, qui semble vouloirparticiper à son jeu; il passe ainsi du srarut de specrateur à celui d'acteur.
Il est intéressant de constater que le pilier TEPMOI\ figure akernarivement sur le
- . ï4. Amentum ou ciyxüÀ1 : E. N. GARDTNEa, op. cit. (supra, n. 7), pp, t7r-t74, ftg. r4r. cf. aussi cvA, Lo1re, rg,pl. 5o/r et comment., ad loc. (H. Giroux).
r5. PourEtos,voirladédicacedeCharmos,rapportéeparAthen.XIII 6o9 d:,,,èitiau.rcpoiçtép1ta.ou.Cf.A.Lrsxv,Vom Eros der Hellenen (rg76)
' pp, 8o-82. Si, comme le suggère J. DELoRME, Gymnasion ( t 96o), p. 37 "t
p. 5o, rr. t , cég1t u.caa le sens précis de bornes, on aurait une confirmation éclatante du rapport entre Eros, le gymnàsà et les piliers filpliON.Eros comme athlète : J. D. Baezr,rv, Some Attic Vases in the Cgprus Museum, p.47 (à propos du 1écythe pansu C 796 :sutrra, n, ro). Eros et palestre : Ps.-THoocn., Erastes, sg sqq.; Athen,, XIII, 56r d sqq, cf. J, Drronllrr, $, cit., passim,notâmmentp.219'p.338etpp.369sqq.;S.Fascr,Eros,Lafiguraeilculto(rglù,pp.3g-4J;W,BuRKERI,GriechischeReligion der archaischen und klassischen Epoche (:,977), p. 247 ; A. FunrwÀNcr.rn, Èroiln der'Vasenmalerei eâ74), p. t9;A.GnsrreNIHAcrN,GriechischeEroten(rg57),p.43etpp.58-62;ReallexikonfürAntikeund,Christentum(r9Oà;,'s.v.ErosI(c. schneider) er s.v. .Eros II (4. Rumpf). Niké et palestre : J. Drr.onmr, op. cit., p.2r9 et pp. 3671e 9 iG. Krusnorrz^",Nike in der Vasenmalerei (1876), passim, notamment p. r r,
côté principal (Cat. 2, 4 et 6) et au revers (Cat. r, 5 et 7), autrement dit dans des scènes
« narratives » et dans des scènes de simple « présentation », selon la hiérarchie établie parIes peintres entre les deux faces des vases. Le plus souvent, les deux scènes se trouventen étroite corrélation. Sur le cratère de Naples (Cat. r), l'image contenant le pilier inscrit(celle du revers) fait pendant à une représentation d'Eros æa-l,awrp?rqq. Un strigile à la main,le pied posé sur un disque, il s'adresse à une femme drapée dans un manteau, qui s'appuie,
elle aussi, sur un pilier16. Ailleurs (Cat. 7), ce sont Hermès et Héraclès, les divinités « pales-
trites », qui décorent le côté principal du vase, alors qu'un pilier TEPMQN, particulière-ment imposant, se dresse entre les éphèbes du revers1?.
La forme et les dimensions du « pilier » ne sont pas moins symptomatiques. Simple
bande réservée (Cat. 4) ou tétragone dressé sur une base (Cat. r), parfois dessiné en perspec-
tive (Cat. z, 6 et 7), cet emblème du gymnase est d'échelle variable. Quelquefois, il atteintà peine le genou ou 1a taille des figures (Cat. z et 4) ; ailleurs, il dépasse la tête des éphèbes
(Cat. 7). Cela suffirait à montrer qu'on a affaire à un objet conventionnel, à un motif icono-graphique, non à la réplique exacte d'un monument réel. L'idée d'écrire le nom sur l'objetlui-même ne peut d'ailleurs se comprendre que comme une convention d'imagier; c'estune nécessité du langage iconographique. Dans la réalité, une telle u auto-désignation »
eût été absurdels. Il va de soi, cependant, que l'intention des décorateurs italiotes diflèrede celle des peintres archaïques, qui inscrivaient volontiers, en regard de l'objet, 1e nomcorrespondant - moins pour éviter un malentendu que pour souligner l'importance de
l'objet dans le contexte narratif ou mythologiquele. Sur les documents italiotes, le nomfigure non pas à côté de l'objet, mais sur I'objet : différence essentielle, qui implique déjà
une hiérarchie des fonctions. L'inscription ne sert pas à désigner l'objet; c'est plutôtl'objet qui sert de support à l'inscriptionzo. Aux yeux de l'imagier, le principal était le mot
16. Disque semblable : coupe du Louvre G rrr, du peintre de Kléomélos (ARV2, p. rr8/r ; CVA, rg,pl,6+ld,).17. Face A : L. Caupo, I drammi, satireschi della Grecia antica (rg4o),pp.2ro-2r2, fig. 3r. Hermès et gymnâse :
H. Stsre, De Mercurio ceterisque deis ad artem ggmnicam pertinentibus (1933), passim; J. DELoRME, op. cit, (supra, n, 15),pp.337i6r 1R.E,s,v. Hermes,col.zozz (Eitrem);rJ7.Bumanr, op.cit.(supra, n. r5),p.247;A. Bnrr,rcu, Heros.Ilcultogreco degli eroi e il problema degli esseri semi-diaini (tSS8), p. r8z. Héraclès et gymnase : H. Srsra, op. cît., pp. :8-4e ;J. Drr,onur, op, cit.,pp.339-340; W. Bun«rnr, op. cit.,p.247 etp.3z3. Hermès et Héraclès associés : J. Duronur, op. cir.,pp,33g-34o;§ÿ. Bun«snr, op,cit,,p. z47.Ils sont,parexcellence,lesxacà itaTuLorpav 0eo[,1esza0u8püpr,evotèvtÇtyupr,vaoit,o Oeoû. Sur les cultes héroiques célébrés dans les palestres : A. BRELICH, Gli eroi Greci (t958), pp. 97-99 ; §ü. Bumrnr,op. cit., p. 3r9.
18. Sur les bornes sacrées, le mot 6poç est touiours suivi du nom de Ia divinité honorée dans le sanctuaire. Ex. :
ôpoq coü cepr,évouq riq 'Apcépr.u8oç (L. Jrnnnnv, The local Suipts of archaic Greece Ir96r], p. 3o7158, pL..57) ou : ôpoq iepoü'401v&q, 6poq ÀrovÜoou (F. Cuauoux, BCH 8r, t957t p. r45). Voir §f. LARFELD, Griechische Epi.graphik\ (rgt1), pp. 5og-5ro. Souvent, on a seulement le nom de la divinité : 'I{paxÀéoq (rétr,) sur une borne d'Egine,duvrr" s. (L. Jnnnrnv, op. cir.,p. trzl3, pl. 16).
19. Ex.:BONIO>surl'amphoretyrrhéniennedeMunich14z6(Jrz$(ABV,p.g5l5; K.Scunnot»,FrühgriechischeSagenbilder [r964], p1. 73 a) ; HTÀPIA et KPENE sut le vase François (ABV, p. 76lt ; K. Scunror"o, op. cit., pl. 48 b-c).Cf. O. JAHN, op. cit. (supra, n. r), p. cxv, et E. PFU:r.L, op. cit. (supra, n. 2)r p. 33.
zo. O. fesN, op. cit.> p. cxxIu, croit, au contraire, à la réalité de ces inscriptions : n §(/ir sehen nâmiich,.. ân ver-schiedenen Gegenstânden Inschriften angebracht, wo man sie in §ûirklichkeit anzubringen pflegte, um auch dadurch denSchein einer individuellen§(rahrheit zu erhôhen.,.Sehr hâufig ist an einer Stele derName einerPerson,eines Gottes dem siegeweiht ist oder sonst eine Bezeichnung ihres Zweckes angeschrieben. »
écrit. La fréquence de l'inscription, l'ildifférence qu'on observe dans le dessin du supportrévèlent d'emblée 1'attirance des imagiers pour uo motif aux porentialités multiples. Sommes-nous en présence d'une mode passagère ? L'intenrion des peintres de vases était-elle unique-ment décorative ? Ou faut-il supposer u.ü sens second au nom inscrit ?
Avant de nous interroger sur le rôle du texre au sein de l'image, il convient d'insistersur l'aspect purement conventionnel du motif. L'alternance des types scripturaux n,estpas moins révélatrice : tantôt, les lettres sont alignées verticalement sur le pilier, selon latechnique kionedonzl (Cat. 5, 6 et :l I tantôt, elles sont juxtaposées horizontalement, lalecture se faisant de gauche à droite, après rotation de 45o de l,imagez2 (Cat. r, z et 4).Aucun de ces procédés, remarquons-le, ne correspond à la réatité épigraphique du rve siècle2a.Les inscriptions sur pierre se composaient de lignes, lues toujours horizontalement, etdisposées en colonnes2r. La répartition des deux techniques graphiques entre les écolesstylistiques (Apulie et Lucanie) montre qu'on a affaire à des habitudes d'ateliers : tous lesdocuments lucaniens affestent le rype horizontal, le rype vertical n'est attesté qu'en Apulie2;.
Indépendamment de l'intérêt pour le signe écrit et sa valeur ornementale, quel senspeut avoir revêtu le mot TEPMQI{, dans l'esprit des imagiers, qui justifie non seulementla fréquence de son emploi, mais son apparition dans un type de scènes précis ? Je croisqu'il faut d'abord souligner I'antériorité du contexte par rapporr à l'inscription26. Sur ungrand nombre de vases italiotes, on retrouve le même schéma décoratif avec deux éphèbesdrapés de part et d'autre d'un pilier2?. Mais celui-ci apparaît encore dans d'autres ensemblesiconographiques, où la valeur neutre de l'objet lui permet d' « actualiser », tour à tour,diverses signif,cations. Sur nos images, par exemple, le mot TEPMON sert à préciser lesens du u pilier » : la lecture du signe linguistique se substitue, en quelque sorte, à celle dusigne iconique. IJne telle substitution implique un goût de l'abstraction, une volonté
zr . §7. Lenr, ro '
oP. cit ' (su/ra' n. r 8), p. r 36 ; G. KLAFFENBAcH, Griechische Epigraphik GgSù, p.44. La persistancede ce type d'écriture dans l'art paléochrétien confirme l'impression qu'il s'agit d'une convéntio" i"orrog*pÀiq, e-. Cf. infra,2e partie,
zz. rJü. Lenrelo, op. cit., p. tz9.23. La disposition strictement kionedon n'a été empioyée que tout à fait exceptionnellement : W. LARFELD, op. cir.,p. 136.
, ,. . -2.4, 6 ss1 é.gard: l'inscription ![AAI/O, sur l'amphore attique de Budapest (supra, n. r r ), est plus conforme à la
réarte : le mot est écrit horizontalement, au haut de la stèle, et la dernière lettre a été reléguée à la ügne suivante, faute d.eplace. On connaît, cependanr, de nombreux exemples d'inscriptions placées dans les cannelures de colonnes votives : J. Man-cttÉ, Recueil des signatures de sculpteurs grecs ,l ( r 953), no z r (Delphes, vre s. ) et no r r 2 (Delphes, rrr" s. ) ; A. E. Raunrrscue«,Dedications from the Athenian Acropolis (rg4»,p.6 (5zo-5to av. J.-C.) et p. 7r (env.'48o av. J.-C.). Mais 1a lecture se faitde gauche à droite : A' E' Rausrrscnn«, Das Denkmal-Epigramm, in L'épigramme grecque (EntFonàHardt t4, 1,967 [tg6g)),pp. r4-r5' De même pour les dédicaces écriles sur les statues elles-mêmes (sur h jÀbe ou sur le vetemË"tj à l époquearchaTque : M' Bunzacnscur, Oggetti parlanti nelle epigrafi greche, Epigraphica 24, 1962, pp, 3-S4, rot"--".t pp. 4-5et pp. 7-8.
25. Même en Apulie, cependant la maiorité des vases présentent l,autre type de graphie.26. Ce qui ne contredit pas notre jugement sur le rapport hiérarchique des àer" éléments. Dès 1,instant oir il reçoit
une inscription, la vaieur du pilier, comme objet concretrtend à s'effacer devant celle d,un simple phylactère.zT.YoirnotammentZCS,p.33/156,p.39l16zetr72,p.4olr7B,p.49lr8z,p.a91z5oitô5,'Suppt. I,p. t57147b,pour le seul peintfe d'Amykos.
10
d'expression symbolique28. Alors pourquoi TEPMOT{ précisément ? Il paraît inconcevableque ce mot n'ait pas eu d'autres résonances, dans l'esprit des peintres de vases, que la simpledésignation de la borne du stade. Déjà chez Euripide, on rencontre le masculin céppr,orv,
associé à piou, dans le sens de u fin de la vie, terme de l'existence »2e. Mais c'est I'épigrammefunéraire qui devait donner à cette formule sa notoriété et sa diffusion3o. Les premiersexemples remontent au vle siècle ; à la fin du ve et au IVe siècle, ils deviennent si nombreuxqu'on a peine à croire que l'imagerie n'ait pas été contaminée par ce thème littéraire3l.L'idée que les scènes de palestre, sur les vases du ve et du Ive siècles, devraient être lues dansune perspective eschatologique a été avancée depuis longtempss2. Les partisans de cettethèse invoquent, à l'appui de leur démonstration, la valeur ambiguë des instruments de lapaiestre (strigile, haltères, balle, disque, etc.), qui servent aussi d'offrandes funéraires,comme l'attestent les pierres tombalesss. La forte concentration d'images de la palestre,dans la première moitié du rve siècle, c'est-à-dire à une époque oir les scènes de libationautour d'une stèle ou d'un naïskos n'étaient pas encore répandues, pourrait suggérer que
celles-ci ont succédé à celles-là, autrement dit que celles-là déjà étaient perçues comme« réunions dans l'au-delà ». Ce problème d'interprétation dépasse largement celui des vases
à pilier inscrit, mais on ne peut pas l'esquiver, si l'on veut replacer ceux-ci dans un cadrehistorique et iconographique adéquat. Sur le cratère de Londres (Cat. 6), pour ne prendreque cet exemple, l'éphèbe appuyé contre le pilier est entièrement nu; seul un bandeauorne sâ tête. D'un point de vue formel aussi, cette représentation s'apparente aux stèlessculptées où l'on voit l'athlète défunt en présence d'un parent ou accompagné d'un petitesclavesa. Le peintre apulien a représenté, en face de lui, une femme d'aspect juvénile, quilui tend une coupe garnie d'offrandes35. Àssise sur un rocher, les cheveux ceints d'une
28. Cf. J.-G. Sztr,Âcvr, BMNH 44, r975,p,28 (traduction légèrement remaniée) : « En Italie, au rve siècle, commeaussi ailleurs, la tendance anticlassique visait à l'abandon de f illusionnisme, de la représentation réaliste de la nature, auprofit d'une vision conceptuelle des formes représentées, d'une recherche plus intense de l'abstraction... Aux scènes figuréesse substituent leurs symboles, indépendamment de toute association objective. » I1 ne faut pas négliger, cependant, l,aspecticonique de f inscription : la lecture de celle-ci s'opète en même temps que celle de l'image. Message linguistique et messageiconique sont, dans un premier temps, perçus globalement.
29. EuR.,Phoen.,r35z. Demême-cépp.upLou:Aesch.fr.36zN2(-Zo8M);SopH.,O.f.,r53o;Eun., A\c.,643.3o. Cf.§(/.Pae«,GriechischeVers-Inschriften(1955),passin;l».,GriechischeGrabgedichte(196o),passim.3r. Déjà sur la stèle de Deinès (env.49o av. J.-C.), au Musée de Sofia, inv.7z7 (Ch. Clernr*oNr, Graoestone and,
Epigrarn [rg7o],p.28/8,p1. $:cép,p"a 0crvdcou.Autresexemplesauves.:4,pp.x),u7_ùv1u't&tov(W.Pnax, GriechischeVers-Inschriften,no 326 : Griech.Grabgedichte,îo 55); rve s.: np6çrépy"a:,.e),eÜOou(Io.,Griech.Vers-Inschriften,îo 39);yilpt»ç cépplz pr.o),ôv rcpàq üxpou (îbid. , no r 987 : Griech. Grabgedichte, îo 456) ; zor,vàv téppla èrcép1oe pi,o» (7o. , Griech.Vers-Inschriften, no r638) ; orix Ëor' oüôèv céppr Bûou Ovryôv èn,.voiutç (ibid., 1o 1639 - Griech. Grabgedichte, no 95).Cf. aussi l'épigramme à Polypoitès et Léonteus dr Péplos pseudo-aristotélicien : céppr,' &.,pLxovto piou (V. Rosn, AristotelisFragmenta4 [r886], p. 4orlz). D'après E, Borsecq, op. cit. (supra, n, 6), s.2., le senÀ premier de téÀoq serait aussi « limiteautour de laquelle tournent les coureurs ».
32. I, Tnrmmr, AA, 1967,pp. rg9-2r3, noramment p.2o3,p.2o8 er p. zrr 1Io., Antaios u, ry6g-rg7o, pp. 4g9-5rr, notamment pp, 496-499; H. SrcnrnnmaNx, Griechische Vasen in Unteritalien (rg66), pp. 3o-3r, à propos des cratèresen cloche lucaniens de Ruvo, I 4z7rI 43o et J 815, oir le strigile estremis par un éphèbe à une jeune femme et inversement.
33. J. THTMME, Antai.os rr, 1969-1970, pp. 496-497.34. Voir notamment H. DTBroLDER, Die attischen Grabreliefs (r93r), pl. 6, pl. 3r, pl. 3zlz, pl. 3512, pl. 3612, pl. 48.35. Sur l'âge indifférencié des porteurs d'offrandes et des visiteurs au tombeau : M. Scutl.r»r,.Eine Gruppe Apulischer
Grabaqsen in Basel (1976), p. 23.
11
7 et 8. Cratère en cloche. British Museum F 62. (Cat. 6.)
couronne, elle semble ne pas avoir aperçu ce n vis-à-vis » qui, pourtant, fixe les yeux sur
elle et prend, sur le plat, une des friandises offertes. L'isolement qui enferme chacune des
figures dans sa sphèie, l'impossibilité non seulement d'une communication, mais d'unsimple échange de regardssG, le choix et l'attitude des personnes représentées ne permettentguère de lire la scène dans un sens réaliste. Mais l'alternative est-elle irréductible ? Doit-onnécessairement considérer toutes les scènes comme reflet de la vie quotidienne, ou les
interpréter toutes comme visions de l'au-delà ? La mobilité avec laquelle, dans l'espritdes Grecs, le passage s'opère d'un plan à l'autre, et la fusion intime qu'on observe, dans
leur conception de l'au-delà et dans leur art funéraire, entre la sphère des morts et la sphère
des vivants, rendraient artificielle toute classification a priori71, L'ambivalence, quelque peu
irritante, du pilier TEPMCIN38 ne prendrait-elle pas tout son sens, si on considérait les
scènes où il s'insère comme des images authentiques du monde des vivants, mais détachées
36, Pour toutes ces caractéristiques de l'art funéraire attique : N. HIMMELMANN, Studien zum llissos-Relief (1956),passim, notarttment pp. 15-16,
37. Remarquons que la fusion entre ce monde-ci et I'au-delà paraît étrangère à f imagerie funéraire apulienne, telleque nous la connaissons par les vases de la deuxième moitié du tve sièc1e. Cf. M. Scru,u»r, op. cit.(suprarrL.3),pp. z5-26.Mais ne peut-on admettre que I'iconographie proto-italiote diffère, sur ce point précisément, de la forme canonique ulté-rieure ? Il est significatif que les défunts ne se distinguent pas par la couleur blanche : 1'ambivalence typologique renddlautant plus délicate f interprétation de ces scènes,
38. H. HrvoemeNN déjà avait proposé une interprétation similaire (BdI, t868, p. 156) : téppr,<ov, synonyme detéppa, doit être entendu dans le sens de finis aitae.
12
d'un cadre spatial et temporel trop rigide, ou, ce qui rerient au même, comme des épisodes
de la vie réelle, mais envisagés déjà sub specie aeternitatisss ?
b)
Cat. 8. Cratère en cloche apulien de Madrid rroSr (L 325) : NIKA sur pilier entre deux éphèbes
portant un bâton (: face B).Peintre d'Eton-Nika. 38o37o (RVAp I, 4184; APS, p. $15' pl. zol97-98).
Cat. 9. Cratère en cloche apulien de Bonn 79 : NIKA sur pilier ente deux éphèbes, l'un avec strigile,
I'autre avec bâton (: face B) (fig. tl).Peintre d'Eton-Nika. 38o37o (RVAp I, 4183, pl. zTlt ; APS, p. Bl4, pl. zo196).
Cat. ro. Cratère en cloche apulien du British Museum F 67: HEPAK^E»surpilier entre deux
éphèbes drapés portant un bâton (: face B) (frg. rz).Peintre d'Eton-Nika. 38o37o (RVAp l, 4185 ; APS Supp l: AIA n, 9691, P. 42815 ter).
Cat. rr. Cratère en cloche apulien de Copenhague 333 : ÂtTll'lTl^OC sur pilier entre trois éphèbes
draPés (: face B) (fig. 13, 14, r5)'Peintre d'Adolphseck. 38o37o (RVAp I, 4l5o; APS, p. 57 ; CVA 6, pl. 44lz).
A la différence du mot TEPMQN, les inscriptions NIKA (Cat. 8 et 9) et HEPAK^E>(Cat. ro) désignent des personnages, et, chose curieuse, des personnages qui ne sont pas
représentés dans l'imagese'. Est-on bien sûr, dans ces conditions, d'avoir aflaire à Niké,déesse de la victoire, et à Héraclès, le héros du dodécathlosao ? Le skyphos de Naples, oùr
les deux noms, écrits à la suite l'un de l'autre, constituent l'unique décor, a égaré les
recherchesal. Kretschmer, interprétant NIKA comme l'impératif de vrxdo et I'HPAK^H>
comme un vocatif,, voyait dans cette inscription une exclamation en l'honneur du héros
éternellement vainqueura2. D'un point de vue strictement épigraphique, une telle lecture
39. Dans l'épigramme funéraire, réppr,* plou ne signifie pas seulementl'arrêt brutal de la carrière terrestre, mais
également soî accomplissemenî i c'est le but auquel tend f individu, Ie couronnement de toutes ses activités ici-bas. L'imagede la course du stade et de la couronne à gagner, si chère à saint Paul, est déjà pressentie dans certaines des épigrammesréunies par §f. PssK (supra, n.30 et n. 3r). Cf. aussi le thème æpp,a &.peri6 si souvent substitué à celui qui nous occupeici.
39a.[Jn skyphos attique, apparu tout récemment sur le marché, permet un intéressant rapprochement avec les
vases italiotes. Sur la face B, deux éphèbes nus, strigiie en main, se dévisagent de part et d'autre d'un pilier portant les
noms KAIITOP et IIOÀT^ETKE>. La référence aux héros du mythe a, bien entendu, une valeur métaphorique : lepeintre compare ainsi les deux éphèbes aux athlètes parfaits que sont 1es Dioscures dans la sphère héroique. Ce vase confirmele lien du pilier inscrit avec le gymnase et atteste que les imagiers attiques ont recouru, eux aussi, à ce mode d'insertiondu texte - des noms Iégendaires en l'occurrence - dans I'image. Je remercie vivement M. G. Becchina d'avoir autoriséla publication de ce document dont la valeur stylistique ne le cède en rien à f intérêt iconographique : le raccourci tentépar le peintre dans Ia présentation dorsale de l'éphèbe est un morceau de bravoure : fig. 9 et ro.
4o. Pour Niké : H, HEvDEMANN avait d'abord songé à un nom de la vie courante (Heroisierte Genrebilder [sapra,n.r1,p.t74,n.45).Par lasuite,ils'estrétracté(tz.HlYPr'1887,p.74'n.zoo).
4r. Skyphos de Naples H 2875 (inv.8o769). De même sut le fragment H 2868.
42. Op. cit. (supra, n. 2), p. zr4 : Ntxa, 'Hpaz),!q ! De même O. JanN, op. cit. (supra, n. r), p. cxr. Remârquonsque le vocatif 'I-Ipdd.elç est purementformel: le sufrxe -euq rappelle le -eeq originel. Lesinscriptionsantiquesn'utiiisentguère cette forme du vocatif. Cf. yaîpe Fdtvu."t" "Ieg&x)reç : inscription du vle s., retrouvée entre Métaponte et Hérakleia(P. FnruorÂNorn, Epigrammata [1948], p. ro6/rrr; P. A. HaNsrt, A List of Greeklnscriptions doun to 4oo B.C.lrglSl,p. 3gl4rà.Sur l'alternance rl/er, dans l'épigraphie, voit infra,ze partie, à propos du nom 'Hpdx),1coç (Cat. z9). Cf. aussi§[. Bunrrnr, op. cit. (supra, n. r5), p, 323, pour l'exclamation 'IJpdLù,etç.
13
9. Skyphos attique. Commerce.
est défendable, mais elle paraît singulièrement artificielle à la lumière des autres documenrsde la série. Si l'inscription NIKA du pilier (Cat. 8 et 9) désigne la divinité - et il n'y a
pas de raison d'en douter - l'hypothèse d'un impératif sur le skyphos devient hautemenrinvraisemblable. La possibilité d'un vocatif I-HPAK^HI disparaît du même coup, carles deux lectures se conditionnent l'une l'autre.
Mais comment faut-il expliquer ici la fonction du pilier ? S'agit-il encore de la bornedu stade, du céppr.aa8 ? L'assimilation n'est pas aussi évidente que dans le groupe TEPMON,mais les instruments de la palestre, représentés sur les trois vases du peintre d'Eton-Nika(Cat. 8, 9 et ro), ne laissent aucun doute quant au milieu ambiant. Déjà sur l'amphore de
43. HrvooueNN lui-même (c1. supra, n.4o) en était arrivé à cette conclusion : «... die Stele das Ziel bezeichnet,weiches der Hoplitodromos zu erreichen hatte, um zu siegen » (rz. HWPr, r887, p. 74, n. zoo). Il peut être intéressant dementionner, dâns ce contexte, l'inscription AKAX,TANTI> ENIKr\ OT,\E que porte la base d'un trépied sur l'amphorede Nole du B.M.E 298, du peintre de Nikôn (ARV2, p. r58r/zo ; CVA,5, p1. 5r/r) : Niké est elle-même représentée à côtédu trépied.
14
10. Skyphos atti-que. Commerce.
Gôttingen (Cat. 4), Niké se trouve en contact direct avec le pilier TEPMON44. Sur le cra-
tère de Madrid (Cat. 8), elle fait face à un guerrier ; l'autel sur lequel elle est assise suggère
qu'un sacrifice va être célébré ; la participation de Niké indique la raison d'être de ce sacri-
flce. Le peintre a ainsi opposé, sur les deux faces du vase, victoire militaire et victoireathlétique. Sur le cratère de Bonn (Cat. 9), le triple emblème pilier - NIKA - palestre
(face B) fait pendant à une scène mythologique : la face principale montre la chouette
d'Athéna, symbole de victoire, déposant une couronne sur la tête de Persée. On pourraitpresque parler de complémentarité : la scène « chiflrée » du revers, comparée aux deux
commémorations de victoire (face À et Cat. 8), implique une conceptualisation de l'imagequi permet au peintre d'exprimer la même idée sous deux formes différentesas.
44. De même sur le skyphos d'Oxford 288, du peintre de Pénélope, Niké, assise su le terma, assiste au combatde deux lutteurs (lR Zs , p. 4or l14 ; Paralip., p. 475 t CVA, r, pl. 4618-g ; L. LÀcRoIx, Etudes d'archéologie numismatique
Irgl+1, p.zo, pl. r16).45. Sur plusieurs vases italiotes de cette époque, on voit Niké en compagnie d'un athlète. Parmi d'innombrables
exemples : cratère en cloche de Leyde tg4118.7 (ZCS, p. 39l16z, pl.. r4lr) ; cratère en cloche de Bologne PU 426 (CVA,3,IV Ër, pl.4/5); cratère en cloche de Karlsruhe B 9 QVA,z,pl.57lz) I cratère en cloche du Vatican T 4(APS, p.66lu;VIE, pl.25 a),11 est signifrcatif qu'un pilier apparaisse sur Ia piupart de ces images.
15
11. Cratèreen cloche.Bonn 79.
(Cat. s.)
Contrairement à l'usage grec des ex-voto et des dédicaces, le nom de NIKA est
donné au nominatifa6. La désinence casuelle permet de préciser à la fois le but de f inscrip-tion et son niveau d'ancrage dans la scène figurée. Prétendre que les éphèbes méditentdevant une image cultuelle ou un monument consacré à Niké serait aberrant d'un pointde vue iconographique et - les cas ayant en grec une valeur pertinente - insoutenable
sur le plan grammaticala?. L'inscription est destinée exclusivement au spectateur du vase :
elle imprime une direction à son pouvoir imaginatif, qu'elle sollicite et stimule, tout en
laissant vague et indéterminé le contenu sémantique.
46. Cela est d'autant plus étonnant que les peintres de vases, particulièrement à l'époque archaique, écrivaientsouvent au génitif le nom des personnages teprésentés, voulant indiquer ainsi qu'on a affaire à let:r image. Cf. O. JAHN,op. cit. (supra, n. r), p, cxv, et B. ScHwErrzER, Studien zur Entstehung des Portràts bei den Griechen, Ausgewàhlte Schriften,II (r963), p. r3o. Schweitzer a montré (ibid.,pp. rz8-r3o) que cet usage du génitifreflète la dissociation, propre à l'espritgrecj entre représentation etreprésenté, Ce n'est pas la statue, offrande à la divinité, qui est le sujet de l'inscription, mais ledédicant, éventuellement Ie sculpteur. Le nominatif leur est normalement réservé dans les dédicaces, Limitées au mondeionien - par opposition à l'attique - Ies exceptions s'expliqueraient par des influences orientales (cf.. ibid., pp, rz6-rz7).L'identification entre le roi et sort image, ou entre la divinité et son image, fait que la statue se présente au nominatif dansl'inscription, Aux observations pertinentes de Schweitzer, on opposera cependant quelques restrictions : sur les hermes deTégée, publiés par K. Rnomros (Ephem., r 9r r, pp. r49-r59), le nom de la divinité figure au nominatif :'A01vcrîa, "Apceptu6,Àai,pl<,rv &yu06ç. Cf. aussi M. P. NEssoN, op. cit. (supra, n. 3), p. zo6, et S. G. MTLLER, CaliJ. Stud. Clas. Ant.7, 1974,pp. 247-248. Sur les bornes dressées par Alexandre aux confins de l'empire nouvellement créé (Pnrr-., Vit. Apoll.,II, 43),le nom des divinités est donné au datif : AX{\{ONI, À@HNÀI, ÀII, etc.
47. Remarquons qu'un cuite de Niké n'est nulle part attesté en Grèce. Cf. S. §[ror, Za konische Kulte (1893), p. 269.Niké était honorée conjointement à d'autres divinités : 'W.
BURKERT, op. cit. (supra, n. r5), p. 225, p, 263 et pp. 286-287(Niké « attribut » d'Athéna).
16
penhague 333. (Cat. rr.)12. Cratère en cloche. BritishMuseum F 61. (Cat. ro.)
Patron de la palestre et symbole de l'athlète victorieux, Héraclès devait naturellementcapter I'attention des imagiers et les inciter à la même formulation abrégée (Cat. ro)a8.
Une fois de plus, on observe une correspondance parfaite entre la version u chiffrée » et les
images narratives. Celles-ci n'illustrent plus les exploits du dodécathlos, mais l'apothéosevictorieuseae : imberbe - car promis à une jeunesse éternelle - le héros reçoit la couronnede victoire des mains de Niké50. L'atmosphère d'idéalisation qui enveloppe cette imagerie
48. Ce rôle d'archétype apparaît également dans les nombreux recoupements qu'on a observés entre le mythed'Héraclès et les carrières fabuleuses des athlètes-héros : J. FoNreNnosr, The Hero as Athlete, Calif. Stud. Clas. Ant, t, 1968,pp.73-ro4, notamment p. 8r et pp. 86-88.
49. Voir K. ScsaurNsunc, Der Gihtel der Hippolyte, Philologus ro4, 196o, pp. r-r3: notamment pp. tz-r3; Io,,Herakles und Omphale, RhM tca, 1960, pp. 57-76, notammerfi pp. 74-75; Io., Herakles unrer Gômern, Gyrnn. 7o,1963, pp. rr3-r33; lo., in Kunst der Antike. Schàtze aus norddeutschem Priaatbesitz (rg77), p. lgr,
5o. Liste des représentations : K. SCHAUENBURG, Gymn. 7o, r 963, pp. 122-124. Cf. aussi H. Mnrzcnn, Les représen-tations dans la céramique attique du IVe sîècle (rg5r), pp. z2g-23o; H. LacRorx, RevBelgNum roz, t956, pp. 5-r3 iIo., Bull,cl. Lettr. sc. mor. pol. 6o, 1974, pp.34 sqq. Parfois, les imagiers combinent Ie thème du sacrifice (cf. Cat. 8) avec celui d'Héra-clès recevant la couronne : K. SclraueNsune, loc. cit.rp. tz5.
17
14. Cratèreen cloche.
Copenhague 333.(Cat. r r.)
n'empêche pas 1es peintres d'introduire, ici ou là, un pilier, qui rappelle le lien étroit entreHéraclès et le gymnase5l.
Sur le skyphos de Napless2 on retrouve, associées en un même hommage, les deux divi-nités tutélaires de la palestre : Niké, garante de la victoire, et Héraclès, patron des athlètes.Une meilleure connaissance stylistique de ces documents permettrait peut-être de préciserleur relation chronologique avec les vases à pilier inscrit. S'agit-il d'une création parallèleou a-t-on affaire à une version dégénérée ? A diverses époques, les peintres de vases ontmanifesté une certaine attirance pour les inscriptionsss. Les coupes des « petits maîtres »
5r. AinsisurlecratèreenclocheduB.M.F4T,dupeintredesEuménides(.RZlp,l,4l4r,pl.34/r).Cf.K.SçHAUEN-rûnc, /oc. cit. (n. préc.), p. t24 i « Die Stele des Glockenkraters F 47 darf vielleicht auf die Paiastia b"rog.r, werden, in derder Hero besonders verehrt wurde. » Qu'Héraclès ait été choisi, par les imagiers, comme symbole d,héroiùtion (cf. N, Hru-MELMÀNN, op. cit. (supra, n. 36), p. z7) ne surprend guère, si l'on songe que Pindare déjà en fait le « patron , des athlètes :O/. III et O/. X (fondation des Jeux Olympiques). Cf. C. M. F,owr., Pindar (196g, pp. 45-48 ; G. K. Ger-rNsxv, The HeraclesTheme (rg7z)'pp.2g-3g. Au rve siècle, chez Lysias etlsocrate, iI devient l'eûepyér1ç par excellence,l,incarnationde toutesles vertus helléniques (eüvor,*, rgpdvlolç, gù,ort1L.ia et Suzzr,ooüvr1) : Ger-rNs«v, ii.-cit.,pp. ro3-ioa; M. Grceurr, Dieolympische Rede des Lysias, in Kleinere attische Redner (rgzù,pp. r5g-r93,.otr--".t p, 16z,pp, ;.66-;.69 etp. r77.
52. CC. supra, n. 4r.53. Notamment les premiers peintres à fig. rouges. Les inscriptions qu'on rencontre sont des plus vatiées : énoncés
placés devant Ia bouche des personnages - l'équivalent des ballons àans la bande dessinée moderne - qui peuvent être
des citations littéraires, des exclamations lancées dans le ieu (dés ou cottabe) ou des salutations à l,adressè diun kalos oud'un contemporain ; inscriptions sut rouleaux, etc. Cf, H. R. Ir*urnweun, Some Inscriptions on Attic pott ery, James SpruntStud. 46,7964' pp. 15-27 3Io., Book Roils on Attic Vases, in Sradze s in Honour of B. L. UUman(r96a1,pp. j-aâ; I»., MoreBook Rolls on Attic Yases, AntK 16, ry73, pp. r43 sqq. On observe un phénomène similaire en Ètrurie-avec les rouleaux oirest écrit le destin des héros : R. Hrnnrc, Giitter und Dâmonen der EÛuskerz (1965), p. 24: p, 29 et frg, 3536, fi,g. 44.
18
15. Cratère en cloche. Co-penhague 333. (Cat. rr.)
sont celles qui se rapprochent le plus de notre cassa : non seulement parce que le texte yprend le pas sur l'élément frguratif, mais parce que ce texte se réfère à un ordre de réalité(nom du peintre, dédicace à un kalos, etc.) indépendant de la représentation f,gurée. Enrevanche, il existe toujours, au vre siècle, une relation organique entre les inscriptions et laforme du récipient, ou, du moins, la conception du décor peint55. L'effet esthétique demeureau premier plan : c'est dans la calligraphie que réside la finalité de l'inscription, non dans lecontenu sémantique. La possibilité d'une lecture signifiante constitue un aspect tout à
fait négligeable56. L'expérience tentée par quelques peintres apuliens de supprimer complè-tement le décor figuré s'est soldée par un échec. Les Grecs étaient un peuple trop artistepour qu'un procédé de décor aussi « intellectualiste » ait pu les satisfaire. L'histoire de lacéramique montre qu'en Italie méridionale les scènes avec personnages étaient effectivementappelées à disparaître, mais au profit de motifs purement décoratifs, comme dans le stylede GnathiasT. La période relativement courte pendant laquelle les piliers inscrits ont été àla mode montre que, dans cette union éphémère entre le texte et l'image, celle-ci, une foisde plus, a fini par évincer celui-là.
54. Voir entre autres J, D. Brezr,rv, Little-Master Cups,/1S 52,1932, pp, t67-2o4, notamment pp. rg4-rg51,F. LoRBER, loc. cit. (supra, n. z), p. ro9.
55. Cf. BEAZLEY, loc, cit. rp. r94 : « §ühereas in most sorts of vases inscriptions are an inessential adjunct ofthe deco-ration, in the little-master cup... they are an integral part of the total design. » Voir aussi F. Lonorn, loc. cit,rp, ttz.
56. Celaestévidentquandlesinscriptionssontdépourvuesdesens:BEAZLEv,loc,cit.,p.r95;F.LoRBER,loc.cit.,pp. ro6-ro7 (qui cite aussi les amphores tyrrhéniennes) et p. ro9.
57. Cf. J.-G. Szrr,Âcyr, loc. cit. (supra, n. zB), p. 26.
19
lf"ii#;liiil(H'ïiiL'inscription du cratère de Copenhague (Cat. rr) ne rappelle aucun mot grec connu,
et, même, tous les signes qui la composent ne correspondent pas à des lettres identifiables.Le peintre d'Adolphseck était apparemment analphabète. Les conclusions qu'on peut entirer quant à la valeur du pilier inscrit n'en sont que plus intéressantes. Rien ne trahitmieux l'intention de l'imagier que ce recours à une inscription factice : il a voulu, lui aussi,illustrer le motif à la mode, et ce n'est pas un hasard s'il a introduit ce pilier truqué au reversd'un vase mettant en scène Héraclès et Niké. Tout se passe comme s'il était conscient dulien existant, ailleurs, entre le nom écrit sur l'une des faces, et les personnages représentéssur l'autre. Ce document, qui constitue un hapax dans la série des piliers inscrits, confirmef idée qu'aux yeux des peintres l'inscription avait une valeur iconique plutôt que linguis-tique, la raison d'être du motif dépassant largement la simple lecture d'un nom.
c)
Cat. tz. Cratère en cloche lucanien de Naples H z87z (inv. 814o6) : *l{}ANMOITAN>OIPANsur pilier conme lequel s'appuie une jeune femme; Eros jouani à ia balle I femme portantmiroir et bandelette (: face A) (fig. 16 et i7).D'influence amykéenne. 4oo-3go (.LCS, p. 6rfio5; J. Thimme, Antaios tt, r969-t97o,p. 5oo, pl. t5ltz; K. Kerényi, in Hommages à Jean Bayet 11964l, p. 336, pl. :/r).
20
Au premier abord, le contenu de l'image est aussi difficile à saisir que celui du textedont le pilier porte l'énoncé. La scène se compose de trois personnages : deux femmes,d'aspect juvénile, et Eros, qui fait rebondir sa balle de la mainsS. Trois des quatre mots del'inscription sont immédiatement intelligibtes : pr.or. (le pronom personnel au datif), tctv(l'article féminin à l'accusatif) et ogîpcrv (le mot balle où 1'« a été omis accidentellement: ogaîpav). Le premier mot est mutilé ; seule la lecture des trois dernières lettres est
sttre : ...]ocrv. On a proposé diverses restitutions :'ieoocv (pour un 'llocrv fautif), xcloav (pouryrî1oxv), '['2ç ü.t et xpuo&.v5e. Aucune de ces solutions ne satisfait entièrement; il subsistetoujours quelque obstacle philologique, paléographique ou iconographique. La leçon
xpuo&,v pr.or tàv o'g <a >îpcrv est celle qui permet l'interprétation la plus satisfaisante de f image.Car la relation très concrète que le peintre a établie entre le pilier et Ia jeune femme qui s'yappuie invite à placer dans la bouche de celle-ci les paroles écrites sur celui-là. Pour les
Grecs, tout ce qui touche aux dieux est d'or, et la balle d'Eros se rattache à cette catégoried'objets merveilleuxGo. L'ellipse du verbe, dans une phrase contenant un complémentd'objet à l'accusatif et un nom, ou un pronom, au datif, est loin d'être exceptionnelle dansla poésie grecqueGl. Mais, paléographiquement, une telle lecture ne s'impose pas. Un sujetau pluriel, tel que l'implique la reconstitution 'leoæv62, obligerait à placer la phrase dans labouche d'Eros (qui n'a pas de lien direct avec le pilier) ou à admettre que la locutrice associe
sa compagne au jeu d'Eros (ce que la scène représentée contredit formellement). La métriquene permet d'étayer ni l'une ni l'autre de ces hypothèses : un vers s'accommode mal de cinqlongues, et le choix du vocabulaire, prosaïque et banal, rend peu vraisemblable l'idée d'unecitation littéraire63.
comme celui d'Ànacréon6a, l'Eros ogaqnr"'4Ç du vase joue un rôle précis : il estl'inspirateur de la passion. La balle d'Eros a une valeur symbolique. Dotée du même
58. Surl'emploiéventueldelaballecommeyo-yorvoirlelécytheapuliendugroupedeLecce,surlerrrarché(palla-dion. Antike Kunst. Katalog 1926,p.44,\o 42 avec ill.). Cf. aussi G. ScnNnrorn-HERRMANN, BABesch 46,r97r,p. rz4.
59 ' Voir P. Krurscnurn , op. cit. (supra, n, z), p. zt5. Xpuo&.v est une suggestion d.u Pr François Lasserre, qui aeu, en outreJ I'obligeance de me fournir plusieurs renseignements à propos de cette inscription. Qu'il en soit vivementremercié.
6o. Chez Apoll. Rh. III, r35 sqq.,1a balle donnée par Aphrodite à Eros est sertie d'or : 7püoea prév oi, züN).« ceceü-\atu. (v. r37)' Cf. A' Lns«v, op. cit. (supra, n. r5), pp. ro3-ro4. Déjà chez Homère, les servantes fabriquées parHéphaistos sont d'or. Elles partagent à la fois le statut des objets artisanaux et des êtres vivants, étant de métal précieux,mais susceptibles de se mouvoir automatiquement. Cf. F. FnoNrrsr-Ducnoux, Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèceancienne (rqZS), pp. ror-r02.
6r. Ex. : pr,! æauài p"&yutgav. De même 'A0z7v{ càv al).oupov (Diogenian, ad Vind. l, 63 : pqtssm. Gr. II, ro).Cf. R. KüsNrn, B, Genru, Ausfiihrliche Grammatik der griechischen Sprache,II, rs (r898), pp. 32g-33r.
62. Cette lecture, qui a été généralement admise, est doublement insatisfaisante : elle oblige à admettre une fauted'orthographe supplémentaire (zl pour e) et elle ne tient pas compte du fait que le grec dit ogaîpav pi).),euv, non ogzipav'ievau (voir ci-dessous les références à Anacréon et Méléagre).
63. Comme me le fait remarquer le Pr Lasserre, n'importe quelle phrase de prose un peu courre est susceptibled'entrer dans le vers d'un poème choral, où tous les schémas sont possibles, s'ils répondent à un typè déterminé par le contexte(par exemple, ici, un type dactylique).
64. Fr. r3 Page. Cf. U. voN §ürrelrlowlrrz, Sappho und Simonides (r9r3), pp. rt6-rr7; D. Pacn, Sappho and Alcaeus(r955), p. r43 ; A. E. HARVEY, CQ, n.s. 7, 1957, p. zr5 ; C. M. BowRA, Greek Lyric Poetryz (r96r),p. zs5 iË. Lassrnnn, Zafigured'Erosdanslapoésiegrecque(1946),pp.44-47. voir aussi A. LEsKy, op.cit. (supra, n. r5); p.::
", pp, 4g-4g,àpropos du jeu de balle entre lJlysse et Nausicaa.
21
pouvoir que la flèche du dieu, elle jette le trouble dans l'âme de celui qui la reçoit65. Eros
est ici l'agent : lror se rapporte à la jeune femme dont le peintre a visualisé les paroles sur
le pilier. Celles-ci prouvent que le motif d'Eros ogcrupr,o'c"{Ç a la même signification sur les
vases que dans la poésie. La métaphore d'Anacréon, avant d'être reprise par Méléagre, et,
beaucoup plus tard, par Gæthe66, a connu une grande popularité dans la céramique italiote,à la fin du ve siècle et au début du Ive. On n'en finirait pas d'énumérer toutes les combi-
naisons iconographiques qui font d'Eros o,pa.q,.o:ri1Ç, tour à tour, le spectateur du jeu67,
I'intermédiaire entre l'amant et la jeune fi11e68, le poursuivant assidu d'un des partenaires6e.
Sur notre vase, Eros conduit l'action, et les deux jeunes femmes jouent un rôle plutôtpassif?o. L'attention avec laquelle elles suivent ses ébats suggère, cependant, qu'elles sont
personnellement concernées par un jeu qui n'est peut-être pas tout à fait innocent. On a
rappelé opportunément la fonction oraculaire de la plupart des ieux, notamment du ieude la balle, dans le monde antique?1. Tout se passe comme si les deux femmes, dont les
yeux sont frxés sur Eros, comptaient les coups, c'est-à-dire supputaient les chances qu'elles
ont de voir leur amour payé en retour ou de recevoir Ia visite de l'être aimé. La doublevaleur du pilier, comme indication du lieu et comme support de f inscription, conviendraitparfaitement à une telle situation. A en juger par les attributs que porte la compagne (sans
doute la servante) de la jeune femme appuyée sur le pilier, la scène se déroule dans
le gynécée7z. On imaginerait volontiers qu'Eros a fait irruption pendant la toilette de lamaîtresse de maison. Mais le pilier évoque aussi la palestre, lieu hanté par Eros?3 et lieufavori des rendez-vous galants, comme nous l'apprend le poème de Théocrite, Les
Magiciennes1a.
65. On remarquera qu'une balle apparaît dans la scène où Léda est séduite par le cygne (fragment de Gnathia, d'unecoll. privée : K. ScnauBNsute, AuA ro, 196r, p. gzlS,pl. t7,fr9.32), de même que dans ce1le du rapt de Thalie par l'aigle(amphote à col paestane, jadis Hamilton : PP,p.84,frg.49; PPSupp,p. 161355; TtscurrrN, I, pl. z6).
66. Méléagre : AP Y , z14 ; Gcethe : Suleika (West-ôstlicher Diwan, êd. GnutrÀclr, I [1952], p. t4ÿ.67. Cratère en cloche de Vienne rr59, du peintre de Créüse (ZCS, p. g4l48g, pl. 46lr ; G. ScHNETDER-HERRMANN,
BABesch 46, rg7r, p. rz4); cratère en cloche de Léningrad, inv. 3r53 (St. zorr), du peintre de Dolon (ICS, p. torl5zB ;K. ScHaurNgune, AW' 7, 1976, 3, p. 48, fig. rZ).
68. Cratère en cloche du Vatican U 3, du peintre d'Amykos (trCS, p. 371146; E,S.I, pL 4a; VIE,p[. ta-b;G. ScuNBrorn-HERRMANN, BABesch 46, r97t, p. rz3, frg. r).
69. Amphore panath. de Naples H z416 (inv. 82264), du peintre d'Amykos (ICS, p. 481246,pL. zolr ; G. ScrNrrorn-IIEnnMANN, BABesch 46, 197r, p. 124).
7o. De même deux éphèbes regardant Eros jouer aux osselets : cratère en cloche du B.M. E 5or, du peintre d'Amykos(ZCS, p. 391169, pl. 6 a; SIVP, pl. r 6). Femmes regardant Eros iouer à la toupie : péliké de Matera, du peintrede Bologne qzS (RVA7,l, 4lzo4; A. D. TRENDALL, G. ScHNETDER-HERRMANN, BABesch 5o,1975,pp.267-27o,frg.7-tt;K.ScnausNsunc,AW'7,1976,3,p.52,frC. z4).Surl'alternanceErosenfant/Erosadolescent:A.LBs«y, op.cit.(supra,n. r5)r pp. ror-ro2.
7r. G. ScuNrIDER-HERRMANN, BABesch 45, t97o, p. ro3; lo., BABesch 46, rg7r, pp. t2S-127, Réticent :
K. ScnerirNsuno, AIY 7r, r976t 3, p. 45.72. Cf.G. ScnNrrorn-HrnRMÀNN, BlBesch 46,t97r, p. rz4 (qui ne parle pas de ce vase en particulier, mais du
motifen général) : n Auch bot das Frauengemach genug Raum zum Ballspiel. ,73.yoitsupra,p.7,etladédicacedeCharmos(n.15).Cf.aussiA.LESKv,o?.cit.(supra,n.r5),pp.8o-8z.Eloquent
aussi le dialogue, par-dessus un pilier, entre Eros et uue femme, sur le skyphos lucanien de Varsovie, inv. r985o5 (ZC.S,p. zglroz ; CVA, a,,IV Dr, pl. z/r-3).
74, Simaitha envoie son esclave Thestylis faire le guet à la palestre de Timagétos, pour qu'elle en ramène son amantDelphis (w. 94-toz). Voir aussi le lécythe attique à fig. noires du Louvre CA ryo4, du groupe de Pholos (ABL,p. z+llZ,pl,4zlr) où deux Hermès et un troisième personnage (Zeus ?) coultisent deux femmes près de deux termq,ta.
22
Le pilier est ambivalent : servant, très concrètement, d'appui à l'héroïne, il remplitune fonction utilitaire. Mais en tant que banderole inscrite, il perd cette valeur objectivepour ne plus être que le support abstrait des paroles prononcées par l'un des personnages
de la scène. Les deux lectures ne sont pas possibles simultanément. Comme dans les dessins
d'illusion, le même objet peut être perçu de deux manières distinctes, mais successivement,
selon que le spectateur oriente dans un sens ou dans l'autre ses facultés psychiques d'enre-gistrementT5. Dans le cas qui nous occupe, il est impossible de dire qui, du pilier ou de
l'inscription, a préexisté dans l'esprit de f imagier. Le contenu de l'inscription est d'impor-tance secondaire ; f image dit beaucoup plus que Ia phrase écrite sur le pilier. On auraittort, cependant, de lui dénier toute valeur iconiqueTo. A cause de l'inscription, le pilierattire d'emblée le regard, et l'on peut admettre que le peintre lui-même a été séduit, avanttout, par cet aspect de u curiosité ».
L'ambiguïté de la scène résulte du statut presque contradictoire du pilier inscrit.Les précédents commentateurs ont reconstitué l'inscription et interprété la scène en fonctiond'idées préconçues. Admettre, avec Kerényi, que la jeune femme, entraînée par Eros, se
rend à son dernier séjour et que ses paroles se rapportent aux déesses du destin?7, c'estforcer le sens du texte et de l'image. Car la jeune femme ne chemine pas; elle se tientimmobile, appuyée sur le pilier. Et pourquoi faire intervenir dans le texte, des figures quine sont pas représentées dans l'image?8 ? Une interprétation funéraire de la scène est assu-rément défendable, mais elle suppose qu'on prête à Eros un rôle eschatologique précis, etqu'on associe, dans la même interprétation, toutes les représentations similairesTe. Replacé
dans le contexte iconographique auquel il appartient, le cratère de Naples offre plutôtl'exemple d'une mode passagère au nom de laquelle les imagiers ont tenté de mêler à
l'image les paroles prononcées par un des personnages. Mais les peintres de vases n'ontpas su remédier au déséquilibre des deux éléments constitutifs, si bien que ce genre hybride
- qui anticipait de plus de vingt siècles notre bande dessinée - a échoué. A considérerl'histoire de l'iconographie antique, on est tenté de croire que les Grecs n'ont pas cherché
75. Voir E. H. GoMBRrcH, L'art et l'illusion (trad. franç., rgTr), pp. 23-24, pp. 332-334 et p. 338 ; E. LeNNans,Illusions (trad. franç., rg75),passim, notamment p. 8r, pp. roo-r04, p. rr3 et p. rr5.
76. Sur la fonction spécifique dr mot écrit dans l'image : R. Benrnrs, Rhétorique de i'image, Communications 4,1964,pp.4o-5r, et la critique de L. J. Pnrtro, Etudes de li.nguistique et de sémiologie générales (1975),pp.134-137. Cf. aussiE, LeNNrns, op. cit. (n. préc.), p. rr.
77. K.KenÉNvr,DerspiegelndeSpiegel,inFestschriftfürAd.E.Jensen,l(rS6+),p.z9o:«...betritteineGriechin
- vom geflügelten Eros gelockt - den §fleg der Verstorbenen nach der lJnterwelt. Dass es der Todesweg ist deutet dieInschrift des Grenzsteins, den sie hinter sich lâsst an, die in Mehrzahi von jenen spricht, die ihr den Ball zugeworfen habenund die nur die Schicksalsgôttinnen sein kônnen. , Cf. aussi : Io., Bildtext einer italischen Vase in Giessen , in Hommages à
Jean Bayet (1964), pp. 336-338. Même interprétation funéraire : F. Hausrn, RM 25, r9ro, p. 285.78. Kerényis'appuie,àvraidire,surl'interprétationdeJ.J.BecnorrN,GesammelteSchriften,Yll(1958),pp.63-64:
« Mau hat mir den Ball zugeworfen, das will sagen : Ich bin zu der Unsterblichkeit in den hôchsten Sphâren des Àlls berufen. »
Contra : K. ScnausNsune , AIX/ 7, 1976, 4, p.3r : « §fie mir scheint, bietet keine italische Vase einen sicheren Anhaltspunktdafür, dass der Ball auf ihnen mehr als ein Spielzeug sein soll. Dies gilt auch für einen oft besprochenen Neapler Krater[: notre vase], dessen Inschrift noch immer Anlass fùr Kontroverse ist. ,
79. Àinsi j. Tnrmua, Antaios n, tg6g-rg7o, pp. 489-5 r r, notamment p. 5o3 : « Das Sterben wird als Liebesverzau-berung verstanden.,5u1 la balle comme ofrande funéraire : G. ScnNeroen-HrnntraNN, BABesch 46, r97t,p.r3t;K. ScnaurNsune, AW 7, 1976,4, pp, 3o-3r.
23
à dépasser le niveau d'une imagerie sans texte. Les expériences tentées par quelques peintres
italiotes prouvent qu'en fait ils s'y sont essâyés, mais ils se sont heurtés à la force de la
tradition et, aussi, à la puissance narrative de l'image elle-même8o.
d)
Cat. 13. Skyphos lucanien de Métaponte 2or5o : I. KAÀHE.,. N sur pilier à côté d'Io assise, quise contemple dans un miroir (: face A).Proche du peintre de Pisticci. Env. 4zo (ICS Suppl. I' p. 6184b, pl. rlz; A. D. Trendall,ArchReps t969-t97o, p. 39, fig. r3).
Cat. 14. Skyphos lucanien de New Yotk t2.235.4: MAP)[ surpilier contre lequel s'appuie le
Silène ; Artémis et une autre déesse (Léto ?) lui font face ; Athéna assise en retrait (- face A).
. Peintre de Palerme. Env. 4oo (ZCt p. filzn,pl. 4ft; ESI, A 346,Pt.9 et pl. ir à).
Cat. 15. Skyphos lucanien de Palerme 96r (inv. zr58) : OI\NA>ETAX sur pilier près duquel est
assis le Silène; À{.énade jouant de l'aulos (: face A).Peintre de Palerme. Env. 4oo (ZCS, p. fi1275, pl. 4lz; ES/, A 348, pl. 8 a).
Sur ces trois images, le pilier contient le nom du personnage représenté juste à côté.
L'inscription MAPX[TA) (Cat. 14) est avant tout épidéictique, car elle n'est pas indis-pensable à l'identification de Ia figure. Dans le cas d'Io (Cat. r3), le libellé de l'inscriptionest incomplet et, bien que l'héroïne soit nommément désignée, on ne peut rejeter a prioril'hypothèse d'une phrase prononcée par elle. Dans un tel cas, le vase offrirait un nouvel
exemple de pilier utilisé comme phylactère. En face de ces deux images, deux questions se
posent : r) quelle est la fonction du pilier inscrit au sein de la représentation ?
z) y a-t-il un rapport entre l'inscription et l'absence d'action qui caractérise ces scènes ?
Sur le skyphos de New York (Cat. r4), le Si1ène est relégué en bordure de composition,
et ce sont les déesses, venues le visiter, qui sont les véritables protagonistes. Leur choix
s'explique en fonction du mythe : pour Athéna, par le rôle qu'elle ioue dans l'adoption,puis l'abandon, de l'aulos8l ; pour Artémis et Léto, par leur lien avec Apollons2. Dans l'ico-nographie italiote, on a plusieurs exemples de scènes mythiques oir l'action violente se
transforme en paisible « conversation »83. Mais le skyphos de New York se distingue par
une autre particularité : le principal intéressé, Apollon, n'est pas représenté. La situation
correspond exactement à celle du Prométhde d'Eschyle, oir les rares amis qui n'ont pas
renié le Titan déchu se rendent au lieu de son supplicesa. Comme celui de Marsyas, le
8o. Si l'on considère que le message linguistique, sur le pilier, est à la fois communication entre les personnages etioformation pou 1e spectateur, force est d'admettle que celle-ci a une valeur marginale par rapport à celle-là.
8r. K.ScHÀuENBURc,RM65,r958,p.42,r\.2,etpp.64-65.SurlemythedeMarsyas,endernier:L§0rrr,rn,DerAgm im Mythos (1974), pp. 37-59 avec bibl.
8z.Léto:K.ScrausNsuno,loc.cit.(n.préc.),p.49,p.56etpp.64-65;Artémis:ibid.,pp.64-65.83. K. ScHAùENsune , Opus Nobile. Festschrift U. Jantzen (rS6S), pp. 135-136 i1o., G3tmn.7o, 1963, pp' r3o-r3r :
u Nu vereinzelt kann die Szene dabei auf einen konkret fassbaren mythologischen Moment festgelegt werden. Dargestelltwird.. . ein taten-loses Zusammensein oder ein ruhiges Gesprâch.. . , Cf. aussi les articles cités supra, \. 49, et infra, t. to8,
84. D'abord les Oceanides (rw, rz8 sqq.), puis Okéanos iui-même (vv.284-396). Sur cette technique dramatique :
A. LEsr<y, Die tagische Dichtung der Hellenens (rg72), pp, t4o-r4r,
24
châtiment de Prométhée appartient encore au futur; il n'est évoqué qu'à titre de menace.Dans la tragédie, l'adversaire victorieux, Zeus, n'apparaît, lui non plus, à aucun moment.Chez Eschyle, toutefois, le but des « visiteurs » est de fléchir l'obstination du Titan. Enva-t-il de même sur le skyphos de New York ? Plutôt que de scène de « persuasion », ondevrait parler ici de scène de « contemplation »85.
Le skyphos de New York86 constitue un des rares exemples où le pilier inscrit serrd'appui à une figure. Marsyas n'a pas Ia pose humiliante qu'on lui voit d'ordinaire sur lesimages des apprêts du supplicesT. Au contraire, il brandit fi.èrement l'insrrument de sa
passionss, et iI paraît braver les divinités qui, bientôt, l'anéantiront. Le pilier sur lequel ilest accoudé lui confère une sorte de suprématie sur ses « yisilsuses ». Cette connotation desupériorité appartient au motif en tant que telse : en donnant plus d'assise au maintien cor-porel, le pilier rehausse, simultanément, le prestige moral de la personne ainsi représentée.L'importance du mot écrit MAPX[TA) s'accroît par contrecoup. Même si, initialement,
85. L'accumulation des verbes exprimant la contemplation, tant dans 1a bouche de Prométhée que dans celle de sesvisiteurs successifs, est symptomatique.: 8épX0z1r', !oiàeoO'.oTç 8eoçr.Q... (r4o-r4r).; ),eüooc,r, flpopl0iü (r43); oixcpaiorvô'iôeiv (zg8); oüc'd.v eiou8eïv cd8e ëXp1(ov eior8oüod.c'.!).yüv01v xéxp (z++-z+g; èÀeuvàq Liàoia, èVii (z+o) ;'ou Sùæ6vcov èpôv{xer,.ç èrôrt.'qç(298-z9g);OetoploôvritlaqèV-ù.ç &gilat Qoz-3o3); ôépzou $éapL* i:o+l jôpa npofrzlQeU GoZl ioàqrcpoorôoüo'ù'où.çr$7uç(553-554).DemêmepoürIo:.'éqp,u' eiocàoüoct:rp&ir,v'Ioüqie95).ftp"t-etÀeè"r,"or.d"r,,le tout dernier vers de la tragédie : èoop{q p'ôq ëxàuxa ædoXc.: (ro93). Le même motif, celui de « visireurs , veûus contemplerun héros malheureux, ou s'apitoyer sur son sort, n'est pas sans parallèle dans l,iconographie, euand Andromède est enchaînéeau rocher ou que Niobé, consumée par le chagrin, se métamorphose eû rocher, leurs parents et amis iouent un rôle semblableauprès d'elles. A f instant décisit celui de la mort, le héros se voit pleuré par son entourage, qui se présente parfois d.ansl'attitude caractéristique des porteurs d'offrandes. Pour Marsyas, voir notamment le skyphos attique dÀ Salonique(K. ScneurNaunc, R1ÿI 65, 1958, p.49,pl.38/r). Andromède: M. Sc}rtrror, op. ciT.(supra, n.35), pp. 47_48;lo.,DerDareiosmaler und sein Umkreis (r 96o), pp. 44-47 ; K. ScuÀurNnunc, Perseus in der Kunst des Ahertums (1916o), p. 66. Niobé :A. D. TnrNoar.r. , RA, tg7z,Il, pp. 3o9-316 ; M. Scrmror, op. cit. (supra, n 35), pp. 4o-5o.
86. De même Cat. 6, rz et 28.87. Accroupi : cratère en cloche de copenhague 3757 , dt peintre de copenhague 37s7 ec s, p. 3g6lrB4, pl. r4g l4 ;cvA,6'pL. z45lr; K. SGraunNnune, RM 65, r958, p. 5r/8 ; Io., RM 79, rg72, p. 32r, n. :z). cf. auisi, dans Ia céramique
attique, le cratère en cloche d'Al Mina 86 (H, Mrrzcrn, op. cit. [supra n. 5o], p. r6zlzo; J, D. Baazrv, JHS 59, 1939,p1. 4-6 et p. 35 j I»., EVP, p.76), et le skyphos de Salonique (supra, n. 85).
Attaché à l'arbre : cratère en calice de Bruxelles Rzz7, dt peintre de Bruxelles R zz7 (K, ScueurNnunc, RM 65,r958, p. 59, n. r3o ;1o., RM 79, t972,p. 32r,n.37 ; CVA, z, IV Db, pl.7lil t vase perdu, jadis Hamilton, du peintre deCaiyano (ZC.S, p. 3ogl586 ; K. SüraueNeuno, RM 65, 1958, p. 50, n. 55 ; Io., RM 79, rg72, p. 32r, n.3r ; Tischbein IV,pl. 6); bouteille de Paestum, Case 33, fabrication locale de I'époque apulianisante (PAdd, p. 4lA i;r; k. ScaauuNnunc,RM65't958,p.47'\.34'pl.35lt-z;l».,RM79,1972;p.32r,r.37);bouteilledeVarsovie,ei-Czartoryskirz5,imitationcampanienne du style apulien (K. scueuENaunc, RM 65, r 958, p. 47 , n. 34 ; cvA, pl. 49lù. cf . aussi le skyphôs attique àreliefs de Naples (K. ScuaueNnunc, RM 65, 1958,p. 52,n. 7r, et p. 60; V. SprNAzzor-d,,Le Arti decoratizte'ià pompei e nelMuseo Nazionale di Napoli [r928], pl. zoo).
88. Même motif du couteau tenu à 1a main par Marsyas : cenochoé de Tarente 2o3o5, du groupe de Schwerin (ZC,S,p.69135r,pl.32lgt K.ScHAUENBURS,RM65, 1958,p.Sr14,pl.3413;Io.,RMlg,r97z,p.3zo;E.panrneNr, ImmaginidiVasi Apuli 11964l, pl. z r couleur) ; cratère à volutes du Louvre K 5 r 9, du peintre de Brooklyn-Budapest (ZCS, p. rril 5g4 ;K. scHausNnune, RM 65, 1958, p. 5r/5, pl. 3z et pl. 33/r; Io., RM zg, rg72, pp. 3zr1zz) I cratère en cloche deCopenhague Zl5l (n. préc.). Schauenburg a souligné l'originalité de ce motif exclusivement italioie (RM 65, r 958, pp. 6o-6r ;cf. aussi IC,S, p' 69, n. r), et iI a proposé le rapprochement avec les martyrs de l'art chrétien. L'attributà, ciites, valeur deprolepse, mais nous ne pensons pasJ comme Schauenburg (ibid.,pp.6o-6r), que les imagiers aient « mal compris le mythe ,.
89. De façon plus n logique » par rapport au dénouement du mythe, c'est Apollon qui, appuyé à une côlonne, dominele Silène, sur le fragment de cratère en cloche attique de Léningrad (Ch. CrarnmoNt, YaleClSt i j, i957,
"" r9 ; K. StueurN-
BURG, -RM 65, 1958'p.62,n. r47'pl,361r).IJn copiste romain a même utilisé Marsyas comme figorà de soutien d,uqe sratued'Apollon: Musée chiaramonti (w. Auu,uNc, vat. Kat.I, pl.5r, zgzB;K. scuAuuNeunc, RM 65, r95g, p.55). c,estplutôt pour se donner une contenance que le Marsyas « soucieux » de I'cenochoé d.e Melbourne go15,-âu p"i"t.. â. f"tto"(4. D' TnrNoert, In Honour of D. Lindsag [rg64], p. 4s, frc. 27 ;1o., phvz, p. g6/1 95, pl. 13 a ;'K. ScueirNnunc, RM 7g,r972t p. 3r8, pl. r3o et pl. r3r/r) s'appuie sur un pilier.
25
Le skyphos de New York86 constitue un des rares exemples où le pilier inscrit sert
18. Stamnos étrusque. Cabinet des Médaillest 947.
le pilier a été choisi par simple commodité, il prend maintenant valeur commémorarive.L'inscription sert moins à désigner le Silène qu'à fixer son nom dans la mémoire - et dansl'æil - du spectateureo. De même que les personnages sont porteurs d'un destin qui n'estévoqué qu'allusivement, de même le pilier accroche l'attention du spectateur. Le mot faitimage; il prend une valeur presque symbolique. Sur un stamnos étrusque du début durve siècle, le peintre de Settecamini s'est servi de la même convention iconographique queson collègue italioteel (fig. 18 et r9). C'est le nom d'Ajax qu'on voir imprimé sur la jacynthe,
9o. A l'époque romaine, les copistes se serviront parfois du support des statues pouï âpposer leur signature oud'autres inscriptions. Cf. G. Lrppor,o, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen (1923),p. 98. Tout autre érair l'intentiondu peintre italiote.
9r. Stamnos du Cab. Méd.947 @VP' pp.5-6, pp. SZ-S+, pl. rr/3-4). Voir de même le miroir étrusque du B.M.(R. HrneIc, op. cir. fsupra, n. fil, p.29, fig. ro ; E. GrnuAn», Etruskische spiegel,rY [r867], pp. tr2-13, p]1. 35g ; EAA rÿ,p. 488, fig' 57 z), où le roul.eau que tient la Lasa porte le nom des personnages mis en scène et non pas, comme on s'y atten-drait, le sort qui leur était réservé.
26
19. Stamnos étrusque. Cabinet des Mé-dailles, 947. Détail de f inscription.
quand la plante jaillit miraculeusement du sang du hérose2. La jacynthe se dresse à l'endroitprécis où Aiax va enfoncer son épée dans le sol et, sur la tige, l'imagier a écrit parprolepse : AIFAM.
La mutilation du pilier d'Io (Cat. l3) est d'autant plus regrettable qu'il s'agissair,peut-être, d'un des documents les plus originaux de la série. Outre le nom propre et l'adjectifx«Àd, il y avait au moins un toisième mot, dont le v final est seul conservé. Toute tentativede restitution paraît vaine. L'énoncé complet nous échappanr, il esr impossible de savoirsi le pilier contenait les paroles d'fo, ses pensées ou une légende explicative. L'idée d'undialogue avec le miroir n'est pas à exclure, et I'on pourrait même imaginer qu'il répondaità une interrogation de l'héroïnee3.
Le motif du miroir n'est pas ici un geste de coquetterie ; il doit être pris dans un sensfortea. fo découvre son nouveau visage : avec horreur ou sans trop de désagrément ? Ovideatteste que la métamorphose n'avait en rien alt&é la beauté de la jeune fille : bos quoque
formosa esf\. A en croire certaines versions du mythe, c'est Zeus lui-même qui l'avaittransformée en génisse, afin d'endormir la suspicion d'Hérae6. Le commerce charnel,en tout cas, ne prenait pas fin avec la métamorphose, Zeus continuant à visiter son amante
92. Oÿ., Met. XIII,3g43g8.93. Voir notamment l'épigramme-devinette lP XIV, 56. De même Gæ.the, Suleika (West-ôstlicher Diwan fsupra,n. 661, p. 83).94. Sur Ie rôle religieux, et magique, du miroir : A. DELATTE, Z a catop*omancie grecque et ses dérioés (t932), passim,
notamment pp. 149-154; K. KraÉNvr, Der spiegelnde Spiegel (seprd, \.7il t G. SclrNErorn-HsnnmnNN, BlBesclz 45, r97o,p, ro3, n. g8 ; I.-G. Szrr,Âcvr, loc. cit, (supra, n. z8), p. 20, n, 16 avec bibl.
95. Ov., Met.I, 6rz.96' APoLLoD.,II, r, 3 ; Hrs., fr. rz4 Merkelbach-rVest; Ov., Met,I,6ro-6L Autre version : AEscH., Suppl. zg9.
Sur le mythe d'Io : C. RoBERT, Die griechische Heldensage (t9zo-rgz6), pp. zg-266; RoscHER, s.v. 1o, col.263-z9o larrg"r-mann)i R-8, s.v. 1o, col. 1732-1743 (Eitrem); F. §[ranr,t, in Gestab und Geschichte. Festschrift K. Schefotd (1967), pp. 196-r9s ; J' D. BDAzr.rv, in CB lll (rs63), pp. 4g-5r ; K. scHaurNnunc, AuA to, 196r, pp. 90-gr ; Io., nu so, tô,7s', p. ,ge .
27
sous forme taurineeT. Les témoignages littéraires nous aident quelque peu à déchiffrercette image que la perte de l'inscription a rendue muette. Le type hybride d'Io correspondà celui qui est le plus fréquent en Italie méridionalees I l'aspect thériomorphe, tel que I'aadopté le peintre de Pisticciee, n'était pas compâtible avec une scène de séduction amoureuse.
Le miroir a une connotation érotique. N'est-ce pas la visite de Zeus, illustrée sur deuxautres vases italiotes1oo, qu'Io attend ici ? Un rhyton attiqueloI, exporté en Italie du Sud,montre face à face Io, reconnaissable à ses petites cornes, et Eros, qui lui tend une parure.L'atmosphère de la scène est très proche de celle de notre vase. Le rhyton de Ruvo prouveque les premiers décorateurs italiotes sont restés fidèles au répertoire formel en vogue à
Athènes1o2. Le peintre lucanien, à qui l'on doit les deux skyphoi retrouvés à Métaponte,a simplement disséqué la scène du rhyton, reproduisant Io sur l'un des récipients qu'ilavait à décorer (Cat. r3), et, sur l'autre103, Eros - dans une position et avec un attributrigoureusement identiques.
Le pilier est-il le simple support de l'inscription ou a-t-il une signification propre ?
Par ses dimensions imposantes, il occupe, dans l'image, une place non moindre que laprotagoniste. Indique-t-il le lieu de I'action ? Il pourrait suggérer le lieu saint où Zeus, à
en croire d'autres témoignages figuratifs1oa, rencontrait son amante. L'arbre dessiné aurevers confirmerait cette interprétation, si l'on pouvait prouver qu'il évoque le « boissacré de Mycènes » où Argos tenait Io prisonnièrelo5. Dans une telle perspective, la présenced'Hermès se justifierait pleinement, car c'est là qu'il surprenait Argos et mettait fin à lacaptivité d'Io1o6.
Le mode d'expression extrêmement concis (chaque face ne contient qu'une figureet un élément de décor, mais un élément signifiant) donne à croire que l'inscription dupilier apportait un complément à l'image. Si l'on considère simultanément les deux facesdu vase107, on a l'impression qu'Hermès, caché derrière l'arbre, a surpris Io en train de se
regarder dans le miroir. Cette contemplation au second degré correspond tout à fait à l'atmo-
97. AEscH., Suppl. 3oo-3ot.98. Cf. I.-M. Monur, L'Ilioupersis dans la cérami.gue italiote (1979, pp. 168-17o.99. G,nochoé de Boston oo.366 (LCS, p.1619; ESI, A99; K. ScreurNeunc, AuA ro, t96r,p.9ol3 ; A. D. TREN-
oer,r,, T. B. L. §7resrrn, Illustrations of Greek Drama lr97rl,ll,6).roo. HydriedeBerlinF3164,dugroupedelaPélikédeMoscou(RZlp,I,llZ+;J.-M.Monrr,op.cit.lsupra,n.98f,
Cat. ro9, pp. 168-170, pl. 9r /z) et amphore panath. perdue, iadis Coghill, du peintre des Choéphores (lôed., Cat. r r r, p|. 9r /3).ror. Rhyton de Ruvo, J r116, de la classe W (ARVZ,p. r55rlrz; H. HorruaNN, Attic red-figured Rhyta 1196z),
p, 4zl14; H. SrcnrrnttanN, op. cir. lsupra n. 32f,p. 29, K zo, pI. 4o).roz. Remarquons que le rhyton de Ruvo, qui date de la fin du v" siècle, est postérieur au skyphos lucanien. Mais
les vases italiotes n'ayant pas été exportés à Athènes, l'imitateur a bien été le peintre lucanien qui travaillait dans l'atelierdu peintre de Pisticci.
ro3. Skyphos de Métaponte zorr5 (ZC.S, Suppl. II, p.6184a, pl. r/r).ro4. Cf. suîtra, n. roo.ro5. APorr,oo.,II, r,3, Cf. J.-M. Moner, op. cit, (supra, n. 98), p. 169, D,après K. ScgeurNeunc, Monumenturn
chiloniense. Festschrift für E. Burck (rg79, p, 558, cer arbre, un palmier, ferait allusion à I'Egypte.ro6. Sur les peintures romaines (cf. I.-M. Monrr, op. cit.,p, 169, n.9), Hermès surprend Argos près de l'efrgie
divine ori Io a cherché refuge.ro7. De même Io et Hermès sur chacune des faces du skyphos attique de Palerme, Banque de Sicile zo, apparenté
au peintre de PénéIope (ARV2,p. t689 3 Odeon ed altri monumenti archeologici [Banco di Sicilia, r97r], pl. t5 a-b Àip. :O).
28
sphère des scènes otr l'on rencontre habituellement des piliers inscrits. Le u ssns second »
du mythe est ici prépondérant et, pour le manifester, il fallait substituer à la mise enscène traditionnelle un langage plus allusif108. On ne peut aimer, tout ensemble, le symbolechiffré et la narration détaillée1oe. C'est pourquoi les piliers inscrits apparaissent si fréquem-ment dans des scènes de u ç611ys1sation » et de « contemplation ». Par sa valeur symbolique,le motif favorisait Ia tendance à l'abstraction que l'art classique tardif a plusieurs foisexpérimentée, mais qu'il n'a jamais adoptée définitivementrlo.
Le même imagier a recouru au même procédé sur le skyphos de Palerme (Cat. r5).Ici également, il faut admettre que f inscription ONNA:EYA> désigne le satyre qui estassis à côté du pilier. Ainsi placé en exergue, le nom vise à frapper l'artention, tout commela présentation frontale du protagoniste. On pourrait presque dire qu'il a force d'interpel-lation. « Je suis Onnaseuas », semble dire le Silène, dont les yeux accrochent immanquable-ment ceux du spectateurlll. N'est-il pas curieux que le revers du vase représente une scèned' « hypnose » contemplative ? Assise sur un rocher - comme Onnaseuas - une jeunefemme scrute un miroir où se reflète son image. Le motif est assez banal, mais il est excep-tionnel que la réflexion soit visible pour le spectateur, comme c'est le cas ici. La comparaisondes deux scènes permet de préciser la portée de f inscription. Pour les Anciens, celui quiinterroge le miroir reçoit non pas un reflet de surface, une apparition trompeuse, maisla vision transparente de son être véritable. Il en va de même du nom : c'est l'individu entierqui se manifeste au travers de lui, car il représente la personnalité intime du sujet.
e)
Cat. 16. Cratère à volutes lucanien de Tarente I.G.8263: KAPNEIOX sur pilier à l'extrémitégauche de Ia scène de danse (: face B, fig. zr).Peintre des Karneia. Env.4oo (ZCS, p. 55lz8o,pl.24t ESI, A 35o, pl. z4-26).
Cat. 17. CratèreenclocheapuliendeCleveland24534iAOPOAITHsurpilierprèsduquelesrassiseune femme à qui Eros tend une bandelette (: face It) (frg. zz).Peintre de Graz. Env. 36o (RVApl, 6lz16; cvA, pl. $t G. schneider-Herrmann,BABesch 45, r97o, p. 90, fig. 5 ; H. R. §7. Smith, Funerary symbolism in Apurinn vase-Painring Ugl6), pl. iS).
Cat. 18. Amphore panathénaïque apulienne du British Museum F 33r : ÂIO) sur Ia colonne prèsde l'autel oir Pélops et Oenomaos offrent une libation avant la course (: face A) (fig. zo).Peintre de Varrese. Env. 35o (RVAp I, $15, pl. toglz [détail]; A. B. Cook, Zeus,I [r9r4],pl. 3, pp. 36 sqq. ; L. Séchan, La *agédie grecque dans ses rapports aoec la céramique lt9z6],fr,g. tzÿ.
ro8. « Zwischen ikonographisch Erklârbarem und allgemein Assoziativem », selon une heureuse formulation deH. SlcsrrnrreNN, Spiite Endymion-Sarkophage (1966), p. ro8. Cette mutation de l'imagerie a été mise en évid.ence aussipar K. Schauenbarg: supra, n. 49, et n. 83. H. Mrtzcrn a fait des observations similaites à propos de la céramique attiquedu w" siècle : la faveur qu'y conservent les scènes du mythe « tient moins au contenu légendaire qu,à la leçon de parei[esimages , (op. cit, lsupra, n, 5ol, p. 4zo), I'essentiel résidant n dans la signification seconde , (ibid., p. 41.6).-
ro9. Bel exemple de figuration n chiffrée » : le lécythe pansu du B.M, 1958.2-r4.r, du peintre de primato (ZC.s,p. rT5lroz; A. D. TRENDAU, T. B. L. §ümsrrn, op. cit.fsupra,n. 99l,III, r,7), avec un pilier pr?cisément.
rro. Voir J.-G. SzrlÂcvr, loc. cit, (supra,n. z8).rrr. Cf. E. H. Gomnnrclr., op, cit. (su1tra, n. 7), pp. 7ÿ-152.
29
20. Amphore panathénaique. Bri-tish Museum F 33r. (Cat. t8.)
L'amphore du British Museum (Cat. r8), qui représente le serment de Pélops et
d'Gnomaos, se rattache à un contexte légendaire bien connu112. Les témoignages littérairessont unanimes à faire de Zeus le garant du pacte113, ce qui revient à dire que l'autel sur lequelPélops et Gnomaos sacrifient lui est consacré. L'inscription ÀIO2, peinte sur la colonne,est-elle superflue ? Sur un cratère attique du début du rve siècle, la colonne qui flanquel'autel où les concurrents accomplissent le rite prescrit est surmontée d'une statued'Artémislla. Qu'en conclure ? Que le peintre a commis une inadvertance ou qu'il s'agitd'une divergence au niveau du mythe ? La réponse est plus simple. Le peintre a choisi, dans
le répertoire iconographique, le type d'effigie qui était le plus usuel, et il l'a reproduitsur le vase, sans se soucier de l'incongruité mythologique qui en résultaitll5. Le nom AIO»,sur l'amphore apulienne (Cat. r8), atteste que la tradition figurée n'est pas en oppositionconstante avec celle des mythographesll6. Mais l'enseignement le plus précieux qu'onpeut tirer de cette image concerne la forme sous laquelle le nom apparaît. Le génitif
r r z, Voir L. LÀcRorx, La légende de Pélops et son iconographte, BC H roo, 1976, pp. 327-34r t avec bibl. p. 329,î. 22, et p. 334, n.67. Cf. aussi H. MErzcER, op. cit. (supra, n. 5o), pp. 32r-323.
rr3. Toutes les sources ne mentionnent pas, à vrai dire, ce sacrifice préliminaire. Les renseignements les plusdétaillés sont fournis par Droo. Src., IV, 73. Cf. aussi Peus,, V, r4, 6.
rr4. CratèreenclochedeNaples}Jzzoo,dupeintred'G,nomaos(ARV2,p,t44olr;Paralip,,p,4g2;H. METZcER,op. cit.fsupra, n. 5ol, p. 32r137,pL. lSl+; I-I.tr. Monrr, op. cit. fsupra, n. g8l, p. 34, 11. t4).
rr5. D'après C. RoBERT, Archàologische Hermeneutik (rgrq), pp. 295-296,l'effigie d'Artémis serait indépendante del'autel et marquerait I'entrée de l'hippodrome d'Olympie.
116. Sur deux autres illustrations apuliennes, I'autel est surmonté d'une statue de Zeus : cratère à volutesdu B.M, F 278, du peintre u de Lasimos , (I.-M. Moner, op, cit.fsupra, n.981, Cat. 7,p.4» et cratère à volutes du SoaneMuseum ror L, dit n vase du Cawdor , (ibid.,p.4».
30
21. Cratères à volutes. Ta-rente I.G. 8263. (Cat. 16.)
est soit celui du complément de nom (un mot comme p.pdq étant sous-entendu), soitcelui d'appartenance (,, de Zeus » ou « à Zets », c'est-à-dire « consacré à Zeus »). C'estla manière traditionnelle, en Grèce; de désigner la divinité à laquelle un objet est
consacré.
Il en va tout autrement avec le pilier KAPNtrIO»i17 (Cat. 16). Que l'épithète apparaissesans le nom d'Apollon ne doit pas nous surprendre ; c'était d'un usage courant11S. Pouréclairer le contexte iconographique - n'est-ce pas le but de l'inscription ? - KAPNEIO»est beaucoup plus suggestif qu'AIIOÀÂQN, car c'est le dieu de la fête qui est ici concerné.Pour éviter les contresens, il convient d'être attentif à chaque détail iconographique. Lepilier inscrit ne figure pas au centre, mais en bordure de la composirion, ce qui indiquedéjà qu'il joue un rôle secondaire dans la représentation. IJn autre pilier, un peu moinsélevé et surmonté d'une coupe, se dresse à peu de distance. Ces deux éléments d'une archi-tecture sacrée donnent à penser que l'action se déroule dans un sanctuaire ou, du moins,dans un lieu habité par la présence divinelle. La danse exécutée en l'honneur d'Apollonest une danse rituelle, et les couronnes qu'on voit sur la tête des participants ont une valeur
r17. SurlafêtedesKarneia:W.Bunxrnr,op.cit.(supra,n.r5),pp.354-358,avecbibl.p.354,n.r;A.Bnnr,rcu,Heros (supra, n. r7), p. r83 ; U. voN §7lr-AMowrtz, Der Glaube der Hellenen,ls (1976), pp. 87-88.
rr8. Ex. : Ai1).&taq cÇr Kapveico 168' &ya),pa àvé01xe, sur une stèle de Sparte (P. Fnrror.ÂNonn, op. cit.lsupra,n. 42), P, 5zl5o). Cf. aussi L. R, Fanltrr,r, The Cubs of the Greek States,lY (r9o7), p. r35 : « In facr,we areneverabletodisentangle Kd.pveroq under any form and in any legend from Apollo. »
rr9' Deuxpiliersrmaisdépourvusd'inscriptions,figurentenrelationavecdesdanseursaucalathiscossurlecratèreen cloche lucanien de Leyde RSx 4 (ZC.S, p. ro5/548; A. B. Coo«, Zeus,lll,z lr94ol,p.997,fi,g.Bo).
31
cukuellel2o. Doit-on assimiler le pilier KAPNEIO> à une idole d'Àpollod2l ? On songe,
en effet, à ces représentations aniconiques du dieu, qui étaient l'objet d'une grande véné-
ration en Grèce, et dont l'existence est encore attestée à une époque tardive122. Pausanias
mentionne, à plusieurs reprises, des &pyoi À[,0or,, c'est-à-dire des pierres non travaillées
de main d'homme12a, fétiches auxquels on vouait un culte tout comme aux statues anthropo-
morphes. Sur l'agora de Pharai, en Achaie, trente de ces u bétyles , se dressaient à côté
d'une statue d'Hermès12a. Or, dit Pausanias, chacun d'eux représentait une divinité. Témoi-
gnage capital pour nous, parce que cês retpd,yovor, Ài,0or, - le grec n'a pas d'autre équivalent
du mot pilier - correspondent exactement aux objets qui sont représentés sur nos vases.
'Exd,or<4 Oeoü cuvàq dvoçra èærÀéyovceç, ajoute Pausanias (« ils attribuent à chacun d'eux le
nom d'une divinité »). La distinction faite, à quelques lignes d'intervalle, entre èær,Àéyo
er èrclypapr.pry" doit être prise à la lettre125. Àlors que la dédicace du Messénien Simylos était
écrite sur l'herme, le nom des &pyoi. ).i0or, était le fait d'une tradition locale - et orale'
Les témoignages antiques ne nous autorisent donc pas à considérer les piliers inscrits comme
lulne réalité archéologique; les exemples qu'on rencontre sur les vases reflètent :une mode
iconographique.
Le nominatif KAPI{EIO) peut se comparer aux inscriptions de deux représentations
célèbres du peintre de Darius : IIEP)AI sur le cratère du Conseil de Darius, IIATPOK^OTTA@O> sur l'autre vase, où td'goç doit être pris dans son sens premier, c'est-à-dire u funé-
railles (littéralement : rites funéraires ou cérémonies funèbres en l'honneur) de Patrocle ))126.
Le mot KAPNEIO>, de même, sert de titre à la représentation. Le pilier pourrait être
considéré comme un simple écriteau, si le peintre avait écrit KAPNEIA. A ce détail appa-
remment insignifiant, on mesure l'abîme qui sépare la conception grecque de la mentalité
r zo. M. P, Nrr.ssoN, Griechische FesTe oon religiôser Bedeutung (r 9o6), p. r 97. Sur Ia danse elle-même : A. B ' CooK,op. cit. (o. préc.), pp, 99o-ror2, notâmment pp. roo8-roo9 ; K. ScnaurNnuxc, op. cit. (supra, n,85), p. roo, n. 7oz avec bibl.Iconographie attique : H. METZGER, op, cit. (supra, n. 5o), pp. z8z-283 i C. rù(/erzrNcsn, in FR III, pp. 323-324. Vases ita-liotes:N.MooN,B§R rr,rg2g,pp.3o-3r;K.ScneurNsusc,oP,cit,,p.roorn.7o4;RVApl,tl57et 58.SurlecratèredeTarente en particulier : P. rÿurtr,Bu.mrsn, RA, rg33,11, pp. 9-r8; A. B' Coox, op. cit.'p.996; K. ScnaueNaunc, op. cir.,pp. 99-ro2. Remarquons que c'est le seul document qui mette explicitement la danse du calathiscos en relation avec la fête
des Karneia. Cf. N. MooN, loc. cit.,à propos des vases italiotes : u They do not seem to illustrate precisely anything that weknow from literary evidence about the Karneia. » De même P. rù(/urr,r,auurBx, loc. cit., p. r3.J et K. ScneurNnunc, op. cit,,pp. 99-roo. Mais I'importance des danses, dans la fête des Karneia, est attestée par Cer,r.rmequr, Hymn. Apoll,,85 sqq.(cf. M. P. Nrr,ssoN, op. cit.rp. rz7), Quelques vases itaüotes montrent un danseur au calathiscos en présence de Dionysos,notamment Ie cratère en cloche du B.M. F r88 d'Astéas (PP, p. 38, pL. ro a, et fig. r5 ; PPSuPp' p. 5146 ; SIVP, pl. t4 a).
Cf. A. FunrwÀNGLBR, AA, r895, p. 39 ; K. ScueurNBURG, op. cit., pp. 99-roo, et H. JraNrrlernr, Dionysos (r95r), p. zrz,r zr . P, Wurr-r,sur*ren, /oc, cir. (n. préc.), p. 13 1Io,, Tarente des origines à la conquête romaine (:.g3g), p. 48 r : " cippe'..
qui peut représenter soit la tombe du génie prédorien auquel s'est substitué Apoilon, soit la statue de la divinité composite.. ' ".De même C. Atr1zzlrtt, DissPontAcc :l4, rg2orp.2r2 i culte funéraire. Contta : L. R. FenNrr-r, op. cit. (supra, n. rr8),p.263 : «... in the Karneia, dissimilar in this to the Hyakinthia, we can discover no chthonian rites at all : there is no grave
of Karnos, no mourning for him, no piacular ceremonies ,. Porvrr, VIII, 28, mentionne une tombe de Hyacinthe à Tarente :
A, Bnrr,rcu, Gli eroi Greci (supra, n. t7), p. 85, i, 24,rzz. PAUS., fr 44, z mentionne une pierre pyramidale servant au culte d'Apollon à Mégare : L. R. FenNrr-r,, oP, cit.
(supra, n. rr8), p. r35.rz3. Cette caractéristique est mise en évidence par Peus., IX,24, Z.rz4. Peus,, YII,22,4. Cf. S. G. Mrlmn, loc, cit. (supra, n. 46), p. 244.rz5. Paus., YIl, zz, 4 et YlI, zz, z.rz6. Cf. déjà O. JeuN, op. cit. (supra, n. r), p. cxty. Contra.' A. FuqrwÂNcr,rn, inFR III,p. 146, n. r, et p. r57.
32
22. Cratèreen cloche.
Cleveland 24534.(Cat. 17.)
moderne. Dans l'esprit des Grecs, l'important n'était pas la fête, mais le dieu à qui elle
était consacréel2?. Cette présence mystérieuse du dieu dans la fête - l'épiphanie - Calli-maque, dans l'Hymne à Apolloz, l'exprimera par le charme magique de l'incantationl28.
Dans la représentation figurée, le pilier et son inscription traduisent la même réalité divine,mais à une échelle plus modeste, et sur un plan strictement visuel.
Sur le cratère de Cleveland (Cat. ry)rla relation entre Ie pilier inscrit et les personnages
est plus compiexe, à mohs d'admemre que la jeune femme représente Aphroditel2e. Dans
ce cas, toute difficulté s'évanouit, mais la scène, avouons-le, serait d'une grande banalité.En écriçant son nom sur le pilier, le peintre aurait cédé à une mode facile - d'autres images
amesrenr qu'il en a été parfois ainsi - et 1a légende ne ferait que doubler, inutilement, 1a
représentation flgurée.
-{OPO-\ITH est un nominatif : la déesse est ici sujet, non complément. Par conséquent,
il ne peut s'agir ni d'une dédicace, ni d'une consécration13o. Mais quel rôle la déesse joue-
rz7. D'après U. voN §ÿ'rr,a»towt"îz, op. cit. (supra, n. rr7), p.535, Karneios, par opposition à Karnos, signifieraitprécisément le dieu de la fête.
rz8. On pourrait rapporter au pilier inscrit ce que Schefold dit de la divinité dans la peinture pompéienne : « DieGottheit wird mehr in ihrer §ÿirkung als in ihrem Sein geschildert, wie im Apollonhymnus des Kallimachos » (K. Scurrolo,in Neue Forschungen in Pompeji [1975], p. 56).
rz9. C'estf interprétationhabituelle:APSadloc.;G.ScnNsI»rn-HrnnuauN,BABesch45,rg7o,p.94;S.Hrr,r,rn,loc.cit.(supra, n. q),p.9z; H. R. W,Str^rru,Funerary SymbolisminApulianVase-Painting(1976),p.r37,p.zo4,pp.zo7-zo8et pp. 229-z3o; C. G. Boulrux, h CVA ad loc.; K. ScuaueNnunc, Festschrift für F. Brommer (stqra, t. r), p. 248, n. 17.
r3o. Contra : S. G. Mrr,rsn, loc. cit. (supra, n. 46), p. 247 : ,. ... musst be an aniconic image of the goddess ,. Mêmeinterprétation : K. Scnrror,o (d'après G. ScnNrr»nn-HERRMANN, BABesch 45, r97o, p.94, î. zo) et S. }JTLLER, loc. cit,(supra, n. 9), qui s'appuie sur Paus.,I, r9, z : 'ca,5cr1ç [scil. 'Àçpo8ir1c,) yù.p oTi1t t pèv ;etpi.y<,rvov xrxrù. raôtù. zai roîç'EppLaîç... Les hermes de Tégée (supra,n,46), auxquels Miller se réfère,offrent, certes,unparallèletroublant,maisils cons-tituent précisément un cas exceptionnel.
33
t-elle dans f image ? L'identité de la jeune femme assise sur le coffre ne peut être élucidéede manière objective. Eros et le miroir, qui dénotent la sphère aphrodisienne, onr placeprès de la déesse, mais aussi près des mortelles occupées aux soins corporels. L'accumu-lation de ces signes - sans même parler de l'inscription - serait une curieuse redondance,s'il s'agissait d'Aphrodite en personne. On voit mal, d'ailleurs, où une telle scène seraitlocalisée. Le coffre suggère que l'on se trouve dans le gynécée, monde par excellence des
espoirs amoureux, mais aussi des angoisses passionnées. C'est le lieu où la femme, livréeà elle-même, consacre toutes ses pensées à Aphrodite et, aussi, à la conservation de sa
beauté. Eros, qui vient de se poser devant elle (ses ailes ne sont pas encore immobiles),s'apprête à lui remettre un ruban. Cette parure doit servir un but précis : comme la « cein-ftr1s » d'Aphrodite chez Homère131, elle rendra celle qui s'en munira invincible en amour.Absorbée dans sa contemplation, la jeune femme n'a pas même remarqué la présenced'Eros I c'est sur sa propre image qu'elle fixe ses regards. Mais ne devrait-elle pas apercevoiraussi, réfléchie dans le miroir, le nom de la déesse, écrit sur le pilier ?
AOPOAITH : ce n'est pas le titre de la représentation, mais plutôt l'objet des préoc-cupations de la jeune femme. On pourrait dire que la scène est ainsi placée sous le signed'Aphrodite. Non seulement la jeune femme est représentée, très concrètement, entreEros et le pilier d'Aphrodite, mais, psychiquement, elle est centrée sur la déesse. Si l'onpeut, une fois encore, proposer un rapprochement avec la poésie, c'est Sappho qu'il convientd'évoquer13z. Dans 7'Hymne à Aphrodite, l'intervention de la déesse s'opère sur différentsplans, mais le caractère intérieur de la vision ne diminue en rien la valeur réelle de l'épi-phanie133. Dans la scène figurée, le nom écrit sur le pilier enrichit celle-ci de tout un contenupotentiel vers lequel convergent non seulement la sphère de pensées de la jeune femme,mais aussi celle du spectateur. Le message verbal, même s'il s'insère dans un contexteiconographique, transcende celui-ci et donne à l'imagination du spectateur un nouvelélan qui n'est pas nécessairement lié à la représentation elle-même. (A suiore.)
J.-M. Moner.
r3r. 1l', XIV, r87-223. Sur cette « ceinture » (en réalité : xeotà6 [pciç) voir A. Lns«v, op. cit,(supra,n. r5),pp. r8-r9.La forme ionienne surprend sur un vase de Tarente (1es hampes du H, qui convergent vers le haut, donnent l'impressionqu'il s'agit d'un A, mais les photos de détail prouvent que le peintre a écrit H). Est-ce l'indice d'une réminiscence homérique ?une allusion au monde de l'épopée ? Un tel éclectisme dans les formes dialectales est, cependant, courant sur les vasesd'Italie méridionale, et il a souvent embarrassé les commentateurs. Cf. E. Buscaon, in FÀ lll,p. r7z et, d.,une façon générale,P. Knerscn.urn, op. cit. (supra, n. z), pp, zzo-224.
r 3z ' Voir A. BoNNARD, La ciailisation grecque,I (t954), pp. r o2-r 03 : u . . . la passion et la poésie de Sappho obéissentà des appels ténus, à ce qu'on peut appeler des u signes,.., La présence totale obéit à I'appel du signe particulier. Le signenous lie à l'obiet, il nous assuiettit à lui... Cette poésie des signes - ce symbolisme au sens premier du mot - est aux anri-podes de la poésie descriptive. Un signe n'est pas un signalement ».
r33. Cf. G. AuRELro Pntvttrna, Quad, Urbin., 4, 1967, p. 5r : « Owiamente l'epifania è la proiezione di uno statoemotivo ), et T. KrRscHER, Hermes, 96' 1968, p, 14 2 « Das bedeutet, dass die Gottheit nicht mehr in jenem pragmatischenSinn hilft wie bei Homer, sondetn auf eine verinnerlichte rùteise, psychisch. » De même A. LEsKy, op. cit, (supra, n. r5),p. 56.
34
UN ANCÊTRE DU PHYLACTÈRE :
LE PILIER INSCRITDES VASES ITALIOTES
(2" partie)
r)
Cat. 19. Hydrie lucanienne du British Museum F 9z : OPEXTAX sur pilier dressé entre une femme
avec hydrie et Oreste assis ; derrière lui, une femme tenant une bandelette (tg. r).Peintre de Brooklyn-Budapest. 37o36o (RVAp I, tolt5; APS, p. z6f z, pl. 8/:: ;
H. B. §(/alters, Catalogue of the Greek and Etuscan Vases,lY [1896], p. 56, pl. III).Car. 20. Amphore panath. lucanienne de Naples H tl55 (inv. 8zr4o) : AIAMEMNON sur colonne
funéraire dans la scène de rencontre entre Oreste et Electre (: face A) (fig. z et 3).Peintre de Brooklyn-Budapest. 36o-35o (ICS, p. ü51597; L. Séchan, op. cit.,fig. z6;H. Sichtermann, RM 78, tg7r, pl. Sllz).
L'épisode mythologique qu'elle illustre étant bien connu134, l'hydrie du British
Museum (Cat. 19) joue un rôle capital dans la démarche herméneutique. Ici, au lieu de
partir de l'inscription pour identifier les figures, on peut, à l'aide des personnages dont
l'identité est sûre, préciser le rôle et la portée du pilier inscrit. Le nom d'Oreste suffit à
éclairer le conrexre. L'éphèbe nu qui est assis contre le monument funéraire et qui brandit un
glaive nu dans la main droite est évidemment le fils d'Agamemnon. L'arme, par sa couleur
blanche (qui s'est presque complètement efacée) attirait d'emblée le regard : signe parlant
au moyen duquel l'imagier dévoile les événements à venir. Les deux porteuses d'offrandes, les
1or1g6por, se iustifient parfaitement, même si aucun indice ne permet d'individualiser Electre.
On a peine à imaginer qu'une telle image ait pu dérouter les commentateurs. « Scène
d'offrande autour de la stèle d'Oreste », lit-on dans le Catalogue du British Museum185.
Et pourtant §(Ialters, qui avait l'original à portée de main, ne pouvait ignorer qu'une colonne
peinte en blanc, contre laquelle Oreste est adossé, marquait l'emplacement de la tombe136.
r34. L.SÉcueN,Etudessurlatragédiegrecquedanssesrapportsareclacérarnique(rgz6),pp.86-9g;A.D.TRENDALL,T. B. L. \PEB5rER, op. cit. (supra, n. 99), pp. 4r-44 ; K. ScHAUENBURG, in Kunst der Antike (suqra, t. 4ÿ' p- 3781328 etp. l8+l ZZz ; H. HorrueNN, ibid., p. 3gS I 34r t C. IsLER-KERÉNvI, ibid., p. 396.
r35. H. B. 1ÿarrsns, Catalogue of the Greek and Etuscan Vases in the British Museum, IV (r8q6), p. 56. Culted'Oreste à Tarente : ARIsr., Mirab. ro6. Cf. S. §hor, op. cit.(supra,n.47)'pp.333-339; M. DELCoURT, Légendes et cultes
de héros en Grèce (t942), p. 59.n6. APS, p. 26, Cf. aussi K. ScuÂurNnunc, Festschrift für F. Brommet (supra, n. r), p. 248.
235REV.,IRCH.,2/r979
1. Hydrie.British
MuseumF 92.
(Cat. r9.)
Distinct du monument funéraire, le pilier sert uniquement à préciser le nom de la figureavoisinante. De façon identique, les peintres et sculpteurs du Moyen Age insèreront, dansleurs paysages et dans leurs scènes fi.gurées, des banderoles contenant le nom des person-nages, des paroles prononcées par ceux-ci ou, encore, une légende explicative. On parleraitvolontiers de phylactère, sur le vase également, si une telIe dénomination ne risquait deréduire la valeur objective du pilier. Or, rien ne permet d'affi.rmer que la bande réservée,contenant l'inscription OPE»TA», ne soit qu'une n étiquette ». Il n,est pas rare, sur lesvases du peintre de Brooklyn-Budapest, qu'une stèle et un pilier bas soient iuxtaposésdans une scène funéraire137. L'idée d'utiliser la surface réservée du pilier pour y apposerle nom du protagoniste devait s'imposer tout naturellement à l'imagier, qui, nous le verrons,a inséré des inscriptions sur bon nombre de représentations figurées138. Dans notre dossier,cette image constitue une importante pièce à conviction, car elle montre que le pilier inscritne peut être assimilé partout à la tombe, et que l'inscription n'est pas toujours une épitaphe.
Àttribuée au même peinrre, l'amphore de Naples (cat. zo) offre, de la même scène,une version plus conforme à la tradition iconographique. Electre est assise sur la base dumonument, tandis qu'oreste s'approche du côté opposé. Le nom du défunt, ATAMEMNCTN,
r37. Ex.: amphore panath. de Muqich 3z6z (J. 84) eCS, p. tt4l5go, pl. Sgl+-9.r38. Cf, Cat. zo, 2t,22 et 24,
236
2 et 3. Amphore panathénaique.Naples H ry55.(Cat. zo.)
est écrit sur la colonne. L'emploi du nominatif est extrêmement fréquent, sur les stèles
funéraires, pour désigner l'occupant du tombeaul3e. Le génitif, attesté sur la péliké d'Exeter1ao,
suppose un mot sous-entendu, o'!plæ ou dplpoq. Dans un cas, l'accent est mis sur le tombeau
lui-même, dans l'autre sur le défunt1a1. Le peintre attique a placé le nom sur la base dumonument funéraire, et il se lit horizontalement. Ce n'est pas une imitation de la réalité,
car les stèles conservées révèlent que les inscriptions étaient placées, presque touiours,
r39. E. Scnwvze*., Griechische Grammatik, II (rq5o), p. 65; V. Lannrt», op. cit, (supra, n. r8), pp. 433-434;G.KLAFFENBAcTt,op.cit.(supra,t.zr),p.5S.D'aprèsB.Scnwerrznn,op.cit.(supra,n.a6),p.r27etpp. r33-r34,I'usagedu nominatifne se serait imposé à Athènes qu'avec la renaissance de la sculpture funéraire, à la fin du ve siècle, et cela sous
I'influence de l'Ionie.r4o. PéIiké du peintre d'Iéna (ARVZ, p. r 5 r 6/8o ; R. M. Coor, Greek Painted Potteryz lr97z], pl. 5o). Sur le skyphos
de Copenhague 597, du peintre de Pénélope (ARVZ,p. r3or l5 ; CVA,8, pl. 35r ; P. ]acoesranr , Die melischen Rehefs Ug3rf ,pp. r8r-r8z avec i11. ; A. D. TnrNoer,r,, T, B. L. WEBsTER, op. cit. fsupra, n, 99], III, r, z), le nom s'interrompt avec lesecond NI (ÀIÀX,IEX{), ce qui crée I'illusion de la rondeur de la colonne. Nom du défunt au génitif sur lesstèles : \ÿ. LÀRFELD, op. cit. (su?ra, n. r8), p. 435.
r4r. Le datif est attesté, exceptionnellement, sur les stèles, pour le nom du défunt : §(/. Lenrnro, op. cit. (supra,
l; i,tJ;l 436, et A. §7Iruou.r, Beitriige zur griechischen Inschriftenkunde (r9o9), p. 67. C'est le datif des dédicaces et des
237
dans la partie supérieure1a2. On n'observe pas la moindre recherche de vraisemblance chez
le peintre de Brooklyn-Budapest. Le nom se déroule sur la colonne, selon un procédé constant
dans f imagerie, sauf qu'ici il faut lire de bas en haut et non de haut en bas143. Le nominatif,,
parfaitement conforme, on I'a vu, à l'usage antique, rappelle que le nomreprésezre le person-
nage au même titre que I'effigie. Sur un vase apulien illustrant la même scène, la tombe
d'Agamemnon est surmontée d'une statue en armes, qui est censée représenter le héros
défuntlaa. L'alternance entre la statue et le nom inscrit prouve qu'ils ont tous deux même
valeur et qu'ils remplissent, au sein de f image, une fonction similairelas.
Mais les personnages sont-ils vraiment ceux que requiert la situation légendaire ?
Le nombre des porteuses d'offrandes n'est pas en cause, car les imagiers ont pu, comme
Eschyle, donner des compagnes à Electre. Dans la tragédie, c'est tout le chæur des xolgdpouqui l'entoure au moment où elle accomplit les rites de libation en l'honneur du roi défunt.
Mais les adolescents ? les figurants masculins ? Se iustifient-ils de la même manière ?
Oreste, on le sait, rentre incognito au pâys, guidé par le vieux pédagogue et accompagné
de Pyladera6. Dans la mesure où il s'agit de porteurs de bagageslaT et d'écuyers, les autres
membres de l'escorte ne sont pas en contradiction flagrante avec la donnée du mythe. Maisles éphèbes du vase ne remplissent pas de fonction précise. Par leur âge (absence de barbe),
leur aspect (nudité héroîque) et leur attitude (debout ou assis autour de la tombe), ils rap-pellent les habituels visiteurs des scènes funéraires. Comme eux, ils s'appuient sur une lance,
le regard fixé sur la tombe ou perdu dans le lointain; ils ne sont pas engagés dans une
véritable action. A propos des scènes funéraires, on s'est demandé si l'âge indéterminé des
figures, leur sexe et leurs traits interchangeables n'évoquaient pas, par anticipation, la
condition des bienheureux dans l'au-delàla8. Sans nous âventurer aussi loin, nous admettrions
volontiers que l'identité formelle entre la scène mythique et les autres images de « réunion
autour de la tombe » recouvre une identité sémantique. On pourrait même se demander si
les peintres de vases n'ont pas volontairement remodelé l'épisode légendaire sur le schéma
couramment utilisé dans les scènes de libation funéraire. À l'image purement narrative,
celle qui ne mettrait en scène que les personnages requis par le mythe, se substituerait une
image n actualisée », c'est-à-dire une image dont l'action pourrait se situer n'importe où
r42. De même sur les hermes : notamment ceux de Tégée (supra, n. 46),r43. C'est tout à fait exceptionnel, mais l'authenticité de f ilscription doit-elle être niée pour autânt ? HEYDBMANN
(AZ, 1869, p. 8r/a) et TRENDALL (ZC§, p. rr5) estiment que le nom d'Agamemnon est antique, alors que ceux d'Oreste etd'Electre sont iugés de façon contradictoire,
r44. Cratère en cloche de Tarente 46o5, du peintre de Sarpédon (RVA7 l, 7 l3 ; ESI, B 16r, pl. 3o a ; E. PenrnrNr,op. cit.fsupra, n. 88], pl. 17 couleur ; L. Fontt, Letteratura e arte figurata [r966], fig. ro4).
r45. La même alternance entre le nom et la stâtue se retrouve dans la scène du serment de Pélops et Gnomaos :
cf, I"e partie, p, 30 et n. 116.146. Sur Iè rôle du pédagogue, qü semble avoir supplanté le Talthybios du mythe ptimitif : C. Rornnr, Bild und
Lied (r88r), p. 165, et L. SÉoreN, op. ci t. (supra, n. r34), p. gz.r47. Voir les images du peintre des Choéphores : A. D. Tnruoatt, The Choephoroi Painter, in Studies Presented
to D. M. Robinson,II (r953), pp. r 14-r26 ; Io., lC.S, pp. r r8-r26.r48. M. SCHMIDT, op. cit. (supra, t. 35), pp. zz-26,
238
et n'importe quand dans la vie quotidienne. On ne devrait plus alors parler de la valeurparadigmatique du mythe, archétype de toute scène funéraire, mais plutôt de l'« actuali-sation » du thème légendaire, c'est-à-dire de son adaptation aux schémas funéraires courants
et de sa réinterprétation en fonction des croyances et des coutumes contemporaines. Lascène des Choéphores montrerait ainsi, de façon exemplaire, comment les peintres italiotesont su accommoder le répertoire mythologique hérité de la Grèce aux besoins de leurs clients,
car, en Italie méridionale, les vases ont servi essentiellement - sinon exclusivement - à
accompagner les défunts dans l'au-delà.
c)
Cat. zr. Amphore panath. lucanienne de Naples H 2868 (inv. 81735) :
NOTOI MOAAXHI{ TE KAI A>OOAOAON I]OAYPIION KOAIIOIÀ OIAITOAAN AAIO TIOI{ EXOsur bande réservée entre deux éphèbes drapés tenant un bâton (: face B) (fig. 4 et 5).Peintre de Brooklyn-Budapest. 37o36o (ZCS, p. tt4l59z; J. V. Millingen, Ancient UneditedMonumentsfrSzzl,pl.34t C. Robert, Oidipus,I [r9r5], pp. 3-4, fig. r-z).
Cat. zz. Amphore panath. lucanienne du Louvre CA 3o8 :
NOTQr MEN MO^AXHHIKO^IIQI A OI^IIIO^AI\[sur colonne funéraire dans une scène réunissant deux jeunes porteuses d'offrandes et unéphèbe avec lance et bandelette (: face A) (fiS. 6 et ).Peintre de Brooklyn-Budapest. 37o36o (ZCS, p. ttof 572, pl. 5615-61 R. Ginouvès,Balaneutikélrg6À,p. z6z,pl.471146; C. Robert, op. cit., p.5, fig.3).
L'équation, en l'occurrence, se compose de deux constantes (le décorateur des vases
et le distique mentionnant Gdipe) et d'une variable (le contexte iconographique). L'amphoredu Louvre (Cat. zz), qui n'a conservé que Ie premier hémistiche de chaque vers - et encore,
de manière incomplète - atteste que l'omission de MEI\, sur le vase de Naples (Cat. zr),n'a été qu'un oubli. Mais pourquoi cette épigramme à Gdipel4e ? Pourquoi son apparitionsur ces vases150 ? Et pourquoi l'alternance du décor figuré dans lequel elle s'insère ?
La tradition manuscrite nous a transmis la même épitaphe, avec toutefois des noms
différents151. Chez Ausone, qui n'a fait qu'adapter en latin des modèles grecs, le distique se
r49. Parmi les historiens de Ia littérature, seul IJ. von §7rr,ÀMowrrz semble lui avoir prêté attention : voir le chapitreu Gdipe à Colone », dans le livre de Tycho von §ÿrr-aiuowtrz, Die dramatische Technik des Sophokles (r9r7), pp. 327-],28.Cf. aussi Die hellenistische Dichtung,I (t924), p. r3r, et Hesiodos. Erga (t928), p. 47.
r50. Sur les vases attiques, les stèles funéraires ne comportent pas d'inscriptions (quoi qu'en dise E. Prunr, op. c/r.lsupra, n.2], pp. 35-36), ou seulement des inscriptions factices. Voir notamment le peintre dit précisément n des Inscrip-tions , : ARVL, p,748. De petits traits verticaux, alignés, constituent l'ornement de ces stèles pseudo-épigraphes (cf. aussiARV2,p.735ltoo). Remarquons,toutefois,queG.Deux, BCH9o,t966,p.74r,frg,3,mentionneunlécytheattiqueàfond blanc, dont la stèle porterait une épigramme.
r5r, Le rapprochement a été fait par J. V. Mu,r,rNcrt, Ancient Unedited Monuments (r8zz), pp. 86-89, pI.35-36,qui a publié I'amphore de Naples (Cat. zt). Mais c'est Letronne qui a attiré l'attention du monde épigraphique sur ce distique(Journal des Sauants, aoÛt r 827, p. 5or). Il figure dans les /GIY,84zg [Curtius], et, depuis lors, dans presque tous les recueilsd'inscriptions.
239
.L.l-.:..q e; e 4lÿtt;ji.qÉiâ,iâ,t,à;iË)iÉ,
?;!e 6aâlé dl; ri;iÉ à ;;; : ; :::
4 et 5. Amphore panathénaïque. Naples H 2868. (Cat. zl.)
rattache à la tombe des Troyens Hippothoos et Py1aios152. A en croire Eusrarhe, les deuxvers figuraient déià sous une forme anonyme chez Porphyre153. L'idée s'est imposée depuis
t5z. Epitaphia XXI :
Hippothoum Pyleumque tenet gremio infi,ma tellus :Caulibus et malztîs terga superna üircnt.
Nec ztexat cineres horti cuhura quietosDum parcente manu molle holus excolitur,
Dans la Préface au lecteur, AusoNn explique lui-même comment il en est venu à composer ces épitaphes : Qzaeantiqua cum aput philologum quendem re/Perisse?n, LaTino sermone conaerti, non ut inservirem ordinis persequendi (tracat),set ut cohercerem libere nec aberrarem (Ausonii Opuscula [éd. R. Punrn, r886], p, 7z).
r53" EusrArH., p. r698, [email protected]. À 532) : àr,à xai. ô ciogoàe).àq i) ogoSe).à6 ôpxei,a.cur. vezpoïq ô'uà.rà npàq c.ilvoæo8àv ôpou6gorrov xai èguceÜeco èv.roïç r&.cpor.ç cà rouoürov g,rr6v, ôq à1),oî xai, rr, rôv rccrpà cô iloi:gupiqùèntypappcitt"v, )'-éyov ô6 &ttô tvoç raçov 6cr. vcôcco pèv p.u}.æy.1v xcri. dog6ôe).ov zo).üpu(ov, x6l,"qu àè càv '»d;và
ëXco. D'après H. Scanoroen, Hermes 14, r879, pp, z3r-252, le passageenquestiondeponpnyns (:fr.14:ibid.,pp.z37-238) proviendrait non des Zrp\p"aca, mais du traité llepi, rôv rcapa),.eÀer,plprévorv cQ zroulrfr ôvop&,r<ov. ôontra :
H. ERBSE, Zetemata 24, t96o, p. rz6.
240
longtemps que l'épigramme faisait partie dt Péplos pseudo-aristotélicied5a. Mais en relationavec quel nom, celui d'CEdipe ou celui des héros troyensls5 ? Les deux hypothèses sont àenvisager, et il ne semble pas qu'on puisse trancher dans I'état actuel des connaissancesls6.
Il y a plus grave : la signification intrinsèque du distique nous échappe15?. Quel rapport a-t-ilpu exister entre la mauve et l'asphodèle, d'une part, Gdipe ou Hippothoos et Pylaios,
d'autre part158 ? L'aspect formulaire de l'épigramme, la facilité avec laquelle on peut faire
entrer p.a}i.aq et &ogôàeÀoç dans un hexamètre, l'incertitude qui règne quant au nom
du destinataire, invitent à la réserve, voire au scepticisme. Nous sommes en présence de
r 54. Voir déià O. JenN, op , ci t , (supra, n r ), p. cxxw, n. 9 14. C'est EusraruE encore qui nous apprend que Porphyrea tiré du Péplos les épigrammes qu'il rapporte (p. 285, rg ad Il. B 558) : locopeî àè ô aôcàç flopgüpr,oç xai 6cr, 'Apr,otoeé),1qoüyypaprp.a æpa"yprereuodçr.evoç, 6æep èx).101 néæ).oq, yevea).oyûcrq ce ilep6vov èlé\eæ xai vsôv Ëxl.ott.iv dpr,0pr.àv
xai èæ,4p&ppltu ei.ç aôtot5ç, &. xai &vuypdLgecær, ô flopgüpr,oç êv toi6 eiq càv "Opr.1pov, &a),& dv'cu xei oüàév tu za7,rixai, gÀeypraïvov é7ovta. ôiorr,7,a àè cù 6).cr êxeiva 8i,7a roü p1Oévcoç ei6 tôv A'lavræ (: fr.4: Scunoroen, loc. cit.,p. 234). Fragments du Plplos : V. Rosr, op. cit. (supra, n. 3r) ; Io., Aristoteles Pseudepigraphus (r86f), pp. 563-579. Unemonographie sw \e Péplos fait toujours défaut : I'article Aristoteles, .RE, suppl. XI [Dùring], n'en parle pas, bien que lecorpzspseudo-aristotélicien soit étudié en détail (co1. 3rz-3r8). Force est de se reporteràE.\PENDLING, DePeploAristo-telico (r89r); M. Scunrrr, Philologus 4, 1866, pp. 47-7r; C. A. FoRBEs, in RE, s.v. Peplos, col. 56r-562 [r937]. Parmi lescommentaires récents : §7'. KULLMANN, DieQuellen der llias (r96o), p, tzr,etE. Hrrrscu, Hermes 96,tg68-ry69, pp. 64r-66o, notamment pp, 6ÿ-657,
r55. HippothoosetPylaiossontnommés,commechefsdesPélasges,dansleCataloguedesTroyens(11.II,84o-843).Pylaios n'apparaît plus par la suite; Hippothoos est tué par Ajax, alors qu'il cherche à entraîner Ie cadavre de Patrocle :
11. XVIII, 289 et 3r3-318.156. Et cela d'autant moins que l'auteur du Péplos a repris plusieurs épigrammes composées antérieutement :
E. Hnrrscn, loc. cit. (supra, n. r54), pp.654-656.r57. Lesversd'HÉsrooe (Op.+o-+r),oulamauveetl'asphodèlesontévoquéesconiointementrsonténigmatiques.
Les jugements contradictoires portés dès l'Antiquité sur le pouvoir de ces plantes sont surprenants, mais la polarité recouvrevraisemblablement des conceptions d'époques différentes. I. Cnrnlssr, Elementi di culture precereali nei rniti e riti greci (t968),a soutenu l'idée que ces produits typiques d'une civilisation horticole avaient été reietés après l'introduction de la clr éalicuhure,De fait, le distique ajouté par AusoNe (supra, n. r 5z) à l'épigramme grecque apporte, à première vue, une éclatante confirma-tion à la thèse d'I. Chirassi. Mais y a-t-il là plus qu'une troublante coincidence ? Ou Ausone a-t-il déià trouvé dans sa sourcele modèle de ce second distique ? Sur le mythème de la plante, généralement le tubercule,'jaillissant du cadavre :
Ad. E. JrNsrN, Mythes et cuhes chez les peuples primitifs (r954) ; Io., Die getôtete Gottheit (r966) ; M, Etttts, Histoire des
croyances et d.es idées religieuses,l (rSZ6), pp. 49-Sr etpp.3g9-4or. I1 est, certes, tentant d'établir une relation entre la plantepoussant sur la tombe et le pouvoir fécondant reconnu, par les Grecs également, aux morts héroïsés : V. Ja. Pnorn, L'alberomagico sulla tomba, in Edipo allaluce delfolklore (trad. ital., r975), pp. 5-39J notamment p. 34; E. Ronor, Psychez (1898),p.247. Ala thèse d'I. Chirassi, on objectera précisément que la mauve et l'asphodèle n'ont pas donné naissance à des mythesde métamorphose. Contre R. PecENsrEclrER, Unteritalische Gtabdenkmiiler (r9iz), pp. 36 sqq., notamment p. 39, K. ScEAUBN-
BURG a iustement souligné le caractère purement abstrait, symbolique, des plantes représeqtées à l'intérieur du naïskos sur lesvases funéraires (RM 6+, 1957, pp. zoo-zo3). Sur la mauve et l'asphodèle dans les prescriptions diététiques des pythago-riciens : M. DETTENNE, Les Jardins d'Adonis (rglz), pp. 8g-ga. Cf. aussi Pr.ur., Mor. r58 A (: Sept. Sapient. Cona. 14) :
offrandes de mauve et d'asphodèle sur l'autel d'Apollon Délien.r58. Nombreuses sont les épigrammes ou la tombe est censée s'adresser aux passants : J. Grnnc«nN, Studien zum
griechischen Epigramm, in Das Epigramm (éd. Pfohl, r969), p. 24, n.9 ) §tr. LuDwrc, Platons Liebesepigramme, ibid., p.63,n. i6. Cf. J, Lanannr, Aspects gnomiques de l'épigramme grecque, in L'épigramme grecque (supra, n. 24), pp. 360-36r, elR. Lerrrrronn, Themes in Greek and Roman Epitaphs (rg4z), p. 232, n. r27. Autres exemples : rù7. PEEK, Griechische Vers-Inschriften(supra,n.3o), nos 76, trr, t1z,5o5, 558, 585, 586, 588, 59r, 5%,767,789, ttTt et rgro; E. HorrueNN, Sy//ogeEpigratnmatum Graecorum (1893), nos 44, 48, 54 et 56; Anth. Pal. Y11,26, 2r7, 2r8, 447 et 7r9. Mais il ne m'a pas étépossible de retrouver ailleurs l'antithèse vôcç/x6),2<p. En revanche, on rencontre fréquemment x6)ototç ou ürcô xô),rcou6seul : rÿ. PEEK, op. cit., nos 29,558, 568, 6Æ, 749, 760,764, 774,806,8o7, 983, r4o3, t446, t5r8, 1542, 1583, 1756, 1775,r78t, 1782, 1982, 1987, 1999. Cf. J. GrnrcxnN, loc. cit., p. 36, n. 73 et p. 38, n. 8o; R. LArrrMoRs, op. cit.,p,243 et IJ. voo Wrr,euo\$fiL, op, cit, (supra, n. 64), pp. 2r4-2r5. Dans les épigrammes v6rq» est exceptionnel, mais il estattesté chez Eunrnror déjà : rÜppou' rci vôc<p (Hel.84z), Les fleurs sont souvent mentionnées dans les épigrammes : W. Pnm,op.cit.,îos84o,r4og,t447,rg7o,2oo';Anth.Pal.Y\56oiÿ11,22,23,3o,315,32o,485,536,657;IX,3r8.Cf.E.Porrtrn,Etude sur les lécythes blancs attiques à représentations funéraires (r889), p. 68 ; R. PAGENsTEcHER, op. cit. (supra, n. r57), p. 39 iK. Scneuexsunc, loc. cit. (supra, n. r57), p, zoo, r. 39 ; R. LÀrrIMoRE, op. cit., pp. r29-r3o. Sur cet usage : Evx., El. 324,5rr et 895 ;Ptrt., Leg. X17,947.
241
|;V.
ri
6 et 7. Amphore panathénaïque.Louvre CA 3o8. (Car. zz.)
vers « passe-partout », dont la signification, parfaitement anodine, pouvait s'adapter à
n'importe quelle personnalité du mythe. rüilamowitz a déployé beaucoup d'ingéniosité pourexpliquer la pointe de cette épigramme : Gdipe ne possédant pas de sépulture, l'inscriptionse rattacherait à une tombe qui, précisément) ... n'existe pas15e. L'auteur du distique n'y a
pas mis, je le crains, tant de subtilité160.
Est-ce par malice, ou par opportunisme, que le peintre lucanien a inséré cette épi-gramme dans sa scène funéraire ? Le contexte héroîque est clairement indiqué lCat. zz)par les offrandes multiples dont s'orne la tombe, notamment par les accessoires guerriers,cnémides et bouclier. L'éphèbe qui est en train de nouer une bandeleme autour du monu-ment presse une lance contre son épaule. On peut admettre qu'elle servira, elle aussi,d'offrande au mort161. Quand bien même elle ne serait que l'attribut du jeune guerrier quila porte, la lance dénote la sphère héroïque162. C. Robert, qui croyait à la réalité de la tombed'Gdipe, et à celle de l'épigramme transcrite sur les deux vases, reconnaissait Polynice et
r59. Voir le chapitre « Gdipe à Colone » du livre de Tycho von rJ7rr,luowrr? (suîtra, n. r49).16o. Ou doit-on considérer qu'il s'agit d'une épigramme-devinette, dont la pointe consisterait précisément à laisser
dans le vague le lieu de la sépulture ? Sur les épigrammes-deünettes : R. RErrzENsrErN, Epigramm und Skotion (t293),pp. 94-96 i C. Onrnnr, Ràtsel und Râtselspiele der ahen Griechenz (r9rz), passim, noramment pp. r43-r45, pp. 153-r54tpp. 169-170 et pp, 2t2-213.
16r. Sur le cratère à volutes de Bari 1394, proche du peintre de l'Ilioupersis (RVA4I,8/ror, pl. 65/r : détail), ialance est appuyée contre la colonne surmontant le tombeau,
16z. Voirl'amphorepanath.deNaples}Izr4T(inv.8zr38),dupeintredel'Ilioupersis(RVApI,8/26),etl'amphorepanath. de Naples H 1755 (Cat. zo).
242
Antigone parmi les porteurs d'oflrandes163. Cette interprétation a été généralemenracceptée164. L'idée d'un culte héroïque célébré par les descendants d'Gdipe sur la tombe decelui-ci, me paraît d'autant plus artificielle que les traditions concernant la mort du héroset la localisation de sa sépulture étaient contradictoireslGs. Le mythe, sous la forme canoniqueque la tragédie euripidéenne lui avait donnée, faisait disparaître Etéocle et Polynice avantmême la mort d'Gdipe166. Certes, on peut se demander si une telle logique est de mise dansun monde de représentations où la loi des genres et diverses traditions, notammenr la tradi-tion iconographique, imposaient un certain nombre de conventions. S'il est vrai que les
âuteurs d'épigrammes n'ont pas craint d'en forger pour des tombes inexistanteslG? et des
héros fictifs, pourquoi les peintres de vases n'auraient-ils pas imaginé des cérémonies funèbresen l'honneur de héros qui n'étaient pas l'objet de cultes réels ? Le caractère fictif de la scène
(c'est-à-dire l'invraisemblance d'un culte rendu à Gdipe et l'impossibilité d'une tombe luiayant appartenu) ne suffit pas à ruiner la thèse de C. Robert, du moins pas au niveau del'interprétation iconographique. Mais une constatation de fait rend cette hypothèse peuprobable : les images empruntées au mythe d'Gdipe sont extrêmement rares en Italie méri-dionale. Si l'on songe à l'attrait que le personnage avait exercé sur les peintres attiques,au vle et au ve siècle, on ne peut s'empêcher de prêter une signification particulière au silencedes imagiers italiotes. Il est peu vraisemblable que le peintre de Brooklyn-Budapest aitconçu sa scène en fonction du héros nommé dans l'épigramme. Le schéma, d'ailleurs, est
des plus banals : ni Ie choix de celui-ci, ni le nombre des figures, ni leur aspect individuelne trahissent la volonté d'illustrer un épisode déterminé du mythe. Cédant à son penchantpour les inscriptions, l'imagier a individualisé, par ce truchement, une scène par ailleursanonyme; il a « héroïsé » le contenu funéraire en y insérant le nom d'Gdipe par le biaisdu distique. L'importance d'une telle « héroïsation » ne doit pas nous échapper, même sielle est indépendante de la genèse de l'image. Dans cette corrélation exceptionnelle entre
163. C. Roranr, Oidipus, I (r9r5), p. z, et fig. r-3 : Polynice et Antigone. L. §ÿ. DALy (RE, suppl. VII, col. 786)considère ôomme fortuit le lien entre Gdipe et l'épigramme.
164. NotammentparTnrN»er,r,,LCSad loc.'EtéocleetAntigone.L'incertitudequantàl'identitédel'éphèbeestrévélatrice.
r65. Les divers cultes que les témoignages mettent en relation avec Gdipe ne sont pas, précisément, localisés sur satombe : sacrifice offert aux fils d'Gdipe à Thèbes (PÂus., IX, 18, :-+) ; culte d'Gdipe et des Erinyes de Laîos à Sparte(Hor., IV, r49) ; culte de l'oracle de Laîos à Eléon (Hor., V,43). Voir L. R. I,-enNerr, Greek Hero Cubs (r9zr),pp.332-334 tL. PRELLER, Griechische Mythologiea (r 8S+), p. 84o, n. 3 (: p. 8+r ) ; M. Drr.count, Gdipe ou la légende du conquérant (1944),pp. 97-ror. La tombe d'Gdipe était localisée à des endroits diférents : Etéonos (schol. Sopn., O.C. gt); Aréopage (Peus.,1,28,7)t Colone(Sops., O.C.,passim). Cf. M.P. Nr.ssoN, op.cit.(supra, n. 3), p. r88; \ÿ. Bunxrnr, op. cit.(supra,n.t5),p.318, etL.§fl. Dr.r-u,loc, cit,(supra, n. 163), col. 785-786. C. RoBERT a lui-même contestél'existence d'un culte et de ritesfunéraires en l'honneur d'Gdipe à Colone (op. cit. fsupra, n. 1631, p. 33 ; ID., Heldensage lsupra, î. g6l, p. gor). Conta :J. Drr-onur, op. cit. (supra, n. r5), p. 448.
r 66, C'est Ia version d'Evn., Phoen. r 7o3 sqq. Chez Sona., O.C., passim, et Ant. gor ,Etéocle et Polynice surviventà Gdipe.
167. Plusieurs exemples dans le Péplos : oôpr,a ôè rôvroç iy,er. (no z5 et no 32, Rose). De même : èni, zevoragiou(no 20 et no 28). Cf. aussi Anth. Pal.YII,247 avecl'oxymoron&0artoçlritçL6a(Pwr.,Flam.9 donne la leçon v<irqu aulieu de tüçr,pqu). RutzrNstuN, op, cit. (supra, n, r 6o), p, 9r, y reconnaît une épigramme fictive, précisément. Sur ces pseüdo-épigrammes : RErrzENsrErN, op. cit., pp. ro6-ro7, Mais on a d'authentiques exemples de cénotaphes dotés d'inscriptionsfunéraires : §t. Prnx, op. cit. (supra, n. 3o), no 4z (de Corcyre) et no rr75 (de Smyrne).
243
le nom mythique - fût-il choisi au hasard - et la scène d'offrande funéraire, nous décelonsle premier indice d'une participation possible du défunt, que ces vases devaient accompagnerdans la tombe, au destin privilégié des dÀpr,or, üp..Çrur.
Mais qu'en est-il de l'autre vase (Cat. zr) où le distique apparaît sur une bande réservéeentre deux éphèbes drapés ? De l'identité du texte, on est tenté de conclure à l'identité dumonument : puisque, sur l'amphore du Louvre, c'est la tombe qui porte l'inscription, etque, par surcroît, on a affaire à une épigramme, la traduction pilier : stèle funéraire nes'impose-t-elle pas16e ? L'enjeu est d'importance, car le même motif (des éphèbes se faisantface de part et d'autre d'un pilier) se retrouve sur un nombre considérable de vases italiotesl?o.La valeur funéraire du pilier inscrit, à supposer qu'elle puisse être démonrrée dans notrecas, devra-t-elle s'étendre à ceux-ci ? Remarquons tout d'abord que l'image contenantl'épigramme figure au revers du vase et qu'aucun indice extérieur ne permet d'affilmer queles éphèbes sont réunis autour d'une tombe. On ne voit d'offrandes ni dans leurs mains,ni contre le pilier. Sur l'autre face, en revanche, il est manifeste que la ieune femme destineà la tombe le ruban qu'elle tire de son cofret171. Mais où est la tombe ? Entre les deux person-nages, on voit seulement un motif floral qui sert d'axe à la scène. La valeur funéraire estgarantie par les nombreuses images où un semblable rinceau figure à l'intérieur d'unnaïskosl72. La branche d'arbre que le second visiteur tient à la main est, elle aussi, uneoffrande funéraire. L'épigramme transcrite sur le pilier du revers apporte à la scène prin-cipale, elliptique dans sa formulation, une sorte de commentaire explicatif. On pourrait direque le pilier inscrit et la plante stylisée sont des frgurations n métaphoriques » de la tombe.Sur la face principale, la plante se substituerait en quelque sorte au monument architec-tonique dont elle n'est, le plus souvent, que l'ornement intérieur. Au revers, l'épigrammeévoque précisément les plantes qui recouvrent les tombeauxl?s. Dans toute métaphore,l'identification avec le nouvel objet n'est rendue possible que par un déplacement du senspremier. C'est pourquoi sa valeur se limite au seul cas particulier. Il en va de même sur lesvases. Le peintre s'est ingénieusement servi, pour transcrire l'épigramme, de la banderésersée du pilier, qui devient, par ce biais, représentation abrégée ou u symbolique » dela tombe. Mais il s'agit d'une rencontre fortuite; le lien entre le pilier et l'épigramme s'estcréé a posteriori. Trouvaille heureuse d'un imagier, l'assimilation du pilier à la tombe n'estpas extensible aux images où les conditions nécessaires à cette identification - ici réuniesde façon exceptionnelle - ne sont pas remplies.
r68, Voit Pruo., O/., II, ro9-r49. De même sur la tablette d'or de Petelia (G. ZvNrz, Persephone [r97r], p. 368) :xai rôr' drer,c' &[)J,ouor, g.e0'] f pôeoouv &v&Zer.[c].
169. Ainsi F. Hausen, RM 25, r9ro, p. 285, n. r.r7o. Parmid'innombrablesexemples:LCS,pl.4zl4;pl.64lz;APS,pl.14164;pl.r5l7z;pl.rgl%-y4'pl.zzlto5-
ro6 ; pl. 291r34 t pl. 3o/r4o ; pl. ZSlrl4.r7r, Pour la typologie de cette porteuse d'offrandes : cf. Cat. 20 et 24.r7z. K. ScHÂUENBURG, RM 64, tg17, pp. r98-zzr ;Io., Opus Nobile (supra, n. g3), p. r34.r73. Lefait qu'Eustarnr (su|ra,n. r53) cite le distique à propos des vers 538-539 d.ela Nekyia prouve que la valeur
funéraire des plantes mentionnées dans celui-ci était immédiatement saisissable.
244
h)
Cat. 23. Hydrie lucanienne du Louvre N z5gg : TPQIÀO sur la stèle ornée d'offrandes et autour de
laquelle sont rassemblées trois jeunes femmes (fig. 9).Proche du peintre de Pisticci. 42o-4ro (J. V. Millinger\ op. cit.' pl. 17 ; K. Schauenburg,
BJbb t6t, 196r, pp. zr8-2r9, pl. 4zlz).Cat. 24. Hydrie lucanienne du Louvre N z5g4 : ôOINII sur le pilier devant lequel est assis un
éphèbe nu portant un bâton; à gauche, fbmme debout avec coffret (fig. 8).
Peintre de Brooklyn-Budapest. 37o36o (RVApI, roftT; I. V. Millingen, op. cit., pl. r8).Cat. 25. G,nochoé apulienne de Compiègne rozr : IAÂX sur le pilier à côté duquel est assis un
éphèbe couronné, tenant lance et bouclier (fig. ro) (§(1. Tischbein, Collection of Engrao'ings
from Ancient Vases... of Sir HamihonltTgt-t7951,IV, pl. 4g; CVA, pl. z5lr et pl. z8/3)'
L'inscription <DOINIE (Cat. z4) nous plonge dans une certaine perplexité. Ce nom
se rapporte-t-il à la figure adjacente ? A-t-on affaire à un personnage vivant ou au défunt ?
Le nom est-il bien celui du héros troyen, fils d'Amyntor et précepteur d'Àchille ? L'éven-tualité d'un nom historique, porté par un contemporain du peintre, ne résiste pas à l'examen.
Un tel emploi serait si inhabituel chez le peintre de Brooklyn-Budapest, et les exemples
attestés dans la prosopographie antique sont si rares174 qu'on peut, d'emblée, abandonner
les recherches dans cette direction. Le caractère sépulcral de la scène transparaît dans le
type de la porteuse de coffret; c'est une des figures de prédilection du peintre, qui apparaît
dans de nombreuses scènes d'offrande funéraire175. Le ruban suspendu au-dessus du piliercorrobore cette interprétation. Mais qui est le personnage assis sur son himation, le défunt
ou un visiteur ? En procédant par voie de comparaison, on s'aperçoit que le même éphèbe
nu, assis sur son manteau et tenant un bâton à la main, se retrouve comme porteur d'offrandes
dans d'autres représentations similaires. Parfois, il tient encore à la main la couronne qu'ildestine au défunt176.
Le contexte iconographique garantit la valeur funéraire du pilier, et, partant, ce1le de
l'inscription. Mais pourquoi le nom de (DOINII ? Selon toute évidence, ni la jeune femme,
ni l'adolescent n'ont un lien quelconque avec le héros homérique dont la stèle et l'épitaphe
apparaissent ici de façon inattendue. D'après les Nôotor,, Phénix mourait en Thrace, et
Néoptolème se chargeait du soin de sa sépulturel?7. Mais la tradition est muette sur unéventuel culte rendu à Phénix, et, à l'époque historique, sa tombe ne paraît pas avoir été
l'objet d'une attention particulière. Une fois de plus, on constate une relation arbitraireentre le nom mythique et la scène funérairel?8. L'imagination du peintre a-t-elle été stimuléepar la vogue des piliers inscrits ? Circulait-il déià, à cette époque, des recueils d'épigrammes
r74.Yoir rW.Perr,G.E.BENsELER,LVôrterbuchilergriechischenEigennaruerf (r884),pp. t64r-t642.ry5, C|. supra,t. r7r. De même sur I'amphore panath. de Naples H 2868 (Cat. zr) et sur celle de Naples H zr47
(supra, î. r6z). Voir aussi I'amphore panath. de Copenhague Chr. VIII, 7 QC3, p. rr4l59r, pl. SS/6).176. Ex.: amphore panath. de Naples H zt47 $upra, n. 162 et î.r75).r77. PRocLUs rro Kullmann. Sur Phénix, voir aussi EusrÂrH., p.762,43.r78. Cf. supta, p.238, à propos de I'amphore panath. de Naples H r755 (Cat. zo).
245
8. Hydrie. Louvre N 2594. (Cat.24.) 9. Hydrie. Louvre N z5gg. (Cat. 23.)
célébrant les héros morts devant TroielTe ? Une chose est sûre : le choix de Phénix étaitjudicieux. D'une part, le personnage était assez connu pour rendre la scène attractive ;d'autre part, il jouait un rôle suffisamment effacé, dans l'épopée, pour permettre au peintrede ne pas se compromettre en insérant son nom dans une scène funéraire18o.
C'est encore à une pseudo-scène mythologique que nous fait assister l'hydrie duLouvre (Cat. z3). I1 semble que le nom de Troïlos aurait dû inspirer au peintre une compo-
r79, Phénix est mentionné par Hygin dans le Catalogue des Achéens (Fab. 97 ; Phoenix Amyntoris filius Argiz;usnaoibus L). M. Scnuror, loc. cit. (supra, n. r 54), en a déduit qu'une épigramme lui était consacrée dans le Péplos, Sur l'ordredes épigrammes dansle Péplos : cÊ. ibid.,pp. 47-7r.
r8o. Phénix a été mis en scène à plusieurs reprises par les poètes tragiques, notamment par Euripide dans Ia tragédieintitulée précisément OoivuE (cf. T. B. L. §7rnsrrn, TheTragediesof Euripideslrgîil,pp. 34-85),etparunpoèteinconnu.,.] 1v68<»poç (TrGF1, r54). Phénix est représenté sur plusieurs vases apuliens, rrotamment : cratère en cloche fragroentairede Heidelberg z6 .87, ût peintre de Sarpédon (RVAp I, 7l5 ; ESI, B 163, pl. zg ; CVA z, pl. 7Z); fragment de cratère encalice d'Oklahoma, IJniversité C SI+SS (4. D. TnaNoer.r., T. B. L. §/rasrrn, op. cit. lsupra, n. 991, III, 3,42) ; cratère àvolutes de Boston o38o4 Qbid.,l11,4, z).
246
10. Gnochoé.Compiègne rozr. (Cat. 25.)
sition particulièrement tragique, où Hécube, sa mère, Polyxène et Cassandre, ses sæurs, se
lamenteraient sur la tombe du jeune garçod81. Rien de tel en l'occurrence : la scène reste
anonyme dans sa conception, et les trois porteuses d'offrandes, d'âge et d'aspect rigoureu-sement identiques, n'incarnent certainement pas des héroïnes de la guerre de Troie. Il y a
une sorte de contradiction entre l'allusion mythologique - en lisant le nom de Troï1os182,
le spectateur revit toute l'aventure du jeune garçon : 1a chevauchée, la rencontre avec Achille,la poursuite et, finalement, la mott cruelle - et l'action représentée, conventionnelle etbanale. L'eflet tragique résulterait-il précisément de la disparité entre le passé glorieux etle présent, quelques femmes rassemblées autour d'une tombe, alors que le héros n'est plusqu'un nom18B ? On pourrait se demander, inversement, si les peintres de vases n'ont pas
r8r. Voir,danscecontexterlecratèreàvolutesdeBarir3g4(supra,n. r6r),oîrlevieillardàcheveuxblancssoutenupar un intendant donne à la scène funéraire une coloration mythologique (cf, M. Scnmmr, op. cit. lsupra, t. 351, p. 23 :
pas de vieillards, normalement, dans les scènes funéraires) : Priam sur 1a tombe d'Hector ?
r8z. Troilos, comme nom propre, est rarissime : W. Panr, G. E. BsNsnr,rn, op. cit. (supra, n. r74), p. 156r. Voircependant W'. Pm«, Griechische Vers-Inschriften (supra, n.3o), no 14o6 : épigramme du rrre siècle après J.-C. à un défuntTroilos.
r83. L'épitaphe XVIII d'AusoNE est consacrée à Troilos. De même l'épigramme de TzETzEs (ap.Itiarte z6z) :
Tpôi),ov êvOÉàe Tpt»ictà1 1i Âctpàavoç ioXo (Th. Brne«, Poetae lyrici Graeci,Il3 [r866], p.65».D'aprèsM. Scur,rror,op. cit.(supra,n r54), p, 62,1e Péplos contenait également une épigramme à Troïlos. Cf. aussi Eusre:rn., p. 448 (ad Il. §) zÿ.
247
trouvé là une solution de facilité. En s'en remettant au pouvoir de suggestion des nomshéroiques, ils pouvaient se dispenser de dessiner des scènes compliquées, sachanr que lespectateur compenserait, par sa propre imagination, le défaut et la pauvreté de l'imagerar.
L?ænochoé de Compiègne (Cat. z5) a été partiellement repeinte, mais la srèle porranrf inscription est, semble-t-il, intacte. L'originalité du nom est un argument en faveur del'authenticité. Car un restaurateur ou un faussaire aurait certainement ajouté une épitaphedont une autre représentation lui aurait fourni le modèle, et il n'aurait pas donné au À cetteforme incertainelss. On ne connaît pas de personnage historique ayant porté le nom d'Idas186 .
la connotation héroïque de la scène paraît donc assurée. Mais qui est l'éphèbe représentéà côté de la stèle, un visiteur ou l'occupant du tombeau ? Le rapprochement avec les tombessculptées et les lécythes à fond blanc ferait penser au défunt. Dans l'imagerie funéraireitaliote, cependant, celui-ci est généralement isolé dans sa sphère; il ne se mêle pâs auxsurvivants, fût-ce par le biais d'une visio#87. Le naïskos qui l'enferme matérialise cetteséparation entre les deux mondes. Les armes qu'on lui voit à la main ne contredisent pascette interprétation, car on a d'autres exemples où les visiteurs portent, à titre d'offrandes,de semblables attributs188. De toute manière, visiteur ou occupant de la tombe, le personnagen'a pas été conçu en rapport avec le nom peint sur la stèle18e. La scène de l'ænochoé auraitfort bien pu ne pas comporter d'inscription : d'innombrables vases italiotes en témoignent.Si, toutefois, l'héroïsation du mort s'est opérée par ce truchement, l'épitaphe a non seulementun sens, mais elle fournit la seule n clé » permettant de déchiffrer ce langage funéraireénigmatique.
Un détail est particulier à ce documenr : la valeur « obiective » du pilier est soulignéepar les moulures dont s'ornent sa partie inférieure et sa partie supérieure, et aussi par lesoffrandes qui y ont été déposées. Par cette auualisation, le pilier perd sa valeur ambivalenteet devient, irréversiblement, monument funéraire. Les scènes tombales constituent ainsi
r84. Le fait que Ie peintre n'ait pas reptésente de visiteurs masculins constitue une anomalie, car, normalement,Ies scènes funéraires réunissent des porteurs d'offrandes des deux sexes. Autre exemple analogue : I'amphore de Bonn,inv. 99, du peintre de Varrese, avec quatre ieunes femmes autour de la tombe oir Niobé se métamorphose en iocher ( RVA\ l,r3/3 ; A. D. TRENDALL, loc. cit. lsupra, n. 8S], p. 3t5, fr}.4 ; M. Scuuror, op. cit. fsupra, r\.:Sl, p. +o, pl. 3z a). Sur ceproblème: A. D. TntNoatt, loc. cit., pp.3r4-3r5: et M. Scnilrror, op. cit.rp.4r, n. ro5.
r85. L'Asouslaforme^estattestédansl'épigraphie.Entreautesexemples:M.P.N[ssoN,op.cit.(supra,n.3),pl. ztlz.' r86. Tous les exemples de W, Panr, G. E. BeNser,sn , olt. cit. (supra, n, rl+), p. 534, se rapportent à d.es personnagesdu mythe. Voir cependant §Û. Prr«, Griechische Vers-InschriJten (supra, n. 3o),no t436 : épigramme d.u rr"-ru" sièclè après J.-C.à un dénommé "I8aç.
t87. Cf. Ire partie, p. 12 et n. 37.r88. Àinsi sur l'amphore panath. de Ruvo, J 425, du groupe de Ruvo 423 (RVAq r, r5l4z; H. srcrrnnuaNN,
opt. cit. fsupra, n. 32], p. 48, K 7o, pl, rr3).r89. Idas est cité par Phénix dans sa mise en garde à Achille (Hon., 1l. IX, 553-564). Cf. aussi Eusrern., p. 776, rz.
Idas avait-il une épigmmme darrsle Péplos ? Rien ne permet de l'affirmer, mais c'est le cas de plusieurs héros n,aipartenantpas au cycle troyen, notamment Aiétès (no 43), Atalante (no 44) et Orphée (no 48). Tous trois pàuraient avoir figure daus unCatalogue des Àrgonautes (cf. Hvc., Fab. 14): Atalante par le truchement de Méléagre ? ia scène du vase,ln rout câs,n'a rien à voir avec la tombe d'Aphareus, qui joue un rôle déterminant dans le combat opposant Id.as et Lyncée aux Dioscures :PtN»., Nerz. x, 67-72; Tneocn, XXIr, r4r, tgg et 2o7-2o9; Hvc., Fab. go. Tombe d,Idas : paus,, III, 13, r (s. §fmr,op. cit. fsupra, n. 47), p. 3ÿ).
248
11. Canthare.British Museum.
98.7-tz.r.(Cat. 26.)
un groupe à part, où la liberté d'action des peintres était singulièremenr limitée, et l'appel à
l'imagination du spectateur réduit dans une mesure proportionnelle.
i)
Cat. 26. Canthare lucanien du British Museum 98.7-tz.r : ATIA sur le pilier près duquelonvoirun éphèbe avec thyrse (: face A). II^ANON IAIPE sur le pilier à côté duquel se tientun éphèbe appuyé sur un bâton (?) (:face B) (fig. rr).Groupe de Schwerin. 39o-38o (ICS, p. 68134r, pL. 3z16).
Cat. 27. Lécythe pansu apulien du British Museum F rrr : ET]TTXiA sur le pilier près duquelest assise une femme tenant une ciste ; éphèbe nu avec strigile debout devant elle (fig. rzet r3).Groupe de l'Amphore de Dresde. 36o-35o (RVAp I, trltTz).
Cat. 28. Lébès gamikos lucanien de Berlin F ÿ97 : )O<DQN sur pilier contre lequel s'appuie unefemme (Athéna ? ou Amazone ?) armée (: face A).Contexte du groupe de Minniti. 39o-38o (l,CS, p. 72b65, pl. ::/8).
Cat.29. Gnochoé de Foggia rz9.3z8: FHPAKÀHTO» EOHKE sur le pilierauquels'accoudeune jeune femme à qui Eros tend une bandelette (fig. r+).Fabrication locale. 33o-32o.
La salutation X*îpe (Cat. z6), si fréquente sur les vases attiquesleo, n'est guère usitéeen Italie méridionale ; quand d'exception elle apparaît, elle revêt une signification très diffé-rente1e1. Ce déplacement de sens est révélateur. À Athènes, l'invitation s'adresse au spec-
rgo, « yuige is one ofthe commonesr words on vases , (J. D. BEAZLEÿ, AJA lZ, 1929,gp.Z6lt6q). Ex. : amphoredu Louvre G 42, dePhintias(ARV2,p.4lr):
^ENIOITPÀTE +AIPE fotlAt; amphore de Münich 4og (J.4ro),
d'Euthymidès (ARV2,p. zllà: +AIPE @HtEVt; cratèreàÿolutesdeserraOrlando,d'Euthymidès (ARVL,p.2ÿlro)l+AtIlPE +ÀIPE SOIIA I+AIIPE; stamnos de Mùnich 2405 (1.352), dt peinrre de §fürzburg 5r.j çZnVr,p. 3o5/r) : *AIPE tV. Cf. E. Pnuur., op. cit. (supra, n. 2), p. 35.
r9r" cratère en cloche de Lecce qs (RVAq l, 14116o; cvA z,IV, Dr, pl. z4l8; M. scHMrDr, op. cit. {supra,n. 351, p. 25).
tateur - invitation à acheter le vasele2 ou à boire le contenu du récipient1e3. Le Xcrîpe des
vases italiotes a plutôt une valeur funéraire : c'est l'adieu, bien connu par les épitaphes, quele défunt adresse au survivant ou xice aersa. Epigrammes et stèles gravées fournissent unabondarit matériel de comparaisode4. Sur notre vase - un canthare, c'est-à-dire le vase à
boire par excellence - le doute subsisterait si le peintre n'avait pas précisé son intentionpar le biais de la stèle. Il est impossible de savoir si tIÂANOl\ est au nominatif ou au ÿocarif,car la graphie o peut recouvrir aussi un ro. Les deux formes sont attestées dans l'épigraphieen combinaison avec 1aîpe1e5.
Ni II^ANON, ni une autre forme apparentée, ne paraissent admissibles d'un pointde vue prosopographique. La lecture lÀocvôv, proposée par TrendalFe6, semble s'imposermalgré la présence del'apex, Ce nom peut-il être mis en relation avec celui de la cité saliennede Gaule Narbonnaise, lÀav6v1e7 ? I1 est impossible de le démontrer, mais le féminin,lÀavô, est attesté par une inscription d'Hermione1e8. Les erreurs de graphie dont les autresvases de la série fournissent l'exemple nous dispenseront de chercher des solutions rropcompliquées ou trop subtiles. ATIA, au revers du canthare, transcrit sans doute ATTIA,attesté chez Plutarquelee - ici sans redoublement du T. Toutes ces lectures sont hypothé-tiques, mais il n'est pas invraisemblable que dans les colonies grecques d'Occident la proso-pographie ait été influencée par l'onomastique indigène.
Eüru1[cr (Cat. z7) aussi bien que X69<ov (ou Xo9ôv) (Cat. z8) sont attestés épigra-phiquementzo0. L'Amazone accoudée sur la stèle (Cat. z8) a probablement une valeurfunéraire2ol. Le vase date de la fin du ve siècle, époque où le thème a connu, en tout cas àAthènes, une grande popularité. ces noms propres, qui n'ont pas de lien avec le mythe(ATIA, II^ANON, IET]TTXIA, >OOON) désignent-ils les individus pour la sépulturedesquels les vases auraient été commandés ? Nous n'en savons rien. Remarquons toutefois
r9z. Ainsi XAIPI{N KAI IIPIOMHN ou XAIPE KAI IIPIO X{E. Cf. J. D. Brezr.rv, JHS 52, re3z,p. r8z ; Io., AlA,3g, r93j, p. 476 ; R. Br.arrrn, AA, t967, p. 12 ; ID., AA, 1968, p. r ; Io., AA, r97t, p. 422 ; lD.,AA, t973, pp. 70-72 et AA, 1974, p. 67.
r93. Ainsi XÀIPE KAI IIIEI ou XAIPE KAI EI ET. Cf. J. D. Brezrrv, ClRea 57, rg43, p. roz ; K. ScsaurN-tuno, AA, 1974, pp. rg8-2o5; M. Guenouccr, op. cit. (supra, n. z), pp. 49t-4g2.
r94. Stèies : Ch. Cr,arnmoNT, op. cit. (supra, î. 3t), passitn, notamment no 39 et no 89. Epigrammes : W. Prer,Griechische Vers-Inschriften (supra, n.3o), nos 1384, 1385, 1388, r39r, et pp. 4r4 sqq. L'exhortation à saluer le mort et sontombeau est un thème favori de l'épigramme : ibid., pp.4or sqq., et R. Lerrrlaonx, op. cit, (supra, n. r58), p. z3o, § 63.Parfois, c'est, inversement, le défunt qui salue le passant : §f. PBsx, op. cit.,pp.357 sqq.; R, Larrrmonr, op, cit.,p.235,§ 65. Cf. arssi Anth. Pal.Yll,254 et 582.
r95. G.KrannrNBAcrr,olr.cit.(supra,t.zr),p.56;W.Lenrrro,op.cit.(supra,r\,rS),p.+:8;E.Scnwvzrn,op,cir.(supra, n. l3», p. 6SlP. Cf. aussi R. KüHNnn, B. Grnrn, op. cit. (supra, n. 6r), p. 46.
t96. LCS,p.68134r.r97. Pror.., Geog. II, ro, r5 (cf. §7. PapB, G. E. BENsELER, op. cit. fsupra, n. q4l, p. z5o).r98. IG lY , 73r. Cf. F. BEcHTEL , Die historischen Personennamen des Griechischen (r 9r 7), p. 589.ry9. 'Ar:'La : PLUI., Cic. 44 (mais 'Atûa : Anton.5r) et Dro Cass. XLV, r; XLVII, r7. Cf. §7. pepr,
G. E. Brxsrr.rn, op. cit. (supra, n. t74), p. t7z.zoo. Voir §7. PapB, G. E. BrNsrr,rn , op. cit., p. 428 et p. r 43 r . La partie supérieure du pilier étant endommagée,
les premières lettres du mot eücu1ia ont disparu, mais la restitution de Trendall me parait sûre.zor. P. DnvamnÊZ, RA, tg76,I, pp. 265-28o.
250
72 et 73. Lécythe pansu. Bri-tish Museum F rrr. (Cat.27.)
que tous figurent sur des vases qui appartiennent à un groupe stylistique bien défini202 :
modes et traditions d'ateliers n'ont-elles pas joué, ici également, un rôle déterminant ?
L'ænochoé de Foggia (Cat. z9) occupe une place à part dans la série, car c'est unproduit indigène. Le peintre d'Ascoli Satriano, à qui elle est attribuée, a décoré une trenrainede vases provenant de la même nécropole. Cet artiste, de souche locale, a été fortementmarqué par Astéas, Python et le peintre de l'Oreste de Boston. Le rapport entre le pilierinscrit et la scène figurée est encore plus problématique que sur les autres représentations.Car ici les trois éIéments - l'inscription, le pilier et l'identité des figures - ont un contourfuyant. Le texte lui-même est énigmatique dans sa formulation laconique. 'Hpd,zÀ1roÇ estIa forme dorienne de 'HpdxÀerto6203 : nom dépourvu de toute résonance légendaire etemprunté, manifestement, à la vie de tous les jours. Alors qu'dvé01xe désigne de façonunivoque la consécration à une divinité2oa, lï"qxe appartient aussi bien au langage de l'épi-
zoz. voilaussi le skyphos de Sydney 53 . 3o, proche du groupe de Schwerin (lcs, p. 7ol 352, pL.33/r -z), oîr Ie nomde la figure, ATPA, est écrit sur le vêtement, gonflé comme une voile.
zo3, Cf. W. Pana, G. E, BENsELER, op. cit,(supra,n. r74),p.47o, s.u. Voir aussi V. ÀneNcro-Rurz, A. Or-rvrenr,op. cit. (supra, n. 7), pp. 73-76 et p. ro7 : inscriptions datant de roo av. ].-C. Même conrracrion d.e ee en 4, au lieu de er,en dialecte arcadien : E. HorrmeNN, op, cit. (supra, n. r58), p. r49, et K. Rnolraros, loc. cit. (supra, n. 461,p. r52,n. t.
zo4,Tt0éva4 dans le sens de « consacrer , (pour dvarr.0év«u), est exceptionnel. L'exemfle, souvent-allé-gué, deOd, X[I,347, n'est pas probant, non plus que celui d'Eun,,, Phoen. 576. Voir cependant P. A. HANsEN, op, cit. (supra, n. 4z),p. z4t no z7 4, et IG 12, 7or,
2s1
14. Gnochoé.Foggia n9 328. (Cat. 29.)
i
iq.r§;\::::,:::-:ùlÀ'i;.r.;:i}:l:El
;:"ailiÈ,iiillr;lË;
ruqriliii+illr-i §-
sr§6jËàir::1is.ll.q Ëii-:.P.!\§rsrq,§;ȧlîffi
ffi
gramme funéraire2o5 quâ celui de la dédicace votive2o6. Mais, normalement, le verbe estaccompagné d'un complément au datif (le destinataire ou 1e bénéficiaire) et d'un aurre àl'accusatif (l'objet oflert ou consacré)2o7. La forme du pilier ne nous est d'aucun secours, car,sur les vases italiotes, il désigne alternativement un tombeau ou un sanctuaire. La mêmeambiguité se retrouve au niveau iconographique : la jeune femme est-elle une adorante, àqui Eros apparaîtrait tandis qu'elle prend quelque repos dans un lieu saint ? Ou est-elle
zo5'. Ex. : oc1).1v ô'èn'a_ütÇ [olptart] 0!xe (hcûSrpLoq oogdq (§7. Ptxx, Griechische Vers-Inschriftenfsupra,n.3o),lj z4 : vr" 1i!:ct9)^; p1{pa èni Nauoux),eî u9 rcrlùe I{'ü),o,,o'1poç é}rpet (ibid.,no r38 : vre siècle); éaponor+1p
"Z»"ë01xe èæi Muvd.ôar, (ibid., no r53 : vre-ve siècle). cf. ibid..,ç1o,'isq, rsz, t63, r78, r93, r97, 2o4, 2o5, ztl, zz4, 227, 2zg,237, 24r, 244. De même l'épitaphe pour Archiloque :
'Ap7,iÀoXoq llctpuo6 Te),eor,z),éoq èv0d.àe xeitarcô À6xupr,oq pvlpliov ô Neozpé<ovroç 16à' é04zev
(G. Dau, BCH 8s, 196r, pp. 846-847; A. E. Reuarrscrer, Das Denkmal-Epigrammfsupra, n.241, pp. r5-t6). ë}nxe,dans le sens d' « ensevelir », est attesté surtout à époque tardive : §7. Parx, op. cît.,nos 3o3,3o7,3o8^et 3rr. Mais un exempleauvre siècle av. J.-C. :ibid.,no 287 Qt-qrépa. égnxe).
zo6. Entre autres exemples :
Tcio8e y' 'ÀO1vcriar àpa[Xpr]àq (Davdpr.oro6 ë0r1xeI{épat re, hoç xui xèvoç ëy-ot x},éîoç üruïr.tov aiFei.
(P. Fnrnor.ÀNorn, op. cit. fsupra,n. 42), pp. 47-48, no 44; A. E. RausrrscHgx,Ioc. cit. [n. préc.], pp. 8-9). cf. aussi w. perx,op. cit., no tog.
zo7. En revanche, la formule ; nom propre I àvé1nxe, est souvent artesrée. Ex.:'A]puo.copr,ta]1ûà46 &véQr1xe etK)'1vioc6 àvé}'rye, sut les hermes de Tégée (supra, \.46 : no 3 et no 6). De même TElItfAt f-q.iNnOfiXilN rrr l" b"r. d"la colonne portant lâ statue d'Erichthonios : cenochoé du Louvre L 63 (S r66z), du peintre àu-Trophée (ARV2,p, SSgig;O' BrnNoonr, Griechische und sicilische Vasenbild,er [r883], pl. 3rlr ; G. von HoonN, C]oes and Antlhesterioltg5ii,fig. rr),
252
l'épouse - ou la fille - du défunt dont le pilier marquerait la sépulturezo8 ? On peutenvisager une troisième solution : reconnaître en elle Aphrodite qui, trônant dans son sanc-tuaire, recevrait l'hommage filial d'Eros. Le motif du pilier servanr d'accoudoir à la déesseaurait alors valeur de citation20e. Quant à la dédicace, son câractère elliptique se justifieraitpleinement, si l'on admet qu'Héracleitos avait déposé szr le pilier l'offrande à Aphrodite
- objet que f inscription n'avait pas besoin, donc, de désigner nommément2lo.
***
Le rôle ambigu du pilier inscrit, dans l'iconographie, est ce qui frappe le plus au rermede ce tour d'horizon. Le pilier n'est pas la reproduction fidèle d'un monument votif oufunéraire, tel que les Grecs d'Italie en avaient constamment sous les yeux. Mais il ne s'agitpas non plus d'un motif purement abstrait, car on peut toujours déceler quelque rapportavec la réalité, soit dans f inscription elle-même, soit dans son lien avec le support. Lesimagiers italiotes n'ont pas franchi le pas décisif et placé l'inscription dans une banderoletenue à la main par un des personnages2ll. Même 1à oir le texte se détache sur une simplesurface réservée, il est impossible d'affirmer que le peintre ne songeait pas à un pilier rée12r2.
L'alternative ne se limite pas à la simple dichotomie : réalité cultuelle ou conventioniconographique. Il existe toutes sortes de cas intermédiaires, et Ie passage de l'un à l'autres'effectue par mutâtions extrêmement subtiles. Tantôt le nom désigne une des figures de
zo8. Eros n'est pas inconcevable, en Apulie, dans un contexte funéraire : G, ScHNETDER-HERRMANN, BABesch 45,r97o'PP. ror-ro6 et M. SCHMIDT, op. cit. (supra, n. 35), p. 37, Eros comme porteur d'offrandes devant une tombe : amphorepanath. de Genève, du groupe de Bari 559o (ibid.,p. ro8, fig. z6).
zo9. Sur l'Aphrodite accoudée et la difusion du motif en Italie méridionale : J.-M. Moxyr, AntK zr, rg78, p.78,n' 5. Si l'cenochoé de Foggia provenait des fouilles d'un sanctuaire, on pourrait se demand.er si le pilier ne porte pas, en fait,la dédicace du vase lui-même que le fidèle ('Hpdx).ryoq) aurait offert à la déesse. Ce serait un bel exemple à'utilisationréaliste de f inscription (normalement ficrive) du pilier.
zr o. Voir le commentaire de RAUBITscHEK (supra, î. zo5) à la dédicace de Phanaristos : « Das Gedicht, das auf demStein steht, auf den die Drachmen aufgestellt waren...
zrr. Le véritable ancêtre du phylactère apparaît dans l'imagerie attique de la fin du vre siècle et du début du ve :
l'inscription figure sur une taenia portée par un des personnages. Ex. I coupe du Louvre G r39-r4o, d'Apollodoros (,4RIl2,p, tzolt; E. Porilrn, Vases antiques du Loutre,Ill lrgzz), pl. rr5): KALOT sur le bandeau ceignani les cheveux d.,unéphèbe ; amphore à col de Léningrad inv. 5576, de Douris (ARV2,p. 4461266 t c. e. Grcr.rorr, loc. cît. fsupta,t 91, pl. r3lr) :
HO nAIt KÀLO\ surlataenia tenue par un porteur d'offrandes;pyxis d'Athèrr"i,4".. 56o, de Makràr @nV;,p. a79lya;B ' GRAEF - E. LANcLorz, Die antiken Vasen zson der Akropolis zu Athen lt933l,Il, pl. 43) : HIIIIIOÀ.i \tl Kj 1-n s"r tabandelette portée par la ieune fiIle. Dans le domaine apulien, on mentionnera le cratère à volutes de Münich :268 (J 8o5), dupeintre de Sisyphe (RZlp I, r/5r ; lP.§, p. 9lr ; ESI,p. 4!147, pl. r9 et pL. zolr ; A. FuRrwÂNGLEn, FR II, p. zor, pi. 98),oùlafeuilletenueparundespersonnagesportelenomXIIY(DOX.VoiràceproposA.vonSarls, ô7h39,rg5z,pp.gr-92.
zrz, La même ambivalence caractérise l'éiément porteur de f inscription à d'autres époques et d,.rns d'auties genrespicturaux. Voir, entre mille exemples, le Timothée de Jan VaN Evcx (Londres, National Gallery) : le bloc de pierre portantf inscription appartient à un niveau de réalité différent de celui du portrait lui-même, puisqu'il estlun des éléme1ts du cadre et,par conséquent, un intermédiaire entre l'espace du spectateur et celui de la représentation. Mais'la main droite de Timothée,qui s'avance en direction du spectateur au-dessus de ce bloc, incorpore celui-ci à sa sphère de représentation (cf. S. SeN»-srnôu' Levels of Unreality [r 963], pp. 62-63 et fig, 23, p. zzr). Le Saint Sébastien de Manregna, au Kunstmuseum de Vienne(Mantegna. Classici dell'arte Rizzoli lr967f, no 43 et pl, XI), porte la signature du peintre sur le pilier adossé à la colonnedu martyr. Par un gottt antiquisant propre à l'époque, et à Mantegna lui-même, l'inscription est d.isposée verticalement(technique kionedon: cf. I'e partie, p. ro) et rédigée en grec : TO EPION TOT ANAPE O]]I. L^ brll, des bandes dessinées(c'est-à-dire I'espace dans lequel se transcrivent les paroles proférées par les protagonistes) est, elle aussi, traitée parfois« comme un objet réel qu'ot peut saisir, heurter, dégonfler.. . » (P. FRESNAULT-DERUELLE, Le verbal dans les bandes dessinées,Communications 15, rg7o, p. 14ù,
253
clË
a.ooo.
u
o
d13
ô'ü
N...:d
À)odÉ9
od
9€
È'ü;og=:-d
dÔON
o-:dd;()a '.ôtÀ
'dH
btrlBAÊL)
dl
ôraà<"ÉÀ
Z.ErMlu
o§; II{
§.oE!
Ii
00
(nO
4Z-ci<4; ^Lfrt à
()ti..ô
i'i o. oÈ E€ O8S3 ËA-k-'-H olâ P
€ Ïs €Êil, È
hr-N
+j!(d(!UO
HoNN!Ucg sB
UC)
1,2̂\-,zâH
-
o\ocô
o
N\O t--H
(B(Ëd(, Q (.)
+rL'-Z Z<C CO-h ôeË E<F F
;j(dk()(,)
H
.{)IE(,)!cgp.È
Nkrh()
()ÈEBtu?e
Éi trl Ehz FF= foÉr \J 'x\J\7.(.)
O\+ NHN N
+, +i +jcg ri cü(JO C)
C)a.d
)Êe
I
xoo!
Êa
c.)
oF-cô
oo O\O HHH
js+j ü(Üqü(!cËOOO L)
nrn (J<orr(41 j< l-ÈÈ* EzzÉ <
60&o4aEE
o00m
\o ooNNÊ!cÉ(€OC)z
z
\8.vhz-A)- \4.-:< Â
FF{ O
!
-"k() _.BËo95V)E(.) {)
!.É(J
!voËoo\cî
N.+H
cËHUO
()
IcÉ
(,)!o)â=zôP^
Acs à'= - ô.9,o 6
o
o.c),v8,o.
LÇi sÉtâê;
oo.t
H N .ô +h\OHHH
9!9€9!cü6r§ci(§(€UO O UU U
nJùN
27,,, 'rn Oôc E -^ E>=É:11<ào-o- Âl *z ùri rn ;..i <,2 4i i
- i'^' lFF F 'àU È<
o'ÿâ'svd
8ü H gVHL
â'd Ë üsË; E!gr!.9ÀÀÈÈ
oH.f
aô côHN
99(i<do(,
4;+^*à--1-t /-n
MÊ,
(.)'dÈ:tv (-)o9'EEÉk
254
C)
araEJol:\F-rqàÈrÇ7
t{a\t-
la scène (Cat. r3-r5), tantôt une divinité qui n'est présente qu'au travers de l'inscription(Cat. 16-18) et que celle-ci a pour fonction précisément de re-présenrer. L'utilisation dupilier comme ancêtre de Ia « bulle » est exceptionnelle (Cat. rz). L'épigramme d'Gdipe(Cat. zr et zz) montre que le même texte peut entrer en combinaison avec divers typesde réalité iconographique. Dans les scènes funéraires, le sens du pilier n'est pas ambigu :
il est significatif qu'une colonne - qui n'a pas la même ambivalence que le pilier - se
substitue parfois à celui-ci comme couronnement de la tombe (Cat. zo, zz et z3).
La part de réalité et la part de convention se trouvent souvent dans un rapport para-
doxal. Là où le pilier désigne l'objet lui-même (TEPMON), la valeur sémantique de
f inscription est double et le sens véritable se situe à un niveau second. Le pouvoir iconiquele plus marqué appartient au pilier dont le nom désigne la figure placée à proximité(Cat. 13-r5). Le pilier qui renferme les paroles d'un des personnages (Cat. rz), c'est-à-direcelui dont la réalité concrète est la plus contestable, récupère sa valeur objective par le geste
de la femme qui prend appui, matériellement, sur lui.Le rapport hiérarchique entre le pilier et son inscription n'est pas moins élastique.
Dans aucun cas, on ne peut affirmer que l'un n'existe qu'en fonction de l'autre. Le motTEPMON (Cat. i-7), par exemple, serait superflu, s'il ne servait qu'à désigner l'objet quien est le support. Cette réversibilité apparaît de façon évidente grâce aux deux vases quireproduisent l'épigramme d'Gdipe (Cat. zr et zz). Dans la scène de libation funéraire(Cat. zz)r le texte se subordonne à l'image, car le distique ne fait qu'individualiser, sur leplan mythique, une scène banale dans sa formulation. Au revers de l'amphore de Naples(Cat. zr), en revanche, l'épigramme devient l'élément essentiel de la représentation : lalecture du texte prend le pas sur celle de l'image. Jamais, cependant, Ie signe linguistiquen'évince complètement le message iconique; il est partie intégrante de celui-ci, et la signi-flcation de Ia scène résulte de l'action combinée de l'un et de l'autre. Le mot écrit ayant unpouvoir symbolique supérieur, sa mise en æuvre permet à l'imagier ce que la seule figurationn'est pas à même de communiquerzls.
En raison de ce caractère ambivalent, toute tentative de réduire la série à un typeunique est vouée à l'échec. La diversité sémantique est d'autant plus remarquable que legroupement stylistique est parfaitement homogène et cohérent21a. En Apulie, les principauxillustrateurs du motif ont été le peintre de Graz (Cat. 6 et ry)r le peintre d'Eton-Nika(Cat. 8-ro) et quelques tout proches collaborateurs. En Lucanie, on observe la mêmeconcentration autour de certains peintres et de certains ateliers : dans l'entourage du peintredePisticci (Cat. 13 etz3), chez le peintre d'Amykos et ses imitateurs (Cat. r-3 et rz), dans
le groupe intermédiaire, et, tout particulièrement chez le peintre de Brooklyn-Budapest(Cat. ry-zz et z4). Le motif s'est donc imposé en Lucanie plus tôt qu'en Apulie, mais il ne
zr3. On pourrait dire du pilier des vases italiotes ce que P. FnesNeur,T-DERUELLE, loc. ci r. (n. préc.), p. r5o, écrit de Iabuüe des bandes dessinées, qu'elle « réalise une translâtion entre deux codes..., le code iconique et le code linguistique ".
zr4. Voir le tableau synoptique ci-contre.
255
semble pas avoir été importé d'Athènes. C'est une création proprement italiote, et il est
signiflcatif que le peintre de Pisticci, qui est probablement un décorateur athénien émigré,n'a pas lui-même cédé à cette mode iconographique,tu.
Le motif du pilier inscrit n'a pas servi à des fins décoratives : ni dans le dessin des
lettres, ni dans la disposition du mot au sein d'une surface réservée, ne se manifeste lamoindre recherche esthétique. Tout au contraire : les lettres se serrent, le plus souvenr,dans un espace trop exigu, les peintres ne se donnant pas même la peine de calculer à l'avancela place que le mot occupera sur le pilier (ex. : Cat. 4 et 2r). Malgré ces négligences, les
piliers inscrits peuvent être considérés comme un jalon important sur la voie qui mène de
l'iconographie grecque à l'iconographie romaine. On admet communément que ce sont les
Romains qui ont, les premiers, tiré un parti ornemental des inscriptions2l6. Jacobsthal,dans un article très suggestif, a rendu justice aux artistes grecs, en montrant qu'ils avaientdéjà expérimenté les cadres pour distinguer l'inscription elle-même de l'espace envi-ronnant2l?. Il n'en reste pas moins que les ùtuli sont une invention romaine, et c'est dansl'art de l'Empire, notamment dans l'art funéraire, que les imagiers paléochrétiens en onttrouvé le modè1e218. Les citations de versets bibliques ou de paroles du Christ, sur les
mosaiques chrétiennes des Ive et v" siècles après J.-C., devaient permettre aux fidèles demieux comprendre le sens de la représentation figurée21e. L'apparition de livres ou de rou-leaux, entre les mains des personnages, rappelle étonnamment celle des piliers inscrits surles vases italiotes. Dans les deux cas, le texte, le mot écrit, véhic;ttle une information quidonne à f image sa vraie signification.
zr5. Origine attique du peintre de Pisticci : ESI, pp. 3-5.z16. U. von §ÿ'tleu.owrrz, JdI t4, r899, p. 58 ; « Jeder weiss, dass die ornamentale Verwendung der Schrift, wie wir
sie an den Bauten der rômischen Kaiserzeit mit Recht bewundern und wie sie sich von da verbreitet hat und.., noch heutegilt, den Griechen fremd ist, » De même G, KLAFFENBAca, op. cit. (supra, n.2r), pp. 44-45 : « Bemerkenswert ist... dieUnbekümmertheit in der Anbringung der Inschrift, die es gar nicht auf eine kùnstlerische Virkung absieht.,. IJeberhaupthat die ornamentale Verwendung der Schrift den Griechen viel weniger gelegen als den Rômern... ,
zr7. P, Jecoasru{L, Zÿt Kunstgeschichte der griechischen Inschriften, in XAPITES. Friedrich Leo (rgrt),pp. 4fi-465. Les principaux exemples sont les signatures des graveurs de monnaies (pour Syracuse, dès la fin du v" siècle :
dans un cartouche, dans un diptychon ou dans tî rotulus) et les épitaphes serties d'un cadre.zr8. Il arrive fréquemment, sur les miroirs étrusques, que le nom placé en regard des figures se détache dans uae
sorte de cartouche (ex. : R. Hrnnrc, op. cit. fsupra, n. 53], pl. 46). Il s'agit, certes, d'une nécessité technique, car le fond dumiroir présente une surface rugueuse. Mais on ne peut s'empêcher d'être attentifà ce souci, plus italique que grec, d'encadrerl'inscription.
zt9, Le rouleau ou le livre avec l'inscription Dominus legem dat apparaît entre les mains du Christ à S. Costanzavers 35o (J. lVIurnr, Die rômischen Mosaiken unil Malereien der kirchlichen Bauten vom IV-XIII Jahrhundert,I [1916],p.238; I.§ÿ'ILPERT, §[, N, Scnurvracnrn, Die rômischen Mosaiken der kirchlichen Bauten aom IV-XIII Jahrhundert j976),pp, 299-3oo, pl. r), puis, vers 4oo, au Baptisrère de Naples (J. §ürr,nrnr, op. cit., pp, 23g-24o; J. §frr-prnr, rJtr. N. ScHU-MACHER' op. cit., p.3o4, pl, rr ; B. Bnrxr, Spàtantike und frühes Christentum Ugll\, frg. zz a). A S. Pudenziana, le livreporte comme légende:. Dominus Conseroator Ecclesiae Pudentianae (I. §frLpERT, §ÿ. N. Scnuua,cgrn, op. cit,rp. 3o6,pl. zo-zz ;B. Bnrxr, op. cit., frg. r 5), On remarquera que, sur tous ces exemples empruntés à la mosaique, le texte donne l'explicationde la scène, au lieu d'être celui que le livre ou le rouleau est censé contenir. En compamison, les inscriptions SecundumLucam et Secundum foannem, sur les Evangiles tenus par les apôtres, à S. Vitale de Ravenne (8. BnrNx, op. cit., fig. 34),sont banales. Sur les sarcophages, même dans la scène de la taditio /egr's, il est rarissime que le rouleau tenu par le Christcomporte un texte lisible pour le spectâteul. Voir cependant le sarcophage d'Aries, Musée d'Àrt chrétien, inv. 5 : Dominuslegem dat (sur le codex que tient le Christ), Lucanus, Matthaeus, llo]annis et Marcus, respecrivement, sur les rouleaux qu'onvoit aux mains des Evangéüstes (F. \[/. DrrcnuANN, Th. KLAUsER, Frühchristliche Sarkophage in Bitd und Wort lAntK,3. Beiheft, 19661, no 13, pl. r8/r I B. BnrNx, op. cit., flg. :Sq). Cf. aussi Th. Brnr, Die Buchrolle in der Kunst(r9o7), pp. 322i28.
256
Que nous apprennent ces images quant à l'héroisation des défunts et quant au cultedes héros ? Remarquons d'abord que, dans îotre corpus, les scènes de caractère funérairene représentent qu'une minorité. On s'aperçoit, en outre, que les cultes des héros homé-riques, dont on a des traces en Grande Grèce220, n'ont rien de commun avec les scènes des
vases où un nom mythique figure sur le pilier. Dans un cas, il s'agit de scènes de genre,
parents et amis du défunt apportant sur sa tombe les offrandes traditionnelles. Dans l'autrecas, on est en présence de rites funéraires dont le cérémonial dûment fixé221 est décrit en
détail dans nos sources. Ce que nous en savons nous autorise à écarter résolument l'hypo-thèse d'une influence de semblables cultes sur f imagerie funéraire22z. L'exemple d'Héraclès
est révélateur. Le culte d'Héraclès ne comprenait ni tombe, ni re1iques223; les honneurs quilui étaient rendus, notamment dans les palestres, n'ont pas un caractère funéraire, mais
rappellent plutôt ceux qu'on réservait aux Olympiens22a. Le terme d'heroîque n'est donc pas
tout à fait approprié. Soulignons qu'à plusieurs reprises, les vases à pilier mentionnentd'authentiques divinités (Cat. 8-9 et Cat. 16-18).
La scène des Choéphores (cf. le nom d'Agamemnon : Cat. zo) et celle de la mort deTroïlos (cf. l'inscription TPOIÂO : Cat. z3) ont connu une grande popularité en Italieméridionale; mais les autres héros dont les noms figurent sur les stèles (Gdipe, Idas)n'ont guère fait l'objet de représentations sur vases225. La sélection opérée par les peintresn'a donc pas été dictée par des traditions iconographiques. On a plutôt f impression qu'unepart d'arbitraire est intervenue dans le choix de ces noms. Cette conclusion n'est pas
forcément négative en ce qui concerne,l'héroisation des défunts par le truchement des nomsmythiques. Car, chez les Grecs, l'héroisation, comme d'ailleurs aussi Ia mort, est envisagéecomme un destin collectif, non individuel226. L'assimilation des défunts aux héros n'impliquepas une identification avec tel héros déterminé, mais plutôt une participation à un
zzo, Le témoignage 1e plus intéressant est celui d'ÀRrsrorE (Mirab. ro6: 84oa) : èv Td.p*vrr èvayL(ew xur&.:,.vaÇ Xp|vooç gaoi,v 'A;peûàu,.ç xai Tuàeiàarç xai AiaxiSau6 xai Àaepcr,&.8ac6, xcri, 'AyapepLvovi,àauq ôè Xopi,q0uolrv êæu"ce).eîv èv d[),).p lpLépq iàûry êv I v6pr.ptov el',tat raîç yuvocr(i pi yeüoaoOar tôv êxeivor,q Ouoçr.évorv.Cf. M. P. N[ssoN, op. cit.fsupra, n. rzo], p. +SZ;L. R. FenNrr.r, op. cit. fsupra, n. 1651, p. 328; §7. Bumrn.r, op. cjr.lsilpra,n. r5l, p. 3r3.
zzr. 11 s'agit, en premier iieu, d'un culte public, d'un culte officiel, réglé par la cité, non par Ia seule famille def intéressé, Voir notamment les rites en l'honneur des morts de Platées, accomplis par I'archonte (PLul., Arist.zr) : O. RovrnorN, La Religion de la Cité platonicienne Q945), pp. r56-158; M. P. NrLssoN, op. cit. (supra,n.3), p. r87 etp. r9r, Sur le rôle de Ia æ6).r,6 : §(/'. Bunxnnr, op. cit. (supra, n. r5), p. 3t4, et A. Bnrucu,Ileros (supra,n. r7), pp. r16sqq.,notarnment p. I23.
zzz. L'influeoce üttéraire, cependant, s'est exercée sur I'imagerie e, sur les cultes : L. R. FanNnr-r, op, cit. (supra,n. r65), p, 328, et W, BuR«rnt, op, èit. (supra, n. r5)r pp. 3r3-3r4. Textes littéraires relatifs aux culres héroiques : E. DrElrL,Die Hydria (rS6+), pp. r34-t35.
zz3. A,Bnnr,rcn,Heros(supra,n.17),p.23;M.Er-re»r,op.cit.(supra,n.r57),p,3o2,zz4. M. DELCouRr, op. cit. (supra, n. r35), p. 59; A. BRelrcll, Heros (supra,n. ry),p, 93,zz5. Poru Phénix, voir supra, rr. t8o.zz6, En dépit des personnalités très différentes de héros, il y a, morphologiquement, une nature héroTque commune :
A. Bner,rcn, Gli eroi Greci (supra, t. 17), p. ll+ ;V . Bun«enr, op. cit. (supra, n. r 5), pp. 3 r 8-3 r 9. D'ou peut-être l,indifférenceà un choix déterminé. De même Ch. Cr,arnrrlortr , op, cit, (supr(l, n 3 r ), p. 55, a relevé I'absence de toute correspondance entrela situation personnelle du défunt et I'épigramme choisie pour sa tombe. La mort comme destin collectif chez les Grecs :K. Seurn, Untersuchungen zur Darstellung des Todes in der griechisch-rômischen Geschichtsschreibung Q93o), passim, noram-ment pp. 9-r5 et p. 24.
257
statut -?ost mortem - bien déflni. Outre Pindare, les tablettes orphiques et de nombreuses
épitaphes, dont certaines remontent au IVe siècle avant J.-C., attestent que n'importequel particulier pouvait espérer ce sort privilégié dans l'au-delàz27.
une fois de plus, on s'aperçoit qu'entre la réalité et f iconographie, il y a un écartsignificatif. Certains des noms mentionnés sur les vases sont des noms de la vie couranre(Àtia, Glanôn, Héracleitos, Sophôn) : le pilier est censé imiter les stèles véritables où lenom du défunt, parfois quelques indications sommaires sur son origine et les circonstancesde sa mort, constituent le contenu de l'épitaphe. Mais jamais, dans la réalité, le nom d'unhéros du mythe ne se substitue à celui du défunt228. Les piliers des vases sont conven-tionnels, comme aussi la scène où ils figurent : on a affaire à des paradigmes mythologiques22e.On songe à ces autres images italiotes où le mythe n'est qu'un prétexte servant à u héroiser »
une scène funéraire de type courant23o. Les deux groupes de représentations ne peuventêtre dissociés. Promesse d'une condition meilleure pour les défunts dans la tombe desquelsils étaient déposés, ces vases à « dédicace posthume »231, équivalent n chiffré , des scènesfunéraires héroïsées, confirment noüe interprétation des autres représentations à pilierinscrit. Toutes reflètent, à leur manière, cette tendance à l'abstraction, cette recherche durt sÿmbole », par quoi les imagiers italiotes ont tenté - mais en vain - de sauver f imagerielégendaire, héritée de la Grèce, du dépérissement qui commençait déjà de la consumer.
J.-M. Monrr.
zz7. Cf. su?ra, n. 168. Voir aussi §[. Pns«, Griechische Grabgedichte (supra, n. 3o), no r44: rtre siècle av. J.-C. :
la défunte dit avoir reçu de son époux des honneuts égaux à ceux des héros (clpl*îq io6proupov ë01xev rà-v ôpdisxcpov{p<»orv). De même no 443 (deuxième moitié du Ivc siècle av. J.-C.) : oi àè xz},ôç iip<"eç [è reite est perdu) et l'èpigrammede Léonidas de Tarente (Anth. Pal. VII, 659) : ooi, pèv ëàp4 0eioLou nap' ci.vàp{or,. Voir A. Bnrr.rcn, Heros (supra, t. r7),p. 196, et M. Er,raor, op. cit. (supra, n. r57), p. 268.
zz8. Toutauplusvoit-on,danslesépigrammes,établirunecomparaisonenüeledéfuntetteloutelhérosenraisond'une qualité particulière. Ex. : §ÿ. Pxx«, Griechische Grabged,ichte (supra, \, 30), nos 2gg, 3rZ, 323,335, 360, 364, et 393 ;l»., Griechische Vers-Inschriften (supra, n.3o), pp. 5 r 7 sqq. Cf. R. LArrrMoRE, op, cit. (supra, n. r 5g), p. 97, et M. Scumror,op. cit. (supra, n. 35), p. 90.
zz9. Selon la conception des Grecs, c'est le mythe qui confère leur réalité aux événements : « §(/as kein exemplarisches(mythisches) Vorbild besass, besass auch keine Wirklichkeit , (J. THTMME, AA 196r, p.2r2,n.53). De même K. §crruoo"r,Wort und Bild (t97), p. 98 : " §Ûenn man den Toten in der Spâtklassik Vasen mit Heroenbildern ins Grab gab, so wollteman die Toten vom Glùck der Heroen teilnehmen lassen... » L,importance décisive dt nom du héros est ioulignée parM. Er,reor, op. cit.(supra, n. r57), p. 30r : «...le héros jouit également d'une immortalité d'ordre spirituei, et pré-isémentde la gloire, la pérennité de son nom. Il devient ainsi modèle exemplaire pour tous ceux qui s'efforcent de dépasser ia conditionéphémère des mortels, de sauver leurs noms de l'oubli définitif, de survivre dans la mémoire des hommes ».
z3o. Ainsi Andromède et Niobé : c|. supra, r. 85, ad finent.z3 r . voir K. scsauBNnuno, BJbb 16r, r 96r, pp. 23r-235 ; H. srcu:rrnuaNN, op. c, r. (suÿra, n. r og), p. rog. D,après
R. Larrruonr, op. cit. (supra, n. r58), p. 53, ies épigrammes exprimant, ou impliquant, l'immortalité rott lh. fréquentesen Italie (également en Egypte et en Asie Mineure) qu'en Grèce propre. La similarité morphologique entre les cultes funé-râires et les cultes héroïques, en Grèce, a certainement contribué aussi à l'héroisation d.es défunts : A. Bnri,rcn, lieror(supra, n. r7), pp. 8o-9o, et §7, Bun«rnr, op. cit. (supra, n. r5), pp. 3r5-3r8.
Pour l'envoi de photos et l'autorisation de les reproduire, je suis redevable à G. Becchina (Bâle), J. D, Cooney(Cleveland), M. Mazza (Foggia), B. F. Cook (Londres), A. De Franciscis (Naples), E. De ]uliis (Tarente), P. V. Glob(Copenhague), Ch. Grunwald (Bonn), C. Lapointe (Compiègne), G. Le Rider (Paris), F. G. Lo Poro (Tarente), ]. G. Szilâgyi(Budapest), F. Villard (Paris), P. Zanker (Gôttingen), F. Zevi (Naples).
Le Pr A. D. Trendail m'a fort obligeamment communiqué, avant même 1a parution de l'ouvrage, les renvois àRVAP L Sans sa générosité, certaines pièces du Catalogue eussent sâns doute échappé à mon attention. Je lui dois, enoutre, toutes sortes de renseignements relatifs aux vases qui font I'obiet de cet article. Qu'i| en soit vivement remercié.
258