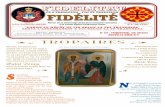Ugo ZANETTI, Leçons liturgiques au Monastère Blanc : Ancien Testament, dans Bulletin de la...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ugo ZANETTI, Leçons liturgiques au Monastère Blanc : Ancien Testament, dans Bulletin de la...
LEÇONS LITURGIQUES AU MONASTÈRE BLANC:ANCIEN TESTAMENT'
PAR
UGO ZANETTI
In memoriam R.P. Hans Quecke, S.J. (1928-1998)
Une recherche récente sur la Lirurgie du Monastère Blanc, en vuede faire l'état de la questionl, nous a amené à réexaminer des notes prisesjadis, ainsi qu'une assez giande quantité de reproductions, dont beaucoupproviennent de la documentation qui a jadis été réunie par le p. HansQuecke2; pour essayer de reconnaltre les diverses structures liturgiques
' Nou, voudrions remercier particulièrement le prof. Dr. Heinzgerd Brakmann etle Dr Catherine Louis, pour leur aide amicale et répétée. pour cet article, nous avonsdisposé de nombreuses reproductions provenant de la partie liturlique des archives duP. Hans Quecke (voir n. 2), et c'est pourquoi il nous a paru juste de dédier cet article àsa mémoirq; il avait d'ailleurs lui-même entrepris de transcrire et d'analyser plusieursdes pièces dont il sera question ici. Nous avons aussi utilisé beaucoup de matériel quenous avions recueilli il y a vingt-cinq ans (avant de décider de limiter notre thèse dedoctorat à la Basse Égypte, et dbn eiclure les témoins sahidiques), en particulier desdescriptions de manuscrits liturgigues, établies soit sur place (à paris, à Londres et auVatican), soit à partir de l'édition de 1922 des codices pierpont-Morgan, ainsi que desreproductions contenues dans la collection Lefort, à LouvainJa-Ncuve. une fois deplus, merci à ceux qui nous en ont alors facilité I'accès, parmi lesquets plusieurs sontdéjà décédés,
I Elk nour avait été demandée pour le congrès < christianity and Monasticism inthe Region ofsohag>, tenu à sohag en février 2006par la saint Mark Foundation avecla collaboration de la Saint Shenouda the Archimandrite Foundation et la bénédictionde ss, shenouda IIL Un condensé dc nos premières recherches parait, en anglais, dansles actes.
2 À la mort du P, Hans, le Recteur de la communauté jésuite de Munster, où il estdécédé (cf, Orientalia, 69 t20001, p. 189-208, par M. Krause), nous a rrès volonriersaccordé I'autorisation de mettre de l'ordre dans ses papiers, étant donné que nouscollaborions avcc lui depuis plusieurs années pour des recherches portant sur la liturgiecopte. Avec I'accord de la Province d'Allemagne du Nord de la compagnie de Jésus etdu P. Ph. Luisier, sj., successeur du P. Hans, tous ses imprimés, in particulier sonimpressionnante collection de tirés-à-part, et toutes les photos qui concernaient destextes bibliquos ont été envoyés au Pontificio Istituto Biblico, sauf la reproduction engrand format du Pap. vatican copro 9 (Petits Prophètes), qui a été expédiéc au prof. R.
UGO ZANE]:TI BSAC XLW 2OO7
attestées3, il a été nécessaire d'éditer ou de rééditer quelques typika ryidoivent provenir de ce monastère. Dans la même ligne, il nous a paruutile de faire le point à propos d'un lectionnaire de I'Ancien Testamentégalement originaire de là. Pour des raisons pratiques, nous avons divisénotre contribution en deux articles distincts, en adjoignant cette introduc-tion au premier d'entre eux, qui est aussi le plus court. La liste des abré-viations, assez longue, qui figure à la fin de ce premier article, vaudraaussi pour le suivant.
Rappelons d'abord, en deux mots, que le Monastère Blanc, à Sohâg(face à Akhmîm, jadis appelée Panopolis), en Haute É,gypte, fut celui deI'archimandrite Shenoute, le champion de I'opposition au concile deChalcédoine et un des pères fondateurs du monachisme copte. Labibliothèque de ce couvent, qui avait traversé les siècles, fut dispersée auxquatre coins de l'univers au cours des XVIII" et XIX" siècles, les diversmanuscrits étant démembrés, voire déchirés, en yue d'être vendus feuillepar feuille, ou même fragment par fragment4. Cela présente une difficultépresque insurmontable lorsqu'il s'agit de reconstituer la séquence desoffices liturgiques puisque, pour la connaltre, il faut d'abord avoirretrouvé, puis reconstitué, une suite cohérente de folios, et cela d'autantplus que nous ne disposons guère de 'fil conducteur' pour nous aider, carcette Fadition liturgique a été supplantée par celle de la Basse Égypre aucours du bas Moyen Âge. Ces raisons justifient la débauche d'efforts queI'on verra ci-dessous pour essayer de tirer parti de bouts de parchemin oude papier qui, sans cela, auraient sans doute été oubliés dans le coin d'unebibliothèque.
Kasser, auquel le P, Hans avait rcmis l'édition. Le Prpf. Kasser a également reçu lesfichiers du P. Hans concemant la langue copte, qui pounaient éventuellement servir augrand dictionnaire auquel il travaille. Pour notre part, nous avons gardé lesreproductions de manuscrits liturgiques, assez nombreuses, auxquelles personne d'autreque nous-même, à notre connaissancc, ne s'intéressait, et qui nous a largement aidé à yvoir plus clair dans la question des typika (voir la n, I de I'article ci-dessous: Leçonsliturgiques au Monastère Blanc : Six o typika r),
3 Nour préparons un article plus vaste, dans lequel le matériel présenté iciintervient à titre*'de démonstration, Des circonstances personnelles nous empêchantd'achever cet article pour l'instant, il nous a paru sagc d'en faire paraître au moins lesparerga, utiles à tous les liturgistes.
4 Cf. Orlandi, Mss lYM.
LIiÇONS LITURGIQUES: ÂNCIENI"IESIAMEN'I'
Les typika et les lectionnaires d'Ancien Testament
Ôommençons par rappeler ce que sont les typika dont il est question.À une époque où la copie des livres était fort onéreuse, il importait detravailler à l'économie. on employait pour cela des recueils particuliers,des livres liturgiques qui se présentent comme un ordo et résument enquelques lignes tout le contenu d'un office, dont ils désignent les diversesparties au moyen d'un irtcipit, qu'il s'agisse de pièces lues (leçons scriptu-raires ou'homilétiques) ou chantées; on les appelle typika (mais aussi<<index>' ou <<directory";5. Ils présentent un intérêt exceptionnel pour lcliturgiste car chaque fragment, même isolé, comprend des indications quipermettent de reconstituer I'ensemble de I'office de plusieurs fêtes consé-cutives. Si, par bonheur, on arrive à réunir plusieurs feuillets d'un lnêmeindex, c'est donc une portion cohérente de I'année liturgique que I'onpourra étudier.
Lorsqu'on s'intéresse aux lectures bibliques faites dans le cadre dela liturgie, on ne perdra pas de vue que notre division actuelle de la Bibleen chapitres et versets n'existait pas6. si le Nouveau Testament connais-sait plusieurs type$ ôe division en << sections r, (nous y reviendrons dans lesecond article), aucun système n'avait étê élaborê pour I'Ancien Testa-ment, de sorte qu'on ne pouvait y renvoyer que par la citation d'un incipitqu'il fallait connaître de mémoire, et identifier correctement lorsque plu-sieurs passages pouvaient convenir. Cela fonctionnait bien pour lespsaumes, qui étaient réellement connus par cæur de tous les moines etsans doute de la plupart des clercsT, mais sans doute guère pour les autreslivres vétérotestamentaires - et cela, même en tenant compte de la
r Voir, pourles lectionnaires de Basse Égypte, Zanettl, LCA, chap.3 et 4, p. 6l-104; pour ceux de Haute É,gypte, ld., Abt-l-Barakât et HE, p. 451 ; ld, Index MB, p. 55.D'autres aspccts de ces livres sont traités dans Quecke, Untersuchungen, p.76 et n.123;1d, Zwei Blittter, p. 194 et n. l-2; Brakmann, Congrès 196, p.456; Id., Congrès2000, p.589; Id., Congrès 20M, p, 139-141. - Nous avons nous-même longtempspréféré le terme <index>, mais nous nous rangeons à présent à I'usage plus général detypika, rottL en rappelant que ce genre de livre liturgique n'a pas grand-chose à voiravec le typikon byzantin.
6 C.tt. division est due à Robert Esticnne, qui I'a introduite dans son édition dela Bible de 1551. Pour plus de détails, cf. H. von Soden, Dje Schriften des NeuenTestaments, I,l, Leipzig, 19l 12, p. 482 ss.
7 Ce qui n'exclut pas des confusions dues au fait que certains versets psalmiquesse ressemblent. Nous en avons relevé un cas dans LCA, p.95 (à propos de S 94).
208 UGO ZANI|TTI BSAC XLW 2OO7
mémorisation de l'Écriture sainte, et de la présence de notes marginales8.Les leçons destinées à la lecture publique ont donc fini par être regrou-pées dans des lectionnaires pléniers. Comme ceux-ci ont connu le tristesort de la plupart des manuscrits sahidiques, il ne nous en reste que desfragments d'interprétation douteuse, et passablement moins abondants quepour le Nouveau Testament.
Il semble bien en effet que, dans la liturgie du Monastère Blanc, onne lisait - mis à part les Psaumes - des passages de I'Ancien Testa-ment qu'à certaines assemblées dont nous reparlerons, et en tout cas pas àla messe. Il est donc normal que le nombre de témoins parvenus jusqu'à
nous ne soit pas très élevé. Si I'on excepte les péricopes intervenant dansles offices du carême et de la semaine sainte; qui constituent un ensembleà partg, l'état fragmentaire de la documentation disponible fait que, à notre
connaissance, personne n'a encore tenté d'analyser une série cohérente deleçons vétérotestamentaires de la liturgie de Haute Égypte,
Est-il sûr, néanmoins, qu'il n'y a jamais eu de typikon pour lesleçons de I'Ancien Testament? À vrai dire, nous en avons repéré un
exemple: est-il unique? C'est un fragment de typikon pour les vigiles (y
compris la messe) de la première semaine de carême, dans lequel on
trouve .donc aassi la mention de leçons vétérotestamentaires (liées au
carême):Vienne, K974L, publié parWessely, SPP, XVIII,26l. Les indi-
cations pour les lectures figurent au début du texte conservé, de sorte que
nous ne disposons pas de la rubrique générale qui les introduisait; en outre,
E On trouu. régulièrement dans les marges des manuscrits bibliques, commedans d'autres (homéliaires, Vies de saints, ctc.), des annotations destinées à permettre
le repérage d'un texte (par ex. eam nxpn < pour le vin >), et il n'y a pas de doute que, à
ccrtains moments, on s'est effectivement contenté de ce genie d'indications pour
repérer les leçons (cf.Zanetti, LCA, p.60 s, et le renvoi à Kunze, Die gottesdienstliche
Schriftlesung, p. 52 ss, pour le rite romain). Mais les leçons étaient souvent, on le verra
ci-dessous, fort brèves, et tirées de livres bibliques différents, ce qui devait rendre
I'identification des péricopes fort onéreuse. En outre, les annotations auxquelles nous
faisons allusion revenaient à maintes reprises (c'est le cas, justement, de I'exemple
que nous venons de citer), ce qui brouillait encore un peu plus les pistes' Tout cela
explique la naissance des lectionnaires.9 La semaine sainte a éfê êditée par O.H.E. Burmester, Semaine Sainle. Pour les
leçons d'Ancien Testament en carême, voir A. Baumstark, Die quadragesimale
alrtestantentliche Schriftlesung des koptischen Ritus, dans Oriens Christianus, 25'26(1g28-lg2g), p. 37-58, ainsi que o. Heiming, Genesis und Proverbienlesung der
koptischen Quadragesima wd Karwoche, dans Jahrbuch fllr Liturgiewissenschaft, l0
(1930), p. 174-180.
LRÇONS LITURGIQUES: ANCIENT TEST.É\MENI.
I'interprétation de ce qui reste n'est pas claire pour nous, car elle supposeque I'on connaisse exactement le dérqulement de I'office. pour ce qui estdes leçons tirées de I'Ancien Testament, dont nous parlons ici, il se faitqu'elles portent toutes (sauf la première) sur les premiers versets du livrebiblique indiqué (Deutéronome, Josué, Ézéchiel...), de sorte que, pourcelles-là du moins, il n'était pas difficile de repérer la péricope désirée;mais ailleurs, en I'absence de divisions suffisamment précises, I' identifi-cation du passage indiqué, avec le bref incipit qui était donné (une ving-taine de lettres), devait relever de I'exploit, et cela malgré la présence denotes marginaleslO; tes lecteurs devaient, à notre avis, disposer d'unlectionnaire plénier distinct, vraisemblablement posé sur un lutrin, quiprésentait les leçons dans I'ordre voulu. c'est évidemment ce lectionnaire-là que nous aimerions retrouver.
Le < grand katameros > décrit par Mgr Hebbelynck (<Z 32 >)
Hélas, si des fragments de plusieurs lectionnaires de I'AncienTestament sont parvenus jusqu'à nous, peu d'entre eux ont conservé unnombre suffisant de feuillets. Néanmoins, dans un article fondamental,Mgr Hebbelynck avait réuni, en l9l l, 25 feuillets d'un manuscritprovenant du Monastère Blanc, très caractéristique notamment par sonornementation; on y trouve un lectionnaire (katameros) de I'AncienTestament, qu'il a appelé <<grand Katamérosoll; c'était d'ailleurs le seullectionnaire de cettg'] série, car tous les autres étaient des manuscrits
l0 Alor*, à quoi pouvait servir'le typikon du Vienne, Kg74l? Ou bien ilconstituait une exception, ou bien il s'agissait d\rn aide-mémoire destiné auxresponsables du déroulement de I'office (les "cérémoniaires", pour employer un termede la liturgie latine), auxquels un incipit suffisait.
I I Hebbelynck , Mss Mon.B,, p, 143-147,où I'on trouvera les références à l'éditionde chacun de ces fragments, références que nous ne reprenons pas ici. Cf. aussi A.Vaschalde, Ce qui a été publié des versions coptes de la Bible, dans la Revue biblique,28 [= p.5, 16] (1919), à 3l (1922), passim (manuscrits sahidiques). Pour le termekatameros, voir Zanetti, LCA, p.7. - Vu la nécessité d'adopter une désignation sûre etcommode pour chacun des manuscrits liturgiques démembrés du Monastère Blanc, eten I'absence d'autre système efficace, H. Brakmann a proposé d'employer, lorsque c'estpossible, le numéro du catalogue de Zoega, universellement connu (cf, Brakmann,Fragmenta Graeco-Copto-Thebaica..., dans Oriens christianus, SS [2004], p. ll7-172:cf. p. 120, n. 7). Dans ce système, le lectionnaire de l'Ancieh Testament décrit ici seraappelé <<232>.
209
210 UGO ZÀNI.]T-TI BSAC XLW 2OO7
bibliques. Le texte scripturaire des passages cités a été le plus souventpublié, mais sans exploiter le potentiel de ce document du point de vueliturgique, un travail qui était encore impossible alors, faute de connais-sances suffisantes en ce domaine. C'est cela, et cela seulement, que nousallons essayer de faire ici.
À notre connaissance, donc, de ce <<grand katameros 232> il reste,sur les 157 folios au moins qu'il a comptés, 25 feuillets (donc environ16%o), dont 17 qui sesuivent (2+2+4+5 +4); leurs cotes sont: Vat ican,Borgia 32 (9 ff);Paris copte 1291e,ff.9-15;Paris copte 12922 (7 ff., jadis àI'IFAOI2); Brit. Lib. Or.3579 A (1) et A (la); Vienne, K9875-9879. Saufdistraction du scribe, les leçons sont numérotées, à I'exception de cellesqui sont hors-série, à la fin du ms. Hélas, il y a peu de rubriques: en plusdu hasard, il y a sans doute aussi une explication plus technique, que nousévoquerons.
Du point de vue codicologique, reprenons d'abord la brève descrip-tion de Mgr Hebrbelynck: <Dimensions: parchemin 32-34 x 24,5-26 cm;texte, 26- ttz x 20 cm; lignes 37 -39; deux colonnes. >
On remarquera ensuite que ce manuscrit est paginé pair/impair, etque cette pagination se maintient de manière constante à travers toute lapartiedu manuscritparvenue jusqu'à nous, autrement dit de la p. 148 à lap.313, laquelle n'était pas la dernièrel3. Les cahiers étaient des quater-nions, comme on pouvait s'y attendre, et il devait y en avoir au moins 20;on r conservé dçs,parties des quaternions ns l0 (qui devait comprendreles pages 146 à 15'1) ot 1l (p. 162à 177), avec les signatures de la fin dul0'cahier, à la p. 161, du début du 11", p. 162, et du début du 12", p. 178,comme le signale Mgr Hebbelynck. Si la suite était régulière et sanserreur, on aurait dt trouver des signatures aux p. 226 (début du 15" cahier)et 306 (début du cahier 20), qui sont conservées; faute d'avoir pu observerces signatures sur les reproductions dont nouç disposons, nous devonsconclure provisoirement que d'autres inégularités se sont produites aprèsla p. 178 (mais seul un examen direct des fragments conservés pourra leconfirmer).
12 Les sept feuillets pûigs-par Lacau en 1901, et qui étaient alors à I'IFAO, setrouvent désormais à la Bibliothèque Nationale de Paris mus la cote 12922: cf, Cat.IFAO (C. Louis), Introduction, $ 1.3.1.5 (L'acquisition de 1900), p, 44 (et n. 178-l8l ).
13 Car le texte est inachevé (cf. n. 39 ci-dessous),
I-EçONS LUURGIQUES: ANCIENT TES1ÂMENT
Voici donc la description du contenu des feuillets parvenus jusqu'à
date ettête no leçon14
Paris copte l29le, .f. l0 = pag. 148-l49tsr?\
211
no <47>n" 48
<4 ff.manquent>
<60>616263&65667
Gen 41,...42-45Is 33,5-13Ex 16,27-36Is 58,7-1 IProv 10,2-5... (suite auf suivant)
Gen l2,l-7Deut 1,3-7.,. (fin mutilée)
Deut33,29-34,8bJos I , l -17Gen 50,19-25Deut32,44-52Gen 25,5-l ITobie 14,7-12Gen 25,9-10...
<41>4243445
K9879, un feuillet = pag.450-l5l>(suite daf préc.) Prov 10,...5-9no 46 Sir 7,15-25
l" Mcchir: les < grands hommes >, archevêques et archimandrites
14 Dans la première colonne figurent la date et I'occasion liturgique auxquellesles leçons sdnt destinées, d'après les rubriques conservées; on trouvera souvent un pointd'interrogation, l'aute de rubrique. Le numéro est celui que le manuscrit assigne à laleçon, lorsqu'il est conservé ou lorsque nous pouvons le déduire du contexte (en ce cascntre soufflets), Dans la troisième colonne, les points de suspension désignent unelacune, située au commencement ou à la fin de la leçon, selon le cas. Les référencesrenvoient à la LXX (Rahlfs).
15 Voir Hebbelynck, Mss Mon.B., p. 144, n.5: ayant aperçu les traces d'un ppresque effacé, Lacau a pu coniger en 148-149 (pMH-pMe) la foliotation que Masperoavait lue 48-49; oela s'accorde avec la numérotation des leçons.
16 te f. 11 a perdu sa pagination, mais il est le dernier du cahier l0 (î); tesuivant, qui ouvre le cahier I I (-tâ), a heureusement gardé sa pagination: 162-163 (pzo-Prr). Les cahiers sont donc des quaternions. Cf. Hebbelynck, Mss Mon.B., p. 145.
t7 Si Marp.to a raison d'identifier les deux lignes et demie qui re$t€nt comme"Isaie", il peut s'agir de Is 2,2, avec une légère variante et une addition (il reste:<ccrl>lorg €eorN epoc xdr Ne€oNoc THpûr {aù npax ùna(oerc>} = <raiii(>ooorv ôn' aùtô ncivta t<i Ë0q {ev t(r ôvcipott Kopioo}). Mais il pourrait s'agir d'unautre livre biblique. La relative banalit6 des mots ne facilite pas I'identification.
Paris
212 UGO ZANE'I-I] BSAC XLW 2OO7
<l f. manque>Paris copte 129te, f. 13 = pag. <166-167>18
- (?) <69>' <70>
alTL
72
l Rois 12,...5-83 Rois 2,7-12Deut26,15-27,14 Rois 13,14-18.. .
Gen 14,...17-20...Prov 22,...28-23,4...3 Rois 8,...4148Is 25,L..
[s26,...2-10Iér 17,19-25Judith 4,8-13Tobie 12,6...
<3 ff. manquen>Londres, Brit. Lib. Or 3579 A (I) = pae. 474-175>te(?) <83>
<84><85>86
<1 f. manque>Paris copte j1292, f. 7 = pal.. 178-17920
- (?) <90>9l9293
<13 ff. manquent>, 32t'2 206-207
Jon 3,,..Dan3,2142?2
18 Ce feuillet n'a pas de pagination, mais il est évident qu'il ne peut manquerqu'un seul feuillet entre la fin du précédent (Paris copte l29re, f. 12) et celui.ci, puisquela dernière leçon de celui-là porte le no 67 et que celui-ci commence par une leçonacéphale qui ne peut être que le no 69, En effet, la première lcçon complète de cefeuillet n'a qu'un numéro illisible, mais les deux suivantes sont bien marquées 7l (-oà)et 72 (oB), Vu la longueur habituelle des leçons de notre ms., il ne peut donc manquerqu'un seul folio, qui devait être paginé <164-165>. Sans doute portait-il une rubrique,qui nous échappe, hélas.
l9 Ce feuillet a perdu sa partie supérieure et, partant, sa pagination, ainsi qu'unepartie du texte; grâce au numéro de la dernière leçon, qui est préservé, on peuttoutefois le situer avec certitude entre le Paris copte l29re, fol. 13, et le f'euillet publiépar Lacau; un petit calcul montre qu'il dcvait s'agir des pages 174-175. Il a été publiépar J. Schleifer, Sahidische BibebFragmente aus dem British Museum za London. II,dans Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichenAkademie der Wissenschaften, 164, Abhandlung VI, Vienne, 1910, p,2-4.
20 Premier folio du cahier 12 G), lt a conservé sa pagination lpon-poe). Cefeuillet, jadis conservé à I'IFAO, a été publié par Lacau en 1901 : cf. Hebbelynck, MssMan,B. p, 145 et n. 1.
2l Texte non signalé parZoega,ni parCiasca; cf. Hebbelynck, Mss Mon.B., p,143 et n. 2.
(?)109. cass.
LEçONS LITURGIQUT1S: ANCIT'.NT TES'IAMEN'I zlJ
t32133
<2 ff. manquent>
Deut 16,16-17,1Prov 8,1-7.,.
Lév 8,6-13Ex29,l-9Ê246,1-7
Zach9,9-14Jér 33,8-15 LXX (= Jér 26,8-15 héb)
- l^a cinquième semoine de carême. Le samedi (fête) de Ia Sainte Sion,ensuite (célébration) de la Crucifixion du Chris4a
<l4l>t42143
144<145>146 Os 10.2-10t47148r4915015l
<3 ff. manquent>
Is 3,9-17Dan9,23-2"1Zach 13,5-14,4Iob 16,13-222sJér 18,18-23...
Is 53,,.,3-12 + addition26Jér I I , l8-12,4. . .
Paris copte l29te,.f. 14 = pal,.226-227
- (?)
<4 ff. manquent>
<156>157
22 H.bbrlyn.k, Mss Mon,B., p. 143 et n. 3, corrige Zoega erCiasca, qui indiquentDan 3,21-33 (la numérotation de la vulgate €t celle de la LXX sonr identiques à cetendroit, semble-t-i l).
23 L, ""rr.t
14 commence au début du folio, sans titre précédent, dbù on peutdéduirequ'i lestacéphale:cf. ciasca, II, p.20, note à <XXI>. Le contenu de la leçonsuggère la même hypothèse,
U En copte (graphie du ms.):Tmeet ùeeeaomac gù il'. ncaesàToN eâNTerorâàB cr(l)x' mNNcoc eÂN Tecrarporcrc ùneE cette rubrique figure surla p, 214 du ms. Il faut lire gù fr et non ax î comme I'a fait Zoega (n. 32, p. I79 s) ; cechiffre "40" - (très mal) tracé en abuqtî ("épacte"), ou ,,chiffies coptes cursifs" _désigne le carême (les 40 jours), Le samedi de Sion est la veille du dimanche desPalmes.
25 coirection de Hebbelynck, Mss Mon.B., p. 143 er n. 5, car ciasca et zoeg^donnentJob 16,14-22 (mais ici la différence doit tenir à l,édition consultée: Job 16,13de la LXX = Job 16,14 de la Vulgate)
26 À l. fin du v. 12, notre ms, ajoute (dernière ligne de la deuxième colonne durecto, et trois premières lignes du verso) une queue absente de l'édition de Rahlfs. ainsique des variantes de l'édition de Gôttingen (ziegler), mais signalée par ciasca commevarianre dc D (p. Z43,apparat du v. l2):àTno,r eâ.,q ll tf. tl;l aï.o àTÀr.uKelMMOq âTdonl à1r(o à nâoelc K(,) Nar €poq ((on l'a poursuivi et persécuté; on Iasaisi, et le Seigneur leur a pardonné >).
Gen 21....14-21
#a
UGO ZANF,TTI BSAC XLW 2OO7
Paris co?te 129te,.f. I5_= pag.236-237- (?) <169> Job 5,17-2727
l?0 Gen43,2-12l7l Deut 7,11-13,..
<15 (?) ff. manquen>2sK9875-78, 5 feuillets continus = pag, ???29
- (T <225b Jér 38,...7-8- Mémoire du grand srchimandrite Moise3o, le 25 Épêp. Voici ce qu'it fautlire en ce jour de l'archimandrite et docteur du peuple
("223Genèser)31 Ex4,10-18<227"> Dest34,7-12
- Le 26 @pefl. Fête du < grand homme, vénérable Abba Joseph, le pèredu Chrisf2
ZZ8 Gen49,20-28229 Deut 32,2-8
- Le l" Mésoré: le vin nouveau<230> Job 1,1-5231 hov 9,1-9232 Deut 33,18-28<233> Jér 38,10-14 LXX [= 31,10-14 héb]2Y Prov 3,9-16235 Iér 42,5-10 [= 35,5-10 héb]236 Deut 32,9-15<237> Jêr 42,12-16... [= 35,12-16... héb]
27 L"çoncommençant en haut de la page, avec une lettrinel cela laisse supposerque l'incipit est complet, mais que le titre se trouvait à la page précédcnte.
28 On peut calculer que, de manière très approximative, les folios de ce ms.portent environ une leçon ct dcmic par page (entrc 2,75 et 4,5 par folio, mais avecbcaucoup de variations, dues à la longueur des leçons et à la présence éventuclle derubriques, celles-ci étant généralement assez sobres). Nous avons perdu ici les leçons172 à 224 (probablcment), avec la fin de la leçon no 171 et le début du no, 225(probable), donc 53 leçons entières et deux fragments. Il devrait donc nous manquer 15ou 16 folios (30 ou 32 pages), et le premier des feuillets ci-après pounait commencerpar la p. 270 ou 272. Voir ci-dessous, notes 33 et 46.
29 Aua. leur coin supérieur externe, ces feuillets ont malheureusement tousperdu leur pagination.
30 Il s'agit de MoTse d'Abydos: cf . CE Y,1679 ss.3l Crtt" leçon comporte à la fois une elreur d'intitulé (Genèse au lieu dExode),
et de numérotation, puisquc, après une leçon dépourvue dc numéro, on trouvera desleçons allant de228à 236. L'erreur la plus probable est une confusion, par le scribe,des chiffres F et î, qui se ressemblent quelque peu: on peut raisonnablement supposerque le scribe aurait dt écire <226. Exode>.
32 Joseph le charpentier; te <père nounicier de Jésus>, comme on I'appelle enOccident.
IÆçONS I,ITURGIQUES: ANCIENT TESTAMENT 215
<14 (?) ff. manquenÈ33m
(?) Dan 3,,..53-6332It.t6 306-3 l
< ?>- Fin-des synax,es du(nois des) Êpagomènes, qui (se trouve) après la finde I'année]î.
- Voici les passages (destinés aux) synaxes qu,on lit en toutn'importe quel jour où I'on décidera de les lire36.
Is 13,4-14Dan 10,4-l IMichée 7,1-7Nahoum l,l-12Aggée2,1-917Hab 1,2-llrs 64,5-65,2Zach I,l2-2,238
f-
temps et à
33 En vertu du calcul effectué plus haut, il devrait manquer ici l3 ou 14 feuillets.cela est confirmé par le fait que, entre le paris copte 129'e,f. I5 (= pag.236-237) et leBorgia copte 109, cass. I0,rasc.32ttrt 1= pag. 306-313) il devait y avoir (à moins quele scribe n'ait commis une erreur de pagination) 68 pages, donc 34 folios; cinq de ceux-ci sont préservés à Vienne, et ils doivent se situer à peu près au milieu de la lacune; 29folios ont donc disparu, et ils se répartissaient vraisemblablement soit l5 avant et 14après les feuillets de vienne, soit 16 avant et 13 après. ceci nous permet de calculerque - toujours en se fiant au calcul des probabilités - ia dernière leçon de I'année,dont le numéro n'est malheureusement pas conservé, devait vraisemblablemenr porrerun chiffre entre 270 er 280,
34 corre I'indique la rubrique qui suit immédiatement, cette leçon - dont nousignorons malheureusement le numéro d'ordre - est la dernière du dernier mois clel'année, celui des Épagomènes (aujourd'hui appelé, en arabe,,,At-Nasi"); on peutsupposer qu'elle concerne la fête de l'archange Raphaël (et en ce cas la leçoncommençait sans doute au v. 49), q.ue le synaxaire actuel place le 3 des Épagomènes.on ne peut toutefois exclure qu'il se soit agi d'une action de grâces finale pour I'année,comme on la trouve dans ce même synaxaire après le dernier jour des É,pagomènes.
35 En .opte (graphie du ms.): âTzso:tK eBo^ ùdt ùccoorg ù.,"*or"*nonerMNNcà nzscr,K NTe poMn€. ce texte est séparé de la fin de la leçon précédentepar une ligne assez peu visible. cette précieuse rubrique et celle qui la suitimmédiatement figurent sur la p. 306 du ms.
36 En copte (graphie du ms,)t Nàl ecoor NNKàteà^eoN ùcooreEq9àTTATOOT €:SN KEPOC NIM Mù EOOT NiM ETEKNàT(,)!9 ETâ1rO NEHTOT. CEtitre est séparé de la ligne précédente par une ligne très apparente, Après le titre<<Isai'e> annonçant la première leçon, on trouve une nouvelle ligne; la leçoncommence par une lettrine,
37 Cf. Hebbelynck, M,rs Mon.B, p. 144, n.l, borrigeant Zoega et Ciasca (Agg 2,1-l0); ici encore, Agg2,9 de LXX = Agg 2,10 de ta vulgate (sans compter que le greccomporte une demi-phrase absente du latin), .
216 UGO Z-ANE'TTI BSAC XLW 2OO7
Abdias 8-18Is 40,2641,139
Il y a encore deux feuillets dont la position dans le ms. est inconnue:
Paris conte 1291e,.f.9( "t\ Juges,6, , . .15-16
Gen 41,53-42,5...Ex 34,18-264
Londres, Brit. Lib. Or 3579 A (14)aI (= Cat. BM, n" 2A)(?) Tobie 4, . . .13-19.. .
II est profondément regrettable que nous ayons conservé aussi peude rubriques désignant les occasions auxquelles sont destinées leslectures; on dirait qu'un malheureux hasard a fait disparaître justement les
38Cf. tt"bb.lynck,Mss Mon,B, p. 144, n, 2, corrigeant Zoega et Ciasca (Zachl,12-17); le texte copte correspond à celui de la LXX de Rahlfs, mais équivaut à Zachl,12-19 de la Vulgate (carZach I, l8-21 de la Vulgate =Zach2,l-4 de la LXX)
39 Le verset n'est pas achevé (mapone@N eeorN xce c,2aae = ôTytocitorosvroi l"oÀrlocit<oocv); d'autres feuillets et d'autres leçons devaient donc suivre cette p.3 I 3 (qui est un verso, rappelons-le).
40 Le.haut du feuillet manque, nous privant de la pagination, ainsi que de la finde la leçon tirée de la Cenèse et de la rubrique de Ia suivante avec son numéro. Enrevanche, cette dernière leçon est probablement complète: elle devait commenceravec le v, l8 (une partie de la lettrine est conscrvée dans la marge) et est suivie parune ligne, ce qui montre qu'elle s'achevait bien au bas de cette page, La leçon de laGenèse ne porte pa$ de numéro: le scribe semble avoir d'abord oublié d'en mentionnerle titre, et n'avoir ajouté Genèse qu'en un second temps, mais sans préciser le numéro.Il nous est donc impossible, pour l'instant, de situer ce feuillet dans le lectionnaire,Peut.être était-il voisin du Paris Copte l29le, f. 10 (= p, 150 du ms.), qui le suitactuellement.
4l On a conservé de ce feuillet le bas de la colonne extérieure (col. b du recto etcol. a du verso); ce qui reste de la colonne intérieure, au recto comme au verso, est tropréduit pour pouvoir être identifié (voir l'édition, sans doute assez faible, maissuffisante pour notre propos, de E.O. Winstedt, Some Unpublished Sahidic Fragmentsofthe Old Testamenl, dans Journal ofTheological Studies, l0 [1909J, p' 233'254: cf. p.
238). La partie lisible contient le passage de Tobie indiqué ici, sans pagination ninuméro de leçon, de sorte qu'il n'est pas possible ds déterminer la place que ce foliooccupait dans le ms. Peut-être se situaiçil dans le voisinage de I'autre feuillet
londonien, non loin de la page 175, car les fragmcnts qui se retrouvent ensemble dans
les collections européennes étaient assez souvent (mais pas toujours !) voisins dans le
ms.
omls
LllÇONs J.ITURGIQUF.S: ANCII1NT TES'I'AMENI'
pages qui en portaient. Mais, en y réflechissant de plus près, on doitconstater que les rubriques n'étaient pas nombreuses: si on laisse de côtéles 4 ff. de la collection Borgia (pages 306-313 du manuscrir) qui donnentdes suppléments extérieurs au cycle de I'année liturgique, on ne trouveque 5 rubriques sur 2l folios! Nous avons en effet quelques pages qui sesuivent,àsavoir :p. 148- l5 l (2f f . ) ,p. 160-163 (2f f ) ,p.212 à 219 (4 f f . ) ,les 5 ff. de Vienne er les p.306-313 (a ff.);or, les p. |60-163 ne portenraucune rubrique, les p. 148-15l et212-219 en ont une$our chaque sérieet, dans les cinq feuillets viennois, il y en a trois en tout et pour touÉ2. nn'est donc guère étonnant que, pour notre malheur, aucune rubrique neparaisse sur les 8 folios isolés.
on doit en tirer une conclusion sur la structure de ce lectionnaire: ildevait comporter assez peu de fêtes, mais celles qui étaient retenuesétaient souvent munies d'un bon nombre de leçons, comme on le voit pourle cinquième dimanche de carême (= dimanche des palmes) et le 1"Mésoré. Il existait néanmoins des célébrations de moindre importance,ainsi qu'en témoignent celles des 25 et 26 Épêp, avec deux leçonschacune.
Les < synaxes >
À quel moment se faisaient ces lectures? La double rubrique de lap.306 de <<232>> (cf . n.35 et 36 ci-dessus) fai t état de <<synaxes>> ou de<(passages à (lire dans les) synaxes>, en copte cû)ora, terme qui corres-pond normalement au grec oûvcÇrç. ce dernier mot désigne en fait touteassemblée des moines mais, dans les textes pachômiens, il s,emploie demanière particulière pour I'assemblée de prière du matin, qui <réunit tousles frères d'un monastère. En plus de la prière commune, elle comported'autres éléments tels que le travail, l'accusation des fautes, et peut-être lacatéchèse 'r43. Il est à noter que, dans les manuscrits liturgiques de Haute
42 on p"rt néanmoins présumer la présence'de rubriques sur certains feuilletsdisparus: ainsi, les p. 164-165, perdues, ne contenaient que la fin de la leçon n" 67, laleçon 68 et le début du no 69, probablement I Rois 12,l-5 (la p. 166 commence avec lesderniers mots du verset l elrov æcivteg. Mripruç (avec nrivteç ajouté au texte de Rahlfs);cela donne une moyenne assez basse, une leçon par page, qui se justifie probablementpar la présence d'une rubrique assez fournie (serait-ce l'annonce du début du carême ?les leçons conservées ne le suggèrent guère, apparemment).
43 cf. vrill"u x, Liturgie, p.295.
217
218 UGO ZANEruI BSAC XLVI 2OO7
Égypte, la messe s'appelle non pas c''trNàzlc, comme en Basse Égypte,mais nNâT NcTxare, littéralement: <<le moment de se rassembler>>, cequi permet de distinguer commodément ces deux homonymes (eL c'estpourquoi nous rendrons désormais en français ce dernier par "messe",bien que ce terme soit propre à la liturgie latine, afin d'éviter toute confu-sion possible avec la "synaxe" du matin).
Or, les typika mentionnent régulièrement ce terme de << synaxe >>(coora). Nous avons constaté que la rubrique Kà nc<r;orz eBo^ eN...(mets fin à la synaxe par...), lorsqu'elle intervient, est normalement latoute première après celle de la date d'une fête (ou la mention d'une célé-bration quelconque, comme par exemple <la moisson>>); cette rubriqueest complétée par un ou plusieurs mots-thèmes qui seront le sujet del'hermeneia concluant I'office (par ex. <<les anciens>> ou <<les prêtres>),cette dernière étant encore suivie d'un hymnos servant de chant finalg.Ne faut-il pas en déduire que cette (<synaxe)) (c<rlot2) prêcédait I'officedécrit par nos typika'l Celui-ci est souvent I'eucharistie, mais parfois ontrouve seulement des chants (herneniai et répons), ou encore des chants
suivis de I'eucharistie. Si notre déduction est exacte, la célébration pour
laquelle étaient prévues nos leçons de I'Ancien Testament devait donc
être la réunion de prière du matin propre à la tradition monastique primi-
tive, munie de leçons scripturaires et d'une méditation sileocieuse, et en
principe dépourvue de chant45; elle comprenait sans doute aussi les élé-
ments décrits par dom Veilleux (travail, accusation des fautes, éventuel-
lement catéchèse). Au moins à certains jours (ceux qui sont repris dans
les typika), elle était suivie d'un autre office (messe = nNàT NcTNàre, ou
parfois autre chose) et, au moins dans ces cas-là, la <<synaxer> se
concluait par une hermeneia et un hymnos,
Une qucstion ultérieure est celle de la fréquence de cet office. Il est
clair que, chez Pachôme, cette (synaxe> du matin était quotidienne,
14 Cr n,.rt pas ici le lieu de détaillcr ces points: nous y reviendrons dans I'article
décrivant plus largement la liturgie au Monastère Blanc. Dans Index MB' p' 59 (l' 6),
nous nous étions contenté de traduire I'expression Kâ n9À eao^ (rnets rtn à h fête) pat
<chant final>; à présent, nous pensons pouvoir distinguer lss deux expressions
techniques Kà nc(l)o.re eBo^ et ri nqya eson lnets fiin à la synaxe et mets ftn à la
rête),Enattendant,onpeutconsul ter |etypikonlnsinger33(MssLeide,p, l45ss)et lefragmcnt K9726 (lrVcssely, SPP, n'266)'
45 ny a toutefois des cas où la rubrique <mets fin à la synaxe> intervenait elle-
même après une listc, plus ou moins brève, de chants (hermeniai et répons), et parfois
aussi de lectures.
LEÇONS LITURGIQUES: ANCIENT,IESTAMENT
comme d'ailleurs les < six prières )r vespérales (puïsque c'est ainsi que I'onnommait I'office du soir), ainsi que I'a bien montré le p. Veilleux, citéplus haut. Mais notre manuscrit peut-il s'intégrer dans le cadre d'une célé-bration quotidienne remplissant I'année entière? On voit que les leçonspour le l" Mechir commencent à la p. 150 du manuscrit, avec le n" 47, etcelles du 1"'Mésoré sans doute non loin de la p. 270 (le chiffre ayantdisparu), avec le n" 230; les six mois allant du 1". Mechir au. 30 Épêpcouvrent donc environ 120 pages (soit 60 folios), et occupent 183 numéros(donc 183 leçons46); il faut toutefois ne pas perdre de vue que celacomprenait le carême et le temps pascal, périodes qui étaient peut-etreparticulièrement riches en lectures4T.
Quoi qu'il en soit, i l est plus que certain que seul un petit nombre dejours était muni de lectures: avec 183 leçons pour 180 jours, et en tenantcompte du fait que I'on n'en trouve jamais moins de deux pour un mêmejour, mais souvent bien davantage4S, on peut grossièrement estimer que lenombre de jours concernés par ce lectionnaire de I'Ancien Testamentn'excédait pas un sur douze, du moins pour la partie conservée. Onremarquera tout de suite que cela signifie que même ,les dimanchesn'étaient pas assurés de figurer dans les jours dotés de leçons vétéro-testamentaires. On calculera aussi que, en moyenne, chacun des quinze
'46 sauf bien sûr erreur de numérotation, soit dit en passant, ce carcul confirme ramoyenne évoquée ci-dessus (n. 28)t à peu près une leçon et'demie par page.
47 Nous disons bien (peut-etre>, car on sait que les ermites avaient coutume des'isoler entièrement pendant le carême, pour se retrouver avant la semaine sainte; cen'était sans doute pas I'usage chez les Pachômiens, puisque les livres liturgiques nousrapportent des offices pour le carême, Mais les (synaxes> du matin suivaient-ellesI'usage habituel ou se déroulaient-elles autrement? Les sources pachômiennes ne nousrenseignent guère sur la manière dont se déroulait le carême (cf, veilleux, Liturgie, p.260).
48 La célébration qui précède le l" Mechir comptait au moins 6 leçons (n- 4l-46); les leçons 60-67 étaient aussi destinées à une seule et même occasion; le 5.samedi de carême et le l" Mésoré comptaient au moins 8 leçons chacun (144-l5l et230'237): plusieurs groupes de quatre leçons (au moins!) étaient également destinéesau mêmejour:69-72,83-86,90-93,130-133, 140-143. Au rotal, pour une période de sixmois, la partie conservée du lectionnaire ne peut en aucun cas couvrir plus de 15 joursdifférents (mais sans doute moins de 15, car nous soupçonnons plusieurs groupes dequatre leçons de se rattacher à ce qui précède ou ce qui suit).
219
uco zANliTt't BSAC XLVI 2OO7
jours ainsi mis à I'honneur recevait au moins quatre leçons49, le nombreréel fluctuant entre deux (minimum) et huit ou plus (maximum).
En revanche, les 35 jours allant du 1o' Mésoré à la fin des Épago-mènes (36 jours les années bissextiles) devaient couvrir entre 3l et 34pages, avec un nombre de leçons compris entre 40 et 50 (5 pages àVienne: K9876 verso, K9877 et K9878; les 13 ou l4 feuillets disparus, cequi fait 26ou28 pages;et la première colonne de la p.306). Cela donneune moyenne quotidienne d'un peu moins d'une page, et d'une leçon etdemie, ce qui est assez nettement supérieur à la moyenne des six moisallant du début de Mechir à la fin d'Épêp. Mais il esr fort possible que le1"'Mésoré, pour lequel nous ayons huit leçons (la dernière inachevée), enait compris davantage, et il y avait encore les deux fêtes de la Transfigu-ration et de I'Assomption qui réclamaient sans doute un nombre importantde lectures. On voit que ces moyennes sont, certes, à prendre avec beau-coup de circonspection, mais qu'elles peuvent au moins susciter desquestions.
Justement, on peut aussi s'interroger sur le nombre de lectures quidevaient être prévues pour les cinq premiers mois de I'année, de Thôout àla fin de Tôbé, période qui incluait les fêtes de Noël et de l'Épiphanie, etsans doute aussi la Croix: il paralt invraisemblable que les 46 leçons qui,selon la numérotation de notre manuscrit, précédaient le lo, Mechir, aientpu suffire. Mais on remarquera aussi que le l"'Mechir ne se trouve qu'à lapage 150 du manuscrit, donc assez loin à l' intérieur de celui-ci. En tenantcompte du nombre moyen de leçons par page, on peut estimer que lapartie de notre lectionnaire de I'Ancien Testament qui précédait cettedernière date (46leçons, donc) commençait sans doute aux environs de lapage 120. Il s'ensuit que le codex comprenait (au moins) une premièrepartie couvrant une soix'antaine de folios, du contenu de laquelle nous nesavons absolument rien. Était-ce un lectionnaire pour la première partiede I'année, ou un autre livre liturgique?
Quant aux 46 leçons destinées à la période précédant le 1.. Mechir,on peut conjecturer qu'elles devaient concerner au moins le mois de Tôbéavec beaucoup de lectures pour l 'Épiphanie, ainsi que pour les fêtes de lamort de la Vierge, le 21 Tôbé, et de saint Antoine le Grand, le lendemain.Remontaient-elles plus haut encore, avec le mois de Khoiak et la prépa-
49 Pour ces 15 jours (au maximum), il y avait au moins 62 leçons (en comptanttoutes celles dont nous avons conservé au moins un fragment): ccla fait une moyenned'un peu plus de quatre parjour concemé.
LEÇONS I,ITURGIQUES: ANCIENT 1'ESTAMIINT
ration à Noël? Si c'était le cas, cela signifierait sans doute que beaucoupde jours étaient négligés, car il y a tout lieu de s'attendre à ce qu'un grandnombre de leçons aient été consacrées âux fêtes de Noël et de l'Épiphanie(Baptême du Christ et bénédiction des eaux) 50. Mais, en fin de compte, iln'y a pas lieu de s'étonner que le nombre de jours munis d'offices particu-liers ait été aussi mince:après tout, le lectionnaire M615 (un évangéliairebilingue grec-copte, datant du VII'siècle et qui a appartenu au monastèrede Hamouti, dans le Fayoum), ne contient pas plus d'une quarantaine dejours pour I'année entière.
Une autre question se pose aussi à propos des célébrations couvertespar ce lectionnaire: y avait,il beaucoup de <<fêtes de circonstances>comme on en trouve régulièrement en Haute Égypte (moisson, vinnouveau, crue du Nil...)? Faute d'indications, il n'est pas possible de ledire, mais on remarquera que ces célébrations-là étaient souvent liées auxoffices dominièaux (samedi et dimanche), et plus probablement encore àla saison de I'année, plutôt qu'à une date du calendrier.
La structure de l'ffice pachômien?
Nous penserions volontiers que les manuscrits liturgiques originairesdu Monastère Blanc datant du IX'-X" siècle (les documents postérieurstémoignant déjà d'une autre évolution) avaient conservé la structure deI'ancien office pachômien. On se souvient que, au fVu siècle, la prière desmoines Tabennésiotes était fort simplesl. Les jours ordinaires, il y avaitdeux réunions quotidiennes de prière, ov synaJces, une le matin, réunissanttoute la communauté, et une le soir, qui se tenait par (maisonrr52. Leurstructure était la même: une leçon biblique, le Notre Père ré,cité les brasétendus, une prosternation au sol suivie d'une prière silencieuse, puis on selevait et on contnuait la prière en silence, enfin on se rasseyait pour lalecture suivante, et on recommençait le cycle; entre chaque étape de
50 D'après la moyenne calculée ci-dçssus (quatre leçons par jour), ces 46 leçonsauraient pu concerner I I jours. Mais on doit présumer que Noël et l'Épiphaniemonopolisaient un grand nombre de leçons, étant donné l'impoftance donnée dans leslivres liturgiqu€s aux testimonia de I'Ancien Testament sur lesquels repose lathéologie de ces fêtes,
5l En résumant les passages qui s'y rapportcnt dans Veilleux, Liturgie, etQuecke, U ntersuchungen.
52 Cf. v.ill.ux, Liturgie, p. 295-300.
222 UGO ZANEÏTI BSAC XLW 2OO7
chaque cycle, on se signait. Les leçons pouvaient être prises paffout dans
l'Écriture, et devaient être assez brèves, puisqu'on les- répitait souvent par
cæur, même si*un livre était à disposition du lecteur53. [l n'y avait pas de
chants, semble-t-il, et un travail était prévu pendant la prière, ce qui ne
pouvait guère se faire qu'au moment des lectures (les autreS exercices,
prière les bras étendus ou prosterné au sol, n'en laissant manifestement
pas la possibilité)54.
Les dimanches et jours de fête - c'est-à-dire les jours où I'on célé-
brait l'eucharistie -, on voit que les synaxes s'y déroulaient avec plus de
faste: réunissant tout le monastère, elles étaient chantées, les "grands"(chefs de maisons et moines anciens) servant de chantres et les moines de
la "maison" chargée d'asgurer le service liturgique cette semaine-là leur
répondant à I'ambon55.
Ne serait-ce pas de cela que témoigne encore notre lectionnaire<<7-32>>? On aura remarqué que les leçons sont toujours brèves: n'est-ce
pas une trace de l'époque où on devait les réciter par cæur? Non seule-
ment c'était plus str pour celui qui en était chargé, mais cela découlait
aussi d'une pédagogie élémentaire: puisque les moines devaient
< méditer> l'Écriture sainte tout en travaillant de leurs mains - et on sait
que <méditer)> se disait peÀetôv et signifiait "réciter à mi-voix, de
mérnoire, en méditant"56 -, il valait mieux que les leçons' qu'ils
devaient mémoriser à I'audition, ne fussent pas trop longues !
Un autre détail provenant de I'Antiquité pourrait être précisément
celui de la fréquence des célébrations: nous avons vu ci-dessus que le
lectionnaire décrit ici ne couvrait qu'un nombre fort limité de jours de
I'année. Ne serait-ce pas lié au fait que la synaxe du matin ne comprenait
de péricopes fixes qu'à certains jours <<de fête> - ils étaient sans doute
53 On sait que la Règle de saint Benoît (10,2) prévoit aussi que, en été, on fasse àl'office nocturne une seule leçon, tirée de I'Ancien Testament, et cela <par cceur>
Qnemoriter), En hiver, on fera trois leçons tirées <tant de I'Ancien que du Nouveau
Testaments, ainsi que... (des) Pères...>, et ces lectures se font alors dans le l ivre du
chæur, placé sur le pupitre (ibid., 9,5 et 8).54 V"ill"u*, Liturgie, p. 307 s, 309 (n. 142), et 314.55 V"ill"o*, Liturgie, p. 313. - Les "maisons" assuraient le service liturgique
par roulement, une semaine chacune'56 La pelerrl pouvait porter sur n'importe quel texte tiré de l'É,criturc sainte: à ce
propos' voir t. Haushen, Noms du Christ et voies d'oraison (= oCA' 157)' Rome' 1960:p. 171 ss (et passim).
LEÇONS !,ITURGIQUES: ANCIENT l-E S'I'ÂMI-INT
déjà plus nombreux qu'au IV" siècle -, peut-être ces mêmes jours où lesautres typika, ceux qui rapportent les leçons pour la messe etlou leshymnoi, les hermeniai et autres pièces liturgiques, commencent par larubrique Ka ncorore eBo^ eN... (mets frn à la synaxe par...157? Cesjours <de fête>, la synaxe du matin, contrairement à I'habitude, incluaitsans doute des leçons de l'Ancien Testament, prenait fin avec quelquechant et se poursuivait par la messe (ou, parfois, par un autre office parti-culier). Les jours ordinaires, en revanche, la synaxe du matin aurait étéconstruite autrement. comment? Faute d'indications dans les documentsliturgiques, nous ne pouvons rien en dire, mais peut-être une étude plusdétaillée de la littérature du Monastère Blanc, en particulier des homéliesde Shenoute, offrira-t-elle des suggestions à ce propos.
Les leçons bibliques et leur thème
Pour ce qui est du rapport des leçons aux fêtcs que l,on célèbre, celectionnaife d'Ancien Testament fonctionne selon les principes habituels.on peut aisément le montrer pour celles dont on possède ra rubrique,comme le << samedi de sion > qui reprend des passages de l'Ancien Testa-ment évoqués dans les évangiles de la Passion, et prépare ainsi les lec-tures de la Semaine sainte5S: Zach9,9 est cité par Mt 2l,S (entré,e à Jéru-salem sur l 'ânon);Jér 33,15 LXX (héb 26,15) parle du ,.sang innocent quevous mettrez sur cette ville et ses habitants,'(cf. Mt 27,25); os 10,g estcité par Lc 23,30 ("on dira aux collines: <<tombez sur nous>"); Is.3,l0LXX fait dire aux habitants de Jérusalem: <<lions le juste> (cf. Jn lg,12:<ils prirent Jésus et le lièrent>; noter que le texte d'Isaie est différent enhébreu); Dan 9,27 fait allusion à I'abomination de la désoration gue rap-pelleraJésus (Mt 24,15);Zach 13,7 (',Je frapperai le berger, et les brebisseront dispersées") est cité textuellement par Mt 26,31; Job 16,13 LXX("ils m'ont entouré de lances") n'est pas sans évoquerMt26,47 (la fbule"armée de glaives et de bâtons" qui vient arrêter Jésus); Jér lg,lg(version Lxx) rapporte le complot contre Jé.rémie, quand ses ennemisdisent: "frappons-le par (sa propre) langue, écoutons (attentivement)toutes ses paroles", ce qui rappelle Mt22,15, quand les pharisiens "tinrent
57 Cf. "i-dærus,
alinéa Les < synaxes > (et n. 44),58 Nou, nous contentons de signaler ici un verset du récit de la passion, sans en
indiquer les parallèles,
UGO ZÂNETTI .BSAC XLVI2OOT
conseil en vue le de le prendre au piège de (ses propres) paroles',. C'estencore à la Semaine sainte que se rapportent les deux leçons des p.226-227 du ms., séparées par trois folios perdus, où il est question de ,,l,agneau
innocent mené à I'abattoit' ' (Is 53,7 et Jér 11,19), un passage cité non dansles évangiles, mais dans Act 8,32. En revanche, les trois leçons conser-vées aux p. 236-237 du ms. semblent concerner plutôt une célébrationagricole: "dans la famine, il te libérera de la mort" (Job 5,20), ..lorsqu'ils
eurent achevé de manger le grain", les fils de Jacob durent retourner enÉgypte acheter de nouvelles provisions (Gen 43,2 ss), Dieu bénira ,.le fruitde la terre, le blé, le vin et I'huile..." (Deut 7,13); serait-ce déjà la <fêtede la moisson > ?
Pour en rester provisoirement aux rubriques conservées: le l"'Mechir, on célèbre les < grands hommes >, et les deux leçons nousremettent en mémoire la vocation d'Abraham (Gen l2,l ss) et le discoursde Moïse rappelant qu'il avait demandé à Dieu des auxiliaires pour I'aiderà gouverner le peuple d'Israël (Deut 1,3 ss). Nous avons aussi conservéles rubriques de la fin du mois d'Épêp: pour Moise d'Abydos, le 25, on litdeux passages à la gloire de son saint patron, le prophète Moise (l'envoien mission par Dieu, Ex 4,10-18, et la notice de sa mort avec son éloge,Deut 34,7ss); quant à Joseph, le père nounicier de Jésus, fêté le 26 de cemois, on recourt pour lui à la bénédiction que le patriarche Jacob donna àson fils Joseph (de qui celui-là tirait évidemment son nom; Gen 49,20 ss),ainsi qu'au début du cantique de Moi'se où il est dit notamment: <<Interrogeton père pour qu'il te dise> (allusion au rôle qu'a exercé S. Joseph àl'égard de Jésus enfant; Deat 32,2 ss: cf. v. 7c), Le l"' Mésoré, c'est lafête du vin nouveau, et toutes les lectures font allusion soit au festin, soitaux prémices qu'il faut offrir à Dieu, à la bénédiction divine qui se traduiten récoltes et vendanges, ainsi qu'à la menace de la famine si jamais I'onvenait à désobéir59: les fils de Job festoient chaque jour (Job 1,1 ss), laSagesse a pÉpaÉ son vin et dressé sa table (Sag 9,1 ss), "un pays defroment et de vin" est promis aux fils de Jacob et à leur descendance(Deut 33,18-28: cf. v. 28), "le blé, le vin nouveau et I'huile" couleront (Jér38,10-14 LXX: cf. v. 12), celui qui "offre à Dieu ses prémices" verraabonder le blé et le vin (Prov 3,9 ss), Jérémie offre du vin aux Réchabites,qui le refusent (Jér 42,5-1,0 LXX), Dieu a nourri son peuple avec grande
59 Y avait-il un rapport entre cette fête et le début de la <synaxe de Mésoré> aucours de laquelle avait lieu la reddition annuelle des comptes (cf. veilleux, Liturgie,p.366-370)?
LIJÇONS LITURG IQ UES: ANCIEN'T TESTAMENI'
générosité (Deut 32,9-15), Dieu cite en exemple d'obéissance les Récha-bites, qui s'abstiennent de vin (Iêr 42,12-16... LXX).
ces exemples montrent que, en I'absence de fil conducteur, il estmalaisé de déterminer quelle était la fête prévue pour les nombreux textesqui nous sont parvenus sans leur rubrique. Ainsi, il n'est pas difficile deconstater que les sept leçons identifiables des p. 160-163, dont nous neconnaissons pas la destination, concernent toutes la mort d'un prophète ousa succession immédiate: mort de Moi'se (Dt 33,29 ss), à qui Josué suc-cède (Jos l,l ss), mort de Joseph (Gen 50,19 ss), annonce de la mort deMoïse (Dt 32,44 ss), mort d'Abraham (Gen 25,5 ss), mort de Tobie (Tob14,7 ss), sépulture d'Abraham (Gen 25,9 ss); mais de quelle fête pourait-il s'agir? on peut même se demander si ra série de quatre leçons des p.166-167, qu'un seul folio sépare des précédentes, n'aurait pas appartenu àla même série, puisqu'on nous y rappelle l'épisode où samuel se retire,après le sacre de saûl (l Rois [= I sam héb], l2),le testament et la morrde David (3 Rois [= 1 Rs hébl, Z,7 ss), ainsi que la mort d'Élisée (4 rois [=2 Rs hébl, 13,14 ss); la troisième legon, Dt 26,15ss, qui rappelle l,exi-gence de garder la loi prescrite par Dieu à son peuple, est toutefois d'unton différent, mais reste liée à Moi:se, re législateur. Également dépour-vues de rubrique, les leçons des p. 148-150 se rapporteraient-elles encoreà une situation de famine à laqueile ir a été porté remède? En effet, lapremière d'entre elles, dont nous n'avons que la fin, rapporte I'investiturede Joseph comme vice-roi d'Égypte (Gen 41,...42-45), mais on sait quecelle-ci est due à son interprétation du songe du pharaon, annonçant septans d'abondance, puis sept ans de famine (Gen 41,25-36); dans la secondelecture, Isai'e évoque la sainteté et la puissance de Dieu face à un malheurà venir (Is 33,5-13); la troisième raconte le miracle de la manne grâce àlaquelle Dieu a nouni son peuple au désert (Ex 16,27-36); ensuite, IsaIeexhorte à "partager son pain avec I'affamé (Is 5g, 7 et 10); les proverbesrappellent, entre autres, que "Dieu ne laisse pas le juste mourir de faim,,(Prov 10,3a), etlaleçon tirée du siracide commence par le conseil de nepas répugner "aux besognes pénibles ni au travail des champs" (sir 7,15).comme déjà dit, on ne peut se fier au thème d'une série de leçons pour endeviner la rubrique, car le lien de chacune d'elles avec la célébration peutêtre, à nos yeux, très mince et meme franchement artificiel: il suffitparfois d'un mot, même enfoui à I'intérieur de la lecture, par exemple du
226 UGO ZANËTTI BSAC XLW 2OO7
mot "moisson" ou "blé" ou "récohe" pour une fête de la moissontr. C'estpourquoi nous renonçons pour l'instant à essayer d'interpréter les sériesdes p. 174 s, 178 s,206 s et 212-214, en attendant que d'autres documentsviennent fournir une piste à leur propos.
Le calendrier liturgique
En élargissant l'étude à I'ensemble de la documentation disponible* typika,lectionnaires, homéliaires, antiphonaires, et même notes mar-ginales dans les manuscrits bibliques -, or a en effet de bonnes chancesd'arriver à réunir une quantité suffisante de données pour établir au moinsune grande partie du calendrier liturgique du Monastère Blanc. Ainsi,deux typika au rnoins - le premier est consacré aux hymnes, K9't.26,édité par Wessely, SPP, no 266 a et b; le second, riche d'informations6l,et (à notre connaissance) inédit, est le Paris, BN copte 1616, f. 4'(pagination originale: 88)62 - nous conservent des indications recoupantcelles de notre manuscrit pour la fin d'Épêp et le début de Mésoré, ce quiva nous permettre une première comparaison63. Le premier rapporte lesparties hymniques prévues pour la fête de S. Moïse I'archimandrite le 25Épêp et celle de Joseph, le père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 26,
60Voirdes exemples parlants dans I'article ci-après: Six typika (voir les Esscisde reconstitution et d'interprêtation, et en particulier les notes 58,65, l2Z et 136).
61 On y trouve les parties hymniques, hermeniai et répons, mais aussi les leçonspour la messe avec prokeimenon, épître paulinienne, psaltérion et évangile de lamesse, exact€ment comme la première main du typikon du Monastère Blanc que nousavons publié jadis dans Index MB (lequel, dans le système d'identification proposé parBrakmann - cf. n, I I ci-dessus - sera appelé < K 211 >, d'après la cote de la partie lapfus célèbre). Comme ce dernier (cf. Zanetti, Index MB, p. 57, dernier alinéa), letypikon Paris copte 1616, f. 44,porle des chiffres ajoutés d'une main plus tardive en vuede préciser le numéro du psaume, et les deux secondes mains nous ont paru être fortsemblables, sinon identiques. Les deux écritures principales se ressemblent beaucoupet la mise en page est très semblable, mais il ne nous a pas paru possible de conclure àl'identité entre ces feuillets à partir du matériel dont nous disposons; un examen directdes originaux permettrait sans doute d'arriver à une plus grande certitude,
62 Nour en avons eu connaissance grâce à l'obligeance de Catherine Louis.63 En fait, les hermeniai et répons qu'ils donncnt ne sont pas identiques, mais il
se pourrait qu'ils nc concernent pas le même office, ou la même partie de l'office. Pouren tirer davantage, il faudra d'abord comprendre comment fonctionnaient les diversesparties de chaque célébration, C'est pourquoi nous allons nou$ contenter d'en releverles rubriques relatives aux fêtes qui, elles, complètent celles de notre document.
LllÇONS I.ITURGIQUtsS: ANCIEN'I' TESTÀMENT 227
comme notre manuscrit; en revanche, le 1"'Mésoré y était consacré nonau <<vin nouveau>, mais au grand-pretre Aaron et à un anachorète dont lenom a disparu dans la lacune. Il y avait toutefois une fête du <<vin doux>(Wessely, loc. cit.,266b, ligne.26:rxrprarH €ÂM. nHpn ereond), placéele dimanchequi suivai t lafête de saint Bèce (ana BHca); la mémoire dece dernier, le 4 Mésoré, venait elle-même après une célébration du saintles samedi et dimanche précédents (donc huit jours avant la << fête du vindoux>). En revanche, dans le typikon Paris copte 1616, f. 44",|a fête desaint Moise était fixée au26Épêp, non au 25 comme dans notre "grandKatameros Z 32", et elle était suivie du samedi et du dimanche où I'oncélèbre le raisin (fraîchement cueilli, cela va de soi), ainsi que la mois-son; en revanche, ce typikon-là ne mentionne pas saint Joseph. Lemoment n'est pas encore venu d'analyser ces différences: pour le faireutilement, il faut attendre d'avoir réuni l'ensemble du matériel disponible.Mais ces variations sont un signe manifeste que le calendrier liturgique duMonastère Blanc a évolué (comme on pouvait s'y attendre), et on peutraisonnablement espérer que des études ultérieures arrivent à en recons-tituer au moins une bonne partie, et peut-être rnême à établir son évolutiondans le temps. En matière de leçons, par contre, nous ne connaissons pas(encore?) de manuscrit qui puisse venir compléter l_e nôtre. Tant qued'autres lectionnaires de l'Ancien Testament originaires du MonastèreBlanc n'auront pas été reconstitués, les 25 feuillets que nous avons décritci-dessus restent le seul document qui puisse nous donner une idéeconcrète de la manière ces lectures-là intervenaient dans les offices litur-giques de ce célèbre couvent.
Liste des abréviations
(commune à cet article et au suivant)
Boud'Hors, Onciale penchée = A. Boud'Hors, L'onciale penchée en copte et sa surviejusqu'au xf siècle en Haute-Egypte, dans Fr, Déroche et Fr. Richard (éd,), Scri-bes et manuscrits du Moyen-Orient, Bibliothèque nationale de France, 1997, p.tt7-133.
Brakmann, Congrès 1996= H, Brakmann, Neue Funde und Forschungen zur Liturgieder Kopten (1992-1996), in Âgypten und Nubien in spiitantiker und christlicherZeit. Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses in Mûnster, 20.-26. Iuli
UGO Z,ÂNFïIT] BSAC XLW 2OO7
1996, I Ç Sprachen und Kulturen des christlichen Orients, 6, l), Wiesbaden,1999, p. 45146/..
Brakmann, Congrès 2000= H. Brakmann, Neue Funde und Forschungen zur Liturgieder Kopten (1996-2000), in M. Immerzeel, J. van der Vliet (ed.), Coptic Studies onthe Threshold of a New Millenniun. Proceedings of the Seventh InternationalCongress ofCoptic Studies. Leiden, August 27 -September 2,2000, Leuven 2004,vol. 1, p. 575-6M.
Brakmann, Congrès 2004= H, Brakmann, Neue Funde und Forschungen zur Liturgieder Kopten (2000-2A04), in A. Boud'hors et D. Vaillancourt (ed.), Huitiènecongrès international d'études coptes (Poris 2004). Bilans et perspectives 2000-2004 (= Cahiers de la Bibliothèque copte, l5), Paris, 2006,p.127-149.
Budge= E, A, Wallis Budge, The Earliest Known Coptic Psalter, Londres, 1898.
Burmester, Lit. Serv.= O.H,E. Khs-Burmester, The Egyptian or Coptic Church, ADetailed Description of Her Liturgical Services and, the Rites and CerentoniesObserved in the Administration of Her Sacraments, (= Publications de la Sociétéd'Archéologie Copte. Textes et Documents, X), Le Caire, 1967 .
Burmester, Semaine Sainte= O.H.E. Burmester, Le lectionnaire de la senaine Sainte,dans P at ro Io gia O rientali s, 24, 169 -29 4 (1933) et 25,17 5 -4 8 5 ( I 934).
Cat, BM= W.E. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum,Londres, 1905.
Cat, IFAO (C. Louis) = Catalogue raisonné des nanuscrits littéraires coptes conservés
à I'IFAO du Caire. Contribution à la reconstitution de la Bibliothèque dumonastère Blanc. Mémoire présenté pour I'obtention du Doctorat par Catherine
Louis, sous la dircction de M, Jean'Danicl Dubois, Directeur d'Études, Paris,
École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses (2005)' (Pro
nanuscripto).Cat. JRL= ril.E. Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the
John Rylands Library, Manchester, Manchester, 1909.
Cat. Leide = \#. Pleyte & P. A. A. Boeser, Manuscrits coptes du Musée d'Antiquités
des Pays-Bas à Leide, Leiden, 1897.
Cat. Pierpont-Morgan = L. Depuydt, Calalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont' Morgan Library, 2 vol', (= Corpus of llluminated Manuscripts' 4-5)' Louvain'
t993.
CE= Aziz S, Atiya (éd,),The Coptic Encyclopedia, S vol., New York, Toronto, etc.,
1991.
Crum, Dict = W..8. Crum, A Coptic Dictionary, Oxford' 1939'
DelapOrte, Catalogue, = L. J. Delapofie, Catalogue sommaire des manuscrits coptes de
Ia Bibtiothàque Nationale, dans Revue de I'Orient chrêtien, passim enÎe 14 (2"
série,4), 1909, et l8 (20 série, 8), l9l3 (inachevé)'
Emmel, shenoute,s corpus = stephen Emmel, shenoute's Literary corpus, I & JJ (=
csco,5gg&600,Subsidia,1| |&| |2) ,Louvain,20M(|apaginat ionestcontinue).
I-EçONS LruURGIQU}IS: ANCIENT TESTAMENT
Fritsch, Lit. Year = Emmanucl Fritsch, C.S.Sp., The Liturgical Year and the Lectionaryof the Ethiopian Church. The Temporat: Seasons and Sundays, in EthiopianReview of Cultures, Special Issuc, IX-X, Addis Abeba, 2001 .
GCAL = Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 5 vol. (= StudieTesti, ll8, 133, 146, 141 etl72),CitéduVatican, 1944-1953.
Hebbelynck, Mss Mon.B. = Adolphe Hebbelynck, Les manuscrits coptes-sahidiques du"Monastère Blanc". Recherches sur les fragments complémentaires de lacollection Borgia. I. Les fragments de l'Ancien Testament, dans tre Muséon, 30lN.S. xII] ( l9t l), p. 9l-154.
Homer = [G. Homer], The Coptic Version of the New Testament in the SouthernDialect, 7 volumes, Oxford, 19 ll-1924.
Lefort = L.-Th. Lefort, Concordance du Nouveau Testament sahidique, I. Le's motsd'origine grecque (= CSCO 124, Subsidia l), Louv4iÇ 1950.
LXX = Septante, que nous citons d'après A. Rahlfs, Septuaginta. Id est VetusTestamenturn graece juxta LXX interprete,r. Stuttgart, 1965E.
Maspero, Fragments, VI = G. Maspero, Fragments coptes, Vl, dans Recueil de Travauxrelatifs à la philologie et à I'archéologie égyptiennes et assyriennes, T (1886), p.143-144 (fragment de rypikon = Paris copte 129'z0, f. 16l).
Nau, Ménologes = Fr. Nau, tras ménologes des Évangêliaires copto-arabes, \n PO,L0l2,p.165-244.
Nestle-Aland = Novum Testamentum Graece cum apparatu critico curavit EberhardNestle, novis curis elaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland, editio 25",Londrcs, 1975.
Orlandi, Mss WM= Tito Orlandi, The Library oJ the Monastery of Saint Shenute atAtripe, dans A. Egberts, B.P. Muhs, J. van der Yliet, Perspectives on Panopolis.An Egyptian Town from Alexander the Creat to the Arab Conquest. Acts from anInternational Symposium Held in Leiden on 16, l7 and 18 December 1998(Papyrologica Lugduno-Batava 3 I ), Leiden 2002, p. 211-232,
PO = Patrologia orientalis,
Quecke, Untersuchungen= H, Quecke, Untersuchungen zum koptischen Stundengebet,(= Publications de I'lnstitut Orientaliste de Louvain, 3), Louvain, 1970.
Quecke, Zwei Bliitter= H. Quecke, Zwei Bliitter aus koptischen Hermeneia-Typika inder Papyrussantmlung der Ôsterreichischen Nationalbibliothek (p. Vindob. K9725 und 9734), in Festschriït zum lÀ1jahrigen Bestehen der papyrussammlungder Ôsterreichischen Nationalbibliothek (Yienne, 1983), p. 194-2A6 et pl. l0 etI l .
sidarous, scala copte 43 = A,, Sidarous, un recueil ortginal de philorogie gréco-copto-arabe: la scala copte 43 de la Bibliothèque nationale de France, dans Fr.Déroche et Fr. Richard (éd.), scribes et manuscrits du Moyen-orient,Bibliothèque nationale de France, 1997, p. 293-326.
Taft, Hours= R. Taft, The Liturgy of Hours in East and west, The Liturgical press,Collegeville, 1986 (2" éd, ibid.,1993).
Till, Papyrussammlung = W. Till, Papyrussammlung der Nationalbibliothek in Wien,dans Zeitschrtft fûr die neutestamentliche Wissenschaft, 39 ( 1940), p. I -57.
230 UGO ZANETTI BSAC XLW 2OA7
Veilleux, Liturgie= Armand veilleux, In liturgie dans le cénobitisme pachômien atquatrième siècle (= Studia Anselmiana,5T), Rome, 1968.
Villecourt, Lampe = Louis villecourt, Livre de la r.ampe des Ténèbres et del'exposition (lumineuse) du service (de t'Église), par Abû 'l-Barakât connu sousle nom d'Ibn Kabar, Texte arabe édité et traduit par dom Louis villecourt, o.s.B.,avec le concours de Mgr Eugène Tisserant et M. Gaston Wiet (= pO, 20, fasc. 4),Paris, 1928.
Villecourt, 0bservances= L, Villecourt, Les )bservances liturgiques et la'disciplinedu jeûne darc l'Église Copte. (Ch. xvi.xix, de la l-anpe dei Tënèbres1, dans LeMuséon,36 (1923),p.249-292,37 (t924),p, 201-280, er 38 (1925), p.26142A.
\Yessely, sPP= K. wessely, studien zur Palaeographie und papyruskunde, 23fascicules, Leipzig, I 90 1 - I 923.
wilmet = Michel wilmet, concordance du Nouveau Testament sahidique,ll. Les motsautochtones (= CSCO 173, I 83 et 185, Eubsidia I l, I 3 et l5), Louvain, I 957. 1959,
zanetti, Abt-l-Barakât et HE= ugo zanetti, Abû-l-Barakôt et les lecrionnaires deHaute.Egyptq in M. Rassart-Debergh et J. Ries (ed,), Actes du IV, CongrèsCopte. LouvainJa.Neuve, 5.10 septembre 1988. ll. De Ia linguisuque augnosticisne (= Publications de I'lnstitut )rientaliste de Louvain, 4l), Louvain-la-Neuve, 1992, p. 450-462,
zanetti, Eth. Holy week= ugo Zanetti, Is the Ethiopian Holy week service translatedfrom sahidic? Towards a study of the Gebra Hemâmàt, dans proceedings of theEleventh International conference of Ethiopian studies, Addis Ababa, April l-61991. vol' I, edited by Bahru zewde, Richard pankhurst, Tadesse Beyene, Addis-Abeba, 1994, p. 765-783.
Zanetti, Index MB= Ugo Zanetti, IJn index liturgique du Monastère Blanc, dansChristianisme d'Égypte (= Cahiers de la Bibtiothèque Cop1e,9), paris-Louvain,1994,p.55-75.
Zanetli, LCA= llgs Zanetti, Les lectionnsires coptes annuels : Basse-Égypte, (=Publications de l'lnstitut orientaliste de Louvain, 33), Louvain-ra-Neuve, r9g5.
zanelti, Lect. c, (ép, c.)= ugo Zanetti, Les lectionnaires coptes, avec une annexe surLes lectionnaires arabes, dans chr.-B, Amphoux et J,-p. Bouhot (edd.), La rectureIiturgique des É,pîtres catholiques dnns t'Église ancienne (= Histoire da textebiblique, l), p, l4l-196, Lausanne, 1996.
zanetti, observations cod, -- ugo Zanetti, Les manuscrits de saint.Macaire:Observations codicologiques, in Ph. Hoffmann et Chr, Hunzinger (éd.),Recherches de codicologie comparêe, La composition du codex au Moyen Âge,en orient et en occident, Paris, Presses de l'École Normale supérieure. 199g, p.171-182,


































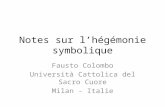
![Ugo ZANETTI, L'Église Copte, dans Seminarium, 38 [= N.S. 27, 3] (1987), p. 352-363.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317feafd93a162f9c0e5f64/ugo-zanetti-leglise-copte-dans-seminarium-38-ns-27-3-1987-p-352-363.jpg)