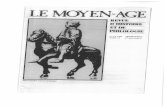<< Modernité du Moyen Âge ou Moyen Âge de la Modernité ? Généalogie médiévale de l'Honnête homme >>
La renaissance copte arabe au Moyen-âge (2010)
Transcript of La renaissance copte arabe au Moyen-âge (2010)
La Renaissance copte arabe du Moyen ÂgeLa Renaissance copte arabe du Moyen ÂgeLa Renaissance copte arabe du Moyen ÂgeLa Renaissance copte arabe du Moyen Âge
Adel Sidarus Environ huit ou neuf siècles après que la culture chrétienne d’Egypte vraiment autochtone, la culture copte, s’est forgée sur fond d’égyptianité et d’hellénisme (IVe/Ve siècle), au moment précis où la Vallée du Nil était en voie de devenir le nouveau centre politique et culturel de l’islam arabe, il a surgi une véritable Renaissance littéraire et artistique de la nouvelle donne copto-arabe.
En effet, grosso modo entre la deuxième moitié du XIIe siècle et la première du XIVe (IXe-XIe de l’ère copte des martyrs, VIe-VIIIe siècle de l’ère islamique), on assiste à l’âge d’or de la littérature copte d’expression arabe, qui représente du même coup – il convient de le dire –
l’apogée de la littérature arabe chrétienne du Moyen Âge.1 C’est à la même époque que les créations artistiques connaissent un développement sans pareil et achèvent de fondre harmonieusement l’art de tradition égyptienne chrétienne avec l’art islamique transnational. Cette renaissance d’une minorité ethno-religieuse en terre d’islam fait écho, d’une certaine façon, à celle des coreligionnaires de langue syriaque, objet du présent volume, ou encore à celle antérieure, et bien plus imposante, que les juifs ont connue dans l’Espagne arabo-
islamique.2 Et ces moments d’exceptionnelle ouverture et fécondité s’avèrent riches en leçons d’histoire sociale et religieuse pour ce début du siècle ou millénaire. Elles questionnent, en effet, les mouvements d’intolérance et d’exclusion, de monolithisme et de totalitarisme religieux et culturels, qui émergent de tous bords comme la panacée aux tensions ou maux de nos différentes sociétés modernes. Dressons, à grands traits, le tableau général de cette Renaissance copte arabe avant
d’analyser le contexte social et politique qui a favorisé son éclosion.3
1 Aperçus récents sur cette littérature: Troupeau 1971; Aßfalg 1987; Samir 1990. Signalons que Coquin 1993
met à jour surtout les données bibliographiques ou autres de la GCAL, et qu’Anawati 1992 résume, dans les différents «inventaires d’auteurs», le contenu de celle-ci. 2 Al-Andalus/Sefarad. Il y a une littérature abondante sur la question. Voir entre autres: Carlos del Valle, La
Escuela hebrea de Córdoba (Madrid: Editora Nacional, 1981); Ángel Sáenz-Badillos (ed.), Judios entre árabes
y cristianos: Luces y sombras de una convivencia (Córdoba: Ediciones El Almendro, 2000); Fierro Maribel
(ed.), Judíos y musulmanes en al-Andalus y el Magreb: Contactos intelectuales (Madrid: Casa de Velázquez, 2002). 3 Une première version anglaise a été publiée in: Coptica, 1 (2002), 141-160. Elle est ici développée, considérablement augmentée et mise à jour, à la demande expresse de l’organisateur du Symposium et éditeur
des Actes.
2
Littérature et production intellectuelleLittérature et production intellectuelleLittérature et production intellectuelleLittérature et production intellectuelle
L’arabisation avait du retard en Égypte, en comparaison avec d’autres espaces de l’empire islamique d’alors. Ce n’est qu’au Xe siècle (IVe de l’hégire), dans le cadre de l’hégémonie consommée de la langue arabe au plan culturel, social et commercial et de son rayonnement au-delà des frontières de l’empire, qu’émerge dans la Vallée du Nil une littérature arabe vraiment locale, qu’elle provienne des milieux musulmans, chrétiens ou juifs; qu’elle ait un
caractère religieux circonscrit ou profane plus universel.4 Du côté chrétien, deux grandes figures auront particulièrement brillé dans ce premier siècle
de la littérature arabe chrétienne: Sa‛īd Ibn al-Baṭrīq (< gr. Patríkios), alias Eutychès,
patriarche melkite d’Alexandrie (877-940),5 et le plus jeune Sāwīrūs Ibn al-Muqaffa‛, alias
Sévère, évêque copte d’Ašmūnayn en Moyenne-Égypte (Hermopolis Magna).6 Aux siècles suivants, cet état de choses a connu des hauts et des bas. Il est survenu des bouleversements sociaux et politiques. Comme partout ailleurs en pays d’Islam, le nombre des chrétiens diminuait progressivement. Leur composition, du reste, changea un peu, du moins au Caire et au Delta: alors que de nouveaux groupes ethno-confessionnels, comme les arméniens ou les syro-jacobites, venaient s’y installer, la communauté melkite déclinait progressivement. Grâce à l’affinité dogmatique de ceux-là, l’hégémonie de l’Église copte, l’Église du pays
profond, s’affirmait considérablement.7 Elle perdait pied, pourtant, devant les progrès de l’islamisation des masses et des élites. Mais cette évolution n’a guère empêché les Coptes de
4 Voir entre autres les chapitres respectifs in: CHAL-ABL & CHAL-RLSAP. Pour le contexte global: Vryonis
1975; Gervers/Bikhazi 1990. Comme nous résumons, dans ce chapitre sur la littérature, l’Essai sur l’âge d’or... (Sidarus 1993), on se reportera à cette étude pour les références bibliographiques illustrant nos propos pas à pas, avec les compléments in: Sidarus 2008. Nous signalons dans la contribution présente ce qui n’y avait pas été
invoqué, tout en rappelant que la production courante est analysée régulièrement dans les Reports sur la matière
(Coptic Arabic Litterature) présentés aux congrès quadriennaux de l’Association Internationale d’Études Coptes,
depuis le Ve Congrès (Louvain-la-Neuve, 1988, pub. en 1992; cf. ICCopSt. 5-8). Nous remercions les différents auteurs (S. Kh. Samir, J. Den Heijer, M. Swanson) du témoignage de leur amitié en mettant à notre disposition leurs comptes-rendus respectifs. 5 Le nouveau texte des Annales établi par M. Breydy en 1985 a été traduit en italien par B. Pirone dans la coll. SOC/Monographiae, 1 (Le Caire/Jérusalem, 1987). Études passées inaperçues: B. Pirone, ‘Testimonianze di
Eutichio sui luoghi santi’, SOC/C 23 (1990), 1-89; H. Horst, «E. und die Kirchengeschichte: Das erste Konzil
von Nikeia (325)», OC, 74 (1990), 153-167. Voir de plus: S. Griffith, «Historiography in the Annals of E. of
Alexandria», in History and Historiography in Early Islamic Times: Studies and Perspectives, ed. L. Conrad (Princeton NJ: University of Princeton Press, 1994); Idem, «Apologetics and Historiography in the Annals of E.
of A.: Christian Self-Definition in the World of Islam», in: ChrArHer, pp. 65-89; U. Pietruschka, «Muslimische
Überlieferungen in christlichem Gewand: das Annalenwerk des E. von A.», in Regionale Systeme koexistierender
Religionsgemeinschaften (Leucorea Kolloquium 2001), hrsg. von W. Beltz u. J. Tubach, Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft, 34 (Halle/Saale: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 2002), pp. 257-286. 6 Noter deux études récentes sur deux de ses œuvres in: CopArChr. 7 Voir p. ex.: Den Heijer, «Relations between Copts and Syrians in the Light of Recent Discoveries at Dayr as-
Suryān», in: ICCopSt. 7, 2: 929-944 ; «Les patriarches coptes d’origine syrienne», in: ChrArHer., pp. 45-63;
Y.N. Youssef, «Multiconfessional Churches in Egypt during the 12th Century», Bulletin of Saint Shenouda the
Archimandrite Coptic Society (Los Angeles CA), 5 (1998-99), 41-54.
3
continuer à peser dans la société de leur pays et à développer leur propre culture, même si définitivement arabisée. Et voilà que, vers le milieu du XIIe siècle, se dessine un mouvement qui débouchera au
siècle suivant dans ce qu’on qualifie couramment d’âge d’or de la littérature copte arabe.8 On observe alors une concentration extraordinaire d’écrivains, une production abondante et variée, ne manquant pas d’originalité et de qualité. Les auteurs cultivent, souvent simultanément, les différentes disciplines du savoir humain de l’époque: histoire et chronologie universelle, droit civil et canonique, linguistique – en l’occurrence, copte –, philologie et herméneutique scripturaires, philosophie et théologie. Ces sciences sont abordées, approfondies, systématisées, dans une langue arabe pas toujours inférieure à celle que manient les contemporains musulmans. Du reste, le genre compilatoire et encyclopédique ne manquera pas d’adeptes, comme partout ailleurs en pays musulmans.9 Évidemment, toute cette production littéraire est teintée de religion et de confessionnalisme, en accord avec les tendances générales de l’époque. Mais qu’on ne se méprenne guère. L’une des marques distinctives de la littérature copto-arabe de l’âge d’or est bien l’universalisme de ses sources et de ses horizons: un universalisme qui lui confère une valeur qui transcende les limites strictes de la confession religieuse et de l’expression sociale de ses protagonistes. En effet, les écrivains coptes de l’époque démontrent une extraordinaire ouverture intellectuelle, fruit d’une érudition poussée dans les différentes traditions linguistiques et religieuses, tant anciennes que plus récentes ou contemporaines. En plus des philosophes et savants grecs obligatoires et de presque tous les Pères de l’Église, ils connaissent et utilisent les auteurs musulmans les plus variés et, bien sûr, les grands et moins grands théologiens et exégètes arabes des autres confessions chrétiennes, sans oublier un peu de tradition judaïque.
En historiographiehistoriographiehistoriographiehistoriographie,10 l’histoire ecclésiastique traditionnelle, du type Histoire des
Patriarches d’Alexandrie, est plus ouverte à l’histoire sociale et politique du pays, si bien que plusieurs de ses pages complètent nos informations sur l’Égypte que d’autres sources nous
fournissent. La version qu’en donne l’évêque Yūsāb de Fuwwa/Melêtis (fl. mi-XIIIe s.), qui
développe en particulier les évènements contemporains, en est le meilleur exemple.11 Mais c’est surtout la chronographie universelle qui s’impose. Alors qu’on l’a trouve sous la
plume de Melkites dès les débuts de leur productions arabes, il y eut rupture, chez les Coptes,
avec la tradition qui a favorisé, par exemple, l’apparition de la Chronique de Jean de 8 Sidarus 1993. Pour la période qui va sensiblement de la 2ème moitié du XIIe siècle au début du XIIIe, que nous qualifions de «pré-renaissance», en particulier pour ce qui est de la littérature, voir Sidarus 2006. 9 Pellat 1966; Paret 1966; Blachère 1970. 10 Pour ce domaine, voir à présent l’importante analyse détaillée des sources effectuée par Den Heijer, 1996. 11 Sur l’ensemble de la question, voir l’analyse pertinente de Den Heijer 1996: 69-83. Un deuxième reprint en 3 vols. de l’ensemble des textes édités, mais sans apparat critique ni traduction, aux soins de Ṣamū’īl, Usquf Shibīn
al-Qanāṭir, Siyar al-Baṭārika... (Le Caire: 1999); le premier reprint, en 4 vols., date de 1984 (Dayr al-Suryān). Voir aussi Nakhla 1951-54. Nouvelles perspectives sur la version attribuée (!) à l’évêque de Fuwwa in: S.
Moawad, «Zur Originalität der Yūsāb von Fūwah zugeschriebenen Patriarchengeschichte», Le Muséon, 119 (2006), 255 -270.
4
Nikiou/Pshati (2ème moitié du VIIe siècle).12 Du milieu du XIIIe siècle donc, nous avons les
deux grandes histoires d’Abū Šākir Ibn al-Rāhib et d’al-Makīn Ibn al-‛Amīd,13 qui se situent au confluent de la tradition byzantine ancienne et celle islamique contemporaine, et conjuguent harmonieusement perspective universelle et vie locale et confessionnelle. Elles ont été largement utilisées par les historiens musulmans et ont fait école en Éthiopie, où elles ont été traduites, glosées et imitées. On voit donc les Coptes s’affirmer non par un procédé de repli ou d’isolement, mais grâce à une franche ouverture au monde qui les entoure, à un effort d’appréhension de l’ensemble de l’œcoumène et de son histoire, dans lesquelles leur groupe ethnique particulier s’insérait. Plus tard, au début du XIVe siècle, avec Abū l-Barakāt Ibn Kabar, Faḍl-Allāh Ibn al-Suqā‛ī ou al-Mufaḍḍal ibn Abī l-Faḍā’il, l’activité des historiens coptes évoluera encore plus loin dans le sens de l’intégration, à la fois stylistique, thématique et méthodologique, dans
l’historiographie arabo-musulmane dominante.14 Dans le domaine du droitdroitdroitdroit, on procède à la compilation, classification et explication de ses sources, de ses principes et de ses multiples applications. Pour donner sa juste valeur à ce domaine de la littérature copto-arabe, et arabe chrétienne en général, il faut se rappeler l’importance du droit dans la société islamique et sa place dans la littérature arabe, de même que l’autonomie juridique dont jouit chaque groupe confessionnel non-musulman. De plus, le développement des études juridiques à un moment donné indique clairement un statut de dignité sociale acquis par le groupe en question, de même que son affirmation positive à l’égard du reste de la société. Nous ne parlons pas ici de l’activité courante des chefs communautaires, élucidant ou promulguant des réglementations ecclésiastiques et civiles: en l’occurrence, les patriarches coptes semblent avoir été les seuls à rédiger pareils textes systématiquement en arabe, dès le
12 GCAL, I: 470-472 (§ 136); CE, V: 1366b-67b (P.M. Fraser). Malgré des traces de sources grecques évidentes, la chronique a dû avoir été rédigé en copte et, plus tard, traduite en arabe avant de passer à l’éthiopien: la seule version qui nous soit parvenue. Reprint de la trad. angl. de R.H. Charles (plus précise que celle de Zotenberg) en 1981 (Amsterdam: Philo Press). Trad. allem. partielle (sur la Conquête arabe etc.) in: Altheim/Stiehl 1971: 356-389. Voir aussi la nouvelle analyse historico-littéraire de A. Carlie, «Giovanni di Nikius, cronista bizantino-copto
del VII secolo», in: N.A. Stratos (ed.), Byzantion: Aphierôma ston Andrea N. Strato/Byzance: Hommage à André
N. Stratos, II (Athènes, 1986), pp. 353-398. [Je remercie Mme Amanda-Alice Maravelia, Athènes, de m’avoir procuré une copie de cette longue étude]. 13 Voir les analyses qu’en fait Den Heijer 1996: 83-95. Pour al-Makīn en particulier, voir aussi la contribution de
Wadi A. in: A‛māl al-Nadwa 7, pp. 5-24. La traduction française annotée de la partie ayyoubide (éd. Cahen,
Damas, 1958) est entre-temps apparue sous le titre de Chronique des Ayyoubides (Paris: Académie des Belles-Lettres, 1994). Une trad. portugaise partielle de la partie I (éd. Th. Erpenius, Leiden, 1625) due à (l’arabisant médiocre) António Caetano Pereira (1799-1867), qui prétend avoir entrepris aussi une révision de la trad. latine, est conservée dans le Codex 12976, bilingue, de la Bibliothèque nationale de Portugal à Lisbonne. 14 Éléments nouveaux sur les rapports entre Ibn al-Kabar et les ouvrages historiques de l’émir mamelouk
Baybars al-Manṣūrī in: Sidarus 2008. Ajouter la note de J. den Heijer in: BAC, 4 (1980), p. 67 (§ 6), qui porte sur les opinions (en général défavorables) de plusieurs chercheurs occidentaux quant à la collaboration en question. Dans les limites de cet exposé, nous ne pouvons pas nous attarder sur la question.
5
XIe siècle.15 On évoque plutôt les travaux de compilation et systématisation désignés
nomocanons et qui, chez les Coptes, au contraire des autres communautés chrétiennes, n’ont
existé qu’en langue arabe.16 Après une première compilation assez rudimentaire datant entre la fin du Xe siècle et le
début du XIe,17 le patriarche Gabriel II Ibn Turayk (1131-1145) et le métropolite Michel de
Damiette (m. peu après 1208) publient d’autres versions plus étoffées.18 Ce n’est pourtant qu’aux XIIIe et XIVe siècles que nous trouverons les collections les plus complètes et les
mieux élaborées en la matière, tel le Nomocanon d’al-Ṣafī Abū l-Faḍā’il Ibn al-‛Assāl, promulgué officiellement en 1238, ou bien le recueil chronologique des sources du droit canonique du moine Macaire, de la première moitié du XIVe siècle, pour ne pas mentionner
d’autres contributions mineures.19 Nous rappellerons qu’al-Mağmū‛ al-Ṣafawī a constitué, depuis lors, le code juridique (religieux aussi bien que civil) de la communauté copte jusqu’à
ces derniers temps et a été adopté par le royaume chrétien d’Éthiopie sous le nom de Fətḥa
Nägäśt. Même les Maronites l’ont adopté partiellement au XVIIIe siècle, non sans les
adaptations nécessaires.20 D’une manière générale, on peut affirmer que, plus qu’ailleurs dans la littérature arabe des Coptes, on trouvera conservée, dans leurs ouvrages canoniques du XIIe au XIVe siècle, la quasi totalité de la production arabe chrétienne en matière de droit romano-byzantin, anté- et post-justinien, et de discipline ecclésiastique anté- et post-nicéenne: littérature canonique pseudo-apostolique et patristique; décrets des conciles universels et des synodes locaux,
d’Égypte et d’ailleurs; canons et règlements médiévaux de l’Église copte, enfin.21
On sait bien que tout renouveau intellectuel sérieux touche, sous une forme ou une autre, le champ linguist iquelinguist iquelinguist iquelinguist ique. Il est difficile de résumer en quelques phrases la richesse et l’originalité 15 Avant d’aborder la question particulière du Patriarche, Brogi 1971 présente et analyse chacune de ses sources, si bien que son étude peut être considérée comme une bonne introduction à ces lois ecclésiastiques coptes de l’époque arabe. 16 Voir de même Brogi 1971, passim, mais aussi les articles bien documentés de R.-G. Coquin in: CE, II: 449a-
451b & VI: 1799 (et plusieurs autres spécifiques du même auteurs: voir l’Index s.v. «Canon Law»). Voir de plus:
U. Zanetti, «Le Nomocanon du Ms. St.-Macaire 267 (can. 2)», ParOr., 16 (1991), 189-206. 17 Collection de traductions de textes coptes, surtout pseudo-apostoliques et synodaux, due à Abū Ṣālih/Ṣulḥ
Yū’annis ibn ‛Abd Allāh; voir GCAL, II: 320; Samir 1990: 449. 18 Nous parlons des deux collections in: Sidarus 2006: 199. 19 À noter la multiplication du genre urğūza (poème didactique) abordant des thèmes particuliers, comme le régime des héritages (Abū l-Farağ Ibn al-‛Assāl) ou les formes et conditions valides du baptême (Athanase de Qous), etc. - A propos de la collection de Macaire, voir l’éd./trad. partielle, passé inaperçue, par Stefan Leder,
Die arabische Ecloga: Das vierte Buch der Kanones der Könige aus der Sammlung des Makarios, Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 12 (Frankfurt a.M.: Löwenklau Gesellschaft, 1985). 20 Sur tout cela, voir les données rassemblées par Samir (1985: 642-644) et Wadi (1997: 106-108). Pour la
version éthiopienne, voir à présent: Encyclopaedia Aethiopica, ed. by S. Uhlig, vol. II (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 2005), p. 534a-535b (on notera l’absence de référence à l’importante analyse de l’ouvrage
entreprise par ‛Abd al-Samī‛ M. Aḥmad, Le Caire, 1965, et signalée par Samir, loc. cit.). 21 Voir l’aperçu général de W. Selb, «Christian Orient and Christian Arabic Works of Law», in: Antike Rechte im
Mittelmeerraum (Wien, Köln, etc.: Böhlau Verlag, 1993), pp. 170-188.
6
du mouvement linguistique qui a marqué la Renaissance copte arabe et que des recherches
récentes ont mis en valeur.22 Jusque vers le milieu du XIIIe siècle, la seule activité des Coptes dans ce domaine aura consisté à maintenir, sans altération de fond, une tradition lexicographique à la fois tributaire de la toute première culture pharaonique et de l’hellénisme antique. Aucune trace de grammaire ou d’une quelconque perspective analytique de la langue. C’est donc sur ce point, avant tout, que les savants coptes de l’âge d’or réaliseront une œuvre absolument nouvelle, pour laquelle ils ont dû se mettre, à l’instar des juifs andalous pour l’hébreu ou d’autres
peuples médiévaux, à l’école de la philologie arabe.23 Plus tard, ils deviendront, à leur tour, les maîtres des Éthiopiens dans ce domaine.
C’est la muqaddima (c’est ainsi que seront appelées ces grammaires copto-arabes) de l’évêque Jean de Samannoud/Sebennetos qui en aura donné, vers le milieu du XIIIe siècle, la première impulsion. Elle aura servi de modèle constant jusqu’à la parution, plus d’un siècle
plus tard, de la Qilādat al-taḥrīr de l’évêque Athanase de Qous (fl. env. 1360-75): la grammaire médiévale la plus complète, la plus pertinente et la mieux structurée de l’idiome copte, sahidique et bohaïrique tout à la fois.
Le travail de lexicographie pour sa part, sous forme de vocabulaires (sullam = scala,
‘échelle’ 24) bilingues ou trilingues (grec-copte-arabe), a repris, systématisé et enrichi les courants anciens: onomasiologique ou thématique, d’origine pharaonique, et alphabétique ou du type glossaire, d’origine grecque. Mais il a été aussi introduit de nouveaux genres
dépendant de la tradition arabe, dont le vocabulaire rimé (sullam muqaffā) mis en œuvre
presque simultanément par Abū Šākir Ibn al-Rāhib et Abū Isḥāq ibn al-‛Assāl.25 Il convient de signaler que l’intérêt philologique des auteurs coptes de l’époque
accompagne et supporte le travail exégétiquetravail exégétiquetravail exégétiquetravail exégétique. Plusieurs des linguistes se sont aussi distingués comme éminents biblistes. De fait, l’étude systématique de la BibleBibleBibleBible sous les aspects textuel, linguistique, herméneutique et spirituel, a connu, à l’époque qui nous intéresse, un développement sans pareil.
Il faut prendre garde de ne point banaliser l’importance de cette branche du savoir relatif aux sciences humaines. Tous les renouveaux culturels que les peuples et les civilisations ont connus, ont comporté nécessairement l’étude et l’exégèse des textes anciens, religieux ou non. Et la tradition arabo-islamique, sous l’égide de laquelle la nouvelle culture copte s'élaborait, est exemplaire sous ce rapport. C’est tout un humanisme qui émerge de cette approche, si bien qu’on aura pu dire, à propos de l’histoire de l’exégèse médiévale en Europe chrétienne entreprise dans les années 30 à 60 du siècle passé, qu’elle a joué le rôle de catalyseur pour une
22 Voir la bibliographie finale sous le nom de Sidarus, surtout pour les études postérieures à 1993. Noter de même l’éd./trad., restée incomplète, d’une importante collection de textes de tradition sahidique de la fin du XIVe siècle (Khouzam 2002-2004). Sur cette tradition en tant que telle, voir Sidarus 2000b (ignoré par l’auteur); sur le
témoin lui-même, ib., pp. 274-276 (M3) & passim. 23 Voir les aperçus respectifs in HistLangSc. Pour notre domaine en particulier: Sidarus 2000c; 2001; 2004a. 24 Nouvelles perspectives concernant l’origine de cette terminologie in: Sidarus 2000b: 269-270. 25 Sur ce point en particulier, voir à présent: Sidarus 2004b: 7-12.
7
compréhension humaniste de l’univers.26 La tradition copto-arabe du XIIIe siècle serait digne d’illustrer cette vérité. Voyons un peu de quelle manière.
On cherche d’abord à établir un texte critique de l’A. & N.T., qui tienne compte des différentes traditions ecclésiales et linguistiques (on notera bien cette ouverture confessionnelle et méthodologique…). On s’applique ensuite à en fournir une traduction arabe
sûre, donnant naissance ainsi à la «vulgate arabe» de plusieurs textes bibliques.27 Mais on s’intéresse aussi à comprendre correctement et profondément le message des textes sacrés, traduisant les commentaires de l’âge patristique et d’autres provenant des différentes confessions chrétiennes, ou bien en en composant des épitomés et des florilèges plus ou moins thématiques. On assiste de plus à la rédaction originale de multiples commentaires, tels que ceux d’Ibn Kātib Qayṣar, probablement le plus grand exégète de la nation copte, ou bien du moine Buṭrus al-Sadamantī, comparé à Jean Chrysostome. Les prêches dominicaux ne manqueront pas, au Caire du moins, de prendre cette tournure, rappelant les homélies des
anciens Pères de l’Église, qui s’y trouvent du reste abondamment invoqués,28 à part le style
arabe recherché connu par sağ‛. A côté des écrivains bien connus, tels al-Mu’tuman Ibn al-‛Assāl ou Abū l-Barakāt Ibn Kabar, c’est Buṭrus al-Būšī, l’évêque du vieux-Caire vers le
milieu du XIIIe siècle, qui semble être le meilleur représentant de ce courant.29 Enfin, on s’adonne à la réflexion épistémologique, comme l’a fait Pierre de Sadamant, auquel il a été fait allusion, dans un traité presque unique dans son genre.
En matière de théologiethéologiethéologiethéologie, le panorama traditionnel change considérablement. On passe
d’une perspective simplement didactique ou pastorale, ou bien encore apologético-polémique interconfessionnelle chrétienne, au grand débat religieux fondé sur la logique et la philosophie universelles, grâce entre autres à la pratique des controverses religieuses, publiques ou privées, qui surgissent depuis le Xe siècle avec les premiers fatimides. On notera, de plus,
l’influence de la théologie scolastique musulmane, le kalām, dont le grand représentant, Faḫr al-Dīn al-Rāzī (1149-1209), s’avère particulièrement apprécié.
26 E. M. Buytaert, dans sa préface à H. Hailperin, Rashi and the Christian Scholars (Pittsburgh PA, 1963), p. ix: «A Catalyst of Universal Humanist Understanding». 27 Sur la célèbre traduction des évangiles d’Abū l-Farağ Ibn al-‛Assāl, voir l’éd. critique de l’Introduction par A. Wadi in: SOC/C, 39 (2006) 47-120. Études antérieures sur l’ouvrage par le même Wadi in: ib., 24 (1991) 215-224 & BSAC, 42 (2003), 127-135. Analyse plus détaillée de S. Kh. Samir in: EtArChr. 4, pp. 441-551. 28 Au sujet de l’arabisation de l’héritage patristique, voir les observations de Rubenson 1996. Signalons la
récente éd. du florilège en question, de 1078: I ‛tirāfāt al-Abā’ (Dayr al-Muḥarraq/Le Caire, 2002). 29 J.M. Faltas, Athanasius the Great as a Source for the Theology of Bulus al-Bushi (Athènes, 1994), thèse de
doctorat dont des sommaires arabes ont été publiés dans la revue Dirāsāt Abā’iyya wa-Lāhūtiyya (Heliopolis, Cairo: Ma‛had al-Abā’ al-Urṯūñuksī), nº 2 (1998) et numéros suivants. Dans un homiliaire pour les fêtes du Seigneur, qui remonte au XIIIe/XIVe siècle, notre évêque est le seul à figurer aux côtés des célèbres Pères de
l’Église; voir entre autres la note de S. Kh. Samir in: Muséon, 89 (1976), 91-95, complétant une célèbre étude de
J.-M. Sauget de 1974. Ajouter aux autres références indiquées dans l’Essai (Sidarus 1993: n. 27): BAC, 7 (1992),
83-84 (nouveaux mss.); ParOr., 16 (1991), 207-226 (art. de Kh. Alwan) & 22 (1997), 503-565 (art. de N. Edelby).
8
Le tournant s’annonce avec le grand théologien spirituel que fut al-Šayḫ al-Makīn Sim‛ān Ibn Kalīl, dont on n’admet pas encore que sa production littéraire se situe, en vérité, dans la première moitié du XIIIe siècle, si bien que nous avons longuement présenté son œuvre dans
notre essai sur la pré-Renaissance.30 Sa Rawḍat al-farīd / wa-Salwat al-waḥīd («Jardin du solitaire et consolation de l’ermite») est un chef-d’œuvre de théologie dogmatique, morale et
spirituelle, rédigé en prose rimée (sağ‛). Plus jeune, se distingue aussi un autre haut fonctionnaire, le prêtre et médecin al-Rašīd Abū l-Ḫayr ibn al-Ṭayyib al-Mutaṭabbib, dont le
principal ouvrage théologique, Tiryāq al-‛uqūl («La thériaque des esprits»), a été rédigé à la demande d’un vizir ayyoubide et où l’argumentation logique est privilégiée, alors que
systèmes religieux et philosophiques sont ouvertement discutés.31 Mais c’est certainement al-Ṣafī Ibn al-‛Assāl (env. 1205-1265) qui fut la figure la plus originale en matière de théologie copte arabe, l’un des plus grands apologistes chrétiens de langue arabe, sinon l’un des plus
grands penseurs chrétiens médiévaux.32 Par ailleurs, se développent la systématisation et le traitement encyclopédique des sciences
divines et ecclésiastiques, donnant naissance à plusieurs sommes théologiques récemment
analysées33 et qu’on ne manquera pas de mettre en parallèle avec celles qui surgissent à la même époque dans les autres communautés chrétiennes, y compris dans le monde latin. Nous
avons ainsi les sommes théologiques d’Ibn al-Râhib, Kitāb al-Burhān, d’al-Mu’taman Abū
Isḥāq Ibn al-‛Assāl, Mağmū‛ uṣūl al-dīn, et d’Ibn Kabar, Miṣbāḥ al-Ẓulma. Moins encyclopédiques ou philosophiques, mais non moins appréciés, nous trouvons, plus tard, vers le terme du mouvement de renouveau qui nous occupe, les ouvrages théologiques de Yūḥannā Ibn Sabbā‛ et d’al-Makīn Ibn al-‛Amīd, le Jeune.
Ce dernier théologien était médecin, en même temps que haut fonctionnaire public,
répétant un peu l’itinéraire de son aîné d’un siècle, Abū l-Ḫayr ibn al-Ṭayyib (v. supra). Cela nous amène à poser la question de l’état des choses en matière de sciences naturelles et sciences naturelles et sciences naturelles et sciences naturelles et exactes,exactes,exactes,exactes, et de leur rapport à la spéculation philosophiquespéculation philosophiquespéculation philosophiquespéculation philosophique, dimensions naturellement présentes dans tout renouveau intellectuel, y compris dans les mouvements analogues d’autres minorités religieuses en Terre d’Islam.
D’une manière générale, le milieu égyptien était loin de se comparer à celui de Bagdad ou même de Cordoue. D’un autre côté, hors d’Alexandrie, ce genre d’activité de l’esprit était presque nul à l’époque gréco-romaine ou byzantine, et il fut, de fait, très peu représenté dans
30 Sidarus 2006: 201-205 (nous avons pu entre-temps confirmer que la date du colophon problématique du ms.
Paris ar. 43 est en réalité 603 A.H. et non 703 A.H. !). Voir en tout cas, à part GCAL, II: 336-338 (§ 109) et
Cheikho/Héchaïmé 1987: 91-92 (§ 90), l’art. de S. Kh. Samir in: OCP, 43 (1977), 135-160, et sa brève notice in:
Islamocristiana, 2 (1976), 230-232. 31 À part GCAL, II: 344-348 (§ 112), voir l’art. de Wadi A. in: SOC/C, 28 (1995), 271-284, et de H. Zanetti in:
ParOr., 28 (2003), 667-701 (éd. des ch. 20-21 du Tiryāq, sur les icônes et la croix). 32 Mis à part les travaux de S. Kh. Samir signalés dans l’Essai (Sidarus 1993: 455, n. 29), dont ici Samir 1985, la
plus récente mise-au-point bio-bibliographique est de Wadi A. (1997: 97-116), qui reprend son article in: SOC/C,
20 (1987), 119-161. Voir aussi BAC, 6 (1990), 41-46. 33 Sidarus 2008. On trouvera dans cette étude une mise à jour des données concernant les auteurs respectifs.
9
la littérature copte autochtone.34 On ne s’étonnera donc pas que la chose se soit maintenue au
Moyen Âge. Pour reprendre ce que nous écrivions dans notre Essai (Sidarus 1993: 457): «Les Coptes avaient de tout temps exercé la médecine, comme d'autres groupes minoritaires d’Égypte. Mais leur médecine était essentiellement pratique, sans doute en étroite dépendance du legs pharaonique ancien..., et encore sans liaison au monde philosophique et scientifique de
l’aire arabo-islamique.35 Ils tenaient, certes, les comptes de l’État et auraient pu, à ce titre, développer les sciences mathématiques, sous une forme ou une autre. Ils ont préféré, toutefois,
s’en tenir à leur système numérique ésotérique et de calcul traditionnel propre,36 pour des raisons socio-économiques évidentes».
Deux cas de médecins, récemment mis en évidence, font exception dans ce cadre général: Ğirğis Ibn Baḫūm al-Mutaṭabbib, sans doute de la période immédiatement antérieure à celle
que nous considérons dans ces pages,37 et al-Mufaḍḍal ibn Māğid Ibn Bišr al-Kātib (al-Qibṭī), incorrectement désigné dans les histoires littéraires par Ibn Bišr al-Isrā’īlī, vivant au XIIIe
siècle.38 La philosophie, pour sa part, se trouve intimement liée au discours théologique, à l’instar
du kalām musulman. Mais il y a aussi, pour la première fois, des textes autonomes: le Traité
sur l’Âme de la plume d’al-As‛ad Ibn al-‛Assāl; un exposé de logique écrit par son frère al-Mu’tamn Abū Isḥāq; cet exceptionnel traité sur l’herméneutique de Buṭrus al-Sadamantī
mentionné plus haut, ou encore une collection de Dicta philosophorum du même auteur. Mais,
comme ce le fut pour l’astronomie avec Abū Šākir Ibn al-Rāhib (v. supra), on en reste à des cas, somme toute, isolés, une «percée en terre étrangère» sans lendemain. Ils témoignent, quand même, du degré d’intégration culturelle et intellectuelle que les Coptes du XIIIe siècle avaient atteint. Et ils auraient pu avoir été le signal d’un changement de perspective, si ce n’est que les circonstances socio-politiques nées de la dynamique du régime mamelouk qui venait de s’implanter, au milieu du siècle, ont coupé court à cette évolution, comme à l’ensemble du mouvement de Renaissance que nous analysons, aspect sur lequel nous reviendrons plus loin.
34 Voir p. ex. pour la philosophie: CE, VI: 1958; pour la médecine: ib., V: 1578a-82b. Voir aussi Krause 1980: 717-718 (§ XIV); Coquin 1993: 195-196 & 212-213. 35 Cet aspect nous semble se refléter dans les lexiques onomasiologiques mentionnés plus haut, tel qu’exposé in: Sidarus 1999: 393. 36 CE, I: 49a-55a & VI: 1820b-22a; S. Abdel-Shahid in: ICCopSt. 5, 2: 13-22. L’aspect secret de cette procédure devrait être nuancé aujourd’hui, dans la mesure où le système en question, appelé couramment «copte cursif», semble en réalité d’origine byzantine et a été utilisé sous d’autres horizons temporels et géographiques; voir à
présent la partie finale de la note de H. Messiha (Le Monde copte, 24, 1994, 25-27) et la double note de G. Levi
Della Vida et de H. Ritter (Revista di Studi Orientali, Roma, 14, 1933 & 16, 1935). Voir de plus: A. Labarta y
Carmen Barceló, Números y cifras en los documentos arábigohispanos (Córdoba: Universidad, 1988). 37 A. Sidarus, «Une justification originale du ‘monophysisme’ due à un médecin-philosophe copte du XIIe/XIIIe
siècle», in: Études Coptes IX - Onzième Journée d'Études (Strasbourg, juin 2003), éd. par A. Boud’hors et al. (Paris: De Boccard, 2006), pp. 355-366. 38 S. Kh. Samir (CE, VII: 1689) a démontré qu’il s’agissait bien d’un copte, dont le long traité sur la cure des
maladies est rédigé sous la forme d’un poème didactique (urğūza f ī l-ṭibb) de 3500 vers (!), conservé dans un autographe encore inédit de la Bibliothèque nationale de France.
10
Art et architectureArt et architectureArt et architectureArt et architecture
Pour ce qui est de l’art, une observation préliminaire s’impose. Il n’existe guère d’histoire de l’art copte à l’époque islamique. De brèves références, à peine, dans les différents manuels d’art copte en général (un peu plus dans les guides touristiques des églises ou monastères), ou bien des articles traitant de certaines périodes, de certains objets ou de sujets particuliers. On sait d’ailleurs que l’art décrit et étudié comprend l’ensemble de la production artistique de l’Égypte entre la Basse Antiquité helléno-romaine et le Moyen Âge arabe, qu’il s’agisse d’œuvres chrétiennes ou païennes. Pour sa part, le premier art islamique du pays (IXe-XIIIe s.) est grandement tributaire de l’apport copte autochtone. Mais son histoire ne considère pas, en général, les objets et monuments à l’usage de la communauté chrétienne.
Dans ce cadre, n’étant pas spécialiste en la matière, il nous est difficile de dresser un tableau correct et éloquent de la dimension artistique de la Renaissance copte-arabe que nous évoquons ici. Heureusement que pour les XIIe-XIVe siècles, il est apparu, ces derniers temps, une série de travaux spécialisés, à la suite de récentes campagnes de restauration des monastères, ou d’étude systématique des trésors du Musée copte et même de certaines églises
du Vieux-Caire.39 Mais en faire la synthèse déborde le cadre de nos compétences et de notre
objectif immédiat.40 Nous devons nous suffire de quelques notes et observations éparses. Le mécénat culturel des hauts fonctionnaires et des riches marchands coptes a concerné les
activités artistiques autant que littéraires. On peut même dire qu’il favorisé d’abord les premières, si bien que le renouveau artistique aura précédé le renouveau intellectuel. C’est
déjà au XIIe siècle, comme nous le montre l’Histoire des églises et monastères d’Abū Ṣāliḥ /
Abū l-Makārim, que de nombreux édifices religieux sont restaurés et embellis.41 Et on constate facilement, à la lecture des chapitres et des quelques études de détail sur l’art copte à l’époque islamique, que les principaux matériaux qui nous permettent d’en étudier les propriétés datent précisément des XIIe et XIIIe siècles: que ce soit pour l’art du livre (reliure, calligraphie, enluminures, miniatures), pour les icônes et les peintures murales, pour les boiseries et la marqueterie, pour les tissus et les objets d’ivoire ou de métal.
A l’instar de la littérature et de la vie intellectuelle, l’art de l’époque manifeste une grande ouverture aux courants dominants de la société environnante, en l’occurrence, les formes et solutions venues de la Mésopotamie abbasside. Mais une ouverture et une assimilation qui ne renient point l’identité propre. Pour reprendre les termes de P. du Bourguet (1968: 167): «Non pas dépendance mais interdépendance; l’orientation nouvelle passe sans heurt dans le mouvement de fond de l’art copte». Et M. Zibawi (1995: 201), de son côté, caractérise l’art de
39 Voir quelques éléments dans l’Annexe bibliographique. Comme pour la littérature (v. supra n. 4), les lecteurs
pourront consulter les Reports réguliers sur la matière dans les actes des congrès de l’Association Internationale d’Études Coptes. 40 Une synthèse utile au chap. 6 (profusément illustré) de Zibawi 1995: 163-201, spéc. 163 ss.; voir aussi Zibawi 2003. 41 Martin 2000, étude qui se base précisément sur cette topographie sainte historique. Jadis attribué à Abū Ṣāliḥ al-Armanī et aujourd’hui presque complet, cet ouvrage représente une rédaction à plusieurs mains dont le gros daterait entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, et semble être dû à Abū l-Makārim Sa‛dallāh ibn Mas‛ūd, voir: Den Heijer 1996: 77-81; Sidarus 2006: 206-209.
11
cette époque dans ces termes: «Enraciné, solide et unifié, novateur et original, l’art copte s’impose. De l’art monumental à l’art du livre, son œuvre innove en multipliant ses épiphanies. Brillant de tout son éclat durant l’époque médiévale, elle s’essouffle au XVIe siècle et perd progressivement ses fondements et sa vision unificatrice».
Nous aimerions illustrer cette brève caractérisation par deux exemples ayant trait l’un à l’art du livre et l’autre à l’architecture.
Émile Blochet, le célèbre catalogueur des manuscrits arabes et islamiques de la Bibliothèque nationale de France, avait qualifié le manuscrit copte 13, datant de 1180, d’
«incunable de la peinture mésopotamienne du XIIIe siècle».42 En effet, cet évangéliaire luxueux, copié et illustré (plus de 77 peintures !) par l’évêque Michel de Damiette et son entourage, à l’usage du Patriarche Marc III Ibn Zur‛a (1169-89), semble être le plus ancien
spécimen de ce nouveau courant, à la fois islamo-abbasside et syro-chrétien.43 De toute façon, il représente une harmonieuse synthèse entre l’héritage égypto-byzantin et le nouvel art de la peinture islamique, comme l’ont démontré deux thèses de doctorats restées inédites et, en
conséquence, peu connues.44 Et d’autres précieux codex bibliques bilingues du N.T., datant du XIIIe siècle, en particulier les deux volumes du N.T. commandités par le susdit notable
Abū Šākir Ibn al-Rāhib, continuent et développent ce nouveau courant local.45 Le deuxième exemple nous est fourni par l’histoire de l’architecture militaire ayyoubide.
Saladin le Grand, en pleine guerre contre les Croisés, engage deux architectes chrétiens, Abū Manṣūr et Abū Maškūr, pour édifier la nouvelle enceinte du Caire et la fameuse citadelle du Moqattam. Malheureusement, il ne reste plus traces des palais privés de cette époque, parmi
lesquels certains ont appartenu à des hauts fonctionnaires coptes,46 pour en savoir plus sur les caractéristiques et tendances de cette architecture à l’époque de la Renaissance copte du Moyen Âge.
Langue copte et héritage grecLangue copte et héritage grecLangue copte et héritage grecLangue copte et héritage grec
42 É. Blochet, Les enluminures des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale (Paris, 1926), p. 51. C’est
clair qu’incunable, ici, est pris dans son sens original de «berceau, débuts». 43 Farès 1953 & 1961; Papadopoulo 1972 & 1973. Sur l’histoire du ms., voir l’article de S. Emmel in: JCopSt. 6
(2006), 5-23. Sur l’art mésopotamien en question, hors de la miniature, voir p. ex.: L’Orient de Saladin (Paris:
IMA, 2001), passim; un cas particulier in: Snelders/Immerzeel 2004.
44 Samy Shenouda, The Miniatures in the Paris Manuscrit “Copte 13» (Ph.D. diss., Princeton University, 1956);
G. Theodoraki, Les enluminures du ms. copte 13 de la B.N. (thèse, Université Paris-Sorbonne, 1966). En vérité, ce codex a été étudié et exposé à plusieurs reprises. A notre connaissance, la plus importante analyse et
discussion de la pièce sont dues à Leroy (1974: 113-148 & 217-228 + pl. 44-74 & passim). Expositions récentes
à Paris: Institut du Monde Arabe, 2000 (L’Art copte, p. 78, n° 56) et Bibliothèque nationale de France, 2001
(L’art du livre arabe, p. 131, n° 94) & 2004 (Pages chrétiennes d’Égypte, nº 12). 45 Voir Hunt 1985 & 1994; MacCoull 1994 & 1996; et passim in: Crammer 1964; Leroy 1974; Zibawi 1995 & 2003. 46 Les sources font mention explicite d’au moins deux d’entre eux: celui des Banū al-‛Assāl et celui des Banū Kabar (de la famille d’al-Šams Abū l-Barakāt).
12
En proposant l’exemple de ladite Renaissance copte comme point de comparaison avec le cas syriaque, on ne peut éluder la question de l’usage de la langue copte durant cette
période.47 À quoi correspondait exactement l’intérêt démontré par les philologues de l’époque à l’étude de leur langue nationale ? Rédigeait-on encore en copte ? Est-ce qu’on noterait une activité de traduction significative, que ce soit du copte à l’arabe ou vice-versa ? Si l’arabisation des habitants de la Vallée du Nil avait pris du retard par rapport aux autres populations du Proche-Orient, elle y a été plus radicale, éliminant définitivement la concurrence de la langue nationale. Le fait que les histoires littéraires du copte s’arrêtent au
Xe-XIe siècle, indique bien cette réalité.48 D’après la nouvelle documentation aujourd’hui
disponible, le milieu du XIe siècle constitue vraiment le terminus ad quem de l’emploi courant du copte: dans les annales ecclésiastiques, c’est vers 1051 que l’évêque Michel de Tinnis
(Basse-Égypte) rédige la dernière série copte des Vies des Patriarches,49 alors que du Fayoum
nous viennent les derniers documents d’archives coptes, encore sur papyrus.50 Durant ces deux siècles, par contre, on assiste à une grande activité de traduction copte-arabe et de copies
de textes anciens, menant, fort malheureusement, à la destruction des originaux.51 Curieusement, c’est à ce moment aussi, déjà au IXe siècle, que surgit la poésie copte,
exclusivement religieuse.52 Elle se poursuit dans les siècles postérieurs, jusqu’au XIVe siècle peut-être, sous la forme des doxologies, psallies, théotokies, etc. qu’on trouve dans différents
ordos liturgiques,53 et alors en bohaïrique et adoptant fréquemment le modèle de la poésie arabe quant à la rime et à la structure strophique. Al-Mu’taman Ibn al-‛Assāl invoque cette
réalité pour justifier la composition de son lexique «rimé» (v. supra), même si le système d’emploi d’une seule lettre, par mimétisme du modèle arabe, s’avère peu adéquat à ce
propos.54
Ibn al-‛Assāl parle aussi de compositions en prose rimée (sağ‛), et son collègue, le grammairien al-Wağīh al-Qalyūbī (m. ap. 1271), manifeste une démarche qui prend en
47 Je remercie Youhanna Nessim Youssef, Melbourne, pour l’aide inlassable qu’il m’a dispensée dans la rédaction de cette section. 48 Doresse 1955; Krause 1980; Orlandi 1970: 59-158 & 1993; Coquin 1993b. Voir aussi Simon 1938. On notera
bien qu’il n’existe aucun manuel d’histoire littéraire à proprement parler, à peine de simples notices ! Dans Al-
Adab al-qibṭī qadīman wa-ḥadī�an (Le Caire: Maktabat al-Hilāl, 1962), Muḥammad Sayyid al-Kīlānī traite en fait de la littérature arabe des Coptes, essentiellement celle du XXe siècle (!); le Moyen Âge y est traité très sommairement, avec pas mal d’erreurs et de malentendus, dans le chap. 1 (pp. 5-23). 49 Cela a été définitivement établi par Den Heijer 1987: 153-156; voir aussi du même «Mīḫā’īl, évèque de
Tinnīs, et sa contribution à l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie», ParOr, 16 (1990-1991), 179-188, et la
notice bio-bibliographique de Wadi A. in: SOC/C, 31 (1998), 261-292. 50 Voir entre autres: Leslie MacCoull, «The Teshlot Papyri and the Survival of Documentary Coptic in the 11th
Century», OCP, 55 (1989), 201-206; C. Gaubert/J.-M. Mouton, «Présentation des archives familiales d’une
famille copte du Fayoum à l’époque fatimide», in: ICCopSt. 7, pp. 505-518. 51 MacCoull, «The Teshlot Papyri...». 52 K.H. Kuhn, «Poetry», in: CE, VI: 1985-86; Krause 1980: 717 (§ XIII); Coquin 1993: 212. 53 Voir dans CE les entrées «Difnar», «Doxology», «Psali», «Psalmodia», «Theotokion» etc. Pour le Difnar ou
Antiphonaire en particulier, voir les plus récentes recherches de G. Gabra in: BSAC, 35 (1996) & 37 (1998). 54 Sidarus 1978a: 279, n. 38; 1978b: 130, n. 16; 2004b: 8-9.
13
considération cette activité, ou du moins la traduction de l’arabe au copte.55 Mais rien ne nous est arrivé de leur époque ! Hormis le genre de poésie tardive susmentionné, qui n’a pas encore été suffisamment étudié, et les écrits stéréotypés de la chancellerie patriarcale concernant les
actes ecclésiastiques,56 on ne rédige donc pas en copte à l’époque de la Renaissance égyptienne chrétienne du bas Moyen Âge, au contraire d’autres groupes ethnolinguistiques de la région, toutes religions considérées ! L’effort d’analyse et de compilation philologiques retracé plus haut pouvait bien avoir en vue un renouveau éventuel de la langue nationale copte, le fait est que celui-ci n’a pas abouti vu les circonstances néfastes qui ont coupé court à l’essor culturel et intellectuel de l’âge d’or et que nous allons évoquer tout de suite.
Il faut pourtant signaler que, si au début du XIIIe siècle, on trouve encore quelqu’un, probablement un moine de S. Macaire, capable de composer en copte bohaïrique (le dialecte
ou idiome de la Basse-Égypte) un récit de martyre, assez artificiel,57 de l’époque qui nous occupe ici, des premières décennies du XIVe siècle plus précisément, deux textes nous sont parvenus en sahidique (dialecte de la Haute-Égypte et idiome de la littérature copte classique). D’abord, un autre récit de martyre, celui de Barsoum le Nu (Barṣūm al-‛Uryān), mort en
1317.58 Et puis, en 1322, le Triadon: ce long poème à contenu religieux, originellement de
732 quatrains, qui représente le «chant du cygne» de la littérature en langue copte.59 Tout en y déplorant le déclin irrémédiable de la langue et de la culture nationales, le moine anonyme s’exprime dans une langue artificielle, sinon barbare, et ne peut s’empêcher d’adopter pour
son entreprise – comme nous l’avons jadis signalé 60 – le moule poétique arabe du mu�alla�, qui se trouve diffus dans les hymnes religieuses évoquées plus haut (tout comme dans les
poèmes didactiques copto-arabes...) et dont le terme triadon n’en est que l’équivalent gréco-copte inventé de toute pièce par l’auteur.
55 Sidarus 1978a: 269; 2001: 68. Voir aussi Sidarus 1978a: 273. 56 Je m’imagine que c’est à cet effet qu’on trouve, un peu partout dans les lexiques onomasiologiques ou les miscellanées philologiques, des listes de correspondance anthroponomastique et toponymique; voir entre autres: Sidarus 1978b: 139, n. 54. 57 Jason R. Zaborowski, The Coptic Martyrdom of John of Phanijōit: Assimilation and Conversion to Islam in
Thirteenth-Century Egypt, The History of Christian-Muslim Relations, 3 (Leiden: E.J. Brill, 2005). Nous parlons plus en détail de ce texte in: Sidarus 2006: 211-212 – où sont signalées, du reste, d’autres études sur ce texte
intrigant. Ajouter le résumé qu’en donne le propre auteur in: ICCopSt. 8, 2.2: 657-665. Voir de plus la longue
recension de l’ouvrage para C. Décobert in: Collectanea Christiana Orientalia (Córdoba), 4 (2007), 498-502.
58 Il s’agit en réalité d’un fragment douteux (extrait ou résumé ?), publié par W.E. Crum avec le texte arabe
originel in: Publications of the Society of Biblical Archeology (London), 29 (1907), 192-195; cf. CE, I: 348b-349a. 59 Le texte nous est parvenu acéphale et assez fragmentaire: GCAL, II: 446-447 (§ 135.4); Coquin 1993: 212.
Version angl. (ignorée) de Leslie MacCoull in: Greek Orthodox Theological Revue (Brookline, Mass.), 42
(1997), 83-148. Un étude de détail: P. Nagel «Der Lanzenstich Joh. 19,34 im Triadon (Vers 487)», JCoptS. 1 (1990); 29-35. 60 Sidarus 1978a: 272. Cette observation est passée inaperçue aux yeux des auteurs qui ont postérieurement analysé ce texte ou parlé de la poésie copte tardive !
14
Curieusement, cette composition est prodigue en grécismes 61 à telle enseigne que l’on peut postuler un modèle grec pour une partie au moins du texte. Cela nous invite à rappeler la connaissance de cette langue et le poids de l’ancien héritage qu’elle véhiculait jusqu’à une
époque tardive en Égypte, au Ṣa‛īd précisément.62 Et relever, du même coup, que si l’essentiel de l’apogée de la culture arabo-copte s’est manifesté en Basse-Égypte au XIIIe siècle, début du XIVe, c’est là qu’à la deuxième moitié de ce dernier siècle, dans un contexte
linguistique, culturel et socio-politique propre, que se clôt véritablement ce cycle,63 avec le dernier représentant de cette glorieuse époque, l’évêque Athanase de Qous déjà mentionné
plus haut.64
Contexte socioContexte socioContexte socioContexte socio----politiquepolitiquepolitiquepolitique
Qui connaît un peu l’histoire d’Égypte aux XIIIe et XIVe siècles – pour ne pas parler du monde musulman dans son ensemble, où, entre autres, plusieurs minorités religieuses ethniques ont été déplacées ou bien totalement islamisées – trouvera étonnant que la renaissance des Coptes, ici ébauchée, ait pu avoir lieu à ce moment-là.
A première vue, les conditions socio-politiques étaient plutôt adverses: fin de l’ère fatimide et entrée en force du sunnisme rigoureux; double attaque des Croisés contre l’Égypte et mobilisation générale du pays contre eux. Plus tard, ce sera l’arrivée au pouvoir de la soldatesque mamelouke et les constantes luttes internes pour accéder à l’autorité suprême, ou pour la récupérer. Puis, une nouvelle mobilisation, cette fois-ci contre l’avancée mongole. Enfin, les vagues successives de vexations, voire de persécutions, officielles ou populaires,
menant à la conversion accélérée des élites coptes, etc.65 Du point de vue de la communauté copte elle-même, la situation n’était guère plus
brillante. Il y avait les luttes incessantes autour de la succession patriarcale; les vacances du
61 Voir le relevé annoté dans la traduction commentée de P. Nagel, Das Triadon: Ein sahidisches Lehrgedicht
des 14.Jhs. Wissenschaftliche Beiträge 1983/23 (K 7) (Halle/Saale: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1983), pp. 147-175. 62 Sidarus 2000b: 292-294. Aux témoins d’origine grecs, ajouter les fragments coptes du Roman d’Alexandre,
qui dateraient du XVe siècle d’après l’éditeur U. Bouriant (cf. CE VII: 2059-60). 63 Voir sur ce point nos observations dans Sidarus 1978a: 273, à compléter par ce que nous avons pu découvrir en analysant la tradition sahidique de philologie gréco-copto-arabe (Sidarus 2000b: 292-294). 64 Dernière mise-au-point sur cette figure: Sidarus 1976, avec des compléments in: Sidarus 2000b: 291 & 293-4; 2001: 70-74; quelques corrections et précisions de transmission textuelle, qui n’avaient pas pu être prises en
considération dans ce dernier article (délivré originellement avant 1993 !) in: Sidarus 1997, passim. Voir de plus
les contributions de Y.N. Youssef in: Coptica, 2 (2003), 106-121 & in: Christianity and Monasticism in Upper
Egypt II, ed. by G. Gabra (Cairo: American Univ. of Cairo, forthcoming). Le procès-verbal, a été étudié par, du point de vue du développement de certains hymnes, et U. Zanetti préparent une édition du ‘procès-verbal’ de la consécration du Myron en 1374, établi par notre auteur. 65 Parmi les travaux récents, à part la triple entrée de la CE indiquée quelques notes plus bas (où sont signalés les
travaux plus anciens), en plus de «Egypt, Islamisation», de S.I. Cody (CE, III: 396a-342b) et de la double entrée
«Waq‛at al-Kanā’is» et «Waq‛at al-Naṣāra», de M. Megally (CE, VI: 2313b-19a; malheureusement sans
références !), voir: Little 1990; B. Pirone in: SOC/C, 24 (1991), 225-326 (texte d’Ibn al-Naqqāš) & 25 (1992), 5-68 (texte d’Ibn Zibr). Voir aussi Bosworth 1979-80: 27ss. Un écho du malaise généralisé se trouve dans
l’apocalypse de Shenute, qui date précisément du XIVe siècle; voir Jos van Lent in: ICCopSt. 6, 2: 155-168.
15
siège patriarcal prolongées, dont la première, longue de presque vingt ans (1216-35), laissa l’Église avec deux seuls évêques pour chacune des deux régions de la Vallée du Nil; par la suite, le pontificat contesté de Cyrille III Ibn Laqlaq (1235-43), etc.
Malgré tout cela, l’âge d’or de la culture copto-arabe a bien eu lieu, comme nous l’avons vu. Comment expliquer le phénomène ?
Il y a, en premier lieu, et en dépit de tout le reste, le cadre politique général. L’Égypte devenait le nouveau centre politique et culturel de l’islam arabe. Toutes proportions gardées, le Caire remplaçait définitivement Bagdad. Localement, après une brève période de rupture radicale avec le régime égyptien antérieur, passant par une certaine animosité à l’encontre des minorités autochtones, les souverains ayyoubides renouèrent avec la politique de tolérance et
d’ouverture culturelle et religieuse des Fatimides.66 Les victoires de Saladin sur les Croisés
ont rassuré la umma et ses sultans; les Coptes avaient d’ailleurs donné preuve de loyauté à
l’égard de l’État musulman.67 Et l’indépendance politique du nouvel espace ne permettait pas qu’on s’aliène les forces vives locales: fonctionnaires coptes assurant les rouages de l’État et
marchands juifs liés au commerce international (division, bien sûr, approximative).68 Nous avons déjà fait allusion à la reprise des sessions publiques de controverses
religieuses. La célèbre rencontre de saint François d’Assise avec al-Malik al-Kāmil s’insère
dans ce climat général.69 Les sources nous parlent des visites de ce dynaste et d’autres à des monastères chrétiens… Et puis, les grands de ce monde avaient besoin de recourir aux soins
qualifiés des médecins issus des milieux de la bimma.70 La prise du pouvoir par les mamelouks, au milieu du XIIIe siècle, et l’installation de leur
régime militaire ont, certes, modifié considérablement ce cadre quelque peu idyllique. Mais
quand même, c’est plutôt avec le XIVe siècle que les choses changent radicalement.71 Entre-temps, la génération qui avait grandi sous les ayyoubides poursuit son activité de mécénat et de production intellectuelle pour plusieurs décennies. Sinon, la multiplication des concessions territoriales aux émirs mamelouks maintiendra encore pour longtemps – jusqu’à la naissance
66 A propos de la bienveillance des fatimides et ses limites, voir: Kraemer 2004: 9-12; Den Heijer 1999; Samir
1996; A. Ferré, «Fāṭimids...», in: CE, III: 1097a-1100a; Bosworth 1979-80: 26-27; Sidarus 2006: 191-193. 67 A.S. Atiya «Crusades, Copts», in: CE, II: 663b-665b); Sivan 1967; Micheau 1994. 68 Kraemer 2004: 12 ss.; A.S. Atiya, «Ayyūbids», in: CE, I: 314a-315a. Voir aussi Cheikho/Héchaïmé 1983 &
1987, passim. 69 Voir entre autres: J. Gwenolé, Rencontre sur l'autre rive: François d'Assise et les musulmans (Paris: Éd.
Franciscaines, 1996; traduit en différentes langues); J. Hoeberichts, Franciscus en de islam, Scripta Franciscana (Assen: 1994). 70 Ibn Sa‛īd al-Maāribī (2ème moitié du XIIIe siècle), repris par Maqrīzī, relève bien cette particularité (Blachère 1969: 572). Il nous manque encore une monographie sur le sujet. Voir entre-temps différentes notices de
médecins coptes in: CE, passim (cf. index: «Medecine»; «Physicians»); Cheikho/Héchaïmé 1983, passim; Kolta 1990; et le ch. 5 de la récente monographie de Le Coz 2006: 129-136. Pour les juifs: Bosworth 1979-80: 26-27;
EI, svv. «Ibn Abī ’l-Bayān», «Ibn Djāmi‛», «Isḥāḳ b. Sulaymān al-Isrā’īlī», «al-Kōhēn al-‛Aṭṭār»; Doris Behrens-
Abouseif, Fatḥ-Allāh and Ibn Zakariyyā’:Physicians under the Mamluks, Suppl. aux Annales Islamologiques, 10 (Le Caire: IFAO, 1987). 71 D’après Little (1976: 569; cité in CE, III: 940b), c’est durant le demi-siècle qui a suivi la mort du sultan Qalā’ūn (m. 1290) qu’a lieu la seconde grande transformation du paysage religieux égyptien.
16
d’une nouvelle élite musulmane ou islamisée… – l’influence des administrateurs coptes
autochtones un peu partout dans le territoire.72 Du point de vue copte interne, le mouvement culturel du XIIIe siècle a, de fait, été préparé
par le siècle antérieur.73 Et cette préparation fut aussi bien intellectuelle que sociale et économique. A l’époque fatimide, il s’est constitué, progressivement, des familles de hauts
dignitaires coptes (arāḫina, pl. de arḫan < a[ρχων)74 ayant accumulé des richesses et résidant dans la capitale. Or, la richesse permet l’accès à la culture et la pratique du mécénat. Et l’exemple de la société islamique était patent: «noblesse oblige» ... Du côté des hauts fonctionnaires coptes, l’ «obligation» se faisait même double, car ils devaient aussi rivaliser avec leurs confrères musulmans et garantir la survie et l’épanouissement de leur communauté «minoritaire».
C’est d’ailleurs autour des hauts fonctionnaires chrétiens de l’État ayyoubide et des débuts du régime mamelouk que s’articule tout le renouveau littéraire et artistique (culturel et intellectuel) des Coptes. Ils sont tout à la fois mécènes des activités éducatives, littéraires et artistiques, et artisans, à part entière, de la production littéraire. En effet, les principaux écrivains de l’époque appartiennent à cette élite, et leurs titres honorifiques en rendent compte. Mentionnons, à tire d’exemple, les célèbres frères al-‛Assāl, dont al-Ṣafī et al-Mu’taman (abréviations de Ṣafī/Mu’taman al-Dawla = «Serviteur loyal/Préposé ou Homme de confiance de l’État»); ‛Alam al-Ri’āsa («Enseigne/Étendard de l’autorité/commanderie») Ibn Kātib Qayṣar, bibliste et linguiste de renom; le polygraphe Nušū’ al-Ḫilāfa («Vigueur/ Splendeur du Califat») Ibn al-Rāhib; ou encore, Šams al-Ri’āsa («Soleil/Splendeur de l’autorité/commanderie») Ibn Kabar.
On notera, à propos, une autre cause de la vigueur, de l’ampleur et de la qualité du mouvement intellectuel de l’époque: c’est le rôle prépondérant des laïcs, lesquels mènent sur presque tous les fronts. Mais notons bien qu’en Chrétienté orientale, «laïc» ne s'oppose pas tant à «ecclésiastique» qu’à «monastique». Les clercs sont mêlés à la vie des gens, prennent part aux fonctions sociales courantes, mesurent mieux l’enjeu des défis religieux. Nous l’avons constaté pour les prêtres écrivains de l’époque (sans parler d’autres sans production littéraire): un peu à la manière des ulémas musulmans, ou bien des rabbins juifs, ils exerçaient de hautes fonctions administratives, et leurs titres honorifiques – nous l’avons vu – en est le reflet. Et les quelques moines écrivains qui se sont illustrés, quand même, avaient exercé ce genre de fonction avant de «se retirer du monde». En sens contraire, les auteurs laïcs non-prêtres sont souvent diacres, attachés à une église, c’est-à-dire entièrement intégrés dans les structures ecclésiales, qui ne représentent, en définitive, que des structures «communautaires».
Finalement, les Coptes des XIIIe et XIVe siècles ont pu mettre à profit l’immense travail déjà réalisé par leurs coreligionnaires des autres confessions, durant quelque cinq cents ans.
72 Voir Yūsuf 1987: 87-98; Richards 1969; A.S. Atiya, «Mamlūks...», in: CE, V: 1517a-18b; C.F. Petry, «Copts
in Late Medieval Egypt», in: ib., II: 618a-635b. Voir de plus: Cheikho/Héchaïmé 1983 & 1987, passim. 73 Voir sur cette période: Sidarus 2006: 211-213. 74 Sur le terme et l’évolution de son contenu dans la Basse Antiquité égyptienne, voir: L. MacCoull, «Patronage
and the Social Order in Coptic Egypt», in: Egitto e società antica dall’elenismo all’età araba: Bilancio di un
confronto (Atti del Colloquio Intern. – Bologna, 1987) (Bologna: Editrice CLUEB), pp. 500-502.
17
Avec le recul, et bientôt la fin des royaumes latins de l’Orient et l’intégration de l’Ouest du Croissant fertile dans l’État ayyoubide, et puis mamelouk, la circulation des hommes, des idées et des styles artistiques reprend son train. Les chrétiens coptes en ont largement exploité la filière, accueillant le patrimoine ancien élaboré par leurs frères en religion. Et cet héritage précieux, ils l’ont respecté et conservé, puisque les trois quarts environ des textes arabes chrétiens, qu’il s’agisse de traductions ou d’œuvres originales, nous sont parvenus par leur truchement: que ce soit dans les manuscrits copiés par eux, dans leurs compilations
monumentales ou dans leurs propres écrits.75 Ils ont eu sur toute la ligne – exception faite pour la philologie copte – de dignes prédécesseurs et des maîtres dont ils ont su poursuivre admirablement l’œuvre. Entrés en scène vers la fin du long processus d’arabisation totale du Moyen-Orient, les chrétiens d’Égypte ont su assumer le défi de fondre à nouveau ce
patrimoine et d’arabiser résolument la culture chrétienne de la région.76 Les siècles difficiles et obscurs qui suivirent n’auront pas permis à cette nouvelle culture de se développer et de prendre de nouveaux élans.
Ainsi donc, le siècle d’or de la littérature copte d’expression arabe, qui aura constitué l’apogée de la littérature arabe chrétienne jusqu’à l’aube des temps modernes, aura été – quoi qu’en penseraient nombre de mes compatriotes coptes ou collègues coptologues branchés sur le premier millénaire – l’apogée en absolu de la pensée (au sens fort et universel de l'expression) des Chrétiens du sol égyptien et de leur culture érudite.
Vu sous cet angle, le mouvement culturel que nous avons ébauché ne constitue pas stricto
sensu une «Renaissance», mais plutôt un essor de grande envergure qui aura, entre autres, mené à une intégration résolue dans un ensemble culturel universaliste, où certes la contribution de l’Antiquité classique était déjà un fait consommé. On rejoint ici certains questionnements qui ont surgi dans le cadre du présent Symposium, à propos de l’adéquation du terme pour caractériser le mouvement artistique et intellectuel des milieux syro-arabes légèrement en avance par rapport à notre mouvement. Mais A. Mez l’avait adopté, et a permis ainsi sa généralisation, pour désigner l’âge d’or ou apogée de la culture arabo-musulmane
entre le VIIIe et Xe siècle,77 un phénomène dont les caractéristiques se retrouvent mutatis
75 Dans différentes publications sur la littérature arabe chrétienne, S. Kh. Samir affirme que la moitié environ de la production originale est d’origine copte. L’œuvre du plus grand théologien arabe chrétien, le syro-jacobite Yaḥyā Ibn ‛Adī (893-974), nous a été essentiellement transmise par les écrivains et les manuscrits de tradition copte. 76 Pour ce qui est de la théologie arabe chrétienne, voir les réflexions de Samir (1981 & 1988) et de Corbon (1977) . 77 Mez 1927 – ouvrage qui a été traduit dans plusieurs langues et dont le titre «Die Renaissance des Islams» est ambigu, car il s’agit de la Renaissance «du Monde musulman» et non de l’ «islam» en tant que religion ! La question a été discutée, entre autres, par D.S. Margoliouth, dans l’introduction à la version anglaise (London,
1927), et par Joel L. Kraemer, dans son Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the
Buyid Age (Leiden: E.J. Brill, 1986; pb. ed., 1992). Du côté français, un maître tel que R. Blachère (1900-1973) parle plutôt de «renaissance de l’humanisme (!) arabo-islamique» [du VIIIe-IXe s., faut-il entendre] pour
caractériser la situation du Caire à la suite de sa fondation par les fatimides (IVe/Xe s.), in: Colloque du Caire, pp. 95-96.
18
mutandis dans celui que nous venons d’esquisser.78 De toute manière, le concept de Renaissance ayant émergé dans un contexte européen spécifique et quelque peu «idéologique» (le retour à un âge mythique confisqué à son avantage !), il conviendrait de l’expliciter et de le critiquer avant de l’appliquer tel quel à d’autres mouvements analogues. Est-ce que, par
exemple, l’idée de Nahḍa («éveil, ascension, essor»), appliqué par les arabophones pour désigner le mouvement de «renouveau», tout à la fois culturel et intellectuel, qui s’est dessiné au Proche-Orient entre le XIXe et le XXe siècle, ne serait pas plus apte à exprimer la réalité exposée ici ?
78 Sans pouvoir discuter la question ici, nous pensons que c’est aussi le cas du phénomène arabo-hébraïque auquel nous avons fait allusion plus haut.
19
Références bibliographiquesRéférences bibliographiquesRéférences bibliographiquesRéférences bibliographiques79 A‛māl al-Nadwa 7 = A‛māl al-Nadwa al-Sābi‛a lil-Tūrāi al-‛Arabī al-Masīḥī / Actes de la 7ème
Rencontre des Amis du Patrimoine Arabe-Chrétien (Al-Faggalah, Le Caire, février 1999), éd. par Wadi [Abullif] (Cairo/Jerusalem: The Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 1999).
Altheim, Franz & Stiehl, Ruth (1971), Christentum am Roten Meer, Bd. I (Berlin & New York: Walter de Gruyter).
Anawati, G.C. (1990), «The Christian Communities in Egypt during the Middle Ages», in: Gervers/Bikhazi 1990: 237-351.
Idem (1992) = Jūrj Shaḥḥāta Qanawātī, Al-Masīḥiyya wal-ḥaḍāra al-‛arabiyya, 2e éd. (Le Caire: Dār al-Thaqāfa).
Aßfalg, J. (1987), «Christliche Literatur», in: Grundriß der arabischen Philologie, Bd. 2:
Literaturwissenschaft, hrsg. von H. Gätje (Wiesbaden: L. Reichert), pp. 384-393.
*Badawy A. (1978), Coptic Art and Archaeology (Cambridge, Mass.: MIT Press).
*Baer, Eva (1989), Ayyubid Metalwork with Christian Images. Leiden/Boston etc.: Brill Academic Publishers.
Blachère, R. (1969), «L’agglomération du Caire vue par quatre voyageurs arabes du Moyen Âge»,
Annales Islamologiques (Le Caire), 8: 1-26. [Rééd. in: Idem, Analecta, Damas: Institut Français de Damas, 1975, pp. 549-574].
Blachère, R. (1970), «Quelques réflexions sur les formes de l’encyclopédisme en Égypte et en Syrie
du VIIIe/XIVe siècle à la fin du IXe/XVe siècle», Bulletin d’Études Orientales (Damas), 23: 7-19.
[Rééd. in : ibidem, pp. 521-540]. Bosworth, C.E. (1979-80), «The ‘Protected People’ (Christians and Jews) in Medieval Egypt and
Syria», BJRLM, 62:12-36. Brogi, M. (1970-71), «Il patriarca nelle fonti giuridiche arabe della Chiesa copta (dal sec. X al sec.
XIII)», SOC/C, 14: 3-161.
BSAC = Bulletin de la Société d’Archéologie Copte (Le Caire).
Buschhausen, H. (1999), «The Coptic Art under the Fatimids», in: Égypte Fatimide, pp. 549-568.
CE = The Coptic Encyclopedia, ed. by Aziz S. Atiya, 8 vols. (New York: Macmillan, 1991).
CHAL-ABL = The Cambridge History of Arabic Literature – ‛Abbasid Belles-Lettres, ed. by J.
Ashtiany et al. (Cambridge, New York etc.: Cambridge UP, 1990).
CHAL-RLSAP = The Cambridge History of Arabic Literature – Religion, Learning and Science in the
‛Abbasid Period, ed. by M.J.L. Young et al. (Cambridge, New York etc.: Cambridge UP, 1990).
Cheikho/Héchaïmé (1983) = Luwīs Shaykhū (alias Louis Cheikho), ‛Ulamā’ al-naṣrāniyya fī l-Islām
(622-1300) / Les savants arabes chrétiens en islam, texte établi et augmenté, avec introd., notes et
index par Camille Héchaïmé (alias Kamīl Ḥishaymeh), PAC, 5 (Jounieh & Rome).
Idem (1987) = Idem, Wuzarā’ al-naṣrāniyya wa-kuttābuhā f ī l-Islām (622-1517) / Les vizirs et
secrétaires arabes chrétiens en islam, texte établi et considérablement augmenté, avec introd., notes et index par C.H., PAC, 11 (Jounieh/Rome).
ChrArHer. = Studies on the Christian Arabic Heritage (in Honour of Father Prof. Dr. Samir Khalil
Samir S.I. at the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday), ed. by R. Ebied and H. Teule, Eastern Christian Studies, 5 (Leuven, Paris etc.: Peeters, 2004).
ChristOr. = Christianismes orientaux: Introduction à l’étude des langues et des littératures, éd. par
M. Albert et al., Initiation au Christianisme Ancien (Paris: Le Cerf, 1993).
79 L’astérisque indique un travail non consulté, mais dont nous avons une idée par voie indirecte.
20
Colloque du Caire = Colloque international sur l’histoire du Caire, éd. par A. Raymond et al. (Cairo: General Egyptian Book Organisation, 1969).
CopArChr. = Second Woodbrooke-Mingana Symposium on Arab Christianity and Islam (19-22
September 1994): Coptic Arabic Christianity before the Ottomans. Text and Context, ed. by D.
Thomas, in: Medieval Encounters, 2 (Leiden, 1996).
Coptica = Coptica (Los Angeles CA). Coquin, R.-G. (1993), «Langue et littérature arabes chrétiennes» & «Langue et littérature coptes», in:
ChristOr., pp. 35-106 & pp. 167-217.
Corbon, Jean (1977), L’Église des Arabes (Paris: Le Cerf).
Cramer, Maria (1964), Koptische Buchmalerei (Recklinghausen: Aurel Bongers).
Décobert, Christian (dir., 2000), Valeur et distance: Identités et sociétés en Egypte (Paris: Maisonneuve et Larose; Aix-en-Provence: Maison méditerranéenne des sciences de l'homme).
Den Heijer, Johann (1989), Mawhūb ibn Man1ūr Ibn Mufarriğ et l’historiographie copto-arabe:
Étude sur la composition de l’Histoire des Patriaches d’Alexandrie, CSCO, 513 / Subsidia, 83 (Louvain: E. Peeters).
Idem (1996), «Coptic Historiography in the Fātimid, Ayyūbid and Early Mamlūk Periods», in:
CopArChr., pp. 67-98. Idem (1999), «Considérations sur les communautés chrétiennes en Égypte fatimide: l’État et l’Église
sous le vizirat de Badr al-Jamālī (1074-1094)», in: Égypte Fatimide, pp. 569-578.
Doresse, J. (1955), «Littérature copte», in: Histoire des Littératures, vol. 1: Littératures anciennes,
orientales et orales, dir. R. Queneau (Paris: Encyclopédie de la Pléiade), pp. 769-779.
Du Bourguet, Pierre (1968), L’art copte, L’Art dans le Monde (Paris: Albin Michel). [pub. aussi dans d’autres langues dans le cadre de la même collection].
*Idem (1980), Peintures chrétiennes: Couleurs paléochrétiennes, coptes et byzantines (Genève: Famont).
Effenberger, Arne (1975), Koptische Kunst (Leipzig: Koehler & Amelang).
Égypte Fatimide = L’Égypte Fatimide, son art et son histoire: Actes du colloque organisé à Paris les
28, 29 et 30 mai 1998, éd. par M. Barrucand (Paris: Université Paris IV- Sorbonne, 1999).
EtArChr. 4 = Actes du 4e congrès international d'études arabes chrétiennes (Cambridge, septembre
1992), éd. par S.Kh. Samir, in: ParOr., 19 (1994).
*Farès, B. (1953), Le Livre de la Thériaque: Manuscrit arabe à peinture de la fin du XIIe siècle,
conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris (Le Caire).
*Idem (1961), Vision chrétienne et signes musulmans: Autour d’un manuscrit arabe illustré au XIII e
siècle (Le Caire).
GCAL, = Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 5 vols., Studi e Testi, 118, 133, 146, 147, 178 (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944-53).
Gervers, Michael & Bikhazi, Ramzi J. (eds.), Conversion and Continuity: Indigenous Christian
Communities in Islamic Lands, Papers in Mediaeval Studies, 9 (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990).
*Grossmann, Peter (2002), Christliche Archäologie in Ägypten, Handbook for Oriental Studies - Section 1: The Near and Middle East, 62 (Leiden: E.J. Brill). [Inclut les XIIe-XIVe siècles].
HistLangSc. = History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des
Sciences du Langage, vol. I, ed. by S. Auroux et al. (Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2000).
ICCopSt. 5 = Acts of the Fifth International Congress of Coptic Studies (Wasington, D.C. - August
1992), 2 vols., ed. by T. Orlandi and D. Johnson (Roma: Centro Internazionale de Microfichas, 1993).
21
ICCopSt. 6 = Ägypten und Nubien in spätantiker und christlicher Zeit. Akten des 6. Internationalen
Koptologenkongresses (Münster, Juli 1996), hrsg. von M. Krause u. S. Emmel, 2 Bde, Sprachen und Kulturen des Christlichen Orients, 6 (Wiesbaden: Reichert Verlag, 1999).
ICCopSt. 7 = Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of the Seventh
International Congress of Coptic Studies (Leiden, Aug./Sept. 2000), ed. by M. Immerzeel and J.
van der Vliet, 2 vols., Orientalia Lovaniensia Analecta, 133 (Leuven, Paris etc.: Peeters, 2004).
ICCopSt. 8 = Huitième Congrès international d’Études coptes (Paris 2004), éd. par A. Boud’hors and D. Vaillancourt, 2 vols. en 3 tomes, Cahiers de la Bibliothèque Copte, 15-16 (Paris: De Boccard, 2006-2007).
Khouzam, R. Fouad (2002-2004), La langue égyptienne au Moyen Âge: Le manuscrit copte 44 de
Paris de la Bibliothèque nationale de France, vol. I-IIa (Paris, Budapest, Torino: L’Harmattan).80
Kolta, K.S. (1990), «Ärztenamen der kopto-arabischen Epoche», in: Lingua restituta orientalis:
Festschrift Julius Aßfalg, hrsg. von R. Schulz und M. Görg, Ägypten und Altes Testament, 20 (Wiesbaden: Harrassowitz), pp. 190-194 (in-4º).
Kraemer, Joel L. (2004), «Maimonides’ Intellectual Milieu in Cairo», in: Maïmonide philosophe et
savant (1138-1204), éd. par T. Lévy and R. Rashed (Leuven, Paris etc.: Peeters), pp. 1-37.
Krause, Martin (1980), «Koptische Literatur», in: Lexicon der Ägyptologie, Bd. III, hrsg. von W. Helck/W. Westendorf (Wiesbaden: O. Harrassowitz), col. 694-728.
Le Coz, Raymond (2006), Les chrétiens dans la médecine arabe, Peuples et Cultures de l’Orient (Paris, Budapest, etc.: L’Harmattan).
Leroy, Jules (1974), Les manuscrits coptes et copto-arabes illustrés, Bibliothèque archéologique et historique, 96 (Paris: Paul Geuthner).
Little, D.P. (1976), «Coptic Converts to Islam during the Baḥrī Mamlūk Period, 692-755/1293-1354»,
JSOAS, 39: 552-569. Idem (1990), «Coptic Converts to Islam during the Baḥrī Mamlūk Period», in: Gervers/Bikhazi 1990:
263-288. [Suite donnée à l’article antérieur]. Martin, M. (2000), «Chrétiens, juifs et musulmans à la fin du XIIe siècle», in: Décobert 2000: 83-92.
Mez, Adam (1922), Die Renaissance des Islams (Heidelberg). [Reprint Hildesheim: Olms, 1968]. Micheau, F. (1994), «Croisades et croisés vus par les historiens arabes chrétiens d’Égypte», in:
Itinéraires d’Orient: Hommage à Claude Cahen, Res Orientales, 6 (Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient), pp. 169-185.
Mikhail, Maged S.A. (2004), Egypt from Late Antiquity to Early Islam: Copts, Melkites, and Muslims
Shaping a New Society (Ph.D. diss., Univ. of California, Los Angeles, CA).81
Nakhla, Kāmil Ṣāliḥ (1951-54), Silsilat tārīkh al-Bābawāt Baṭārikat al-Kursī al-Iskandarī, 5 vols.
(Dayr al-Suryān; reprint en 1 vol., 2001).82
Orlandi, Tito (1970), Elementi di lingua e letterature copta (Milano: La Goliardica).
Idem (1993), «Literature, Coptic», in: CE, V: 1450b-60a.
*Papadopoulo, A. (1972), Esthétique de l’art musulman: la peinture, 6 vols. (Lille: Service de reproduction des thèses de l’Université). [Abondamment illustré; à l’origine thèse de doctorat à l’Univ. de Paris-Sorbonne].
80 L’auteur est malheureusement décédé avant de finir l’édition intégrale du manuscrit en question. 81 Nous savons gré à l’auteur de nous avoir procuré une copie électronique de son travail. 82 Travail basé principalement sur l’Histoire des Patriarches, mais avec un certain nombre d’extrapolations et de malentendus.
22
*Idem (1973), «Esthétique de l’art musulman: La peinture», Annales (Paris), nº de Mai-Juin, pp. 681-710. [Sommaire du titre antérieur].
*Pauty, E. (1930), Bois sculptés d’églises coptes (époque fatimide) (Le Caire). Paret, R. (1966), «Contribution à l’étude des milieux culturels dans le Proche-Orient médiéval:
l’encyclopédisme arabo-musulman de 850 à 950 de l’ère chrétienne», Revue Historique (Paris), 235 (fasc. 477), 47-100.
Pellat, Charles (1966), «Les encyclopédies dans le Monde arabe». In: Cahiers d’Histoire Mondiale
(Paris), IX/3: 631-658. [Rééd. in : Idem, Études sur l’histoire socio-culturelle de l’Islam (VII e-XV e
siècles), London : Variorum Reprints, 1976, ch. XVIII].
Richards, D.S. (1969), «The Coptic Bureaucracy under the Mamluks», in: Colloque Caire, pp. 373-381.
Rubenson, S. (1996), «Translating the Tradition: Some Remarks on the Arabization of the Patristic
Heritage in Egypt», in: CopArChr., pp. 4-14.
*Rutschowscaya, Marie-Hélène (1992), La peinture copte (Paris: Réunion des Musées nationaux).
Sadek, Ashraf & Bernadette (dir., 2003), Le trésor du monastère de Saint-Antoine, Le Monde Copte, 33 (Limoges).
Samir, Samir Khalil (1985) = Al-Ṣafī Ibn al-‛Assāl, Brefs chapitres sur la Trinité et l'Incarnation, éd., trad. et introd. par S.Kh.S., Patrologia Orientalis, 43, fasc. 3 (= nº 192) (Turnhout: Brepols).
Idem (1981), «Une théologie arabe pour l’islam», Tantur Yearbook 1979-80 (Jerusalem), pp. 57-84. Idem (1988), «Pour une théologie arabe contemporaine: Actualité du patrimoine arabe chrétien»,
POC, 38: 64-98.
Idem (1990), «Christian Arabic Literature in the ‛Abbasid Period», in: CHAL-RLSAP, pp. 446-460. Idem (1996), «The Role of Christians in the Fatimid Government Services of Egypt…», in:
CopArChr., pp. 77-92. Sidarus, Adel (1976), «Athanasius von Qūs und die arabisch-koptische Sprachwissenscahft des
Mittelalters», BiOr., 34: 22b-35b.
Idem (1978a), «La philologie copte arabe au Moyen Âge», in: La signification du bas M.A. dans
l’histoire et la culture du Monde Musulman. Actes du 8e Congrès de l’Union Europ. des
Arabisants et Islamisants (Aix-en-Provence, sept. 1976) (Aix-en-Provence: Edisud), pp. 267-281.
Idem (1978b), «Coptic Lexicography in the Middle Ages: The Coptic Arabic Scalae», in: The Future
of Coptic Studies, ed. by R. McL. Wilson, Coptic Studies, 1 (Leiden: E.J. Brill), pp. 125-142.
Idem (1993), «Essai sur l’âge d’or de la littérature copte arabe (XIIIe-XIVe siècles)», in: ICCopSt. 5, 2: 443-462.
Idem (1997), «Un recueil original de philologie gréco-copto-arabe: La scala copte 43 de la
Bibliothèque nationale de France», in: Scribes et manuscrits du Moyen Orient: Actes des Journées
de codicologie et de paléographie des manuscrits du Moyen-Orient (Paris, juin 1994), éd. par F. Déroche and F. Richard, Pro Libris (Paris: BnF), pp. 293-326.
Idem (1998), «Sullam (Vocabulaire copto-arabe / Coptic Arabic Vocabulary)», in: EI2 , IX: 883b-884a/879b-880a.
Idem (1999), «Contribution des scalae médiévales à la lexicologie copte: Compte-rendu d’un projet
de recherche», in: ICCopSt. 6, 2: 390-404. Idem (2000a), «Onomastica Ægyptiaca: The Tradition of Thematic Lexicography in Egypt through
the Ages and Languages», BSAC, 39: 11-22. Idem (2000b), «La tradition sahidique de philologie gréco-copto-arabe (Manuscrits des XIIIe-XVe
siècles)», in: Études Coptes VII: Neuvième Journée d’Études Coptes (Montpellier, juin 1999), éd. par N. Bosson, Cahiers de la Bibliothèque Copte, 12 (Leuven, Paris etc.: Peeters), pp. 265-304.
23
Idem (2000c), «L’influence arabe sur la linguistique copte», in: HistLangSc., pp. 321a-325b (ch. 47).
Idem (2001), «Medieval Coptic Grammars in Arabic: The Muqaddimāt», Journal of Coptic Studies (Leuven), 3: 63-79.
Idem (2004a), «Le modèle arabe en grammaire copte: Une approche des muqaddimāt copto-arabes
médiévales», in: Le voyage et la langue: Mélanges en l’honneur d’Anouar Louca et d’André
Roman, éd. par J. Dichy et H. Hamzé (Damas: Institut Français du Proche-Orient – Institut Français d’Etudes Arabes), pp. 253-267.
Idem (2004b), «L’œuvre philologique copte d’Abū Shākir Ibn al-Rāhib (XIIIe s.)», in: ChrArHer., pp. 1-23.
Idem (2006), «La pré-renaissance copte arabe du Moyen Âge (2ème moitié du XIIe, début du XIIIe
siècle)», in: Eastern Crossroads: Essays on Medieval Christian Legacy, ed. by Juan Pedro Monferrer-Sala, Gorgias Eastern Christian Studies, 1 (Piscataway, NJ: Gorgias Press LLC, 2006), pp. 191-216.
Idem (2007), «Multilingualism and Lexicography in Egyptian Late Antiquity», in: Stabilisierung und
Profilierung der koptischen Kirche im 4. Jahrhundert (X. Internationale Hallesche
Koptologentreffen 2006), hrsg. von J. Tubach und G.S. Vashalomidze, Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft, 44 (Halle: Universität), pp. 173-195.
Idem (2008), «Encyclopédisme et savoir religieux à l’âge d’or de la littérature copte arabe (XIIIe-XIVe
siècle)», OCP, 78: 347-361.
Simon, J. (1938), «L’aire et la durée des dialectes coptes», in: Actes du 4e Congrès international de
linguistique (Copenhague, 1936, pub. 1938), pp. 182-186. [Résumé in: BSAC, 6, 1940, pp. 209-211].
Sivan, E. (1967), «Notes sur la situation des Chrétiens à l’époque ayyūbide», Revue de l’Histoire des
Religions (Paris), 162: 117-130.
*Skalova, Z. G. & Gabra, G. (2003), Icons in the Nile Valley (Cairo: The American Univ. of Cairo). Snelders, B. & Immerzeel, M. (2004), «The Thirteenth Century Flabellum from Deir al-Surian in the
Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz)», Eastern Christian Art (Leuven), 1: 113 – 139.
SOC/C = Studia Orientalia Christiana – Collectanea (Cairo/Jerusalem).
Troupeau, G. (1971), «La littérature arabe chrétienne du Xe au XIIe siècle», Cahiers de civilisation
médiévale (Poitiers), 14: 1-20.
Vryonis Jr., Speros (ed. 1975), Islam and Cultural Change in the Middle Ages (4th Giorgio della Vida
Biennal Conference, May 1973) (Wiesbaden: Harrassowitz).
Wadi A. (alias Wadī‛ Abū al-Līf) (1996-97), «Muqaddima fī l-adab al-‛arabī al-masīḥī lil-Aqbāṭ»,
SOC/C, 29-30: 441-491.
Idem (1997), Dirāsa ‛an al-Mu’taman Ibn al-‛Assāl wa-kitābihi Mağmū‛ uṣūl al-dīn wa-taḥqīqihi
(titre ital. Studio su ...), SOC/Monographiae, 5 (Cairo/Jerusalem: The Franciscan Centre of Christian Oriental Studies ).
Wessel, Klaus (1963), Koptische Kunst: Die Spätantike in Ägypten (Recklinghausen: Aurel Bongers). [Trad. franc./angl.: Bruxelles, 1964 & Londres, 1965].
Yūsuf, Abū Sayf (1987), Al-Aqbāṭ wal-qawmiyya al-‛arabiyya (Dirāsa istiṭlā‛iyya) (Le Caire: Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-‛Arabiyya).
Zaloscer, Hilde (1974), Die Kunst im christlichen Ägypten (München: Schroll).
Zibawi, Mahmoud (1995), Orients chrétiens entre Byzance et l’Islam, 2 vols. (Paris: Desclée de Brouwer). [Pub. simultanément en italien et en allemand].
Idem (2003), Images de l’Égypte chrétienne: Iconologie copte (Paris: Picard). [Idem].
24
Appendice bibliographiqueAppendice bibliographiqueAppendice bibliographiqueAppendice bibliographique 83838383 (Titres récents portant sur l’art des XII e-XIV e siècles, en rapport souvent aux travaux récents,
français et hollandais, de restauration des monastères coptes.
Liste établie avec l’aimable collaboration de Mat Immerzeel et Gertrud van Loon, Leiden).
AA.VV., Proceedings of the Wadi al-Natrun Symposium (Wadi al-Natrun, Egypt, February 1-4,
2002), Part II, in: Coptica, 3 (2004), passim.
Abū l-Ḥamīd, Maḥmūd, The Miniature Paintings of the Ayyubid Manuscripts (M.A. diss., University of Cairo, 1981). [Comprend les mss. copto-arabes].
Atalla, Nabil Selim, Illustrations from Coptic Manuscripts (Cairo: Lehnert & Landrock, 2000).
Bolman, E.S. (ed.), Monastic Visions: Wall Paintings in the Monastery of St. Antony at the Red Sea (Cairo: ARCE; New Haven NH / London: Yale UP, 2002).
Hunt, Lucy-Anne, «Christian-Muslim Relations in Painting in Egypt of the Twelfth to Mid-Thirteenth Centuries: Sources of Wallpainting at Deir es-Suriani and the Illustration of the New Testament
MS Paris, Copte-Arabe 1 / Cairo Bibl. 94», Cahiers Archéologiques (Paris), 33 (1985), 111-155. [Rééd. in Idem 1998/2000: I, 205-281].
Idem, «The Al-Mu‛allaqa Doors Reconstructed: An Early Fourteenth-Century Sanctuary Screen from
Old Cairo», Gesta (New York), 28/1 (1989), 61-77 [Repr. in Idem 1998/2000: I, 282-318]. Idem, «Introducing the Catalogue, in progress, of the Illustrated MSS. in the Coptic Museum», in:
EtArChr.4, pp. 401-413. [Rééd. in Idem 1998/2000: II, 353-356] Idem, «Churches of Old Cairo and Mosques of al-Qahira: A case of Christian-Muslim Interchange»,
in: CopArChr., pp. 43-66 [Rééd. in Idem 1998/2000: I, 319-342].
Idem, Byzantium, Eastern Christendom and Islam: Art at the Crossroads of the Medieval
Mediterranean, 2 vols. (London: Pindar Press, 1998/2000). Idem, «Christian Art in Greater Syria and Egypt: a Tryptich of the Ascension with Military Saints
Reatributed», Al-Masāq (Leeds), 12 (2000), 19-25.
Leroy, Jules, La peinture murale chez les coptes I: Les couvents du désert d’Esna, MIFAO, 94 (Le Caire: IFAO, 1975).
Idem, La peinture murale chez les coptes II: Les couvents du Ouadi Natrun, MIFAO, 101 (Le Caire: IFAO, 1982).
MacCoull, Leslie S.B., «Illustrated MSS. in the Coptic Museum: Language and History», in: EtArChr.
4: 391-399.
Idem, «A Note on the Career of Gabriel III, Scribe and Patriarch of Alexandria», Arabica (Paris), 43 (1996), 357-360. [Copiste de mss. enluminés et illustrés].
Samuel al-Suryānī, «Icônes et iconographie en Égypte au XIIe siècle d’après ... Abū-el-Makārim», Le
Monde Copte (Limoges), 18 (1990), 78.
Skalova, Zuzana, «Five 13th-century Great Deesis Portraits in the Wadi Natrun: Their Origin», in:
ICCopSt. 7, 2: 1525-1550.
van Loon, G.J.M., The Gate of Heaven: Wall Paintings with Old Testament Scenes in the Altar Room
and the Khūrus of Coptic Churches, PIHANS, 85 (Istamboul: Institut Historique-Archéologique Néerlandais de Stamboul, 1999).
Idem, «Abraham, Isaac, and Jacob in Paradise in Coptic Wall Painting», Visual Resources - An
International Journal of Documentation (Abingdon), 19/1 (2003), 67-79.
83 Le listage des travaux de chaque auteur suit l’ordre chronologique.
25
Idem, «‘The Meeting of Abraham and Melchizedek’ and ‘The Communion of the Apostles’», in:
ICCopSt. 7, 2: 1381-1400. Idem & Immerzeel, M., «Inventory of Coptic Wall-paintings. Part One: Wall-paintings in Monasteries
and Churches», Essays on Christian Art and Culture in the Middle East (Leuven), 1 (1998), 6-55; 2 (1999), 6-12 (Add. & Corr.).
van Moorsel, Paul, The Icons, Catalogue général du Musée copte (Cairo: Coptic Museum, 1994).
Idem, La peinture murale chez les Coptes III: Les peintures du monastère de Saint Antoine (près de la
Mer Rouge), 2 vols., MIFAO, 112/1-2 (Le Caire: IFAO, 1995-97).
Idem, La peinture murale chez les Coptes IV: Les peintures du monastère de Saint-Paul (près de la
Mer Rouge), Idem, 120 (Idem, 2002).
Idem, Called to Egypt. Collected Studies on Painting in Christian Egypt, Publications of the De Goeje Fund, 30 (Leiden, 2000).