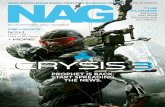La bibliothèque copte de Nag Hammadi: sa nature et son importance
Transcript of La bibliothèque copte de Nag Hammadi: sa nature et son importance
303-1
La bibliothèque copte de Nag Hammadi: sa nature etson importance*
Paul-Hubert Poirier
Paul-Hubert Poirier est professeur agrégé à la Faculté de théologie de l’Université Laval à
Québec.
D6couverts il y a maintenant quarante ans,1’ensemble des papyri d6sign6saujourd’hui sous le nom de « textes » ou de « corpus » de Nag Hammadin’est pas inconnu des milieux universitaires ni meme du grand publiccultive. Meme si leur divulgation fut a l’origine tr6s lente, ces textes sontd6sormais accessibles dans leur entier depuis la publication, en 1977, de laNag Hammadi Library in English,’ 1 éditée par le Prof. James M. Robinson,de F Institute for Antiquity and Christianity de Claremont (CA). Et bienavant la publication de cette premi~re traduction complete, les textes deNag Hammadi avaient fait l’objet de nombreux travaux de tous ordres,inventaires, 6ditions, traductions, commentaires et etudes monogra-phiques.2 A la fin de I’ann6e 1985, plus de six mille titres avaient 6t6inventories, se rapportant de pres ou de loin aux textes de Nag Hammadi.
Cependant, malgr6 le nombre et la qualite de ces travaux, une decou-verte comme celle de Nag Hammadi est loin d’avoir livr6 a la science toutce que l’on est en droit d’en attendre. Car il s’agit la, il faut bien le dire,d’une des plus importantes d6couvertes de textes anciens a avoir ete faiteau vingti6me si6cle; ~ ce titre elle m6rite de figurer a cote des d6couvertesde textes bibliques etjuifs de Qumran, en 1947,3 et de textes manich6ens deMddindt Mddi, en 1930.~ D’autre part, malgr6 l’intense activite deployeeautour des textes de Nag Hammadi, bien du travail reste ~ faire. A 1’heurequ’il est, cinq textes n’ont pas encore connu leur editio princeps;s plusieurs
* Conférence donnée à l’Université de Toronto à l’invitation du Centre for ReligiousStudies, le 12 février 1986.Abréviations: BCNH = Bibliothèque copte de Nag Hammadi; BG = Berolinensis gnos-
ticus 8502; NH = Nag Hammadi; NHS = Nag Hammadi Studies.1 James M. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library in English (San Francisco: Harper
& Row, 1977). 2 Cf. D. M. Scholer, Nag Hammadi Bibliography 1948-1969, NHS 1 (Leiden: Brill, 1971), et
les suppléments qui paraissent annuellement, depuis 1971, dans Novum Testamentum,sous le titre « Bibliographia gnostica ».
3 Cf. P. W. Skehan et M. Delcor, « Littérature de Qumrân », dans le Supplément auDictionnaire de la Bible 9 (1978), 805-960, et l’inventaire plus récent de M. Delcor et F. G.Martinez, Introducción a la literature esenia de Qumrán, coll. Academia christiana, 20(Madrid: Cristianidad, 1982).
4 Voir M. Tardieu, « Les manichéens en Egypte », Bulletin de la Société française d’Egyp-tologie 94 (1982), 5-19.
5 Il s’agit des textes suivants: Zostrien (NH VIII, 1); Interprétation de la gnose (NH XI,1),Allogène (NH XI,3), Hypsiphrone (NH XI,4) et Evangile de vérité (NH XII,2).
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
304
textes 6dit6s et accessibles en traduction n’ont encore fait I’objet d’aucuneetude d’ensemble, ce qui rend leur utilisation hasardeuse voire impossible 6Pour d’autres textes, qui ont eu davantage la faveur des critiques ou de lapressed bien des aspects demandent toujours a ~tre 6clair6s.
La recherche sur les textes de Nag Hammadi, et par ricochet sur legnosticisme, est donc en pleine effervescence,8 ainsi qu’en t6moignent lesnombreux congr~s, colloques et s6minaires qui leur furent consacr6s:Messine (1966),9 Stockholm (1973),1° Strasbourg (1974),11 New Haven 12 etQu6bec (1978),13 Louvain (1980)14 et Springfield (1983).15 A cela, il fautajouter les conf6rences internationales d’6tudes patristiques d’Oxfordl6 quifont une bonne place aux gnostica, ainsi que les trois congrès interna-tionaux d’6tudes coptes tenus au Caire (1976),17 à Rome (1980),18 et àVarsovie (1984).19
6 Par exemple Zostrien (NH VII,1).7 Citons le cas de l’Evangile selon Thomas (NH II,2).8 Cf. M. Tardieu, « Gnostiques », Encyclopaedia universalis, Vol. 8 (2e éd.; Paris:
Encyclopaedia universalis France, 1984), 656-57.9 Cf. U. Bianchi (éd.), Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina 13-18 aprile 1966,
Studies in the History of Religions, Suppl. to Numen, 12 (Leiden: Brill, 1967).10 Cf. G. Widengren (ed.), Proceedings of the International Colloquium on Gnosticism,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Handlingar, Filologisk-filosofiska serien, 17 (Stockholm: Alnqvist; Leiden: Brill, 1977).
11 Cf. J. E. Ménard (éd.), Les textes de Nag Hammadi: Colloque du Centre d’Histoire desreligions, Strasbourg, 23-25 octobre 1974; NHS 7 (Leiden: Brill, 1975).
12 Cf. B. Layton (ed.), The Rediscovery of Gnosticism, Studies in the History of Religions,Suppl. to Numen, 41 (2 vols.; Leiden: Brill, 1980-81); voir aussi M. Tardieu, « Le Con-
grès de Yale sur le Gnosticisme (28-31 mars 1978) », Revue des Etudes augustiniennes 24(1978), 188-209.
13 Cf. B. Barc (éd.), Colloque international sur les textes de Nag Hammadi, Québec, 22-25août 1978; BCNH, section « Etudes », 1 (Québec et Louvain: Presses de l’UniversitéLaval, 1981).
14 Cf. J. Ries (éd.), avec la collaboration de Y. Janssens et de J.-M. Sevrin, Gnosticisme etmonde hellénistique: Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve, 11-14 mars 1980; Publica-tions de l’Institut orientaliste de Louvain, 27 (Louvain-la-Neuve: Université catholiquede Louvain, 1982).
15 Les Actes du séminaire de Springfield doivent paraître bientôt; voir P.-H. Poirier,« Gnosticisme et christianisme ancien: Chronique d’un Colloque », Laval théologique etphilosophique 39 (1983), 221-30.
16 Voir les Studia patristica publiés dans les Texte und Untersuchungen. Les Gnostica de laseptième Conférence (1975) furent édités par M. Krause, Gnosis and Gnosticism: PapersRead at the Seventh International Conference on Patristic Studies, Oxford, September8-13, 1975; NHS 8 (Leiden: Brill, 1977), de même que ceux de la huitième Conférence:Gnosis and Gnosticism: Papers Read at the Eighth International Conference on PatristicStudies, Oxford, September 3-8, 1979; NHS 17 (Leiden: Brill, 1981).
17 Le Congrès du Caire a donné lieu à deux publications, toutes deux éditées par R. McL.Wilson: Nag Hammadi and Gnosis: Papers Read at the First International Congress ofCoptology, Cairo, December 1976; NHS 14 (Leiden: Brill, 1978); The Future of CopticStudies, Coptic Studies, 1 (Leiden: Brill, 1978).
18 Cf. T. Orlandi et F. Wisse (éd.), Acts of the Second International Congress of CopticStudies, Roma, September 22-26, 1980 (Rome: C.I.C.M., 1985).
19 Les Actes n’ont pas encore été publiés; voir L. Painchaud, « Le troisième Congrèsinternational des Etudes coptes, Varsovie, 20-25 août 1984 », Laval théologique etphilosophique 41 (1985), 111-13.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
305
1 La d6couverte de Nag Hammadi20
En d6cembre 1945, des paysans de la region de Nag Hammadi, ville situ6e aquelques 129 km au nord de Louxor,21 partis ~ la recherche d’engrais,d6terraient fortuitement une jarre enfouie au fond d’un cimeti6re. Le sitepr6cis de la d6couverte, demeur6 longtemps incertain, semble devoir 6tresitu6 pres du hameau de Hamra Doum, au pied du Jabal al-Tarif, a environneuf kilom6tres de Ch6noboskion et des ruines de la basilique de S. Pa-chome. Qu’il s’agit bien la de la region ou eut lieu la decouverte, cela a 6t6confirm6 par les donn6es que portent des fragments de papyri qui ont servia fabriquer les couvertures de certains codices (i, v, xi et VII).22 La jarremise au jour par les paysans contenait des feuillets de papyrus reli6s a platcomme des livres (il s’agit donc de codices au sens strict du terme, et nonde volumina), treize au total.
Vendu a des commergants, un des codices (codex in) aboutit bient6tau Mus6e copte du Caire, entre les mains de son directeur Togo Mina(d6c6d6 en 1949), qui F acquit en octobre 1946. Un an plus tard, JeanDoresse 6tablissait un inventaire de ces pages et en identifiait le contenu.En janvier 1948, la presse du Caire diffusait la nouvelle de la d6couverte etle monde scientifique était mis au courant par la communication de H.-Ch.Puech et de J. Doresse a I’Acad6mie des Inscriptions et Belles-Lettres23 etpar celle de Togo Mina a l’Institut d’Egypte.24
A peu pr~s ~ la meme époque, un autre codex, devenu la possessiond’un antiquaire, avait quitt6 1’Egypte pour entreprendre un long p6riple.Apr6s diverses p6rip6ties, il finissait par etre achete a Bruxelles, le 10 mai1952, par les soins du Prof. Gilles Quispel, de I’Université d’Utrecht, pourle compte de l’Institut C. G. Jung de Zurich. Ce codex des lors connu sousle nom de « codex Jung », fait aujourd’hui partie du fonds du Mus6e coptedu Vieux Caire et on lui a attribue le num6ro i au sein de la collection despapyri de Nag Hammadi.
Outre ces deux codices, il y avait encore onze autres cahiers dont lesort resta longtemps ind6cis. Apport6s au Mus6e copte au d6but de 1949,par 1’antiquaire qui les avait acquis et qui voulait les soumettre a uneexpertise en vue d’un achat eventuel, ils furent l’objet de longues tracta-tions avant de devenir d6finitivement propriete du Mus6e copte du VieuxCaire, en 1956. Un peu plus tard, en 1960, a la suite de negociations entre leMus6e copte et l’Institut Jung, une partie du codex i revenait au Caire. Lereste du codex n’allait pas tarder a suivre le meme chemin, si bien que,depuis 1975, la totalite de la collection de Nag Hammadi est rassembl6e auMus6e copte, o6 chaque feuillet a ete mis sous plexiglass et peut etre
20 Pour un compte rendu détaillé de la découverte, voir J. M. Robinson, « From the Cliff toCairo: The Story of the Discoverers and the Middlemen of the Nag Hammadi Codices »,
dans Barc (éd.), Colloque (cité note 13); et J. M. Robinson (ed.), The Facsimile Edition ofthe Nag Hammadi Codices: Introduction (Leiden: Brill, 1984), 3-14.
21 Cf. ibid., 4.22 Ibid., 4, n. 3.23 « Nouveaux écrits gnostiques découverts en Egypte », Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l’année 1948 (Paris, 1949), 87-95.24 « Un papyrus gnostique du ive siècle », Bulletin de l’Institut d’Egypte 30 (1947-48),
325-26.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
306
examine a la loupe ou soumis aux rayons ultra-violets.25 Notons enfinqu’aujourd’hui, la collection est par ailleurs accessible au grand public etaux chercheurs, grace a 1’edition photographique de chaque page, produiteen collaboration par l’ uNEsco et par le D6partement des Antiquit6s de laR6publique arabe d’Egypte. 26
L’ensemble de la collection comprend donc douze codices auxquelss’ajoutent huit feuillets retir6s d’un treizi6me codex et inseres tardivementa l’int6rieur de la couverture ant6rieure du codex vi. Ces feuillets pr6sen-tent un texte complet et, pour des raisons de commodit6, on les traitecomme un codex. D’après les estimations les plus récentes,2í la collectioncomportait a 1’origine, sur un total de 1304 pages, 1240 pages inscrites; dece nombre, 1196 pages ont ete conservees, dont 1156 pages inscrites, soit 93pour cent du corpus original. Si on ajoute a ce total le codex de Berlin 8502,qui contient deux textes d6jh pr6sents dans la collection de Nag Hammadi,on arrive a 1284 pages inscrites conserv6es.
Collection considerable, surtout si l’on songe qu’il s’agit presqueuniquement de textes neufs. On peut cependant se demander si on poss6detous les textes de Nag Hammadi. Sans faire 6tat des histoires qui ont 6t6rapport6es, selon lesquelles les inventeurs des manuscrits, les paysans deNag Hammadi, auraient utilise des feuillets pour alimenter le foyer domes-tique, il est permis de penser qu’une partie de la collection a échappé auxantiquaires et aux savants. Cela est sur pour un feuillet, a tout le moins, ducodex tn, qui a ete retrouve par Stephen Emmel a la Beinecke Rare Bookand Manuscript Library, Yale University.28 Et des informations circulentdepuis quelque temps, selon lesquelles un codex, ayant peut-etre appar-tenu a la collection de Nag Hammadi, se trouverait dans les voutes d’unebanque de Geneve. Ce codex comporterait des textes apocryphes relatifs àJacques ainsi que des textes bibliques.29
L’ensemble des textes du corpus de Nag Hammadi forme une collec-tion de cinquante-quatre 6crits, aussi appel6s « trait6s »,30 dont cinq 31
25 Cf. St. Emmel, «The Nag Hammadi Editing Project: A Final Report », AmericanResearch Center in Egypt, Inc., Newsletter 104 (1978), 10-32, sp. 17-22.
26 The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices published under the auspices of theDepartment of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in conjunction with the UnitedNations Educational, Scientific and Cultural Organization (12 vols.; Leiden: Brill, 1972-84).
27 Cf. St. Emmel, « Final Report » (cité note 25), 29, et Robinson (ed.), The FacsimileEdition (cité note 20), 15-24.
28 Cf. ibid., 23 et planche 25*-26*; aussi St. Emmel, « A Fragment of Nag Hammadi CodexIII in the Beinecke Library: Yale inv. 1784 », Bulletin of the American Society ofPapyrologists 17 (1980), 53-60.
29 Informations orales fournies par James M. Robinson (janvier 1985).30 Il existe plusieurs listes des traités de Nag Hammadi. Cf., entre autres, Robinson (ed.),
The Facsimile Edition (cité note 20), 100-102 et 96-100 (avec bibliographie); St. Emmel,« Final Report » (cité note 25), 24-26; K. Rudolph, Gnosis: The Nature and History ofGnosticism, translation edited by R. McL. Wilson (Edinburgh: T. & T. Clark, 1983),44-48; Tardieu, « Gnostiques » (cité note 8), 661-62 (avec toutefois des titres nouveauxattribués à certains traités).
31 Soit Evangile de vérité (NH 1,3 et XII,2); Apokryphon de Jean (NH II,1, III,1, IV,1 et BG 2);Ecrit sans titre (NH II,5 et XIII,2); Evangile des Egyptiens (NH III,2 et IV,2); Eugnoste III,3 et V,1). Sagesse de Jésus Christ (NH III,4) a un doublet en BG 3 seulement.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
307
trouvent des parall6les au sein meme du corpus; ce qui donne un total dequarante-six trait6s distincts.32 Si I’on excepte quelques textes tr6s frag-mentaires, les manuscrits sont parvenus jusqu’à nous dans un excellent6tat de conservation.
L’6tude des cartonnages de la reliure des codices IV, v, VII et VIII,33des indications tir6es des textes, de meme que les premiers r6sultatsd’analyses paleographiques34 ont amene les savants a fixer comme dateapproximative de la copie des manuscrits, le milieu du quatri6me siecle, etcomme date de leur enfouissement, la fin du quatri6me si6cle ou le d6but ducinquieme. Cela n’indique toutefois pas la date de la redaction originale des strait6s, qui, par certains de leurs 616ments, peuvent remonter jusqu’aud6but du deuxi6me siecle de notre 6re.
Bien que ces manuscrits soient 6crits en copte, plusieurs indiceslaissent croire qu’il s’agit, dans tous les cas, de traductions d’originauxgrecs. Deux dialectes coptes ont surtout servi ~ la traduction: ce sont lesahidique et le subakhmimique.35 Mais meme parmi les textes traduits dansle meme dialecte, on retrouve des divergences mineures, ce qui laissepenser qu’on a affaire ~ plusieurs traducteurs. Dans le cas de versionsparalleles, plusieurs traducteurs ont du travailler a partir d’originaux grecsdiff6rents. Le processus de traduction a donc pu s’6tendre sur un vasteespace g6ographique et durer assez longtemps. 36
On devine des lors l’int6r~t considerable de ces pages pour 1’etude dela langue copte, pour 1’histoire du livre, dont les codices de Nag Hammadiconstituent les plus anciens sp6cimens, et pour la pal6ographie gr6co-copte, pour ne mentionner que ces domaines.
2 Les textes de Nag Hammadi: un corpus11 ressort des caract6ristiques que nous venons de mentionner, que lespapyri de Nag Hammadi forment un corpus ou une collection, du moins ausens materiel du terme. En effet, ces manuscrits proviennent d’un memeendroit, ils ont ete confectionn6s a la meme epoque, ils pr6sentent tous unefacture identique ou presque, et ils ont ete enfouis dans une meme cachettepar une ou plusieurs personnes qui voulaient les conserver.
Mais bien plus que de former un corpus mat6riellement homogene, cesmanuscrits constituent aussi une collection de textes id6ologiquementapparentes, une biblioth6que, entendue au sens d’un ensemble d’ouvragesqui, quoique diff6rents les uns des autres, auraient ete rassembl6s dans uneperspective pr6cise. Et c’est encore le gnosticisme qui rend le mieuxcompte de 1’unite de cette bibliotheque: le corpus de Nag Hammadi est une
32 Si l’on compte le BG, on obtient un total de cinquante-six traités, dont quarante-huittraités distincts.
33 Cf. J. W. B. Barnes, G. M. Browne, et J. C. Shelton, Nag Hammadi Codices: Greek andCoptic Papyri from the Cartonnage of the Covers, The Coptic Gnostic Library; NHS 16(Leiden: Brill, 1981).
34 Sur les différentes mains d’écriture que l’on retrouve dans les codices de Nag Hammadi,cf. St. Emmel, « Final Report » (cité note 25), 27-28.
35 Ibid., 27.36 Cf. Robinson (ed.), The Nag Hammadi Library (cité note 1), 13.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
308
collection d’6crits rassembl6s par et pour des gnostiques. C’est ce quiressort d’une manière tr6s claire de 1’analyse des diff6rents trait6s quecontient cette collection et qui sont pour la plupart indiscutablement gnos-tiques .37 Des lors, il semble bien qu’on ne puisse retenir certaines hypo-theses avanc6es pour expliquer la r6union de cette cinquantaine d’ecrits enune collection. On ne saurait donc y voir une documentation h6r6siolo-gique,38 ni la biblioth6que d’un groupe encratite 6voluant autour du mys-t6rieux Hi6racas de Leontopolis.39 D’autre part, le fait que les manuscritsde Nag Hammadi aient ete d6couverts a proximite du site des premi~resfondations pach6miennes et qu’un des d6bris de papyri ayant servi arenforcer la couverture du codex vII portat le nom de Pach6me, a amen6certains chercheurs a 6tablir un lien entre nos manuscrits et les milieuxmonastiques pach6miens: ces milieux auraient servi aux manuscrits decentres de copie et de diffusion. Mais un examen attentif de toute cettequestion par Armand Veilleux4° a montre que la « Pachomian connection »reste tr6s hypoth6tique, meme si les points de rapprochement entre lestextes de Nag Hammadi et le monachisme egyptien sont r6els et m6rite-raient une etude approfondie.41
Une fois admis que les textes de Nag Hammadi forment une biblio-thèque et que le gnosticisme en est le d6nominateur commun, force est biende constater que ladite biblioth6que comporte une grande diversite. Seuleune etude approfondie de chacun des textes permettra de les caract6riser etde reduire ainsi la disparate de 1’ensemble de la collection. En attendantque ces etudes soient completees, on peut proposer, a titre provisoire, unetypologie sommaire des textes, qui permettrait de les r6partir en quatregroupes. Cette typologie, dont la pertinence varie selon les textes, a pure-ment valeur d’hypoth6se de travail.
En raison du contenu des textes et de leur rapport avec le gnosticismesous ses formes attest6es avant la d6couverte de Nag Hammadi, on r6par-tira ainsi les trait6s de la collection copte du Caire:42
(1) les textes valentiniens, ou proches des doctrines valentiniennes:Priere de Paul (NH i,i); Evangile de verite(NH 1,3 et XII,2); Traiti sur larisurrection (NH 1,4); Traite tripartite (NH 1,5); Evangile selon Philippe(NH 11,3); Exégèse de l’time (NH 11,6); Timoignage de vérité (NH IX,3);Interpretation de la gnose (NH XI, 1); Expose valentinien (NH XI,2);
37 Cf. J.-P. Mahé, Hermès en Haute-Egypte, t. 2; BCNH, section « Textes », 7 (Québec:Presses de l’Université Laval, 1983).
38 Cf. T. Säve-Söderbergh, « Holy Scriptures or Apologetic Documentations? The ’Sitz imLeben’ of the Nag Hammadi Library », dans J.-E. Ménard (éd.), Les textes de NagHammadi: Colloque du Centre d’Histoire des religions, Strasbourg, 23-25 octobre 1974;NHS 7 (Leiden: Brill, 1975), 3-14.
39 Cette hypothèse a été formulée par F. Wisse, « Gnosticism and Early Monasticism inEgypt », dans B. Aland (éd.), Gnosis: Festschrift für Hans Jonas (Göttingen: Vanden-hoeck & Ruprecht, 1978), 431-40; voir cependant l’examen critique qu’en a fait A. Guil-laumont, dans l’Annuaire du Collège de France 81 (1980-81), 411-13.
40 A. Veilleux, « Monachisme et gnose », Laval théologique et philosophique 40 (1984),275-94; 41 (1985), 3-24.
41 Cf. ibid., 3-10.42 Sur la classification des traités, cf. Tardieu, « Le Congrès de Yale » (cité note 12), 192;
Mahé, Hermès en Haute-Egypte (cité note 37), 120 (qui reprend Tardieu).
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
309
(2) les textes dits « s6thiens » ou qui leur sont apparentes:43 *Apokry-phon de Jean (NH 11,1 et IV,1 [version longue]; NH iii,i et BG 2 [versionbr6vel); *Hypostase des archontes (NH 11,4); Ecrit sans titre (NH II,S etXIII,2); *Evangile des égyptiens (NH 111,2 et IV,2); Eugnoste (NH 111,3 etV,I); Sagesse de Jesus Christ (NH 111,4 et BG 3); *Apocalypse d’Adam(NH v,5); Paraphrase de Sem (NH VII,I); Deuxième traiti du Grand Seth(NH VII,2); *Trois stèles de Seth (NH VII,S); *Zostrien (NH VIII,I); *Mel-chisédek (NH IX,I); *Norea (NH IX,2); Marsanès (NH X,I); Allogène(NH XI,3); Hypsiphrone (NH XI,4); *Pr6tennoia trimorphe (NH XIII’l);44
(3) les textes gnostiques ou gnosticisants, mais qu’on ne saurait rat-tacher a une « école » ou a un courant determine: Apokryphon de Jacques(NH 1,2); Evangile selon Thomas (NH 11,2); Livre de Thomas l’Athlete(NH 11,7); Dialogue du Sauveur (NH III,S); Apocalypse de Paul (NH V,2);Premiere apocalypse de Jacques (NH V,3); Deuxième apocalypse deJacques (NH V,4); Brontè (NH VI,2); Authentikos logos (NH VI,3); Conceptde notre grande puissance (NH VI,4); Apocalypse de Pierre (NH VII,3);Lettre de Pierre d Philippe (NH VIII,2); Fragments (NH XII,3); Evangileselon Marie (BG 1 );
(4) les textes non gnostiques, parfois gnosticis6s, mais susceptiblesd’une lecture ou d’une illustration gnostique: Actes de Pierre et des douzeapôtres (NH VI,t); Fragment de la République de Platon (NH VI,S);45 Og-doade et Ennéade (NH VI,6); Priere d’action de grâces (NH VI,7); Frag-ment du Discours parfait (NH VI,8); Silvanos (NH VII,4); Sentences deSextus (NH XII,I);46 Acte de Pierre (BG 4).
Quand on consid6re la quantite de textes nouveaux que nous a r6v6l6sla d6couverte de Nag Hammadi, ainsi que leur 6tonnante diversite, on voittout de suite la place privil6gi6e qu’occupe ce corpus a cote des autrescollections de textes gnostiques que nous avaient fait connaitre les codicesde Londres (Askewianus), d’Oxford (Brucianus) et de Berlin (Berolinensisgnosticus). 47
43 Nous marquons d’un astérique (*) les titres des traités retenus comme séthiens par H.-M.Schenke, « Das sethianische System nach Nag-Hammadi-Handschriften », dansP. Nagel (éd.), Studia coptica (Berlin: Akadamie-Verlag, 1974), 165-72, sp. 165-66.
44 A cette liste, il faut joindre le deuxième ouvrage du codex Brucianus, appelé aussiAnonyme de Bruce; trad.: C. Schmidt, Koptisch-Gnostische Schriften, Die griechischenchristlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte (4e éd.; Berlin: Akadamie-Verlag,1981), 335-67.
45 Sur la gnosticisation à laquelle a donné lieu la traduction de ce texte en copte, cf.L. Painchaud, Le Fragment de la République de Platon, NH VI,5; BCNH, section« Textes », 11 (Québec: Presses de l’Université Laval, 1983), 117-22; le portrait quePainchaud a donné du traducteur copte du fragment pourrait bien être aussi celui de plusd’un utilisateur de la collection de Nag Hammadi: « C’est un gnostique fortement im-prégné par les thèmes et le vocabulaire des récits anthropogoniques et théogoniquesqu’on retrouve dans les écrits mythologiques du Codex II et dans plusieurs autres écritsde la Bibliothèque de Nag Hammadi, soit les textes dits ’séthiens’ ou encore ’mytholo-giques’. D’autre part, sa sotériologie, bien que fort peu évidente, porte la trace probabled’une conception généralement considérée comme valentinienne » (122).
46 Sur la version copte des Sentences de Sextus, cf. P.-H. Poirier, Les Sentences de Sextus,BCNH, section « Textes », 11 (Québec: Presses de l’Université Laval, 1983), 26-28.
47 Sur ces codices, cf. Tardieu, « Gnostiques » (cité note 8), 661, ainsi que M. Tardieu etJ.-D. Dubois, Introduction à la littérature gnostique, 1. Les collections retrouvées avant
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
310
3 L’importance de la bibliotheque de Nag Hammadipour I’histoire du gnosticisme et du christianismeancien
L’int6r6t que peut representer une masse de textes comme celle qui a 6t6mise au jour a Nag Hammadi est multiple. Ces textes jettent en effet unelumière nouvelle non seulement sur 1’histoire du christianisme ancien, deses institutions aussi bien que de ses doctrines, mais aussi sur celle d’unmouvement que l’on aurait tort d’enfermer dans les limites du christia-nisme, a savoir le gnosticisme. Les textes de Nag Hammadi ont aussi leurmot a dire sur 1’histoire de la philosophie, en particulier pour 1’epoquecruciale qui s’6tend grosso modo de Numénius d’Apam6e à Plotin. 48
Mais c’est avant tout pour 1’etude du gnosticisme que les textes de NagHammadi rev6tent une importance capitale. Ils projettent en effet unelumi6re nouvelle sur ce courant de pensee philosophico-religieux attest6aussi bien dans le judaisme, dans la religion et la philosophie hell6nistiquesque dans le christianisme, et qui se pr6sente comme un essai d’explicationde la place de 1’homme dans un univers marqu6 par une coupure irr6m6dia-ble entre le monde divin, pl6r6matique, et le monde de l’expérience.49Partant du postulat que ce monde-ci n’a pu 6tre voulu par le Dieu supremeet que son origine ne saurait correspondre a un dessein positif et premier, legnosticisme affirme que le salut ne peut venir, pour 1’homme prisonnier de ~ce monde, que d’une connaissance (gnôsis) communiquée par révélation.Se manifestant sous une multitude de formes, comme 1’ hydre de la legende,le gnosticisme a pris une telle ampleur aux deuxième et troisi6me si6cles,que la Grande Eglise a pu le considerer comme une des menaces les pluss6rieuses a son unite et al’orthodoxie de sa doctrine. Aussi a-t-il suscit6 des
1945; coll. Initiations au christianisme ancien (Paris: Cerf, 1986), 65-138 (partie rédigée parMichel Tardieu).
48 Cf. J. M. Dillon, The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 B.C. to A.D. 220
(Londres: Duckworth, 1977), 384-89 et index, 424; cf. aussi Hadot, « Gnostiques » (citénote 49 infra), 660-61.
49 Cf. P. Hadot, « Gnostiques », Encyclopaedia universalis, Vol. 8 (2e éd.; Paris: Ency-clopaedia universalis France, 1984), 658-60; dans cet article, P. Hadot a fort bien décrit laproblématique philosophique du gnosticisme: « Les racines philosophiques du gnosti-cisme sont le scandale de la raison devant le mal et une représentation de la genèse dumonde selon un schéma de fabrication.... La solution gnostique, qui consiste à rendre
responsable le Démiurge, n’est qu’une conséquence, comme l’a bien vu Plotin, desdifficultés propres à une pensée créationniste. Le gnosticisme imagine un Ouvrier duMonde qui raisonne pour fabriquer son ouvrage. Si l’on constate ensuite que le produitfabriqué par cet Ouvrier n’est pas conforme à la raison, on est obligé de supposer que ceDémiurge est ou mauvais ou borné. Pour Plotin, le monde sensible procède nécessaire-ment, immédiatement et sans raisonnement, du monde intelligible; toutes choses naissentd’elles-mêmes sous la lumière du Bien, leur imperfection est liée seulement à leur
éloignement progressif de la simplicité originelle; le monde sensible est donc, dans sabeauté comme dans son imperfection, la suite normale du monde spirituel. Pour legnostique, au contraire, il résulte de l’intervention dramatique et tragique d’une volontémauvaise et ignorante » (660). Sur les diverses acceptions qu’a reçues le terme « gnos-
tique » du quatrième siècle av. J.C. jusqu’au vingtième siècle, lire la très intéressantenotice de M. Tardieu, dans Tardieu et Dubois, Introduction à la littérature gnostique(cité note 47), 21-37.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
311
adversaires irr6ductibles dans 1’Eglise, tels les h6r6siologues lr6n6e deLyon, Hippolyte de Rome et Epiphane de Salamine. 511
Encore que les historiens des doctrines aient depuis longtemps re-connu la necessite de s’interesser au gnosticisme pour 1’etude de la gen6seet du d6veloppement de la pensee chretienne, leurs investigations demeu-raient n6cessairement limit6es du fait que l’on ne connaissait que desfragments de litt6rature gnostique, difficilement intelligibles en tant quetels5l et encore obscurcis par la pol6mique des P6res, qu’il n’6tait pastoujours ais6 de distinguer de l’argumentation des gnostiques eux-memes.La situation a commence a changer a la fin du dix-huitième si6cle lorsqued’authentiques oeuvres gnostiques, pr6serv6es en traduction copte, ontcommence a arriver en Europe. 11 faudra cependant attendre le milieu duvingti6me siecle pour que l’on commence vraiment a exploiter cette docu-mentation nouvelle. 52 Commengant a paraitre au milieu des ann6es cin-quante,53 les textes de Nag Hammadi, par leur masse autant que par leurnouveaut6, ont precipite le rythme de la recherche et transforme sur plusd’un point notre connaissance du gnosticisme.
A titre d’illustration, nous 6voquerons ici ce que les textes de NagHammadi nous apprennent sur une variete de gnosticisme designee le plussouvent sous 1’6tiquette de « gnose s6thienne » ou de « s6thianisme ».Cette forme de gnosticisme était d6ja connue, avant la d6couverte de NagHammadi, par quelques notices h6r6siologiques dont la plus importanteétait celle d’lr6n6e de Lyon.54 Or la collection de Nag Hammadi, et d6jh lecodex Brucianus,55 ont versé au dossier des pi6ces essentielles, parce quede provenance non plus indirecte, mais indubitablement gnostique. Ce quiest commun ~ ces textes autant qu’aux notices h6r6siologiques, c’est laconcurrence des mêmes mytholog6mes dont les plus remarquables sont:l’importance accord6e ~ la figure de Seth, origine et chef de file des
gnostiques, qualifi6s eux-mêmes de « race sainte et immuable »,56 la
presence d’« illuminateurs » (phõstëres), le rôle d6volu à la triade form6edu P6re, de la M6re, d6nomm6e aussi Barb6lo, et du Fils autog6n6r6, letheme de la generation sans roi (abasileutos), ainsi qu’une certaine visionou p6riodisation de 1’histoire.5’
50 Cf. G. Vallée, A Study in Anti-Gnostic Polemics: Irenaeus, Hippolytus, and Epiphanius,Studies in Christianity and Judaism/Etudes sur le christianisme et le judaïsme, 1 (Water-loo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 1981).
51 Pour les textes gnostiques connus avant la découverte de Nag Hammadi, voir l’anthologieéditée par W. Foerster, Die Gnosis, Erster Band: Zeugnisse der Kirchenväter, Biblio-thek der alten Welt (Zürich et Stuttgart: Arlemis Verlag, 1969); trad. anglaise éditée
par R. McL. Wilson, Gnosis: A Selection of Gnostic Texts, Vol. 1: Patristic Evidence
(Oxford: Clarendon Press, 1972).52 Découvert en 1896, le BG ne sera édité qu’en 1955 par W. C. Till, Die gnostischen
Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis 8502, Texte und Untersuchungen, 60(2e éd.; Berlin: Akademie-Verlag, 1972).
53 Le premier texte de Nag Hammadi à faire l’objet d’une édition sera l’Evangile de Vérité:M. Malinine, H.-Ch. Puech et G. Quispel, Evangelium Veritatis (Zürich: Rascher, 1956).
54 Adversus haereses 1,29-31.55 Sur ce traité, voir la note 44.56 Sur ce thème, voir l’ouvrage de M. A. Williams, The Immovable Race: A Gnostic
Designation and the Theme of Stability in Late Antiquity, NHS 29 (Leiden: Brill, 1985).57 Cf. P.-H. Poirier et M. Tardieu, « Catégories du temps dans les écrits gnostiques non-
valentiniens », Laval théologique et philosophique 37 (1981), 3-13.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
312
C’est surtout a Hans-Martin Schenke que revient le m6rite d’avoirclairement d6gag6 les caract6ristiques de cette gnose « s6thienne » dans unarticle-programme intitul6 « Das sethianische System nach Nag-Hammadi-Handschriften ».5g Dans cet article, Schenke a tente d’elaborerune forme canonique du s6thianisme en en pr6cisant les caract6ristiquesdoctrinales (les plus importantes sont 6num6r6es plus haut), les pratiquescultuelles (le baptême et 1’ascension rituelle), le milieu d’origine (celui dessectes baptistes de Palestine et des Mand6ens) et la situation par rapport auchristianisme (les elements chr6tiens que 1’on pourrait relever dans cestextes sont le r6sultat d’une christianisation tardive) et a la philosophie.
La th6se de H.-M. Schenke a suscit6 beaucoup de reactions parmi lessp6cialistes de la gnose. On lui a surtout reproch6 de reprendre les 6ti-quettes et les classifications des heresiologues59 et d’61aborer un 6dificedoctrinal artificiel qui n’est pas atteste comme tel par les textes. De fait, il ya, dans 1’entreprise de Schenke, un certain vice de forme: il se sert destextes de Nag Hammadi pour d6gager les caract6ristiques oblig6es dus6thianisme, puis il utilise ces caract6ristiques pour d6terminer, dans cememe corpus, quels sont les textes s6thiens et ceux qui ne le sont pas. Il y adonc jusqu’a un certain point p6tition de principe.
La critique la plus vive a ete formul6e par Fr6d6ric Wisse, 60 professeura 1’Universite McGill. Pour Wisse, les textes de Nag Hammadi reconnuscomme s6thiens ne pr6sentent tout au plus qu’une parente thematique, duea la presence de « free-floating theologoumena and mythologoumena »; enconsequence, « there never was a sect properly or improperly calledSethians ».61
Si bien des elements de la critique de Wisse sont pertinents, il faut biendire que, dans 1’ensemble, elle apparait excessive. 62 Bien sur, le syst6me61abor6 par Schenke est dans une certaine mesure artificiel, construit qu’ilest ~ partir d’6crits dont on postule qu’ils sont des formes plus ou moinscompl6tes, ou d6velopp6es, d’un meme mythe, qu’aucun d’entre eux nelivrerait au complet. 11 n’en reste pas moins qu’il existe des textes gnos-tiques et des textes sur les gnostiques qui pr6sentent les uns avec les autresune indiscutable parent6. Et cette parente ne peut s’expliquer que par unfonds doctrinal commun. Ce qui demeure encore incertain, c’est de savoir
58 Voir la note 43; ainsi que, toujours de H.-M. Schenke, « The Phenomenon and Signifi-cance of Gnostic Sethianism », dans B. Layton (ed.), The Rediscovery of Gnosticism,Vol. 2, Studies in the History of Religions. Suppl. to Numen, 41 (2 vols.; Leiden: Brill,1980-81), 558-616.
59 Cf. en ce sens M. Tardieu, « Les livres mis sous le nom de Seth et les Séthiens del’hérésiologie », dans M. Krause (éd.), Gnosis and Gnosticism, NHS 8 (Leiden: Brill,1977), 204-10.
60 F. Wisse, « Stalking those Elusive Sethians », dans B. Layton (ed.), The Rediscovery ofGnosticism, Vol. 2, Studies in the History of Religions, Suppl. to Numen, 41 (2 vols.;Leiden: Brill, 1980-81), 578-87; voir aussi, ibid., l’article de K. Rudolph, « Die ’sethia-nische’ Gnosis—eine häresiologische Fiktion? », 577-87.
61 Ibid., 575 et 571.62 En particulier, il faudrait tenir compte davantage du témoignage d’Epiphane dont l’in-
formation est souvent de première valeur, comme l’a souligné P. Nautin (cf. Dictionnaired’histoire et de géographie ecclésiastigue 15 [1963], 621, 626-27); voir aussi Poirier,
« Gnosticisme et christianisme ancien » (cité note 15), 229.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
313
si ce corps de doctrine a ete v6hicul6 par une groupe distinct, et s’il a servide point de reference, ou d’ « orthodoxie », a une secte, qu’on la qualifie des6thienne ou non. Des lors, la bonne m6thode impose d’6tudier de fagonplus stricte les textes et les mytholog6mes qui les parcourent, en vue ded6gager leur coh6rence interne et leur appartenance a un syst~me communqui demeure encore, jusqu’a preuve du contraire, une hypothese de travailnon seulement valable mais feconde.
C’est a ce genre de travail que vient de se livrer Jean-Marie Sevrin dansune etude remarquable consacr6e a la pratique baptismale des textes dits« s6thiens ».63 Au terme de cette recherche, men6e avec une grande pru-dence et une saine m6thodologie, Sevrin arrive a la conclusion que lesallusions au baptême que l’on rel6ve dans nos textes supposent une pra-tique effective de ce rite, pratique que sous-tend ou accompagne, dans tousles textes qui en font 6tat, une doctrine dans 1’ensemble coh6rente. Sevrinétablit aussi que ce bapt~me, typiquement gnostique dans son interpr6ta-tion, 64 derive d’un milieu juif, baptiste et h£t£rodoxe , et qu’il aconnu, apr£sson adoption par des gnostiques, une histoire et une evolution. Des lors,Sevrin peut affirmer, a propos des textes qu’il a etudies, qu’ils « appartien-nent, par la pratique dont ils nous laissent deviner quelques 6chos, a unememe famille historique, celle des gens qui ont pratique ce baptême enra-cin6 ailleurs que dans le bapt6me chr6tien ».65 Cette famille de textessuppose-t-elle une communaut6 specifique ? Sur ce point, Sevrin reste tresprudent: « nous dirons donc que les traditions baptismales particuli~resque l’on trouve dans plusieurs 6crits de la famille barb6lo-s6thienne per-mettent de lui reconnaitre une existence historique; mais elles ne permet-tent pas de tracer les fronti6res de cette famille et donc, a elles seules, de lad6finir »,ss
Malgr6 la r6serve dont il s’entoure ~ bon droit, nous pouvons d’ores etd6j~ affirmer que Sevrin a demontre, au moins sur le point du bapteme, quele gnosticisme dit « s6thien » a eu une existence autre que livresque ethérésiologique.67 11 faudra bien sur soumettre a semblable examen lesautres caract6ristiques suppos6es du s6thianisme. 11 nous semble cepen-dant qu’au bout du compte, la realite se r6v6lera assez voisine de cequ’avait postule, avec une rigueur toute germanique, H.-M. Schenke.
Si la contribution des textes de Nag Hammadi a notre connaissance dugnosticisme est exceptionnelle, Ih ne s’arrete pas leur interet. 11 faut encorefaire 6tat de leur apport a 1’histoire du christianisme ancien, tant de sesdoctrines, en particulier de sa christologie, que de ses institutions. Sur cedemier point, les textes de Nag Hammadi nous apportent une moissonparticuli6rement abondante. Ils nous apprennent en effet ce que les sourceseccl6siastiques orthodoxes ne sauraient nous livrer, a savoir les tensions etles tiraillements auxquels a donn6 lieu la mise en place, dans 1’Eglise des
63 J.-M. Sevrin, Le dossier baptismal séthien: études sur la sacramentaire gnostique,BCNH, section « Etudes », 2 (Québec: Presses de l’Université Laval, 1986).
64 Ibid., 291.65 Ibid., 293.66 Ibid., 294.67 L’étude de Sevrin revêt, sur ce point, une grande importance pour l’édification si souvent
souhaitée d’une sociologie du gnosticisme ancien.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
314
deuxième et troisi6me siecles, de structures d’autorit6 appel6es a devenirexclusives et universelles. D6jh, les etudes de K. Korschorke68 et deJean-Pierre Mah669 ont montre comment des trait6s comme 1’Apocalypsede Pierre et le Témoignage de vérité instituent une vive polémique contre laGrande Eglise et sa hierarchie. Par ailleurs, Louis Painchaud7° a bien vu quele Deuxième traiti du Grand Seth opposait à la Grande Eglise, contrefagonde 1’Eglise celeste, une Eglise veritable, 6galitaire et libre.
Mais il n’y a pas que ces trait6s, ouvertement pol6miques, a offrirmatière pour 1’histoire de la structuration de 1’Eglise ancienne. Dans lath6se qu’il a consacr6e a 1’Apokryphon de Jacques du codex i. DonaldRouleaU7’ a montre que, sous le couvert de consid6rations a saveur as-c6tique et r6dig6es dans un style paradoxal, ce texte a lui aussi une vis6epol6mique pr6cise. 11 oppose, en particulier, une fin de non-recevoir auxstructures hi6rarchiques et aux m6canismes de m6diation institutionnellequ’6tait en train d’instaurer une Eglise se r6clamant de I’ap6tre Pierre.L’auteur de 1’Apokryphon de Jacques d6nonce la généralisation d’un mo-d6le eccl6sial autoritaire qui introduit au sein des disciples une distinctionentre ceux qui parlent et ceux qui ecoutent (cf. 9,29-35). La mefiancevis-h-vis la structure enseignants-enseign6s s’accompagne, dans 1’Apokry-phon de Jacques, du refus des concepts de grace et d’intercession dont onpouvait se r6clamer pour justifier la mise en place d’interm6diaires, dem6diateurs entre les croyants et le P6re: « Malheur a vous, qui avez besoind’un defenseur ! Malheur a vous, qui avez besoin de la grace ! Bienheureuxsont-ils, ceux qui auront parl6 avec assurance et se seront acquis poureux-m~mes la grace » (ll,llb-17a). Si les disciples n’ont pas besoin deparaklëtos, c’est qu’ils sont libres et qu’ils ont libre accès (parresia) auprèsdu P~re.
L’exploitation des textes de Nag Hammadi pour 1’histoire du gnos-ticisme, des institutions et du dogme chr6tiens, ne fait que commencer.Mais on peut pr6voir, au vu des exemples que nous venons d’en donner,qu’elle nous am6nera a reviser bien des id6es reques sur le gnosticisme et lechristianisme anciens, et sur leur interrelation. 12
4 L’6dition de la bibliothèque copte de Nag Hammadi
Si l’on fait abstraction des 6ditions parues sous forme de monographies oud’articles dans des revues scientifiques, il existe actuellement quatre pro-grammes d’6dition ou de traduction compl6te de la collection de NagHammadi: (1) la Coptic Gnostic Library, 13 dirig6e par le Prof. James M.
68 K. Korschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum, NHS 12
(Leiden: Brill, 1978).69 Voir son article « L’élitisme gnostique et la souillure de la Grande Eglise d’après les
textes de Nag Hammadi », à paraître.70 L. Painchaud, Le deuxième traité du Grand Seth (NH VII,2), BCNH, section « Textes », 6
(Québec: Presses de l’Université Laval, 1982), 20.71 D. Rouleau, L’Epître apocryphe de Jacques (NH 1,2), à paraître dans la section « Textes »
de la BCNH.72 Voir dans ce sens E. Pagels, The Gnostic Gospels (New York: Random House, 1979); sur
cet ouvrage, lire G. G. Stroumsa, « The Gnostic Temptation », Numen 27 (1980), 278-86.73 Les volumes de la Coptic Gnostic Library paraissent dans la collection Nag Hammadi
Studies (Leiden: Brill, depuis 1975).
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
315
Robinson, de Claremont (cA); (2) les Gnostische Schriften 74 du BerlinerArbeitskreis fiir koptisch-gnostische Schriften, sous la direction du Prof.H.-M. Schenke; (3) les Sources gnostiques et manichéennes75 6dit6es parM. Michel Tardieu, directeur d’6tudes a la cinqui6me section de 1’Ecolepratique des hautes etudes (Paris); (4) la Bibliothèque copte de Nag Ham-madi (= BCNH) , 76 editee par un groupe de recherche de la Faculte deth6ologie de l’Universit6 Laval, avec une large collaboration interna-tionale.
En regard des programmes d’6dition et de traduction int6grales encours, la BCNH se distingue par 1’ampleur qu’elle donne a l’introduction etaux commentaires des traites publics. N6cessaire ~ lintelligibilit6 de textesdont les doctrines sont complexes et le langage souvent obscur, l’impor-tance accordee a 1’introduction et aux commentaires a en outre confere a laBCNH son originalite propre au plan m6thodologique. En effet, mus par lavolont6 de rendre justice aux textes, les 6diteurs de la BCNH ont adopt6 uneapproche des documents centr6e sur le texte lui-meme considere commeun ensemble signifiant a d6coder. La recherche de la coh6rence interned’un traite, la mise a jour de 1’intention de son r6dacteur, le rep6rage de sesarticulations doctrinales, I’analyse de sa structure narrative et de son cadrede composition sont autant de pr6occupations qui se sont affirm6es de plusen plus nettement depuis les d6buts de 1’entreprise. Sans etre originale ninouvelle, cette approche 1’est du fait qu’elle est appliqu6e syst6matique-ment au corpus de Nag Hammadi, si bien que la BCNH a pu renouvelercompl6tement et de fagon irrevocable la compr6hension que 1’on avait euejusqu’ici de certains traités.77 Au terme de sa publication, la collectionBCNH comptera environ quarante volumes, dont un volume d’index. A cejour, dans la section « Textes » de la collection, quinze volumes ont 6t6publi6s, un volume est sous presse et trois autres devraient etre mis souspresse d’ici la fin de I’ann6e 1986. La publication de chacun des trait6scomporte les elements suivants: (1) le texte copte, 6tabli a partir de 1’edi-tion des fac-simil6s et v6rifi6 par une collation directe sur les papyriconserv6s au Caire et a Berlin; (2) un apparat critique sur le texte copte;(3) la traduction franraise; (4) une introduction apportant des donn6es debase sur le milieu d’origine du traite, I’histoire de sa r6daction et son plan;(5) un commentaire s’efforgant d’expliquer le texte par lui-meme, puis de1’eclairer a 1’aide de textes gnostiques qui lui sont proches ou par descomparaisons et des parallèles avec d’autres textes, philosophiques, bi-bliques ou patristiques; (6) un index des mots, grecs et coptes.
En marge de 1’edition du corpus de Nag Hammadi, on a aussi entreprisla constitution d’une Concordance informatis6e de tous les textes qu’il74 A paraître, à la suite de l’ouvrage de Schmidt, Koptisch-Gnostische Schriften (cité
note 44), dans la collection Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahr-hunderte (Berlin).
75 Aux éditions du Cerf; M. Tardieu y a publié le premier volume de cette collection: Ecritsgnostiques: le Codex de Berlin (Paris: Cerf, 1984).
76 Editée par les Presses de l’Université Laval (depuis 1977).77 C’est le cas notamment pour le Deuxième Traité du Grand Seth (NH VII,2), la Paraphrase
de Sem (NH VII,1), le Témoignage de vérité (NH IX,3), l’Hypostase des Archontes(NH II,4) et l’Evangile selon Marie (BG 1).
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from
316
comporte. Cette concordance se r6v6lera un outil pr6cieux pour leur etudedoctrinale aussi bien que linguistique.
En conclusion, il est permis d’affirmer que la collection des textes deNag Hammadi porte en elle la promesse d’un complet renouvellement denos connaissances sur le gnosticisme et sur le christianisme ancien. Maispour que cette promesse devienne realite, il faut de toute necessite elargir lechamp des etudes qui les concernent et les situer dans la perspective d’unehistoire globale de la pensee et de la civilisation dans le monde m6diterra-neen des quatre premiers sièc1es de notre 6re. D’autre part, 1’etude destextes de Nag Hammadi devra amener une reconsid6ration des temoi-gnages « classiques » sur le gnosticisme, c’est-h-dire de ceux, indirectspour la plupart, qui 6taient connus avant la d6couverte de Nag Hammadi.
Ce sont Ih, parmi d’autres, quelques-unes des taches que les textes deNag Hammadi proposent a la sagacit6 des chercheurs et dont on peutesp6rer, si elles sont realisees, un essor nouveau des etudes portant sur legnosticisme et le christianisme anciens.
at UNIVERSITE LAVAL on December 19, 2014sir.sagepub.comDownloaded from





















![Unique Photographic Evidence for Nag Hammadi Texts [1977–1980]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319fd35b41f9c8c6e09fe84/unique-photographic-evidence-for-nag-hammadi-texts-19771980.jpg)





![The "Coptic Gnostic Library of Nag Hammadi" and the Faw Qibli Excavations [2010]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319f2b2b41f9c8c6e09fa4d/the-coptic-gnostic-library-of-nag-hammadi-and-the-faw-qibli-excavations-2010.jpg)