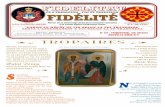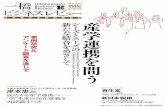Le quartier Pasteur ou l'extension urbaine de Nice au pied du monastère Saint-Pons. M. Bouiron....
Transcript of Le quartier Pasteur ou l'extension urbaine de Nice au pied du monastère Saint-Pons. M. Bouiron....
La reconstruction de l’hôpital Pasteur a été l’occa-sion d’examiner en détail l’évolution du quartier
qui s’étend dans une anse du Paillon en contrebas del’ancien monastère Saint-Pons. Ce “quartier Pasteur”(fig. 1), comme on l’appelle désormais, a été pendantdes siècles une zone de culture, facilement irrigablepar des canaux prenant leur prise directement dansle fleuve.
Les transformations urbaines du siècle dernierrendent désormais difficile la lecture du parcellaireancien, mais des éléments fossiles en sont encoreperceptibles. L’étude qui est donnée ici constitue unepremière approche, essentiellement centrée sur lapériode Contemporaine.
1. Avant le XXe s.
En l’absence de recherches détaillées dans lesfonds d’archives, les données sur l’occupation et leparcellaire anciens sont principalement issues d’unepart d’une étude géotechnique préalable à la recons-truction de l’hôpital Pasteur et d’autre part dequelques documents d’archives datant de la fin de lapériode Moderne.
1.1 Les niveaux les plus anciens
Deux études géotechniques conduites sur le sitede l’hôpital Pasteur permettent de se faire une idéedu sous-sol en contrebas immédiat du monastère
116
LE QUARTIER PASTEUR OU L’EXTENSION URBAINEDE NICE AU PIED DU MONASTÈRE SAINT-PONS
Marc Bouiron*
Fig. 1 - Vue aérienne du quartier Pasteur (cl. Ville de Nice).
* Directeur du Pôle Patrimoine Historique de la Ville de Nice et chercheur
associé au CEPAM (UMR 6130).
ARCHÉAM n° 16 - 2009, pp. 116-126.
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 116
Saint-Pons. Elles font apparaître des profondeurs desubstrat souvent importantes (supérieures à 10 m)qui semblent témoigner de la présence d’un paléo-thalweg au sud du monastère, dont l’axe d’écoule-ment allait du nord-ouest vers le sud-est, c’est-à-direen direction du Paillon. Dans la partie la plus prochedu fleuve, on trouve en effet des épaisseurs sédimen-taires pouvant dépasser les 20 m. La difficulté d’in-terprétation des carottages (réalisés en deux cam-pagnes distinctes), ainsi que l’erreur de positionne-ment de certains d’entre eux dans la restitution dusubstrat qui a été tentée par la société Sol ConseilMéditerranée, ne permettent malheureusement pasde tirer des conclusions définitives quant à la mor-phologie du sous-sol.
Nous n’avons pas à ce jour de renseignements surl’occupation du sol avant l’époque moderne. Larecherche en archives reste à faire pour les périodesdu Moyen Âge et des XVIe –XVIIe s.
1.2 Une zone de cultures au XVIIIe s.
Le cours du Paillon délimite deux anses propices àla culture et au développement de canaux. La bouclela plus au sud correspond à la zone de l’actuelleMaison d’arrêt. Elle portait anciennement le nomd’Arbre (ou Aubre en niçois) inférieur, toponymeconservé encore aujourd’hui par l’ancien cheminprincipal desservant le quartier.
Les Archives municipales conservent un plan par-cellaire de la zone au début du XVIIIe s.1 (fig. 2). Ilaccompagne un recueil d’actes d’arbitrage concer-nant les réparations à effectuer à la route du quartierde « l’Aubre », régulièrement inondée par le Paillon.Ce document atteste d’une configuration probable-ment ancienne, que l’on retrouve jusqu’au début duXXe s. Toute la zone est bordée à l’ouest par la routenord-sud qui mène au monastère Saint-Pons.Signalée comme strada publica sur le plan, elle cor-respond à l’actuel chemin de l’Arbre inférieur dans
117
Fig. 2 - Plan parcellaire du quartier de l’Arbre inférieur (ACN DD 38/02) (Cl. M. Bouiron).
Fig. 3 - Détail du plan topographique de Nice vers 1740.
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 117
les parties où le boulevard Pasteur ne l’a pas fait dis-paraître. Les terrains cultivés constituent desensembles délimités par des axes secondaires sou-vent doublés de canaux. Des bâtiments (fermes ?moulins ?) sont dessinés dans certaines parcelles. Lapartie gauche du document donne la liste de tous lespropriétaires.
Un document un peu plus tardif (fig. 3), daté desenvirons de 1740, indique seulement les voies et lesconstructions, accompagnées du nom des proprié-taires. Il s’agit du grand plan des propriétés de Nicequi fait apparaître ici le monastère de Saint-Pons etnous montre la configuration des deux zones del’Arbre inférieur et de l’Arbre supérieur. Ici apparaîtclairement la canalisation de la source de l’Arbre (laFont de l’Auber) non distinguée dans le premierdocument. Au nord, le chemin de l’Arbre se poursuiten direction de Saint-Pons. Il détermine encore lalimite avec une zone cultivée située en partie bassedonc inondable.
En 1797, la municipalité a le projet de réaliser unmur de digue sur le Paillon sur une grande partie dela boucle de l’Arbre supérieur2 (fig. 4). Outre la repré-sentation du moulin du sieur Baud, il faut noter ladénomination du quartier : « terres en plaine dite
les condamines de St-Pons ». La représentation ducadastre de 1812 est assez proche de celle du planparcellaire de 1740. Que cela soit pour la partie sud(fig. 5) ou pour la partie la plus proche de Saint-Pons(fig. 6), le foncier est organisé en parcelles générale-ment perpendiculaires au Paillon. Plusieursconstructions sont signalées, dont des moulins à eau.Des axes secondaires, à peu près les mêmes que sur leplan de 1740, structurent l’espace cultivé où trouventplace cultures maraîchères, fruitières et florales(Germain-Musso 1970, p. 2). L’oranger domine lar-gement, au côté du chanvre et de l’horticulture, trèsdéveloppée sur la rive droite du Paillon.
Le cadastre de 1872 (fig. 7) est beaucoup plus pré-cis pour cette zone et montre le développement d’uneagriculture de plus en plus intensive, accompagnéed’un important réseau d’irrigation. La zone de l’Arbresupérieur est divisée en trois grands terrains, qui por-tent le nom de leur propriétaire : la villa Gruning aunord, au contact de Saint-Pons ; la villa Gauthier aucentre (fig. 8) et la villa Clary au sud. Ces terrainssont bordés à l’ouest par le « chemin de Nice à Saint-Pons » et à l’est par la « Route départementale n°1de Nice à Saint-Martin Lantosque » appelée ulté-rieurement « route de Levens ». Le plan mentionne
118
Fig. 4 - Plan de l’Arbre supérieur en 1797 (AD06) (cl. Archives Départementales 06).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 118
119
Fig. 5 - Détail du quartier de l’Arbre inférieur sur lecadastre de 1812 (cl. Archives Municipales).
6 - Le quartier de l’Arbre supérieur sur le cadastre de 1812(cl. Archives Municipales).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 119
120
Fig. 8 - Détail du terrain de la villa Gauthier en 1872 (cl. Archives Départementales).
Fig. 7 - Le quartier de l’Arbre supérieur sur le cadastre de 1872 (cl. Archives Départementales).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 120
également les canaux d’arrosage, qu’il distingue ducanal qui aboutit au moulin situé à peu de distance duPaillon, déjà visible en 1812 et en 1797 sous le nom demoulin du sieur Baud.
2. L’évolution du quartier de l’Arbresupérieur dans la 1ère moitié du XXe s.
Les grandes transformations du quartier sontl’œuvre du XXe s. La superposition du cadastre de1872 avec le bâti actuel (fig. 9) témoigne amplementde ces changements.
Les vues anciennes (tableaux ou photographiesantérieures aux années 1910, moment de la construc-tion de l’hôpital Pasteur) ne laissent apparaître qu’uncouvert végétal semi-forestier sur la pente de la peti-te colline de Saint-Pons.
2.1 L’hôpital Pasteur
Le projet de construction d’un nouvel hôpitalprend forme dès le moment où le monastère Saint-Pons est transformé en annexe de l’hôpital Saint-Roch en 1908. Les dossiers conservés3 indiquent unachèvement du projet durant l’été 19094.
La construction de l’hôpital s’est faite approxima-tivement sur le terrain dénommé « Villa Gruning »sur le cadastre de 1872, en mordant sur l’ancien che-min menant au Paillon (ancêtre de l’avenue de la VoieRomaine) et les terrains situés au-delà.
Au moment de la Première guerre mondiale,seuls trois pavillons sont achevés. Les autres sontbâtis de façon échelonnée jusqu’à la Seconde guerremondiale : quatrième pavillon achevé en juillet 1932,pavillons dits « des fiévreux » en 1933-1934 etpavillons des tuberculeux en 1937-1938 (fig. 10).
Le projet initial prévoyait de démolir l’ancienbâtiment du monastère pour construire un pavillonpour les enfants « fiévreux ». L’extrait de plan pré-senté ici (fig. 11) pour la pose de conduites en 19135,donne une vue d’ensemble des pavillons initialementprévus ; tous ne seront pas construits.
Durant toute la première moitié du XXe s., l’envi-ronnement ne change pas, l’hôpital reste éloigné de laville, quasiment en pleine nature (fig. 12).
2.2 La création de la voirie et le développement del’habitat
Une école est construite le long de la voie bordantle Paillon en 1900. A cette époque, cet axe est un desprincipaux sur la rive droite. Les deux rives sontencore difficilement joignables ; c’est pourquoi onentreprend de construire, entre 1915 et 1920, unepasserelle qui franchit le Paillon au niveau des abat-toirs.
Dans les années 1910-1920 (fig. 13 et 14), les voiessont encore peu nombreuses. Elles correspondent à
l’ancien tracé de la Voie Romaine (rectifié en 1973) etaux actuelles avenue Antonia Augusta, rue Lesueur etrue Gauthier-Roux (qui n’est encore qu’un cheminsecondaire en 1910).
L’ancien chemin de l’Arbre inférieur étant tropétroit pour desservir l’hôpital, un nouveau boulevard,le boulevard Pasteur, est percé entre la place du XVe
Corps et l’hôpital, par tronçons successifs, de 1933 à19476 (fig. 15). Tous ces travaux d’amélioration de lavoirie entraînent de facto le développement de lazone, qui se trouve en quelque sorte rapprochée de laville. Un plan d’alignement pour le quartier est misen œuvre en 1936.
La densification de l’habitat se fait conjointementaux créations des voies d’accès. Ainsi les rues Curie,du 11 novembre et Claude Bernard (Arbre inférieur)sont ouvertes en 1929 pour desservir les premièresHabitations à Bon Marché, ancêtres des HLM.
On construit en 1926 dans ce quartier le stadevélodrome, sur l’ancienne propriété Gauthier. Il com-prend « une piste cyclable de 400 m, une pistegazonnée pour les épreuves pédestres et un espacelibre pour les matchs de rugby, de football et deboxe » (Germain-Musso 1970, p. 12). Son emprise estimportante, et le réseau des voies va être recomposétout autour. Ce stade se trouvait à l’emplacement del’actuel immeuble Arc-en-ciel, entre la rue Delvalle etla rue Lesueur. Il est détruit vers 1955-1956.
M.-F. Germain-Musso (1970) a étudié en détail lacomposition et l’accroissement de la population.L’occupation de la zone, dans la première moitié duXXe s., reste très largement agricole, à l’inverse de larive gauche beaucoup plus industrielle.
3. La transformation de la 2e moitié duXXe s.
Les évolutions les plus importantes ont lieu aprèsla Seconde guerre mondiale : « la mutation en quar-tier urbain est liée à l’extension de la ville et à unecrise du logement qui a sévi à partir des années1950 » (M.-F. Germain-Musso 1970 p. 14).
3.1 La construction des grands ensembles
La nécessité de loger rapidement de nombreuxhabitants conduit à créer de grands ensembles immo-biliers. Les contraintes financières fortes imposéespar l’Etat aux offices d’HLM conduisent ces derniersà rechercher les terrains les moins chers, donc éloi-gnés de la ville. Les premiers logements sociauxapparaissent sur l’ancienne propriété Musso achetéepar la ville en 1956. Ce vaste terrain est loti durantplusieurs années avec trois ensembles différents(fig. 16). La construction des différents HLM se faitparallèlement à la création de la rue Delvalle, quireprend l’alignement de l’ancien vélodrome.
De grands ensembles immobiliers sont érigés sur
121
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 121
122
Fig. 9 - Superposition du cadastre de1872 sur une vue aérienne actuelle
(M. Bouiron sur fond ville de Nice).
Fig. 10 - Phases de construction de l’hôpital Pasteur(M. Bouiron sur fond ville de Nice).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 122
123
Fig. 12 - Le quartier Pasteur vu de la rive gauche du Paillon dans la 1ère moitié du XXe siècle (AD06 3 Fi 90/5).
Fig. 11 - Projet de pose de conduites dans l’hôpital Pasteur (AD06 2 O 764) (cl. M. Bouiron).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 123
124
Fig. 13 - Détail du plan de Nice en 1910 (cl. M. Bouiron).
Fig. 14 - Détail des réseaux d’eau pour l’incendie (AD06 2 O 764) (cl. M. Bouiron).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 124
le terrain de l’ancienne villa Clary à partir de 19627.Ils sont construits par la Caisse des Dépôts etConsignations, l’EDF et la Ville pour loger les fonc-tionnaires. L’année suivante est construit l’Arc-en-Ciel, sur l’ancien vélodrome et en 1965 a lieu l’ouver-ture d’un bureau de poste8. Enfin les derniers grandsimmeubles construits à la fin des années 1960 bor-dent l’avenue Pasteur.
Pour accompagner l’accroissement des habitats,un nouveau groupe scolaire (Pasteur-Vélodrome,actuellement Pasteur) est ouvert à partir de 1964. Ilest « réservé, en principe, aux enfants habitant aunord de la rue Clary jusqu’à la route de Levens » (M.-F. Germain-Musso 1970 p. 22).
3.2 Les derniers percements de la voiriemoderne
Plusieurs petits réalignements de voirie ont lieudans les années soixante9 ; ils permettent de gom-mer progressivement les différences d’orientationavec l’ancien parcellaire.
L’avenue Maurice Maccario est percée en 1969-1970. Rejoignant la rue du Professeur Delvalle, cetaxe est construit en surélévation par rapport auxanciens quartiers se trouvant plus à l’est. Ceci entraî-ne la transformation en impasse des rues Carlo etMarengo.
125
Fig. 15 - Détail du plan de perce-ment du boulevard Pasteur (AD06 14W 1682) (cl. M. Bouiron).
Fig. 16 - Plan de l’ancienne propriété Musso en 1959
(AD06 47 W 202) (cl. M. Bouiron).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 125
En 1973, l’avenue de la Voie Romaine est rectifiéedans son tronçon oriental pour aboutir au débouchédu pont de Bon-Voyage. Il subsiste encore dans l’ur-banisme actuel la trace de l’ancienne rue parallèle àl’avenue Antonia Augusta. Là encore le niveau de lachaussée est surélevé, pour venir au contact de l’in-tersection avec la rue Maurice Maccario.
Les derniers grands terrains disponibles sontsitués au nord du groupe scolaire Pasteur (fig. 17). Ilsont été utilisés récemment pour construire un centreomnisports.
Conclusion
Le quartier Pasteur, en contrebas du monastèreSaint-Pons, est passé en moins d’un siècle d’un espa-ce agricole à un véritable quartier urbain, coincéentre le Paillon et l’hôpital Pasteur. L’opuscule de M.F. Germain-Musso étudie de façon beaucoup plusdétaillée la population et les fonctions urbaines de cequartier de la vallée du Paillon.
Il reste encore beaucoup à faire pour la périodemédiévale et de l’Ancien Régime. Nul doute qu’uneétude approfondie apporterait de nombreux rensei-gnements sur cette ancienne Condamine de Saint-Pons.
Bibliographie
Germain-Musso 1970 : GERMAIN-Musso (Marie-France),Pasteur – Bon Voyage. Nice : Université de Nice,Laboratoire de géographie Raoul Blanchard, s. d. v 1970(Les quartiers de Nice, 7), 45 p.
Notes
1 ACN DD 38/02.2 AD06 CE S 83.3 AD06 1 X 168 à 172 pour le projet, 1 X 173 à 181 pour lesextensions successives.4 Voir l’article du Petit niçois du 1er août 1909.5 AD06 2 O 764.6 AD06 3 O 373.7 AD06 47 W 202 pour l’achat des terrains par l’officepublic HLM de la Ville de Nice. Voir également le dossierAD06 207 W 117.8 AD06 201 W 339 (1964-1965).9 AD06 218 W 18 : rue Louis Gassin (1960) ; AD06 14 W1680 : av. Gauthier-Roux (1964) ; AD06 14 W 1682 : quaiMaréchal Lyautey (1961) ; AD06 69 W 475 : Voie Romaine(1961).
126
Fig. 17 - Les terrains de la villa Clary en 1967 (AD06 598 W 94).
$Archéam 16 IMP V6 5/03/10 15:59 Page 126