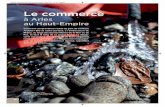Le monastère de gTam zhing (Tamshing) au Bhoutan central
Transcript of Le monastère de gTam zhing (Tamshing) au Bhoutan central
Yoshiro ImaedaFrançoise Pommaret
Le monastère de gTam zhing (Tamshing) au Bhoutan centralIn: Arts asiatiques. Tome 42, 1987. pp. 19-30.
AbstractThe gTam zhing lHun grub chos gling monastery is situated in the Chos 'khor valley in the Bum thang region of Central Bhutan. Itwas founded by the famous gter ston « treasure- discoverer» Padma gling pa (1450-1521) at the very beginning of the sixteenthcentury. Since 1959, it became the residence of the two lineages of reincarnation of Padma gling pa tradition : the Pad glinggsung sprul, reincarnation of Padma gling pa, and the Pad gling thugs sras, that of Zla ba rgyal mtshan ( 1499-?), son of the gterston. Thus it is an important centre of teachings of Padma gling pa tradition of the rNying ma pa school of Tibetan Buddhism.Moreover, this small monastery presents a particular interest in the general history of Tibetan art. In fart some paintings of theground floor date from the very foundation of the monastery and miraculously escaped from being retouched or repainted. Thereis a certain similarity of style between them and those of gTsang in Tibet, particularly those of rGyal rtse which are chronologicallyand geographically very close. One can admire for the first time the hitherto little studied iconography which is peculiar to thegreat « treasure-discoverer » of Bhutanese origin.
Citer ce document / Cite this document :
Imaeda Yoshiro, Pommaret Françoise. Le monastère de gTam zhing (Tamshing) au Bhoutan central. In: Arts asiatiques. Tome42, 1987. pp. 19-30.
doi : 10.3406/arasi.1987.1213
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arasi_0004-3958_1987_num_42_1_1213
Yoshiro Imaeda et Françoise Pommaret
Le monastère de gTam zhing (Tamshing)
au Bhoutan central
Le nom complet du monastère de gTam zhing « le monastère du lieu du discours » est lHun grub chos gling. Situé au Bhoutan central, dans la vallée de Chos 'khor
(Choekhor) qui fait partie de la région de Bum thang (Bum- thang), ce monastère d'humble aspect, souvent négligé par le voyageur pressé, inconnu du reste du monde, est, à plus d'un titre, extrêmement important1.
Fondé par Padma gling pa (1450-1521) au tout début du XVIe siècle, c'est un des rares lieux où l'enseignement de la tradition de ce « découvreur de trésors cachés » (gter ston) se poursuit de nos jours.
Depuis 1959, il est aussi la résidence de la réincarnation de Padma gling pa, le Pad gling gsung sprul2.
La réincarnation d'un des fils de Padma gling pa, Zla ba rgyal mtshan (1499-?),\e Pad gling thugs sras(Hg. l)3 habite également à gTam zhing et ces deux réincarnations forment le noyau spirituel d'une petite communauté monastique qui s'est créée à l'emplacement de ce site historique lorsque les moines du monastère de lHa lung de la région du lHo brag au Tibet s'y réfugièrent chassés par l'invasion chinoise.
Le monastère de lHa lung n'est qu'à quelques journées de marche au nord de gTam zhing. Il était le grand monastère de la tradition de Padma gling pa au Tibet et la résidence des Pad gling gsung sprul et Pad gling thugs sras.
Mais, au-delà de son importance spirituelle, ce monastère présente un intérêt exceptionnel pour l'histoire de l'art tibétain. En effet, le vestibule qui se trouve au rez-de-chaussée est orné de peintures qui datent du tout début du XVIe siècle et qui ont miraculeusement échappé aux restaurations qui sont considérées dans le monde bouddhiste comme des actes pieux.
Avant d'étudier en détail ces peintures et celles, qui leur sont postérieures, des deux cellae du temple, et pour mieux comprendre leur signification, nous devons situer le monastère de gTam zhing dans son contexte historico-religieux et bien saisir son importance.
Tous ceux qui s'intéressent à la culture tibétaine savent la place qu'occupe actuellement le Bhoutan dans ce vaste ensemble. Royaume du sud de l'Himalaya, longtemps fermé sur lui-même et interdit aux étrangers, le Bhoutan est un extraordinaire conservatoire de traditions aujourd'hui perdues au Tibet. Il se proclame avec fierté, le seul pays du monde où le bouddhisme tantrique est la religion officielle.
Du XIe au XVIe siècle, des missionnaires bouddhistes venus du Tibet établirent de nombreuses écoles dans ce « pays du Sud » : les rNying ma pa, les Sa skya pa, les gNas rnying pa, les lHa pa bka' brgyud pa, et les 'Brug pa bka' brgyud pa se
partagèrent le pays jusqu'à la victoire de ces derniers au XVIIe siècle et l'unification du pays sous leur hégémonie. Toutefois, l'école des rNying ma pa qui selon la tradition bhoutanaise aurait été introduite au VIIIe siècle par Padma- sambhava, était prépondérante dans le centre et l'est du pays et y maintint son importance même après l'unification des 'Brug pa.
A partir du XIe siècle, cette école vit au Tibet et au Bhoutan le développement du mouvement des « découvreurs de trésors cachés», les gter ston, et c'est à ce mouvement qu'appartint le grand saint bhoutanais dont il est question ici, Padma gling pa.
L'histoire de Padma gling pa est bien difficile à démêler de la légende ou de l'hagiographie. Nous n'en retracerons ici que les grandes lignes.
Selon son autobiographie4, Padma gling pa est né en 1450 dans un petit village de la vallée de Tang située dans la région de Bum thang. La tradition veut qu'il soit, entre autres, la réincarnation de la fille du roi Khri srong lde btsan, la princesse Padma gsal morte à huit ans ainsi que du grand philosophe rNying ma pa de tradition rDzogs chen pa, Klong chen rab 'byams pa (1308-1363). Son père appartenait à l'ancien clan tibétain appelé sMyos. Le premier membre de ce clan qui se rendit au Bhoutan fut rGyal ba lHa gnang pa gZi brjid dpal (1164-1224), le fondateur de l'école lHa(s) pa bka' brgyud pa.
Fig. 1. Thugs sras rin po che donnant une bénédiction.
19
Cette école exerça une influence considérable au Bhoutan occidental avant de disparaître complètement après l'unification du Bhoutan sous les 'Brug pa dans la première moitié du XVIIe siècle.
Le fils de lHa(s) gnang pa, 'Khrul zhig chos rje alias bDe mchog (1 179-1265) se rendit également au Bhoutan et établit dans la vallée d'U ra à Bum thang le monastère de Sum phrang bSam grub chos rdzong qui deviendra le siège principal de la branche bhoutanaise du clan sMyos.
Cinq générations plus tard, la branche bhoutanaise des sMyos fut divisée en deux lignées: celle de Sum phrang, continuée par 'Jam dbyangs grags pa 'od zer ( 1 382- 1442) (et qui continue jusqu'à nos jours) et celle de son frère aîné bsTan pa'i nyi ma (1382-?) qui établit le temple de Glang 'brang près de Sum phrang.
Le fils aîné de bsTan pa'i nyi ma, Don grub bzang po eut neuf enfants dont l'aîné fut dPal 'byor alias Padma gling pa5. Pad ma gling pa fut très tôt attiré par la religion. Un jour Guru rin po che (Padmasambhava) lui apparut et lui révéla sa doctrine ainsi que les dates auxquelles il lui faudrait aller chercher les « trésors cachés » (gter). Suivant les instructions de ces prophéties, Padma gling pa découvrit des textes et des statues à Me 'bar mtsho, dans une gorge profonde où la rivière de Tang forme un petit lac. Il donna de nombreux enseignements et il eut aussi des visions du paradis de Guru rin po che. On dit d'ailleurs que c'est au retour de l'un de ces voyages mentaux qu'il composa des danses qui sont encore exécutées de nos jours lors des festivals à travers tout le Bhoutan et plus particulièrement lors de la fête annuelle du monastère au huitième mois lunaire.
Padma gling pa fut aussi un excellent artisan forgeant des rideaux en mailles de fer (Icags khrab)6 et exécutant des masques en bois qui sont toujours à gTam zhing. Il passa la plus grande partie de son existence dans la région de Bum thang et quand il mourut en 1521, son corps fut conservé au monastère de gTam zhing jusqu'au moment de la conquête de Bum thang par le Gouverneur 'Brug pa de Krong gsar (Tongsa) au XVIIe siècle. L'endroit où repose actuellement la dépouille de Padma gling pa fait aujourd'hui l'objet d'un débat chez les érudits bhouta- nais7.
C'est Grags pa gyal mtshan, un de ses nombreux fils, qui hérita du temple de gTam zhing et fonda la famille des gTam zhing chos rje dont les descendants actuels patronnent en partie le monastère7. Ses autres fils se disséminèrent à Bum thang, à sKur stod (Kurtoe) au nord-est de Bum thang et jusque dans la région orientale de bKra çis sgang (Tashigang)8.
Padma gling pa fut à l'origine d'une lignée d'incarnations appelée Pad gling gsung sprul dont l'actuel, Kun bzang Padma rnam rgyal, né en 1968, est le onzième du nom.
Après la mort de Padma gling pa, la résidence des Pad gling gsung sprul fut, comme on l'a vu lHa lung au Tibet. Pourquoi cet abandon, et pourquoi faut-il attendre l'année 1959 pour que gTam zhing redevienne résidence principale? Ce fait reste mystérieux. Cependant le slob dpon Padma lags (Lopon Pemala), Directeur de la Bibliothèque nationale du Bhoutan, qui comme nous s'est posé la question, nous a proposé l'explication que voici : il semble que Padma gling pa ait entretenu des liens de maître à disciple avec le chef de la région de lHa lung, rGyal ba don grub, tandis que ce dernier n'était pas en bons termes avec l'historien Karma pa dPa'o gtsug lag phreng ba ( 1 503- 1 566) qui, justement, avait comme résidence lHa lung fondé en 1 154 par Dus gsum mkhyen pa ( 1 1 1 0- 1 1 93)9. A la mort de dPa'o gtsug lag
phreng ba, le chef local s'arrangea pour que le monastère revienne aux réincarnations de Padma gling pa qui toutes furent retrouvées au Tibet, exceptées la huitième et l'actuelle, toutes deux bhoutanaises.
Padma gling pa fonda le monastère de gTam zhing en 1501. On raconte que le chef de la région de Chos 'khor, principal protecteur de Padma gling pas fit un discours (gtam) pour essayer de trouver un nom au temple,... et c'est le mot gtam lui-même qui fut retenu.
Le temple, de taille modeste, fut établi sur la rive gauche du lCam mkhar chu (Chamkhar Chu) qui est la rivière principale de Chos 'khor, à cinq kilomètres au nord de l'actuel rdzong (dzong) de Bya dkar (Jakar) et sa construction dura quatre ans10.
Dans son état actuel, le monastère se compose de deux parties : les habitations et le temple orienté vers l'est. Une cour, ouverte sur les champs à l'est, est entourée au sud et à l'ouest par des bâtiments où sont situées les cellules des moines et la cuisine. Le temple clôt le côté nord de la cour et son mur sud est percé d'une porte qui débouche sur une petite cour intérieure dallée. Un porche soutenu par des piliers donne accès au temple (fig. 2, 3 et 4).
Fig. 2. Vue d'ensemble du monastère de gTam zhing, côté sud.
Fig. 3. Entrée sud du temple et danse masquée dans la cour du monastère.
20
rez-de-chaussée (dressé par J. Maseland). Fig. 6. Intérieur de la cella du premier étage, dans le fond, peinture du Buddha primordial Samantabhadra.
A l'intérieur, de chaque côté de la porte, dans des niches, on trouve deux statues grossièrement sculptées de Pe har (a) à gauche et rDo rje legs pa (b) à droite.
Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste vestibule (fig. 5) qui se continue par le chemin de circumambulation entourant la cella. Celle-ci est à son tour divisée en deux parties, comme souvent les temples au Bhoutan, avec une antichambre et le saint des saints séparés par une ouverture à piliers fins.
On atteint le premier étage par deux escaliers latéraux. Une simple galerie soutenue par des piliers et un espace vide servant de puits de lumière remplacent le vestibule de l'étage inférieur. La galerie se prolonge en chemin de circumambulation autour d'une seconde cella (fig. 6), reprenant ainsi le plan du rez- de-chaussée. Au-dessus du porche, du côté ouest se trouve le temple des divinités protectrices terribles, le mgon khang (K).
Fig. 5. Vestibule et les deux cellae du temple.
t.T — . • * m* "H:
Le schéma de ce temple est conforme à celui des temples anciens que G. Tucci attribue au début de la période de la seconde diffusion (phyi dar) du bouddhisme : « In general these temples are small and rectangular in plan ; frequently but not invariably, there is an atrium with wooden pillars in front of the temple... Sometimes the temple consists of two parts, one inside the other, separated by a passage running round the inner chamber in which the worshipper could perform the prescribed circuit. [...] The interior was almost always decorated with paintings, some good examples of which, dating from the period of construction of the temple, have been preserved »n.
L'architecture même du temple semble donc prouver qu'il a échappé à la période de reconstruction qui, à la fin du XVIe siècle, a touché tant de temples au Tibet et au Bhoutan.
On trouve à gTam zhing deux grandes séries de peintures. La première comprend celles du vestibule du rez-de-chaussée, qui sont contemporaines de la construction du temple. La seconde série regroupe les peintures des deux cellae qui peuvent être datées de la fin du XIXe siècle.
Le rez-de-chaussée
Les peintures du vestibule du rez-de-chaussée (A) datent sans aucun doute de l'époque de la construction du temple. Quelques-unes seulement sont endommagées mais la plupart sont dans un état de conservation remarquable sans doute parce qu'elles sont éloignées des sources de ruissellement des eaux de pluie, en raison aussi de l'absence de lampes à beurre et de toute lumière dans le vestibule.
Ces peintures sont au nombre de trente-six. En commençant par la gauche à partir de la porte d'entrée et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, on trouve successivement :
1 — La Roue de la vie (Srid pa'i 'khor lo). 2 — La déesse lHa mo Rematî. 3 — Le gnod sbyin gÇan pa dmar nag (fig. 7)12. 4 — Srogbdud13. 5 — Le gnod sbyin gÇan pa nag mo14. 6 — Padma gling pa. 7 — Le septième Karma pa Chos grags rgya mtsho (1454-
1506)15.
21
■A ; V--.. , '>'
-y/'.
\. r. .,
Fig. 7. Peinture du vestibule: le gnod sbyin gÇan pa dmar nag. . 5. Peinture du vestibule: Ye ces mtsho rgyal.
8 — Ye ces mtsho rgyal (fig. 8). 9 — Guru rin po che.
10 — 'Jam dpal bçes gnyen (fig. 9)16. 11 — dGa' rab rdo rje17. 13 — Vajradhara. 14 — Vajrasattva. 15 — Amoghasiddhi (fig. 10). 16 — Amitâbha. 17 — Ratnasambhava. 18 — Aksobhya. 19 — Vairocana. 20 — Peinture détruite.
La série est interrompue par l'entrée du chemin de circumam- bulation. Elle reprend à sa sortie, du côté droit du vestibule après une peinture des Buddha des Trois Temps. Cette dernière peinture, sans doute assez récente, a pu être exécutée à la place de celles qu'un ruissellement des eaux aurait endommagées, comme dans le cas de la peinture 20.
21 — Amitâyus enyabyum (fig. 11)18. 22 — Guru drag po. 23 — Avalokiteçvara Mahâkaruna enyabyum (fig. 12). 24 — Hayagrîva en yab yum. 25 — Samantabhadra de forme paisible en yab yum (fig. 13). 26 — Sa forme terrible 19 enyabyum. 27 — Manjuçrî (fig. 14). 28 — Yama20 enyabyum (fig. 15). 29 — Avalokiteçvara mahâkaruna (fig. 16). 30 — Vajrapâm21.
Fig. 9. Peinture du vestibule : 'Jam dpal bçes gnyan.
Sïtv/i/ /
22
y. 10. Peinture du vestibule: Amoghasiddhi. Fig. 11. Peinture du vestibule: Amitâyus avec sa parèdre.
Cl i lite** ' i'i-*» f { sS^ i* \ ■ x ^-fr*. ' '■!" •*" i. -^ -^j.^-"^* -3
^w
»fe^i. Fig. 12. Peinture du vestibule: Avalokiteçvara Mahâkaruna avec sa parèdre. Fig. 13. Peinture du vestibule: le Buddha primordial Samantabhadra
avec sa parèdre.
31 — Prajnâpâramitâ (fig. 17). 32 — Vajrakîla en yab yum. 33 — Vaiçravana. 34 — Mahâkâla (fig. 18)22. 35 — Ekajarî(fig. 18)22. 36 — Râhu22.
D'après leyongs 'dzin « précepteur » Tshebrtan, certains sâdhana (sgrub thabs) « rituels de coercition » ne sont plus exécutés de nos jours à gTam zhing parce que leur tradition a été perdue au cours des siècles. D'autre part, certains ne viennent pas de Padma gling pa mais de Klong chen rab 'byams pa dont on sait que Padma gling pa était une réincarnation. On trouve dans les œuvres complètes de Padma gling pa différents sâdhana en relation avec les divinités des peintures de gTam zhing et leur liste est donnée en note23.
Chaque peinture se compose d'une figure centrale entourée de petits personnages qui forment sa suite et sont placés de part et d'autre en registres. Les couleurs sont disposées uniformément et le trait du dessin est ferme et bien délimité.
En regardant ces peintures, on se pose la question de leur appartenance à un style défini. Essayons, avec toute la prudence qui s'impose, de formuler quelques hypothèses et demandons- nous si ces œuvres ne pourraient pas appartenir aune école dont l'aboutissement géographique le plus méridional et l'aboutissement chronologique le plus tardif se situeraient à gTam zhing. Il est bien entendu qu'il s'agit de suggestions et non pas de conclusions définitives. L'absence de repères chronologiques contemporains au Tibet même, ne permet pas d'aller au- delà.
Reprenons l'examen des peintures : la composition symétrique de chacune d'elles avec sa figure centrale aux dimensions
23
W: ÏÏÏ^r^ ̂ ̂̂ Ù % -' I • ié fC^W.4
y^
^fcTw
a
T^' ..A ''fi
Fy. 74. Peinture du vestibule: Manjuçrî.
Fig. 16. Peinture du vestibule: Avalokiteçvara.
Fig. 15. Peinture du vestibule: Yama avec sa parèdre.
1 ;Z- *'.'5:":'.^T^7'
24
Fig. 17. Peinture du vestibule: Prajnâpâramitâ.
. 75. Peinture du vestibule: mGon po ma ning et Ekajalî.
imposantes entourée de petits personnages en registres, le traitement du vêtement, de la couronne et la position apprêtée des bodhisattva disposés de chaque côté de certaines figures centrales font irrésistiblement penser à une influence indonépalaise (fig. 12 et 14). Elles permettent de les rapprocher du regroupement opéré par G. Tucci entre les peintures de Karakhoto et celles du Tibet méridional d'Iwang, Samadha et gNas gsar, entre autres, bien que les dates de ces peintures soient antérieures d'au moins deux siècles à celles de gTam zhing.
Toutefois certains éléments comme les bracelets à plusieurs bandes avec un ornement triangulaire sur le dernier, les écharpes remplaçant le cordon sacré ou drapées autour des membres, la coiffure à trois étages avec des rubans flottant de chaque côté des oreilles, le traitement des yeux, et même les vêtements couvrants de style chinois des bodhisattva entourant Amoghasiddhi (fig. 10), Vajrasattva et Ratnasambhava rappellent aussi le style de rGyal rtse (Gyantse) dont on sait que le tnchod rten (stûpa) et le monastère de dPal 'khor chos sde datent du début du XVe siècle. Or, il est sûr que le style de rGyal rtse de
cette époque a été influencé par l'art d'Iwang, Samadha et gNas gsar, entre autres, qui se trouvent dans la même région tout en y incorporant des éléments chinois24. On remarquera aussi que les peintures des personnages tels que 'Jam dpal bçes gnyen, Ye ces mtsho rgyal rappellent étonnamment celle d'Atîça dans le monastère de sPos tshogs chos sde au gTsang publiée par G. Tucci25, représentation qu'il date au plus tard du début du XVIe siècle.
On sait que le Bhoutan, par sa position géographique, avait des contacts privilégiés avec tout le sud du Tibet et que rGyal rtse était un important centre commercial pour le bois et autres matières premières.
Bien qu'il soit impossible de connaître l'origine des artistes qui ont peint gTam zhing, on peut suggérer que ces peintures constituent un témoignage tardif et régional du style de rGyal rtse mais il est sûr qu'elles forment par leur nombre, leur authenticité indiscutable et leur qualité un ensemble unique et une étape importante de l'histoire de l'art tibétain.
Le chemin de circumambulation est également décoré de peintures qui semblent, elles aussi, anciennes mais dont la datation est bien moins aisée. Le mur extérieur (B) est orné de huit arhat (gnas brtan) puis du Buddha de médecine (sMan bla, Bhaisajyaguru) et à nouveau de huit arhat.
Sur le mur intérieur (C) est figurée la lignée spirituelle de Padma gling pa (Padgling bla brgyud) et dans un cas comme dans l'autre, par manque de références, nous ne nous hasarderons pas à dater ces peintures.
La cella du rez-de-chaussée est dédiée à Guru rin po che. Il y a dans le sanctuaire intérieur (D) une statue de Guru rin po che entourée des statues de ses Huit Manifestations (Gu ru mtshan brgyad)26. Les deux grands murs latéraux de l'antichambre présentent un intérêt considérable car la lignée de Guru rin po che appelée Nor bu rgya mtsho, une tradition particulière à Padma gling pa, est figurée sur le mur de droite (E) (fig. 19) tandis que sur le mur de gauche (F) est représentée la lignée de Padma gling pa, l'identité de chaque personnage est donnée par une inscription.
Voici maintenant le détail de ces peintures :
Nor bu rgya mtsho (E) : 1 — Padma 'byung gnas. 2 — Ratna thod phreng27. 3 — Buddha thod phreng27. 4 — dGa' rab rdo rje. 5 — Kun bzang (Samantabhadra) yabyum, le Buddha
dial des rNying ma pa. 6 — rDo rje sems dpa' (Vajrasattva), le Buddha primordial du
rDzogs chen.
Fig. 19. Schéma de la peinture du cycle de Nor bu rgya mtsho.
2
10
20
3
11
21
4 5
12
22
23
13
14
24
I
15
25
6 7
16
26
8
17
27
9
18
28
19
25
7 — Çrî sing ha (çrî simha), disciple de 'Jam dpal bçes gnyan et maître de Vimalamitra.
8 — Badza (Vajra) thod phreng27. 9 — Padma thod phreng27.
10 — Nyi ma 'od zer, une des Huit Manifestations de Guru rin po che.
11 — Blo ldan mchog sred, idem. 12 — Çâkya seng ge, idem. 13 — Karma thod phreng27. 14 — Manda ra ba (Mandâravâ), parèdre de Guru rin po
che. 15 — Ye ces mtsho rgyal, idem. 16 — mTsho sky es rdo rje, une des Huit Manifestations de Guru
rin po che. 17 — Padma sam bha va (Padmasambhava), idem. 18 — Padma rgyal po, idem. 19 — 'Jigs med gling pa (1730-1798), célèbre gter ston, éditeur
des rNying ma'i rgyud 'bum «Collection des tantra anciens».
20 — Nub gyi dpa' bo yab yum28. 21 — Car gyi dpa' bo yab yum28. 22 — Seng ge sgra sgrogs, une des Huit Manifestations de Guru
Rin po che. 23 — Kun bzang 'jigs med phrin las rnam rgyal (dates
nues), lama rNying ma pa maître du Spa gro dpon slob (Paro Penlop) « Gouverneur de Paro » Phrin las stobs rgyas (1857-?) qui était le frère aîné d'U rgyan dbang phyug (Ugyen Wangchuck, 1862-1926), premier roi du Bhou- tan.
24 — rTa phag yab yum, Hayagrîva et Vajravârâhî. 25 — 'Jigs med rang grol rdo rje, « frère de religion » (chos grogs)
de Kun bzang 'jigs med phrin las rnam rgyal, qui habitait à Skur stod.
26 — rDo rje gro lod, une des Huit Manifestations de Guru rin po che.
27— lHo yi dpa' bo yab yum28. 28— Byang gi dpa' bo yab yum28.
Lignée de Padma gling pa (F) (fig. 20 et 21) 1 — gTer chen yongs kyi gtso 'gyur pa U rgyan rgyal tshab
Padma gling. 2 — Rigs ma Sangs rgyas skyid, deuxième incarnation
rieure de Padma gling pa, gsang yum29 du grand gter ston Nyang rai Nyi ma 'od zer (1124-1192).
3 — rGyal sras Mu khri btsan po, circa 800, fils de Khri srong lde btsan et frère de Padma gsal, la première incarnation antérieure de Padma gling pa.
4 — Thugs rje chen po (Avalokiteçvara Mahâkanma). 5 — 'Od dpag med (Amitâbha). 6— Guru rin po che. 7 — Khri srong lde btsan, roi du Tibet, seconde moitié du
VIIIe siècle. 8 — lHa lcam Padma gsal, fille de Khri srong lde btsan et
première incarnation antérieure de Padma gling pa. 9 — 'Khrul zhig Rin chen grags pa, la quatrième incarnation
antérieure de Padma gling pa. 10 — mChog tsol(?) Padma sgrol ma, troisième incarnation
antérieure de Padma gling pa, gsang yum du grand gter ston Guru chos dbang (1212-1270).
11 — gsum pa Kun mkhyen Tshul khrims rdo rje, troisième Pad gling gsung sprul ( 1 598- 1 669) .
12 — Kun mkhyen Klong chen rab 'byams pa (1308-1363)30, sixième incarnation antérieure de Padma gling pa.
13 — Padma las 'brel rtsal (1291-1316)30, cinquième tion antérieure de Padma gling pa.
Fig. 20. Peinture de la cella du rez-de-chaussée: la lignée de Padma gling pa.
Fig. 21. Schéma de la peinture de la lignée de Padma glmg pa.
2 3 4 5 6 7
10
I 12 1 13 14
15 16
17 18 19 20 21 22
26
14— bzhi pa Ngag dbang kun bzang rdo rje, quatrième Padgling gsung sprul (1680-1723).
15 — lnga pa bsTan 'dzin grub mchog rdo rje, cinquième Pad gling gsung sprul ( 1 724- 1 762 ) .
16 — gnyis pa rGyal dbang Btsan 'dzin grags pa, deuxième Pad gling gsung sprul (1536-1597).
17 — bdun pa Ngag dbang chos kyi bio gros, septième Padgling gsung sprul (1819-1 842 ) .
18 — rig 'dzin Khams gsum yongs sgrol, lama contemporain du premier roi du Bhoutan auquel il conseilla de faire faire la statue de Guru rin po che du temple de sKu rjes (Kuje) à Bum thang. Il était aussi le disciple du grand 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (1820-1892).
19 — dbu mdzad Grub pa kun 'dus, disciple direct de Padma gling pa.
20 — chos rje sNa tshogs rang grol (1494-1570), disciple direct de Padma gling pa et première réincarnation du gter ston Ratna gling pa (1403-1479)31.
21 — brgyad pa Kun bzang bstan pa'i nyi ma, huitième Padgling gsung sprul (1843-1891?), né au Bhoutan, dans la famille du gTam zhing chos rje et oncle maternel du premier roi du Bhoutan.
22 — drug pa bsTan pa'i rgyal mtshan, sixième Pad gling gsung sprul (1763-1817).
Ces peintures restaurées sur ordre de la Grand-Mère Royale A lce Phun tshogs chos sgron (Ashi Phuntsho Chogron) auraient donc probablement été exécutées pour la première fois à la fin du XIXe siècle puisque la lignée des réincarnations de Padma gling pa s'arrête au huitième gsung sprul et que tous les personnages historiques représentés ont vécu avant la fin du siècle dernier.
Le premier étage
Dans la galerie du premier étage (fig. 22), on trouve sur le mur de gauche des peintures récentes des Mille Buddha suivies des vingt et une Tara (G).
Le mur extérieur du chemin de circumambulation porte des peintures récentes des Trois Corps du Buddha, le dharmakâya Amitâbha, le sambhogakâya Avalokiteçvara et le nirmânakâya Padmasambhava (Guru rin po che) (H). Ce sont de simples figures finement dessinées en lignes jaunes sur fond rouge, procédé courant au Bhoutan pour représenter les Trois Corps32.
Sur le mur intérieur, on voit le cycle de sâdhana appelé bSam pa Ihungrub (I) (fig. 23) extrêmement populaire chez les rNying ma pa, dans lequel treize formes de Guru rin po che sont représentées33. La série s'achève par les Quatre-vingt-quatre Mahâsiddha dans un paysage de collines verdoyantes (J). Cette
Fig. 22. Plan du premier étage (dressé par J. Maseland).
Fig. 23. Peinture du chemin de circumambulation du premier étage: une partie du cycle de bSam pa lhun grub.
"l Se|:~ — — — ■ "-" "~"^
27
r#s&,v.. -v^.tiî •
! -^btf- i ^i% 1:^- ■.'; rN^- rr
Fy. 24. Peinture de la cella </m premier étage: Fadma ghng pa. 'Jigs med glmg pa, Klong chert rab byams pa, le huitième gsung sprul et le premier rDo grub rin po che.
série est difficile à dater. Son charme naïf pourrait faire penser à des peintures anciennes, mais comme nous ignorons sur laquelle des trois versions du cycle de bSam pa Ihungrub elles se fondent, nous manquons de références pour en fixer la date avec certitude.
La partie droite de la galerie continue la série des Mille Buddha commencée sur la partie gauche (G).
Le côté ouest de la galerie est occupé par le mgon khang(K) dont la porte est encadrée par des peintures de Vajrapâm et Guru drag dmar.
Le mgon khang, comme souvent au Bhoutan est interdit à la visite34 mais on sait qu'il est dédié à la divinité protectrice Tsi'u dmar po35 dont le masque rouge orné du miroir est accroché dans le temple du premier étage. Lors de la fête annuelle, ce masque est porté pendant la danse de Tsi'u dmar po par un moine en habit de chos skyong.
La cella du premier étage est dédiée à Amitâyus dont la statue orne le saint des saints.
Le mur de droite de l'antichambre (L) est illustré d'une peinture du Buddha primordial Samantabhadra entouré des quatre bodhisattva et de plusieurs lamas rNying ma pa dont Kong sprul Blo gros mtha' yas (1813-1899) et 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (1820-1892).
Le mur de gauche (M) porte une peinture de Vajrasattva entouré des quatre autres bodhisattva.
Une très intéressante représentation de plusieurs lamas de la lignée de transmission du rDzogs chen orne le panneau immédiatement à droite du sanctuaire intérieur dans l'antichambre (N) (fig. 24). On y voit :
1 — Padma gling pa (1450-1521), en haut à gauche. 2 — 'Jigs med gling pa (1730-1798), en haut à droite.
28
3 — Klong chen rab 'byams pa (1308-1363), au centre. 4 — Le huitième Pad gling gsung sprul Kun bzang bstan pa'i nyi
ma (1843-1891), en bas à gauche. 5 — Le premier rDo grub rin po che 'Jigs med phrin las 'od zer
(1745-1821), en bas à droite.
D'après le style orné, la qualité de la peinture légèrement brillante très employée au Bhoutan à cette époque et surtout grâce à l'identification des personnages historiques, on peut dater les peintures de cette cella de l'extrême fin du XIXe siècle. Le huitième Pad gling gsung sprul étant le dernier figuré sur cette peinture, on peut se demander si le neuvième, bsTan 'dzin chos kyi rgyal mtshan (1894-1925) était né, ou tout du moins s'il n'était pas encore un petit enfant puisqu'il ne figure nulle part dans les peintures du temple.
Les peintures du vestibule du rez-de-chaussée peuvent être datées de l'époque de la construction du temple c'est-à-dire des années 1501-1505, en revanche, les peintures des deux cellae datent de la fin du XIXe siècle. Cependant si l'importance artistique des peintures anciennes l'emporte sur tout le reste, les peintures tardives des deux cellae présentent un intérêt tibéto- logique majeur. Elles montrent parfaitement les lignées religieuses selon la tradition de Padma gling pa qui était encore jusqu'à aujourd'hui fort mal connue et elles prouvent qu'il est difficile de comprendre un personnage historique dans la culture tibétaine sans prendre en considération tous les autres personnages historiques ou légendaires de sa lignée.
Le temple de gTam zhing occupe donc une place de premier plan non seulement dans l'histoire de l'art tibétain mais aussi dans l'histoire religieuse puisqu'il est l'un des derniers endroits où la tradition de Padma gling pa se perpétue de nos jours.
Tous nos remerciements vont au slob dpon Padma lags. Directeur de la Bibliothèque nationale du Bhoutan et moine rNying ma pa qui a bien voulu éclairer des points obscurs.
Notre plus vive gratitude va également au yongs 'dzin Tshe brtan, « l'âme » du monastère de gTam zhing et l'héritier de la tradition de Padma gling pa. Il a consacré beaucoup de temps et de patience en visitant avec nous le temple et, comprenant parfaitement l'intérêt que nous portions à gTam zhing, nous a fourni nombre de renseignements inestimables.
1. A notre connaissance, B.C. Olschak est le seul auteur qui ait donné une description, sommaire certes, de ce monastère et qui en ait reproduit certaines peintures. Cf. B.C. Olschak, 1979, pp. 104- 106. M. Ans mentionne à plusieurs reprises gTam zhing sans néanmoins entrer dans les détails. Cf. M. Ans, 1979, pp. 38, 103, 163-164. Pour la localisation exacte de ce monastère. Cf. également M. Aris, 1979, p. 4 map 2 et B.C. Olschak, 1979, p. 41. Après la rédaction de cet article, nous avons eu connaissance de l'article de Detlef I. Lauf dans lequel il a étudié brièvement quelques-unes des peintures de ce monastère (surtout celles du rez-de-chausée) : « Vor- liufiger Bericht ùber die Geschichte und Kunst einiger Iamaitischer Tempel und Klôster in Bhutan III» dans Ethnologische Zeitschnft, 1975, II. Dans plusieurs cas, son identification des figures diffère de la nôtre. En effet, il a identifié les figures sans tenir compte de la particularité de l'iconographie qui est propre à la tradition de Padma gling pa, ce qui est une entreprise vouée à l'échec. 2. Pour la liste complète de cette lignée de rein- carnations. Cf. Y. Imaeda, 1984, p. 315, note 32.
3. Voici la liste des réincarnations de cette lignée : 1) Thugs sras Zla ba rgyal mtshan (1499-?). 2) Nyi zla rgyal mtshan (?-?). 3) Nyi zla klong yangs (?-?). 4) bsTan 'dzin 'gyur med rdo rje (1641-?). 5) 'Gyur med mehog grub dpal 'bar (1701-?). 6) bsTan 'dzin chos kyi nyi ma (1756-?). 7) Kun bzang 'gyur med rdo rje (1777-?). 8) Kun bzang zil gnon bzhad tshal (?-?). 9) Thub bstan dpal 'bar (1906-1939).
10) Theg mehog bstan pa'i rgyal mtshan (né en 1939). En plus du Pad gling gsung sprul et du Pad gling thugs sras, il existe une troisième lignée de réincarnations dans la tradition de Padma gling pa, les sGang steng sprul sku résidant au monastère de sGang steng dans les Montagnes Noires. Cf. Aris, 1979, pp. 163-164.
4. Cette autobiographie qui fut complétée par son disciple rGyal ba don grub est intitulée Bum thanggter ston pa padma gling pa 'i rnam thar 'od zer kun mdzes nor bu 'iphreng ba zhes by a ba skal Idan spro ba skye ba 7 tshul du bris pa. Elle se trouve dans le volume Pha (14) (254 fol., pp. 3-5 10) du Zabgterchos mdzad « le Grenier des enseignements religieux des trésors révélés profonds».
5. Bla ma bsang sngags, 1983, pp. 99-117, 224- 230.
6. B.C. Olschak mentionne ces rideaux en mailles de fer (Icags khrab). 1979, pp. 105 et 108 et en reproduit une photo, p. 107.
7. Cf. M. Aris, 1979, pp. 164- 165 où il donne l'une des versions qui a cours aujourd'hui.
8. M. Aris, 1979, p. 163-164.
9. Al Ferrari, 1958, p. 139, note 393. 10. M. Aris, 1979, p. 310, note 20. 11. G. Tucci, 1973, p. 91. 12. R. de Nebesky-Wojkowitz, 1975, p. 281. 13. Id., p. 28. 14. Id., p. 114 = Çing bya can. 15. Le septième Karma pa eut une activité consi
dérable dans le sud du Tibet et fut même, selon certains, le médiateur entre les Nagas et les Bhouta- nais. Il avait un respect particulier pour Guru rin po che et eut également une activité de gter ston. Cf. KL Thinley, 1980, pp. 83-87 et Douglas et White, 1976, pp. 69-72.
16. Dans la tradition du rDzogs chen qui est le véhicule le plus élevé des rNying ma pa, 'Jam dpal bçes gnyan est le disciple direct légendaire de dGa' rab rdo rje et son héritier spirituel. 17. Dans la tradition du rDzogs chen, dGa' rab rdo rje est le premier des « détenteurs de sagesse » (rig 'dzin) qui reçut l'enseignement du Buddha Vajra- sattva.
18. A partir de ces peintures, le yongs 'dzin Tshe brtan fait toujours précéder le nom des divinités de «Pad gling» indiquant ainsi qu'on se trouve dans la tradition iconographique propre à Padma gling pal
19. Ces deux figures sont appelées dans la tradition rNying ma pa « Kun bzang zhi khro » i.e. la forme paisible du Buddha primordial Samantabhadra (tib. Kun tu bzang po) et sa forme terrible. En réalité sa forme terrible a une iconographie si proche de Vairocana que les deux semblent ne faire qu'un. Ce point reste à discuter ultérieurement.
20. Forme nang grub « intérieure » de Yama (tib. gÇin rje). Cf. R. de Nebesky-Wojkowitz, 1975, p. 82.
29
21. Vajrapâm «terrible» avec 5 garuda. En tibétain: Phyag na rdo rje gtum po khyung lnga.
22. Mahâkâla sous sa forme mGon po ma ning. Il est sous cette forme, et avec Ekajarî et Râhu, une des grandes divinités protectrices des rNying ma pa.
23. Dans le Pad gling zabgter chos mdzod, on trouve les sâdhana (sgrub thabs) pratiqués aujourd'hui. Toutefois, les sâdhana des volumes Kha dédiés aux Guru mtshan brgyad. Ga aux dPa' bo et aucun des volumes Cha et Da ne sont exécutés de nos jours.
Les sâdhana toujours pratiqués sont les suivants : Texte Titre Vol. Kha 14 Tshe dpag med yang gsang 'od kyi drva
ba'iphyi sgrub. 1 5 Tshe dpag med yang gsang 'od kyi drva
ba 'i nang sgrub. 1 6 Tshe dpag med yang gsang 'od kyi drva
ba 'i gsang sgrub. 39 gÇin rje'i sgrub thabs. 69 rNam sras mdung dmar can gyi nor sgrub
'khor lo'i nm pa. Vol. Ga 10 Bla ma drag po'i rta mgnn gyi sgos
sgrub. 1 1 Guru drag po 'i phyag rdor sgos sgrub. 12 Guru drag po'i mkha' 'gro'i rtsa sgrub. 13 Guru drag po yakça nag po me dbal sgos
sgrub. 14 Guru drag po'i khyung gi sgos sgrub. 15 Guru drag po 7 sdig pa 'i sgos sgrub. Vol. Nya 16 Tshe lha Inga'i sgrub thabs. Vol. Ta 12 Dregs p a kun 'dut gyi 'dzam lha dmar
po'i sgrub thabs. Vol. Na 14 rTa mgnn dpa 'bo gcig pa'i sgrub thabs
rtsa ba. 18 Pad gling gter by on rta nag lha Inga'i
sgrub thabs kyi nm pa mams. VoL Ma 12 sNying thig yang gsang spu gri 'bar ba'i
sgrub thabs. 29 rDo rje phur pa'i glo bur brdung las by or
tshul du sgrub pa'i thabs. Vol. Dza 14 Bla ma nor bu rgya mtsho'i yang gsang
skor dgu 'i nang tshan las phag mo yang
folios
209-210 211-213 215-217 553-560 913-930
67-68 69
71-73 75-77 79-81 83-84
159-176
95-103
169-237 273-280
157-159 357-367
gsang bla med kyi dbang gi mtshams sbyor dbang sgrub dang bcas pa thabs ces pad tshal kun nos bzhad pa'i nyin byed. 335-373 24. J.C. Huntington, 1968, pp. 109-114. 25. G. Tucci, 1980, p. 203, fig. 79. 26. Ces Huit Manifestations ayant été décrites de
nombreuses fois, nous ne nous y attarderons pas. Cf. Pommaret-Imaeda, 1983, p. 25 et Huntington, 1986, pp. 53-55.
27. Comme le Buddha suprême peut s'incarner dans les cinq jina, Padmasambhava se manifeste en cinq thod phreng, littéralement « guirlandes de crânes», différents qui correspondent chacun à une direction et un aspect de son activité.
28. Les dpa' bo « héros » sont des personnages de l'entourage de Guru rin po che qui confèrent des pouvoirs extraordinaires. Ils gardent les quatre directions: car lest, Ihol sud, nubl ouest, byangl nord.
29. gsang yum: littéralement «partenaire secrète » désigne la compagne d'un lama tantriste qui exécute certains rituels avec lui.
30. On remarque un problème chronologique : la date de naissance (1308) de Kun mkhyen Klong chen rab 'byams pa est antérieure de huit ans à la date de la mort (1316) de Padma las 'brel rtsal dont il est la réincarnation immédiate. Sur ce problème qui n'est pas tranché, cf. Smith, 1978.
31. Cf. Khetsun Zangpo, vol. 3, pp. 723-724. 32. Pour une reproduction en noir et blanc de la
peinture de ces Trois Corps du Buddha, cf. B.C. Ols- chak, 1979, p. 106.
33. Le cycle de bSam pa Ihun grub est un gter ma dont la première découverte remonte à Ri khrod pa bZang po grags pa (quatorzième siècle), gter ston du Le'u bdun ma et contemporain de Rig 'dzin rGod Idam (1337-1409). La deuxième découverte fut faite par Mnga' ris Pan chen Padma dbang rgyal (1487-1542) et la dernière, la plus populaire au Bhoutan est celle de mChog 'gyur gling pa (1829-1870).
34. B.C. Olschak a reproduit trois peintures qui se trouvent à l'intérieur du mgon khang : Cf. pp. 1 04, 105 et 107.
35. Cf. Nebesky-Wojkowitz, 1975, pp. 166-176.
Bibliographie
Aris, Michael, Bhutan. The early history of a Himalayan kingdom. Warminster, 1979.
Bla ma gsang sngags, 'Brug gi smyos rabs gsal ba'i me long. Thimphu, 1983.
Dargyay, Eva, The rise of esoteric Buddhism. Delhi, 1979.
Douglas, N. et M. White, Karmapa, the black hat lama of Tibet. London, 1976.
Ferrari, A., Mkhyen brtse's guide to the holy places of central Tibet. Roma, 1958.
Huntington, J.C., The styles and stylistic sources oj 'Tibetan painting. PhD, University of California, Los Angeles, 1968.
Idem. « Notes on the Iconography and Iconology of the Paro Tsechu Giant Thang-ka», in Orientations July 1986, pp. 51-57, 74.
Imaeda, Y. « Memento chronologique (bstan-rtsis) du calendrier bhoutanais », dans Tibetan and Buddhist Studies Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Kbrôs, vol. 1, Budapest, 1984, pp. 303-319.
Khetsun Zangpo (= mKhas btsun bzang po). Biographical dictionary of Tibet. Vol. III. Dharamsala, 1973 (en tibétain).
Nebesky-Wojkowitz, R. de.. Oracles and demons of Tibet. Graz, 1975. (Première édition: The Hague, 1956).
. Olschak, B.C., Ancient Bhutan. A Study on Early Buddhism in the Himalayas. Zurich, 1979.
Pal, P., Tibetan paintings. London, 1984. Padma gling pa, Zab gter chos mdzod/ The Recovered
Teachings of the Great Pema Lingpa. 22 vols. Thimphu, 1976.
Pommaret-Imaeda, F. (= Tashi Wangmo), Paro Tsechu Programme. Department of Tourism Royal Government of Bhutan. Thimphu, 1983.
Sangyay Tenzing (Khempo) et Gomchen Oleshey, The Nyingma Icons. (Solu Khumbu), 1985 (en tibétain).
Smith, E.G., «Preface» in Mkha' 'gro snying thig. 2 vols. Sumra Kinnaur Distt. H.P., 1978.
Thinley, K., The History of the Sixteen Karmapas of Tibet. Boulder, 1980. Tucci, G., Indo-Tibetica. Roma, 1932-41.
Idem., Tibetan Painted Scrolls. Tokyo, 1980 (Première édition: Roma, 1949).
Idem., Transhimalaya. Geneva, 1973.
The gTam zhing monastery in Central Bhutan
The gTam zhing lHun grub chos gling monastery is situated in the Chos 'khor valley in the Bum thang region of Central Bhutan. It was founded by the famous gter ston « treasure- discoverer» Padma gling pa (1450-1521) at the very beginning of the sixteenth century. Since 1959, it became the residence of the two lineages of reincarnation of Padma gling pa tradition : the Pad gling gsung sprul, reincarnation of Padma gling pa, and the Pad gling thugs sras, that of Zla ba rgyal mtshan ( 1499-?), son of the gter ston. Thus it is an important centre of teachings of Padma gling pa tradition of the rNying ma pa school of Tibetan Buddhism.
Moreover, this small monastery presents a particular interest in the general history of Tibetan art. In fart some paintings of the ground floor date from the very foundation of the monastery and miraculously escaped from being retouched or repainted. There is a certain similarity of style between them and those of gTsang in Tibet, particularly those of rGyal rtse which are chronologically and geographically very close. One can admire for the first time the hitherto little studied iconography which is peculiar to the great « treasure-discoverer » of Bhutanese origin.
30