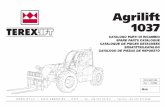Le phénomène eurosceptique au sein du parti conservateur britannique
-
Upload
u-bourgogne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Le phénomène eurosceptique au sein du parti conservateur britannique
Article paru dans Politique Européenne, n° 6, 202, pp. 53-76.
Le phénomène eurosceptique au sein du Parti conservateur britannique1
Agnès Alexandre-Collier
Au lendemain de la ratification du traité de Maastricht, l'euroscepticisme au sein du Parti conservateur se définit non seulement comme un discours à l'égard de l'intégration européenne mais également comme un comportement parlementaire distinct.
En tant que discours, l'euroscepticisme, fondé sur les valeurs thatchériennes du libéralisme économique et de l'indépendance nationale, s'articule autour de la défense du nationalisme, de la démocratie et du libéralisme.
Du point de vue du comportement parlementaire, les "rebelles" eurosceptiques s'appuient sur toutes les ressources et stratégies disponibles, pour se mobiliser dans un vaste mouvement, dont la puissance aboutira à la défaite du parti aux élections de mai 1997 et juin 2001 et à la victoire, dans l'opposition, des attitudes eurosceptiques incarnées par le nouveau dirigeant, Iain Duncan Smith.
Le traité d'Union Européenne signé en février 1992 a donné naissance, au sein du Parti
conservateur britannique, à un courant d'opposition aux principes d'union politique et
monétaire et à la politique européenne du gouvernement de John Major, élu en avril de la
même année. Au sein de la Chambre des Communes, ce mouvement fut initié par un groupe
de députés qui ont voté contre la ratification du traité malgré les consignes de leur propre
parti. Ces députés furent également appelés eurosceptiques.
Notre étude a pour objectif de définir le phénomène eurosceptique au sein de ce parti,
non seulement comme un discours mais également et surtout comme un comportement
parlementaire. La spécificité de cette attitude, fondée sur un mélange de nationalisme et de
fondamentalisme idéologique, réside dans sa capacité à mettre en péril la cohésion partisane
et la performance électorale du Parti conservateur, dans un contexte politique déstabilisant du
fait de la nature de l'organisation partisane, de la procédure parlementaire de ratification du
Traité de Maastricht, et des circonstances défavorables, en particulier la courte majorité dont
disposait le parti à la Chambre des Communes. Il s'agira donc de montrer à la fois l'origine de
ce phénomène eurosceptique et ses répercussions sur l'organisation partisane, ou comment le
comportement eurosceptique, simple tendance intra-partisane devenue véritable faction, a
favorisé l'émergence d'un clivage beaucoup plus puissant que les autres en raison de sa propre
dynamique de mobilisation à l'échelle nationale, fondée sur une multitude de ressources et de
stratégies. Par conséquent, l'importance du phénomène eurosceptique au sein du Parti
1 Cet article est tiré de la thèse de doctorat de l'auteur (2001).
1
conservateur serait moins liée à la nature de l'enjeu européen, souvent considéré comme
générateur de factionnalisme qu'à la force intrinsèque de cet "euroscepticisme".
Malgré un usage de plus en plus courant de ce néologisme, la genèse du terme est
difficile à situer. On peut cependant formuler certaines hypothèses. Les éditions les plus
récentes des dictionnaires français semblent faire coïncider l'origine du phénomène
"eurosceptique" avec la création de l'Union Européenne au début des années 1990. C'est le cas
du Petit Larousse publié en 1997 qui y fait explicitement référence : "Personne qui doute de la
viabilité ou de l'utilité de la construction de l'Union Européenne". L'anglais situe toutefois la
naissance du terme "Eurosceptic" à une période antérieure à 1992. Dans son dictionnaire des
mots nouveaux2, Sara Tulloch cite un article du Times datant du 30 juin 1986, qui utilise le
terme pour qualifier la façon dont l'attitude de Margaret Thatcher vis-à-vis de l'Europe fut
perçue3. Selon elle, c'est vraisemblablement le débat sur l'enjeu européen qui a contribué, dans
la seconde moitié des années 1980, à la chute de l'ancien Premier ministre. Ainsi, l’expression
"eurosceptique" est initialement apparue au Royaume-Uni dans les années 1980 pour désigner
les partisans de Margaret Thatcher avant que son emploi ne soit généralisé.
Si l'on se fie strictement à l'épisode de la ratification du traité de Maastricht, le
comportement parlementaire des députés conservateurs ajoute une nouvelle dimension aux
définitions courantes de l'euroscepticisme. Le cas du Parti conservateur constitue en effet un
objet de recherche distinct, qui ne se réduit pas à une simple question de sentiment, de
perception, ou de discours à l'égard de l'Union Européenne. Au sein du groupe parlementaire,
le phénomène eurosceptique se traduit initialement par l'indiscipline de vote de certains
députés conservateurs sur de nombreux projets de lois liés à l'Union Européenne, à
commencer par la ratification du traité de Maastricht4, et aboutit parfois à un engagement
politique au sein d'organisations ou de groupes anti-Maastricht. L'indiscipline de vote
constitue donc le socle de cette mobilisation, c'est-à-dire le trait d'union entre l'opinion et
l'engagement. Selon le nombre des acteurs5 impliqués, cette "rébellion" parlementaire peut
aboutir à la scission du parti en deux, voire en plusieurs groupes d'attitudes à l'égard de
2 Tulloch Sara (1996). The Oxford Dictionary of New Words. A popular guide to words in the news. Oxford, Oxford University Press, p. 105-107.3 "Mrs Thatcher is seen in most of the EEC as a Euro-sceptic at best". In : Owen Richard, "Thatcher, still the sceptic in Europe", The Times, 30/06/86, p. 9.4 Sur chaque vote soumis aux consignes gouvernementales, les volumes des débats parlementaires (Hansard) nous fournissent la liste de ceux qui franchissent cette limite et constituent ainsi l'instrument de mesure le plus efficace de la rébellion parlementaire.
2
l'intégration européenne en fonction des votes auxquels les députés ont été soumis. Ainsi
posé, le problème de l'euroscepticisme soulève la question du conflit au sein d'une
organisation partisane et des clivages intrapartisans. En d'autres termes, le phénomène
eurosceptique pose la question du factionnalisme ou inversement de la cohésion intra-
partisane que Kenneth Janda définit comme "le degré de congruence dans les attitudes et
comportements des membres de parti"6.
L'état des recherches sur les clivages internes du Parti conservateur
Pour reprendre la double caractéristique définie par Kenneth Janda, les travaux
antérieurs réalisés sur les clivages internes du Parti conservateur ont abouti à deux types de
typologies : celles centrées sur la dimension idéologique7 et celles centrées sur la dimension
comportementale. Les premières reposent généralement sur une analyse historique ou
politique s'inspirant d'archives et de documents bibliographiques. Celle que proposent Philip
Norton et Arthur Aughey (1981) a abouti à la construction de six catégories de Conservateurs8
spécifiquement axées sur l'idéologie susceptibles de caractériser indifféremment chaque
période de l'évolution du Parti, depuis 1945. Les auteurs postulent que "pour être utiles, elles
(les attitudes) ne peuvent être étudiées que dans leur contexte (particulier)" (p. 55). L'enjeu de
l'intégration européenne n'intervient donc que comme variable conjoncturelle ou contextuelle
qui ne modifie en rien les catégories structurelles de cette typologie. D'autres typologies,
construites sur la base de ces travaux, tiennent compte de cette donnée. Celle de Whiteley,
5 Par opposition aux 7 députés conservateurs (soit seulement 2% du groupe parlementaire) qui avaient défié les consignes de Margaret Thatcher en votant contre l'Acte Unique Européen en troisième lecture, on identifie ainsi, sous le gouvernement de Major, 47 Conservateurs (soit environ 14% des 331 députés du groupe parlementaire) qui se sont rebellés au moins une fois contre la progression actuelle de l'Union Européenne, qu'il s'agisse de la ratification du traité de Maastricht ou des votes ultérieurs imposant l'application de directives émises par la Commission Européenne. Certes, le choix d'un seul vote comme critère ne suffit pas. En revanche, la récurrence du vote indiscipliné constitue un témoignage pertinent de l'ampleur de l'action eurosceptique. Ainsi, au sein du Parti conservateur, 21 députés, soit seulement 6,4 % de l'ensemble du groupe, se sont rebellés de façon constante et systématique lors du processus de ratification.6 Janda Kenneth (1980), Political Parties: A Cross National Survey, New York, The Free Press, p. 118.7 L'adjectif "idéologique" ne renvoie pas au débat complexe sur la définition et les différentes connotations du terme "idéologie". Cependant, une remarque s'impose sur l'application de ce terme au Parti conservateur. Il faut en effet souligner le danger de construire des catégories idéologiques au sein d'un parti qui privilégie l'expérience et le pragmatisme à la doctrine et réfute officiellement son appartenance à une quelconque idéologie. Comme l'expliquent David Baker, Andrew Gamble et Steve Ludlam, "le Conservatisme britannique a évolué selon une tradition de diplomatie politique où les doctrines abstraites étaient subordonnées à une combinaison de réalités gouvernementales (la politique du pouvoir) et de réalités électorales (la politique du soutien)". In : "Mapping Conservative Fault Lines : problems of typology", article présenté au Congrès annuel de UK Political Studies Association, Swansea, mars 1994, p. 2.8 "Le conservatisme pessimiste (Pessimistic Torysm), le conservatisme paternaliste (Pate.rnalistic Torysm), le conservatisme progressiste (Progressive Torysm), le conservatisme combatif (Combative Torysm), la cinquième catégorie fondée sur les principes whig (Corporate Whiggery) et le néolibéralisme (Neo-liberalism). Aughey et Norton (1981, p. 53-89).
3
Seyd et Richardson (1994, p. 185-203), en particulier, synthétise les six catégories de Norton
et Aughey pour ne retenir que trois traditions essentielles, qui sont apparues tout au long de la
période contemporaine à des degrés plus ou moins forts : le traditionalisme, le conservatisme
progressiste et l'individualisme (Whiteley et al., 1994, p. 190). Cette étude introduit un
élément nouveau qui consiste à analyser l'idéologie conservatrice en termes d'enjeux
politiques contemporains. C'est pourquoi, les divisions du Parti sur la question de l'intégration
européenne tiennent une place non négligeable mais elles ne sont analysées en fait qu'à la
lumière du thatchérisme. Les résultats de cette recherche aboutissent en effet à l'idée que les
attitudes à l'égard de la Communauté Européenne qui sont répertoriées comme "indices du
traditionalisme" (traditionalism indicators), peuvent être utilisées comme le plus fiable
instrument de prédiction des attitudes à l'égard de Margaret Thatcher.
Le second type de typologie est apparu en 1964, lorsque Richard Rose (1964, p. 33-
46) publie une étude axée non pas sur les idées mais sur les comportements des députés ou
des membres d'un parti. Il classifie ainsi les formes d'organisation des divisions intra-
partisanes, en distinguant les factions (selon lui, caractéristiques du Parti travailliste), les
tendances (propres au Parti conservateur) et les partisans non-alignés. Contrairement à la
faction qu'il définit comme "un groupe d'individus fondé sur des représentants du Parlement
qui cherchent à développer un large éventail de politiques grâce à une activité politique
consciemment organisée", la tendance est un "ensemble stable d'attitudes, plutôt qu'un groupe
stable de politiciens. Elle peut être définie comme un faisceau d'attitudes exprimées au
Parlement sur une large gamme de problèmes" (p. 37). Privilégiant la structure des
subdivisions aux dépens de leur contenu idéologique, Rose aboutit en fait à une typologie
axée sur le clivage "gauche-droite" qui a inspiré de nombreux autres politologues. Dans les
années 1990, Patrick Dunleavy (1993) démontre que les sentiments favorables ou
défavorables à l'Europe sont incompatibles avec cette tendance des typologies à s'inspirer de
l'axe gauche-droite et suggère ainsi la nécessité de reformuler ce type de classement, du fait
de l'importance qu'a revêtu cet enjeu depuis l'épisode de la ratification du traité de Maastricht.
Utilisant des instruments quantitatifs de mesure plus complexes, les typologies
"comportementales" fournissent généralement des catégories bien plus détaillées que les
précédentes mais pas toujours plus aptes à rendre compte des dissensions du Parti autour de la
question de l'intégration européenne. En effet, si elles s'appuient sur l'étude du comportement
parlementaire des députés au moment du vote, elles ne tiennent pas compte de la diversité de
leurs attitudes individuelles vis-à-vis de l'Europe. Toutefois, l'étude de Samuel Finer et al.
(1961) puis les typologies de Philip Norton, (1990 a et b), en se fondant sur la signature de
4
motions ou l'indiscipline de vote, complétées par des entretiens avec les acteurs du parti,
accordent une place relativement importante à la nature des sujets de discorde mais elles ne
portent pas spécifiquement sur les questions européennes. Ainsi, un rapide bilan de ces
travaux nous montre que la dimension européenne y tient une place dérisoire, voire nulle. Elle
est intervenue parfois comme indice de prédiction ou facteur d'explication mais jamais
comme objet de recherche. En outre, l'inaptitude des typologies dites "idéologiques" à prendre
en compte cet aspect montre que la plupart des politologues continuent à le concevoir comme
un élément d'explication du comportement parlementaire plutôt que comme un facteur de
division idéologique proprement dit.
Au début des années 1990, certains observateurs ont proposé leur propre classification
des attitudes conservatrices à l'égard de l'intégration européenne qui commençait à faire l'objet
d'une abondante littérature. Citons, parmi d'autres, la typologie de Nigel Ashford (1992, p.
119-148) qui distingue six groupes d'attitudes à l'intérieur du Parti conservateur : les
fédéralistes (Federalists); les pro-européens de bon sens (Common-sense Europeanists); les
modernisateurs conservateurs (Tory modernisers); les néo-libéraux partisans de l'économie de
marché (Free market neo-liberals); les gaullistes conservateurs (Tory Gaullists) et enfin les
opposants au Marché Commun (Anti-marketeers). Si l'on se fie exclusivement à cette
classification réalisée avant la ratification du traité de Maastricht, les détracteurs de l'idée
européenne n'appartiennent qu'à la dernière catégorie citée, éventuellement à l'avant-dernière.
A l'inverse, la typologie proposée par Michael Spicer (1992, p. 166-185) donne le sentiment
que les eurosceptiques sont majoritaires au sein du Parti conservateur : on retrouve les
opposants au Marché Commun (anti-Common Marketeers) auxquels s'ajoutent les
constitutionnalistes (Constitutionalists), les patriotes (Patriots), et enfin les partisans de
l'économie de marché (Marketeers) essentiellement opposés à une Union monétaire
européenne. Ces typologies donnent finalement une certaine indication des principaux enjeux
qui structurent les attitudes à l'égard de l'intégration européenne mais leur intérêt reste limité.
On s'aperçoit en effet qu'elles ne résultent d'aucune méthode empirique particulière et ne sont
le fruit que d'une simple observation a priori du Parti conservateur. Ainsi dès 1992, une
équipe de trois chercheurs (Baker David, Gamble Andrew et Ludlam Steve, 1993 a et b, 1994,
1995, 1999), tentant de concilier les deux dimensions idéologiques et comportementales, a
choisi d'élaborer une typologie non pas des différentes tendances mais des différentes
dissensions qui ont lieu au sein du Parti conservateur. Les chercheurs ont finalement élaboré
un repère doté d'une abscisse "gouvernement étendu" / "gouvernement minimal" et d'une
5
ordonnée "interdépendance" / "souveraineté" dans le but de l'appliquer aux dissensions à
l'égard de l'intégration européenne quelles que soient les allégeances partisanes.
Il résulte de ces recherches que le phénomène eurosceptique au sein du Parti
conservateur n'a jamais été étudié en tant que tel mais toujours dans le cadre de travaux plus
généraux sur les clivages intrapartisans. S'appuyant sur la double dimension idéologique et
comportementale que nous avons déjà évoquée, notre étude s'inscrit toutefois dans la lignée
de ces travaux antérieurs. Tout en isolant le phénomène eurosceptique des autres attitudes à
l'égard de l'intégration européenne, elle repose sur une double approche du sujet qui
examinerait à la fois le contenu de l'euroscepticisme, en cherchant à identifier la nature des
enjeux impliqués et des arguments utilisés, et la forme qu'il a pu revêtir dans ce contexte
précis, en apparaissant comme un type de comportement parlementaire spécifique visant à
influencer l'action du gouvernement.
Après avoir exploré les origines de ce phénomène au sein du Parti conservateur, nous
l'étudierons dans cette double dimension statique et dynamique afin de mieux comprendre
l'impact qu'il a pu avoir sur la défaite électorale du parti en 1997 et les douloureux efforts de
reconstruction qu'il accomplit actuellement.
Les origines de l'euroscepticisme conservateur
Sous sa forme actuelle, l'euroscepticisme apparaît comme l'aboutissement d'une
évolution qui suit étroitement celle de la construction européenne. Si l'opposition
conservatrice à l'idée européenne reste, jusque dans les années 1970, confinée à un groupe
d'irréductibles qui bénéficiaient du charisme d'Enoch Powell, et dirigée contre le Marché
Commun, l'euroscepticisme contemporain, quant à lui, puise ses racines dans le thatchérisme.
En effet, celui-ci s'incarne notamment dans le discours de Bruges du 20 septembre 1988
(Holmes, 1996)9 qui offre aux eurosceptiques du parti une vision économique et politique de
la Grande-Bretagne beaucoup plus large, dans laquelle s'insère harmonieusement leur propre
conception de l'Europe. Les valeurs de l'indépendance nationale et de la liberté symbolisées
pour l'ancien Premier ministre par les principes de libéralisme économique, semblent
parfaitement résumer la substance de l'argumentation eurosceptique.
D'autres éléments contribuent à entériner l'hypothèse des multiples liens existant entre
euroscepticisme et thatchérisme, concernant notamment l'origine et la rhétorique de ces deux
phénomènes. L'allégeance thatchérienne est explicitement formulée par certains acteurs en
9 Voir l'analyse du discours de Bruges par Robin Letwin Shirley (1992). Anatomy of Thatcherism, Londres, Fontana, 377 p.
6
termes de complicité eurosceptique. Toutefois, elle apparaît plus clairement encore dans la
confrontation entre la typologie élaborée par Philip Norton (1990a) et la liste des rebelles
eurosceptiques. Parmi les nombreux votes ou motions contre le traité sur l'Union Européenne,
prenons à titre d'exemple l'adoption du traité de Maastricht en troisième lecture, le 20 mai
1993. En examinant les listes de noms des 41 députés conservateurs qui ont voté contre et que
nous avons identifiés comme eurosceptiques, nous pouvons en effet constater, à la suite de
David Baker et al. (1993a, p. 160) qu'une majorité d'entre eux se situent à la droite du parti.
Parmi ces députés et à l'exception des députés élus en 1992 et qui par conséquent ne figurent
pas sur la liste de Norton, quatorze d'entre eux appartiennent à la catégorie des thatchériens
(Thatcherite). Aux côtés des thatchériens se situent les loyalistes (Party Faithful) dont on
trouve cinq représentants parmi nos eurosceptiques. Selon Norton, ces loyalistes regroupent
des députés attachés au style gouvernemental de Margaret Thatcher (Thatcher Loyalists) sans
pour autant partager scrupuleusement ses positions, ainsi que des fidèles du parti (Party
Loyalists) qui manifestent une loyauté de façon relativement constante mais non systématique
au dirigeant du parti. Parmi les rebelles, on compte également quatre populistes (Populists),
qui sont "opposés ou sceptiques à l'égard de la Communauté Européenne" et dont les
positions sont plutôt à droite en ce qui concerne la peine capitale ou l'immigration et à gauche
sur les questions économiques et sociales. Enfin, il n'y a parmi les eurosceptiques qu'un seul
modéré (wet). Philip Norton définit les "wets" et les "damps" comme deux sous-groupes de la
catégorie des députés critiques à l'égard du gouvernement de Margaret Thatcher (Critics). A
une exception près, donc, les critiques sont définis comme favorables à l'intervention étatique
et à la Communauté Européenne. Quelle que soit la motion ou le vote anti-Maastricht auquel
il est fait référence, la confrontation entre la liste des eurosceptiques et la typologie de Philip
Norton aboutit à l'idée que la majorité des députés hostiles à l'Union Européenne revendique
sa fidélité au thatchérisme.
L'adéquation entre euroscepticisme et thatchérisme n'est toutefois pas dénuée
d'ambiguïté. Pour la plupart des eurosceptiques, qui n'ont jamais accepté l'éviction de
Margaret Thatcher10, l'attirance qu'ils éprouvent pour le thatchérisme correspond à une forme
de nostalgie à l'égard d'une période qui semble révolue et que Paul Taggart identifie comme
"l'âge d'or du conservatisme" (1996b, p. 14). Le paradoxe est que le thatchérisme a été perçu
10 La thèse du complot organisé par les pro-européens pour la remplacer à la tête du parti est l'argument le plus répandu parmi les eurosceptiques comme en témoigne cet entretien avec le député John Wilkinson (bureau de Londres, 20/02/95) : "It was a plot against the Lady. If the truth was known!…It was a plot organised very well by Garel-Jones, the two Pattens, Mellor, Lamont, who had waited for that big opportunity to bring the Lady down. They all had in their minds the jobs they wanted and they were all rewarded when John Major got into power".
7
en son temps comme une sorte de révolution dans différents domaines, du moins "une rupture
par rapport à l'époque du consensus d'après-guerre" (p. 14). De la même façon, cette fidélité
aux principes fondateurs du conservatisme qui caractérise l'euroscepticisme apparaît comme
une nostalgie similaire pour l'identité partisane originelle. L'euroscepticisme ne caractérise
pas vraiment les courants extrêmes d'un parti, comme certains observateurs ont pu le
suggérer11, mais reflète plutôt un certain "fondamentalisme" idéologique. De ce point de vue,
un parallèle avec la France peut s'avérer instructif. Au moment du référendum du 20
septembre 1992 sur la ratification du traité de Maastricht, les membres du R.P.R. qui ont
milité pour le "non" ont souvent été identifiés à ce qu'on appelle parfois le "gaullisme
historique", ce que Florence Haegel corrobore en évoquant le thème du "retour aux sources"12.
Quant au parti de Philippe de Villiers, il incarnait selon Jean-Louis Schlegel, les "valeurs de
l'enracinement"13, autant d'expressions qui confirment l'idée selon laquelle l'euroscepticisme
constituerait une version parmi d'autres de la substance originelle d'une idéologie partisane.
Dans le cadre théorique plus général des clivages partisans, cette hypothèse n'est pas si
éloignée de celle développée récemment par Gary Marks et Carole J. Wilson (2000) qui
démontrent que "le nouvel enjeu de l'intégration européenne s'insère dans les idéologies pré-
existantes des leaders, des militants et des circonscriptions de partis qui reflètent leurs
positions durables sur des enjeux nationaux fondamentaux" (p. 433). Autrement dit, le lien
entre l'attitude du parti à l'égard de l'intégration européenne et ses fondements et
positionnements idéologiques se vérifie. Prenant le cas des partis conservateurs, les auteurs
expliquent le scepticisme à l'égard de l'intégration européenne par un "conflit courant entre les
nationalistes et les néo-libéraux sur l'avenir de l'Union européenne, qui aboutit à un équilibre
précaire et une ambiguïté rhétorique destinée à éviter de coûteuses dissensions politiques et
l'impression d'une discorde interne" (p. 457).
Certaines théories du nationalisme fournissent également un cadre explicatif adapté au
discours eurosceptique. Nous faisons référence en particulier à l'approche primordialiste14 qui
constitue le pendant de l'idée de "fondamentalisme" doctrinal précédemment évoquée à
11 C'est notamment le cas de David Baker et al. (1993a) pour reprendre notre dernière citation de ces auteurs sur l'appartenance des rebelles à la droite du Parti conservateur.12 Haegel Florence (1990). "Mémoire, héritage, filiation. Dire le gaullisme et se dire gaulliste au R.P.R.", Revue Française de Science Politique, 40(6), p. 864-879.13 Schlegel Jean-Louis (1995). "Philippe de Villiers ou les valeurs de l'enracinement". Esprit, février 1995, n° 209, p. 54-67.14 Pour un examen plus détaillé de cette approche, voir :
Jaffrelot Christophe (1991). "Les modèles explicatifs de l'origine des nations et du nationalisme". In : Delannoi Gil et Taguieff Pierre-André. Théories du nationalisme. Paris, Editions Kimé, p.154-161.
8
propos de l'identité partisane. L'euroscepticisme véhicule en effet un discours sur la primauté
de l'identité nationale qui postule la nation comme "donnée" prioritaire et la prégnance de ce
lien primordial (primordial tie)15 au même titre que la race, le langage, la région, la religion.
Orientation des attitudes et arguments eurosceptiques
Ayant réalisé entre 1994 et 1996 une trentaine d'entretiens auprès de députés
conservateurs ayant voté contre la ratification du traité de Maastricht, nous avons constaté que
les arguments eurosceptiques se structurent autour de trois stratégies16. La première consiste à
rejeter le principe de l'intégration européenne qui préside à la construction politique de
l'Europe pour défendre la souveraineté nationale, qui s'exprime à travers ses symboles (le
Parlement - "the mother of parliaments" - la monnaie, l'armée) et ses ennemis (le
fédéralisme17 - ou "F-word" pour certains eurosceptiques - l'Allemagne18 et dans une moindre
mesure la France). La deuxième stratégie vise à condamner les aspects "technocratiques" des
institutions communautaires, en particulier le déficit démocratique, tout en cherchant à
préserver et à promouvoir le modèle démocratique britannique. Enfin la troisième stratégie
consiste à critiquer la dimension sociale de l'Union Européenne en s'engageant dans la
défense opiniâtre des valeurs du libéralisme économique19. Parallèlement, la rhétorique
eurosceptique ne cherche guère à dispenser des remèdes. Parmi les quelques propositions
avancées par les députés eurosceptiques, la conception de l'"Europe des patries" remporte un
franc succès. D'autres acteurs privilégient plutôt la dimension économique pour préconiser la
création d'une vaste zone de libre-échange, en conformité avec leurs principes libéraux.
D'autres, enfin, souhaitent plutôt favoriser les échanges avec les pays anglophones, en
particulier les Etats-Unis, voire tout simplement quitter l'Union Européenne.
Sur la base des trois axes autour desquels s'articulent les arguments eurosceptiques, à
savoir la défense du nationalisme, de la démocratie et du libéralisme, le discours
15 Geertz Clifford (1963). "The integrative revolution – primordial sentiments and civil politics in the new states". In : Geertz C.(dir). Old Societies and New States. Londres, The Free Press of Glencoe, p. 109.16 Pour une analyse plus détaillée, voir Alexandre-Collier Agnès (2001), Chapitre 4 "Les arguments eurosceptiques".17 Comme l'explique le député conservateur John Butterfill (Chambre des Communes, 24/02/94) : "Federal in English means a relatively decentralised state with most decisions being taken locally and it is understood wrongly in England to mean a unitary and centralised state".18 Voir l'interview de l'ancien secrétaire d'Etat à l'Industrie, Nicholas Ridley qui dénonça "a German racket to take over Europe" in : "Saying the Unsayable about the Germans", The Spectator, 14/07/90.19 "A Single Currency and Conservatism are mutually exclusive. They are a contradiction in terms. Conversely a Single Currency and socialism are not. In the hands of socialists a Single Currency would be more powerful, more dangerous and more destructive than Clause 4 ever was!", in : Gill Christoher MP (1995), Speaking Out on Europe. Bruges Group Occasional Paper n°18, p. 6.
9
eurosceptique révèle une fois de plus une extrême fidélité aux principes fondateurs du
conservatisme. Ces trois axes recouvrent les deux dimensions de l'intégration européenne
traditionnellement dissociées dans les approches théoriques, notamment dans celle de Gary
Marks et Carole J. Wilson (2000) sur les attitudes partisanes à l'égard de l'intégration
européenne : l'intégration politique qui postule que "l'Union européenne est devenue partie
intégrante d'un système politique à plusieurs niveaux (multi-level polity) dans lequel les
institutions européennes partagent le pouvoir avec les gouvernements nationaux et infra-
nationaux dans une multitude de domaines" (p. 436) et l'intégration économique, illustrée par
le marché unique et l'Union économique et monétaire. Dans cette perspective,
l'euroscepticisme découlerait de la tension extrême qui existe entre les tendances nationalistes
et néo-libérales qui caractérisent le Parti conservateur et dont l'issue ne peut être que son
implosion.
Les logiques de l'action collective eurosceptique
La notion de "phénomène" eurosceptique pour caractériser le cas du Parti conservateur
s'explique surtout par les prodigieuses capacités d'organisation dont ont fait preuve les
acteurs. Pour reprendre la terminologie mise au point par John D. McCarthy et Zald Meyer
(1987, p. 18-20), théoriciens de la mobilisation des ressources, leur logique d'action a reposé
sur des soutiens individuels et organisationnels (support base) et des stratégies et tactiques
spécifiques. Au moment de la ratification du traité de Maastricht, les ressources des
eurosceptiques ont été principalement médiatiques et financières comme en témoignent le rôle
joué par les journaux20 du groupe Murdoch ou le pouvoir exercé par des hommes d'affaires
tels que James Goldsmith ou Paul Sykes. Quant à leurs soutiens, ils provenaient
essentiellement des organisations partisanes locales, d'autres députés ou de membres du
gouvernement qui ont tenté d'user de leur influence et de leur pouvoir de négociation au sein
du Cabinet pour défendre la cause eurosceptique auprès des dirigeants. Mais les
eurosceptiques ont puisé l'essentiel de leurs forces dans la multiplication des associations et
groupes de pression qui se sont créés pour lutter contre la ratification du traité de Maastricht.
On peut ainsi remarquer qu'à la différence de la France, par exemple, où l'action ponctuelle
des eurosceptiques, notamment au moment du référendum du 20 septembre 1992, a nécessité
la création d'organisations éphémères, en Grande-Bretagne, en revanche, l'activité
20 Sur ce sujet, voir Wostyn David (1999). La perception par la Presse britannique de la ratification parlementaire du Traité de Maastricht au Royaume-Uni, Mémoire de DEA sous la direction de Michael Palmer, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 104 p.
10
eurosceptique a été nettement stimulée par l'existence d'une vingtaine de groupes21 qui, pour
la plupart, n'ont pas disparu après leur création22. L'importance du Groupe de Bruges, de
Campaign for an Independent Britain, de European Foundation de William Cash et de
formations politiques tels que United Kingdom Independence Party n'a cessé de croître. Dans
le contexte du prochain référendum sur la monnaie unique, notamment, ces organisations
continuent de jouer un rôle crucial même si certaines d'entre elles ont changé de nom.
L'ampleur des ressources et l'étendue des soutiens eurosceptiques ont toutefois compensé
certaines carences comme leur relative faiblesse numérique et l'absence de dirigeant capable
de prendre la tête de ce mouvement.
Pendant la ratification du traité de Maastricht, les députés eurosceptiques ont
également disposé au sein de la Chambre des Communes de toute une gamme de stratégies
semblables à celles que Robert J. Jackson (1968, p. 292-307) avait énumérées pour décrire les
principales étapes du processus de rébellion parlementaire : la formation d’une coalition par
des députés liés par une communauté de pensée, l’action de rébellion proprement dite qui peut
être privée (par exemple, le recours à des méthodes extra-parlementaires comme la
publication de pamphlets), semi-privée (comme le dépôt ou la signature de motions, et dans
une certaine mesure, l’abstention) ou publique (comme le vote indiscipliné).
Parallèlement, ces multiples stratégies mises en œuvre par les eurosceptiques pour
faire échouer la ratification du traité ont contraint les chefs de file du parti à adopter des
mesures disciplinaires, allant de la convocation impérative (ou three-line whip, qui signifie
que la référence au projet est soulignée trois fois et que le député a affaire à une discipline de
vote maximale) à la dissuasion collective en passant par l'intimidation individuelle,
notamment le risque de démission forcée, de retraite anticipée, de suspension ou d'exclusion
forcée (withdrawal / resignation of the whip) (Jackson, 1968, p. 201-252). En dépassant
parfois le cadre de la bienséance23, les dirigeants se sont aperçus que les moyens de pression
traditionnels ne suffisaient pas toujours, comme en témoigne l'exclusion d'un de ces députés,
Rupert Allason, du groupe parlementaire, sanction qui n'avait pas été utilisée depuis un demi-
siècle.
Si l'on se fie à la définition de Richard Rose (1964, p. 33-46), l'euroscepticisme
conservateur apparaît, en termes de structure, comme un mouvement qui réunit toutes les
21 Voir l'enquête par questionnaire réalisée auprès de ces groupes, in Alexandre-Collier Agnès (2001), chapitre 6, "Les ressources des acteurs".22 Ces associations sont actuellement toutes répertoriées sur le site Internet : http://www. keele.ac.uk/socs/ks40/gbcrit.htm23 Voir le témoignange accablant de l'un des députés "rebelles" : Gorman Teresa MP (1993).
11
caractéristiques de la faction : la pérennité, l'organisation et la volonté de développer toute
une gamme de politiques au-delà des questions européennes. A la différence de la tendance
qui a traditionnellement caractérisé les dissensions internes du groupe parlementaire
conservateur, la faction se définit comme "un groupe d'individus fondé sur des représentants
du Parlement qui cherchent à développer un large éventail de politiques grâce à une activité
politique consciemment organisée" (Rose, 1964). Au lendemain de la ratification du traité de
Maastricht, c'est cette définition qui semble désormais s'appliquer à l'organisation du parti de
John Major et qui a permis la réorientation du parti vers une position nettement eurosceptique
sous William Hague.
A l'issue de cet épisode, les eurosceptiques ont profité, malgré leur échec, de la position
difficile du gouvernement, accrue par la courte majorité parlementaire, pour poursuivre une
action dont les effets ont été effectivement destructeurs pour l'organisation partisane.
Concrètement, la radicalisation de leur action a atteint son paroxysme dans l'exclusion
temporaire de neuf députés conservateurs qui avaient ignoré les consignes gouvernementales
concernant un vote du 28 novembre 1994 sur la contribution britannique au budget
communautaire. Certains pro-européens de la première heure ont même apporté leur soutien à
ces "dissidents", comme l'ancien Chancelier de l'Echiquier, Norman Lamont, qui figure
désormais parmi les eurosceptiques les plus virulents. Après la réélection, à la tête du Parti
conservateur, de John Major qui avait dû démissionner le 22 juin 1995 pour réaffirmer son
autorité, les élections générales de mai 1997 traduisent une nouvelle défaite du leader
conservateur devant la puissance de la mobilisation eurosceptique. Plusieurs facteurs
contribuent à précipiter cet échec : la création du Referendum Party par James Goldsmith qui
dispose de moyens financiers prodigieux pour élaborer sa campagne24; l'extrême
euroscepticisme, teinté de xénophobie, de certains jeunes candidats conservateurs25; une
diabolisation caricaturale du parti travailliste26; la désaffection croissante de certains organes
de presse qui apportaient traditionnellement leur soutien au parti de John Major; comme ceux
du groupe de Rupert Murdoch, notamment The Sun ou The Times, et enfin le désintérêt de
24 Pour plus d'informations sur le Referendum Party, voir : Carter Neil, Evans Mark, Alderman Keith et Gorham Simon (1998). "Europe, Goldsmith and the Referendum Party". Parliamentary Affairs, 51 (3), p. 470-485.25 Voir les propos du candidat Rupert Matthews pour la circonscription de Bootle : "For generations, the people of Bootle have fought to keep Britain free and independent. Now powerful people in the Establishment want to sell out and push Britain into a Federal Europe… Don't let them go away with it". Cité par : Critchley Julian et Halcrow Morrison (1997). Collapse of Stout Party. Londres, Victor Gollancz, p. 151. 26 Voir l'affiche électorale publiée à l'été 1996 par le Parti conservateur reproduisant une photographie de Tony Blair, aux yeux rouges et diaboliques, accompagnée du slogan "New Labour, New Danger".
12
l'opinion publique pour une campagne conservatrice trop exclusivement centrée sur l'enjeu
européen, comme l'indiquait par exemple un sondage MORI qui en octobre 1996 révélait que
seulement 22% des électeurs conservateurs considéraient l'Europe comme le sujet de
préoccupation le plus important27. L'alternance a ainsi donné lieu à la victoire, dans
l'opposition, des attitudes eurosceptiques qui ont trouvé un représentant sous les traits du
nouveau dirigeant du parti et fidèle partisan de Margaret Thatcher, William Hague.
La radicalisation eurosceptique du parti sous William Hague
En matière européenne, William Hague s'est immédiatement positionné comme un
Conservateur modéré de centre droit qui cherche à séduire les rebelles eurosceptiques sans
pour autant effrayer les loyalistes du parti (Turner, 2000, p. 241). Cet esprit de conciliation a
été rapidement assimilé à une certaine inconsistance qui n'a pas empêché le nouveau leader de
se lancer dans une nouvelle entreprise de mobilisation des ressources eurosceptiques. La
nouvelle orientation de son discours est apparue comme la première étape de cette démarche.
C'est d'abord sur la question de l'adoption d'une monnaie unique que son discours s'est mis à
évoluer. Il opta initialement pour une politique radicale qui exclut l'adoption de l'euro pour
très longtemps voire pour toujours. Quelques jours plus tard, il décida d'exclure le mot
"never" de son vocabulaire et de réduire cette période indéterminée à trois ou quatre décennies
: "because I do not know, déclara-t-il, in 30 or 40 years' time if we will be in a radically
different Europe or have a radically different proposition for a single currency, but I do know
that the principled objections I have to a single currency will hold good for a very long
time"28. Enfin, il réunit le cabinet fantôme qui prit une décision définitive, limitant l'exclusion
de la monnaie unique à 10 ans. En novembre 1997, il déclara devant le patronat britannique :
"We oppose Britain joining a single currency during the lifetime of this parliament and we
intend to campaign against British membership of the single currency at the next election"
(Hague, 1997b). C'est donc en appliquant cette politique attentiste que William Hague,
influencé par un environnement partisan de plus en plus eurosceptique, a progressivement
dessiné les contours de sa position européenne.
Dès lors, William Hague ne tardera à délaisser l'Union Economique et Monétaire pour
s'intéresser désormais à l'Europe politique. L'attitude du leader conservateur envers la
monnaie unique évoluera en effet vers une vision politique plus globale qui sera présentée
sous sa forme la plus accomplie dans le discours de Budapest, émaillé de références sous-
27 "Bogeyman in Brighton", The Economist, 19/10/96, p. 41.28 Hague William, Today Programme, BBC Radio 4, 12 juin 1997.
13
jacentes aux grands noms du parti, indices du fondamentalisme idéologique qui définit
l'euroscepticisme. Ce discours fut prononcé le 13 mai 1999 et reste, aujourd'hui encore, bien
connu dans les milieux conservateurs pour ses accents éminemment thatchériens, et pour cette
formule récurrente et d'inspiration churchillienne, cette fois-ci, qui deviendra le slogan
européen du parti : "in Europe but not run by Europe". On se souvient de la fameuse
expression de Winston Churchill prononcée en 1953 à la Chambre des Communes : "We are
in Europe but not of it"29.
Le lien de William Hague avec Margaret Thatcher ne s'arrête pas aux propos tenus par
le jeune homme devant son idole au congrès du Parti conservateur de 1977. Pour commencer,
le discours de Budapest rappelle étrangement le discours de Bruges prononcé onze ans plus
tôt par l'ancien Premier ministre et qui allait servir de texte fondateur aux eurosceptiques du
parti30. Tout comme Thatcher qui présenta à Bruges une vision européenne fondée sur le
libéralisme économique et l'indépendance nationale. Hague conclut son discours de Budapest
en évoquant trois principes fondamentaux autour desquels s'articule sa propre conception
européenne : la liberté, la démocratie et l'indépendance nationale. C'est en ces termes qu'il
s'adressa à son public hongrois : "Yours was a revolution made in the name of liberty, of
democracy and of national independence. And, as Europe enters the next century, I hope we
shall seek to organise our affairs on the basis of these same precepts. (…) These values are
not just Hungarian or British; they are truly European values". Margaret Thatcher elle-même,
reconnaissant la filiation, accorda son soutien indéfectible à son fidèle disciple: [Hague],
déclara-t-elle, "stands for the things I believe in – above all he offers a clear vision of Britain
as a free, sovereign nation with control over its own affairs"31.
On peut donc affirmer que la victoire de William Hague est celle du minimalisme
thatchérien car sa vision, loin d'être nouvelle, repose en fait sur une appropriation de valeurs
thatchériennes désormais prédominantes au sein du Parti conservateur et qui se sont
progressivement imposées comme le reflet de l'identité partisane originelle, comme nous
avons tenté de le démontré précédemment. C'est cette vision que Philip Lynch définit comme
"an authoritarian, individualist perspective, primarily associated with Thatcherite
conservatism, which views enterprise, individual liberty and state authority as the key
attributes of British identity" (Lynch, 2000, p. 66).
29 Cette conception avait déjà été exprimée bien avant par Winston Churchill dans un article du Saturday Evening Post datant du 15 février 1930. 30 Discours de Bruges, 20 septembre 1988, in Holmes, 1996.31 Thatcher Margaret, The Guardian, 19 juin 1997.
14
Au-delà du discours, William Hague chercha à s'attirer les soutiens. Ceux des
militants, tout d'abord, lui permirent d'asseoir la légitimité de sa position sur une base qui, si
elle ne partageait pas ses opinions sur l'Europe, avait au moins la réputation avantageuse
d'être extrêmement fidèle à la position de son dirigeant. C'est dans cet esprit que Hague décida
d'organiser, le 5 octobre 1998, un sondage sur la monnaie unique auprès des 300 000 militants
du parti. Si l'on se fie à la capacité de William Hague à mobiliser des soutiens, l'issue de cette
consultation (84,4% d'opposition à la monnaie unique) était prévisible, ce qui explique que
certains commentateurs actuels prévoient une dérive définitive vers une position
eurosceptique claire, officielle et quasi-unanime.
Enfin, dans la perspective d'une future élection à la tête d'un gouvernement
conservateur, William Hague chercha à mobiliser les soutiens des électeurs et de l'opinion
publique. Or, dans ce domaine, ces soutiens se sont avérés particulièrement ambivalents : il
semble qu'il existe en effet une contradiction flagrante entre d'un côté, l'opposition claire et
croissante de l'opinion publique britannique à la monnaie unique qui conforte ainsi
l'orientation adoptée par le Parti conservateur et de l'autre, la désaffection de l'électorat
conservateur à l'égard de son propre parti et de son leader. A la question suivante "Dans un
référendum, voteriez-vous pour ou contre le remplacement de la livre sterling par une
monnaie unique européenne ?", un sondage récent réalisé par l'institut MORI les 22 et 23 juin
2000 affichait une opposition de 64%, toutes préférences partisanes confondues alors que ce
chiffre avoisinait les 48% deux ans auparavant. Toutefois, lorsque la formulation des
questions est différente, les résultats le sont également : s'il subsiste une minorité de
Britannique favorables à l'adoption de l'euro, 58% d'entre eux préféreraient "organiser un
débat public avant de décider ou non d'adopter une monnaie unique après un référendum"
(57% d'électeurs conservateurs et 63% de travaillistes). Le plus intéressant est que la
proposition de William Hague d'exclure la monnaie unique pendant au moins dix ans ne
suscite que 10% d'approbation au sein de l'opinion publique et seulement 14% chez les
électeurs conservateurs. Parallèlement, les soutiens de l'opinion publique au Parti
conservateur et à son leader s'avèrent très limités puisque le même sondage indique que 47%
des Britanniques se disent prêts à soutenir le Parti travailliste contre seulement 34% pour les
Conservateurs. Quant à William Hague, lui-même, il n'est approuvé que par 32% des
personnes interrogées contre 43% pour Tony Blair.
La mobilisation des ressources médiatiques et organisationnelles ont constitué l'autre
élément-clé de cette démarche. William Hague a pu compter sur l'appui relatif de la presse et
des différentes organisations eurosceptiques qui se sont constituées depuis la ratification du
15
traité de Maastricht. La plupart des journaux comme le Daily Mail, le Daily Express et le
Daily Telegraph ont manifesté leur soutien à la politique de William Hague contre l'Union
Economique et Monétaire, à l'exception du Sun qui depuis les élections de 1997 semble
persister à soutenir Tony Blair malgré une profonde hostilité à l'euro. Certains commentateurs
(Butler et Westlake, 1999, p. 135-137) ont même souligné le rôle déterminant de la presse
dans le succès des Conservateurs aux élections européennes de 1999.
William Hague a pu également compter sur le soutien inconditionnel de la multitude
d'organisations qui se sont créées dans la mouvance de la campagne contre la ratification du
traité de Maastricht, en particulier celles qui font actuellement campagne contre l'euro comme
For Sterling!, Business For Sterling, Save the Pound, Domesday ou encore Euroland. La
campagne du Parti conservateur, officiellement lancée par William Hague le 15 février
dernier, repose elle-même sur un slogan - Keep the Pound - qui ressemble fort au nom de l'un
de ces groupes d'influence - lesquels se déclarent pourtant apolitiques - semant ainsi le doute
et la confusion dans l'esprit des électeurs conservateurs. Aux élections européennes de juin
1999, certains conservateurs eurosceptiques n'ont pas hésité à radicaliser leur position en
appelant à voter contre leur propre parti, en faveur du United Kingdom Independence Party,
groupuscule minoritaire qui revendique quelques sièges au Parlement de Strasbourg. Ceci
n'empêcha pas le Parti conservateur d'apparaître comme le grand vainqueur de ces élections,
remportant 36% des voix contre 28% pour les travaillistes et 12,7% pour les libéraux-
démocrates, preuve éclatante pour William Hague que sa politique de radicalisation
eurosceptique commençait à porter ses fruits. Du point de vue stratégique et tactique, pour
reprendre toujours la terminologie de McCarthy et Meyer (1987), la démarche du leader
conservateur a essentiellement reposé sur une double stratégie d'élimination des principaux
ténors pro-européens et de réhabilitation des eurosceptiques au sein du Cabinet fantôme. En
1997, il nomma Michael Howard aux Affaires Etrangères, Peter Lilley aux Finances et John
Redwood comme porte-parole de l'opposition dans le domaine de l'Industrie32 tandis que les
pro-européens John Gummer et Kenneth Clarke furent réduits au statut de simples députés.
Plus récemment, le grand retour de Michael Portillo, qui fut réélu le 25 novembre 1999 après
la mort du député Alan Clarke, puis nommé Chancelier de l'Echiquier au sein du Cabinet
fantôme en février 2000 témoignait d'une volonté de doter le parti d'une nouvelle coloration
fortement eurosceptique33.
32 Pour la composition du Cabinet fantôme, voir entre autres : "Hague hands out shadow jobs to just three women", The Guardian, 25/06/97.33 "William the unflappable", The Economist, 05/02/2000, p. 38.
16
Dans le même esprit, William Hague n'hésita pas à inscrire cette nouvelle coloration
dans un cadre plus autoritaire en imposant une contrainte de vote maximale (three-line whip)
pour obliger les députés à voter contre le traité d'Amsterdam en juin 1997, inversant ainsi
littéralement la stratégie politique de son prédécesseur John Major. Edward Heath fut le seul
Conservateur à transgresser la consigne.
Cette vaste mobilisation des ressources eurosceptiques qui consiste à rallier le parti
autour d'une position eurosceptique quasi-unanime ne permit ni de remporter les élections, ni
d'en restaurer la cohésion, puisque certains pro-européens continuent d'y exercer leur
influence. La radicalisation eurosceptique ne fut pas une stratégie payante pour le parti dont la
nouvelle défaite électorale du 7 juin 2001 ne fit qu'accélérer un processus d'implosion qui
devint impossible à gérer pour le jeune leader, comme en témoigne sa démission en
septembre de la même années. L'élection du nouveau leader refléta cruellement les divisions
du parti sur l'enjeu européen puisqu'il s'agissait de choisir entre Kenneth Clarke, une des
figures de proue du parti, pro-européen convaincu mais dont la position européenne est loin
de faire l'unanimité au sein du parti et Iain Duncan Smith, eurosceptique notoire qui avait fait
ponctuellement campagne pour le retrait du pays de l'Union Européenne, bref un représentant
fidèle des attitudes majoritaires à l'égard de l'Europe mais susceptible, à terme, de menacer
l'avenir du pays au sein de l'Union. Le choix final vint confirmer l'hypothèse d'une
radicalisation eurosceptique du parti, inquiétante à l'approche d'un référendum sur l'euro,
puisque le 13 septembre 2001, Iain Ducan-Smith fut élu avec 61% des voix contre 39% pour
son adversaire.
Les effets destructeurs du phénomène eurosceptique se sont non seulement manifestés
dans la défaite électorale du parti aux élections de mai 1997 et de juin 2001 mais dans son
incapacité actuelle à se reconstruire dans l'opposition. Aussi bien dans sa forme que dans son
contenu, l'euroscepticisme a imposé une nouvelle structuration du parti qui se juxtapose
désormais à l'axe gauche-droite. D'un point de vue comparatif, cette structuration caractérise
actuellement certains partis européens, parmi lesquels on pourrait citer le R.P.R. Il semble en
effet que l'enjeu européen soit devenu incontournable dans l'étude d'une organisation
partisane.
Au-delà du Parti conservateur, cette étude a surtout permis de faire ressortir certains
traits dominants de l'euroscepticisme contemporain qui pourraient s'appliquer à bien d'autres
cas, à commencer par les partis dits "souverainistes" qui émergent au moment des élections au
17
Parlement européen. S'appuyant sur un "discours des origines" qui allie une défense de la
primauté de la nation et des principes fondateurs d'une idéologie partisane, l'euroscepticisme
apparaît globalement comme une combinaison de "primordialisme" national et de
"fondamentalisme" partisan. Tel que nous le concevons dans cette étude, l'euroscepticisme
n'est pas seulement une attitude ou un discours mais il est aussi un comportement et une
démarche reposant sur un réseau de ressources variées et engageant une palette de stratégies,
dont l'objectif prioritaire – l'opposition à une union européenne politique, économique et
monétaire – se superpose à d'autres motifs de mécontentement et dont les effets clivants sont
potentiellement destructeurs.
Dès lors, analyser l'euroscepticisme devrait surtout permettre de mieux comprendre les
crises identitaires que traversent nos pays européens à l'heure du passage à la monnaie unique,
au moment où ils s'efforcent de préserver leur identité nationale face au défi de la
mondialisation, autrement dit de concilier leur histoire et leur avenir.
18
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVEBIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
Alexandre-Collier Agnès (1997). "L'enjeu européen dans les élections générales de mai 1997
en Grande-Bretagne". Revue Française de Civilisation Britannique, IX (3), p. 163-172.
Alexandre-Collier Agnès (2001). L'"euroscepticisme" au sein du Parti conservateur
britannique (1992-1997), sous la direction de Monica Charlot et Pascal Perrineau, Institut
d'Etudes Politiques de Paris, 1998. Lille, Presses Universitaires du Septentrion.
Alexandre-Collier Agnès (2002, à paraître). La Grande-Bretagne eurosceptique ? L'enjeu
européen dans le débat politique britannique, Paris, Editions du Temps.
Anderson Peter J. et Weymouth Anthony (1999). Insulting the Public ? The British Press and
the European Union. Londres & New York, Longman, 230 p.
Ashford Nigel (1992). "Political Parties", in : George Stephen. Britain and the European
Community : the politics of semi-detachment. Oxford, Clarendon Press, p. 119-148.
Aughey Arthur et Norton Philip (1981). "Varieties of Conservatism" (chapitre 2).
Conservatives and Conservatism, Londres, Temple-Smith, p. 53-89.
Baker David, Gamble Andrew, Ludlam Steve (1993a). "Whips or Scorpions ? The Maastricht
vote and the Conservative Party". Parliamentary Affairs, 46 (2), p. 151-166.
Baker David, Gamble Andrew, Ludlam Steve (1993b). "1846...1906...1996 ? Conservative
splits and European integration". The Political Quarterly, 64 (4), p. 420-434.
Baker David, Gamble Andrew, Ludlam Steve (1994). "The Parliamentary Siege of Maastricht
1993 : Conservative Divisions and British Ratification". Parliamentary Affairs, 47 (1) : p. 37-
60.
Baker David, Fountain Imogen, Gamble Andrew, Ludlam Steve (1995). "Backbench
Conservative Attitudes to European Integration". Political Quarterly, 66 (2), p. 221-233.
Baker David, Seawright David (dirs.) (1998). Britain For and Against Europe. British
Politics and the Question of European integration. Oxford, Clarendon Press, 252 p.
Baker David, Gamble Andrew, Seawright David (1999). "MPs and Europe : Enthusiasm,
Circumspection or Outright Scepticism", British Elections and Parties Review, volume 9, p.
171-185.
Baker David (2001). "Britain and Europe : the argument continues", Parliamentary Affairs,
54 (2), p. 281.
Beloff Lord (1996). Britain and the EU. Dialogue of the deaf. Londres, Macmillan, 172 p.
19
Buller Jim (2000). National Statecraft and European Integration. The Conservative
Government and the European Union (1979-1997). Londres & New York, Pinter, 190 p.
Bulpitt Jim (1992). "Conservative leaders and the 'Euro-ratchet' : five doses of scepticism".
Political Quarterly, 63 (3), p. 258-275.
Butler David, Kavanagh Dennis (1997). The British General Election of 1997. Londres,
Macmillan, 1997, 343 p.
Butler David, Westlake Martin (1999). British Politics and European Elections. Londres,
Macmillan, 271 p.
Cash William (1991). Against a Federal Europe : the battle for Britain. Londres, Duckworth,
138 p.
Cash William (1992). Europe : The Crunch. Londres, Duckworth, 64 p.
Conservative Party (1997). You Can Only Be Sure with the Conservatives. The Conservative
Manifesto 1997. Londres, Conservative Central Office, 56 p.
Conservative Party (2001). Time for Common Sense. The Conservative Manifesto 2001.
Londres, Conservative Central Office.
Dunleavy Patrick, Gamble Andrew, Holliday Ian, Peele Gillian (1993). Developments in
British Politics 4. Londres, Macmillan, 408 p.
Evans Geoffrey & C.R.E.S.T (1996). Euroscepticism and Conservative Support (1992-96) :
How an Asset became a Liability. Social and Community Planning Research & Nuffield
College. Working Paper Series n°55, 15 p.
Finer Samuel, Berrington Hugh, Bartholomew D.J. (1961). Backbench Opinion in the House
of Commons (1955-59). Oxford, Pergamon Press, 219 p.
Garry John (1995). "Divisions over European Policy in the British Conservative Party". West
European Politics, 18 (4), p. 170-189.
George Stephen (1998). An Awkward Partner : Britain in the European Community. Oxford,
Oxford University Press, 3ème édition, 298 p.
Gorman Teresa (1993). The Bastards : Dirty Tricks and the Challenge to Europe. Londres,
Pan Books, Sidgwick and Jackson, 236 p.
Gowland David et Turner Arthur (2000). Reluctant Europeans. Britain and European
integration 1945-1998. Londres, Longman, 393 p.
Hague William (1997a). A fresh future for the Conservative Party. Londres, Conservative
Central Office, 16 p.
Hague William (1997b). Britain and the single currency. Discours prononcé à la conférence
annuelle de la CBI le 10 novembre 1997. Londres, Conservative Political Centre, 8 p.
20
Harrop Martin (2001). "An Apathetic Landslide: The British Election of 2001, Government
and Opposition, 36(3), p. 295-313.
Hill Stephen (dir.) (1993). Visions of Europe : Summing up the Political Choices. Londres,
Duckworth, 234 p.
Holmes Martin (dir.) (1996). The Eurosceptical Reader. Londres : Macmillan, 410 p.
Jackson Robert J. (1968). Rebels and Whips: an analysis of dissension, discipline and
cohesion in British Political Parties. Londres, Macmillan.
Ludlam Steve, Smith Martin J. (1996). Contemporary British Conservatism. Londres,
Macmillan, 322 p.
Lynch Philip (2000). "The Conservative Party and Nationhood", The Political Quarterly, 71
(1), p. 59-67.
Marks Gary et Wilson Carole J. (2000). "The Past in the Present: A Cleavage Theory of Party
Response to European integration", British Journal of Political Science, 30.
McAllister Ian, Studlar Donley T. (2000). "Conservative Euroscepticism and the Referendum
Party in the 1997 British General Election", Party Politics, 6 (3), p. 359-372.
McCarthy John et Meyer Zald N. (1987). "Resource Mobilization and Social Movements: a
Partial Theory" (chapitre 1), Social Movements in an Organizational Society. Collected
Essays. New Brunswick, Transaction Books, p. 18-20.
Morris Peter (1996). "The British Conservative Party". In : Gaffney John (dir.). Political
Parties and the European Union. Londres et New York, Routledge, p. 122-138.
Norton Philip (1990a). "The Lady's not for turning, but what about the rest ? Margaret
Thatcher and the Conservative Party". Parliamentary Affairs, 43 (1), p. 41-58.
Norton Philip (1990b). "Choosing a Leader : Margaret Thatcher and the Parliamentary
Conservative Party". Parliamentary Affairs, 43 (3), p. 249-259.
Preston Peter Wallace (1994). Europe, Democracy and the dissolution of Britain : an essay
on the issue of Europe in UK Public Discourse. Londres, Aldershot/Brookfield & Dartmouth,
220 p.
Redwood John (1997). Our currency, our country. Londres, Penguin, 214 p.
Robins Lynton, Blackmore Hilary, Pyper Robert (dirs.) (1994). Britain's changing party
system. Leicester University Press, 236 p.
Rose Richard (1964). "Parties, factions and tendencies in Britain". Political Studies. 12 (1), p.
33-46.
Schnapper Pauline (2000). La Grande-Bretagne et l'Europe. Le grand malentendu. Paris,
Presses de Sciences Po, 218 p.
21
Spicer Michael (1992). A Treaty Too Far. A new policy for Europe. Londres, Fourth Estate,
213 p.
Taggart Paul (1996a). "Rebels, Sceptics and Factions: Euroscepticism in the British
Conservative Party and the Swedish Social Democratic Party", Glasgow, paper presented at
the 44th Political Studies Association Conference. 11 p.
Taggart Paul (1996b). "New Populism in the British Conservative Party", Sheffield, paper
presented at the EPOP Conference, PSA. 22 p.
Thatcher Margaret (1993). The Downing Street Years. Londres, Harper & Collins, 883 p.
Turner John (2000). The Tories and Europe. Manchester, Manchester University Press, 283 p.
Whiteley Paul, Seyd Patrick, Richardson Jeremy et Bissell Paul (1994). "Thatcherism and the
Conservative Party". Political Studies. 42 (2), p. 185-203.
Wincott Daniel (1992). "The Conservative Party and Europe". Politics Review, 1 (4), p. 12-
16.
Young Hugo (1998). This Blessed Plot. Britain and Europe from Churchill to Blair. Londres,
Macmillan, 558 p.
22



























![Le Parti Commoniste — Roy Lichtenstein et l’art pop, editions Carré, Paris, 2013. [galley proof]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325ad52852a7313b70e9d1a/le-parti-commoniste-roy-lichtenstein-et-lart-pop-editions-carre-paris.jpg)